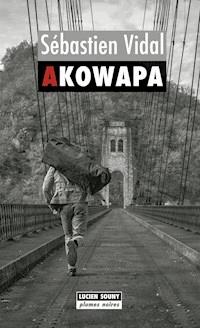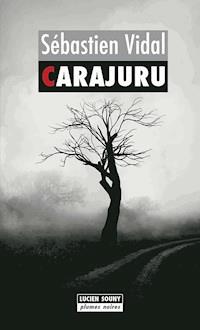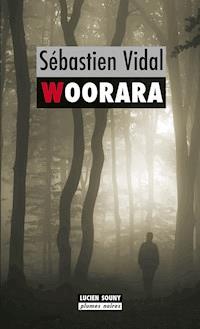
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Tatanka
- Sprache: Französisch
Une enquête entre passé et présent qui s'annonce complexe...
Un homme criblé de trois balles est découvert dans un hameau isolé, sur le plateau de Millevaches. Tout porte à croire que le travail est l’œuvre d’un professionnel. Pilotée par l’intraitable juge Laîné et le colonel Tognotti, l’enquête est confiée à un groupe de gendarmes. Parmi eux, l’adjudant Walter Brewski, une forte tête spécialiste de l’intervention.
L’équipe n’a que très peu de choses à se mettre sous la dent. La victime semble tombée du ciel ; le tueur n’a laissé aucune trace. Pas de mobile apparent ni d’arme du crime. Seule la course-poursuite engagée avec une mystérieuse berline la nuit du meurtre donne un peu d’espoir aux limiers de la gendarmerie, le nez collé à la piste poussiéreuse d’un assassin insaisissable et invisible. Sous une chaleur caniculaire, un deuxième cadavre apparaît, présentant le même modus operandi…
Parce que le présent se noue ici dans les méandres d’un passé, où couvent encore les braises de la haine et de la vengeance, l’affaire entre dans un tourbillon survolté et diabolique.
Découvrez les enquêtes de l'adjudant Walter Brewski à travers ce roman policier palpitant, qui prend pour décor les hauteurs limousines !
EXTRAIT
— On pense que le tueur est allé le chercher à l’intérieur. Il l’a fait sortir et agenouiller au sol. Ensuite, il lui a tiré trois balles : une dans le genou, une dans le buffet et une dans la tête.
— On connaît son identité ?
— Il s’appellerait Christophe Longeval, d’après son permis de conduire. Il est né en République tchèque. Il avait quarante-sept ans. Le permis a été délivré par la préfecture de Tulle il y a vingt ans.
— Il est mort depuis longtemps ?
— J’suis pas légiste, mais je pense que ça fait dans les douze heures.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Comment vous dire, voici un petit roman, un premier polar qui a su susciter mon intérêt. Des personnages bien campés. Un décor auquel on s’accroche et qui participe à l’ambiance du livre. Un crime crapuleux au milieu du plateau de Millevaches, du jamais vu, il fallait oser. Une brigade de gendarmerie et un juge que l’on suit pas à pas dans leur enquête. Bref tout est là pour nous donner un vrai bon polar mâtiné d’un soupçon de roman noir rural. - Blog Collectif polar : chronique de nuit
Ce beau roman sur la toxicité de la vengeance est aussi un hommage à une région dont l’auteur est manifestement amoureux. - Thomas Fiera, La tactique du gendarme
Belle découverte pour le premier livre que j'ai lu de cet auteur. Ce que je préfère, dans mes lectures, c'est le polar, le vrai, et j'ai retrouvé ce qui fait que j'apprécie ce genre un peu plus que les autres. - Blog Anaïs Serial Lectrice
Tous les ingrédients sont là […]. Bon cru, belle plume, belle intrigue, des frissons de peur et de plaisir, et des personnages attachants qu’on espère recroiser dans une prochaine aventure. - Dealer de lignes
Sérieux et rigoureux dans les aspects procéduraux, plein de suspens et d’humour, et surtout farci d’humanité. […] Même les méchants y sont intéressants, pleins de subtilités et de nuances. - Thomas Fiera
À PROPOS DE L'AUTEUR
S’il n’écrit pas, Sébastien Vidal lit. Il ne peut envisager de passer une seule journée sans l’une ou/et l’autre de ces activités. Fin connaisseur de la littérature américaine, il se délecte aussi avec Claude Michelet et Antoine de Saint-Exupéry. Il écrit beaucoup mais publie très peu. Woorara est son premier polar. Il tient un blog littéraire, de très bonne facture, Le Souffle des mots, qui attire un public toujours plus nombreux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Woorara désigne dans la langue des Indiens d’Amazonie une plante qui entre dans la fabrication du curare. Le curare est un anesthésiant et un poison… Comme la vengeance.
« Aucune journée ne ressemble à une autre. Chaque matin apporte un miracle particulier, le moment magique où des vieux univers sont détruits et créent de nouvelles étoiles. »
Paulo Coelho, Sur le bord de la rivière Piedra je me suis assise et j’ai pleuré
Pour ma tribu, de sang et de cœur, le clan des amis et la bande des copains, pour celles et ceux qui ne sont plus là, compagnons des souvenirs et des projets, auteurs des rires et des pleurs, témoins de ces regards et de ces silences. Merci. Vous êtes ma seule richesse.
À Michel Delpech, qui était, aussi, un sacré chanteur de « noir ».
J. 1
La radio balançait des bribes de paroles tandis que le véhicule d’intervention filait sur la route. À l’avant, le gendarme installé du côté passager tenait la radio de sa main gauche et s’accrochait comme il le pouvait à la poignée de portière. Le deux-tons hurlait et couvrait en partie les communications radio qui crachaient des mots inaudibles venus d’ailleurs. Les virages s’enchaînaient à un rythme endiablé et le pinceau des phares déchirait le rideau de la nuit en découvrant les bois, les prés, des animaux saisis en pleine vie nocturne. Leurs yeux étincelaient de surprise, grands ouverts avant de disparaître dans le néant, poursuivis par les cris de souffrance des pneus. L’adjudant Walter Brewski conduisait la Ford Focus et en tirait le maximum. Concentré, il se livrait à une véritable épreuve de rallye, bondissant d’un virage à l’autre dans le vacarme des sirènes et à la lueur perturbante du gyrophare. Le moteur diesel montait très haut dans les tours ; son vrombissement se mêlait au vacarme du deux-tons et de la radio. Comme à chaque fois qu’il utilisait un véhicule de service, Brewski avait extrait son pistolet de son étui et l’avait placé entre ses jambes, sous sa cuisse gauche, crosse offerte. Tout était fureur et décibels. Sur les ondes de service, quelqu’un hurlait des propos inintelligibles. Tout en se concentrant sur son pilotage, Walter dit calmement à son équipier :
— Dis-lui de se calmer et de ne pas crier, on ne comprend rien.
L’homme acquiesça et attendit que le brailleur, à l’autre bout de la radio, reprenne son souffle pour l’inciter au sang-froid. Quelque part dans ces collines noires comme le désespoir, à quelques kilomètres, si loin et si près, des camarades poursuivaient un véhicule de grosse cylindrée. Pires que des morpions tenaces, ils s’accrochaient au cul de la BMW sombre.
Tout avait commencé quinze minutes plus tôt, dans la moiteur d’une nuit d’été. Sur un petit axe secondaire, à un carrefour perdu au milieu de nulle part, deux gendarmes de brigade avaient décidé de procéder à un point de contrôle. Lorsqu’ils stoppèrent sur le bord de la chaussée, calant leur voiture dans un renfoncement mangé par les arbustes, ils avaient dans l’idée de rester un petit quart d’heure. Ils ne nourrissaient aucune illusion sur ce qu’ils allaient ramener dans leurs filets, échoués dans une zone oubliée du monde à l’heure où la nuit se partage, à l’intersection de deux routes à peine plus larges que leur véhicule. Leur seul espoir se résumait au passage fortuit d’un ivrogne encore assez lucide pour se savoir trop imbibé et qui aurait tenté les chemins de traverse. Tout là-haut, au-dessus d’eux, des milliers d’yeux brillaient de curiosité – la Voie lactée, cette beauté absolue que les Indiens Crows appelaient « le pont entre deux mondes ». Quelques insectes crissaient dans le sous-bois. Le son du moteur à l’arrêt, qui se refroidissait en cliquetant, posait un tempo qui fit souhaiter aux deux hommes que l’instant dure toujours. Ils avaient le sentiment que tout se résumait ici et maintenant. La vérité de l’univers rôdait dans les parages. Comme souvent à cette heure de la nuit, la radio mutique laissait juste échapper des bruits numériques, des crachotis, des gloussements synthétiques. Le halo vert pâle de son cadran éclairait avec timidité le bas du siège passager. L’un des deux gendarmes, un adjudant un peu enveloppé, colla une cigarette à ses lèvres. Comme un magicien, il fit apparaître un briquet et embrasa sa clope. Il tira fortement dessus et exhala un nuage de fumée âpre en poussant un soupir de bien-être, qui donna presque envie à son complice de se mettre à fumer. Derrière les volutes qui se dissipaient, le gradé avisa un panneau indicateur planté face à lui, de l’autre côté de la route. Avec le temps, la moitié des lettres s’en étaient allées.
Entre deux bouffées, l’adjudant méditait. Il eut envie de partager ses pensées avec son pote de galère. Il adorait ces moments de la nuit, loin de tout, du vacarme du jour, de son regard curieux qui vous déshabillait. Loin de tous ces gens assistés et dépendants des forces de l’ordre. Ceux qui ne pouvaient s’empêcher de téléphoner pour se plaindre du voisin qui pisse trop près de la clôture, de la petite jeune du deuxième qui écoute encore la musique les fenêtres ouvertes, ou de la famille de cas sociaux qui a encore trop bu et qui s’est foutu sur la gueule. Mais, un peu trop las pour faire des grandes phrases, il lâcha juste un :
— On n’est pas bien là ?
Le jeune gendarme opina et répondit comme s’il attendait cette discussion :
— Ouais, c’est clair qu’on est bien. Ça fait du bien de souffler un peu. J’espère que la fin de patrouille sera calme, je suis vanné.
Leur sacerdoce était tel qu’ils devaient se cacher dans les replis de la terre pour trouver un peu de répit. Mais le hasard se moque bien du repos des hommes de loi. Il saupoudre l’humanité de sa main imprévisible et facétieuse, puis s’assoit sur le rebord du monde, pour observer le résultat.
La cigarette de l’adjudant n’était pas encore terminée qu’un bruit de moteur leur parvint des hauteurs de la colline. Un peu plus haut dans les lacets, des phares découpaient les arbres au gré des virages.
Un peu surpris, le gradé fit voler sa luciole de papier rougeoyant, d’un claquement d’index. L’autre se pencha par la fenêtre ouverte du véhicule et attrapa une grosse lampe noire et ronde. Ils s’avancèrent vers le carrefour en empruntant le bas-côté. Le véhicule roulait doucement, il serait là dans trente secondes. Le gradé souffla :
— On attend qu’il soit bien près, et puis tu allumes la lampe et tu lui fais signe de s’arrêter. On le passe au fichier, on le fait souffler, et puis basta !
L’homme descendait la petite route dans la nonchalance, une main sur le volant et un bras replié sur la portière. Il était très détendu pour quelqu’un qui venait de tuer un individu de sang-froid. L’air qui s’engouffrait dans l’habitacle faisait flotter ses cheveux, et des senteurs épaisses de mousse, de sphaigne et d’humidité parvenaient à ses narines.
Quand les deux militaires apparurent dans ses phares et qu’une lampe agressive lui vrilla les yeux, l’homme eut un instant de vide. La surprise totale. Puis son cerveau de professionnel réagit et les réflexes prirent le relais. Les deux mains sur le volant, il écrasa l’accélérateur pour forcer le passage.
Le véhicule sembla bondir de l’asphalte et manqua d’engloutir les deux flics. L’adjudant sortit son arme tandis que son équipier plongeait dans le fossé pour éviter l’impact. Dans le mouvement, le rétroviseur de la berline toucha la pointe de son ranger droit. Il s’affala dans l’herbe du bas-côté, avec un bruit sourd et épais. Le gradé, arqué sur ses jambes, suivit la trajectoire du monstre à quatre roues qui grondait comme un ours. Il ne put apercevoir le conducteur et se crispa sur la queue de détente de son pistolet. Une seconde d’hésitation… La première cartouche fut la plus dure à tirer ; les quatre autres s’engouffrèrent dans son sillage, elles résonnèrent comme la fin du monde. La nuit aspirait déjà la grosse allemande dans un crissement de pneus aux airs de violons fous. Bras tendus, doigts congelés sur l’acier de son flingue, le militaire ferma un œil, bloqua sa respiration et se concentra sur les feux rouges qui s’éloignaient… Puis rien, trop tard. Une énorme barre vitrifiait ses épaules et ses trapèzes. Il se mit alors à trembler ; l’adrénaline l’inondait. Il détacha son regard de la route désormais vide et avisa son camarade. Celui-ci se tenait à quatre pattes dans les herbes, éberlué. Sur le côté, sa lampe abandonnée projetait un faisceau vers le ciel.
— Vite, relève-toi, on le poursuit !
Le jeune homme obéit, il ne sentait plus la moindre fatigue et ses yeux scintillaient comme ceux d’une chouette effrayée.
Ils sautèrent dans la Ford et démarrèrent en trombe dans une gerbe de feuilles et de brins d’herbe. Ils atteignirent le premier virage alors qu’Antoine, le jeune gendarme, attrapait le combiné radio pour alerter le centre opérationnel. Il se souvint de ses cours de l’école de gendarmerie : lieu des faits, type de voiture, direction de fuite et demande de renforts.
La grosse berline sombre en avait sous le capot. Elle augmentait son avance dans les courtes et rares lignes droites, mais les gendarmes, qui connaissaient très bien la route, regagnaient du terrain dans les courbes nombreuses. Cela dit, ce n’était pas suffisant pour revenir à hauteur, tout juste parvenaient-ils à rester au contact visuel. Gavé d’adrénaline, le jeune passager beuglait des informations et répondait en criant au permanencier du centre opérationnel. Celui-ci, devant la gravité des événements, décida de solliciter la patrouille du PSIG1, qui, la nuit, rôdait presque toujours dans les environs. Un rapide coup d’œil sur l’ordinateur lui apprit que l’adjudant Brewski la dirigeait. Il en fut soulagé. C’était un homme de sang-froid et un militaire chevronné. Il déclencha l’intervention du PSIG qui répondit immédiatement.
Brewski bombardait toujours le bitume. Zébrure bleue tonitruante dans la nuit, sa Ford Focus souffrait le martyre. Ils étaient sur la D 49, ils avaient traversé Chaveroche et filaient maintenant vers Saint-Germain-Lavolps. D’après le centre opérationnel qui faisait le relais avec les poursuivants, la voiture suspecte devait se trouver sur le même axe qu’eux, à environ deux kilomètres. Ils faisaient route l’un vers l’autre tambour battant. Dans la lueur des phares, Brewski vit un petit panneau indicateur du lieu-dit le Guet-Apens. Il pila et la Ford fit une embardée tandis que son équipier posait lourdement ses mains sur le tableau de bord pour éviter de cogner le pare-brise. La voiture s’immobilisa trente mètres avant un virage serré. Sur la gauche, un vieux moulin en déliquescence offrait sa silhouette romanesque à la nuit et, sur la droite, une petite grange abandonnée se logeait dans un mouvement de terrain de la colline.
— Ici, c’est parfait ! lança Brewski.
David Arpontet, son équipier, lui adressa un regard interrogateur. Sans en dire plus, l’adjudant coupa le deux-tons et manœuvra pour placer le véhicule illuminé en travers de la route.
— Tu m’expliques ? demanda Arpontet.
— Ça ne sert à rien de filer sans réfléchir jusqu’à rencontrer le suspect. On ne fera que le croiser et, au final, nous serons deux voitures à le poursuivre. On va l’attendre. Si je ne m’abuse, il n’y a pas d’autre route entre nous et lui. Sauf s’il fait demi-tour, il va arriver sur nous.
Les deux hommes se regardèrent et Arpontet vit avec une grande netteté un éclat spécial dans les yeux de son chef. Un mélange de joie et de détermination. Walter Brewski s’empara du combiné radio et s’adressa à la patrouille de poursuivants.
— BT Meymac de PSIG…
Un silence qui leur parut immense se glissa entre eux.
— BT Meymac sur écoute…
Emporté par le stress, Antoine continuait à hurler dans la radio. Brewski et Arpontet entendaient en fond sonore derrière sa voix le bruit de son propre deux-tons.
— Ici PSIG. Nous sommes stationnés au lieu-dit le Guet-Apens, nous attendons le véhicule suspect, nous allons l’intercepter. Mettez un peu de distance entre vous et lui, au cas où…
— De BT Meymac, c’est reçu !
Brewski et son équipier descendirent de voiture et humèrent l’atmosphère. Le gradé s’approcha d’Arpontet.
— Le virage est très serré. Ça va l’obliger à ralentir avant de l’aborder. Il va arriver devant nous au pas, surtout si les autres relâchent un peu la pression. Tu vas prendre le HK2 et tu te positionnes là-bas, dit-il en désignant le côté droit de la route. Moi je reste ici, derrière la voiture. Je fais les signes et les sommations. S’il s’arrête, tu me rejoins et on le fixe en attendant l’arrivée des gars de Meymac. On l’interpellera sous ton appui.
— Et s’il force le passage ?
— Si tu l’estimes nécessaire, tu ouvres le feu.
Arpontet savait ce qu’il avait à faire. Alors que le jeune homme ouvrait la portière arrière pour saisir le pistolet mitrailleur de calibre 9 mm, un écho arriva jusqu’à eux. Il roulait dans la petite vallée et grossissait. Un bruit de sirène et de moteurs en furie.
— Les voilà ! lâcha Brewski, de l’excitation dans la voix.
Arpontet courut se mettre à son poste, le cœur tambourinant et les mains moites dans ses gants de cuir. Il avait, d’un coup, très chaud dans sa combinaison d’intervention. Il vérifia trois fois que le sélecteur de tir de son arme était sur coup par coup. Il s’imagina en train de manœuvrer la culasse pour introduire une cartouche dans le canon. Les battements de son cœur s’accélérèrent. Il considérait comme probable un usage des armes, il savait que les autres avaient tiré plusieurs fois.
La plainte du deux-tons enflait et diminuait au gré du relief ; cela accentuait la montée de stress. On s’attendait à voir surgir le véhicule suspect, et puis le bruit s’atténuait… et puis revenait…
L’adjudant Brewski se tenait toujours derrière la voiture de service. Comme dans un rêve, dans la lumière bleutée, il vit passer un peu au-dessus de lui un grand duc magnifique. Il se pencha dans l’habitacle, s’appuya sur le volant et saisit la télécommande du deux-tons et du gyrophare. Il se redressa, prêt. Le câble de la télécommande était tendu à mort, les hommes aussi.
Arpontet respirait fort, il avait des fourmis dans les jambes. Il vérifia encore une fois son équipement : menottes, second chargeur. Le deux-tons des poursuivants était maintenant très net ; ils étaient tout près, bon sang !
Puis un bruit de moteur. Brewski utilisa la télécommande pour couper le gyrophare ; pas la peine de s’annoncer. Il n’y avait plus que l’éclairage des feux de la voiture qui ouvraient la nuit. Leur halo blanc plongeait vers la rivière invisible en contrebas du moulin. De nouveau un bruit de moteur, plus fort. Arpontet piétina nerveusement en regardant son chef, quinze mètres devant lui. Il n’entendait même plus la petite rivière qui bruissait, il soufflait comme un bœuf et serrait son arme d’épaule si fort qu’il en avait des crampes.
Encore le son d’un moteur, un peu en retrait un deux-tons : les copains. Un trait de lumière furtif, des pneus qui crissent. Un bruit de moteur en surrégime ; le son caractéristique d’un rapport qui tombe ; encore de la lumière, un peu plus longtemps.
Arpontet n’en pouvait plus. Il regarda encore son chef, jambes décalées, pistolet main droite et télécommande main gauche. Son cœur bardoulait dans son torse ; il allait devenir fou !
Puis la fureur. Une lumière forte, un hurlement de moteur malmené par des rétrogradages extrêmes, un voile bleu poursuivi par une sirène. Un gros cri de gomme maltraitée, et le monstre noir apparut dans le virage. Arpontet ne voyait que lui, il n’y avait plus rien autour. L’effet tunnel.
Brewski actionna le gyrophare. La grosse BMW fit un écart et s’immobilisa. Derrière elle, des reflets bleutés tournoyants grimaient les arbres. Brewski songea une seconde à la dernière fois où il avait utilisé son arme et il sentit une légère contraction dans ses boyaux. Il aboya dans la télécommande haut-parleur.
— Halte ! Gendarmerie. Coupez le moteur !
L’écho des sommations ricocha dans la petite vallée et fut absorbé par le silence. Brewski jeta la télécommande et braqua le véhicule de ses mains jointes… Un instant qui dura une éternité. La voiture noire semblait jauger le militaire. Une scène de western. Une tension énorme. Les armes, prêtes à fendre la nuit, avaient déjà leur cri dans la gorge. Puis la BMW rugit, ses pneus patinèrent avec furie, et la tonne et demie d’acier bondit. Brewski ajusta son arme ; il ne discernait pas le conducteur, mais visa l’endroit où il supposait qu’il se trouvait. Ses deux yeux grands ouverts, le guidon du canon et un point précis sur le pare-brise formaient une ligne droite parfaite. Quand la voiture fut à moins de dix mètres, il tira une cartouche, puis s’écarta de justesse. La berline heurta le nez de la Ford dans un fracas assourdissant. La voiture bleue sursauta et l’allemande glissa vers le fossé. Son moteur fou n’en finissait pas de monter dans les tours ; elle racla de partout, la Ford et le muret du moulin. Les pierres du fossé torturèrent son ventre plat dans un horrible bruit de ferraille. L’homme venait de passer en force. Arpontet arma et épaula. Il suivit le véhicule avec le guidon de l’arme et le HK expulsa trois balles. Il distingua avec acuité la vitre du côté conducteur, qui vola en éclats, et aussi un impact plus bas dans la portière. Sa respiration se figea lorsqu’il vit une main émerger de la voiture ; elle brandissait un pistolet noir. Trois coups de feu très rapprochés claquèrent, trois flammes brèves dans la nuit. Le militaire sentit leur souffle, mais aucun ne fit mouche.
La voiture fila avec un affreux bruit de raclement. Des étincelles jaillissaient du châssis en plusieurs gerbes et aussi de la jante avant gauche. Arpontet avait dû toucher un pneu. Alors que les poursuivants débouchaient dans le virage, Brewski et Arpontet étaient déjà aux trousses de la berline. Walter enrageait. Les poings crispés sur le volant, il ne desserrait pas les mâchoires. Il sentait une puissante colère l’inonder, comme à chaque fois que quelqu’un tentait de lui échapper. Cette colère, mélange dangereux de violence pure et de méchanceté, semblait le pousser, comme quelqu’un qui court avec le vent dans le dos. Il se prit à s’imaginer en train d’interpeller celui qui conduisait cette grosse berline, il se vit en train de lui défoncer la gueule et il fut pressé de vivre ça. Il se demanda un bref instant si cette envie irrépressible ne cachait pas un trait de caractère très autoritaire et une violence sauvage.
Malgré son état, la BMW filait toujours, comme si elle avait le diable aux trousses. Au bout de quelques minutes dans le dédale de virages, Brewski ralentit. Il ne voyait plus les feux du suspect et ce n’était pas normal. Il s’arrêta. Il se saisit de son arme placée sous sa cuisse et sortit de la Focus. Arpontet l’imita et l’interrogea du regard. La patrouille de Meymac attendait derrière dans la même position. L’adjudant scrutait les alentours et tendait l’oreille.
— Ce n’est pas possible qu’on ne le rattrape pas. Avec un pneu crevé et je ne sais quoi de pété, on aurait dû au moins pouvoir le suivre.
— Tu en dis quoi ?
— J’en dis qu’il a dû prendre un chemin ou une route entre le moulin et ici. Il faut revenir en arrière. On a loupé quelque chose.
C’est à ce moment que le centre opérationnel se signala par la radio. Ils savaient qu’il y avait eu une fusillade et ils voulaient des informations. Tout le département gendarmique était déjà en émoi ; un usage des armes en Corrèze est une grande rareté. Alors que son équipier fournissait les informations demandées, Brewski faisait demi-tour. Il stoppa à hauteur de la patrouille de Meymac et lui dit de rester sur zone pour tenir l’axe. Il enfonça la pédale et rebroussa chemin. Il roulait sur la D 88 et s’approchait une nouvelle fois de Chaveroche. Au détour d’un virage, il aperçut des flammes. Sur le versant droit de la colline, à mi-hauteur, un brasier isolé léchait les arbres. En découvrant le chemin de terre qui partait de la route et qui montait en direction du feu, Brewski sut que c’était la BMW qui cramait là-haut. Le suspect était donc à pied dans la nature, peut-être juste là, tapi dans l’obscurité, à les observer. La poursuite devenait chasse à l’homme ; il avait l’habitude de ça. Il prévint le centre opérationnel et demanda des renforts pour établir un large périmètre de bouclage. En agissant de la sorte, il espérait fixer l’homme – il n’envisageait pas que ce fût une femme – pour l’empêcher de bouger. Ensuite, il réclama une équipe cynophile, pour trouver une éventuelle trace, et aussi un hélicoptère, pour avoir un appui aérien. Mais dans l’immédiat il brûlait d’aller voir ce feu de près. Il avisa l’équipe de Meymac qui resta en place.
* * *
Le petit matin frissonnait sur le plateau. Le chemin de terre était carrossable. Il montait raide et les pluies du printemps l’avaient raviné en son milieu. De chaque côté, ce n’était que forêt et fougères. Des geais vociférant et un picvert restaient à distance. Quatre enquêteurs munis d’un masque et vêtus d’une combinaison blanche travaillaient sur la carcasse encore fumante de l’allemande. Appuyé contre sa Focus au museau défoncé, Walter Brewski savourait un café revigorant en ruminant sans fin son échec de la nuit. Le type s’était envolé. Il avait dû patienter plusieurs heures avant que son désir de lui casser la figure ne s’estompe. Il leva les yeux et se laissa pénétrer par les essences et la profondeur de l’air. La nature avait fini par l’apaiser. Pour cela, rien n’égalait une aurore immaculée. Encore une fois, il avait vu le soleil se lever. Les gendarmes voient bien plus de levers de soleil que la plupart des gens. Quelque part au-dessus des arbres, derrière le mamelon de conifères, il entendait le ronronnement électrisant de l’hélicoptère de la base d’Égletons, qui tournait inlassablement. Trois équipes cynophiles se trouvaient engagées dans l’opération, mais l’espoir s’amenuisait. L’incendie avait pourri la zone d’un point de vue olfactif ; on n’avait pas pu sauver, de la grosse cylindrée allemande, une seule chose qui aurait pu servir pour prendre l’odeur du suspect. Une quarantaine de gendarmes avaient été réveillés dans la nuit pour étoffer le dispositif de recherche. Aux dernières nouvelles, un escadron de gendarmes mobiles était attendu dans la matinée.
Walt se perdit dans la contemplation du lieu. Ces arbres épais et immenses, ces collines denses cachant des vallons sombres et humides. Et cette sensation d’immensité. Il aurait aussi bien pu se trouver en Europe centrale. Il se demanda si c’était ce genre de paysage que découvrirent l’empereur Marc-Aurèle et ses légions, en 174 de notre ère. Quelque part entre la mer Noire et la source du Rhin, le grand philosophe défendait les frontières de l’Empire contre les hordes de Marcomans, de Quades, de Sarmates ou encore de Iazyges. Toutes ces peuplades barbares qui s’étaient coalisées pour défier Rome. Dans les moments de répit de cette campagne militaire interminable, le sage homme avait dû se ménager du temps pour méditer et admirer ces endroits si sauvages. Tout en soufflant sur son café brûlant qui déformait le gobelet de plastique, Brewski quitta ses pensées lointaines. Il jeta un regard de mépris vers une autre voiture de gendarmerie, garée juste en dessous de lui. C’était celle du commandant de la compagnie d’Ussel, son supérieur direct. Il était arrivé sur les lieux une heure après les faits. Au lieu de s’inquiéter de l’état de santé de ses hommes, il s’était lamenté en voyant la Ford Focus du PSIG et son avant bien amoché. Il allait avoir des tonnes de paperasse à remplir et des emmerdes à gogo. Le commandant de compagnie portait fièrement le grade de capitaine, il s’appelait Gontran Leroi. Le personnage valait le détour. De petite taille, gras comme un beignet, il vous observait de ses yeux porcins derrière ses petites lunettes rondes qui lui conféraient une ressemblance avec Heinrich Himmler. Il ne manquait que la moustache. Brewski détestait son chef. Il le tenait pour un incompétent doublé d’un poltron. C’était pourtant une grosse tête ; il était titulaire d’un master en histoire, mais n’avait aucune chance de l’écrire, l’Histoire. Incapable de prendre une décision, il s’engluait d’une manière irrémédiable dans la médiocrité.
Le capitaine Leroi éprouvait les plus grandes difficultés à coordonner les forces sur place. Il y avait des trous dans son dispositif et ses ordres étaient tous marqués du sceau de l’incurie. La hiérarchie l’avait mis là parce que c’était un « coin calme » et que ce serait l’endroit où il serait le moins « nuisible ».
En observant l’officier assis dans sa voiture, le téléphone collé à l’oreille, Brewski savait que la partie était perdue, le suspect était loin. Les mobiles allaient venir pour rien. Il avait donné son avis à son supérieur, mais celui-ci ne voulait pas se déjuger et s’entêtait à requérir du renfort.
Il soupira et vida son gobelet. Il fit un signe de tête à Arpontet et démarra la voiture. Ils étaient fourbus. Cela faisait vingt-cinq heures qu’ils n’avaient pas dormi, ça commençait à peser. Mais ils allaient devoir attendre encore avant de se glisser sous les draps. Les enquêteurs de la section de recherches de Limoges les attendaient pour les auditionner au sujet de leur usage des armes. Quand il passa lentement à côté de la voiture de son capitaine, Brewski vit son visage rubicond et bouffi. Il repensa à ses premières paroles dans la nuit, lorsque Leroi avait posé les yeux sur l’avant de la Focus : « Ah ! Bravo, mon adjudant ! Vous avez fait du beau travail ! » Cette réflexion déplaisante avait un peu ranimé son envie de violence et, avec la fatigue de la nuit, l’officier n’aurait pas dû insister beaucoup pour que Walt l’attrape par le col.
Cette affaire avait sorti le département de sa torpeur habituelle. On avait tiré du lit les hommes de la brigade de recherches pour qu’ils viennent sur place et procèdent aux investigations. Des OPJ3 des brigades environnantes étaient aussi sollicités. C’est qu’il y avait un énorme travail. D’abord au lieu-dit le Guet-Apens : réaliser des photos, matérialiser les endroits où l’on avait retrouvé les douilles à l’aide de petits panneaux jaunes frappés d’une lettre, entendre les protagonistes et détailler toute la scène pour qu’elle soit comprise. Dans ce but, le commandant de la brigade de recherches de Tulle avait décidé, vers trois heures du matin, de procéder à une mise en situation. C’était une sorte de reconstitution des faits avec les protagonistes. La célérité s’avérait primordiale tant que les souvenirs étaient encore précis. Cela permettait d’avoir une solide base de départ. Ensuite, il y avait du travail important à l’endroit où l’on avait retrouvé la carcasse calcinée.
Enfin, on avait besoin de personnel pour quadriller la zone et conserver une chance d’interpeller le suspect. Suspect dont on n’avait d’ailleurs aucun signalement, aucune description.
Les auditions de Brewski et d’Arpontet furent achevées en fin de matinée. Les enquêteurs saisirent l’arme individuelle de Brewski et le HK utilisé par Arpontet pour analyse. Il était impératif de déterminer qui avait tiré, sur quoi ou sur qui, et où et comment. En attendant qu’on les leur rende, il faudrait qu’ils en demandent d’autres. Un peu comme lorsque l’on va chez le garagiste pour une réparation, celui-ci vous prête une voiture en remplacement. Brewski et Arpontet allaient se retrouver avec un pistolet de courtoisie en quelque sorte ! Le gradé sourit à cette pensée. On est rarement courtois, une arme à la main.
Ils déjeunèrent ensemble peu avant midi. La faim les tenaillait et la fatigue les harcelait. Le repas fut assez vite expédié malgré une discussion animée. Ils éprouvaient l’intense besoin de parler des événements de la nuit ; cela permettait d’évacuer la tension et de mettre les choses à plat. Brewski n’en était pas à son coup d’essai. Les aléas de sa carrière faisaient qu’il en était à son troisième usage des armes. Trois fois il avait été obligé d’utiliser son arme, trois fois en vingt-six ans de boutique. C’était beaucoup ; la plupart des gendarmes finissent leur carrière sans jamais avoir sorti réellement leur arme de leur étui. Hormis les entraînements au stand de tir, bien sûr. Cette particularité donnait une certaine aura à Brewski. Il trouvait ça bizarre. Beaucoup de jeunes gendarmes, pollués par les films d’action, rêvent de tirer en mission, mais, en même temps, le redoutent. Ils voient cela comme un passage obligé, un rite initiatique, l’épreuve du feu. Sauf que l’un de ces usages des armes restait dans la mémoire de Brewski comme une cicatrice à vif, un cruel échec qui revenait au galop en ce jour où son arme avait encore craché le feu. Il savait qu’il allait passer un mauvais moment en se confrontant au passé, ce passé qui exhumait des cadavres et des fantômes. La scène surgie de sa mémoire ancienne s’avança devant ses yeux et il la repoussa de toutes ses forces. Pas maintenant !
Pour Arpontet, c’était différent. C’était la première fois. Et il faudrait qu’il se débrouille avec ça. Tout seul comme un grand. Les cellules psychologiques, c’est pour les autres, les civils. Les militaires ne sont pas vraiment humains, ils sont considérés comme des citoyens de deuxième classe. Il ne viendrait pas à l’idée d’un préfet ou d’un général commandant de région qu’un gendarme puisse avoir besoin d’un soutien psychologique.
Brewski songeait une nouvelle fois à l’acte d’utiliser son arme…
Chaque fois qu’un gendarme décide de tirer, il est seul avec lui-même. Seul avec sa conscience qui le regarde droit dans les yeux. Cela se fait en un quart de seconde. En un clignement de paupière, il doit avoir analysé une situation changeante et pensé au cadre légal. Il doit mettre en œuvre plusieurs choses simultanément : les gestes nécessaires pour réussir son tir, la prise en compte de l’environnement, mais aussi la protection de ses camarades, des éventuels civils et de lui-même.
Il faut penser à tout. Il faut faire rentrer toutes ces choses dans un quart de seconde. Et si le gars se loupe, il sera crucifié sur la croix médiatique et l’autel hiérarchique. Parce qu’il ne faut pas compter sur le soutien des galonnés. Pour ceux qui commandent, utiliser son arme, c’est mal. Ça attire l’attention des journalistes, le préfet téléphone en personne, le procureur s’inquiète, ça fait des vagues, et les ronds-de-cuir galonnés détestent les vagues parce que leur slip n’est pas imperméable. Ce n’est pas bon pour leur carrière. Les vagues amènent l’incertitude et un vent incontrôlable. Les hauts gradés préfèrent de loin l’air confiné de leur confortable bureau ; d’ailleurs, la plupart ont le mal de mer…
1 Peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, qui s’apparente à la BAC (brigade anti-criminalité) de la police nationale.
2 HK UMP 9. Pistolet mitrailleur de fabrication allemande, de marque Heckler & Koch.
3 Officiers de police judiciaire.
J. 2
Il était treize heures trente quand Walt se glissa dans ses draps frais. La sensation du tissu sur son corps lui procura beaucoup de plaisir. Des zébrures de lumière transperçaient le volet roulant de la chambre et instillaient une atmosphère douillette et confortable. Dehors, des oiseaux piaillaient. Il adorait les entendre avant de s’endormir ; ça lui arrivait souvent quand il rentrait le matin, au lever du jour. Les bouvreuils, les pinsons, les bergeronnettes ou les grimpereaux des arbres, ces petits oiseaux au bec fin et recourbé qui leur permet d’attraper les insectes cachés dans l’écorce. Il se cala sous la fine couette d’été avec la ferme intention de ne pas sortir du lit avant l’heure du dîner. Il se réjouit de ne pas avoir ses enfants ce jour-là. Le souvenir douloureux de son vieil usage des armes remonta à la surface. De nouveau, il le chassa en secouant la tête. Pas maintenant ! Ce nouvel tir en service avait ranimé ce cadavre poussiéreux relégué très loin dans un compartiment de son cerveau. Cela faisait déjà dix ans.
Il naviguait vers le large lorsque son téléphone de service sonna. Il crut qu’il rêvait déjà. Dégoûté, il attrapa l’appareil et décrocha sans identifier l’appelant ni lever sa tête de l’oreiller.
— Ouais… ? !
— Brewski ?
Son estomac se serra ; il avait reconnu la voix aiguë et couinante du capitaine Leroi.
— Je vais avoir besoin de vous de toute urgence, mon adjudant.
— Euh… Ça fait plus de trente heures que je n’ai pas dormi, mon capitaine.
— Oui, je sais, mais je ne peux pas faire autrement. Nous avons un cadavre sur les bras.
— Où ça ?
— Au lieu-dit Florentin, un trou perdu entre Péret-Bel-Air et Bonnefond.
— C’est de la compétence de la brigade de Bugeat, non ?
— Exact, l’OPJ est sur place pour les premières constatations. C’est le chef Dufour qui m’a demandé de vous prévenir.
— Et pourquoi ça ?
— Le mort a été tué par balle, trois balles précisément. Dufour dit que c’est une exécution. Il a aussi fait le rapprochement avec vos exploits de la nuit dernière. Florentin, c’est à moins de sept kilomètres de l’endroit où la patrouille de Meymac a débuté sa poursuite avec la BMW.
Brewski resta un instant silencieux. Il réfléchissait.
— Mon adjudant, vous êtes toujours là ?
— Oui, mon capitaine. (Il soupira.) Bon, je me prépare et je me rends sur place.
Brewski était déjà épuisé de devoir remettre la tenue, le ceinturon, les rangers et tout le bazar. Il décida de laisser Arpontet se reposer et emmena avec lui un jeune gendarme adjoint. Après tout, qu’il soit de la baise sur ce coup-là était largement suffisant.
L’endroit était vraiment perdu. Deux maisons au milieu des bois épais. L’une abandonnée et l’autre habitée, celle de la victime. Un large périmètre de sécurité avait été déployé. Brewski releva la présence de la brigade de Bugeat, mais aussi de celle de Meymac. Le technicien de la brigade de recherches était déjà sur place. Un silence de cathédrale régnait sur le site. Brewski leva la tête et regarda le ciel. Les hauts sapins qui l’entouraient lui donnaient le vertige. Une brume étrange s’élevait en volutes entre les troncs immenses des conifères. Les hautes herbes hirsutes mangeaient les pieds des arbres et semblaient capables d’abriter des bêtes immondes. Un papillon rouge orangé passa en funambule à côté de lui. Brewski l’identifia comme étant un cuivré des marais. Il entra à pied dans la zone et s’approcha de ce qui semblait être la scène de crime derrière la maison. Petite et rectangulaire, elle formait un bloc. Un jardin entretenu ornait l’avant du terrain et un 4 × 4 sale et décrépit stationnait sur le côté. Quand Brewski passa l’angle du mur sud-ouest de la demeure, il découvrit une cour pavée de pierres arrondies. Quatre gendarmes s’affairaient. L’un d’eux, accroupi, portait une combinaison de technicien. Il cherchait quelque chose dans une mallette noire ouverte à ses pieds. Dufour vit Walt et accourut vers lui. Les deux hommes se serrèrent la main. Ils s’appréciaient.
— Tu as gagné le gros lot, Jacques, on dirait, chambra Brewski.
— Putain, tu peux le dire ! Merde, la tuile ! Toi, tu as une sale mine, ajouta Dufour en passant sa main sur son crâne rasé.
— C’est un peu grâce à toi. Ça fait plus de trente et une heures que je n’ai pas dormi, répondit Brewski en consultant sa montre. J’espère que je suis là pour une raison valable.
Dufour lui adressa un clin d’œil.
— Je pense que oui. Suis-moi, je vais t’affranchir. C’est la factrice qui l’a trouvé oblitéré comme un timbre vers midi et demi. J’te dis pas la frousse qu’elle a eue, souffla Dufour tout en marchant.
Le militaire emprunta un chemin balisé spécifique, le même que celui qu’il avait suivi pour rencontrer Brewski. Ils arrivèrent au centre de la cour. Un homme d’une quarantaine d’années gisait sur le dos, dans son sang. La mousse qui colonisait les pierres en avait absorbé une partie. Les yeux de la victime regardaient droit vers le ciel. Elle n’était pas de grande taille, mais semblait assez massive. Une grosse barbe galopait sur ses joues et Brewski trouva que son visage avait quelque chose d’ailleurs. Il remarqua que la porte de la maison était ouverte. Dufour prit la parole :
— On pense que le tueur est allé le chercher à l’intérieur. Il l’a fait sortir et agenouiller au sol. Ensuite, il lui a tiré trois balles : une dans le genou, une dans le buffet et une dans la tête.
— On connaît son identité ?
— Il s’appellerait Christophe Longeval, d’après son permis de conduire. Il est né en République tchèque. Il avait quarante-sept ans. Le permis a été délivré par la préfecture de Tulle il y a vingt ans.
— Il est mort depuis longtemps ?
— J’suis pas légiste, mais je pense que ça fait dans les douze heures.
— Le calibre utilisé ?
— À confirmer, mais ça serait du 9 mm que ça ne m’étonnerait pas. Je pense que le tueur l’a questionné avant de l’abattre. Tu vois la blessure par balle au genou ? Elle est vraiment moche. Il y a de la terre sur le tissu du pantalon, comme si le tueur avait appuyé dessus avec son pied pour faire parler la victime. En plus, la maison a été fouillée.
En imaginant la scène qui s’était déroulée ici même quelques heures plus tôt, Walter Brewski se remémora une grande phrase du philosophe Marc-Aurèle qu’il aimait beaucoup. Cette phrase était presque en lui, il y pensait souvent et elle l’avait parfois aidé à conserver sa dignité : « Ce que l’on fait dans sa vie résonne dans l’éternité. » Pour Walt, invoquer Marc-Aurèle était devenu un réflexe presque sanitaire face aux miasmes du monde.
Brewski n’avait pas envie de prendre cette affaire, mais la possible relation entre elle et sa patrouille de nuit très agitée piquait sa curiosité. Le jeune gendarme adjoint restait silencieux à côté des deux hommes. Il observait le corps sans pouvoir en détacher son regard. C’était la première fois de sa vie qu’il voyait un mort. Deux corneilles passèrent au-dessus d’eux en croassant comme des lanceurs d’alerte. Peu habitués à voir autant de monde en ce lieu qu’ils possédaient, les deux corvidés tournaient en hauteur.
— La factrice s’est pointée par où ?
— Par le chemin nord. On a balisé et utilisé le même parcours qu’elle. Et quand on a débarqué il n’y avait pas d’autres traces de pneus que les siennes.
— Si on suppose que le tueur est venu vers les minuit, ça veut dire qu’il a dû se faire très discret pour surprendre sa victime. Je mettrais bien un billet sur le fait qu’il se soit garé à distance respectable pour ne pas être entendu.
— Ça se tient, répondit Dufour.
— Le problème, c’est que maintenant les voies d’accès sont bien pourries. Ça va être compliqué de trouver des traces. Il faut dès à présent limiter les mouvements de véhicules et surtout préserver les bas-côtés. On a peut-être une chance de trouver des traces, si jamais il s’est garé en marge du chemin.
— Tu as raison. Dès qu’on a terminé ici, j’envoie mes gars fouiner sur les deux côtés. On ne sait jamais.
— Je ne suis pas vraiment saisi de cette affaire et je ne voudrais pas que tu croies que je m’immisce… Mais il faudrait bétonner l’enquête de voisinage. Je sais qu’ici c’est vite vu puisque la victime est seule, mais il y a des hameaux sur les deux voies d’accès, ça pourrait donner quelque chose.
— Tu as raison et ne t’en fais pas pour ma réaction, je n’ai jamais été possessif en matière d’enquête. J’ai eu la proc au téléphone, elle arrive. Juste le temps d’enlever ses chaussures à talons et de mettre des bottes en caoutchouc, je suppose !
— Elle fait venir le légiste ?
— Non, ils sont débordés à Limoges, et puis ici on est en bordure du monde, trop loin de tout.
— Tu crois vraiment que ça a un rapport avec la petite animation de la nuit dernière ?
— Je ne serais pas surpris, répondit Dufour, clignant d’un œil malicieux.
— Décidément, ça bouge en Corrèze depuis deux mois. C’est Chicago !
— Tu fais allusion au braquage sanglant de l’agence bancaire à Brive au mois de juin ?
— Ben oui, à quoi veux-tu que je fasse allusion, blaireau ?
— C’est clair qu’on a eu plus de morts en deux mois que les trois années précédentes réunies. Sur le braquage de Brive, heureusement que cet ancien militaire était là. Il a bien réagi.
— Ouais, à vingt-cinq ans, cinq ans d’armée, ça faisait pas longtemps qu’il était retourné dans le civil. Maintenant, c’est un véritable héros, une vraie star.
— Paraît qu’il va avoir la Légion d’honneur, c’est ce qui se murmure.
— Je lui laisse. Ça ne veut plus rien dire, on la donne à n’importe qui. Tu sais comment Victor Hugo appelait toutes ces décorations ?
— Non, mais je sens que tu vas me le dire…
— Les hochets de la République.
Les deux hommes se séparèrent sur une grosse poignée de main tandis que le jeune adjoint semblait hypnotisé par le cadavre qui baignait dans son sang. Brewski n’en pouvait plus, il fallait vraiment qu’il dorme. En repartant, il ne put s’empêcher de jeter des coups d’œil sur les bas-côtés, histoire de voir si quelque véhicule n’y aurait pas stationné…
Au moment de regagner une route digne de ce nom, il vit arriver en face une voiture sombre : la procureur déboulait. Elle était suivie par celle du capitaine Leroi. « Bon toutou », pensa-t-il. Les deux véhicules ralentirent pour se croiser sur la route étroite, les rétroviseurs se frôlèrent et le regard de Brewski passa sur celui de la procureur. Il eut juste le temps d’y lire de la surprise et de l’inquiétude avant de voir la face cramoisie et boursouflée de son capitaine qui, trop concentré à suivre la chef de la police judiciaire du département, ne pensa même pas à lui faire un signe.
Brewski se félicita d’être parti à temps pour ne pas avoir à se coltiner cette mégère égocentrique et autoritaire, qui plus est accompagnée de ce flagorneur de capitaine Leroi. Son chef était ainsi, méprisant pour ses hommes et lèchecul avec ceux qui lui étaient supérieurs.
Dufour vit arriver les deux voitures comme un paysan voit un nuage de criquets fondre sur ses cultures. Il inspira une grande goulée d’air frais et tapa dans ses mains pour se donner du courage. La procureur La Ferrière claqua la portière de sa voiture et s’avança vers la scène de crime sans attendre le capitaine Leroi qui en était encore à manœuvrer avec maladresse. La silhouette frêle et étique de Geneviève La Ferrière avait quelque chose d’incongru dans ce décor. Elle s’approchait en prenant soin d’éviter de marcher dans la terre et prenait appui sur les quelques pierres qui festonnaient le chemin. Elle stoppa devant Dufour. Il lui offrit un beau sourire et, sans aucun signe de soumission, il lui dit bonjour très poliment. La magistrate répondit et tendit sa main vers lui. Elle était quelque peu soulagée de le voir sur les lieux, elle appréciait ce gradé et son travail. Gontran Leroi arriva de son pas lourd et emprunté. La Ferrière commença :
— Bien, je vous écoute, chef.
Dufour fit un topo rapide mais précis en s’ouvrant sur une ou deux hypothèses. La procureur prenait l’affaire très au sérieux. Un meurtre par balle en Corrèze est une chose rarissime. A fortiori sur le plateau de Millevaches où il ne se passait jamais rien. Un événement pareil allait réveiller les journalistes et faire la une pendant plusieurs semaines.
— Il faut absolument conserver un secret absolu sur ce crime. Pas de communication avec les journalistes, tout doit passer par moi. Vous pensez à un règlement de compte ?
— Difficile à dire, c’est une éventualité. Nous n’avons rien sur la victime, on ignorait jusqu’à sa présence sur notre territoire. Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’a pas de casier. Pas un PV, rien du tout. C’est comme si ce gars était tombé du ciel.
— Il devait bien faire ses courses, il faut bien manger. Interrogez les commerçants les plus proches, fouillez dans ses affaires. Le point de départ se trouve peut-être chez lui. Il faut en savoir plus sur cet homme.
— Celui qui a fait ça nous a précédés. Il a retourné la maison ; il cherchait quelque chose, mais l’a-t-il trouvé ?
— Pourquoi vous dites « Celui qui a fait ça » ? Ils étaient peut-être plusieurs.
— Oui, c’est possible. Rien ne permet de l’affirmer ou de l’infirmer. Nous n’avons pas de traces, car le sol est herbeux et ensuite c’est de la pierre au niveau de la cour.
La procureur alla voir le cadavre et posa un œil dégoûté dessus. Elle questionna les techniciens. Elle donna quelques directives, destinées à montrer qui commandait plutôt qu’à faire avancer l’enquête. Le capitaine Leroi la suivait comme un petit chien et sa tête ne cessait d’aller et venir entre La Ferrière et Dufour qui discutaient. La procureur resta en tout et pour tout une vingtaine de minutes, elle confia à Dufour qu’elle allait ouvrir une information pour assassinat. C’est le juge Laîné qui hériterait de l’affaire et cette éventualité remplit Dufour de joie. Laîné était un homme pugnace d’une probité éclatante, un accrocheur et un puncheur. Âgé d’une cinquantaine d’années, il avait exercé à Lille et à Paris, métropoles où il ne s’était pas fait que des amis. Il avait fait tomber un sénateur-maire et sa femme pour corruption, abus de biens sociaux et fraude fiscale. Malgré les appuis importants du client, malgré les interférences du parquet aux ordres du pouvoir, en dépit de toutes les opérations de déstabilisation montées contre lui, Laîné n’avait rien lâché, allant jusqu’à raccrocher au nez du procureur général. Le sénateur-maire Kalbany se pavanait et ergotait, sûr de son fait ; il arrosait d’arrogance le juge et les policiers, persuadé de son immunité et de son impunité. Il menait grand train et méprisait la plèbe qui le vouait aux gémonies. Il se moquait des gens de loi qu’il accusait d’envier sa réussite. Au bout du compte, ce fut une victoire éclatante pour le juge et ses enquêteurs. Kalbany fut condamné à cinq ans de prison ferme et sa femme à deux ans et demi avec sursis. Revanchard et rancunier, le juge avait fait envoyer un bouquet de fleurs – des chrysanthèmes – à Kalbany à la prison de la Santé. L’avocat de l’ex-sénateur avait crié à la provocation, au harcèlement, et l’affaire, montée en épingle par quelques médias complices, avait fait grand bruit. Mais le juge avait réglé le bouquet de fleurs sur ses deniers personnels et conservé la facture, il eut beau jeu d’expliquer que ce présent était un geste d’apaisement et que dans l’histoire très ancienne les chrysanthèmes n’avaient pas une fonction funeste.
Il commit toutefois une erreur. Il postula au grade supérieur et la chancellerie sauta sur l’occasion pour le promouvoir loin, très loin, au milieu des vaches et des bois, en Corrèze.
La procureur voulait aller vite ; une affaire pareille ne devait pas traîner. Elle voulait éviter à tout prix d’avoir à supporter longtemps une telle épine dans son pied. À quarante-cinq ans, elle pouvait encore faire une belle carrière et accéder à un poste plus en rapport avec l’idée qu’elle se faisait de sa personne. Dès son retour au bureau, elle rédigea les documents nécessaires et ouvrit l’information au nom du juge Laîné. La mécanique judiciaire était en marche, et, même si les secondes de cette horloge s’écoulaient beaucoup moins vite que celles du temps, la machine s’ébranlait et rien ne l’arrêterait, surtout si l’horloger s’appelait Patrick Laîné. Le juge accueillit le dossier avec des yeux avides et affamés, il se jeta dessus avec une fièvre enivrante. Comme à l’accoutumée, il saisit immédiatement le colonel commandant le groupement de gendarmerie de la Corrèze et lui délivra une commission rogatoire. Il prit soin de l’appeler pour lui dire combien il tenait à ce dossier et désirait aboutir. Le colonel Ange Tognotti, un Corse au fort caractère, détonnait dans le décor militaire et formel des officiers de gendarmerie. Son franc-parler et son énergie en faisaient un trublion gênant. Sa hiérarchie avait donc procédé de la même manière que celle du juge Laîné et le colonel Tognotti était passé de la prestigieuse section de recherches de Lyon au groupement de la Corrèze. Une mise au rancart déguisée en promotion. Nourris à la mamelle de l’indépendance, les deux personnages s’entendaient comme larrons en foire.
Le grand patron de la gendarmerie mit les petits plats dans les grands. Il créa une cellule d’enquête du nom d’Homicide Millevaches. Il s’empressa de désigner le chef Dufour comme directeur et des éléments de la brigade de recherches de Tulle pour l’épauler. Bien au fait de la possible relation entre le meurtre et la course-poursuite de la veille, il inclut aussi l’adjudant Brewski dans l’équipe. Cela allait poser des problèmes ; Brewski commandait le PSIG d’Ussel, une unité qu’il allait devoir délaisser le temps de l’enquête. Ça n’allait pas plaire au capitaine Leroi, mais celui-ci fermerait sa gueule puisque l’ordre venait d’en haut. Privée d’une vision d’ensemble, l’administration française avait rassemblé en un même lieu des hommes de caractère et des insoumis. De quoi constituer une poudrière, tout ce qu’elle exécrait.
* * *
L’homme arriva au petit matin à proximité de son logis. Cette fois, il l’avait échappé belle. Ces foutus gendarmes étaient accrocheurs et de sacrés pilotes ! Même avec sa grosse cylindrée, il n’avait pas pu se mettre à l’abri. Sa confiance en prenait un petit coup.
Après avoir mis un peu de distance à la faveur d’une courte ligne droite et d’une grosse prise de risque, il avait aperçu dans un virage ce chemin sur le côté gauche. Il n’avait pas hésité une seule seconde. Sa jante étincelait comme la meuleuse d’un ouvrier et il pressentait que sa voiture allait le lâcher. Il s’engagea sur le chemin sans freiner et éteignit ses feux, continuant comme il put sous les yeux froids de la lune et des étoiles. Il avança à une vitesse un peu optimiste. Les mouvements chaotiques de son bolide qui s’agitait de soubresauts, comme les ultimes convulsions d’une bête blessée à mort, malmenaient son pistolet qui glissait sur le siège passager.
Quand il pensa être assez éloigné, il coupa le moteur et bondit de l’habitacle. Il tendit l’oreille, aux aguets et en éveil comme le plus beau des félins. Rien, pas un bruit de moteur, le silence magnifique de la forêt écrasait tout. Il pouvait sentir son immensité, là, à ses pieds, une impression renforcée par la fraîcheur qui montait de la terre. Une énergie vitale et directe émergeait du sol et transperçait tout.
Il récupéra ses affaires, vérifia qu’il n’oubliait rien et sortit une petite fiole de son sac à dos. Il en versa le contenu sur le siège conducteur et le reste sur celui du passager. Règle numéro un : toujours avoir un peu de liquide inflammable sur soi. Il alluma un bout de papier avec son briquet et le jeta à l’intérieur. Les vapeurs prirent vie en un champignon de feu jaune et bleu, puis les flammes se mirent à grignoter les sièges. Devant ce brasier au milieu de nulle part, il ressentit une émotion irrationnelle, une excitation qui le ramena des années en arrière vers ses souvenirs d’enfant, lorsqu’il sautait au-dessus des feux de joie agonisants avec ses copains du village. C’était si loin, c’était avant que n’arrive le pire du pire. Il resta quelques longues secondes pour s’assurer que l’incendie prenait bien. Rassuré sur ce point, il ferma sa veste et partit sans hésiter vers le haut de la colline.