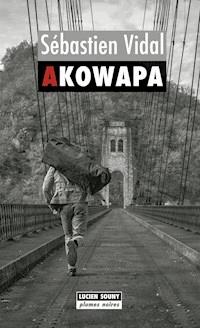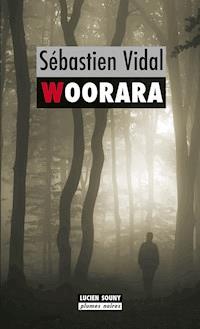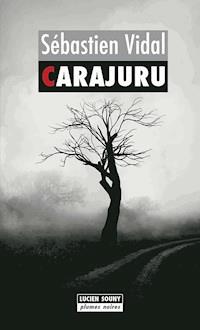
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Tatanka
- Sprache: Französisch
Le gendarme Walt Brewski en proie à ses propres démons...
Lors d’une patrouille nocturne, les gendarmes Walt Brewski et David Arpontet découvrent le corps d’un homme, sans vie, une balle en pleine tête. Il s’avère que la victime est un ancien militaire devenu récemment une célébrité en faisant échec d’une manière héroïque à un braquage dans une banque.
Les premières constatations portent à penser qu’il s’agit d’un suicide, mais certains détails sèment le doute. Pour découvrir la vérité, Brewski et son équipe se plongent dans le passé de l’individu. Ils en exhumeront de sales histoires et de pénibles secrets. Alors que de nouveaux personnages troubles apparaissent, les pires tourments de Walt ressurgissent et corrodent son moral.
Quand les âmes damnées s’unissent et que les victimes se révoltent, l’atmosphère devient explosive et… mortelle.
Après la vengeance dans Woorara, Sébastien Vidal s’attaque à la haine, à la honte et à l’imposture, ces sentiments noirs qui tirent l’être humain vers le fond et l’entraînent du côté obscur. Frissons garantis !
EXTRAIT
Elle avait tenté de se débattre, mais il s’accrochait à son cou comme un naufragé à une bouée. Elle n’avait aucune chance. Il avait alors entrevu le pire de son être, parce qu’il avait aimé cet instant, ces secondes où l’adversaire comprend son erreur et pressent la défaite. La défaite, celle qui éteint tout. Il avait savouré intensément ce regard de bête pourchassée, et ce mélange d’amertume et de regrets. Il avait serré de plus en plus au fur et à mesure que s’éteignait cette lueur dans ses yeux de garce, serré pour annihiler une vie comme on souffle une vulgaire bougie. Ça valait le coup. Bien plus puissant et plus efficace qu’un discours. Plus fort que lui envoyer au visage ses quatre vérités. Il resta dans cette position bien après qu’elle eut cessé de gigoter et d’émettre des sons enfouis dans sa gorge, penché sur elle et les doigts raides autour de son cou.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Lecture addictive, passionnante à beaucoup d’égards, que je ne peux que vous encourager à découvrir. -
Polarmaniaque
À PROPOS DE L'AUTEUR
S’il n’écrit pas,
Sébastien Vidal lit. Il ne peut envisager de passer une seule journée sans l’une ou/et l’autre de ces activités. Fin connaisseur de la littérature américaine, il se délecte aussi avec Claude Michelet et Antoine de Saint-Exupéry.
Il tient un blog littéraire, de très bonne facture,
Le Souffle des mots, qui attire un public toujours plus nombreux. Il a signé
Woorara, paru en janvier 2017, dans la collection Plumes noires.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« On a toujours assez de temps pour faire des ravages quand on sait où se cachent les vieilles blessures. »John Irving, Le Monde selon Garp.
« Les plus belles alliances sont des promesses de guerre. »Antonin Varenne, Battues.
À toutes ces rencontres déterminantes, tous ceux qui ont façonné mon univers et qui m’ont fait progresser. Aussi loin que je me souvienne, vous avez joué un rôle et rempli une mission, apporté un gain, une connaissance. Vous vous êtes trouvés là, sur mon chemin, à un moment de ma vie, pile dans le bon tempo, comme des passerelles de bambous ou de bois fatigué, mais finalement bien plus solides que le béton. Chacun d’entre vous habite ma mémoire, et je sais qu’il reste encore pas mal de passerelles… Merci.
À Bruce Springsteen, qui demeurera le Boss des Badlands…
Walt se sentait extrêmement bien. Il était reposé malgré la longue patrouille de la nuit passée. Il éprouvait ce sentiment assez rare de bien-être, cette sensation de flotter dans son corps et de goûter la présence de chacune de ses cellules. La journée s’était parée de beaux attributs. Le soleil veillait sur le monde comme un ami très proche. Il faisait déjà chaud pour la saison et ils avaient ouvert les vitres de leur véhicule. La radio FM passait Everyday now du groupe Texas. La voix si reconnaissable et si sexy de la chanteuse, Sharleen Spiteri, rendait ce moment encore plus beau. Walt conduisait lentement, sur un rythme « patrouille en mode pépère ». Son pote Daniel était assis à côté. Un gars très volubile. Toujours un truc à dire, un avis à donner. Il ne jugeait pas, mais il avait besoin d’exprimer sa façon de voir les choses sur à peu près tout ce qu’il entendait et tout ce qui lui passait sous les yeux. Walt se disait qu’il cachait derrière ces bavardages une peur viscérale de la solitude et du silence. C’était le genre de type à devenir fou sur une île déserte. Le genre à se mettre, au bout de quelques jours, à parler à un ballon de basket, auquel il aurait grossièrement dessiné un visage.
Comme souvent après une patrouille nocturne, l’équipe reprenait dans l’après-midi, sauf si elle était rentrée tôt le matin. Dans ce cas précis, elle jouissait d’une récupération physiologique de dix heures. Ça, c’était en théorie. Dans les faits, il y avait des entorses au règlement. En tant que militaires, les gendarmes ne sont pas soumis au Code du travail. Ils peuvent être contraints de bosser dix-huit ou vingt heures d’affilée sans que personne y trouve rien à redire, mis à part leur famille. Donc parfois, assez régulièrement, on les rappelle avant ce délai des dix heures. Le plus souvent pour participer à une guerre qui est déjà terminée avant qu’ils aient sauté dans leurs rangers. Mais cette fois-ci personne n’avait rappelé Walt et Daniel. La nuit avait été assez calme. Quelques contrôles d’identité, quelques véhicules arrêtés et eux aussi contrôlés. Seule une échauffourée, opposant trois poivrots trop saouls pour parvenir à se faire mal, les avait un peu distraits. Walt avait les alcoolos en horreur. Ces types qui picolaient pour oublier leur médiocrité le repoussaient comme peu d’autres choses sur terre. Prisonniers de la bouteille, ils étaient condamnés à revivre la même journée toute leur existence, l’haleine un peu plus chargée que la veille et l’horizon un peu plus restreint.
Walt s’engagea dans la rue Clemenceau. À chaque fois qu’il y passait, il ressentait une pointe d’agacement. Selon lui, un homme de la stature de Georges Clemenceau, véritable sauveur de la patrie lors de la première guerre mondiale, méritait au minimum une avenue ou un boulevard. Il n’avait pas pu s’empêcher de s’indigner une nouvelle fois. Daniel avait souri, mais n’avait pas relevé. Le coude posé sur la portière, tel un touriste, il se laissait distraire par le feuillage opulent des platanes qui bordaient la « rue du Tigre », comme l’appelait Walt. Des nuées de piafs passaient d’un arbre à un autre en faisant un boucan d’enfer. Le printemps donnait toute sa mesure ; on pouvait sentir le gros cœur de la nature battre comme un tambour, avec force et amplitude. À la radio, Texas venait de passer le témoin à Gérald de Palmas qui grattait sur sa guitare les premiers accords de J’en rêve encore. La voiture de service ronronnait ; une brise tiède s’invitait dans l’habitacle et apportait, dans son sillage, des odeurs de lilas et d’herbe coupée. La rue du Tigre débouchait sur un petit carrefour où un feu tricolore régnait en maître.
— Encore une heure et on se rentre, j’ai envie de profiter de ma soirée. La terrasse, le soleil, une bonne binouze derrière la cravate et les doigts de pied en éventail, lança Daniel en étirant ses bras droit devant lui et en faisant bouger ses doigts comme s’il jouait du piano.
— Beau programme ! C’est tentant, répondit Walt en adressant un clin d’œil à son pote.
Il se dit que ça lui ferait aussi du bien de retrouver ses enfants, Loriane et Diego. Leur bagnole arrivait presque au feu qui venait de passer au rouge. Walt décéléra et s’approcha tout doucement, au point mort. Sur sa gauche, un clodo assis sur un muret se cramponnait à son picrate qui macérait dans une bouteille en plastique vert. Une grosse femme trop serrée dans une robe bleue trop voyante passa devant l’homme en lui jetant un regard plein de dégoût et de reproche. Walt pensa instantanément que c’était une mégère. Un pigeon descendit en rase-mottes devant eux alors que la voiture s’immobilisait au feu. C’était une belle journée de printemps. Ça aurait pu être une belle journée de printemps. Sur la droite, le bureau de tabac, dont l’enseigne clignotait, attirait l’attention avec sa devanture en partie recouverte de pubs pour les jeux à gratter. Un homme en jaillit comme un diable d’une boîte. Il portait une vieille veste de surplus militaire avec un écusson américain cousu sur une manche. Walt posa les yeux sur lui. Il fut obnubilé par ce regard injecté de sang ; les deux ouvertures de sa cagoule noire lui conféraient un air étrange. Puis tout se déroula au ralenti. L’homme stoppa d’un coup sur le trottoir, juste devant l’entrée du buraliste. Sidéré de se retrouver nez à nez avec les gendarmes, il ne bougeait plus. Ses yeux, aussi grands que les trous de la cagoule, regardaient partout. Ils suintaient la trouille sale et poisseuse des amateurs chargés à mort. Walt vit ensuite son bras se lever et brandir un flingue. Il ouvrit la bouche pour alerter Daniel qui observait avec un léger sourire le clochard sur son mur, de l’autre côté. Walt voulait crier, mais les sons arrivaient avec une lenteur incroyable… Ils devaient naître dans ses pieds pour mettre autant de temps à parvenir à ses lèvres. Simultanément, son bras droit se dressa pour toucher l’épaule de Daniel qui rêvassait toujours, la tête un peu inclinée, comme quelqu’un qui détaille un tableau accroché à un mur. Et le bras du type qui était presque tendu vers eux, verrouillé, l’arme menaçante. Ses yeux disaient qu’il allait tirer. Il allait tirer parce que la peur l’inondait et que son cerveau était trop cramé pour lui signaler que c’était une grosse connerie. Alors, le bras de Walt changea de direction. L’instinct. Sa bouche, sèche comme le désert, n’avait toujours pas émis de sons. Sa main se posa sur la crosse de son pistolet. Son pouce commença à déverrouiller le loquet de sécurité de l’étui. Un truc clochait. Ça bloquait. Un coup d’œil au taré cagoulé qui les braquait avec son calibre à quatre mètres d’eux. Une vision le traversa : au ralenti, la tête de Daniel qui interroge Walt et ses lèvres qui s’agitent. Walt perçoit des sons informes, comme si son pote parlait doucement et avec des chamallows plein la bouche. Il lui semble qu’il lui dit un truc sur le clodo. Le loquet qui bloque toujours. Walt baisse la tête et comprend. Cette putain de ceinture de sécurité le gêne, elle empêche le mécanisme de s’abaisser à fond. Il va devenir fou. D’un coup, il comprend les claustrophobes. Sa main bouge à peine ; il a l’impression affreuse de se transformer en statue de pierre. Son pouce libère la ceinture et revient sur le bouton-poussoir du holster. Un coup d’œil au barjot en veste de treillis. Il est planté dans le sol et un peu penché vers l’avant. Walt reconnaît la posture et sait que c’est le signe qu’il va tirer. Ce con doit croire qu’ils sont là pour lui alors que c’est le hasard qui les a menés ici. Daniel commence enfin à tourner la tête vers la droite ; dans deux secondes, il va voir le gars, avec sa cagoule qui souligne son regard d’halluciné.
Ce putain de cran de sécurité obéit enfin ; Walt sent l’arme qui sort péniblement de l’étui. Le siège et l’embout dans lequel s’enclenche la ceinture perturbent son extraction. Ça accroche, ça coince, ça frotte le tissu du siège. Un autre regard furtif sur le mec… Walt voit un éclair, une flamme. Et puis le bruit de la détonation, comme étouffé. Il sent un déplacement d’air près de sa joue et, tout de suite, une chaleur humide sur tout le côté droit de sa figure. La projection d’une matière inconnue, sur son visage, lui a fait cligner des yeux et il a sursauté. Sa main tient enfin son arme libérée, mais bon sang ! Elle monte tellement lentement vers l’agresseur ! Un œil sur Daniel. Il a dû voir le type… Lui aussi doit avoir la main sur son arme… Daniel est avachi. Son corps semble mou, relâché, et il lui manque toute la moitié gauche de la tête… Walt est figé, sidéré. Il ne croit pas ce qu’il voit. Un autre coup de feu, plus fort, le fait sursauter. La vitre arrière de la voiture explose dans son dos ; il a l’impression de voir le monde avec des yeux de chouette. Ses poumons se remplissent et se vident beaucoup trop vite. Une autre détonation. C’est le rétroviseur droit qui éclate dans une gerbe de plastique et de verre. Walt a envie de se planquer sous le volant pour éviter le déluge de feu, il réprime cet instinct. Le toxico panique et tire n’importe comment. Puis les réflexes parlent, ils prennent les commandes. Walt voit l’arme du braqueur trembler et tenter de se stabiliser sur lui. Il n’aura pas une autre chance. Il aligne le guidon de son pistolet sur ses deux yeux ouverts. Une belle ligne droite imaginaire et trois points posés sur elle : ses yeux, le guidon de son arme, le thorax du type. Malgré l’adrénaline, il bloque sa respiration et appuie sur la queue de détente avec sa dernière phalange. Un geste presque léger, dénué de toute crispation. La balle part dans un barouf surprenant. Walt distingue très nettement l’étui qui s’éjecte du côté droit de son arme et qui tourne sur lui-même. L’homme à la veste kaki bascule en arrière, comme frappé par un coup de pied gigantesque, et s’étale de tout son long. Son arme s’échappe de sa main et va glisser au pied d’un platane.
Walt pose les yeux sur Daniel. Sa tête est comme un immeuble éventré sur un champ de bataille : des os explosés, des cheveux mêlés à des trucs rouges qu’il sait être de la matière cérébrale broyée. Il distingue une partie de cerveau, grosse comme un pamplemousse, réduite en bouillie. Et puis il remarque ce qu’il n’oubliera jamais : dans ce magma sanguinolent, à peu près là où aurait dû se trouver son oreille gauche, gît l’étui de la cartouche qu’il vient de tirer sur le braqueur. Accroché aux chairs éclatées, comme posé sur une fenêtre donnant sur l’enfer. Entre eux, le plafond de la voiture est crépi de petits fragments de crâne et de cervelle pulvérisée. Walt sent alors cette chose gluante sur son visage et porte ses yeux sur le rétroviseur intérieur. Son cœur bat trop fort ; ses palpitations sont assourdissantes. Dans le reflet de ce petit miroir criblé de sang, il ne peut pas retenir un cri d’horreur. Toute la partie droite de sa tête est rouge. Il sait d’où provient la matière organique qui la boursoufle, mais il refuse de laisser cette pensée pénétrer en lui. C’est comme si on lui avait jeté un bol de sang frais mélangé avec des bouts… Mon Dieu ! Des bouts de Daniel ! Puis arrive l’odeur. Ce remugle terreux, mêlé à des parfums de fer et à quelque chose d’indéfinissable. L’odeur du sang. Du sang partout, qui gicle de la tête inerte de Daniel, qui dégouline dans son cou et imprègne sa combinaison. Des éclaboussures tapissent la tenue d’intervention de Walt, surtout du côté droit. Il réprime une féroce envie de passer sa main dessus, comme pour enlever une poussière.
Ses sens recouvrèrent leur acuité et le monde se stabilisa. Walt vit les gens affolés courir ; il entendit les voix trop fortes, les pleurs. Et dans les enceintes ces paroles de de Palmas, qu’il n’oublierait jamais, gravées dans l’équilibre du temps et sur la surface de sa mémoire à vif, ces mots qui parlent de supprimer les traces, le plus petit morceau de candeur, de supprimer la moindre trace pour ne laisser qu’un morceau de glace à la place du cœur.
Oui, c’était ça. À cet instant affreux de son existence, il avait le cerveau en fusion et un morceau de glace à la place du cœur. Il monta, vers son visage ensanglanté, une main qui tremblait sous l’effet de l’adrénaline ; son doigt toucha une boule informe, à la consistance caoutchouteuse, collée à sa joue. Il appuya un peu dessus et le chuintement qui s’en échappa manqua de le rendre fou.
* * *
Walt s’éveilla en sursaut. Il s’était redressé et se tenait droit dans le lit. Il respirait fort ; son estomac se contracta quand il repensa à cette vision émétique. Ce cauchemar récurrent égrisait son moral avec une efficacité redoutable. Il ressentait la curieuse impression que son cerveau était étançonné pour laisser surgir ce rêve venu du passé. Cet événement qu’il appelait de manière intime « la chose de mai 2005 ». Il attendit un peu et, quand le malaise se dissipa, il se leva, chancelant. Dans la salle de bains, il se passa plusieurs fois de l’eau froide sur le visage. Il laissa couler le robinet, il avait besoin d’un bruit dans cet appartement : tout sauf le silence. La lumière froide de l’ampoule, qui descendait sur lui, l’affligea. Il s’essuya la figure et prit appui sur la faïence froide du lavabo. Il savait que le miroir lui renverrait un reflet sans pitié, alors il évita d’y poser les yeux. Il ferma le robinet et tourna les talons. De retour dans l’obscurité de la chambre, il avisa le radio-réveil : trois heures dix. Il savait très bien qu’il ne se rendormirait pas tout de suite. Trop de violence résiduelle dans les turbulences de son cauchemar. Ça faisait dix ans que tout cela était arrivé ; pourquoi ça revenait le hanter maintenant ? Il s’en voulut de se poser la question alors qu’il possédait la réponse. Pourquoi ? Parce que depuis il y avait eu l’affaire des trois frères serbes, il y avait eu ce tueur non identifié sur lequel il avait tiré une nuit, la première fois qu’il utilisait son arme depuis Daniel… Et puis il y avait eu Charline. Il se dit que les traumatismes étaient des rochers sous l’eau de la rivière : quand le niveau baissait, ils réapparaissaient. Et puis il y avait le facteur amour-propre. Pour un militaire, accepter de subir un traumatisme était en soi traumatisant. Walt se découvrait plus fragile qu’il ne le croyait. Il s’allongea dans le noir et enchaîna des séries de respirations, genre de yoga à sa sauce. Au bout de cinq minutes de vide, il commença à se sentir mieux. Il pensa à une magnifique phrase de l’écrivain Dan O’Brien, qui figurait dans Rites d’automne : « Nous resterons à jamais blottis entre le vert et le brun de la terre, et le bleu infini d’un ciel de prairie. » Cette pensée l’apaisa et il put même se représenter le tableau. Il alluma sa lampe de chevet et attrapa ce roman qu’il avait entamé. Un bijou qu’il avait dégoté pour cinquante centimes dans un salon annuel qui se tenait en novembre à Ussel et où l’on vendait des livres au kilo. Au début, il avait été choqué qu’on puisse vendre des livres comme de vulgaires patates, puis il avait changé son fusil d’épaule en se rendant compte que celui qui savait fouiner pouvait réaliser de belles affaires. Et les gendarmes s’y entendaient pour ce qui était de savoir fouiner. D’une manière curieuse, il ne lisait presque pas de polars. Il les trouvait, pour la plupart, peu crédibles et engagés dans une surenchère sanguinolente absurde. Il se cala contre son oreiller et ouvrit le poche aux coins rabotés. Au bout de trente pages, il avait oublié son rêve horrible. Ce n’était d’ailleurs pas un rêve ou un cauchemar, c’était une scène affreuse vécue qui revenait, comme les marées, engloutir son sommeil de sable. Il sentit ses paupières peser plus lourd et s’aperçut qu’il relisait le même passage pour la troisième fois et qu’il ne parvenait toujours pas à le comprendre. Il marqua la page et déposa le roman sur sa table de chevet. Il éteignit la lampe et sombra presque aussitôt.
Fin mai 2015
Seul dans la pièce, le visage juste éclairé par la lumière de l’écran de l’ordinateur face auquel il se tenait, l’homme se demandait s’il avait bien fait. La vidéo démarra pour la énième fois. Elle datait du mois précédent. L’image tremblait, saturée de pixels grossiers. Le son était terrible, avec cet écho typique des pièces vides, dénué de tout maquillage, froid et réel, affreux. D’abord les insultes, la morgue caractéristique qui dégueulait des voix assurées par le sentiment d’appartenir au groupe des vainqueurs. Ces relents de moquerie, de condescendance et de sexisme. Que les mâles se sentent forts quand ils chassent en meute ! Ils demeurent si misérables quand ils sont seuls. Et puis la voix de la fille, qui jaillit ; un coup d’épée qui crève l’atmosphère ; un éclair aigu qui fendille les certitudes. Au début, ils n’avaient pas prévu de la violer. Ils voulaient juste lui faire un peu peur, lui mettre la pression, s’amuser avec elle comme un chat avec une souris qu’il a capturée et pas encore tuée. Il fallait la remettre à sa place, elle, la minette au milieu des mecs, des vrais. Sa présence était une provocation ; elle devait être punie. Elle qui rivalisait avec eux, qui osait se mesurer à eux, qui leur tenait tête, elle devait recevoir une leçon. La main qui tient le téléphone tremble et descend un peu. L’angle est mauvais, l’approche incertaine. Il subsiste un halo maigre. Impossible de dire s’il fait nuit ou si c’est un lieu interdit à la lumière ; néanmoins, on voit plutôt bien, car l’appareil est un téléphone haut de gamme. On voit très bien que celui qui filme le fait en douce, il ne veut pas qu’on le repère. Il est là, mais se fait oublier. Il avait pensé que c’était une mauvaise idée et maintenant il en était sûr. Une prémonition. Les chacals aveuglés par les geysers d’hormones ne veulent pas se l’avouer, mais ils ont changé leur plan, comme par télépathie, tous ensemble et en même temps. Lui, il filme et il a peur. Il regrette d’être là. Ils ne lui ont pas trop laissé le choix. « Viens avec nous et ferme ta gueule ; on va bien se marrer », qu’ils avaient dit avant de lui balancer un violent coup au foie. Comme pour le mouiller avec eux, lier leurs destins dans le mal. On dirait une petite meute de loups, des loups pathétiques, avec de petits crocs qui n’ont jamais déchiré aucune chair, des griffes ridicules qui n’ont jamais rien égratigné d’autre que des fantasmes. Ils se donnent du courage, les trois loups, mais chacun attend que l’autre se lance pour le suivre en hurlant. La proie les a tenus à distance un moment, quand les conventions sociales étaient encore debout. Maintenant, c’est autre chose, le stade au-dessus. Un cap décisif est franchi. Elle avait aboyé, menacé, gesticulé. Au début, les petits loups s’étaient effrayés. Ils avaient tourné autour, décrivant un cercle qui se resserrait peu à peu. Elle savait que sur le plan physique la bataille était perdue. À un contre un, elle avait sa chance, une bonne chance : elle était musclée et maîtrisait les techniques de base. Mais contre trois adversaires, surtout avec le balèze juste là, il n’y avait pas de suspense. Puis il survient un changement subtil, une modification de la structure de l’air. C’est palpable, tous le perçoivent. À cet instant, elle peut sentir tous ses poils, un par un, qui se dressent dans son dos, vague sous l’épiderme qui soulève la prairie de sa pilosité jusqu’à sa nuque raide et douloureuse. Le plus trapu et petit s’approche et d’un mouvement vif lui saisit un poignet. C’est là que tout bascule, le langage secret des corps, un genre de télépathie, le signal. Les deux autres se jettent sur elle, la bloquent, l’immobilisent. Ils s’organisent et la prennent chacun à leur tour dans une litanie de râles gras et gutturaux. La scène est interminable ; la grande pièce renvoie les échos terribles des bruits organiques qui sont plus insupportables que la vision du viol lui-même. Ce corps maintenu qui lutte en vain ; cette position de force des trois autres qui œuvrent avec méthode et qui en rajoutent, comme pour faire durer le supplice encore et encore. La fille geint, se débat, puis s’éteint comme un feu trop vite ravivé, en manque de combustible. Combien de plombs ont fondu pour entraîner ainsi la chute des inhibitions et faire surgir cette brutalité haineuse des entrailles du mal ?
L’homme stoppa la vidéo. Il n’en pouvait plus. Ses poumons tournaient à plein régime. Il se passa les mains sur le visage. Il regrettait de ne pas être intervenu. Mais les autres l’auraient défoncé. Il savait de quoi ils étaient capables. Déjà, après le viol, ils lui étaient tombés dessus et lui avaient mis trois tonnes de pression. Il était complice, il devait la fermer, ce serait leur secret. Ils étaient inséparables, trois malfaisants qui complotaient sans cesse. Eux trop forts et puissants, lui trop faible. Maintenant qu’il était hors de portée, il pouvait agir. Cela changerait-il les choses ? Que ferait l’autre, celui sur qui il comptait ? Peut-être qu’il n’en avait rien à foutre. Si c’était le cas, qu’allait-il faire, lui ? Il ne pouvait plus s’arranger avec sa conscience qui suintait comme une sale blessure infectée.
Juin 2015. Commissariat de Brive-la-Gaillarde. Dix-sept heures douze.
L’inspecteur gigotait sur son siège, il donnait l’impression de ne pas parvenir à trouver sa place. Il pianota avec virtuosité sur le clavier de son ordinateur et manipula sa souris. Thomas Osveta avait toujours aimé les petits bruits que produisaient les touches de clavier et les souris, ces cliquetis légers qui possédaient un pouvoir rassurant et un peu soporifique, comme la pluie sur un toit de tôles dans un vieil atelier abandonné et silencieux. Le flic se racla la gorge.
— Comment ont-ils fait pour pénétrer dans la banque ?
— Ils devaient savoir que c’était la guichetière qui ouvrait le sas, ils ont juste attendu que je rentre pour entrer avec moi. J’ignore où ils se cachaient, je ne les ai pas entendus arriver, j’ai juste senti qu’on me poussait très fort dans le dos. Je me suis retrouvé étalé par terre dans l’agence.
— OK. Que se passe-t-il ensuite ?
— Le plus massif a tout de suite crié de mettre les mains apparentes, de ne plus bouger. Les deux brandissaient leurs armes dans tous les sens. Après, le costaud, qui semblait être le chef, est allé chercher le responsable dans son bureau.
— Donc, je reprends. Nous en sommes au moment où le plus costaud des deux va chercher le chef d’agence de la banque. Qu’est-ce que vous avez vu exactement ?
Thomas plisse les yeux pour mieux se concentrer. Seulement deux heures que tout cela s’est passé et il peine à mettre ses idées en ordre. Il est sur le fil du rasoir, il ne doit pas se tromper.
— À ce moment-là, je me suis relevé doucement, par réflexe. L’autre gars ne nous a pas encore fait mettre au sol. Le plus balèze, très énervé, a contourné le guichet et a filé directement vers le directeur qui se trouvait dans son bureau. On voyait tout grâce à la grande vitre qui sépare les guichets des bureaux.
— Et ensuite ?
— Ensuite, le directeur était au téléphone. Il l’a frappé au visage avec le plat de son pistolet et a raccroché le combiné. Il a tiré le pauvre gars vers nous ; il le cramponnait par le col de sa chemise, car il tenait à peine debout. C’est là que l’autre a fait sortir la guichetière et nous a ordonné de nous mettre au sol, elle, moi et l’autre client.
— Donc, à ce moment précis, vous êtes six personnes dans la banque : le directeur, la guichetière, un client, vous et les deux braqueurs.
— C’est ça.
— Il est quelle heure à cet instant ?
— Onze heures trente-cinq. Je m’en souviens, car j’ai regardé l’horloge située derrière l’employée quand je me suis relevé.
— Après, que se passe-t-il ?
— Le plus balèze, celui qui a cogné le directeur, n’arrêtait pas de crier « le coffre, le coffre ». Ah oui ! Juste avant, l’autre type a désactivé les portes coulissantes de l’entrée.
— Continuez.
Le policier tapa avec frénésie sur la même touche, comme s’il effaçait un long mot dans son document.
— Ils nous ont pris, l’autre client et moi, et nous ont emmenés avec eux et le directeur vers la salle du coffre. En fait, nous avons juste emprunté un couloir de quelques mètres qui débouchait sur une petite pièce. Le coffre se trouvait là, contre le mur du fond. Pas plus gros qu’une machine à laver. De la pièce, on avait une vue en enfilade sur le guichet et sur l’employée qu’ils avaient laissée là-bas.
Le flic tiqua sur l’expression « en enfilade ».
— Ah oui ! J’oubliais ! Vous êtes un ancien militaire. À votre avis, pourquoi n’ont-ils pas pris aussi la jeune femme ?
— Je ne sais pas. Elle était terrorisée. Ils ont dû se dire qu’elle ne représentait aucun danger ; et puis, de là où ils étaient, ils pouvaient la surveiller.
Thomas répondait aux questions au son de la musique des touches du clavier, qui ne s’arrêtait pas.
— Et après ?
— Celui qui avait l’air d’être le chef a encore frappé le directeur. Ce dernier avait du mal à ouvrir le coffre ; il était paniqué et plus très sûr de la combinaison.
— Comment étiez-vous disposés dans la pièce ?
Thomas réfléchit un instant, puis se lança en faisant des gestes pour appuyer ses explications.
— Le coffre était contre le mur du fond, le directeur se tenait accroupi devant et les deux braqueurs se trouvaient de chaque côté. Le balèze à gauche et l’autre à droite. L’autre client était placé à environ un mètre du malfrat qui se trouvait à droite du directeur, et moi j’étais derrière le client.
— Donc, si je comprends bien, les deux truands tournaient le dos au couloir et au guichet ?
— Oui, mais le chef jetait des coups d’œil très souvent. Et puis le directeur a ouvert le coffre. La porte a pivoté vers la droite et ça a obligé le braqueur qui était de ce côté à se décaler un peu. Le rustaud, lui, regardait déjà dans le coffre. C’est là que j’ai senti que l’autre client allait déconner…
Décembre 2015
Quand Thomas Osveta s’extirpa de son sommeil en hurlant à pleins poumons, il se retrouva avec tous les muscles de son corps durs comme du bois. À bout de souffle, gluant de transpiration, il était en proie à une nausée visqueuse comme une marée noire. Ce cauchemar était insupportable. Il le hantait depuis plusieurs mois déjà. Cet homme s’avançait vers lui, couvert de sang, mais le pire était ses yeux. Fixes, pénétrants, des yeux de reproche, des yeux où il finissait par être englouti dans un abîme obscur et froid. Un endroit dans lequel il effectuait un saut sans fin. La torture de la chute éternelle. Il jeta un œil à son réveille-matin. De toute façon, il était presque l’heure. Il ouvrit la fenêtre de l’hôtel dans lequel il descendait toujours. La tonitruance de Paris le saisit. Cette ville se révélait très bruyante, pleine de pollution sonore. Lui, le rural, éprouvait les pires difficultés à s’accoutumer à la capitale. Curieusement, les moteurs rageurs et les klaxons dissipèrent son vilain rêve. Il fallait se préparer ; dans deux heures, il devait être dans les studios de RFL. Si un jour on lui avait dit qu’il animerait une émission hebdomadaire sur une radio nationale, il aurait quand même bien rigolé. Lui l’orphelin, élevé par de braves gens, qui n’étaient plus de ce monde, qui avaient peut-être été les seuls à lui témoigner de l’amour. Lui qui était n’importe qui, un anonyme, était devenu quelqu’un par la grâce d’un jour de juin, il y avait presque six mois. Cela lui semblait déjà si loin ; tant de choses étaient arrivées depuis. Avec le recul, Thomas regrettait ce qui s’était passé. Si c’était à refaire, il ne le referait pas. Pourquoi avait-il agi de la sorte ? Pourquoi le destin l’avait-il placé dans cette banque ce jour-là, pile au mauvais moment ? Depuis, il revivait ces minutes qui furent les plus longues de sa vie. Depuis, il ne vivait plus vraiment.
Six mois plus tôt, en juin, Thomas Osveta s’était couvert de gloire en faisant échouer un braquage dans une banque à Brive-la-Gaillarde. Le hasard et la chance avaient soufflé de son côté, le poussant sous les feux des projecteurs. Il avait échappé à la mort et, sans qu’il puisse vraiment l’expliquer, il était intervenu, sur un coup de tête. Il avait senti l’opportunité, celle qu’on voit apparaître avec une incroyable acuité, en une demi-seconde. La folie pure, sans limites, sans retenue. Les médias partout, tout le temps. Sa trombine en gros plan dans le salon des Français. Il en avait perdu son identité, il n’était plus que « le héros ». Il voyait sa gueule à la une de la presse écrite ; pas un jour sans que l’on parle de lui à la télé ; son portable n’arrêtait pas de sonner ; tout le monde voulait l’interviewer. Il repensait souvent à ces quelques secondes, ces instants si brefs et si anodins, dont on ne se méfie pas assez, ce tout petit morceau de temps qui l’avait rendu visible aux yeux du monde. Lui le fantôme en tenue de camouflage, lui le patriote revenu de la guerre. Quand il était rentré de sa dernière mission, orphelin de deux camarades tués au combat, seul le vent qui hurlait sur le tarmac était là pour l’accueillir. Ces mêmes journalistes qui lui couraient après aujourd’hui ignoraient alors jusqu’à son existence. Où étaient-ils à son retour de « là-bas » ? L’arrivée des soldats se faisait dans l’anonymat blafard d’un lendemain de gueule de bois. La bise qui hantait le béton, les feuilles qui glissaient dessus dans ce crissement d’ongle qui rend fou. La lumière basse et déprimante, le silence violé par l’air qui se déplace sans aucune ombre derrière lui. Bien sûr, les familles sont là, dignes et impatientes, soulagées de voir leur proche en un seul morceau et sur ses deux jambes. Elles sont loin de soupçonner les ravages intérieurs, ceux qui ne sortent de leur tanière que la nuit, quand l’équilibre d’une longue et éphémère journée vacille sous les coups de boutoir de l’horloge ancienne. Ces démons furieux et instables comme de l’explosif concentré, qui jaillissent en tournoyant et en hurlant des mots sauvages et odorants, ceux d’une autre langue, d’une autre époque. Tous ces gens ne savent pas ce que c’est que de passer son temps à avoir peur de mourir. Depuis, tout avait changé, le président de la République l’avait décoré de la Légion d’honneur. Il n’avait pourtant pas été foutu de les décorer, lui et ses potes, à leur retour de « là-bas ». Devant un parterre haut de gamme, sous les flashs omniprésents et les cliquetis des appareils photos, le président avait agrafé la breloque sur sa veste, achetée pour l’occasion. Thomas avait vite compris qu’il n’était qu’un infime élément d’un vaste programme. Pour le premier personnage de l’État, il n’était qu’une ligne dans un agenda, un simple rendez-vous, une bonne occasion pour le résident de l’Élysée de profiter un peu des retombées médiatiques de son acte de bravoure. Putain ! Comme il regrettait d’avoir fait ce qu’il avait fait ! Il aurait dû rester la figure plaquée au sol et ne rien envisager d’autre, juste attendre que l’orage passe, car il finit toujours par passer. Qu’est-ce qui lui avait pris ? Quel spectre lui avait murmuré ces injonctions dans le creux de l’oreille, ou directement dans son âme ? Maintenant, les morts au combat le toisaient du ciel, eux les oubliés, parfois décorés pour la forme, par pur réflexe, mais pas par respect. Ils venaient dans la nuit, au moment où le vent hurle et où les fractures apparaissent. Ils arrivaient en flottant et en cortège ; ils vociféraient en l’encerclant, lui arrachant sa médaille honteuse et la lui enfonçant dans la bouche.
Au début, son ego s’était gavé jusqu’à l’indigestion de cette célébrité qui tombait du ciel. Il était comme un saint qui recevait, les bras écartés et un sourire béat aux lèvres, un concert de louanges. Très vite, sans qu’il eût l’impression d’avoir eu son mot à dire, un aréopage de gens qu’il ne connaissait pas ou à peine se constitua en garde prétorienne. On lui prenait ses rendez-vous, on lui louait ses chambres d’hôtel, on lui disait comment s’habiller. Toutes ces personnes se donnaient beaucoup de mal pour qu’il soit persuadé qu’elles lui étaient indispensables. Il avait fait tous les plateaux télé. Annoncé en grandes pompes, suivi par un projecteur qui le mettait à nu, il arrivait jusqu’à la table de l’invité vedette, et il se trouvait que c’était lui ! Sa tête de gendre idéal et sa répartie avaient vite fait de lui un personnage très recherché. Il était ce qu’on appelle un « bon client ». Au cœur de la tempête, alors que le typhon médiatique battait son plein, RFL l’avait appelé. Ils lui proposaient une émission hebdomadaire. Pas encore d’idée très concrète sur le contenu, mais il savait déjà qu’il y avait un gros paquet de fric au bout du micro. Il s’était senti tellement faible en recevant cette offre. Lui l’ex-sans-grade, l’ex-anonyme qui ne voulait plus le redevenir ; lui le fauché sans horizon ni avenir. Comment résister à l’appel de la notoriété, celle qui brille, qui clinque et sonne, qui propulse au septième ciel ? Cette chose qui éteint, d’un coup, toutes les craintes matérielles et qui peut allumer des lumières puissantes, qui font alors disparaître toutes les ombres inquiétantes dans le long tunnel de l’existence. Il avait envie de dire oui ; son ego le réclamait tellement fort qu’il n’entendait que lui, et en même temps, dans un tortueux méandre de son esprit, quelque chose dissonait, quelque chose dérapait.
Puis il y avait eu le gros chèque d’un éditeur pour qu’il raconte son histoire. Suivi de celui d’un producteur pour acquérir les droits cinématographiques. On parlait de Pio Marmaï ou de Tomer Sisley pour jouer son rôle. Il trouva cela amusant, car parfois, dans la rue, on le confondait avec l’acteur Yvan Attal. Il avait vécu un été complètement fou, un été qui avait filé comme une comète. Mais l’embellie n’avait pas tenu la distance. Tout au plus le temps que mettent les braises d’un feu de joie pour s’éteindre et être emportées en lucioles légères dans la main invisible du vent. Quand septembre avait surgi, avec ses jours raccourcis et ses soirées lancinantes, quand les premiers frissons s’enroulèrent autour de sa colonne vertébrale surchauffée, quand l’ambiance de l’été déjà mort s’évaporait dans les brumes matinales revenues, il sut qu’il allait redescendre, qu’il allait en baver.
Maintenant, il était dans le dur, il dégustait grave. Ses habits de star l’oppressaient, ou plutôt il se sentait mal habillé, comme s’il portait un déguisement. Mais comment revenir en arrière ? Le temps n’attend pas et l’histoire se grave en une seule fois et pour l’éternité. Il avait plein d’amis, mais pas un qui ait connu le vrai Thomas Osveta, que des nouveaux potes « du héros ». Il était enfin quelqu’un aux yeux de tous, mais sentait au fond de lui qu’il n’était personne. Un pauvre ectoplasme entré par hasard dans un costume trop bien taillé et bien trop propre. Pour échapper à la pression, il s’était mis à picoler. Il se voyait tomber dans les pièges qui attendaient les apprenties stars : l’alcool, les soirées, les filles, la poudre qui détendait tout et pouvait même modifier les couleurs et la façon qu’avait le temps de s’écouler. La poudre blanche d’où naît la magie qui transforme la douleur en une simple et légère palpitation que l’on peut alors ignorer. Chaque fois qu’il entendait le mot « héros », la nausée le dévorait sous sa couenne de simple mortel. Tous oubliaient qu’il y avait eu des morts au cours de ce braquage, des braves gens qui n’avaient rien demandé. On ne leur reconnaissait même pas le droit de figurer dans l’histoire qu’ils avaient écrite. Il apprenait que pour les médias un héros vivant valait plusieurs morts anonymes. Il devait se faire aider. Mais il n’avait aucune confiance dans son entourage de pacotille, papillons attirés par la lumière et tout ce qui brille. Il devait gérer son tourment seul. Alors, c’était devenu son grand secret. Personne n’était au courant et personne ne le serait. Mais il n’était pas de taille ; c’était une culpabilité trop imposante pour sa petite conscience. Il avait l’impression de se noyer. Des semelles de plomb l’entraînaient par le fond dans un cortège de bulles qui dansaient autour de lui. Il s’enfonçait d’une manière inexorable, le visage tendu vers la surface aux reflets iridescents, flottant dans ses beaux habits de vedette, mangé un peu plus à chaque seconde par l’obscurité de l’abysse. Que sa vie aurait été différente, ce terrible jour de juin ! Elle aurait pris une autre courbure, s’il avait décidé simplement de commander un deuxième café à la terrasse de ce bar du centre. Il aurait, par cette décision banale, gravé un autre sillon, plus simple, moins douloureux. Juste un deuxième café, quelques minutes de plus au soleil et rien de tout cela n’aurait existé. Il prenait conscience maintenant, dans le halo triste des sentiments noirs, de la futilité d’une vie, de sa légèreté imprévisible. Il comprenait que les battements d’ailes d’un papillon pouvaient repousser au loin, protéger du tumulte ou, au contraire, faire tomber dans une spirale trépidante et incontrôlable. Il se sentait attaqué de toutes parts, encerclé. Il n’aurait jamais supposé que des sentiments morbides possédaient cette force obscure, cette onde fluctuante qui générait l’ignition de la matière qu’elle tourmentait.
Il remonta à la surface de ses pensées. Le grand Paris grondait de toute sa frénésie hivernale. Il déambula dans la chambre luxueuse, incapable de décider ce qu’il allait faire. Cette émission radio, pompeusement appelée Un héros vous écoute, il ne pouvait plus la sentir. C’était une souffrance de la faire chaque semaine ; rien que le générique lui bouffait ce qui lui restait de moral. Mais impossible de lâcher l’affaire : il avait signé un contrat. Il traîna les pieds en traversant la chambre et régla la chaîne sur une station musicale. Midnight Oil déferla avec sa grosse musique et la fin de son tube Blue sky mine. Il porta un regard sans vie sur le mobilier qui l’entourait. Tout était magnifique, mais tout était froid et sans âme. Il se dit que les hôteliers pouvaient bien dépenser sans compter pour agrémenter leurs chambres, ils pouvaient chercher l’osmose et la beauté, ils ne capteraient jamais l’essence mystérieuse qui fait qu’on aime un endroit. Simplement parce que les murs s’imprégnaient du passage permanent, et que chaque occupant effaçait les traces du précédent. Il était convaincu qu’on ne pouvait pas s’enticher, dans son repli intime, d’un lieu partagé avec le reste du monde.
Mais tout cela était sans importance ; plus rien n’en avait, d’ailleurs. Ce numéro de Un héros vous écoute serait le dernier. Le boulet qu’il traînait accélérait sa sénescence. Le fait qu’il ne pouvait plus continuer constituait un truisme éventé. Il allait animer cette émission et il rentrerait en Corrèze. Il rejoindrait son chez-lui, l’endroit où il avait grandi, le seul où le bonheur l’avait vraiment effleuré, la Xaintrie. Ce petit endroit niché entre deux rivières sombres, comme des parenthèses, inondé de forêts mixtes et giboyeuses, où des pentes bossues et surprenantes laissaient courir des ruisseaux si fins qu’ils restaient invisibles. Un domaine où résonnaient encore le cri du hibou et le chant cristallin de petits oiseaux qui ignoraient la prégnance des hommes. Un petit pays d’où dégringolait dans des vallées profondes, en cascades insoumises, le sang limpide et transparent d’une terre qui défiait, depuis des crépuscules immémoriaux, les montagnes d’Auvergne. Une contrée de villages resserrés et de maisons anciennes polies par les intempéries. Des bâtisses en pierres apparentes, ramassées contre les éléments, arborant des jardins précieux, bordés de murs de guingois et avachis, scellés par du mortier de mousse épaisse. Un sanctuaire innervé de sentiers inaliénables qui s’offrent à des menhirs antédiluviens et des blocs de rochers pétris par des saisons sans cesse renaissantes. Un coin de petites fermes humaines, enveloppées par des chênes centenaires et des sapins pointus. Un petit monde, fragile et oublié, de routes étroites étouffées par des sous-bois odorants et des prairies tailladées par des haies foutraques et piquantes. Une craquelure de terre, chapeautée par une chapelle plantée au point culminant, semblant tutoyer l’empyrée sous les ordres d’un coryphée invisible. Cette structure de pierres ancestrales, érigée pour révérer un dieu presque oublié, dressée là comme pour désigner une zone sacrée, d’où émanent des énergies et des ondes mystiques, connues de druides depuis longtemps rendus à la poussière. Et ce toit pointé vers la voussure céleste, comme pour affirmer qu’ici c’est spécial, qu’ici c’est un autre territoire et une autre histoire, qu’ici la cime des arbres magnifie le vent. Un lieu qui s’apparente au paradis pour celui qui cherche à se retirer un peu du monde, un coin attirant pour tout humain désirant faire un pas de côté, pour souffler un peu et raviver sa flamme, dans les interstices de son existence. C’était là qu’il retournerait, après ce baroud d’honneur, bien qu’il doute d’avoir pu en préserver un peu. Une fois dans sa maison achetée avec l’argent de sa célébrité, il en finirait avec la détresse et la souffrance, il se suiciderait. Il n’avait pas d’autre chemin que celui-là, parce qu’il lui était impossible d’affronter la vérité et surtout le regard des autres. Ces choses affreuses qu’il savait, ces éclairs de vérité et de justice qu’il avait entre les mains s’étaient révélés bien trop lourds. Quel usage en avait-il fait ? Et puis toutes ces trahisons qui l’avaient blessé à mort, au moment où il ne se méfiait plus. Bien sûr, ils sauraient tous après son décès, le passé sortirait de sa gangue, car il parlait aux nuages, mais leurs regards ne trouveraient plus rien à balayer de leurs yeux courroucés. Il avait tout prévu. Il ne verrouillerait pas la porte, il ferait ce qu’il avait à faire et puis ce serait terminé. Plus de secrets, plus de croix à porter, plus de douleur. Il se demanda si on éprouvait des regrets dans l’au-delà. Il ne put répondre à cette question essentielle pour lui, et il en retira une lourde angoisse.
* * *
Au petit matin, le froid réveilla Walter Brewski. Son sommeil agité l’avait fait beaucoup bouger et sa couette gisait au sol. Il se leva en prenant soin de bien dérouler son dos avant de mettre les pieds sur le vieux lino décati. Il enfila un t-shirt et un bas de survêtement, puis imbriqua ses pieds dans d’antiques chaussons. Ensuite, il releva le volet de bois qui couinait de plus en plus. Chaque matin, il s’attendait à ce que ce foutu store rende l’âme et le laisse dans la pénombre. Ça ne serait pas pour cette fois-ci, pensa-t-il en regardant la fenêtre entièrement libérée. Il l’ouvrit pour aérer la pièce. Il fallait absolument chasser à grands coups d’air pur et froid les mauvais génies de la nuit. Dans la cuisine, il alluma la cafetière qui se mit à crachoter comme un fumeur indécrottable à l’aube. Tandis que le jus sombre s’écoulait en un fin filet qui produisait un petit bruit agréable, Walt se prépara deux tartines et puis consulta sa montre. Interloqué, il se rendit compte qu’il n’était pas de service cette journée-là, et l’horizon se dégagea. Le genre de réalité qui confère un relief nouveau à un jour naissant. Walt colla son visage à la vitre de la cuisine et leva les yeux au ciel. Il aima la sensation de froid contre sa joue. Le temps ne semblait pas décidé à dégouliner, ce qui l’incita dans l’instant à consacrer une partie de sa matinée à une bonne séance de course à pied. Tandis que ses yeux scrutaient les nuages épars, une ombre le traversa. Les bribes du cauchemar revinrent s’installer comme une simple émotion. Il sentit une boule tenter de se former au creux de son ventre. Une soudaine envie d’appeler Barbara l’assaillit, puis il se souvint de l’heure qu’il était et sut qu’elle ne décrocherait pas, qu’elle devait se trouver au volant de sa voiture, en plein centre de Limoges.
Une heure après avoir avalé son petit déjeuner, il détala à travers les rues. Ussel début décembre ressemblait à une ville figée. Le coup de bourre du début de matinée avait laissé la place à une activité linéaire et assez peu engageante. Dès les premières foulées, Walt se félicita d’avoir mis des gants et un bonnet ; le froid se montrait agressif et pénétrant. La faute à cette humidité omniprésente depuis quelques jours. Il ne gelait pas, mais on flirtait avec le zéro. Très vite, Brewski s’échappa par une succession de ruelles agréables et anciennes pour se retrouver en pleine campagne. Il sentait ses jambes pleines d’énergie malgré sa nuit hachée. Il fit un effort pour ne pas leur céder et chauffer suffisamment ses muscles avant de se tirer sur la couenne. Même s’il refusait pour l’instant de l’envisager, il savait très bien que ce footing matinal n’était rien d’autre qu’une tentative désespérée de vitrifier son esprit et de ne pas penser à sa nuit. Il espérait en secret parvenir à abandonner dans ses pas, au milieu des bois et des prés, ces images du passé qui lui desquamaient le moral. Le chemin emprunté s’élevait par à-coups au milieu des arbres. Un bruit, suivi d’un mouvement que sa vision périphérique capta, attira son attention. Il stoppa et repéra tout de suite un écureuil qui jouait au funambule sur la branche d’un chêne. L’animal parut sentir qu’on l’observait et s’arrêta comme s’il venait d’être changé en pierre. Seuls ses yeux pleins de vie et de curiosité bougeaient et détaillaient Walt. Un peu essoufflé, celui-ci avait posé ses mains sur ses hanches et laissait s’échapper de sa bouche de brefs jets de condensation blanche. Cela lui fit penser à ce hérisson sur lequel il était tombé une nuit, sur la pelouse d’une habitation, un soir de crime. Ils s’étaient longtemps observés et quelque chose s’était passé, quelque chose d’indicible et d’intangible. Il avait acquis la certitude que, d’une certaine manière, ce hérisson et lui étaient entrés en communication. Il se demanda si le petit animal conservait le souvenir de cette rencontre fortuite. Il s’imagina qu’un lien s’était créé entre eux à cette occasion, et que, chaque fois qu’il pensait au hérisson, ce dernier aussi songeait à lui. Puis, comme frappé par une autre possibilité, il se dit que c’était peut-être le hérisson qui pensait à lui en premier et qui générait ainsi un réflexe identique chez lui. Cette idée lui plut beaucoup. Il décida d’en rester là de ses réflexions, séduit par les perspectives et les implications d’une telle hypothèse. Le démarrage subit de l’écureuil roux dans une gerbe de mousse le ramena à la réalité. Il sourit et reprit sa course, le cœur détourné et les pas un peu plus légers.
À son retour, il resta quelques minutes dans la cour de la caserne. Il tendit l’oreille pour écouter le brouhaha de la ville et les bruits parasites qui en émanaient. Il regretta tout de suite la sérénité de son footing. Il revit d’une manière fugace l’écureuil sur son chêne et se demanda ce qu’il pouvait bien faire à cet instant précis. Puis un nuage noir s’approcha, chargé de menaces : il repensa à Charline. Six mois déjà, mais la douleur, si elle s’apaisait, était toujours bien là. Un puissant et bref accès de colère le submergea et il sentit une grande violence circuler sous sa peau. Un désir naissant de vengeance cherchait son chemin dans son esprit et dans son cœur. Il se morigéna en le réalisant et se mit à inspirer et expirer longuement pour chasser ces sentiments qu’il considérait comme néfastes. Il se méfiait d’autant plus de ces émotions-là qu’il leur avait souvent cédé. Honteux, il reconnut même y avoir trouvé du plaisir. Mais la satisfaction de l’instant était vite balayée par les regrets et les remords, ce duo pénible et indissociable, comme deux crocs aiguisés et acérés plantés dans sa conscience. Panser ce genre de plaie était plus ardu que se vautrer dans ce qui l’avait provoquée. Walt n’était pas un philosophe ; il n’en avait lu aucun, à l’exception de Marc-Aurèle pour qui il nourrissait une grande admiration. Quand cela allait mal, quand il sentait son corps grincer de douleur, quand il percevait un risque prégnant de dérapage, il pensait aux écrits du philosophe guerrier. Il devait bien admettre que ça l’aidait beaucoup. Son désir de vengeance était vain, car il ne pouvait le diriger contre personne. Il avait trouvé cela tout seul, en réfléchissant à son malheur. L’introspection, si elle est pratiquée avec régularité et impartialité, peut être un véritable remède. Il rassembla ses forces pour repousser ce désir de se faire justice, un désir qui augmentait sa souffrance, car il savait que cela était impossible. Désirer quelque chose d’inaccessible engendre de terribles maux. Il se dit que la vengeance est une rivière indomptable, et que tout ce que l’on peut construire dessus finit toujours par être emporté dans son courant. Il frissonna et se demanda en regardant les façades de la caserne combien de personnes l’observaient, cachées derrière les rideaux de la curiosité et du voyeurisme. Puis, tout en rentrant chez lui, il repensa à son envie de se venger, et à son impossibilité de le faire. Ça palpitait à l’intérieur de lui, comme un mal caché et corrosif. Il appela à la rescousse Marc-Aurèle, le guerrier sage, le stoïcien empereur. Comme un baume, il s’appliqua sur l’esprit la grande phrase du détachement et du lâcher-prise, celle qui venait à bout de toutes ces contrariétés sur lesquelles il n’avait aucun pouvoir, mais qui, parfois, lui pourrissaient la vie. Au risque de passer pour fou, il monta l’escalier en répétant à voix basse :
— Tout ce qui est indépendant de ta volonté n’est que cadavre et fumée.
Arrivé chez lui, il se sentit mieux et se prépara un café. Tout en dégustant son breuvage brûlant et corsé, il s’interrogea sur les méandres de la pensée. Quels pouvaient être ses chemins tortueux ? Il y ajouta les souvenirs. Comment parvenaient-ils à surgir en une fraction de seconde, sans prévenir, et à repartir de la même manière en le laissant là, planté en pleine action, en train de se demander à quoi il songeait ? Alors que le parfum puissant du café lui montait aux narines, il comprit que cette boisson possédait de grandes vertus, en particulier celle d’aiguiser les esprits. Il sentit une joie immense et une grande excitation monter en lui. Il en connaissait la raison. En fin de journée, il se mettrait au volant de sa Brera et filerait en direction de Limoges. Il retrouverait Barbara, celle qui l’avait ramené d’entre les morts-vivants, celle qui l’avait dépouillé de sa peau de zombi. L’ironie du sort voulait qu’il l’ait rencontrée lors de ce funeste été, celui des grands battements de cœur et des tristesses infinies. Quand il repensait à cette période, il en conservait un goût amer et sucré à la fois, et aussi une impression de grosse gueule de bois. Il parvint à sourire en se disant qu’il avait rencontré dans une morgue celle qui lui avait redonné le goût de l’existence. La vie possède un solide humour, et ses messages ne sont pas tous aisés à décrypter. Assis dans son canapé élimé, il aspira la dernière lampée de café en grimaçant. Il était désormais tiède et Walt détestait le boire ainsi. Un éclair de lubricité le traversa quand il pensa à Barbara, nue sur son lit et lascive comme elle pouvait l’être. Elle représentait presque l’antithèse de Charline. Ses seins, même s’ils étaient respectables, ne faisaient pas la moitié de ceux de Charline. Barbara avait un corps plus sec, elle était vraiment très jolie, mais ses formes moins prononcées ne lui conféraient pas cette allure de bombe sexuelle qui accompagnait Charline dans le moindre de ses mouvements, même quand elle ne bougeait pas. Néanmoins, il émanait d’elle autre chose, un danger sous-jacent, une capacité permanente à surprendre, un côté imprévisible très excitant pour lui.
Lorsqu’ils avaient fait l’amour pour la première fois, Walt se trouvait encore en plein marasme, embourbé dans le marécage putride de la dépression. Il avait revu enfin, après des mois, le monde en couleur, un monde en Kodachrome. Barbara l’avait pris par surprise. S’attendant à des ébats assez conventionnels puisque c’était leur première fois, il fut étonné. Elle s’était montrée telle qu’elle était, elle n’avait pas posé de masque sur son visage, elle n’avait retenu aucune pulsion. Elle disait que la sagesse au pieu était un truc de coincé. Être sage dans le sexe était un non-sens. Walt était d’accord, même s’il ne s’était jamais posé la question en ces termes. Barbara avait donc laissé les rideaux ouverts, pour, avait-elle dit, qu’ils soient bénis par la lumière du jour. Puis, dans une gestuelle qui fit penser à Walt à une danse frénétique, elle avait ôté ses fringues, sa minijupe et puis son string. Walt bandait comme un étalon resté trop longtemps à l’écurie. Elle avait sauté sur lui avec des yeux allumés et des braises dans le bas-ventre. Elle ne cachait rien de ses intentions ; elle montrait tout de son corps sculpté, dépourvue du moindre gramme de pudeur. Alors que Walt pensait qu’ils allaient commencer gentiment par s’embrasser avec gourmandise, elle lui avait empoigné le pénis, droit comme un épicéa, et avait commencé à l’astiquer avec application. Walt avait eu l’impression d’être pris à la gorge et avait éprouvé des difficultés à respirer. Puis son engin avait disparu dans la bouche humide et chaude de Barbara. Ce fut la plus belle sensation depuis des mois. Agrippée à son appendice, la furie s’était activée avec une adresse et un savoir-faire sans équivoque. La jeunette s’y connaissait en turlutte et le fait d’imaginer l’étendue de ses connaissances avait excité Walt au-delà du raisonnable. Il avait voulu parler pour dire qu’elle devait arrêter si elle voulait qu’ils fassent l’amour, mais le regard de biais qu’elle lui avait adressé, langoureux et déterminé, avait étouffé ses paroles avant qu’elles ne soient formées. Il avait redressé la tête pour la voir à l’œuvre. La vision de son crâne rasé montant et descendant vers son entrejambe l’avait chauffé plus qu’il ne l’aurait pensé. Comme des fulgurances, Barbara lui avait lancé des œillades qui eurent raison de sa capacité à se retenir. Il s’était vidé dans une contorsion cataclysmique accompagnée d’un râle sublime ; son corps s’était raidi de la tête aux pieds dans une interminable convulsion de plaisir. Il avait pensé avec sincérité qu’il allait s’évanouir. Il avait senti la langue de Barbara lécher son gland et, les yeux mi-clos, il l’avait aperçue dans une espèce de brouillard, en train de remonter à quatre pattes sur lui avec un sourire de jouisseuse qui rallumait déjà sa bougie encore fumante.
Walt revint au présent dans son canapé. Il tenait toujours la tasse de café vide et il avait une trique d’enfer. Se souvenir de cette première fois l’avait excité d’une manière assez considérable. Il s’avoua un peu désappointé de constater que la concupiscence tenait tous les hommes par les couilles. Il sourit à son trait d’esprit et fila sous la douche.