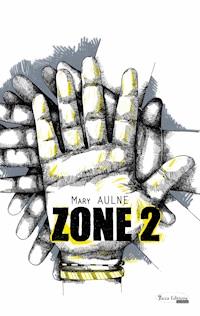
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Yucca Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Comme chaque année à la même date, Karina retourne à Bazar, le village isolé de son adolescence. Elle ne peut pas faire autrement que d’y aller. Parce que là-bas, les autres l’attendent.
Bazar. Ukraine. Depuis l’explosion nucléaire de Tchernobyl, on dit seulement qu’il est dans la zone de contamination classée 2.
ZONE 2, c’est le témoignage d’une enfant de la catastrophe. Elle parle d’amitié, d’amour, de folles espérances mêlées de peurs confuses. Bref, de ce que vivent tous les ados du monde… Et pourtant, à Bazar plus qu’ailleurs, les choses ordinaires se vivent avec une intensité particulière.
À travers le témoignage de son héroïne, l'auteur aborde de thème de la vie après Tchernobyl et donne des éléments pédagogiques pour l'expliquer aux plus jeunes.
EXTRAIT
Je m’appelle Karina, je suis née en 1984 à Bazar, un petit village situé au nord de l’Ukraine. Deux ans plus tard, dans le timide avril, ce lieu aurait dû disparaître de la carte. Mais, comme souvent dans la vie, cela ne s’est pas passé comme prévu. Je n’ai pas de souvenirs de ma vie de toute petite fille dans ce village. Un mois seulement après que la Mort ait poussé son mugissement maudit depuis les hauteurs de Tchernobyl, mes parents avaient pris valises et enfant pour se réfugier à Kiev, à l’autre pied de l’arc-en-ciel noir.
Bien plus tard, mon père a perdu son emploi de routier et nous ne pouvions plus payer le loyer de notre appartement. La seule solution qui s’offrait à nous s’étalait chaque semaine en caractères gras dans le journal. Le maire de Bazar proposait de venir vivre gratuitement dans les datchas abandonnées du village, à la condition que les habitants les rénovent à leurs frais.
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Un roman poignant, bouleversant de vérité et qui au fond nous dit de profiter de tous les petits bonheurs tant la vie est éphémère. -
Blog Viou et ses drôles de livres
En résumé un livre vraiment merveilleux que je vous recommande à lire. Laissez vos préjugés de côtés et plongez au cœur de ce récit. -
Aurélie, Les livres en folie
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 117
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mary Aulne
ZONE 2
Illustrations
Laure Cadars
Tous droits réservés pour tout pays
© Yucca Éditions, Carmaux, 2016
« Sans cornemuse, sans cornemuse,
Mes pieds marchent mal,
Mais quand ils entendent jouer la cornemuse,
Ils commencent à faire le bal ».
Chanson ukrainienne
☢
Chaque année c’est la même chose. Je suis toujours la dernière. Ce n’est pas vraiment de ma faute si on y réfléchit bien. Pourtant mon retard me met toujours mal à l’aise. Même si je ne rate jamais le rendez-vous, je ne suis pas là à l’heure prévue et cela change tout, insidieusement. C’est un peu comme si l’on m’attendait trop longtemps pour dîner et qu’à mon arrivée, le vin était éventé, le soufflé aplati et la glace fondue. Mes hôtes seraient bien sûr ravis de ma venue, mais ils ne sauraient me cacher, dans leurs excuses maladroites, que j’ai gâché le repas.
C’est que chaque année me vient la même question. Sur le bien-fondé de ces retrouvailles. Une semaine avant le jour J, déjà, j’hésite à revenir. Je soupèse tellement le pour du contre, que tout ce que la vie peut m’offrir de précieux en cette période me passe à côté. Mes yeux ont beau se poser sur ses trésors, ils n’en voient pas la lumière. Ils ne perçoivent plus qu’une chose : comptabiliser les raisons favorables et défavorables à ce voyage. Mon esprit devient un manège. Préoccupé à comparer les résultats, et à recommencer sans fin la même addition.
J’attends à l’arrêt de bus, mais cette question me fait laisser filer l’autocar de onze heures. Sans moi. Tant que je n’ai pas terminé de vérifier mes comptes, je ne peux pas me décider. Je suis ainsi faite que je déteste avancer dans le flou.
Et puis, finalement, le bus de quinze heures se présente devant moi. Je ne peux plus reculer, je sais qu’ils m’attendent, que je n’ai pas prévenu de mon absence. Je n’ai pas d’autre choix que de monter.
La route est noire et longue. Elle semble ne jamais devoir finir. Comme ce rendez-vous qui revient sans cesse. Chaque année, je rejoins l’horizon, pensant y trouver la fin de l’histoire, mais chaque année, il me faut y retourner la chercher. Cela ressemble un peu à la quête du pied de l’arc-en-ciel que l’on n’atteint jamais… au détail près que je ne nourris plus en moi ce rêve d’enfant. Mon arc-en-ciel à moi est devenu la courbe d’une route noire.
Ce n’est pas tout à fait dix-sept heures quand je franchis les grilles du cimetière. Il me paraît plus grand que la fois précédente, et je sais que ce n’est pas seulement une impression personnelle. Ici, comme dans beaucoup d’endroits du monde, il y a plus de morts que de vivants. Ici, comme partout, on ne sait pas quand on va mourir. Ici, comme dans d’autres endroits du monde, on meurt tôt, parfois même avant d’avoir vécu.
À ma gauche, le soleil rouge s’enfonce dans la mer brune des pins et des bouleaux. Je ne regarde pas ce naufragé silencieux. Je fixe les deux silhouettes qui se détachent sur ce tableau de sang. Elles me tournent le dos, mais je sais que leurs visages n’ont pas changé. Ici, on est vieux dès l’enfance. C’est peut-être aussi pour cette raison que l’on meurt plus tôt.
Gennadiy, sa stature haute et dégingandée. Je me rappelle ses bras musclés ainsi que le goût doux amer de sa peau. Il serre la main de Laryssa. Laryssa, petite fleur qui aurait cessé de grandir après avoir gelé, un froid matin de printemps.
Je m’approche d’eux. Ils entendent forcément mes pas qui font gémir le gravier. Mais aucun ne se retourne. Ils savent que c’est moi. Qui d’autre pourrait venir à cette heure ?
Parvenue à leur hauteur, Laryssa lâche la main de Gennadiy. C’est toujours Laryssa qui laisse la main de Gennadiy, et non l’inverse. Cet ordre des choses me pince quelque part dans la zone droite du cœur. Ensuite Laryssa passe son bras autour de mes épaules, et finalement Gennadiy consent à faire de même.
Nous voilà tous les trois serrés comme un seul corps dans la pénombre sanglante du couchant. Un monstre à trois têtes face à la tombe de Pavlo.
Personne ne parle, personne ne pleure. Ici, comme dans d’autres endroits du monde, seules les mères ont encore des larmes. Les autres sont résignés.
☢
Je m’appelle Karina, je suis née en 1984 à Bazar, un petit village situé au nord de l’Ukraine. Deux ans plus tard, dans le timide avril, ce lieu aurait dû disparaître de la carte. Mais, comme souvent dans la vie, cela ne s’est pas passé comme prévu. Je n’ai pas de souvenirs de ma vie de toute petite fille dans ce village. Un mois seulement après que la Mort ait poussé son mugissement maudit depuis les hauteurs de Tchernobyl, mes parents avaient pris valises et enfant pour se réfugier à Kiev, à l’autre pied de l’arc-en-ciel noir.
Bien plus tard, mon père a perdu son emploi de routier et nous ne pouvions plus payer le loyer de notre appartement. La seule solution qui s’offrait à nous s’étalait chaque semaine en caractères gras dans le journal. Le maire de Bazar proposait de venir vivre gratuitement dans les datchas abandonnées du village, à la condition que les habitants les rénovent à leurs frais.
Moi, je ne voulais pas quitter mes amis. Mais j’étais en âge de comprendre les épreuves de la vie. Quand la décision fut prise de retourner à Bazar, maman s’est mise à répéter que « là-bas ou ailleurs, c’était partout pareil ». Sa litanie était devenue un chapelet qu’elle égrenait à longueur de journée. Une prière routinière pour nous rassurer tous, elle y comprise.
Je me souviens de notre arrivée. Les tours venaient de s’effondrer de l’autre côté du monde. Nous n’avons pas pu habiter dans l’ancienne maison de mes parents, car elle n’était plus qu’une ruine. Le maire nous a menés à une autre datcha, non loin du centre du village. Quand nous en avons franchi le seuil, j’ai bien cru qu’elle allait s’effondrer, elle aussi. Ma mère exprima ma pensée, en cachant sa pauvre phrase derrière ses mains « le monde s’écroule autour de nous ». Mon père, lui, ne dit rien. Cela faisait longtemps que sa vie n’en finissait plus de s’écrouler.
Mais après nous avoir laissé faire un tour rapide de notre nouveau foyer, papa s’agaça d’entendre geindre ma mère. Avec une brusque sagesse, il nous pria de mettre un peu d’ordre dans la maison, tandis que lui monterait vérifier le toit.
Les voisins n’ont rien demandé. Notre histoire ressemblait à celle de tous. Ceux qui le purent nous offrirent quelques légumes. Ils ajoutèrent que nous trouverions tout ce dont nous aurions besoin à l’épicerie. En attendant que notre propre potager nous fasse vivre à la saison prochaine.
Ils ont précisé que l’on pouvait manger des cerises et des pommes de terre, mais pas d’oseille ni de raisin… trop de césium d’après les analyses des scientifiques.
☢
J’avais accompagné ma mère chez l’épicier, monsieur Nikonenko. Il nous a souhaité la bienvenue à Bazar. Il se souvenait très bien de ma mère et du bébé. Comme j’avais grandi… Il avait également pris des nouvelles de papa.
Je m’étais demandé s’il arrivait que des clients lui annoncent leur installation dans la région suite à un emploi.
Depuis le rayon de lait garanti « non irradié », j’avais continué d’écouter la conversation. Ils auraient pu croire que les descriptifs savants des emballages me faisaient froncer les sourcils, alors qu’en vérité, je venais d’être frappée en plein cœur par les propos métalliques de l’épicier qui contrastaient avec la chaleur de ses vœux énoncés quelques minutes plus tôt. Il expliquait à ma mère de faire ici comme chez elle, sans oublier que toute avance devait être acquittée impérativement à la fin de mois. Il n’y avait pas d’exception à la règle, aucun privilège, sinon l’homme n’avait plus qu’à mettre la clé sous la porte... L’épicier m’avait fait l’effet d’un seigneur assis sur son trésor et exigeant la taxe à ses serfs acculés.
Même si nous en avions eu l’envie, nous n’aurions pas pu laisser nos provisions sur le comptoir. Les denrées souillées de la cupidité du ventripotent Nikonenko allaient nous nourrir. Il n’y avait pas d’alternative. La seule possibilité de me rebeller était de décider de ne pas salir mon corps de son lait, fût-il préservé de toute radiation. Et je reposai vivement la brique sur le rayon.
Avant de rentrer, maman avait voulu me montrer le centre de Bazar. Comme nous avions les bras chargés de courses, il s’agissait juste de jeter un coup d’œil rapide. La mairie-école et la bibliothèque se dressaient sur notre gauche. Les bâtiments étaient décrépis, mais ils semblaient propres et en état d’accueillir les habitants. Maman s’était tournée vers une ruine imposante de l’autre côté de la rue et s’était soudainement figée. En grandes lettres rouges, la façade annonçait encore ce que la bâtisse avait été autrefois : un théâtre.
Ma mère fut très émue, comme si elle retrouvait un vieil ami après de longues années de séparation. L’émotion avait dû lui faire oublier les poches qui nous sciaient les doigts, car elle m’avait bredouillé de la suivre à l’intérieur.
Les portes de la bâtisse étaient grandes ouvertes et, dans le hall, une dame nous avait fait signe d’entrer. Avec ses cheveux noirs hirsutes et ses petits yeux ronds, elle ressemblait à un oiseau exotique dont je n’ai jamais su le nom et qui a un énorme cou rougeâtre.
Je ne pouvais détacher mes yeux de ce goitre dont les soubresauts accompagnaient chaque parole de la femme, mais j’arrivai cependant à retenir les informations principales qu’elle nous donna.
Du théâtre, si charmant autrefois, il ne restait rien. Durant les premiers mois qui avaient suivi la catastrophe, les gens avaient préféré ne plus se chauffer avec le bois des forêts environnantes. Ils avaient peur que des fumées toxiques s’échappent de la combustion. Alors ils avaient pris tout le bois qu’ils avaient pu dans les lieux publics. Les sièges et la scène du théâtre, les étagères de la bibliothèque… Seule l’école avait été épargnée. C’est quand il n’y eut plus rien à brûler qu’on alla à nouveau couper les arbres de la forêt ! Maintenant, les menuisiers fabriquaient du nouveau mobilier… pour remplacer l’ancien parti en fumée !
Dans ce qui était autrefois la salle de spectacle, on avait installé un bar de fortune, quelques tables et des chaises dépareillées. C’était un lieu bruyant et convivial où les jeunes, surtout, venaient se retrouver et boire du café. Au fond de cette grande pièce, une estrade minuscule s’offrait à ceux qui travaillaient dans les ateliers. En effet, les coulisses avaient été transformées en salles de dessin, comédie ou musique, selon des horaires établis. Ce « centre culturel », dont la femme avait la responsabilité, n’avait aucune prétention, sinon celle de fournir un abri aux enfants qui traînaient trop leur chagrin dans les rues de Bazar.
À l’une des tables, trois paires d’yeux s’étaient mises tout à coup à me fixer et cela fut trop pour que je ne me sente pas mal à l’aise. Il y avait un jeune homme grand et efflanqué, dont les cheveux châtains cachaient à peine deux billes couleur noisette, ainsi qu’un autre garçon, plus petit et trapu avec un singulier visage d’ange aux prunelles bleues. Entre eux deux se tenait une fille. Le regard d’un vert perçant, on aurait pu la prendre pour une enfant, si son tee-shirt n’avait laissé deviner sa poitrine.
Mon cerveau photographia instantanément ces trois têtes qui me dévisageaient. Attablés tels des juges prêts à énoncer leur sentence, je les surnommai déjà les trois mousquetaires. Je me détournai au plus vite de leur regard inquisiteur comme si c’était le KGB qui était à mes trousses. Je pressai discrètement ma mère de rentrer à la maison, prétextant, mais sans réellement exagérer, que les sacs devenaient trop lourds à porter.
☢
L’hiver était arrivé très vite. Un matin, j’avais ouvert les volets et il avait brusquement posé un baiser glacé sur chacune de mes joues. Je compris plus tard que l’hiver ne part jamais vraiment de Bazar. Il sommeille tel un poisson, les yeux grands ouverts, au fond de l’eau. Et puis un jour, d’un seul coup de queue, il remonte troubler l’onde à la surface.
Nous ne sortions plus de la maison que par nécessité. Faire les courses, chercher de l’eau à la fontaine du bout de la rue. Les baisers du poisson-hiver mordaient trop fort. Dans les rues, la vie se déroulait au ralenti, comme si les gens se mouvaient dans l’écume blanche de son bocal. Ils avaient le pas lent, les yeux vides et les joues trop maigres. La fatigue les terrassait et la maladie planait au-dessus de leur tête telle une auréole de sainteté. Même les jeunes les moins faibles quittaient un temps leur errance pour se réfugier dans la chaleur du centre culturel.
Pas une quinzaine ne s’écoulait entièrement sans que l’église ne sonne un nouveau mort. Leucémie, cancer… À Bazar, on ne mourait pas de vieillesse. Le césium ne nous en laissait pas le plaisir.
Un jour cependant, il y eut un léger couac dans la parade du poisson-hiver. Un trébuchement de rien auquel il ne s’attendait sûrement pas. Un infime je ne sais quoi qui allait modifier pour longtemps la rondeur de l’onde à la surface de l’eau blanche.
Maman m’avait demandé d’aller changer les livres que nous avions empruntés à la bibliothèque. Elle avait retardé l’échéance autant que possible, mais à présent que nous avions lu Jane Eyre et Crimes et Châtiments par deux fois chacune, nous avions vraiment envie de nouvelles lectures. Maman n’eut pas à insister beaucoup. Rester coincée à la maison m’engourdissait tellement, j’étais plus qu’heureuse de pouvoir défier le poisson-hiver et ses baisers piquants.
Tandis que je passais devant l’école, je les vis, eux : les trois mousquetaires. Adossés à un mur gris, ils cachaient leurs rires moqueurs derrière l’écran de fumée de la cigarette qu’ils se partageaient. Comme les autres rares passants, j’avais feint de ne pas les remarquer.













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)















