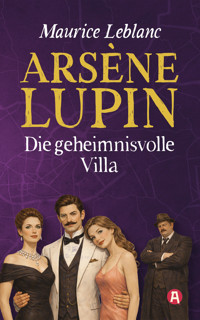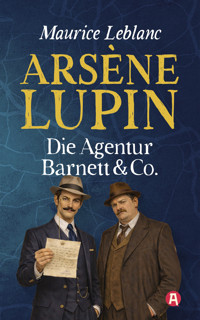Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
813 est un roman de Maurice Leblanc mettant en scène les aventures d'Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur. Contrairement aux volumes précédents des histoires d'Arsène Lupin qui étaient parus en feuilleton dans Je sais tout, il est publié dans le quotidien Le Journal, un des plus importants de l'époque, de mars à mai 1910. Le volume est sorti dès le mois de juin 1910 aux éditions Lafitte. C'est un épais volume de 500 pages. Il sera réédité en 1917 en deux volumes intitulés 813 et Les trois crimes d'Arsène Lupin. Le texte est modifié pour accentuer l'aspect anti-germanique, Première Guerre mondiale en cours oblige. On trouvera ensuite le premier volume sous le titre La double vie d'Arsène Lupin. Le ton de ce roman est assez différent des trois premiers : on a affaire à un Arsène Lupin complexe, inquiétant, dont l'objectif n'est ni plus ni moins que de dominer l'Europe. 813 contient aussi un nombre assez grand de morts très violentes, et un ennemi redoutable, invisible et particulièrement inquiétant, L.M.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
813
Pages de titrePremière partieLa double vie d’Arsène Lupin123451 - 12 - 11 - 22 - 23 - 14 - 15 - 11 - 32 - 33 - 21 - 42 - 43 - 31 - 52 - 53 - 41 - 62 - 6Deuxième partieLes trois crimes d’Arsène Lupin1 - 72 - 73 - 54 - 21 - 82 - 81 - 92 - 93 - 61 - 102 - 101 - 112 - 113 - 71 - 122 - 123 - 84 - 31 - 132 - 133 - 91 - 142 - 143 - 104 - 41 - 152 - 153 - 11Épilogue1 - 162 - 16Page de copyrightMaurice Leblanc
Arsène Lupin
« 813 »
Première partie
La double vie d’Arsène Lupin
Le massacre
1
M. Kesselbach s’arrêta net au seuil du salon, prit le bras de son secrétaire, et murmura d’une voix inquiète :
– Chapman, on a encore pénétré ici.
– Voyons, voyons, monsieur, protesta le secrétaire, vous venez vous-même d’ouvrir la porte de l’antichambre, et, pendant que nous déjeunions au restaurant, la clef n’a pas quitté votre poche.
– Chapman, on a encore pénétré ici, répéta M. Kesselbach.
Il montra un sac de voyage qui se trouvait sur la cheminée.
– Tenez, la preuve est faite. Ce sac était fermé. Il ne l’est plus.
Chapman objecta :
– Êtes-vous bien sûr de l’avoir fermé, monsieur ? D’ailleurs, ce sac ne contient que des bibelots sans valeur, des objets de toilette...
– Il ne contient que cela parce que j’en ai retiré mon portefeuille avant de sortir, par précaution, sans quoi... Non, je vous le dis, Chapman, on a pénétré ici pendant que nous déjeunions.
Au mur, il y avait un appareil téléphonique. Il décrocha le récepteur.
– Allô ! C’est pour M. Kesselbach, l’appartement 415. C’est cela... Mademoiselle, veuillez demander la Préfecture de police, Service de la Sûreté... Vous n’avez pas besoin du numéro, n’est-ce pas ? Bien, merci... J’attends à l’appareil.
Une minute après, il reprenait :
– Allô ? allô ? Je voudrais dire quelques mots à M. Lenormand, le chef de la Sûreté. C’est de la part de M. Kesselbach... Allô ? Mais oui, M. le chef de la Sûreté sait de quoi il s’agit. C’est avec son autorisation que je téléphone... Ah ! il n’est pas là... À qui ai-je l’honneur de parler ? M. Gourel, inspecteur de police... Mais il me semble, monsieur Gourel, que vous assistiez, hier, à mon entrevue avec M. Lenormand... Eh bien ! monsieur, le même fait s’est reproduit aujourd’hui. On a pénétré dans l’appartement que j’occupe. Et si vous veniez dès maintenant, vous pourriez peut-être découvrir, d’après les indices... D’ici une heure ou deux ? Parfaitement. Vous n’aurez qu’à vous faire indiquer l’appartement 415. Encore une fois, merci !
De passage à Paris, Rudolf Kesselbach, le roi du diamant, comme on l’appelait – ou, selon son autre surnom, le Maître du Cap – le multimillionnaire Rudolf Kesselbach (on estimait sa fortune à plus de cent millions), occupait depuis une semaine, au quatrième étage du Palace-Hôtel, l’appartement 415, composé de trois pièces, dont les deux plus grandes à droite, le salon et la chambre principale, avaient vue sur l’avenue, et dont l’autre, à gauche, qui servait au secrétaire Chapman, prenait jour sur la rue de Judée.
À la suite de cette chambre, cinq pièces étaient retenues pour Mme Kesselbach, qui devait quitter Monte-Carlo, où elle se trouvait actuellement, et rejoindre son mari au premier signal de celui-ci.
Durant quelques minutes, Rudolf Kesselbach se promena d’un air soucieux. C’était un homme de haute taille, coloré de visage, jeune encore, auquel des yeux rêveurs, dont on apercevait le bleu tendre à travers des lunettes d’or, donnaient une expression de douceur et de timidité, qui contrastait avec l’énergie du front carré et de la mâchoire osseuse.
Il alla vers la fenêtre : elle était fermée. Du reste, comment aurait-on pu s’introduire par là ? Le balcon particulier qui entourait l’appartement s’interrompait à droite ; et, à gauche, il était séparé par un refend de pierre des balcons de la rue de Judée.
Il passa dans sa chambre : elle n’avait aucune communication avec les pièces voisines. Il passa dans la chambre de son secrétaire : la porte qui s’ouvrait sur les cinq pièces réservées à Mme Kesselbach était close, et le verrou poussé.
– Je n’y comprends rien, Chapman, voilà plusieurs fois que je constate ici des choses... des choses étranges, vous l’avouerez. Hier, c’était ma canne qu’on a dérangée... Avant-hier, on a certainement touché à mes papiers, et cependant comment serait-il possible ?
– C’est impossible, monsieur, s’écria Chapman, dont la placide figure d’honnête homme ne s’animait d’aucune inquiétude. Vous supposez, voilà tout... vous n’avez aucune preuve, rien que des impressions... Et puis quoi ! on ne peut pénétrer dans cet appartement que par l’antichambre. Or, vous avez fait faire une clef spéciale le jour de votre arrivée, et il n’y a que votre domestique Edwards qui en possède le double. Vous avez confiance en lui ?
– Parbleu ! depuis dix ans qu’il est à mon service... Mais Edwards déjeune en même temps que nous, et c’est un tort. À l’avenir, il ne devra descendre qu’après notre retour.
Chapman haussa légèrement les épaules. Décidément, le Maître du Cap devenait quelque peu bizarre avec ses craintes inexpliquées. Quel risque court-on dans un hôtel, alors surtout qu’on ne garde sur soi ou près de soi aucune valeur, aucune somme d’argent importante ?
Ils entendirent la porte du vestibule qui s’ouvrait. C’était Edwards.
M. Kesselbach l’appela.
– Vous êtes en livrée, Edwards ? Ah ! bien ! Je n’attends pas de visite aujourd’hui, Edwards, ou plutôt si, une visite, celle de M. Gourel. D’ici là, restez dans le vestibule et surveillez la porte. Nous avons à travailler sérieusement, M. Chapman et moi.
Le travail sérieux dura quelques instants pendant lesquels M. Kesselbach examina son courrier, parcourut trois ou quatre lettres et indiqua les réponses qu’il fallait faire. Mais soudain Chapman, qui attendait, la plume levée, s’aperçut que M. Kesselbach pensait à autre chose qu’à son courrier.
Il tenait entre ses doigts, et regardait attentivement, une épingle noire recourbée en forme d’hameçon.
– Chapman, fit-il, voyez ce que j’ai trouvé sur la table. Il est évident que cela signifie quelque chose, cette épingle recourbée. Voilà une preuve, une pièce à conviction. Et vous ne pouvez plus prétendre qu’on n’ait pas pénétré dans ce salon. Car enfin, cette épingle n’est pas venue là toute seule.
– Certes non, répondit le secrétaire, elle y est venue grâce à moi.
– Comment ?
– Oui, c’est une épingle qui fixait ma cravate à mon col. Je l’ai retirée hier soir tandis que vous lisiez, et l’ai tordue machinalement.
M. Kesselbach se leva, très vexé, fit quelques pas, et s’arrêtant :
– Vous riez sans doute, Chapman... et vous avez raison... Je ne le conteste pas, je suis plutôt... excentrique, depuis mon dernier voyage au Cap. C’est que... voilà... vous ne savez pas ce qu’il y a de nouveau dans ma vie... un projet formidable... une chose énorme... que je ne vois encore que dans les brouillards de l’avenir, mais qui se dessine pourtant... et qui sera colossale... Ah ! Chapman, vous ne pouvez pas imaginer. L’argent, je m’en moque, j’en ai... j’en ai trop... Mais cela, c’est davantage, c’est la puissance, la force, l’autorité. Si la réalité est conforme à ce que je pressens, je ne serai plus seulement le Maître du Cap, mais le maître aussi d’autres royaumes... Rudolf Kesselbach, le fils du chaudronnier d’Augsbourg, marchera de pair avec bien des gens qui, jusqu’ici, le traitaient de haut... Il aura même le pas sur eux, Chapman, il aura le pas sur eux, soyez-en certain... et si jamais...
Il s’interrompit, regarda Chapman comme s’il regrettait d’en avoir trop dit, et cependant, entraîné par son élan, il conclut :
– Vous comprenez, Chapman, les raisons de mon inquiétude... Il y a là, dans le cerveau, une idée qui vaut cher... et cette idée, on la soupçonne peut-être... et l’on m’épie... j’en ai la conviction...
Une sonnerie retentit.
– Le téléphone... dit Chapman.
– Est-ce que, par hasard, murmura M. Kesselbach, ce serait...
Il prit l’appareil.
– Allô ?... De la part de qui ? Le colonel ?... Ah ! Eh bien ! oui, c’est moi... Il y a du nouveau ?... Parfait... Alors je vous attends... Vous viendrez avec vos hommes ? Parfait... Allô ! Non, nous ne serons pas dérangés... je vais donner les ordres nécessaires... C’est donc si grave ?... Je vous répète que la consigne sera formelle... mon secrétaire et mon domestique garderont la porte, et personne n’entrera. Vous connaissez le chemin, n’est-ce pas ? Par conséquent, ne perdez pas une minute.
Il raccrocha le récepteur, et aussitôt :
– Chapman, deux messieurs vont venir... Oui, deux messieurs... Edwards les introduira...
– Mais... M. Gourel... le brigadier...
– Il arrivera plus tard... dans une heure... Et puis, quand même, ils peuvent se rencontrer. Donc, dites à Edwards d’aller dès maintenant au bureau et de prévenir. Je n’y suis pour personne... sauf pour deux messieurs, le colonel et son ami, et pour M. Gourel. Qu’on inscrive les noms.
Chapman exécuta l’ordre. Quand il revint, il trouva M. Kesselbach qui tenait à la main une enveloppe, ou plutôt une petite pochette de maroquin noir, vide sans doute, à en juger par l’apparence. Il semblait hésiter, comme s’il ne savait qu’en faire. Allait-il la mettre dans sa poche ou la déposer ailleurs ? Enfin, il s’approcha de la cheminée et jeta l’enveloppe de cuir dans son sac de voyage.
– Finissons le courrier, Chapman. Nous avons dix minutes. Ah ! une lettre de Mme Kesselbach. Comment se fait-il que vous ne me l’ayez pas signalée, Chapman ? Vous n’aviez donc pas reconnu l’écriture ?
Il ne cachait pas l’émotion qu’il éprouvait à toucher et à contempler cette feuille de papier que sa femme avait tenue entre ses doigts, et où elle avait mis un peu de sa pensée secrète. Il en respira le parfum, et, l’ayant décachetée, lentement il la lut, à mi-voix, par bribes que Chapman entendait :
– Un peu lasse... je ne quitte pas la chambre... je m’ennuie... quand pourrai-je vous rejoindre ? Votre télégramme sera le bienvenu... Vous avez télégraphié ce matin, Chapman ? Ainsi donc Mme Kesselbach sera ici demain mercredi.
Il paraissait tout joyeux, comme si le poids de ses affaires se trouvait subitement allégé, et qu’il fût délivré de toute inquiétude. Il se frotta les mains et respira largement, en homme fort, certain de réussir, en homme heureux, qui possédait le bonheur et qui était de taille à se défendre.
– On sonne, Chapman, on a sonné au vestibule. Allez voir.
Mais Edwards entra et dit :
– Deux messieurs demandent monsieur. Ce sont les personnes...
– Je sais. Elles sont là, dans l’antichambre ?
– Oui, monsieur.
– Refermez la porte de l’antichambre, et n’ouvrez plus... sauf à M. Gourel, brigadier de la Sûreté. Vous, Chapman, allez chercher ces messieurs, et dites-leur que je voudrais d’abord parler au colonel, au colonel seul.
Edwards et Chapman sortirent, en ramenant sur eux la porte du salon. Rudolf Kesselbach se dirigea vers la fenêtre et appuya son front contre la vitre.
Dehors, tout au-dessous de lui, les voitures et les automobiles roulaient dans les sillons parallèles, que marquait la double ligne de refuges. Un clair soleil de printemps faisait étinceler les cuivres et les vernis. Aux arbres un peu de verdure s’épanouissait, et les bourgeons des marronniers commençaient à déplier leurs petites feuilles naissantes.
– Que diable fait Chapman ? murmura Kesselbach... Depuis le temps qu’il parlemente !...
Il prit une cigarette sur la table puis, l’ayant allumée, il tira quelques bouffées. Un léger cri lui échappa. Près de lui, debout, se tenait un homme qu’il ne connaissait point.
Il recula d’un pas.
– Qui êtes-vous ?
L’homme – c’était un individu correctement habillé, plutôt élégant, noir de cheveux et de moustache, les yeux durs – l’homme ricana :
– Qui je suis ? Mais, le colonel...
– Mais non, mais non, celui que j’appelle ainsi, celui qui m’écrit sous cette signature... de convention... ce n’est pas vous.
– Si, si... l’autre n’était que... Mais, voyez-vous, mon cher monsieur, tout cela n’a aucune importance. L’essentiel c’est que moi, je sois... moi. Et je vous jure que je le suis.
– Mais enfin, monsieur, votre nom ?
– Le colonel... jusqu’à nouvel ordre.
Une peur croissante envahissait M. Kesselbach. Qui était cet homme ? Que lui voulait-il ?
Il appela :
– Chapman !
– Quelle drôle d’idée d’appeler ! Ma société ne vous suffit pas ?
– Chapman ! répéta M. Kesselbach. Chapman ! Edwards !
– Chapman ! Edwards ! dit à son tour l’inconnu. Que faites-vous donc, mes amis ? On vous réclame.
– Monsieur, je vous prie, je vous ordonne de me laisser passer.
– Mais, mon cher monsieur, qui vous en empêche ?
Il s’effaça poliment. M. Kesselbach s’avança vers la porte, l’ouvrit, et brusquement sauta en arrière. Devant cette porte il y avait un autre homme, le pistolet au poing.
Il balbutia :
– Edwards... Chap...
Il n’acheva pas. Il avait aperçu dans un coin de l’antichambre, étendus l’un près de l’autre, bâillonnés et ficelés, son secrétaire et son domestique.
M. Kesselbach, malgré sa nature inquiète, impressionnable, était brave, et le sentiment d’un danger précis, au lieu de l’abattre, lui rendait tout son ressort et toute son énergie.
Doucement, tout en simulant l’effroi, la stupeur, il recula vers la cheminée et s’appuya contre le mur. Son doigt cherchait la sonnerie électrique. Il trouva et pressa le bouton longuement.
– Et après ? fit l’inconnu.
Sans répondre, M. Kesselbach continua d’appuyer.
– Et après ? Vous espérez qu’on va venir, que tout l’hôtel est en rumeur parce que vous pressez ce bouton ?... Mais, mon pauvre monsieur, retournez-vous donc, et vous verrez que le fil est coupé.
M. Kesselbach se retourna vivement, comme s’il voulait se rendre compte, mais, d’un geste rapide, il s’empara du sac de voyage, plongea la main, saisit un revolver, le braqua sur l’homme et tira.
– Bigre ! fit celui-ci, vous chargez donc vos armes avec de l’air et du silence ?
Une seconde fois le chien claqua, puis une troisième. Aucune détonation ne se produisit.
– Encore trois coups, roi du Cap. Je ne serai content que quand j’aurai six balles dans la peau. Comment ! vous y renoncez ? Dommage... le carton s’annonçait bien.
Il agrippa une chaise par le dossier, la fit tournoyer, s’assit à califourchon, et montrant un fauteuil à M. Kesselbach :
– Prenez donc la peine de vous asseoir, cher monsieur, et faites ici comme chez vous. Une cigarette ? Pour moi, non. Je préfère les cigares.
Il y avait une boîte sur la table. Il choisit un Upman blond et bien façonné, l’alluma et, s’inclinant :
– Je vous remercie. Ce cigare est délicieux. Et maintenant, causons, voulez-vous ?
Rudolf Kesselbach écoutait avec stupéfaction. Quel était cet étrange personnage ? À le voir si paisible cependant, et si loquace, il se rassurait peu à peu et commençait à croire que la situation pourrait se dénouer sans violence ni brutalité. Il tira de sa poche un portefeuille, le déplia, exhiba un paquet respectable de bank-notes et demanda :
– Combien ?
L’autre le regarda d’un air ahuri, comme s’il avait de la peine à comprendre. Puis au bout d’un instant, appela :
– Marco !
L’homme au revolver s’avança.
– Marco, monsieur a la gentillesse de t’offrir ces quelques chiffons pour ta bonne amie. Accepte, Marco.
Tout en braquant son revolver de la main droite, Marco tendit la main gauche, reçut les billets et se retira.
– Cette question réglée selon votre désir, reprit l’inconnu, venons au but de ma visite. Je serai bref et précis. Je veux deux choses. D’abord une petite enveloppe en maroquin noir, que vous portez généralement sur vous. Ensuite, une cassette d’ébène qui, hier encore, se trouvait dans le sac de voyage. Procédons par ordre. L’enveloppe de maroquin ?
– Brûlée.
L’inconnu fronça le sourcil. Il dut avoir la vision des bonnes époques où il y avait des moyens péremptoires de faire parler ceux qui s’y refusent.
– Soit. Nous verrons ça. Et la cassette d’ébène ?
– Brûlée.
– Ah ! gronda-t-il, vous vous payez ma tête, mon brave homme.
Il lui tordit le bras d’une façon implacable.
– Hier, Rudolf Kesselbach, hier, vous êtes entré au Crédit Lyonnais, sur le boulevard des Italiens, en dissimulant un paquet sous votre pardessus. Vous avez loué un coffre-fort... Précisons : le coffre numéro 16, travée 9. Après avoir signé et payé, vous êtes descendu dans les sous-sols, et, quand vous êtes remonté, vous n’aviez plus votre paquet. Est-ce exact ?
– Absolument.
– Donc, la cassette et l’enveloppe sont au Crédit Lyonnais.
– Non.
– Donnez-moi la clef de votre coffre.
– Non.
– Marco !
Marco accourut.
– Vas-y, Marco. Le quadruple nœud.
Avant même qu’il eût le temps de se mettre sur la défensive, Rudolf Kesselbach fut enserré dans un jeu de cordes qui lui meurtrirent les chairs dès qu’il voulut se débattre. Ses bras furent immobilisés derrière son dos, son buste attaché au fauteuil et ses jambes entourées de bandelettes comme les jambes d’une momie.
– Fouille, Marco.
Marco fouilla. Deux minutes après, il remettait à son chef une petite clef plate, nickelée, qui portait les numéros 16 et 9.
– Parfait. Pas d’enveloppe de maroquin ?
– Non, patron.
– Elle est dans le coffre. Monsieur Kesselbach, veuillez me dire le chiffre secret.
– Non.
– Vous refusez ?
– Oui.
– Marco ?
– Patron ?
– Applique le canon de ton revolver sur la tempe de monsieur.
– Ça y est.
– Appuie ton doigt sur la détente.
– Voilà.
– Eh bien ! mon vieux Kesselbach, es-tu décidé à parler ?
– Non.
– Tu as dix secondes, pas une de plus. Marco ?
– Patron ?
– Dans dix secondes tu feras sauter la cervelle de monsieur.
– Entendu.
– Kesselbach, je compte : une, deux, trois, quatre, cinq, six...
Rudolf Kesselbach fit un signe :
– Tu veux parler ?
– Oui.
– Il était temps. Alors, le chiffre... le mot de la serrure ?
– Dolor.
– Dolor... Douleur... Mme Kesselbach ne s’appelle-t-elle pas Dolorès ? Chéri, va... Marco, tu vas faire ce qui est convenu... Pas d’erreur, hein ? Je répète... Tu vas rejoindre Jérôme au bureau où tu sais, tu lui remettras le clef et tu lui diras le mot d’ordre : Dolor. Vous irez ensemble au Crédit Lyonnais. Jérôme entrera seul, signera le registre d’identité, descendra dans les caves, et emportera tout ce qui se trouve dans le coffre-fort. Compris ?
– Oui, patron. Mais si par hasard le coffre n’ouvre pas, si le mot « Dolor »...
– Silence, Marco. Au sortir du Crédit Lyonnais, tu lâcheras Jérôme, tu rentreras chez toi, et tu me téléphoneras le résultat de l’opération. Si par hasard le mot « Dolor » n’ouvre pas le coffre, nous aurons, mon ami Kesselbach et moi, un petit entretien suprême. Kesselbach, tu es sûr de ne t’être point trompé ?
– Oui.
– C’est qu’alors tu escomptes la nullité de la perquisition. Nous verrons ça. File, Marco.
– Mais vous, patron ?
– Moi, je reste. Oh ! ne crains rien. Je n’ai jamais couru aussi peu de danger. N’est-ce pas, Kesselbach, la consigne est formelle ?
– Oui.
– Diable, tu me dis ça d’un air bien empressé. Est-ce que tu aurais cherché à gagner du temps ? Alors je serais pris au piège, comme un idiot ?
Il réfléchit, regarda son prisonnier et conclut :
– Non... ce n’est pas possible... nous ne serons pas dérangés...
Il n’avait pas achevé ce mot que la sonnerie du vestibule retentit. Violemment il appliqua sa main sur la bouche de Rudolf Kesselbach.
– Ah ! vieux renard, tu attendais quelqu’un !
Les yeux du captif brillaient d’espoir.
On l’entendit ricaner, sous la main qui l’étouffait.
L’homme tressaillit de rage.
– Tais-toi... sinon, je t’étrangle. Tiens, Marco, bâillonne-le. Fais vite... Bien.
On sonna de nouveau. Il cria, comme s’il était, lui, Rudolf Kesselbach, et qu’Edwards fût encore là :
– Ouvrez donc, Edwards.
Puis il passa doucement dans le vestibule, et, à voix basse, désignant le secrétaire et le domestique :
– Marco, aide-moi à pousser ça dans la chambre... là... de manière qu’on ne puisse les voir.
Il enleva le secrétaire, Marco emporta le domestique.
– Bien, maintenant retourne au salon.
Il le suivit, et aussitôt, repassant une seconde fois dans le vestibule, il prononça très haut d’un air étonné :
– Mais votre domestique n’est pas là, monsieur Kesselbach... non, ne vous dérangez pas... finissez votre lettre... J’y vais moi-même.
Et tranquillement il ouvrit la porte d’entrée.
– M. Kesselbach ? lui demanda-t-on.
Il se trouvait en face d’une sorte de colosse, à la large figure réjouie, aux yeux vifs, qui se dandinait d’une jambe sur l’autre et tortillait entre ses mains les rebords de son chapeau. Il répondit :
– Parfaitement, c’est ici. Qui dois-je annoncer ?
– M. Kesselbach a téléphoné... il m’attend...
– Ah ! c’est vous... je vais prévenir... voulez-vous patienter une minute ?... M. Kesselbach va vous parler.
Il eut l’audace de laisser le visiteur sur le seuil de l’antichambre, à un endroit d’où l’on pouvait apercevoir, par la porte ouverte, une partie du salon. Et lentement, sans même se retourner, il rentra, rejoignit son complice auprès de M. Kesselbach, et lui dit :
– Nous sommes fichus. C’est Gourel, de la Sûreté...
L’autre empoigna son couteau. Il lui saisit le bras :
– Pas de bêtises, hein ! J’ai une idée. Mais, pour Dieu, comprends-moi bien, Marco, et parle à ton tour... Parle comme si tu étais Kesselbach... Tu entends, Marco, tu es Kesselbach.
Il s’exprimait avec un tel sang-froid et une autorité si violente que Marco comprit, sans plus d’explication, qu’il devait jouer le rôle de Kesselbach, et prononça, de façon à être entendu :
– Vous m’excuserez, mon cher. Dites à M. Gourel que je suis désolé, mais que j’ai à faire par-dessus la tête... Je le recevrai demain matin à neuf heures, oui, à neuf heures exactement.
– Bien, souffla l’autre, ne bouge plus.
Il revint dans l’antichambre, Gourel attendait. Il lui dit :
– M. Kesselbach s’excuse. Il achève un travail important. Vous est-il possible de venir demain matin, à neuf heures ?
Il y eut un silence. Gourel semblait surpris et vaguement inquiet. Au fond de sa poche, le poing de l’homme se crispa. Un geste équivoque, et il frappait.
Enfin, Gourel dit :
– Soit... À demain neuf heures... mais tout de même... Eh bien ! oui, neuf heures, je serai là...
Et, remettant son chapeau, il s’éloigna par les couloirs de l’hôtel.
Marco, dans le salon, éclata de rire.
– Rudement fort, le patron. Ah ! ce que vous l’avez roulé !
– Débrouille-toi, Marco, tu vas le filer. S’il sort de l’hôtel, lâche-le, retrouve Jérôme, comme c’est convenu... et téléphone.
Marco s’en alla rapidement.
Alors l’homme saisit une carafe sur la cheminée, se versa un grand verre d’eau qu’il avala d’un trait, mouilla son mouchoir, baigna son front que la sueur couvrait, puis s’assit auprès de son prisonnier, et lui dit avec une affectation de politesse :
– Il faut pourtant bien, monsieur Kesselbach, que j’aie l’honneur de me présenter à vous.
Et, tirant une carte de sa poche, il prononça :
– Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur.
2
Le nom du célèbre aventurier sembla faire sur M. Kesselbach la meilleure impression. Lupin ne manqua pas de le remarquer et s’écria :
– Ah ! ah ! cher monsieur, vous respirez ! Arsène Lupin est un cambrioleur délicat, le sang lui répugne, il n’a jamais commis d’autre crime que de s’approprier le bien d’autrui... une peccadille, quoi ! et vous vous dites qu’il ne va pas se charger la conscience d’un assassinat inutile. D’accord... Mais votre suppression sera-t-elle inutile ? Tout est là. En ce moment, je vous jure que je ne rigole pas. Allons-y, camarade.
Il rapprocha sa chaise du fauteuil, relâcha le bâillon de son prisonnier, et, nettement :
– Monsieur Kesselbach, le jour même de ton arrivée à Paris, tu entrais en relation avec le nommé Barbareux, directeur d’une agence de renseignements confidentiels, et, comme tu agissais à l’insu de ton secrétaire Chapman, le sieur Barbareux, quand il communiquait avec toi, par lettre ou par téléphone, s’appelait « le colonel ». Je me hâte de te dire que Barbareux est le plus honnête homme du monde. Mais j’ai la chance de compter un de ses employés parmi mes meilleurs amis. C’est ainsi que j’ai su le motif de ta démarche auprès de Barbareux, et c’est ainsi que j’ai été amené à m’occuper de toi, et à te rendre, grâce à de fausses clés, quelques visites domiciliaires au cours desquelles, hélas ! je n’ai pas trouvé ce que je voulais.
Il baissa la voix, et, les yeux dans les yeux de son prisonnier, scrutant son regard, cherchant sa pensée obscure, il articula :
– Monsieur Kesselbach, tu as chargé Barbareux de découvrir dans les bas-fonds de Paris un homme qui porte, ou a porté, le nom de Pierre Leduc, et dont voici le signalement sommaire : taille, un mètre soixante-quinze, blond, moustaches. Signe particulier : à la suite d’une blessure, l’extrémité du petit doigt de la main gauche a été coupée. En outre, une cicatrice presque effacée à la joue droite. Tu sembles attacher à la découverte de cet homme une importance énorme, comme s’il pouvait en résulter pour toi des avantages considérables. Qui est cet homme ?
– Je ne sais pas.
La réponse fut catégorique, absolue. Savait-il ou ne savait-il pas ? Peu importait. L’essentiel, c’est qu’il était décidé à ne point parler.
– Soit, fit son adversaire, mais tu as sur lui des renseignements plus détaillés que ceux que tu as fournis à Barbareux ?
– Aucun.
– Tu mens, monsieur Kesselbach. Deux fois, devant Barbareux, tu as consulté des papiers enfermés dans l’enveloppe de maroquin.
– En effet.
– Alors, cette enveloppe ?
– Brûlée.
Lupin tressaillit de rage. évidemment, l’idée de la torture et des commodités qu’elle offrait traversa de nouveau son cerveau.
– Brûlée ? mais la cassette... avoue donc... avoue donc qu’elle est au Crédit Lyonnais ?
– Oui.
– Et qu’est-ce qu’elle contient ?
– Les deux cents plus beaux diamants de ma collection particulière.
Cette affirmation ne sembla pas déplaire à l’aventurier.
– Ah ! ah ! les deux cents plus beaux diamants ! Mais dis donc, c’est une fortune... Oui, ça te fait sourire... Pour toi, c’est une bagatelle. Et ton secret vaut mieux que ça... Pour toi, oui, mais pour moi ?
Il prit un cigare, alluma une allumette qu’il laissa éteindre machinalement et resta quelque temps pensif, immobile. Les minutes passaient.
Il se mit à rire.
– Tu espères bien que l’expédition ratera, et qu’on n’ouvrira pas le coffre ? Possible, mon vieux. Mais alors il faudra me payer mon dérangement. Je ne suis pas venu ici pour voir la tête que tu fais sur un fauteuil... Les diamants, puisque diamants il y a... Sinon, l’enveloppe de maroquin... Le dilemme est posé...
Il consulta sa montre.
– Une demi-heure... Bigre !... Le destin se fait tirer l’oreille... Mais ne rigole donc pas, monsieur Kesselbach. Foi d’honnête homme, je ne rentrerai pas bredouille... Enfin !
C’était la sonnerie du téléphone. Lupin s’empara vivement du récepteur, et changeant le timbre de sa voix, imitant les intonations rudes de son prisonnier :
– Oui, c’est moi, Rudolf Kesselbach... Ah ! bien, mademoiselle, mettez-moi en communication... C’est toi, Marco ?... Parfait... Ça s’est bien passé ?... À la bonne heure... Pas d’accrocs ?... Compliments, l’enfant... Alors, qu’est-ce qu’on a ramassé ? La cassette d’ébène... Pas autre chose ? aucun papier ?... Tiens, tiens !... Et dans la cassette ?... Sont-ils beaux, ces diamants ?... Parfait... parfait... Une minute, Marco, que je réfléchisse... tout ça, vois-tu... si je te disais mon opinion... Tiens, ne bouge pas... reste à l’appareil...
Il se retourna :
– Monsieur Kesselbach, tu y tiens à tes diamants ?
– Oui.
– Tu me les rachèterais ?
– Peut-être.
– Combien ? Cinq cent mille ?
– Cinq cent mille... oui...
– Seulement, voilà le hic... Comment se fera l’échange ? Un chèque ? Non, tu me roulerais... ou bien je te roulerais... écoute, après-demain matin, passe au Lyonnais, prends tes cinq cents billets et va te promener au Bois, près d’Auteuil... moi, j’aurai les diamants... dans un sac, c’est plus commode... la cassette se voit trop...
– Non... non... la cassette... je veux tout...
– Ah ! fit Lupin, éclatant de rire... tu es tombé dans le panneau... Les diamants, tu t’en fiches... ça se remplace... Mais la cassette, tu y tiens comme à ta peau... Eh bien ! tu l’auras, ta cassette... foi d’Arsène... tu l’auras, demain matin par colis postal !
Il reprit le téléphone.
– Marco, tu as la boîte sous les yeux ?... Qu’est-ce qu’elle a de particulier ? De l’ébène, incrusté d’ivoire... oui, je connais ça... style japonais, faubourg Saint-Antoine... Pas de marque ? Ah ! une petite étiquette ronde, bordée de bleu, et portant un numéro... oui, une indication commerciale... aucune importance. Et le dessous de la boîte, est-il épais ?... Bigre ! pas de double fond, alors... Dis donc, Marco, examine les incrustations d’ivoire sur le dessus... ou plutôt, non, le couvercle.
Il exulta de joie.
– Le couvercle ! c’est ça, Marco ! Kesselbach a cligné de l’œil... Nous brûlons !... Ah ! mon vieux Kesselbach, tu ne voyais donc pas que je te guignais. Fichu maladroit !
Et, revenant à Marco :
– Eh bien ! où en es-tu ? Une glace à l’intérieur du couvercle ?... Est-ce qu’elle glisse ?... Y a-t-il des rainures ? Non... eh bien ! casse-la... Mais oui, je te dis de la casser... Cette glace n’a aucune raison d’être... elle a été rajoutée.
Il s’impatienta :
– Mais, imbécile, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas... Obéis.
Il dut entendre le bruit que Marco faisait, au bout du fil, pour briser le miroir, car il s’écria, triomphalement :
– Qu’est-ce que je te disais, monsieur Kesselbach, que la chasse serait bonne ?... Allô ? Ça y est ? Eh bien ?... Une lettre ? Victoire ! Tous les diamants du Cap et le secret du bonhomme !
Il décrocha le second récepteur, appliqua soigneusement les deux plaques sur ses oreilles, et reprit :
– Lis, Marco, lis doucement... L’enveloppe d’abord... Bon... Maintenant, répète.
Lui-même répéta :
– Copie de la lettre contenue dans la pochette de maroquin noir. Et après ? Déchire l’enveloppe, Marco. Vous permettez, monsieur Kesselbach ? Ça n’est pas très correct, mais enfin... Vas-y, Marco, M. Kesselbach t’y autorise. Ça y est ? Eh bien ! lis.
Il écouta, puis ricanant :
– Fichtre ! ce n’est pas aveuglant. Voyons, je résume. Une simple feuille de papier pliée en quatre et dont les plis paraissent tout neufs... Bien... En haut et à droite de cette feuille, ces mots : un mètre soixante-quinze, petit doigt gauche coupé, etc. Oui, c’est le signalement du sieur Pierre Leduc. De l’écriture de Kesselbach, n’est-ce pas ?... Bien... Et au milieu de la feuille ce mot, en lettres capitales d’imprimerie :
APOON
Marco, mon petit, tu vas laisser le papier tranquille, tu ne toucheras pas à la cassette ni aux diamants. Dans dix minutes j’en aurai fini avec mon bonhomme. Dans vingt minutes je te rejoins... Ah ! à propos, tu m’as envoyé l’auto ? Parfait. À tout à l’heure.
Il remit l’appareil en place, passa dans le vestibule, puis dans la chambre, s’assura que le secrétaire et le domestique n’avaient pas desserré leurs liens et que, d’autre part, ils ne risquaient pas d’être étouffés par leurs bâillons, et il revint vers son prisonnier.
Il avait une expression résolue, implacable.
– Fini de rire, Kesselbach. Si tu ne parles pas, tant pis pour toi. Es-tu décidé ?
– À quoi ?
– Pas de bêtises. Dis ce que tu sais.
– Je ne sais rien.
– Tu mens. Que signifie ce mot Apoon ?
– Si je le savais, je ne l’aurais pas inscrit.
– Soit, mais à qui, à quoi se rapporte-t-il ? Où l’as-tu copié ? D’où cela te vient-il ?
M. Kesselbach ne répondit pas.
Lupin reprit, plus nerveux, plus saccadé :
– écoute, Kesselbach, je vais te faire une proposition. Si riche, si gros monsieur que tu sois, il n’y a pas entre toi et moi tant de différence. Le fils du chaudronnier d’Augsbourg et Arsène Lupin, prince des cambrioleurs, peuvent s’accorder sans honte ni pour l’un ni pour l’autre. Moi, je vole en appartement ; toi, tu voles en Bourse. Tout ça, c’est kif-kif. Donc, voilà, Kesselbach. Associons-nous pour cette affaire. J’ai besoin de toi puisque je l’ignore. Tu as besoin de moi parce que, tout seul, tu n’en sortiras pas. Barbareux est un niais. Moi, je suis Lupin. Ça colle ?
Un silence. Lupin insista, d’une voix qui tremblait :
– Réponds, Kesselbach, ça colle ? Si oui, en quarante-huit heures, je te le retrouve, ton Pierre Leduc. Car il s’agit bien de lui, hein ? C’est ça, l’affaire ? Mais réponds donc ! Qu’est-ce que c’est que cet individu ? Pourquoi le cherches-tu ? Que sais-tu de lui ? Je veux savoir.
Il se calma subitement, posa sa main sur l’épaule de l’Allemand et, d’un ton sec :
– Un mot seulement. Oui... ou non ?
– Non.
Il tira du gousset de Kesselbach un magnifique chronomètre en or et le plaça sur les genoux du prisonnier.
Il déboutonna le gilet de Kesselbach, écarta la chemise, découvrit la poitrine, et, saisissant un stylet d’acier, à manche niellé d’or, qui se trouvait près de lui, sur la table, il en appliqua la pointe à l’endroit où les battements du cœur faisaient palpiter la chair nue.
– Une dernière fois ?
– Non.
– Monsieur Kesselbach, il est trois heures moins huit. Si dans huit minutes vous n’avez pas répondu, vous êtes mort.
3
Le lendemain matin, à l’heure exacte qui lui avait été fixée, le brigadier Gourel se présenta au Palace-Hôtel. Sans s’arrêter, et dédaigneux de l’ascenseur, il monta les escaliers. Au quatrième étage il tourna à droite, suivit le couloir, et vint sonner à la porte du 415.
Aucun bruit ne se faisant entendre, il recommença. Après une demi-douzaine de tentatives infructueuses, il se dirigea vers le bureau de l’étage. Un maître d’hôtel s’y trouvait.
– M. Kesselbach, s’il vous plaît ? Voilà dix fois que je sonne.
– M. Kesselbach n’a pas couché là. Nous ne l’avons pas vu depuis hier après-midi.
– Mais son domestique, son secrétaire ?
– Nous ne les avons pas vus non plus.
– Alors, eux non plus n’auraient pas couché à l’hôtel ?
– Sans doute.
– Sans doute ! Mais vous devriez avoir une certitude.
– Pourquoi ? M. Kesselbach n’est pas à l’hôtel ici, il est chez lui, dans son appartement particulier. Son service n’est pas fait par nous, mais par son domestique, et nous ne savons rien de ce qui se passe chez lui.
– En effet... en effet...
Gourel semblait fort embarrassé. Il était venu avec des ordres formels, une mission précise, dans les limites de laquelle son intelligence pouvait s’exercer. En dehors de ces limites, il ne savait trop comment agir.
– Si le Chef était là... murmura-t-il, si le Chef était là...
Il montra sa carte et déclina ses titres. Puis il demanda, à tout hasard :
– Donc, vous ne les avez pas vus rentrer ?
– Non.
– Mais vous les avez vus sortir ?
– Non plus.
– En ce cas, comment savez-vous qu’ils sont sortis ?
– Par un monsieur qui est venu hier après-midi au 415.
– Un monsieur à moustaches brunes ?
– Oui. Je l’ai rencontré comme il s’en allait vers trois heures. Il m’a dit : « Les personnes du 415 viennent de sortir. M. Kesselbach couchera ce soir à Versailles, aux Réservoirs, où vous pouvez lui envoyer son courrier. »
– Mais quel était ce monsieur ? À quel titre parlait-il ?
– Je l’ignore.
Gourel était inquiet. Tout cela lui paraissait assez bizarre.
– Vous avez la clef ?
– Non. M. Kesselbach avait fait faire des clefs spéciales.
– Allons voir.
Gourel sonna de nouveau furieusement. Rien. Il se disposait à partir quand, soudain, il se baissa et appliqua vivement son oreille contre le trou de la serrure.
– écoutez... on dirait... mais oui... c’est très net... des plaintes... des gémissements...
Il donna dans la porte un véritable coup de poing.
– Mais, monsieur, vous n’avez pas le droit...
– Je n’ai pas le droit !
Il frappait à coups redoublés, mais si vainement qu’il y renonça aussitôt.
– Vite, vite, un serrurier.
Un des garçons d’hôtel s’éloigna en courant. Gourel allait de droite et de gauche, bruyant et indécis. Les domestiques des autres étages formaient des groupes. Les gens du bureau, de la direction, arrivaient. Gourel s’écria :
– Mais pourquoi n’entrerait-on pas par les chambres contiguës ? Elles communiquent avec l’appartement ?
– Oui, mais les portes de communication sont toujours verrouillées des deux côtés.
– Alors, je téléphone à la Sûreté, dit Gourel, pour qui, visiblement, il n’existait point de salut en dehors de son chef.
– Et au commissariat, observa-t-on.
– Oui, si ça vous plaît, répondit-il du ton d’un monsieur que cette formalité intéresse peu.
Quand il revint du téléphone, le serrurier achevait d’essayer ses clefs. La dernière fit jouer la serrure. Gourel entra vivement.
Aussitôt il courut à l’endroit d’où venaient les plaintes, et se heurta aux deux corps du secrétaire Chapman et du domestique Edwards. L’un d’eux, Chapman, à force de patience, avait réussi à détendre un peu son bâillon, et poussait de petits grognements sourds. L’autre semblait dormir.
On les délivra. Gourel s’inquiétait.
– Et M. Kesselbach ?
Il passa dans le salon. M. Kesselbach était assis et attaché au dossier du fauteuil, près de la table. Sa tête était inclinée sur sa poitrine.
– Il est évanoui, dit Gourel en s’approchant de lui. Il a dû faire des efforts qui l’ont exténué.
Rapidement, il coupa les cordes qui liaient les épaules. D’un bloc, le buste s’écroula en avant. Gourel l’empoigna à bras-le-corps, et recula en poussant un cri d’effroi :
– Mais il est mort ! Tâtez... les mains sont glacées, et regardez les yeux !
Quelqu’un hasarda :
– Une congestion, sans doute... ou une rupture d’anévrisme.
– En effet, il n’y a pas de trace de blessure... c’est une mort naturelle.
On étendit le cadavre sur le canapé, et l’on défit ses vêtements. Mais, tout de suite, sur la chemise blanche, des taches rouges apparurent, et, dès qu’on l’eut écartée, on s’aperçut que, à l’endroit du cœur, la poitrine était trouée d’une petite fente par où coulait un mince filet de sang.
Et sur la chemise était épinglée une carte.
Gourel se pencha. C’était la carte d’Arsène Lupin, toute sanglante elle aussi.
Alors Gourel se redressa, autoritaire et brusque :
– Un crime !... Arsène Lupin !... Sortez... Sortez tous... Que personne ne reste dans ce salon ni dans la chambre... Qu’on transporte et qu’on soigne ces messieurs dans une autre pièce !... Sortez tous... Et qu’on ne touche à rien... Le chef va venir !
4
Arsène Lupin !
Gourel répétait ces deux mots fatidiques d’un air absolument pétrifié. Ils résonnaient en lui comme un glas. Arsène Lupin ! le bandit-roi ! l’aventurier suprême ! Voyons, était-ce possible ?
– Mais non, mais non, murmura-t-il, ce n’est pas possible, puisqu’il est mort !
Seulement, voilà... était-il réellement mort ?
Arsène Lupin !
Debout, près du cadavre, il demeurait stupide, abasourdi, tournant et retournant la carte avec une certaine crainte, comme s’il venait de recevoir la provocation d’un fantôme. Arsène Lupin ! Qu’allait-il faire ? Agir ? Engager la bataille avec ses propres ressources ?... Non, non... il valait mieux ne pas agir... Les fautes étaient inévitables s’il relevait le défi d’un tel adversaire. Et puis le chef n’allait-il pas venir ?
Le chef va venir ! Toute la psychologie de Gourel se résumait dans cette petite phrase. Habile et persévérant, plein de courage et d’expérience, d’une force herculéenne, il était de ceux qui ne vont de l’avant que lorsqu’ils sont dirigés et qui n’accomplissent de bonne besogne que lorsqu’elle leur est commandée.
Combien ce manque d’initiative s’était aggravé depuis que M. Lenormand avait pris la place de M. Dudouis au service de la Sûreté ! Celui-là était un chef, M. Lenormand ! Avec celui-là, on était sûr de marcher dans la bonne voie ! Si sûr même que Gourel s’arrêtait dès que l’impulsion du chef ne lui était plus donnée.
Mais le chef allait venir ! Sur sa montre, Gourel calculait l’heure exacte de cette arrivée. Pourvu que le commissaire de police ne le précédât point et que le juge d’instruction, déjà désigné sans doute, ou le médecin légiste, ne vinssent pas faire d’inopportunes constatations avant que le chef n’eût eu le temps de fixer dans son esprit les points essentiels de l’affaire !
– Eh bien, Gourel, à quoi rêves-tu ?
– Le chef !
M. Lenormand était un homme encore jeune, si l’on considérait l’expression même de son visage, ses yeux qui brillaient sous ses lunettes ; mais c’était presque un vieillard si l’on notait son dos voûté, sa peau sèche comme jaunie à la cire, sa barbe et ses cheveux grisonnants, toute son apparence brisée, hésitante, maladive.
Il avait péniblement passé sa vie aux colonies, comme commissaire du gouvernement, dans les postes les plus périlleux. Il y avait gagné des fièvres, une énergie indomptable malgré sa déchéance physique, l’habitude de vivre seul, de parler peu et d’agir en silence, une certaine misanthropie et, soudain, vers cinquante-cinq ans, à la suite de la fameuse affaire des trois Espagnols de Biskra, la grande, la juste notoriété. On réparait alors l’injustice, et, d’emblée, on le nommait à Bordeaux, puis sous-chef à Paris, puis, à la mort de M. Dudouis, chef de la Sûreté. Et, en chacun de ces postes, il avait montré une invention si curieuse dans les procédés, de telles ressources, des qualités si neuves, si originales, et surtout il avait abouti à des résultats si précis dans la conduite des quatre ou cinq derniers scandales qui avaient passionné l’opinion publique qu’on opposait son nom à celui des plus illustres policiers. Gourel, lui, n’hésita pas. Favori du chef, qui l’aimait pour sa candeur et pour son obéissance passive, il mettait M. Lenormand au-dessus de tous. C’était l’idole, le dieu qui ne se trompe pas.
M. Lenormand, ce jour-là, semblait particulièrement fatigué. Il s’assit avec lassitude, écarta les pans de sa redingote, une vieille redingote célèbre par sa coupe surannée et par sa couleur olive, dénoua son foulard, un foulard marron également fameux, et murmura : « Parle. »
Gourel raconta tout ce qu’il avait vu et tout ce qu’il avait appris, et il le raconta sommairement, selon l’habitude que le chef lui avait imposée.
Mais quand il exhiba la carte de Lupin, M. Lenormand tressaillit.
– Lupin ! s’écria-t-il.
– Oui, Lupin, le voilà revenu sur l’eau, cet animal-là.
– Tant mieux, tant mieux, fit M. Lenormand après un instant de réflexion.
– évidemment, tant mieux, reprit Gourel, qui se plaisait à commenter les rares paroles d’un supérieur auquel il ne reprochait que d’être trop peu loquace, tant mieux, car vous allez enfin vous mesurer avec un adversaire digne de vous... Et Lupin trouvera son maître... Lupin n’existera plus... Lupin...
– Cherche, fit M. Lenormand, lui coupant la parole.
On eût dit l’ordre d’un chasseur à son chien. Et, de fait, ce fut à la manière d’un bon chien, vif, intelligent, fureteur, que chercha Gourel sous les yeux de son maître. Du bout de sa canne, M. Lenormand désignait tel coin, tel fauteuil, comme on désigne un buisson ou une touffe d’herbe avec une conscience minutieuse.
– Rien, conclut le brigadier.
– Rien pour toi, grogna M. Lenormand.
– C’est ce que je voulais dire... Je sais que, pour vous, il y a des choses qui parlent comme des personnes, de vrais témoins. N’empêche que voilà un crime bel et bien établi à l’actif du sieur Lupin.
– Le premier, observa M. Lenormand.
– Le premier, en effet... Mais c’était inévitable. On ne mène pas cette vie-là, sans, un jour ou l’autre, être acculé au crime par les circonstances. M. Kesselbach se sera défendu...
– Non, puisqu’il était attaché.
– En effet, avoua Gourel déconcerté, et c’est même fort curieux... Pourquoi tuer un adversaire qui n’existe déjà plus ?... Mais n’importe, si je lui avais mis la main au collet, hier, quand nous nous sommes trouvés l’un en face de l’autre, au seuil du vestibule...
M. Lenormand avait passé sur le balcon. Puis il visita la chambre de M. Kesselbach, à droite, vérifia la fermeture des fenêtres et des portes.
– Les fenêtres de ces deux pièces étaient fermées quand je suis entré, affirma Gourel.
– Fermées ou poussées ?
– Personne n’y a touché. Or, elles sont fermées, chef...
Un bruit de voix les ramena au salon. Ils y trouvèrent le médecin légiste, en train d’examiner le cadavre, et M. Formerie, juge d’instruction.
Et M. Formerie s’exclamait :
– Arsène Lupin ! Enfin, je suis heureux qu’un hasard bienveillant me remette en face de ce bandit ! Le gaillard verra de quel bois je me chauffe !... Et cette fois il s’agit d’un assassin !... À nous deux, maître Lupin !
M. Formerie n’avait pas oublié l’étrange aventure du diadème de la princesse de Lamballe, et l’admirable façon dont Lupin l’avait roulé, quelques années auparavant. La chose était restée célèbre dans les annales du Palais. On en riait encore, et M. Formerie, lui, en conservait un juste sentiment de rancune et le désir de prendre une revanche éclatante.
– Le crime est évident, prononça-t-il de son air le plus convaincu, le mobile nous sera facile à découvrir. Allons, tout va bien... Monsieur Lenormand, je vous salue... Et je suis enchanté...
M. Formerie n’était nullement enchanté. La présence de M. Lenormand lui agréait au contraire fort peu, le chef de la Sûreté ne dissimulant guère le mépris où il le tenait. Pourtant il se redressa, et toujours solennel :
– Alors, docteur, vous estimez que la mort remonte à une douzaine d’heures environ, peut-être davantage ?... C’est ce que je suppose... nous sommes tout à fait d’accord... Et l’instrument du crime ?
– Un couteau à lame très fine, monsieur le juge d’instruction, répondit le médecin... Tenez, on a essuyé la lame avec le mouchoir même du mort...
– En effet... en effet... la trace est visible... Et maintenant nous allons interroger le secrétaire et le domestique de M. Kesselbach. Je ne doute pas que leur interrogatoire ne nous fournisse quelque lumière.
Chapman, que l’on avait transporté dans sa propre chambre, à gauche du salon, ainsi qu’Edwards, était déjà remis de ses épreuves. Il exposa par le menu les événements de la veille, les inquiétudes de M. Kesselbach, la visite annoncée du soi-disant colonel, et enfin raconta l’agression dont ils avaient été victimes.
– Ah ! ah ! s’écria M. Formerie, il y a un complice ! et vous avez entendu son nom... Marco, dites-vous... Ceci est très important. Quand nous tiendrons le complice, la besogne sera avancée...
– Oui, mais nous ne le tenons pas, risqua M. Lenormand.
– Nous allons voir... chaque chose à son temps. Et alors, monsieur Chapman, ce Marco est parti aussitôt après le coup de sonnette de M. Gourel ?
– Oui, nous l’avons entendu partir.
– Et après ce départ vous n’avez plus rien entendu ?
– Si... de temps à autre, mais vaguement... La porte était close.
– Et quelle sorte de bruit ?
– Des éclats de voix. L’individu...
– Appelez-le par son nom, Arsène Lupin.
– Arsène Lupin a dû téléphoner.
– Parfait ! Nous interrogerons la personne de l’hôtel qui est chargée du service des communications avec la ville. Et plus tard, vous l’avez entendu sortir, lui aussi ?
– Il a constaté que nous étions toujours bien attachés, et, un quart d’heure après, il partait en refermant sur lui la porte du vestibule.
– Oui, aussitôt son forfait accompli. Parfait... Parfait... Tout s’enchaîne... Et après ?
– Après, nous n’avons plus rien entendu... la nuit s’est passée... la fatigue m’a assoupi... Edwards également... et ce n’est que ce matin...
– Oui... je sais... Allons, ça ne va pas mal... tout s’enchaîne...
Et, marquant les étapes de son enquête, du ton dont il aurait marqué autant de victoires sur l’inconnu, il murmura pensivement :
– Le complice... le téléphone... l’heure du crime... les bruits perçus... Bien... Très bien... il nous reste à fixer le mobile du crime. En l’espèce, comme il s’agit de Lupin, le mobile est clair. Monsieur Lenormand, vous n’avez pas remarqué la moindre trace d’effraction ?
– Aucune.
– C’est qu’alors le vol aura été effectué sur la personne même de la victime. A-t-on retrouvé son portefeuille ?
– Je l’ai laissé dans la poche de la jaquette, dit Gourel.
Ils passèrent tous dans le salon, où M. Formerie constata que le portefeuille ne contenait que des cartes de visite et des papiers d’identité.
– C’est bizarre. Monsieur Chapman, vous ne pourriez pas nous dire si M. Kesselbach avait sur lui une somme d’argent ?
– Oui, la veille, c’est-à-dire avant-hier lundi, nous sommes allés au Crédit Lyonnais, où M. Kesselbach a loué un coffre...
– Un coffre au Crédit Lyonnais ? Bien... il faudra voir de ce côté.
– Et, avant de partir, M. Kesselbach s’est fait ouvrir un compte, et il a emporté cinq ou six mille francs en billets de banque.
– Parfait... nous sommes éclairés.
Chapman reprit :
– Il y a un autre point, monsieur le juge d’instruction. M. Kesselbach, qui depuis quelques jours était très inquiet – je vous en ai dit la cause... un projet auquel il attachait une importance extrême – M. Kesselbach semblait tenir particulièrement à deux choses : d’abord une cassette d’ébène, et cette cassette il l’a mise en sûreté au Crédit Lyonnais, et ensuite une petite enveloppe de maroquin noir où il avait enfermé quelques papiers.
– Et cette enveloppe ?
– Avant l’arrivée de Lupin, il l’a déposée devant moi dans ce sac de voyage.
M. Formerie prit le sac et fouilla. L’enveloppe ne s’y trouvait pas. Il se frotta les mains.
– Allons, tout s’enchaîne Nous connaissons le coupable, les conditions et le mobile du crime. Cette affaire-là ne traînera pas. Nous sommes bien d’accord sur tout, monsieur Lenormand ?
– Sur rien.
Il y eut un instant de stupéfaction. Le commissaire de police était arrivé et, derrière lui, malgré les agents qui gardaient la porte, la troupe des journalistes et le personnel de l’hôtel avaient forcé l’entrée et stationnaient dans l’antichambre.
Si notoire que fût la rudesse du bonhomme, rudesse qui n’allait pas sans quelque grossièreté et qui lui avait déjà valu certaines semonces en haut lieu, la brusquerie de la réponse déconcerta. Et M. Formerie, tout spécialement, parut interloqué.
– Pourtant, dit-il, je ne vois rien là que de très simple : Lupin est le voleur...
– Pourquoi a-t-il tué ? lui jeta M. Lenormand.
– Pour voler.
– Pardon, le récit des témoins prouve que le vol a eu lieu avant l’assassinat. M. Kesselbach a d’abord été ligoté et bâillonné, puis volé. Pourquoi Lupin qui, jusqu’ici, n’a jamais commis de crime, aurait-il tué un homme réduit à l’impuissance et déjà dépouillé ?
Le juge d’instruction caressa ses longs favoris blonds d’un geste qui lui était familier quand une question lui paraissait insoluble. Il répondit d’un ton pensif :
– Il y a à cela plusieurs réponses...
– Lesquelles ?
– Cela dépend... cela dépend d’un tas d’éléments encore inconnus... Et puis, d’ailleurs, l’objection ne vaut que pour la nature des motifs. Pour le reste, nous sommes d’accord.
– Non.
Cette fois encore, ce fut net, coupant, presque impoli, au point que le juge, tout à fait désemparé, n’osa même pas protester et qu’il resta interdit devant cet étrange collaborateur. À la fin il articula :
– Chacun son système. Je serais curieux de connaître le vôtre.
– Je n’en ai pas.
Le chef de la Sûreté se leva et fit quelques pas à travers le salon en s’appuyant sur sa canne. Autour de lui, on se taisait... et c’était assez curieux de voir ce vieil homme malingre et cassé dominer les autres par la force d’une autorité que l’on subissait sans l’accepter encore.
Après un long silence, il prononça :
– Je voudrais visiter les pièces qui touchent à cet appartement.
Le directeur lui montra le plan de l’hôtel. La chambre de droite, celle de M. Kesselbach, n’avait point d’autre issue que le vestibule même de l’appartement. Mais la chambre de gauche, celle du secrétaire, communiquait avec une autre pièce.
Il dit :
– Visitons-la.
M. Formerie ne put s’empêcher de hausser les épaules et de bougonner :
– Mais la porte de communication est verrouillée et la fenêtre close.
– Visitons-la, répéta M. Lenormand.
On le conduisit dans cette pièce qui était la première des cinq chambres réservées à Mme Kesselbach. Puis, sur sa prière, on le conduisit dans les chambres qui suivaient. Toutes les portes de communication étaient verrouillées des deux côtés.
Il demanda :
– Aucune de ces pièces n’est occupée ?
– Aucune.
– Les clefs ?
– Les clefs sont toujours au bureau.
– Alors, personne ne pouvait s’introduire ?...
– Personne, sauf le garçon d’étage chargé d’aérer et d’épousseter.
– Faites-le venir.
Le domestique, un nommé Gustave Beudot, répondit que la veille, selon sa consigne, il avait fermé les fenêtres des cinq chambres.
– À quelle heure ?
– À six heures du soir.
– Et vous n’avez rien remarqué ?
– Non, rien.
– Et ce matin ?
– Ce matin, j’ai ouvert les fenêtres, sur le coup de huit heures.
– Et vous n’avez rien trouvé ?
– Non rien... Ah ! cependant...
Il hésitait. On le pressa de questions, et il finit par avouer :
– Eh bien, j’ai ramassé, près de la cheminée du 420, un étui à cigarettes... que je me proposais de porter ce soir au bureau.
– Vous l’avez sur vous ?
– Non, il est dans ma chambre. C’est un étui en acier bruni. D’un côté, on met du tabac et du papier à cigarettes, de l’autre des allumettes. Il y a deux initiales en or... un L et un M.
– Que dites-vous ?
C’était Chapman qui s’était avancé. Il semblait très surpris, et, interpellant le domestique :
– Un étui en acier bruni, dites-vous ?
– Oui.
– Avec trois compartiments pour le tabac, le papier et les allumettes... du tabac russe, n’est-ce pas, fin, blond ?
– Oui.
– Allez le chercher... Je voudrais voir... me rendre compte moi-même...
Sur un signe du chef de la Sûreté, Gustave Beudot s’éloigna. M. Lenormand s’était assis, et, de son regard aigu, il examinait le tapis, les meubles, les rideaux. Il s’informa :
– Nous sommes bien au 420, ici ?
– Oui.
Le juge ricana :
– Je voudrais bien savoir quel rapport vous établissez entre cet incident et le drame. Cinq portes fermées nous séparent de la pièce où Kesselbach a été assassiné.
M. Lenormand ne daigna pas répondre.
Du temps passa. Gustave ne revenait pas.
– Où couche-t-il, monsieur le directeur ? demanda le chef.
– Au sixième, sur la rue de Judée, donc, au-dessus de nous. Il est curieux qu’il ne soit pas encore là.
– Voulez-vous avoir l’obligeance d’envoyer quelqu’un ?
Le directeur s’y rendit lui-même, accompagné de Chapman. Quelques minutes après, il revenait seul, en courant, les traits bouleversés.
– Eh bien ?
– Mort...
– Assassiné ?
– Oui.
– Ah ! tonnerre, ils sont de force, les misérables ! proféra M. Lenormand. Au galop, Gourel, qu’on ferme les portes de l’hôtel... Veille aux issues... Et vous, monsieur le directeur, conduisez-nous dans la chambre de Gustave Beudot.
Le directeur sortit. Mais, au moment de quitter la chambre, M. Lenormand se baissa et ramassa une toute petite rondelle de papier sur laquelle ses yeux s’étaient déjà fixés.
C’était une étiquette encadrée de bleu. Elle portait le chiffre 813. À tout hasard, il la mit dans son portefeuille et rejoignit les autres personnes.
5
Une fine blessure au dos, entre les deux omoplates... Le médecin déclara :
– Exactement la même blessure que M. Kesselbach.
– Oui, fit M. Lenormand, c’est la même main qui a frappé, et c’est la même arme qui a servi.
D’après la position du cadavre, l’homme avait été surpris à genoux devant son lit, et cherchant sous son matelas l’étui à cigarettes qu’il y avait caché. Le bras était encore engagé entre le matelas et le sommier, mais on ne trouva pas l’étui.
– Il fallait que cet objet fût diablement compromettant, insinua M. Formerie, qui n’osait plus avancer une opinion trop précise.
– Parbleu ! fit le chef de la Sûreté.
– Mais on connaît les initiales, un L et un M et avec cela, d’après ce que M. Chapman a l’air de savoir, nous serons facilement renseignés.
M. Lenormand sursauta :
– Chapman ! Où est-il ?
On regarda dans le couloir parmi les groupes de gens qui s’y entassaient. Chapman n’était pas là.
– M. Chapman m’avait accompagné, fit le directeur.
– Oui, oui, je sais, mais il n’est pas redescendu avec vous.
– Non, je l’avais laissé près du cadavre.
– Vous l’avez laissé !... Seul ?
– Je lui ai dit : « Restez, ne bougez pas. »
– Et il n’y avait personne ? Vous n’avez vu personne ?
– Dans le couloir, non.
– Mais dans les mansardes voisines... ou bien, tenez, après ce tournant... personne ne se cachait là ?
M. Lenormand semblait très agité. Il allait, il venait, il ouvrait la porte des chambres. Et soudain il partit en courant, avec une agilité dont on ne l’aurait pas cru capable.
Il dégringola les six étages, suivi de loin par le directeur et par le juge d’instruction. En bas, il retrouva Gourel devant la grand-porte.
– Personne n’est sorti ?
– Personne.
– À l’autre porte, rue Orvieto ?
– J’ai mis Dieuzy de planton.
– Avec des ordres formels ?
– Oui, chef.
Dans le vaste hall de l’hôtel, la foule des voyageurs se pressait avec inquiétude, commentant les versions plus ou moins exactes qui lui parvenaient sur le crime étrange. Tous les domestiques, convoqués par téléphone, arrivaient un à un. M. Lenormand les interrogeait aussitôt.
Aucun d’eux ne put donner le moindre renseignement. Mais une bonne du cinquième étage se présenta. Dix minutes auparavant, peut-être, elle avait croisé deux messieurs qui descendaient l’escalier de service entre le cinquième et le quatrième étage.
– Ils descendaient très vite. Le premier tenait l’autre par la main. Ça m’a étonnée de voir ces deux messieurs dans l’escalier de service.
– Vous pourriez les reconnaître ?
– Le premier, non. Il a tourné la tête. C’est un mince, blond. Il avait un chapeau mou, noir... et des vêtements noirs.
– Et l’autre ?
– Ah ! l’autre, c’est un Anglais, avec une grosse figure toute rasée et des vêtements à carreaux. Il avait la tête nue.
Le signalement se rapportait en toute évidence à Chapman. La femme ajouta :
– Il avait un air... un air tout drôle... comme s’il était fou.
L’affirmation de Gourel ne suffit pas à M. Lenormand. Il questionnait tour à tour les grooms qui stationnaient aux deux portes.
– Vous connaissez M. Chapman ?
– Oui, monsieur, il causait toujours avec nous.
– Et vous ne l’avez pas vu sortir ?
– Pour ça, non. Il n’est pas sorti ce matin.
M. Lenormand se retourna vers le commissaire de police :
– Combien avez-vous d’hommes, monsieur le commissaire ?
– Quatre.
– Ce n’est pas suffisant. Téléphonez à votre secrétaire qu’il vous expédie tous les hommes disponibles. Et veuillez organiser vous-même la surveillance la plus étroite à toutes les issues. L’état de siège, monsieur le commissaire...
– Mais enfin, protesta le directeur, mes clients...
– Je me fiche de vos clients, monsieur. Mon devoir passe avant tout et mon devoir est d’arrêter, coûte que coûte...
– Vous croyez donc ?... hasarda le juge d’instruction.
– Je ne crois pas, monsieur... je suis sûr que l’auteur du double assassinat se trouve encore dans l’hôtel.
– Mais alors, Chapman...
– À l’heure qu’il est, je ne puis répondre que Chapman soit encore vivant. En tout cas, c’est une question de minutes, de secondes... Gourel, prends deux hommes et fouille toutes les chambres du quatrième étage... Monsieur le directeur, un de vos employés les accompagnera. Pour les autres étages, je marcherai quand nous aurons du renfort. Allons, Gourel, en chasse, et ouvre l’œil... C’est du gros gibier.
Gourel et ses hommes se hâtèrent. M. Lenormand, lui, resta dans le hall et près des bureaux de l’hôtel. Cette fois, il ne pensait pas à s’asseoir, selon son habitude. Il marchait de l’entrée principale à l’entrée de la rue Orvieto, et revenait à son point de départ.
De temps à autre, il ordonnait :
– Monsieur le directeur, qu’on surveille les cuisines, on pourrait s’échapper par là... Monsieur le directeur, dites à votre demoiselle de téléphone qu’elle n’accorde la communication à aucune des personnes de l’hôtel qui voudraient téléphoner avec la ville. Si on lui téléphone de la ville, qu’elle mette en communication avec la personne demandée, mais alors qu’elle prenne note du nom de la personne. Monsieur le directeur, faites dresser la liste de vos clients dont le nom commence par un L ou par un M.
Il disait tout cela à haute voix, en général d’armée qui jette à ses lieutenants des ordres dont dépendra l’issue de la bataille.
Et c’était vraiment une bataille implacable et terrible que celle qui se jouait dans le cadre élégant d’un palace parisien, entre le puissant personnage qu’est un chef de la Sûreté et ce mystérieux individu poursuivi, traqué, presque captif déjà, mais si formidable de ruse et de sauvagerie.
L’angoisse étreignait les spectateurs, tous groupés au centre du hall, silencieux et pantelants, secoués de peur au moindre bruit, obsédés par l’image infernale de l’assassin. Où se cachait-il ? Allait-il apparaître ? N’était-il point parmi eux ?... celui-ci peut-être ?... ou cet autre ?...
Les nerfs étaient si tendus que, sous un coup de révolte, on eût forcé les portes et gagné la rue, si le maître n’avait pas été là, et sa présence avait quelque chose qui rassurait et qui calmait. On se sentait en sécurité, comme des passagers sur un navire que dirige un bon capitaine.
Et tous les regards se portaient vers ce vieux monsieur à lunettes et à cheveux gris, à redingote olive et à foulard marron, qui se promenait, le dos voûté, les jambes vacillantes.
Parfois accourait, envoyé par Gourel, un des garçons qui suivaient l’enquête du brigadier.
– Du nouveau ? demandait M. Lenormand.
– Rien, monsieur, on ne trouve rien.
À deux reprises, le directeur essaya de faire fléchir la consigne. La situation était intolérable. Dans les bureaux, plusieurs voyageurs, appelés par leurs affaires ou sur le point de partir, protestaient.
– Je m’en fiche, répétait M. Lenormand.
– Mais je les connais tous.
– Tant mieux pour vous.
– Vous outrepassez vos droits.
– Je le sais.
– On vous donnera tort.
– J’en suis persuadé.
– M. le juge d’instruction lui-même.