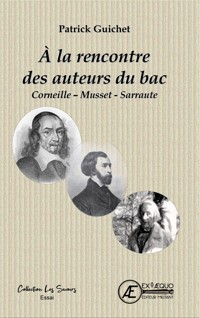
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Ce livre s’adresse à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances littéraires, aux candidats au baccalauréat d’abord, mais aussi à ceux qui éprouvent le désir de découvrir ou de redécouvrir les grands noms de la littérature.
Les jeunes y trouveront l’essentiel à savoir sur Corneille, Musset et Sarraute pour aborder sereinement les trois nouvelles œuvres au programme de français pour les trois années à venir. Ceux qui veulent seulement parfaire leur culture y trouveront une présentation de trois pièces majeures du répertoire français.
Cet ouvrage s’appuie sur l’idée qu’une œuvre est toujours révélatrice de son auteur et que tout ce qu’il a choisi est porteur de sens, à commencer par le titre de son ouvrage.
Chaque pièce est donc abordée de manière progressive. Une lecture guidée qui débute par les indications de la première page, celle du titre. Les éléments importants de la vie de l’auteur sont apportés au fur et à mesure de la découverte des grandes étapes du texte.
Ainsi, la compréhension de l’œuvre et la connaissance de l’auteur se font en parallèle.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Agrégé de lettres modernes, conférencier à l’Université du Temps Libre de Nevers et auteur de fictions, Patrick Guichet a conçu cet ouvrage en s’appuyant sur son expérience de professeur et d’examinateur. Il propose ici une approche novatrice, simple et efficace, de trois grandes œuvres dramatiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 120
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick GUICHET
À LA RENCONTRE DES AUTEURS DU BAC
CORNEILLE
MUSSET
SARRAUTE
ESSAI
ISBN : 979-10-388-0925-3
Collection : Les Savoirs
ISSN : 2428-9450
Dépôt légal : septembre 2024
© couverture Ex Æquo
© 2024 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. Toute modification interdite
Éditions Ex Æquo
6 rue des Sybilles
Nous limitons volontairement le nombre de pages blanches dans un souci d’économie des matières premières, des ressources naturelles et des énergies.
Avant-propos
Chaque année, le programme des œuvres pour l'épreuve anticipée de français du baccalauréat est partiellement renouvelé. Les trois auteurs abordés dans cet ouvrage sont des dramaturges. Leurs œuvres concernent les épreuves de 2025, 2026 et 2027.
Les programmes scolaires sont parfois discutables mais les auteurs choisis pour le français au baccalauréat sont en général représentatifs du patrimoine littéraire. Indispensable pour les candidats, la connaissance de ces grands noms de la littérature intéresse plus largement tous les amateurs de culture.
Il s’agit donc de faire connaître ces écrivains, de favoriser la compréhension de leurs textes, en partant des œuvres au programme.
Au terme d'une carrière de professeur de lettres et d'examinateur, j'ai pu constater le désarroi d'un jeune public qui manque souvent de repères pour comprendre les enjeux des œuvres étudiées au lycée. Certes, dans le rayon parascolaire des librairies, il existe de nombreux ouvrages mais leur approche est bien souvent abstraite, trop théorique.
Le parti pris de ce livre est donc simple : il a été conçu comme une découverte progressive des œuvres. On les feuillette ensemble, en commençant par la première page, celle du titre. C'est au fur et à mesure de cette lecture guidée que l'essentiel à savoir sera mis en évidence. En suivant les grandes étapes de ces pièces de théâtre, le lecteur découvrira les éléments indispensables à leur compréhension : le contexte historique et les événements de la vie l'auteur.
Pierre CORNEILLE
Le Menteur
Comédie
1644
Le nom de l’auteur
Pour diverses raisons, certains écrivains s’avancent sous un pseudonyme. Jean-Baptiste Poquelin signait Molière, François Marie Arouet se faisait appeler Voltaire et George Sand s’appelait en réalité Aurore Dupin.
Pierre Corneille, c’est la véritable identité de l’auteur du Menteur. On remarquera qu’il n’est pas issu d’une famille noble. Il est né en 1606 dans une famille de juristes rouennais. Ils n’occupent pas un rang très élevé dans la hiérarchie sociale mais ils ont du bien et de l’entregent – on dirait aujourd’hui du réseau. En 1637, le père de l’auteur est anobli, officiellement « pour services rendus ». Pierre Corneille hérite donc d’un quartier de noblesse. Lucide, il restera pourtant persuadé que Louis XIII a surtout « gratifié ses vers » à lui !
Corneille devient licencié en droit en 1624 et, parallèlement à ses activités théâtrales, il exerce des fonctions juridiques pendant plus de vingt ans. Avocat, titulaire de deux charges, il représente l’État devant un tribunal qui traite des affaires liées aux Eaux et Forêts et à l’administration de la Seine. Bien considéré par le pouvoir, il est d’abord protégé par le cardinal de Richelieu, le principal ministre de Louis XIII. À l’époque, les artistes ne sont pas indépendants, ils sont souvent financés (c’est-à-dire « pensionnés ») par un aristocrate de haut rang qui devient leur mécène (aujourd’hui, on dit : un sponsor). Molière eut pour mécène le frère du roi ; La Fontaine eut la malchance d’être sponsorisé par Fouquet, le surintendant des Finances du royaume tombé en disgrâce et incarcéré sur ordre du roi.
Quand Mazarin succède à Richelieu en 1643, il confirme la pension attribuée à Corneille. Plus tard, en 1663, Louis XIV qui veut tout contrôler décide d’assurer lui-même les mécénats. Corneille est l’un des plus généreusement rémunérés, sur proposition de Colbert, contrôleur général des Finances et homme de confiance du roi.
Le titre de l’œuvre
Le Menteur : un titre bref, qui se limite à un groupe nominal. On a tous en mémoire des titres similaires, dans le répertoire de Molière par exemple, comme l’Avare ou le Misanthrope. Des titres qui évoquent des défauts.
Il y a une raison à cela : les dramaturges du dix-septième siècle s’inspirent bien souvent des auteurs de l’Antiquité. Pour eux, la comédie devait aider à corriger les mœurs par le rire. Dans de nombreuses préfaces, les auteurs contemporains de Corneille affichent le même objectif : divertir et instruire. Pour eux, la comédie a une fonction moralisatrice car elle nous tend le miroir de nos travers.
Pour être plus exact, le dosage entre divertir et instruire varie d’un dramaturge à l’autre et d’une pièce à l’autre. Pour savoir le point de vue de Corneille sur cette question, il peut être intéressant de lire l’épître qui précède la pièce.
L’épître
Bon à savoir : le mot « épître » vient du latin epistŏla qui désigne la lettre qu’on envoie. Une épître dédicatoire est un texte adressé à une personnalité pour lui dédier l’œuvre.
La plupart des épîtres de Corneille ont un destinataire identifié. Celle qui précède Rodogune, par exemple, est adressée à Monsieur le Prince (de Condé). Mais il s’agit d’une tragédie qui met en scène des personnages de légende, comme Cléopâtre. Quand Corneille publie cette pièce, Condé est considéré comme un chef militaire de première importance. Le dramaturge lui rend hommage en lui dédiant sa tragédie.
À qui s’adresse l’épître du Menteur ? On l’ignore ; il est fort probable qu’il s’agisse d’une fausse épître. On comprend qu’il pouvait être fort délicat de dédier une pièce qui montre les exploits… d’un menteur !
Dans cette épître qui sert de présentation de la pièce, Corneille le dit explicitement : après avoir applaudi des « poèmes graves » (c’est-à-dire des tragédies), les Français qui « aiment le changement » lui ont « demandé quelque chose de plus enjoué qui ne servît qu’à les divertir ». On aura remarqué la formule restrictive (ne… que) qui semble exclure la fonction instructive de cette comédie.
D’ailleurs, bien que Dorante soit souvent empêtré dans ses mensonges, il parviendra quand même à ses fins. Le mensonge lui réussit ! C’était relativement osé à une époque où le théâtre n’était pas très bien perçu par une partie des autorités religieuses, alors très influentes.
Bon à savoir : la particularité de cette comédie, c’est qu’elle sera suivie d’un second opus publié en 1645. Dans la Suite du Menteur, Dorante ment surtout pour rendre service à un homme poursuivi à cause d’un duel. Dans son épître, Corneille réaffirme que la comédie « n’a pour but que le divertissement ». Il semble vouloir corriger l’image de son personnage, estimant que dans la Suite du Menteur, Dorante « donne des exemples de vertus à suivre, au lieu qu’en l’autre, il ne donne que des imperfections à éviter ».
Le Menteur : ce genre de titre désigne un type de comportement. Et comme l’un des ressorts de la comédie c’est l’exagération, la caricature, le défaut mis en avant ici est presque toujours amplifié. Très rapidement, le mensonge atteint un niveau élevé. Dès la deuxième scène, le personnage se laisse aller. Pour se donner de l’importance aux yeux de la jeune femme qu’il veut éblouir, il n’hésite pas à s’inventer un passé militaire glorieux. Alors qu’il arrive de Poitiers où il a passé du bon temps, il affirme avoir bataillé pendant quatre ans en Allemagne – on est alors en pleine guerre de Trente ans. Et Dorante ne se contente pas d’un second rôle, il se présente comme un véritable héros en affirmant, au vers 162 :
« Je m’y suis fait quatre ans craindre comme un tonnerre. »
Le public de l’époque ne s’y trompe pas, surtout s’il est amateur de comédies. Dorante est ici l’équivalent d’un personnage comique bien connu depuis l’Antiquité, le soldat fanfaron popularisé par Plaute. Quelques années avant le Menteur, Corneille écrit l’Illusion comique. Un personnage appelé Matamore s’y vante d’exploits imaginaires, sans aucun souci de vraisemblance, comme en témoignent ces deux vers de la scène 2 de l’acte II :
« Le seul bruit de mon nom renverse les murailles,
Défait les escadrons et gagne les batailles. »
Dans le langage courant, de nos jours, on le traiterait de mytho. C’est l’abréviation de mythomane. On sait que le mot « manie » évoque un désordre psychologique. Un mythomane ne contrôle guère sa propre production de récits fantaisistes. Est-ce le cas de Dorante ? On peut raisonnablement le penser car il ne manque pas une occasion de fabuler, c’est-à-dire d’inventer des événements susceptibles de le valoriser.
Dans la scène 5 de l’acte I, Dorante surprend une conversation entre deux de ses amis. Alcippe est en colère car il a ouï dire qu’un galant avait offert une fête à Clarice, sa promise. La fête semblait somptueuse. Alors, simplement pour se faire valoir, pour se faire passer pour un grand séducteur, pour fanfaronner, Dorante prétend qu’il est ce galant. Il n’en est rien, évidemment mais, pour le simple plaisir de se vanter, il vient de se créer un rival et de semer la discorde entre Alcippe et Clarice ! Au tout début de la scène 3 de l’acte II, Alcippe accuse brutalement la jeune femme, d’ailleurs à tort :
« Ah ! Clarice, ah ! Clarice, inconstante ! volage ! »
Un vers irrégulier sur le plan rythmique, à cause de la ponctuation et de l’accentuation tonique. Un rythme qui traduit la colère du personnage. Émotion d’ailleurs injustifiée puisqu’elle repose sur le mensonge de Dorante. Le public comprend alors qu’un menteur est d’autant plus efficace que ses interlocuteurs sont crédules. Dans la réalité, il en va ainsi, ce qui donne tout de même à la comédie de Corneille une certaine valeur éducative.
La date
La pièce a vraisemblablement été créée (c’est-à-dire jouée pour la première fois) en 1643, par la troupe du Marais. Fondée en 1630 par l’acteur Mondory, cette troupe a largement contribué au développement du genre comique. La date qui figure sur la première page (1644) est celle du privilège royal qui donne l’autorisation d’imprimer le texte.
Le genre : comédie
Quand Pierre Corneille publie Le Menteur, il approche de la quarantaine. Il a connu le succès avec des pièces de genres variés :
– des comédies comme Mélite ou l’Illusion comique,
– des tragédies comme Médée, Cinna ou Horace,
– une pièce au statut particulier, Le Cid, une œuvre généralement classée dans les tragi-comédies.
À l’époque de la création du Menteur, ceux qu’on appellera plus tard les classiques cherchent à imposer certaines règles pour l’écriture théâtrale. De plus, ils aiment hiérarchiser : le genre dit « noble », c’est la tragédie. Bientôt, Racine va supplanter tout le monde car il est tragédien et ses pièces respectent les règles (trois unités, vraisemblance et bienséance). Il a écrit une comédie, une seule, les Plaideurs. Molière est spécialisé dans la comédie. Corneille, lui, explore tous les genres.
Bon à savoir : la règle des trois unités concerne le temps, le lieu et l’action. La durée de l’action doit être contenue dans vingt-quatre heures ; les événements doivent se situer dans un lieu unique et ne constituer qu’une seule intrigue.
Par ailleurs, tout doit être vraisemblable. Enfin, la bienséance doit prévaloir : ni meurtres ni gestes intimes sur scène.
Avant Corneille, la comédie n’est guère considérée : on l’assimile à une farce bouffonne au style parfois grossier. Les premiers succès de Corneille contribuent à réhabiliter le genre comique – et à faire entrer le dramaturge dans les bonnes grâces des gens très influents. En 1633, l’archevêque de Rouen l’incite à composer des vers à la gloire du roi. Corneille écrit alors un poème intitulé « Excusatio », un ensemble de plus de quatre-vingts vers latins où il s’excuse d’abord de n’être point digne de parler du roi, avant d’évoquer les succès de la politique menée par Louis XIII et Richelieu… Au passage, le dramaturge nous livre ses réflexions sur sa manière d’écrire et s’il admet avoir du talent, il le limite à la scène comique.
C’est le moment de détruire un préjugé tenace. On dit parfois que toute comédie se termine bien pour les personnages et que les tragédies se terminent mal, en général par la mort du protagoniste. Or il est facile de trouver des contre-exemples. Corneille a écrit une tragédie qui a un dénouement heureux : il s’agit de Cinna ou la clémence d’Auguste. Cinna a fomenté un complot contre l’empereur Auguste. Cet événement est emprunté à l’histoire romaine, il s’agit donc de personnages de rang élevé et d’un sujet sérieux. L’enjeu de l’intrigue est simple, si les tractations secrètes de Cinna sont découvertes, celui-ci risque le châtiment suprême. La conjuration est finalement découverte… Pourtant, contre toute attente, l’empereur accorde son pardon. Certes, dans la tragédie, la mort rôde mais il ne suffit pas d’un dénouement dominé par le deuil et les larmes pour qu’une pièce soit tragique.
Bon à savoir : au siècle de Corneille, la référence c’est Aristote, le philosophe grec du quatrième siècle avant Jésus-Christ. Les principes de la tragédie et de la comédie sont définis dans un ouvrage intitulé Poétique. Pour le penseur grec, la tragédie imite des actions de caractère élevé, des actions d’éclat, de manière à susciter la crainte et la pitié. Le langage doit être relevé et les personnages sont des grandes figures historiques ou mythologiques. A contrario, la comédie met en scène des personnages appartenant à l’humanité dite ordinaire, les actions sont plus communes et les exigences en matière de langage sont moindres.
La tragédie suppose enfin l’existence d’une force supérieure qui pousse l’homme à agir : une divinité, la fatalité, etc.
D’autre part, on trouve des comédies privées de « happy end ». On pense au Dom Juan de Molière où le personnage éponyme est finalement englouti par l’enfer parce qu’il persévère dans son libertinage. On peut également citer Les Caprices de Marianne, une comédie d’Alfred de Musset où l’un des protagonistes meurt à la fin.
Le Cid est un cas particulier.
Outre les accusations de plagiat qui pesèrent sur Corneille, on apprécia modérément le mélange du tragique et du comique. Cette comédie fut considérée comme baroque, tout comme L’Illusion comique. L’adjectif « baroque » est péjoratif à l’époque.
Dans le Cid, Rodrigue est un jeune aristocrate espagnol vaillant et un amoureux transi. Il aime Chimène et il en est aimé, mais voilà… le père de Chimène a humilié le père de Rodrigue et dans le contexte guerrier de l’Espagne du onzième siècle, on ne plaisante pas avec les questions d’honneur. Le père de Rodrigue étant âgé, c’est à son fils de laver l’affront. On assiste alors à ce grand moment de solitude qui envahit Rodrigue et qui se traduit par un long monologue. Seul sur scène, Rodrigue exprime son désarroi.
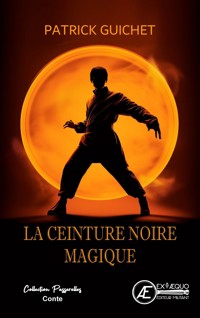
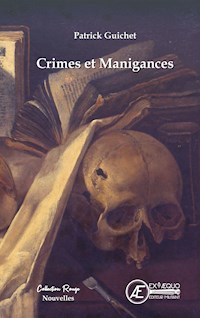

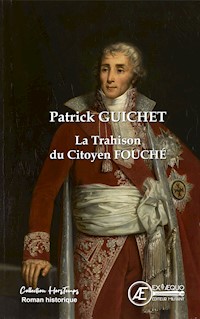













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)











