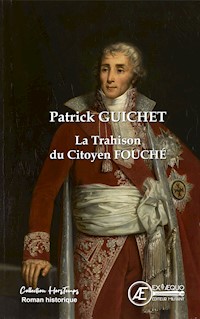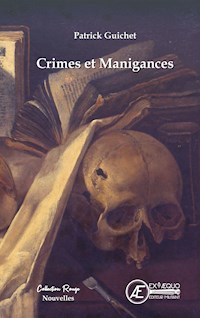
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Originales, ces nouvelles mêlent le réel et la fiction, dans des proportions qui sont révélées au lecteur au fil des pages. On y traverse les époques, de la Renaissance au XXIème siècle. Les personnages mis en scène participent également à cette variété. Il y a des anonymes, il y a aussi des célébrités, souvent montrées sous un angle inhabituel mais véridique : Rabelais médecin, Molière volage ou encore deux proches d’Hitler qui s’affrontent dès 1938. La diversité règne enfin dans les scénarios. Sorte de panorama tragique du fait divers, ce recueil nous met en présence d’innocents confrontés à l’indicible, de tueurs dépourvus d’empathie, de victimes qui sombrent dans le mal par désespoir et d’enquêteurs aux motivations parfois douteuses.
La diversité n’excluant pas l’unité, le fil conducteur de l’ensemble du livre, c’est le poids des mots : que les événements contés soient réels ou imaginaires, ils nous rappellent qu’on est parfois persécuté pour avoir publié des idées. A contrario, c’est souvent grâce à leurs déclarations ou leurs écrits que des coupables sont identifiés…
À PROPOS DE L'AUTEURE
Ancien professeur, agrégé de lettres modernes, Patrick Guichet a déjà publié plusieurs ouvrages, dont deux romans aux éditions Ex Æquo. Cette fois, il a choisi le genre de la nouvelle, tout en restant fidèle à son ambition de produire des textes à la fois divertissants et culturellement enrichissants.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Patrick GUICHET
Crimes et manigances
Nouvelles policières et historiques
ISBN : 979-10-388-0457-9
Collection : Rouge
Dépôt légal : novembre 2022
© couverture Ex Aequo
© 2022 Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
PREMIÈRE PARTIE
DE LA RENAISSANCE
À LA GUERRE FROIDE
Les nouvelles de cette première partie combinent réalité et fiction.
Deux de ces récits sont librement inspirés d’événements réels, les autres sont imaginaires mais le lecteur y retrouvera des contextes bien connus comme la guerre froide ou des personnages célèbres. Qu’ils se soient distingués par leur talent, leur courage ou leur cruauté, ils sont ici fidèles à ce que les biographes et les historiens nous en ont appris.
On peut enfin se dispenser de lire les notes de bas de pages et les postfaces explicatives intitulées « le réel et l’imaginaire » : elles sont surtout destinées au lecteur qui veut savoir précisément ce qui relève de la fiction et ce qui appartient à l’histoire.
Rabelais et les Sorbonnards
En novembre de l’an de grâce 1541.
Il y avait quelques années déjà que François Rabelais enchaînait les séjours en Savoie et dans les contrées transalpines, à Rome par exemple. D’abord médecin et secrétaire particulier du cardinal Jean du Bellay, il était maintenant au service de l’aîné des frères du Bellay, Guillaume, gouverneur du Piémont depuis 1538.
Quand il rentrait en France, à moins que son appartenance à la Maison du roi ne l’oblige à rejoindre Paris, Rabelais se retirait en Touraine, dans la demeure de son enfance. Il redevenait alors pour quelques jours ou quelques semaines le sieur de la Devinière.
Arrivé la veille dans la maison familiale située à Seuilly, il mettait sa matinée à profit pour travailler à l’édition de son Almanach de l’année 1541. Le feu crépitait. Son regard s’était arrêté sur l’immense cheminée qui atteignait presque le plafond ; il revoyait alors son père qui s’y réchauffait les mains jadis, le soir à la veillée, en lui racontant des historiettes. Un bruit sourd le tira de sa rêverie. On frappait à la porte tout en l’appelant par son nom. Une voix masculine qu’il connaissait.
— Maître Alcofribas{1} ! s’exclama le visiteur. Les habitants du bourg m’ont bien dit que vous étiez à la Devinière. Avant de repartir vers Chinon, il me fallait avoir avec vous un entretien.
— Monsieur le bailli ! Quel bon vent vous amène ?
L’officier de justice avait succédé à Antoine Rabelais, le père de François. Les deux hommes se connaissaient bien et, ce n’est pas incompatible, ils s’appréciaient. Le bailli n’avait-il pas montré d’emblée qu’il connaissait le pseudonyme de son interlocuteur ? Toujours enclin à pratiquer l’hospitalité, Rabelais le pria de faire entrer le sergent d’armes qui l’attendait dehors. Les trois hommes s’attablèrent, la servante leur apporta de quoi se désaltérer, tout en goûtant la « purée septembrale » de la dernière vendange.
Signe que les écrits du sieur Rabelais étaient populaires, le sergent fit savoir qu’il avait beaucoup ri au sujet du jeune Gargantua, car « ce petit paillard tâtait toujours ses gouvernantes sens dessus dessous, devant derrière, et hue cocotte ! » Le garde du corps du bailli connaissait par cœur cette phrase du récit de la jeunesse de Gargantua. Avait-il lu cet extrait lui-même ? Avait-il simplement entendu et répété cette phrase à l’envi ? Il est vrai que grâce au développement de l’imprimerie et la pratique du colportage, l’accès aux textes commençait à se vulgariser.
C’était précisément à propos de la diffusion de ces écrits rabelaisiens que le bailli souhaitait rencontrer l’écrivain. Oh ! l’homme de loi n’avait aucun grief à l’encontre des histoires popularisées par Rabelais, bien au contraire. Mieux, il ne partageait aucunement l’avis des théologiens de la Sorbonne qui, en 1533, avaient considéré Les Horribles et épouvantables faits et prouesses du très renommé Pantagruel comme un livre obscène. Ce qui motivait présentement le magistrat, c’était une affaire judiciaire qui relevait de sa compétence.
Tout en « humant le pot » offert par Rabelais, il résuma les faits : dans plusieurs villages de la Touraine, de paisibles colporteurs avaient été attaqués, rossés et délestés d’une partie bien précise de leur chargement. Devant le regard interrogateur du sieur de la Devinière, le bailli s’expliqua. D’après les témoignages des pauvres « porteballes » bastonnés, on avait compris que les colporteurs visés étaient ceux qui proposaient des extraits des Chroniques gargantuines à la vente. Celui qui les molestait était une sorte d’hercule armé d’un bourdon. Il les frappait en psalmodiant des malédictions à l’encontre de ces « hérétiques » qui faisaient commerce des « obscénités rabelaisiennes » …
— Une sorte de frère Jean des Entommeures{2} au service de la Sorbonne ! plaisanta Rabelais.
— La même idée m’est venue, répliqua l’officier de justice.
Depuis la publication de La Vie inestimable du grand géant Gargantua, quelques semaines seulement après l’affaire des Placards{3}, Rabelais avait effectivement reçu de nombreuses invitations à corriger les passages de ses récits qui s’écartaient de la bienséance. Les textes particulièrement visés contenaient des moqueries à l’égard de ceux qu’il appelait les « Sorbonnards ».
— Admettez que vous n’avez guère été bienveillant envers les docteurs de la Faculté de théologie, risqua l’homme de loi.
— Que diable ! monsieur, estimez-vous que les méfaits des assaillants soient légitimés par mes écrits ? Que mes facéties justifient de tels excès ?
— Non, mon ami. Au nom de notre amitié et de celle que j’avais pour votre père, je vous prie de me croire. Je cherche à comprendre pourquoi on maltraite ces pauvres « bisouards ». Le malfaisant qui les attaque à l’escrime ancienne est si fort et si habile qu’il finira par occire quelqu’un !
Certes Rabelais ne voulait causer le trépas de personne mais il ne voyait pas très bien ce qu’il pouvait faire. Et puis, tous ces événements s’étaient-ils réellement produits comme on les lui avait racontés ? Malgré la respectueuse amitié qui les unissait autour de la figure d’Antoine Rabelais, François savait pertinemment que les temps avaient changé. La diffusion des thèses réformatrices commençait à créer des tensions dans le pays, dans les villages et même au sein des familles. Le bailli était-il venu à lui pour l’amener à corriger ses propos les plus « horrifiques » sur les hauts dignitaires de la puissante Faculté de théologie ?
Rabelais laissa ce « légiste » prendre congé, en lui promettant de réfléchir utilement. Il allait tout de même prendre le temps de consulter plusieurs personnes qu’il avait « en recommandation », parce qu’elles partageaient ses idées novatrices et parce qu’elles connaissaient mieux que lui les finesses et les méandres du pouvoir politique. Deux conseillers royaux lui semblaient dignes de cette confiance. Il leur rédigea incontinent une lettre, il paierait ensuite un messager à cheval, un « chevaucheur », qui porterait les missives.
À celle qui avait été adressée à Geoffroy du Mesnil, il n’obtint aucune réponse. La seconde avait été adressée à un officier de la Maison du roi, un proche de Marguerite de Navarre{4}. Une fois de plus, elle manifesta sa considération pour Rabelais en lui répondant personnellement. C’est en femme de lettres, en poétesse, qu’elle avait composé une belle épître à celui qu’elle nommait son « cher ami Rabelais ». En des termes qui se voulaient quelque peu énigmatiques, en procédant par allusions, elle invitait l’auteur des Chroniques gargantuines à ne pas pécher par excès de confiance, à ne pas se croire « à l’abri des ennemis des nouvelletés » dans le domaine religieux. « Prenez garde, avait-elle écrit, à la sévérité qui règne depuis peu dans le fraternel esprit. » Le verbe « régner » et l’adjectif « fraternel » désignaient indubitablement François 1er. Rabelais comprit aussi que la sévérité récente correspondait au durcissement de la politique royale depuis l’affaire des Placards. Autant l’écrivain fut flatté de la sollicitude de la reine de Navarre à son égard, autant il se sentit soudainement bien seul face à l’adversité{5}…
Il relisait cette lettre pour la énième fois, accoudé à la fenêtre de son grenier ; de là, il avait un point de vue imprenable sur la campagne environnante. Son regard s’attardait nonchalamment sur les vignes de l’abbaye lorsqu’un groupe de trois cavaliers pénétra dans la cour.
Accompagné de deux gardes, le bailli venait annoncer au sieur de la Devinière qu’un colporteur avait été retrouvé mort le matin même. En revenant du marché de La Roche-Clermault, un marchand ambulant avait repéré, au bord du chemin, un ballot grand ouvert, visiblement fouillé et vidé d’une partie de son contenu. Il avait alors pensé que le porteballe ne devait pas être bien loin et qu’il avait sûrement besoin de secours. Le marchand n’avait pas mis bien longtemps à découvrir le malheureux inanimé, à plat ventre dans le Négron, le cours d’eau qui se jette dans la Vienne. Il avait dû s’y noyer…
— Il n’a pas pu périr noyé dans le Négron aux alentours de La Roche ! objecta Rabelais qui connaissait bien sa région. Voyons, monseigneur ! la profondeur de l’eau n’est pas suffisante. Il est impérieux que je puisse observer le cadavre de l’infortuné !
— Quoi ? Vous voulez que je vous autorise à voir la dépouille du supplicié ? Mais…
— Je suis docteur en médecine, monsieur, ne l’oubliez pas ! J’ai pratiqué une dissection publique à Lyon en 37. Je trouverai la cause du trépas de cet homme et vous n’en serez que plus instruit pour mener à bien vos investigations.
Finalement convaincu du bien-fondé de cette requête, l’homme de loi proposa à Rabelais de chevaucher en sa compagnie jusqu’à Chinon, sans plus attendre. Il y avait à peine plus de deux lieues à parcourir, ils y parviendraient avant midi.
Le corps de l’infortuné colporteur gisait en la chambre mortuaire de la prison. Le procureur chinonais fut averti et c’est lui qui chargea officiellement le docteur Rabelais de procéder à l’examen du corps, sous réserve de coucher ses constatations sur le papier, à toutes fins utiles. Quelques coups de scalpel plus tard, François Rabelais qui était accoutumé à disserter devant un public livra ses conclusions.
— Messires, approchez, je vous prie. Vous admettrez premièrement que le corps ne présente aucune contusion, donc aucune trace de coups. Pour la tête, c’est autre chose… Le crâne a été brisé, il a été heurté par derrière, peut-être une, peut-être deux fois. Le coup a atteint « la commissure lambdoïde{6} ».
Il désigna du doigt un enfoncement rendu visible grâce à la tonsure des cheveux qu’il venait de pratiquer. Il reprit le cours de son exposé après avoir écarté les chairs au niveau du thorax qu’il avait préalablement incisé.
— Observez, messieurs. Ceux qui trépassent par noyade conservent toujours un peu d’eau dans ces organes de la respiration… aucune trace d’eau ici, même en exerçant une pression…
— Vous en déduisez ? s’enquit le procureur.
— L’homme ne s’est pas noyé. Il est passé de vie à trépas suite à un ou plusieurs coups assénés de haut en bas sur l’arrière du crâne. C’est ensuite qu’il a été jeté dans l’eau. Je peux aussi garantir qu’il n’a pas été molesté, il a donc été homicidé par quelqu’un qui avait prémédité son geste.
Quelques jours plus tard.
Avant de s’en aller à Lyon où il devait négocier avec ses éditeurs, Rabelais s’en fut à Paris car il avait quelques obligations en la Maison du roi. À peine arrivé, il fut prévenu du désir que Geoffroy du Mesnil avait de l’entretenir. « Le jour avait été pris » avec l’assentiment du roi, le sieur Rabelais ne pouvait donc s’y soustraire.
Dès le premier abord, du Mesnil lui fit « bonne chère » mais Rabelais avait senti que cette approche était une « couverture ».
— Cher ami, avait lancé le gentilhomme qui était désormais au service de la Sorbonne, notre roi très chrétien me fait l’honneur de me demander mon avis avant que d’accorder ses privilèges{7}. Nous allons donc parler de vos intentions, vous pourrez ensuite entendre mes recommandations, s’il vous plaît.
Le mielleux émissaire de la Faculté de théologie l’assura ensuite qu’il l’avait en très haute estime et qu’il avait pour dessein de le servir au mieux… Sans lui faire l’injure de le questionner sur le contenu de son Almanach ou de ses autres œuvres en gestation, il adopta le ton de celui qui raisonne in abstracto sur le grand danger de répandre des idées contraires à LA religion. Au passage, il laissa entendre à l’auteur de Gargantua que tout signe de bonne volonté à l’égard des docteurs de la Sorbonne serait accueilli avec la plus grande bienveillance et que l’on saurait faire preuve de mansuétude envers l’auteur des Chroniques gargantuines… Rabelais se remémora alors l’avertissement que lui avait adressé la sœur du roi de France.
Malgré l’affliction qui croissait en lui, il fit comprendre au sieur du Mesnil que le nécessaire serait fait pour que la fantaisie de ses écrits n’entre « oncques » en conflit avec les intérêts de l’Église ni avec ceux du royaume.
Geoffroy du Mesnil sembla s’en satisfaire.
À compter de ce jour, les colporteurs purent colporter les pantagruéliques fictions sans craindre la bastonnade. Quelque poursuite qu’on en ait faite, celui qui avait assailli les porteballes ne fut jamais attrapé…
En 1542, Rabelais publia chez le Lyonnais François Juste une version remaniée de Pantagruel et de Gargantua. Les railleries sur les théologiens avaient été remplacées par des termes plus neutres. Hélas, les tensions entre les conservateurs et les réformateurs prenant une ampleur considérable, la bonne volonté du sieur de la Devinière ne suffit pas : dans la liste des œuvres censurées en 1545 par la Sorbonne, il y eut Pantagruel et Gargantua ! Il est vrai que Rabelais n’avait fait qu’édulcorer son propos. Sa verve critique visant le camp « papiste » s’exacerbera encore dans le Tiers livre et le Quart livre.
***
Le réel et l’imaginaire
Dans cette fiction, rien n’est vrai mais tout est vraisemblable ! Humaniste, auteur de la Renaissance, François Rabelais avait acquis un savoir éclectique, inconcevable de nos jours tant les connaissances sont étendues. Fils d’un lieutenant du bailli de Touraine, il étudia d’abord le droit puis la théologie et enfin la médecine dont il obtint le doctorat en 1538.
Alors que les oppositions se cristallisaient de jour en jour entre l’Église catholique et ceux qui portaient des idées réformatrices, Rabelais parvint à conserver son statut de moine tout en flirtant avec les novateurs. Proche des frères du Bellay qu’il accompagna effectivement dans leurs ambassades, il obtint par exemple une dispense du pape pour devenir moine « séculier » et pour pratiquer la médecine. Proche du pouvoir politique, tenu en haute estime par la sœur de François 1er, il fut admis à la Maison du roi en 1538.
Les écrits de Rabelais furent à peu près systématiquement censurés, en raison de leur « obscénité » et ce malgré les privilèges royaux obtenus par l’auteur. En réalité, il y a fort à parier que ses ennuis venaient surtout de sa sympathie pour les idées évangélistes ainsi que de ses moqueries à l’encontre de certaines autorités ecclésiastiques.
Par souci de réalisme, certaines circonstances attestées par les biographes ont été conservées ici, comme l’ancrage de Rabelais dans sa région d’origine. La Devinière, sa maison familiale située à Seuilly accueille aujourd’hui le musée Rabelais.
Quelques précisions sur la langue du XVIe siècle.
Pour les linguistes, il s’agit du Moyen français, une langue intermédiaire entre l’Ancien français et le français moderne, une langue qui conserve quelques particularités de la langue médiévale, l’habitude de prononcer toutes les lettres, par exemple. De ce fait, contrairement à nous, l’homme de la Renaissance est dispensé d’employer systématiquement les articles et les pronoms personnels. Les terminaisons des noms et des verbes pouvaient suffire.
Pourtant, dans cette nouvelle, les dialogues n’ont pas été reconstitués dans la langue de l’époque. La tâche n’était pas insurmontable mais il aurait fallu tout traduire en notes. Or, ralentir la lecture n’est guère dans la logique du genre de la nouvelle. Par exemple, la première réplique, celle du bailli, aurait pu été rédigée ainsi : « Maistre Alcofribas, les habitans du bourg avoient bien dist qu’estiez en la Deviniere. Avant que de retourner en Chinon, me failloit avoir avec vous un parlement. »
Dernier point, les corrections de l’édition de 1542 évoquées dans la nouvelle sont bien réelles. Rabelais a vraisemblablement dû accepter de faire quelques concessions. Il a donc édulcoré sa verve critique : le mot « Sorbonistes » par exemple, fut remplacé par le terme « maistres » qui perd sa charge péjorative.
Les agressions des colporteurs, elles, sont purement imaginaires ; il n’en reste pas moins que ces marchands ambulants contribuaient à diffuser les textes, donc les idées nouvelles. Le colportage permit à Rabelais de faire connaître ses écrits. Des extraits des histoires de Gargantua et de Pantagruel étaient ainsi mis à la disposition du public. Les petits livrets portaient des titres variés, une manière comme une autre d’attirer le chaland.
Le mystère de la septième lettrede La Fontaine
— Mais où est donc passé ce diable de La Fontaine ?
Le prévôt de Paris ne décolérait pas. Respectueux, Monsieur de Batz, comte d’Artagnan, écoutait le récit dont il connaissait déjà les moindres péripéties. Quelques semaines plus tôt, en août 1663, La Fontaine avait quitté Paris pour accompagner Jannard, l’oncle de son épouse, jusqu’à Limoges. Substitut du surintendant Foucquet arrêté deux ans plus tôt, Jannard avait eu la fâcheuse idée de proposer son aide à madame Foucquet, elle-même exilée à Limoges.
Conséquemment, Jannard avait été instamment prié de se faire oublier quelque temps en Limousin… Resté fidèle à Foucquet, son ancien mécène, le futur fabuliste était du voyage. Il ne resterait pas à Limoges, il rejoindrait ensuite Château-Thierry où il exerçait la fonction de maître des Eaux et Forêts.
Le prévôt avait posé quelques feuilles sur son bureau, il les désignait au mousquetaire en maugréant :
— Jean de La Fontaine a envoyé six lettres à sa femme restée dans son logis de Chaury{8}. Ces lettres, le petit protégé de Foucquet les a fait cheminer au vu et au su de tous. Il doit se prendre pour le Tite-Live{9} du dix-septième siècle ! La première de ces lettres que nous avons recopiées date du 25 août, la dernière du 19 septembre. Je les ai lues et relues, ces missives, elles sont sans intérêt ! À sa jeune épouse délaissée, il raconte ses pérégrinations, il décrit Amboise et Richelieu, il qualifie Poitiers de « ville mal pavée », il trouve Bellac « désagréable » mais il a l’outrecuidance de s’extasier devant la fille des aubergistes. Quel goujat ! À moins que ce gratte-papier n’utilise un langage codé, rien n’est exploitable dans ces textes, rien ne peut nous donner une indication sur ce qu’il fomentait alors. Il évoque une septième lettre, que nous n’avons pas vu passer malgré la vigilance de nos mouchards. Aurait-il réussi à confier discrètement cette missive à un messager à cheval ?
Après un court instant de réflexion, il ajouta :
— Mais pourquoi diantre avons-nous rémunéré des gens pour le surveiller ?! Monsieur de Châteauneuf par exemple ! J’aurai deux mots à lui dire, moi, à ce valet de pied du roi ! L’homme de confiance de Sa Majesté qui accorde trop facilement sa confiance à ce saltimbanque de La Fontaine !
Considérant l’air interrogatif de son interlocuteur, le prévôt l’invita à s’exprimer.
— Un détail me préoccupe, monsieur le prévôt… Qu’est-ce qui vous incline à penser que La Fontaine s’emploie à quelque manigance au profit de Foucquet ?
Alors l’officier royal prit le temps de juxtaposer plusieurs documents devant lui, en les tournant de manière à ce que d’Artagnan puisse les lire. En montrant la première de ces feuilles, il adopta un ton de précepteur :
— Monsieur de Batz, approchez, je vous prie. Le premier texte dans l’ordre chronologique est intitulé « Adonis ». En 1658, La Fontaine rend hommage à son bienfaiteur en lui dédiant ce poème. Adonis ! rien que ça… En 1662, il publie « Aux nymphes de Vaux », un poème dithyrambique pour chanter la magnificence de Vaux, cette résidence qui avait tant déplu à Sa Majesté ! Or en 62, Foucquet est déjà écroué, et vous le savez puisque c’est vous qui aviez été chargé de son arrestation ! Ensuite, comme s’il ignorait qu’il est diabolique de persévérer, La Fontaine récidive : il adresse une « Ode au roi » pour plaider officiellement la cause de l’ancien surintendant des Finances. Ce n’est plus de l’impertinence, c’est tout bonnement de l’inconséquence !
D’Artagnan ne pipait mot. Le prévôt reprit la parole.
— Que vous faut-il de plus ? La fidélité de La Fontaine envers Foucquet est restée entière, comme au premier jour. Il est évident dès lors que le bougre fera son possible pour favoriser celui qui l’avait pensionné.
— Certes, mais que craignez-vous ? Foucquet est sous bonne garde, son épouse est en résidence surveillée et on vient d’éloigner Jannard de la Cour… Avec sa plume, La Fontaine est-il donc si dangereux ?
— On connaît ses liens d’amitié avec des écrivailleurs illustres, dont certains ont l’oreille du roi ! Poquelin, Racine et même la marquise{10}. Qui sait si La Fontaine n’est pas en train d’œuvrer pour les rallier à sa cause ? De constituer une ligue capable d’influer sur quelques personnages haut placés… Il est peut-être présentement en train de réunir des complices pour tenter un coup d’éclat depuis la Bretagne où l’ancien surintendant a conservé de nombreux partisans{11}.
— Ne croyez-vous pas plutôt que notre homme soit tout simplement retourné à Chaury où il a encore sa charge de Maître des Eaux et Forêts ?
— Nos informateurs sont catégoriques, il n’est pas dans son domaine de Chaury.
Le prévôt donna du poing sur la table.
— Nous n’allons tout de même pas mobiliser des exempts pour le guetter jusqu’à la Noël !
— Qu’attendez-vous de moi, monsieur le prévôt ? Sa Majesté m’a prié de me mettre à vos ordres. Je suis donc votre serviteur.
— Soit ! monsieur de Batz, vous partirez à la recherche de La Fontaine. Faites-vous accompagner de deux ou trois de vos mousquetaires. Je vais vous remettre une lettre de cachet, vous en userez comme bon vous semblera. Avez-vous une idée pour mettre la main sur ce drôle ?
— Ayez l’obligeance de me confier une copie des lettres envoyées par La Fontaine à sa femme. Je les relirai en essayant de tirer profit du moindre détail, en présence de monsieur de Châteauneuf qui pourra m’aider dans cette tâche. J’obtiendrai peut-être alors de précieuses informations.
— Votre plan me semble pertinent, comte d’Artagnan. Quand comptez-vous partir ?
— Demain dès potron-minet, le temps de constituer une petite escouade. Il y a peut-être des hommes de ma compagnie qui connaissent les contrées que nous allons traverser. Nous allons refaire le voyage de Paris à Limoges, questionner les aubergistes, les loueurs de chevaux et même les filles de petite vertu !
— Voyez monsieur Colbert avant que de partir. Faites-lui part de notre projet, il vous allouera des fonds en conséquence. Vous aurez des frais, et puis les pistoles peuvent délier bien des langues.
Une dizaine de jours plus tard.
La réussite des mousquetaires du roi était cette fois en demi-teinte. On n’avait pas débusqué La Fontaine mais la septième lettre destinée à sa femme avait été retrouvée. Elle était restée dans un relais de poste, entre Bellac et Limoges. Pour autant, l’enquête n’avait guère progressé : hormis les allusions à Foucquet et à Colbert, l’ensemble n’avait livré aucun indice sérieux. Alors le comte d’Artagnan eut une idée.
— Comme les six premières, cette missive a été adressée à Marie Héricart. Pourquoi n’irions-nous pas la trouver ? À n’en pas douter, elle saura en lire les sous-entendus.
Il fut alors convenu que le prévôt de Paris et le capitaine des mousquetaires iraient prochainement visiter l’épouse du futur fabuliste.
Le lendemain, rue du Chastel à Château-Thierry.
La femme qui les reçut était jeune, ravissante et bien mise. Si La Fontaine la délaissait, c’est surtout en raison de son tempérament qui l’inclinait à l’instabilité. À butiner de-ci de-là, à l’instar des insectes qu’il mettra plus tard en scène… Marie Héricart s’était fait une raison, elle entretenait avec son époux une relation amicale désormais, mais à distance{12}. Elle accueillit ceux qui enquêtaient « au nom du Roy » avec une affabilité non feinte. Le prévôt lui tendit la septième lettre et lui fit part de ses soupçons : Jean de La Fontaine se dissimulerait-il pour œuvrer au profit du surintendant destitué par une décision royale ?
Marie les pria de s’installer confortablement avant de s’asseoir et de lire la lettre à part soi. Elle éclata alors de rire, à la grande surprise de ses visiteurs. Eux ne goûtèrent pas particulièrement cette hilarité, tant l’heure ne leur paraissait pas propice à la badinerie ! Ils sollicitèrent alors une prompte explication.
— Pardonnez ma soudaine gaieté, messires. N’y voyez aucune impertinence de ma part. C’est que je ne suis nullement surprise par ce que je lis. Au contraire, j’y reconnais bien mon Jean…
— Nous sommes tout disposés à vous croire, mademoiselle La Fontaine{13}, mais faites-nous la grâce de nous dire ce que vous avez entendu derrière ces lignes, je vous prie.
Alors, la digne épouse de l’imprévisible La Fontaine se lança dans une glose minutieuse, alternant lecture et commentaires.
— Voyons cela, messieurs… Jean écrit donc :
« Certains séjours peuvent paraître déplaisants de prime abord, avant de se révéler du plus grand intérêt quand on y trouve de l’agrément. »
Rappelez-vous, s’il vous plaît, ces quelques lignes versifiées de la sixième lettre. Jean y évoquait Limoges en ces termes :
« Ce n’est pas un plaisant séjour :
J’y trouve aux mystères d’Amour
Peu de Philis, beaucoup de Jeannes. »
Vous le savez, les « Jeannes » sont des femmes ordinaires. Il lui faut des femmes plus divertissantes, voyons ! Continuons la lecture. Qu’écrit-il ensuite ?
« Certaine circonstance nouvelle m’a décidé à retarder mon départ de quelques jours, sans que mes compagnons de voyage en fussent informés, de peur qu’on ne contrariât mes desseins ! »
— Vous voulez dire qu’il a enfin trouvé une Philis capable de l’affrioler et qu’il a demeuré auprès d’elle ?
— Et quoi d’autre, messieurs ? Écoutez les trois vers qui suivent. Ne prennent-ils pas tout leur sens désormais ?
« Maintenant que monseigneur le serpent
A croqué tous les petits écureuils,
Au tour de Céladon d’être content{14}. »
— En d’autres termes, reprit d’Artagnan, comme l’écureuil symbolise Foucquet et la couleuvre Colbert, il nous dit que l’affaire du surintendant est réglée parce que Colbert en a écarté tous les protagonistes… Et qu’il est temps maintenant pour lui de prendre du bon temps…
— Vous avez parlé juste, monsieur le comte. Oh ! Jean ne cherche pas le grand amour, comme ce Céladon auquel il se compare, juste une accorte bourgeoise capable de lui faire oublier les désagréments du voyage !
Ainsi, les autorités royales s’étaient superbement fourvoyées ! La Fontaine était certes un esprit libre, un peu trop libertaire pour complaire au monarque et aux Grands. Toutefois, il était suffisamment lucide pour éviter de jouer le pot de terre contre le pot de fer. Il savait pertinemment que rien n'était capable d’atténuer la fureur royale contre le clan Foucquet. L’affaire qui avait tenu les officiers du roi en haleine se terminait donc comme une farce…
Sur le point de quitter Limoges, La Fontaine avait rencontré une jeune veuve tout à fait avenante. En quelques jours — et quelques nuits –, la gironde limousine avait rendu la ville bien agréable ! En son for intérieur, La Fontaine avait bien estimé que l’inconsolable jeune femme avait séché ses larmes un peu vite, mais l’épicurien avait suivi la pente de ses désirs.
Grand observateur des animaux et des hommes, La Fontaine avait alors constaté que malgré les regrets et les pleurs,
« Sur les ailes du temps la tristesse s’envole. »
Il y a fort à parier que l’accueillante limougeaude fut l’inspiratrice de l’une de ses plus belles fables, « La Jeune veuve ».
***
Le réel et l’imaginaire.
Cette histoire est totalement fictive, mais tout y est vraisemblable car je me suis appuyé sur un grand nombre d’éléments biographiques réels : l’arrestation de Foucquet par Charles de Batz, comte d’Artagnan le 5 septembre 1661, la charge de maître des Eaux et Forêts exercée par La Fontaine à Château-Thierry, son voyage en août 1663 et sa fidélité à son malheureux mécène. Fidélité attestée par plusieurs textes, notamment la célèbre « Ode au roi ».
La Fontaine n’entretenait plus guère que des relations épistolaires avec son épouse, Marie Héricart, la nièce de Jannart. Il lui a bien adressé six lettres au cours de son voyage. Peut-être indélicat mais pas cachottier, il n’hésitait pas à lui parler des femmes qu’il avait remarquées ! Par ailleurs, les biographes du fabuliste considèrent que ces missives étaient censées circuler de main en main, de manière à être lues au passage. Une opération de com’ dirions-nous aujourd’hui. En quête de notoriété, La Fontaine avait en quelque sorte utilisé le réseau social du Grand siècle. En 1663, il n’avait pas encore publié les œuvres qui le rendirent célèbre : les premiers contes furent publiés en 1665, les premières fables en 1668.
Une septième lettre est bien mentionnée dans la sixième, mais à ma connaissance, elle n’a jamais été retrouvée. Les extraits de cette septième lettre qu’on peut lire dans la nouvelle sont donc sortis de mon imaginaire. Tout comme le séjour prolongé de La Fontaine auprès de sa blonde limougeaude. Comme on ignore la date exacte de son retour, on pouvait bien combler ce trou dans son emploi du temps ! Le récit se termine un peu comme une farce, un vaudeville que n'aurait sûrement pas renié le futur auteur des contes.
Molière et le policier metteur en scène
— Monsieur ! quelqu’un vient d’arriver, un homme du bel air qui exige de vous un moment d’entretien.
— Je t’avais pourtant dit d’éconduire les fâcheux !
— Tudieu ! c’est qu’il insiste. Il dit qu’il a été envoyé par le lieutenant général de police et qu’il agit au nom du roi…
Le grand Molière blêmit et parut fort contrarié par cette annonce. Il se radoucit pourtant : protecteur des artistes, monsieur de La Reynie ne l’avait-il pas soutenu dans sa défense du Tartuffe{15} ?
Une fois le visiteur introduit dans la loge, La Forest s’éclipsa discrètement : femme à tout faire, elle était depuis fort longtemps au service du directeur de la troupe des Comédiens du Roy. Domestique, habilleuse, elle était aussi une précieuse confidente pour Molière, et bien davantage encore, quand le maître en éprouvait le besoin...
— Monsieur Poquelin, je suis le chevalier Du Plessis, commissaire au Châtelet. J’ai l’honneur d’être aux ordres de monsieur de La Reynie, que vous connaissez, si ce qu’on m’a rapporté est véridique…
— De vrai, monsieur, répliqua Molière qui feignit de ne pas avoir perçu la pointe ironique de son visiteur. Donnez-vous la peine de prendre un siège et mandez-moi le but de votre visite. Je suis très occupé mais il n’y a rien que je ne fasse pour obliger monsieur de La Reynie.
C’est que l’affaire était délicate…
La nuit précédente, les archers du guet avaient découvert le corps supplicié et sans vie d’une jeune femme dans la rue de l’Arbre-sec, tout près du Palais Royal. Ce qui incommodait les autorités au plus haut point, c’étaient les dires de plusieurs témoins qui avaient vu la future victime entrer dans les locaux du théâtre quelques heures avant son trépas.
— Je n’ai rien à celer, déclara Molière que cette accusation à peine voilée mettait mal à l’aise. J’ai eu l’heur de recevoir cette jeune personne très prometteuse hier, en effet. Elle avait ouï dire que j’étais en quête d’une comédienne qui pût incarner Célimène dans mon Misanthrope. Je l’ai écoutée réciter des vers de Corneille et comme je lui avais promis de l’engager, elle s’en est allée, gaillarde, avant qu’il fût le soir. Ciel ! la pauvrette… elle était si enjouée et semblait si talentueuse !
— À quel moment précis a-t-elle pris congé de vous ?
— Je ne saurais l’affirmer avec certitude…
— C’est fort regrettable !
— Ah si ! une de nos costumières l’a rencontrée en revenant des vêpres, elle s’est même enquise auprès de moi du nom de cette visiteuse.
— En revenant des vêpres ?
Molière fit encore mine de ne pas sentir l’allusion au préjugé concernant l’impiété et le libertinage des gens de théâtre. Il avait fait son devoir en donnant au chevalier une indication précise, l’office des vêpres étant invariablement à la même heure.
— Ce qui me chagrine fort, monsieur Molière, c’est que la jeune et jolie comédienne a été vue en grande conversation avec quelqu’un de votre troupe, un certain Baron{16}.
— Je me porte garant de mes comédiens, monsieur le chevalier. Michel est un jeune homme au talent indiscutable et c’est aussi un bel esprit.
— Je suis tout disposé à vous croire mais ce n’est pas l’opinion de votre épouse ! Je l’ai croisée à mon arrivée en ces lieux, elle tient Baron pour une canaille ! Ce sont ses propres termes.
— Elle a eu une algarade avec lui autrefois, elle n’est pas juste !
— Vous souffrirez tout de même que je questionne ce Baron, ainsi que d’autres de vos gens.
— Procédez, monsieur Du Plessis, procédez je vous prie.
— Le lieutenant général qui semble faire grand cas de votre théâtre m’a instamment prié de n’y point gêner les répétitions. Vos heures seront les miennes, je reviendrai à votre convenance.
— Dans ce cas, c’est le sieur de La Grange qui vous fera connaître les heures et les jours de nos répétitions et de nos représentations. Je vais vous mener jusqu’à lui.
Entré dans la troupe en 1659 pour y jouer les jeunes premiers, Charles Varlet, dit sieur de La Grange, avait très vite gagné l’estime du patron grâce à ses qualités de comédien mais aussi grâce à son sens de l’organisation. En tenant scrupuleusement les registres de la troupe, il en était devenu le secrétaire et l’économe. Du Plessis se fit remettre la liste de tous ceux qui avaient travaillé au théâtre la veille, ainsi qu’un calendrier détaillé des activités à venir.
Depuis le succès d’Amphitryon et l’autorisation royale pour jouer de nouveau le Tartuffe, la troupe des Comédiens du Roy était animée d’une sorte de frénésie. Quant à Molière, il courait en tous sens ; il tenait à tout conduire, à tout contrôler, jusqu’au choix des décors et des costumes, jusque dans les moindres détails.
Quand le commissaire du Châtelet prit congé de La Grange, il avait en mains les renseignements indispensables à la poursuite de ses investigations. Pressé par monsieur de La Reynie de ménager Molière, il avait finement manœuvré…
— Un fin matois, ce Du Plessis ! fit observer La Grange. En feignant de ne pas nous contraindre à nous rendre au Châtelet pour y être interrogés, il s’octroie le droit de venir nous visiter quand il lui plaira…
— Tu lui as fait connaître les heures de nos répétitions, au moins ?
— Oui, mais maintenant, il va pouvoir jouer l’importun !
— Eh bien ! Qu’il vienne ! Nous n’avons rien à dissimuler, et s’il se montre trop insistant, j’en toucherai deux mots à qui de droit. Bon… je cours jusqu’à mon logis pour y quérir Armande… enfin si elle est rentrée{17}… Nous répéterons un peu plus tard. J’aimerais bien savoir ce qu’elle a dit exactement à ce commissaire.
Le lendemain, quand Du Plessis se faufila dans le théâtre pour venir questionner ledit Baron, il feignit de se fourvoyer, errant de-ci de-là dans les couloirs. Il parvint dans une salle où deux comédiennes discutaient entre elles, il y fut accueilli sans plus d’égards que le marquis fâcheux de l’Impromptu de Versailles ! Faisant comme si elle ne l’avait pas vu, Catherine eut la présence d’esprit de réciter, à l’intention du chevalier, une tirade adaptée à la circonstance{18} :
« Monsieur, ces demoiselles ont peine à vous dire qu’elles souhaiteraient fort que votre personne ne fût ici pendant cette répétition. »
Ne sachant démêler la part de sincérité et la part de comédie, le commissaire demeura un instant interdit. Il bredouilla ensuite de maladroites excuses avant de tourner les talons et de retrouver, comme par enchantement, le chemin du local qui servait à Molière de loge, de bureau et même de chambre à coucher. Baron avait été convoqué par son patron ; après de brèves présentations, celui-ci quitta les lieux, laissant le commissaire et le jeune comédien en tête à tête.
— Monsieur Michel Boyron, dit Baron, est-ce bien cela ?
— Oui, monsieur, mais qu’attendez-vous de moi, s’il vous plaît ?
— C’est moi qui pose les questions, c’est moi qui mène la danse, jeune homme ! Et pas à la manière de Lully{19}, plutôt dans le style des inquisiteurs !
Devant ce commissaire du Châtelet qui ne semblait pas d’une grande bienveillance à l’égard des saltimbanques, pas question de disputer : mieux valait lui donner satisfaction…
— J’implore votre pardon, monsieur le chevalier, et je suis prêt à aider la justice du Roy.
« Trop éloquent pour être honnête ! se dit Du Plessis à part soi. Restons sur nos gardes ! Ces comédiens ont quelque chose de diabolique, on ne sait jamais s’ils répondent ou s’ils déclament ! »
— Michel Boyron, reprit-il à voix haute, l’on vous a vu céans converser avec la jeune femme qui fut suppliciée quelques heures plus tard.
— Mes répliques peuvent être cinglantes, elles n’ont jamais tué personne, monsieur ! objecta le jeune homme qui ne se privait jamais du plaisir d’un bon mot, au risque d’incommoder son interlocuteur.
— Vous excellez dans l’art du sarcasme, soit ! Mais votre humeur badine ne plaide pas en votre faveur. Dites-moi plutôt et sans tergiverser le sujet de votre entretien avec cette Isabelle !
— Mais monsieur, je ne badine pas. Acceptez derechef mes excuses, je ne suis point accoutumé à commercer{20} avec les gens du guet. Sachez qu’avec Isabelle, l’entretien fut charmant. Comme je savais que le patron allait l’engager, je lui faisais part de ma joie à l’idée de la revoir.
— Cherchiez-vous à la soumettre à vos désirs ?
— Que nenni ! monsieur le commissaire. Je ne suis point gentilhomme mais j’ai de l’honneur et de l’éducation. La submission{21} n’est pas ma méthode pour attraper les belles !
— Madame Molière, l’épouse de votre illustre directeur, vous a vu en conversation avec Isabelle. Elle a déclaré que votre discord était manifeste et que vous sembliez fort l’importuner…
— Madame Molière ne m’aime guère ! Lors de mon premier séjour dans la troupe, nous nous sommes querellés, j’avais alors 13 ans…
— Ainsi vous avez appartenu à la troupe de Monsieur, frère du Roy ! Quel rôle pouviez-vous y tenir, à peine sorti de l’enfance ?
— Je suis un enfant de la balle, monsieur. Le théâtre, c’est ma vraie famille. À la mort de mes parents, j’avais été placé chez la Raisin{22}. Monsieur Molière m’avait un jour remarqué pour ma manière de déclamer et je suis alors entré dans sa troupe. Ô plus comme un « apprentif » que comme un vrai comédien… Armande ne m’appréciait pas et maintenant, elle se trouve fort marrie que monsieur m’ait retrouvé, qu’il m’ait de nouveau agrégé à sa troupe… et hébergé en son logis !
— Aucune querelle entre vous et Isabelle, donc. Vous êtes positif sur ce point ?
— Aucune querelle. Je crois même pouvoir affirmer que je n’avais pas laissé Isabelle insensible… Dommage !
D’un regard furtif, le commissaire jaugea le jeune homme. Outre son habileté à discourir et sa belle humeur, le galant était admirablement proportionné. Nul doute que son charme opérât auprès des belles. Comme si Baron avait lu dans les pensées du chevalier, il ajouta, l’air espiègle :
— Vous me croirez si vous voulez, la Molière ne me regarde plus comme elle le faisait il y a quatre ans… Je gage qu’elle ne m’a desservi à vos yeux que par pure jalousie{23}. Quand elle nous a lorgnés en passant, Isabelle était sur le point de partir. Je suis d’ailleurs rentré car le patron m’avait envoyé quérir.
— Qui est venu vous chercher ?
— Marceline, la costumière qui venait d’arriver après avoir assisté aux vêpres, comme chaque jour.
— Êtes-vous ressorti ensuite ?
— Non, monsieur. Molière avait des directives à nous donner à propos de son Tartuffe. Après la répétition, nous avons tous fait chère lie{24} à la taverne de la Pomme du pin.
— Tous ! C’est-à-dire ?
— Toute la troupe.
Il convenait de vérifier promptement les dires du jeune homme. Si aucun témoignage ne venait les démentir, Baron serait hors de cause. Le commissaire se fit reconduire au Châtelet incontinent. En chemin, il réfléchit : rien dans les propos du godelureau ne semblait à reprendre, rien dans son comportement ne semblait trahir une volonté de travestir la vérité… Et si la Molière avait menti par pure jalousie ? Était-il possible qu’elle eût homicidé elle-même une rivale ? À moins que Baron n’ait lancé cette idée pour nuire à celle qui ne cachait pas son hostilité à son égard… Allons ! se dit-il à lui-même, je ne dois pas laisser la confusion gagner mon esprit. Il me faut revenir aux faits, étayer mes cogitations sur des certitudes.
L’heure était venue de s’enquérir des constats des médecins chargés de l’examen post-mortem. Partisan des principes récemment élaborés par Descartes, Du Plessis prônait une approche méthodique. Il était impérieux de savoir comment on avait occis la jeune comédienne. Quand les suspects étaient des gueux, les investigations étaient plus faciles : on les arrêtait sans ménagement, on les intimidait d’emblée et on pouvait même leur appliquer la question{25}. Mais cette fois, il s’agissait de l’entourage d’un homme qui avait ses entrées à la Cour… Jean-Baptiste Poquelin avait conservé sa charge de « tapissier du Roy » et à ce titre, il était parfois admis au lever du monarque. Il ne s’agissait pas de faire un pas de clerc !
De son côté, seul dans sa loge, le grand Molière était pensif, l’inquiétude l’avait gagné. La protection royale ne lui apparaissait plus comme une évidence. Grand observateur des us et coutumes en vigueur à Versailles, il savait qu’une disgrâce pouvait frapper soudainement quiconque avait déplu au maître des lieux. D’autant que Lully, à qui Molière avait accordé toute sa confiance et toute son amitié, n’avait de cesse d’intriguer pour le supplanter dans l’estime du roi. La Cour était alors un univers où chacun cherchait à pousser ses affaires, dût-il pour cela évincer ses concurrents.
Comment expliquer l’affliction qui avait envahi l’auteur du Tartuffe ? Avait-il quelque chose à dissimuler ? Détenait-il un secret qu’il convenait de taire ? Protégeait-il un proche ? C’était en tout cas la conviction qui s’était forgée dans l’esprit de ce commissaire réputé pour sa grande perspicacité : pour lui, quelqu’un de l’illustre théâtre était compromis dans le meurtre d’Isabelle !
Il reviendrait donc le lendemain avec quelques archers afin de perquisitionner les locaux du théâtre. On ne trouverait sûrement rien mais on inspirerait la crainte et ceux qui avaient quelque chose à se reprocher feraient à coup sûr un faux pas.
Dans le local destiné aux examens des cadavres, Du Plessis reconnut le docteur Péronne et le chirurgien Maupas qui avaient uni leurs arts pour découvrir les causes du trépas{26}