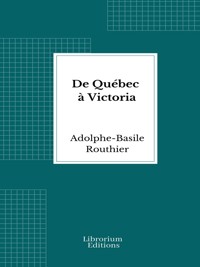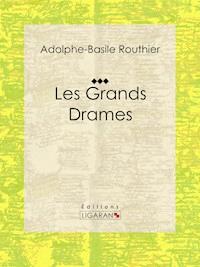Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "La neige tombait par flocons quand nous avons quitté Québec, hier, et je disais à mes amis : Dieu soit béni ! je tourne le dos à la neige et je cours vers le soleil. Mais le soleil était loin, et nous avons eu quelque peine à l'atteindre. Après nous avoir boudés toute la journée d'hier, il nous a enfin montré ce matin sa face souriante, et il a mis en fuite toute une légion de petits nuages qui se sont réfugiés au couchant."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MONSIEUR ARTURO BALDASANO Y TOPETE
COMMANDEUR DES ORDRES D’ISABELLE LA CATHOLIQUE ET DU MÉRITE NAVAL, CHEF D’ADMINISTRATION, CONSUL GÉNÉRAL D’ESPAGNE À QUÉBEC, etc., etc.
Je dédie ce livre, qui n’est qu’une faible expression de l’admiration que j’ai conçue pour son beau pays.
En comparant l’Espagnol aux autres peuples de l’Europe, je reconnais qu’il a su conserver mieux que les autres ses croyances, ses traditions, son vieil honneur.
Il est resté noble ; il n’a pas été atteint par la fièvre de l’agiotage ; il n’a pas appris à faire fortune, sans travailler, dans des coups déboursé qui ruinent des milliers de malheureux et qui font saigner les consciences.
À vous qui représentez dignement cette noble race au Canada, je présente ces pages modestes, espérant que vous pardonnerez à leur auteur les critiques sans amertume qu’il s’est permises, et les erreurs qu’un voyage trop rapide a dû lui faire commettre.
Québec, juin, 1889.
A.B. ROUTHIER.
Une partie de cet ouvrage se compose de lettres publiées dans la Minerve pendant l’hiver de 1884. Avant de les mettre en volume, je les ai revues, corrigées et considérablement augmentées.
En outre, j’ai cru devoir y joindre des études faites depuis sur l’histoire, la littérature et le théâtre de l’Espagne.
Sans doute ce travail est encore bien incomplet ; mais j’ose espérer qu’on ne le trouvera pas sans intérêt, et qu’il contribuera à faire mieux connaître et apprécier par mes compatriotes un pays qui mérite de l’être, et avec lequel nous devrions entretenir des relations plus étroites et plus suivies.
Départ de Québec. – Les côtes de Gaspé. – La télégraphie des pavillons. – Comment on gouverne les navires et les peuples. – Chant des matelots. – Les îles Miquelon et Terreneuve. – Les mouvements de la mer et le navire. – Croquis féminins.
18 Novembre, 1883.
La neige tombait par flocons quand nous avons quitté Québec, hier, et je disais à mes amis : Dieu soit béni ! je tourne le dos à la neige et je cours vers le soleil. Mais le soleil était loin, et nous avons eu quelque peine à l’atteindre. Après nous avoir boudés toute la journée d’hier, il nous a enfin montré ce matin sa face souriante, et il a mis en fuite toute une légion de petits nuages qui se sont réfugiés au couchant. En retraitant vers le bas de l’horizon, ils se sont rangés en bon ordre comme des soldats bien disciplinés, et ils ont formé une phalange serrée que l’astre n’a pu percer.
Le navire longe les côtes de Gaspé, que la neige n’a pas encore entièrement blanchies, mais qui grisonnent légèrement comme les vieux garçons qui manquent de teinture. Au pied des montagnes, sur les grèves solitaires, se détachent çà et là, comme des bas-reliefs ciselés, quelques pauvres villages de pêcheurs. On les voit groupés comme des bandes de goélands, tantôt au fond d’une petite baie, tantôt à l’embouchure d’une petite rivière, dont le cours dessine une profonde déchirure dans la montagne.
Un vaisseau à voiles passe à l’horizon, et nous télégraphie son nom, sa destination, presque tout un récit de voyage.
Quelle jolie invention que cette télégraphie au moyen de pavillons ! N’est-ce pas imité de la politique, où l’on parle si bien le langage des couleurs et des drapeaux ? Aussi ai-je observé à bord une pratique que les politiciens connaissent mieux encore peut-être que les matelots : c’est de ne déployer le pavillon que lorsqu’il est en haut. Pour le hisser, ils le roulent soigneusement de manière à ce qu’il puisse monter à travers les cordages et les vergues sans s’accrocher nulle part, et de telle sorte qu’on en soupçonne à peine les couleurs. Mais une fois au bout du mât le pavillon se déroule, il exhibe librement toutes ses nuances, et il flotte triomphalement.
Ne font-ils pas ainsi, les partis et les chefs politiques qui cachent leurs principes pour gravir sans obstacles les hauteurs du pouvoir, et qui ne déploient franchement leur drapeau que lorsqu’ils sont vainqueurs ?
Le couchant a changé d’aspect. Les petits nuages se sont allongés, étirés, comme des écheveaux de laine de couleurs différentes, et je ne sais quelle navette mystérieuse les tisse et les drape comme une belle étoffe à rideaux. Ils forment des zones de largeurs diverses, mais toutes horizontales, et tour à tour bleues, rosées et grises. C’est une riche tenture ; mais à cette saison de l’année où le soleil ne saurait griller le teint le plus délicat, j’aimerais mieux le ciel tout bleu.
19 Novembre.
Une autre chose digne de remarque à bord, c’est que ceux qui dirigent sont à l’avant. La passerelle où se tiennent sans cesse le capitaine et ses officiers, la cabine ronde qui abrite la roue et ceux qui la tiennent occupent des postes non seulement élevés mais avancés, bien que le gouvernail qui imprime la direction, et l’hélice qui est le grand moteur, soient à l’arrière.
Le même ordre doit être observé pour bien conduire les individus et les peuples. Les vrais, chefs doivent marcher en tête. C’est d’eux que l’opinion publique, qui est le gouvernail, et le peuple qui est la force motrice, doivent recevoir la direction. S’ils laissaient le peuple faire tout ce qu’il veut, et courir où il lui plaît, sans lui indiquer la route à suivre, nous aurions le spectacle d’un navire sans pilote, obéissant à la fois à l’hélice et aux caprices de la mer et du vent.
Les matelots hissent les voiles et chantent, un air mélancolique que je trouve délicieux. Que de charmes dans la vie du marin, mais aussi que de tristesses ! Les chants de la terre sont plus-généralement gais ; ceux de la mer semblent imprégnés d’une espèce de nostalgie. Les marins ont beau aimer la mer ; ils sentent que ce n’est pas la patrie, et quand leurs yeux sont perdus sur l’immensité, c’est au-delà des mers qu’ils regardent. Mais quand la tempête vient les assaillir ils oublient la terre et la mer, et c’est vers le ciel qu’ils élèvent leurs regards.
C’est pourquoi le rythme mineur domine dans toutes leurs chansons. Atomes perdus entre deux abîmes, ils sont envahis par une vague mélancolie dont ils n’ont pas conscience, mais qui n’en est pas moins invincible et perpétuelle.
Nous avions perdu de vue la terre et nous la regrettions déjà, lorsqu’elle nous est apparue de nouveau sur notre gauche. Ce sont la grande Miquelon, la petite Miquelon et Saint-Pierre, rangés sur une même ligne. On les prendrait de loin pour des baleines énormes nageant à la surface de la mer, et se dirigeant à la file vers les rives canadiennes. De près, ce sont plutôt des navires, chargés de Français, qui venaient nous rejoindre, et qui se sont échoués à l’entrée de notre golfe. En souvenir de Jacques Cartier, on devrait les appeler la grande Hermine, la petite Hermine et l’Emérillon.
Plus loin, Terreneuve se cache dans les brumes éternelles. Que ce pays semble désolé ! Je m’étonne que tant de brouillards et de tempêtes n’aient pas encore submergé cette île mystérieuse ; mais je ne m’étonne pas que l’on vante tant ses chiens, car si j’en juge par les apparences, c’est un pays de chiens et un « chien de pays ».
Cela me rappelle qu’un jour j’ai rencontré à bord d’un steamer un jeune Canadien revenant des États-Unis, tout à fait yankéfié, et accompagné d’un joli chien de Terreneuve.
– Quel beau terreneuve vous avez-là, lui dis-je.
– Ce n’est pas un terreneuve, répondit-il, c’est un newfoundland.
– Ah ! j’avais cru…
– Non, monsieur.
Je racontai la chose à plusieurs passagers, et ils s’amusèrent à le féliciter tour-à-tour sur son terreneuve. Mais le jeune homme leur répondait imperturbablement : « Pardon, monsieur, c’est un newfoundland. »
En nous éloignant des côtes, sur les bancs toujours brumeux nous rencontrons quelques goélettes de pêcheurs, et des troupes de goélands. Cela me remet en mémoire une chanson que Turquety met dans la bouche des jeunes filles bretonnes vivant au bord de la mer :
Il y a de ces oiseaux de mer qui nous suivent toute la traversée, planant au-dessus de la vague, le col tendu, et attendant leur nourriture. Aussitôt que les cuisiniers du vaisseau leur ont jeté la manne qu’ils guettent, ils s’abattent d’un coup d’aile et sauvent leur dîner du naufrage. Leur voracité a de quoi se satisfaire, et ils font la noce, sans craindre le mal de mer.
20 Novembre.
Il n’y a pas un fil de vent, et le brouillard nous enveloppe. Le roulis se fait sentir et les victimes du mal de mer qui gémissent dans leurs cabines s’imaginent qu’il fait un grand vent. Est-ce une tempête ? demandent-elles avec anxiété.
Eh ! bien non ; mais la mer est perpétuellement en mouvement, sans cause apparente. Elle soupire comme un cœur qui souffre, et son sein se soulève en exhalant une plainte.
Ô mer ! pourquoi souffres-tu ? Dis-moi le secret de ta douleur. Est-ce le regret d’avoir englouti des milliers de mes semblables ? Est-ce une expiation de tes nombreux homicides ? Est-ce la peine du talion que tu subis pour les cœurs que tu as brisés, et pour les larmes que tu as fait répandre ? Alors, souffre, misérable, car tu l’as bien mérité.
Mais non, ce n’est pas cela. La mer souffre, avec toute la nature, parce que l’homme souffre. La douleur est le lien commun qui unit tous les êtres, étalon dirait qu’une mutuelle sympathie rapproche l’homme et la mer. C’est en vain qu’il résiste à cette sensation mystérieuse la première fois qu’il se livre à ses mouvements. Quand elle s’agite il ne peut rester calme, et quand elle se soulève il se sent le cœur gonflé.
Si les femmes sont plus sensibles que les hommes à cette mobilité malsaine de la mer, c’est qu’elles sont naturellement plus sympathiques. Est-ce parce qu’elles ont plus de cœur que nous, ou parce que leurs cœurs sont plus faibles ? Voilà un problème que je ne veux pas résoudre.
22 Novembre.
Le vent s’est élevé, et la mer moutonne. J’aime cette expression qui me représente la mer comme des pâturages sans limites, couverts d’innombrables troupeaux de brebis blanches. Ce matin, c’était de charmants agneaux sautillant légèrement dans la verdure ; mais à présent ce sont des béliers qui bondissent, et leurs mugissements les feraient prendre pour des buffles.
C’est à eux, sans doute, que pensait le psalmiste quand il demandait aux montagnes pourquoi elles bondissaient comme des béliers ; car en mer les deux se ressemblent, et les spécimens de l’espèce ovine qui gambadent en ce moment autour du navire ont presque la taille des montagnes.
Je comprends pourquoi les flots courroucés du lac de Tibériade obéissaient si bien à la voix du Christ ; c’est qu’ils reconnaissaient en lui le Pasteur universel. Ô divin berger ! il faudrait bien votre houlette pour rassembler aujourd’hui l’immense troupeau échappé de la bergerie.
23 Novembre.
La nuit vient déjà, et le ciel est sombre. Une grande brise de l’Ouest nous poursuit ; mais le Parisian se sauve si bien qu’elle a quelque peine à le suivre. Dans la nuit, le steamer ressemble à un monstre de fer gigantesque, qu’un esprit mystérieux anime, et qui fait une course fantastique au-dessus de l’abîme. Les vagues se dressent en vain devant lui ; il les brise avec fracas, il ; les réduit en écume, il les lance au loin, il creuse au milieu d’elles son sillon profond, et court toujours sans écouter leurs plaintes.
Quelle puissance dans cet organisme de fer ! Quelle grandeur dans l’âme qui l’habite, et qui n’est autre que le génie de l’homme ! Mais en même temps comme on sent bien, en mer, que l’assistance divine lui est toujours nécessaire !
Que faut-il en effet pour que ce mécanisme si savant et si fort fasse soudainement défaut ! Que faut-il pour que ce titan devienne une épave ? – Un rien, une cheville qui se brise, un écrou qui se déplace, un jet de vapeur qui s’échappe.
Une étincelle dans les flots d’huile qui coulent partout suffirait aussi pour allumer un incendie ; et que deviendrions-nous entre le feu et l’eau, à douze cents milles des côtes ?
Mais, dans la nuit sombre, au-dessus des vagues amoncelées, plus haut que les nuages ténébreux qui nous cachent les célestes flambeaux, nous savons que l’œil de Dieu flamboie, qu’il nous regarde et qu’il nous protège.
25 Novembre.
Les côtes d’Irlande se dessinent à l’horizon, et dans quelques heures nous serons à Movile.
J’ai traversé la mer en avril, en juin, en août et en septembre, et je n’hésite pas à dire que la traversée que je viens de faire est la plus belle de toutes, au point de vue de la température, du vent et de la rapidité.
Le ciel est presque pur et nous promet une belle nuit. Nous serons à Liverpool demain matin, lundi, avant le jour.
Je m’amuse à croquer quelques spécimens du beau sexe qui sont à bord, pour répondre à une dame qui a fait quelques silhouettes assez piquantes du sexe fort.
Mademoiselle A. – Anglaise de naissance, Française de caractère. Feu-follet capable d’égarer les voyageurs imprudents. Oiseau-mouche qui voltige et bourdonne sans cesse, et qui après avoir vainement cherché des fleurs, se métamorphose en guêpe et pique délicatement tout le monde.
Madame B. – Belle au bois dormant, gardée par un minotaure. Énigmatique comme le sphynx, froide et muette comme une statue. Sourire ressemblant à une grimace.
Mademoiselle C. – Toute petite, mais convaincue qu’elle est grande, et regardant les autres du haut de sa grandeur. Comptant ses pas, faisant économie de sourires, et fort heureuse de penser (si elle pense), que le silence est d’or.
Madame D. – Circassienne rêveuse, coiffée d’un turban rouge. Toujours étendue sur un divan, avec une nonchalance orientale. Je parie qu’elle s’endort le soir en répétant : Allah ! Allah ! Dieu seul est grand !
Madame E. – Femme charmante, sachant se taire et parler, riant de bon cœur et à propos. Esprit actif et cœur calme, préférant un bon repas aux rêveries sentimentales. Assez dévouée à son mari pour faire le désespoir de son voisin.
Visite au marquis de Lorne. – L’ambassade d’Angleterre à Paris. – Marseille. – Entrée imaginaire en Espagne. – Barcelone, Tarragone, Montserrat, Saragosse, Lourdes. – Pau.
Pau, 10 Décembre 1883.
Depuis ma dernière lettre qui était ma première, j’ai voyagé à grandes journées ; et ma course a été aussi irrégulière que celle des comètes.
Je n’ai pas voulu quitter Londres sans aller voir le marquis de Lorne qui m’a reçu avec une amabilité parfaite. Il est très bien installé au palais de Kensington, et dans le long corridor qui conduit du vestibule à ses appartements, j’ai pu saluer, comme des compatriotes, les grands caribous empaillés qu’il a rapportés du Canada.
Le noble lord m’a dit qu’il donnerait, dans le cours de l’hiver, une série de conférences sur notre pays, et qu’il allait commencer dès le surlendemain à Birmingham. Il se propose en outre de publier, au printemps, un ouvrage qui sera probablement intitulé : Canada Illustrated, et qui contiendra, outre les informations les plus importantes, de nombreuses gravures destinées à faire mieux connaître notre pays.
Il espère pouvoir, dès le mois de mai, diriger vers le Nord-Ouest plusieurs milliers d’émigrants, grâce à son initiative personnelle.
Il garde le meilleur souvenir des Canadiens, et rêve pour nous un brillant avenir.
Grâce à sa recommandation, j’ai reçu à l’ambassade d’Angleterre, à Paris, l’accueil le plus bienveillant, et lord Lyons m’a remis une lettre pour le ministre plénipotentiaire anglais au Caire, dans la prévision que je me rendrais en Égypte. L’ambassade anglaise est princièrement installée tout près de l’Élysée, et l’on n’arrive jusqu’à Son Excellence qu’en traversant une suite de salons somptueusement meublés.
Lord Lyons m’a paru fort alarmé des nouvelles récemment arrivées d’Égypte ; mais les Français ne croient guère à la sincérité de ses alarmes. Ils soupçonnent que notre mère-patrie exagère le danger pour se justifier de maintenir ses troupes nombreuses en Égypte, et pour conquérir finalement ce pays.
Le froid, le vent et la pluie m’ont bien vite chassé de Paris, et je n’ai retrouvé qu’en Provence le beau ciel bleu et le soleil. C’est avec un vrai plaisir que j’ai revu Marseille, et même les Marseillais.
Il y faisait un peu froid, et le mistral soufflait avec violence, mais le ciel était pur, et les chauds rayons du soleil riaient dans l’éternelle verdure des gazons et des charmilles, sur le Prado et dans le jardin de Longchamp.
Je me proposais de me rendre par mer de Marseille à Barcelone ; mais j’ignorais jusqu’à quel point l’Espagne est séparée du reste de l’Europe. Une zone mystérieuse l’enveloppe, et la traverser semble une entreprise pleine de hasards.
Lors donc que j’ai voulu m’embarquer à Marseille pour Barcelone, je me suis heurté à mille obstacles. Telle compagnie avait de mauvais paquebots auxquels on me conseillait de ne pas risquer ma précieuse existence.
Telle autre n’avait aucun départ avant le dimanche suivant, et nous étions au lundi. Enfin, les steamers de la troisième ne partaient que tous les quinze jours, et arrivaient Dieu sait quand.
Il me restait la voie de terre ; mais c’était plus long, plus dispendieux et plus fatiguant. Comme compensation, cette voie me rapprochait de Lourdes, et la grande fête de l’immaculée Conception était prochaine.
Ces raisons me décidèrent à changer mon itinéraire, et à rentrer en Espagne par le Nord. C’était prendre le taureau par les cornes, et je savais à quelles injures de la température je m’exposais. Mais les éléments et les hommes semblaient conjurés pour me fermer la voie la plus courte, et je dus prendre la plus longue.
C’est ainsi que j’ai fait deux entrées en Espagne, l’une imaginaire et l’autre réelle ; et, comme on s’en doute bien, l’imaginaire a été la plus belle.
Les belles vagues libres de la Méditerranée avaient à peine un frisson, et le mistral mourait dans le port même de Marseille. Après douze ou quinze heures d’une navigation charmante, nous entrions dans les eaux calmes qui baignent les pieds de Barcelone.
Ville maritime fort animée, trop moderne, Barcelone nous paraissait un peu cosmopolite ; mais déjà ce n’était plus la France. C’était l’Espagne, avec ses vieilles cathédrales, ses vieux châteaux, ses cloîtres, ses femmes voilées et en mantilles.
Puis, nous courrions à Tarragone, admirablement située au bord de la mer, qu’elle contemple du haut de ses bastions crénelés. Nous y retrouvions des ruines et de vieux souvenirs de l’époque romaine et de la période mauresque. Nous visitions l’antique cathédrale, le vieux cloître avec ses longs promenoirs circulant autour d’un parterre embaumé, sous une série d’arceaux appuyés sur la plus élégante colonnade. Végétation luxuriante, air doux, ciel ensoleillé, guitares et castagnettes, voilà ce que mon imagination me montrait partout.
Avant de partir pour Tarragone, nous allions visiter Mont-Serrat.
Quelle apparition fantastique ! Un groupe de rochers échelonnés en pyramide, dressant vers le ciel des milliers de clochetons, d’arêtes, de tours et de pinacles ! Était-ce une forteresse, une cathédrale, un château ou un cloître ? C’était tout cela à la fois dans des proportions merveilleuses ; et de ces hauteurs où nous éprouvions la sensation du voisinage du ciel, nous contemplions à nos pieds la mer immense, miroir de l’infini.
Un jour, c’était, vers l’an 1526, l’on vit arriver au monastère de Montserrat, un jeune officier blessé. Il avait longtemps combattu pour son roi, Ferdinand le Catholique, et il venait de défendre vaillamment Pampelune, assiégée par Jean d’Albret. Très gravement blessé à la jambe, et devenu incapable de poursuivre sa carrière de soldat, il avait conçu le projet d’établir une autre milice qui combattrait les ennemis de l’Église par la parole, et qui répandrait au loin la vérité. L’ancienne chevalerie avait fait son temps. L’heure était venue d’armer des chevaliers spirituels pour lutter contre les nouvelles doctrines que la réforme propagerait dans le monde.
C’est dans l’Église de Mont-Serrat que le nouveau chevalier vint faire sa veillée des armes. Il se nommait Inigo de Loyola, et, quelques années après, il jetait à Paris les bases de cette puissante association qui s’est appelée la Société de Jésus.
Enfin nous arrivons à Saragosse, paresseusement couchée aux bords de l’Ebre, qui murmure bruyamment sans pouvoir la réveiller.
C’est là que se révélait à nos yeux le cachet national de la vieille Espagne. C’est là que nous retrouvions, écrits dans la pierre, les souvenirs culminants de son passé, le Moyen Âge et ses légendes, la domination arabe et son architecture étrange et gracieuse.
Nous visitions Notre-Dame-del-Pilar, basilique immense sans grande beauté, mais célèbre par la tradition qui lui a donné ce nom ; la Séo, cathédrale remarquable par la grandeur et l’élégance de ses nefs ; l’Aljaféria, ancien palais des rois d’Aragon, et tribunal de l’inquisition.
Mais pourquoi m’attarder à vous décrire ce rêve qui ne s’est pas réalisé ? En sacrifiant les jouissances que je comptais y trouver, j’ai rencontré des compensations dans mon voyage réel.
Je n’ai pu tourner le dos à la Méditerranée sans regret ; mais j’ai revu avec bien du bonheur les villes que j’avais traversées en 1875 : Arles et Nîmes avec leurs superbes ruines ; Carcassonne avec ses merveilleuses murailles et ses tours féodales ; Toulouse, et surtout Lourdes, la ville aimée de la Vierge Immaculée.
Les pèlerins accourent toujours par milliers à la grotte miraculeuse, et le 8 décembre, une foule immense, venue de Tarbes, de Lûchon, de Pau et des environs encombrait la ville. C’est avec une peine infinie que nous avons pu pénétrer dans l’église, bâtie sur les roches Massa-bielle. Trois messes solennelles y furent célébrées, à la suite l’une de l’autre, pour satisfaire la piété des fidèles, mais à chaque fois l’église s’est trouvée trop étroite.
J’y ai entendu un sermon magnifique de l’archevêque de Tarbes. À un moment donné, l’orateur sacré, répondant aux incrédules, s’est écrié : « On a osé dire que l’apparition de la sainte Vierge à la grotte de Massabielle est un rêve ! Un rêve, qui fait jaillir du rocher des fontaines inépuisables, qui élève jusque dans les nues d’admirables basiliques, et qui attire des extrémités du monde des millions de croyants. Un rêve, soit ; mais c’est un rêve de Dieu poursuivant l’accomplissement de ses desseins sur le monde, et l’effusion de ses miséricordes sur la France ! »
Les processions des pèlerins allant de la ville à l’église et de l’église à la grotte, bannières déployées, et chantant des hymnes et des cantiques, ont présenté le spectacle le plus grandiose et le plus émouvant.
Vers le soir, nous nous sommes rendus à Pau, où nous avons passé une journée très intéressante.
La capitale du département des Basses-Pyrénées est délicieusement située au bord du Grave. Toujours ensoleillée sur sa colline pittoresque, elle contemple les grandes ombres et les neiges des Pyrénées.
Elle est fière d’avoir vu naître Henri IV qui l’affectionnait beaucoup et qui y vécut longtemps. Son Château est très curieux et plein de souvenirs. Son parc est charmant et forme la plus agréable promenade. Ses hôtels sont très fréquentés par les phtisiques et les sportmen ; et l’on y entend tellement parler l’anglais qu’on se croirait dans une ville des Îles Britanniques.
Irun. – Les douaniers espagnols. – Fontarabie. – Saint-Sébastien. – Dans les montagnes. – Burgos. – Les Serenos. – La Fonda del Norte et les servantes castillanes. – La cathédrale.
Après vous avoir raconté dans ma dernière lettre mon entrée imaginaire en Espagne, il me semble convenable, dans un journal sérieux comme la Minerve, de vous faire maintenant un récit vrai, plus vrai qu’une réclame, ou un programme politique.
Je ne vous décrirai pas Biaritz, qui, à cette saison de l’année, (décembre) grelotte au bord de la mer, aussi glacée par l’isolement que par les souffles du Nord qui troublent si profondément la baie de Biscaye.
Je passe également sous silence Saint-Jean-de-Luz, et les paysages pittoresques qui s’étendent sous nos yeux depuis cette petite ville jusqu’à Irun.
Irun est la première station espagnole, et nous avons franchi la frontière sans tambour ni trompette, sans brûler une cartouche, sans montrer nos passeports, sans la moindre émotion. Ô pays du Cid ! ce n’est pas ainsi qu’on entrait jadis dans tes redoutables Pyrénées.
Les anciens chevaliers de Don Rodrigo del Vivar sont aujourd’hui remplacés par des officiers de douane, et je proclame qu’ils font leur devoir avec toute la rigueur de sentinelles vigilantes. Ils y mettent même une solennité et une lenteur fort ennuyeuses pour les voyageurs. C’est avec des poses pleines de dignité consciencieuse, qu’ils plongent les mains dans tous les coins de toutes les malles.
Un voyageur, qui avait une boîte à chapeau d’une profondeur insondable, et remplie de mille choses qui ne servent pas à couvrir la tête, dût la vider entièrement ; et le douanier fouilla dans le chapeau jusqu’au fond sans pouvoir rien trouver… pas même le fond.
Il y a une chanson basque qui fait une jolie critique des douaniers espagnols :
Irun est pittoresquement situé aux bords de la Bidassoa, rivière très petite mais bruyante qui ouvre ses deux bras pour embrasser l’île des Faisans. C’est dans cette île que le grand peintre espagnol, Vélasquez, éleva, en 1660, un pavillon où Louis XIV vint recevoir des mains de Philippe IV sa royale fiancée, Marie Thérèse.
Nous passons Fontarabie, bâtie sur une colline et qui a tout à fait l’aspect d’une ville espagnole : des rues étroites, des maisons jaunies, des toits en tuiles brunes, des fenêtres grillées et des balcons en fer. Ruine imposante, son vieux château est perché sur une montagne escarpée, et semble pleurer dans la solitude et la désolation les souvenirs de François I, de Jeanne la Folle, et de Charles-Quint. Les bastions écroulés servent aujourd’hui de refuge à quelques familles de Gitanos.
Sans égard pour la mémoire de Gambetta, dont le séjour a augmenté la célébrité de Saint-Sébastien, nous traversons cette ville sans nous y arrêter. Elle occupe une position des plus agréables, entourée d’un amphithéâtre de montagnes, avec une échappée de vue sur la mer.
Nous faisons nos adieux à l’Océan, car nous ne le verrons plus qu’à Cadiz, et nous entrons dans les Pyrénées dont les cimes neigeuses découpent l’horizon.
Le chemin de fer suit les sinuosités de la rivière Urumea, profondément encaissée dans les montagnes, et de distance en distance il s’engage résolument dans d’immenses tunnels. La nuit vient, et la couche de neige qui recouvre le sol s’épaissit. Le train se ralentit, et je commence à craindre qu’il ne s’arrête tout à fait au milieu de ces gorges profondes et inhabitées. Le froid augmente, et nous grelottons sous nos fourrures.
Heureusement les tunnels se multiplient et s’allongent ; et la marche du train s’y accélère, tandis qu’au dehors les roues de la locomotive glissent sur la neige.
À une petite gare, dont les pâles réverbères tremblotent au vent, la porte de notre compartiment s’ouvre, et un caballero gigantesque, drapé dans une large cappa doublée de rouge, s’installe à côté de nous après nous avoir dit en soulevant son sombrero : buenas noches (bonsoir.) Nous le saluons à peine pour lui témoigner qu’il n’est pas le bienvenu ; et tout tranquillement il allume un cigare. C’était le moment pour moi de sortir mon espagnol, que j’étudiais depuis le matin.
– No se fuma, senor, lui dis-je, avec un embarras parfaitement caché.
– Si, si, répondit-il en me montrant la porte de la voiture, et il se pencha en dehors pour me montrer la pancarte qui devait lui donner raison. Mais la pancarte lui donnait tort, et il éteignit immédiatement son cigare en nous faisant très poliment ses excuses.
Ce premier succès en espagnol me mit de bonne humeur, et j’essayai de causer avec le nouveau venu, qui se montra charmant et qui m’apprit plus d’espagnol en deux heures que je n’en ai appris depuis en huit jours.
Je lui exprimai mes craintes au sujet de la neige, et il m’apprit qu’elle, avait en effet arrêté un train deux jours auparavant, mais que la voie n’était plus embarrassée, et que nous serions seulement retardés de quelques heures. Quand nous nous séparâmes à Burgos, nous étions devenus des amis.
La nuit était avancée. Il faisait un froid sec, comme nous en avons en décembre en Canada, et dans le ciel devenu serein la lune escaladait les plus hautes cimes de la Sierra Demanda. Un omnibus traîné par deux mulets, et dont les ais mal joints craquaient affreusement, nous conduisit à la Fonda del Norte, où nous trouvâmes d’excellents lits dans des chambres glacées.
Quelle bonne nuit j’y aurais passée sans les cris des Serenos ! Mais qu’est-ce que les Serenos, me direz-vous ? – Ce sont des gardes nocturnes qui, à chaque heure de la nuit, passent à notre porte en chantant sur un ton bizarre et avec des voix qui percent les murs : « Dieu soit loué ! Deux heures de la nuit sont sonnées. Le ciel est pur, et les étoiles scintillent ! » Je vous épargne les variantes obligées d’heures et de température, ainsi que la traduction en espagnol. Ce chant peu agréable quand on s’endort, a cependant du caractère et m’a plu.
Au saut de mon lit, je courus à la fenêtre, et j’eus sous les yeux le vrai type de la ville castillane.
Au milieu d’une place étroite et sans décors jaillissait une fontaine, où des femmes puisaient de l’eau avec de grandes cruches de grès qu’elles portaient sur leurs têtes. Des mulets attelés en tandem, parfois au nombre de six et même de neuf, circulaient dans des rues tortueuses, traînant des charrettes étranges encombrées d’objets de toutes sortes. Sous leurs toits en tuiles de brique rouge s’alignaient de vieilles maisons uniformes, bâties en pierres rondes noyées dans un crépit jaunâtre.
Comme décor sur ce fond un peu monotone, des boutiques basses, peintes en couleurs vives, avec des vitrines mal installées, des saillies, des corniches, des balcons, des grilles, des portes enfoncées où de petits ânes, flanqués d’énormes paniers, vous regardent avec curiosité.
Tout cela pique l’intérêt, mais n’exciterait pas d’enthousiasme si l’on n’apercevait au-dessus de cette mer de tuiles rouges qui recouvre Burgos, le dôme et les clochers de la cathédrale, pareils à d’innombrables mâts de navires.
Je me hâte de faire ma toilette pour aller contempler de près cette merveille, et je descends à la salle, à manger.
On serait tenté de croire qu’il n’y a pas d’homme dans cet hôtel, car on n’y voit que des femmes ; mais si, il y a un propriétaire, gros, trapu, vulgaire, avec une barbe négligée qui grisonne. Il doit mal parler l’espagnol puisque… je ne le comprends pas. Heureusement qu’on ne le voit jamais, et qu’après s’être montré un instant comme une réalité peu attrayante il a disparu comme un fantôme.
Ce sont des jeunes filles qui nous servent ; pas jolies, mais souriantes, égayées, et avec les yeux flamboyants des Castillanes. Mon langage les amuse, mais je réussis à me faire comprendre et je jouis de leur bonne humeur.
Elles sont pour nous pleines d’égards, de prévenance et d’intelligence. Quand on ne trouve pas le mot espagnol, il n’y a qu’à faire un signe, et elles comprennent. Elles ont même poussé la complaisance jusqu’à trouver avec nous que la note était trop élevée, et que leur maître nous écorchait. N’est-ce pas charmant et… habile ?
Après déjeuner, nous courons à la Cathédrale. Hélas ! elle est entourée de laides constructions qui rendent toute vue d’ensemble impossible, et sous prétexte de restaurer la façade on l’a gâtée jusqu’au-dessus des portes. Mais, plus haut, subsiste le vieux portail d’où s’élancent les deux clochers ; et l’art gothique y a déployé ses ogives, creusé ses niches, dentelé ses flèches, sculpté ses statues, brodé ses décors, multiplié ses ornements.
C’est un poème dont le premier chant est en prose, le second en vers, et dont les derniers chants atteignent à la poésie la plus sublime.
Les portails latéraux sont moins restaurés, et ont conservé le style fleuri des artistes du XIIIème siècle. Mais ce qui est plus admirable encore, c’est la tour octogone du dôme, lançant dans le ciel une gerbe de pyramides et de flèches, au milieu desquelles semble vivre et se mouvoir tout un peuple de statues.
Je le répète, ce temple merveilleux ne déploie à l’œil ravi du visiteur que son couronnement ; mais ce couronnement est un prodige de grandeur et de beauté.
Imaginez une colline, ayant trois sommets en forme de cônes et hérissés de sapins verts ; supposez que ces cônes et leur végétation soient de pierre sculptée, ouvragée, ciselée, et que tous les vides de ce feuillage étrange soient remplis de statues d’anges, de saints, de martyrs, de chevaliers, de guerriers, de moines, de figures mythologiques, de monstres, d’animaux, et vous aurez peut-être une idée imparfaite de l’aspect extérieur de cette cathédrale :
Cependant, il nous semble que l’intérieur est encore plus beau.
Longtemps, nous nous sommes arrêtés sous la coupole, et nos regards éblouis ne voulaient plus s’abaisser. On vante les grottes, aux voûtés desquelles la nature a sculpté des milliers de stalactites ; mais ici l’art a fait mieux que la nature, et jamais il ne s’est montré plus prodigue d’ornements.
Que vous dirais-je maintenant des chapelles particulières ? Comment vous décrire celle du duc d’Abrantès, qui est une broderie de marbre et d’or dans un fouillis de dentelles de pierre ? Quels coups de pinceau pourraient vous représenter le chœur avec ses stalles étonnantes, et la capricieuse variété de leurs sculptures ? Quel volume suffirait à vous énumérer les chefs-d’œuvre de peinture, de sculpture, d’architecture, que l’on trouve entassés dans les chapelles, dans les sacristies, dans les nefs, dans les boiseries, dans les colonnes, dans les autels, dans les tombeaux, dans les portes, dans les grilles, dans les arceaux, dans les fenêtres, et jusque dans les moindres détails de cette immense et splendide cathédrale ?
Non, je renonce à ce travail impossible. C’est quand on a vu ces merveilles que l’on sent combien les hommes d’aujourd’hui sont petits. La foi et le génie qui élevaient ces monuments ne sont plus, et ne feront jamais ces merveilles que les XIIIe, XIVe et XVe siècles nous ont léguées.
Quand je sortis de la cathédrale de Burgos, il me semblait que j’avais traversé tout un monde évanoui. Une mélancolie profonde m’oppressait, et, comme Théophile Gautier lui-même l’éprouva, tout viveur qu’il fut, je n’aspirais plus qu’à me retirer dans un coin, à me mettre une pierre sous la tête, pour attendre dans l’immobilité de la contemplation, la mort, cette immobilité absolue.
Pour secouer cette impression de tristesse, je fis une course à travers la campagne jusqu’à la chartreuse de Miraflores, pleine de souvenirs historiques et de monuments. J’admirai sa chapelle, enrichie de l’or que les premiers découvreurs espagnols apportèrent d’Amérique, je m’extasiai devant les admirables tombeaux de Juan II et de sa femme Isabelle ; mais je ne me sentis pas consolé.
Le sentiment de ma petitesse et de mon impuissance en face de toutes ces grandes choses m’écrasait.
Je revins à la ville. J’allai voir l’endroit où naquit le Cid, et les os que l’on montre à l’Hôtel-de-ville, et que l’on affirme être ceux du fameux chevalier et de Dona Chimène, sa femme. Je fis de mon mieux pour croire à l’authenticité de ces restes ; et, pour chasser les doutes qui m’assaillaient, je courus au bord de l’Arlanzon où s’étend la promenade de Burgos, dans l’espoir d’y rencontrer beaucoup de Castillans et de Castillanes.
Mais les promeneurs étaient rares, et l’Arlanzon qui baigne Burgos, disent les géographes, était à sec.
Je revins à mon hôtel sans avoir recouvré ma gaieté, et le soir même je partais pour Madrid.
Une nuit en chemin de fer. – L’Escurial. – L’église. – Le Campo Santo des rois d’Espagne. – Le cloître. – Le palais. – Une course dans la montagne.
Le meilleur moyen de voir lever l’aurore et le soleil, c’est de passer la nuit debout. Je vous donne gratis cette recette dont je viens de faire usage. Mais je vous préviens qu’une nuit dans un train espagnol n’est pas gaie – sauf l’heure du réveillon. Car il va sans dire qu’on ne passe pas une nuit sans dormir ni manger. Qui dort dîne… en songe ; mais qui ne dort pas doit dîner en réalité.
C’est une heure charmante que celle où l’on tire de son panier du pain, du beurre, du jambon, du poulet, et une bouteille de Valdepenas ou de Malaga. Le prix exorbitant qu’on nous les fait payer gâte un peu toutes ces bonnes choses ; mais quand on a faim et soif… n’est-ce pas ? Ah ! je comprends pourquoi il n’y a plus de brigands en Espagne : c’est qu’ils se sont faits hôteliers, cochers, portefaix, gardiens de musées, ou qu’ils exercent d’autres industries également lucratives.
Enfin nous avons réveillonné de bon appétit et de bonne humeur. Cela réchauffe, ragaillardit, et fait prendre patience. Or, je ne tous dirai jamais assez quelle patience il faut pour voyager en Espagne, la nuit, dans un train omnibus. Certes, j’aime un ciel clair, tout scintillant d’étoiles, avec la lune toute grande qui poursuit sa course en attachant sur vous son regard serein ; mais tout lasse en ce monde, et je fus heureux de voir enfin l’orient changer sa couleur terne, et passer du gris sombre au rouge, du rouge au rose, et du rose à l’opale.
Le soleil ne paraissait pas encore, quand nous aperçûmes sur notre gauche, suspendu aux rochers d’une montagne désolée, le palais colossal des rois d’Espagne.
Les proportions de l’Escurial sont étonnantes, même vues de loin ; mais quand vous en approchez, vous avez peine à retenir un cri de surprise, je n’ose pas dire d’admiration. C’est un géant qui vous écrase, mais qui ne vous plaît pas, et que vous êtes tenté de trouver monstrueux. L’architecte a réussi à faire grand, mais non à faire beau.
Cet immense édifice est dû à Philippe II, qui le fit construire en accomplissement d’un vœu fait à saint Laurent, et l’architecte lui a donné la forme d’un gril pour rappeler le martyre du saint. Il contient un couvent, un palais, une église, des cours, des jardins, des galeries, des portiques, et l’on pourrait construire une ville avec le granit qu’on y a amoncelé.
Vous savez quand vous y entrez, mais non quand vous en sortirez. À peine le seuil franchi, vous avez la frayeur de n’en jamais sortir. C’est un labyrinthe de cours, de passages, de vestibules, de portiques, d’escaliers, de promenoirs, dont les murs sont nus, massifs, sombres, et si hauts qu’ils vous cachent le ciel. Tous voulez retourner sur vos pas, mais vous ne savez déjà plus par où vous êtes entré.
Enfin, vous levez une portière, vous entendez un chant lugubre et lointain, vous avancez : des piliers énormes comme des tours se dessinent dans l’ombre ; vous marchez toujours, guidé par les voix et l’orgue, dont l’harmonie devient plus distincte ; vous levez les yeux, et vous poussez un soupir de soulagement ; car devant vous se dresse l’autel illuminé, et sur votre tête s’arrondit, à une hauteur immense, une coupole décorée de fresques magnifiques.
Nous sommes dans l’église, et, comme c’est l’anniversaire de la mort de la reine Marie Christine, on y célèbre un service solennel pour le repos de son âme. Cinq ou six femmes, agenouillées dans la chapelle qui porte le nom de la défunte, composent toute l’assistance, et les prêtres qui officient sont perdus dans l’immensité et la solitude du sanctuaire. Un chœur assez nombreux, dont l’écho multiplie les voix dans une proportion formidable, est logé quelque part dans le jubé de l’orgue, mais il reste invisible.
En arrière d’un pilier de colonnes fuselées, capable de porter un monde, s’ouvre un grand escalier de marbre noir, veiné de blanc, conduisant au campo santo des rois. Nous y descendons jusqu’à une profondeur immense, sous les assises du sanctuaire, précédés d’un sacristain qui porte une mèche allumée, et nous arrivons à une rotonde funèbre, autour de laquelle sont étagés les tombeaux, comme les rayons d’une bibliothèque. D’un côté sont les rois, et les reines qui ont régné seules, et de l’autre les princes et les reines qui n’ont pas régné. C’est riche, mais simple et lugubre ; tous les cercueils sont en bronze, et parfaitement uniformes.
Cette uniformité de sépulture a sans doute pour objet de rappeler l’égalité dans la mort ; mais la doctrine de l’égalité, prise dans un sens absolu, est fausse, même au-delà du tombeau. Les bons rois ne sauraient occuper dans l’autre vie la même place que les mauvais ; et, qui osera soutenir que Charles-Quint n’est pas plus vivant, dans la mémoire des hommes, que ses successeurs qui dorment à ses côtés ?
Car c’est là qu’il repose, le souverain illustre qui a exercé sur les destinées du monde une si puissante influence, et il faudrait être bien insensible pour contempler sans émotion le cercueil qui renferme ses restes glorieux. Le sacristain nous affirme que son corps est parfaitement conservé, que ses ongles et ses cheveux ont continué de croître, pendant quelque temps, dans la tombe.
Là dorment aussi de leur dernier sommeil l’impératrice Isabelle, épouse de Charles-Quint, Philippe II leur fils, et Anne sa femme, Philippe III et Marguerite, Philippe IV et Elizabeth de Bourbon, Charles II, Charles III, Charles IV et Ferdinand VII.
En sortant du Panthéon, nous entrons dans la sacristie, qui est très belle, bien éclairée, ornée de tableaux et de bas-reliefs, et qui contient les plus précieux reliquaires. Nous retraversons l’église, autour de laquelle nous comptons quarante-huit autels, tous plus ou moins riches en tableaux, marbres et reliques, et nous visitons le cloître.
Je ne vous décrirai pas ses immenses galeries voûtées, à deux étages reliés entre eux par un escalier monumental. Je ne vous conduirai, ni dans le chœur, dont les stalles nombreuses sont maintenant abandonnées, ni dans les bibliothèques pleines de manuscrits des plus curieux, ni dans le collège et le séminaire maintenant vides, ni dans les innombrables salles du palais qui, contiennent pourtant de fort belles tapisseries, un riche mobilier, et des chefs-d’œuvre d’ébénisterie et d’incrustation.
Non, toutes ces visites m’entraîneraient trop loin, et j’ai hâte d’en finir avec l’Escurial. Veuillez pourtant descendre avec moi de la salle des batailles, dans cette chambre oblongue, aux murs nus et blanchis à la chaux, éclairée par une seule fenêtre, et aux extrémités de laquelle s’ouvrent deux alcôves sombres. C’est ici que le roi Philippe II vint passer les dernières années de sa vie, et mourir. C’est d’ici que, sombre, soucieux, il prévoyait les éclipses de la gloire espagnole, et qu’il commandait encore à l’Europe. De ce palais immense, il ne s’était réservé que ce coin sépulcral, pour s’habituer au repos de la tombe, et, du fond de cette alcôve, une baie pratiquée dans le mur lui permettait d’entendre le chant des moines, et de voir le prêtre officiant.
Allons, ne nous attardons pas dans ce tombeau ; car nous pourrions y mourir. Je suis las, je suis triste ; il me semble que dans ces sombres corridors j’entends marcher des spectres. Verrai-je encore le soleil ? Respirerai-je encore le grand air ? Courons de ce côté, et franchissons ce portique ; enfilons ce corridor, et traversons cette cour. Que de portes, grand Dieu ! que d’appartements ! que de galeries ! que de murailles ! que d’escaliers ! N’arriverons-nous jamais ?
Tiens, voici des arcades et des murs peints à fresques ; c’est donc encore le cloître ? Où va nous conduire ce couloir ? Ah ! voilà de longs vestibules et des meubles dorés ; serait-ce encore le palais ?
Là-bas brille une lumière ; plus loin verdissent des myrtes entourant une fontaine. Réjouissons-nous, nous sommes sortis !
Nous revenons à notre hôtel avec une faim inexprimable, et l’hôtelier nous improvise un déjeuner indescriptible, qui nous transforme en tambours de basque. Nous avons trois heures devant nous, avant celle du départ ; que pourrions-nous faire de mieux qu’une course à pied dans la montagne ? L’ascension est un peu pénible, mais fatiguer le corps reposera l’esprit.
Il fait un temps ravissant, et les rayons du soleil baignent les flancs de ces rochers cyclopéens.
Nous gravissons un premier sommet, d’où la vue s’étend bien loin, sur un pays accidenté mais désert. Ce matin, les vallons étaient noyés dans la brume, et ressemblaient à autant de lacs ; mais maintenant les croupes sombres des rochers, se succédant à perte de vue, nous offrent l’image des convulsions de la mer.
Un torrent dégringole de la montagne, et sur ses bords sont échelonnées des blanchisseuses, étrangement vêtues, et nous regardant avec curiosité, des chuchotements et des rires.
Nous franchissons un second sommet, et nous rencontrons un second torrent, avec une seconde échelle de blanchisseuses. C’était le tableau le plus animé et le plus pittoresque que l’on puisse voir. Les unes chantaient des romances bizarres, que les autres semblaient accompagner avec leurs battoirs. Toutes semblaient gaies, riantes, et l’eau glacée colorait leur teint brun, et rougissait leurs bras nus.
Sous nos pieds s’étendaient le parc royal, les jardins, et les toits réguliers et spacieux de l’Escurial. Au loin se succédaient les pics, les ravins, les rochers, et de grandes routes blanches serpentant au milieu de ce désert.
Derrière nous se dressaient des escarpements et des cimes, dont les têtes allaient se perdre dans les nuages, ou se fondre dans le ciel. Nous redescendîmes, charmés, en écoutant les chants des laveuses et les mugissements des torrents.
Le soir, nous étions à Madrid.
La capitale de l’Espagne. – La Puerta del Sol et ses flâneurs. – Les fumeurs en Espagne. – Le Musée du Roi. – Le Buen Retiro. – L’Armeria. – Le réveil de l’Espagne.
La capitale de l’Espagne est la moins espagnole de toutes ses villes, et ce qu’on appelle le progrès moderne l’assimile de plus en plus aux autres villes européennes.
Sa population dépasse 600 000 habitants, ses rues s’élargissent pour y installer des tramways, ses maisons se multiplient, sa cuisine se perfectionne ; elle a son Hôtel de Paris et son Grand Café de Paris. Mais on chercherait en vain dans toute son étendue un seul édifice vraiment monumental.
Je ne vous décrirai donc pas ses églises : aucune n’est remarquable. Je ne puis pas vanter son palais : il n’est qu’un vaste bloc carré sans style.
Ses boutiques sont assez pauvres, ses hôtels ne sont guère bons, son climat est détestable, en décembre.
La Puerta del Sol, où se trouve mon hôtel, et qui est le vrai centre de Madrid, est une place irrégulière, entourée d’édifices sans architecture, de cafés sans luxe, et de vitrines de province. Elle mérite cependant son nom, parce qu’elle est bien la porte par laquelle le soleil entre dans Madrid.
Ce qui est vraiment, étonnant sur cette place, et dans la rue d’Alcala qui l’unit au Prado, c’est le mouvement. Un pareil rassemblement défie toute description. Ni Broadway, de New-York, ni Cheapside, de Londres, ni les boulevards de Paris ne présentent ce spectacle ; et cela dure tout le jour, et presque toute la nuit.
Ce qui distingue tout particulièrement cette multitude de la foule américaine, c’est qu’elle n’est jamais pressée. Tout le monde paraît flâner, et se chauffer au soleil. Le millionnaire et le mendiant, le politicien et l’artiste, l’homme d’affaires et le rentier, semblent n’avoir d’autre occupation que le far niente. Tous marchent à pas lents, majestueusement drapés dans leurs manteaux ; et le pauvre n’y met pas moins de forme et d’élégance que le riche. C’est ici que Victor Hugo pourrait parler de torchons radieux : il y en a.
Après cela, vous ne serez pas surpris d’apprendre que l’Espagnol est un fumeur infatigable. Il fume toujours, et partout. À l’opéra, et dans les hôtels, il n’y a pas de salon pour les dames, mais il y a un fumoir. Le soleil d’Espagne, si radieux, ne perce pas sans peine les nuages de fumée de tabac qui s’élèvent de Madrid. J’attribue au besoin de fumer des conducteurs la lenteur des chemins de fer espagnols. Il faut bien que le chef du train et le chef de gare allument de temps en temps la pipe, ou fument leurs cigares.
J’ai passé huit jours à Madrid, dont quatre au Musée du roi. C’est qu’en réalité Madrid ne possède guère autre chose que son admirable galerie de peinture, la plus belle du monde peut-être. Comment vous exprimer dans une simple lettre écrite à la hâte, sur un coin de table d’une chambre d’hôtel, toute mon admiration pour les nombreux chefs-d’œuvre entassés dans cet immense musée ? Comment vous dire ce que l’on éprouve, quand on a devant soi les œuvres immortelles de génies tels que Murillo et Raphaël, Vélasquez et Rubens, Ribera et Titien ? Car ici toutes les écoles sont représentées, les écoles de Rome, de Venise et des Flandres, comme celles de l’Espagne. Non, je ne puis pas même effleurer les contours d’une pareille étude.
Après le musée, deux choses m’ont plu à Madrid, ce sont les promenades publiques et l’Armeria.
Le Prado, le Buen Retiro, et les jardins du Palais renferment des parterres, des massifs de verdure, des charmilles et des pièces d’eau très bien entretenues. Le grand étang du Buen Retiro offre tous les charmes d’une navigation paisible, à la rame, à la voile et même à la vapeur ; car deux bateaux-mouches à hélices le sillonnent.
Mais ce qui m’a charmé je puis dire ému, c’est le musée des armes. Il est beaucoup moins grand que celui de la Tour de Londres, mais bien plus intéressant. On ne saurait regarder d’un œil froid les armures de Charles-Quint et de Gonzalve de Cordoue. Il y a là des épées qui jettent des éclairs, et qui réveillent dans l’âme tous les plus nobles sentiments.
Voyez cette lame pesante et large, enrichie de pierreries ; c’est celle du Cid ! Regardez cette autre qui se repose maintenant sur un coussin de velours : elle faisait jadis un dur travail dans les mains de Roland !
Et ces deux fines épées qui se ressemblent comme deux sœurs jumelles, et qui se racontent peut-être leurs exploits et leurs voyages lointains ; il fut un temps où ceux qui les portaient se nommaient Fernand Cortez et Pizarre ! Voici la rapière de Don Juan d’Autriche, et celle de Dom Jaime ! Sur ce lit de camp a souvent dormi Charles-Quint ! Et ce drapeau déchiré, dont les lambeaux pendent dans cette vitrine, vénérez-le comme une sainte relique ; car il fut vainqueur à la bataille de Lépante.
Ô noble Espagne ! Quand on a ton glorieux passé, il est bien permis de se reposer sur ses lauriers ; mais il ne faut pas s’y endormir.
Pour qu’une nation soit vraiment puissante et glorieuse, il ne suffit pas qu’elle vive selon les vrais principes sociaux et religieux ; il faut qu’elle ne perde pas de vue les principes économiques et les intérêts matériels.
Sans doute les premiers sont plus importants, plus essentiels à la vie nationale ; mais les seconds ne doivent pas non plus être négligés.
C’est pour avoir mis en oubli cette doctrine, que l’Espagne a vu décroître sa grandeur et sa puissance, de Charles-Quint à Charles II, l’Augustule de sa race, dit Donoso Cortès.
Mais cette belle nation s’est réveillée depuis, et ses nobles enfants travaillent à l’agrandissement de sa prospérité, de sa puissance et de sa gloire.
Sans doute elle n’a plus les preux chevaliers, les illustres marins, et les grands conquérants d’autrefois. Mais les temps sont changés, et il ne reste plus de Maures à expulser, ni de continents à découvrir.
Il lui suffit maintenant de produire des hommes d’État, des théologiens, d’illustres évêques, des écrivains, des orateurs, des poètes ; et il y en a parmi les contemporains dont elle a droit d’être fière.
La Puerta del Sol. – Le café de Paris. – Fernan Caballero. – Ses nouvelles. – Quelques pages de Paz et Luz.
Décidément, la Puerta del sol me plaît beaucoup, et vaut tout Madrid – sauf le Musée. C’est le centre de la vie espagnole, et l’on y sent battre le cœur de l’Espagne. J’y passe des heures à coudoyer la foule, et le spectacle est très varié.
Les amis, et même les amoureux s’y donnent rendez-vous ; les commerçants y font des affaires ; les hommes d’État y discutent les questions politiques ; les charlatans y déclament leurs boniments ; les malades et les infirmes viennent s’y chauffer au soleil ; les journalistes y font collection de faits-divers ; les dramaturges et les romanciers y cherchent des héros et des héroïnes.
Malgré la tendance malheureuse à l’uniformité de costume, on y voit encore des toilettes pittoresques et originales, depuis la señora, en mantille, jusqu’au paysan aux couleurs bariolées, portant le justaucorps en velours et le châle drapé avec élégance.
Le soir, je vais passer une heure au Café de Paris, et j’y retrouve à peu près les mêmes types. Ils sont groupés autour de petites tables, dans une salle immense, buvant du chocolat, du café, ou des liqueurs ; mangeant des bollos