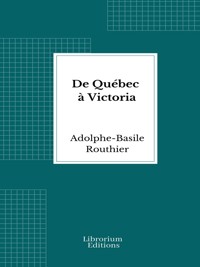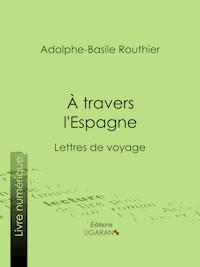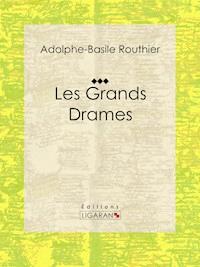
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait "En février 1884, je voyageais en Sicile, jouissant avec délices de la douceur de son climat, et admirant avec enthousiasme les impérissables monuments dont la Grèce antique a doté ce charmant pays. Car c'est là qu'il faut aller, pour retrouver encore debout les plus beaux et les plus grands temples que l'art grec ait élevés en l'honneur des dieux."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335067163
©Ligaran 2015
Les essais qui composent ce volume sont loin d’être des études complètes. Ils ne suffisent pas à faire bien connaître les grands poètes qui en sont l’objet, ni leurs œuvres dramatiques. Nous croyons cependant qu’on ne les lira pas sans intérêt et profit.
Le but que nous nous sommes proposé a été d’apprécier, moins au point de vue littéraire qu’au point de vue moral, philosophique et religieux, les drames qui touchent de plus près à l’âme humaine et à ses rapports avec Dieu. Il en est de plus parfaits comme œuvres littéraires, dans l’immense répertoire du théâtre ; mais nous n’en connaissons guère qui aient représenté l’homme à un point de vue plus élevé, avec ses hautes aspirations, ses grandeurs et ses immortelles destinées.
PROMÉTHÉE
En février 1884, je voyageais en Sicile, jouissant avec délices de la douceur de son climat, et admirant avec enthousiasme les impérissables monuments dont la Grèce antique a doté ce charmant pays. Car c’est là qu’il faut aller, pour retrouver encore debout les plus beaux et les plus grands temples que l’art grec ait élevés en l’honneur des dieux.
Mais au milieu des ruines splendides de Girgenti et de Syracuse, je ne me souvins pas seulement des grands architectes et des incomparables sculpteurs d’Athènes ; je vis surtout repasser dans mes souvenirs ses grands écrivains et ses poètes ; puis, au-dessus de ces derniers et dominant leur groupe illustre, je vis se détacher la sublime figure d’Eschyle ; car le sol que je foulais aux pieds avait été sa seconde patrie et son tombeau.
Je ne sais si tous les voyageurs me ressemblent ; mais, lorsque je visite un pays étranger, mon esprit évoque spontanément les hommes célèbres qui l’ont illustré.
Il arrive même quelquefois que l’un d’eux absorbe entièrement mes pensées. Son souvenir devient pour moi une obsession, et il me semble que j’entre en communication avec lui.
C’est ce qui m’est arrivé en Sicile à l’égard du plus grand poète tragique de la Grèce.
Sans doute, les vastes ruines de Syracuse me rappelèrent Pindare y déclamant ses odes fameuses, Platon y venant séjourner plusieurs fois et y poursuivant ses grands travaux philosophiques, Archimède y faisant l’étonnement des contemporains par ses savantes découvertes ; mais ce fut Eschyle surtout que ma mémoire y fit revivre. Sa grande ombre y ranima pour moi, et les temples écroulés, et le vaste théâtre dont les gradins subsistent et sont adossés aux somptueux tombeaux des Grecs illustres morts à Syracuse.
C’est que je considère Eschyle comme un génie prodigieux, comme le plus grand poète tragique qui ait jamais existé peut-être, et, en même temps, comme une espèce de précurseur païen du Christ, prédisant sa venue cinq siècles d’avance avec plus de force, de clarté, de précision que toutes les sibylles antiques, même les plus rapprochées de l’ère chrétienne, et dans des termes qu’on dirait parfois empruntés aux prophètes.
Eschyle fut en outre un homme de guerre et un héros. Il appartient à la génération des géants qui sauvèrent la Grèce des formidables invasions des Mèdes et des Perses, et qui couvrirent leur patrie d’une gloire dont le rayonnement est parvenu jusqu’à nous.
Il apparaît comme un lion dans les fameuses batailles de Marathon, de Platée et de Salamine, et ses frères furent des compagnons d’armes non moins glorieux. L’un d’eux, nommé Cynégire, abordant une galère persane s’y accrocha d’une main : on la lui coupa d’un coup de hache. Il s’y cramponna de l’autre : on la coupa également. Alors il saisit le bord avec ses dents, et il fallut lui trancher la tête pour lui faire lâcher prise.
Mais ce n’est pas le guerrier dont j’évoquais le souvenir en parcourant les endroits qu’il a habités en Sicile ; c’est le poète tragique dont les œuvres, toutes païennes qu’elles sont, renferment une si haute philosophie religieuse et morale.
Au pied du mont Etna s’élevait autrefois une ville qu’on nommait Géla. Elle est aujourd’hui détruite. C’est là que vint mourir le merveilleux poète, exilé d’Athènes, et fatigué sans doute de la vie bruyante de Syracuse. Il est difficile de ne pas voir entre le volcan et lui une mystérieuse sympathie.
Chose étrange, quand il eut à faire lui-même son épitaphe, il y dédaigna son plus beau titre de globe :
« – Sous cette pierre gît Eschyle, fils d’Euphorion. Né dans Athènes, il mourut aux champs plantureux de Géla. Au bois si fameux, au bois de Marathon, au Mède à la flottante chevelure, de dire s’il fut vaillant. Ils l’ont vu ! »
Pas un mot dans cette épitaphe de son œuvre dramatique, si colossale, si sublime, et qui lui avait valu tant de succès. Pourquoi cela ? Sans doute parce que s’il avait cueilli bien des palmes au théâtre, il y avait éprouvé aussi bien des déboires, rencontré bien des ennemis, et suscité des haines qui furent la cause de son exil.
Quand on relit aujourd’hui ce qui nous reste de son Prométhée on comprend quelles tempêtes il a dû soulever dans Athènes, et quelles colères il a dû allumer dans le cœur des prêtres de Jupiter.
Jusqu’alors Jupiter, ou Zeus, pour employer son nom grec, avait été un dieu incontesté, reconnu comme le souverain maître de toutes choses, et prêché par un sacerdoce puissant dans toutes les villes de la Grèce. Or, voilà qu’un homme ose tout à coup répudier ce culte, et représenter en plein théâtre le souverain des dieux comme un tyran qui persécute le droit et la justice ! Voilà qu’un poète a l’audace de prédire un nouvel ordre de choses, et d’annoncer que la couronne et l’honneur de Zeus passeront sur la tête d’un nouveau dieu. – Ce sont les paroles mêmes qu’Eschyle met dans la bouche de Prométhée. – Quelle impiété ! Quels blasphèmes ! Quel scandale !
Le drame audacieux de Prométhée ébranlait les fondements des temples païens, et des pierres qui en tombaient, les lettrés d’Athènes allaient ériger plus tard ce fameux temple au dieu inconnu, que saint Paul remarqua en traversant la grande ville.
Les prêtres païens s’insurgèrent contre cette nouveauté sacrilège. Ils traînèrent le poète devant l’Aréopage, et l’accusé ne fut sauvé de la mort que par ses glorieuses blessures, et par le souvenir de Marathon et de Salamine. Mais il ne put échapper à l’exil ; et la Sicile, alors gouvernée par Hiéron, protecteur des muses, l’accueillit avec tous les honneurs dus à une telle célébrité.
C’est donc mon voyage en Sicile qui m’a ramené à l’étude d’Eschyle, et c’est le fruit de cette étude que je viens offrir au public.
L’histoire constate que le théâtre chrétien a été essentiellement religieux dans son origine, et, pendant longtemps, les pièces de son répertoire ne représentaient exclusivement que des sujets religieux.
C’est une vérité incontestable. Mais, chose remarquable, le théâtre païen, à son origine, avait le même caractère de piété, et ne mettait en scène que les œuvres et les décrets des dieux – avec cette différence que les actions de ces dieux n’étaient pas toujours édifiantes.
Comme l’a dit un grand critique, les drames du théâtre antique de la Grèce étaient avant tout des fêtes religieuses.
Dans ses trilogies étonnantes, Eschyle met constamment les dieux en scène – comme on mettait en scène au Moyen Âge Jésus-Christ, la sainte Vierge et les saints – et jamais il ne lui vint à l’esprit de prendre, pour sujet de ses drames immortels, ce sentiment qui est le sujet unique et exclusif du théâtre contemporain, l’amour de la femme.
Il eût sans doute pensé qu’un tel sujet n’était pas digne de son génie, et quand on étudie ses œuvres, il faut bien reconnaître que le géant du théâtre antique plane à des hauteurs telles qu’il se fût abaissé, en décrivant les misérables jeux de l’amour humain.
Non, il fallait à son œil d’aigle de plus grandioses spectacles, et à l’essor de sa pensée de plus vastes horizons. Aussi son œuvre dramatique est-elle d’une grandeur et d’une sublimité qui étonnent. Elle se composait de quatre-vingt-dix tragédies, dont sept seulement sont arrivées jusqu’à nous. Quelle perte irréparable pour l’art et pour la philosophie métaphysique et morale !
Tous ses héros dépassent la stature humaine. On éprouve, en les étudiant, la même impression qu’en examinant les grands fossiles antédiluviens, dans un musée d’histoire naturelle.
Eschyle a été le véritable créateur du drame, et son œuvre a gardé la rudesse d’une ébauche. Le fini, le poli de la statue manque à ce colosse. Mais la grandeur en est incomparable.
Entre Sophocle et lui, il y a la même différence qu’entre les versants ombragés des Alpes du midi et les âpres sommets du mont Blanc.
« Son style, dit Paul de Saint-Victor, est extraordinaire comme son génie ; il fait le bruit d’un orage, il a le cours d’un torrent… Comme tous les poètes de sa taille, Eschyle est au-dessus du goût et des règles. Ses difformités sont inhérentes à sa hauteur même. Il y a de l’obscurité sur ses pensées, comme il y a des nuées sur les cimes.
« Il a l’emphase de la tempête et le hérissement du lion. Les toises et les aunes de la rhétorique se rapetissent jusqu’au ridicule lorsqu’elles s’appliquent à de tels génies. Qu’ils soient comme ils sont, ou qu’ils ne soient pas ! »
Cette dernière théorie me paraît contenir une hérésie littéraire. Je la cite seulement pour donner une juste idée de l’admiration que les œuvres du grand poète ont fait naître chez les critiques contemporains. Je dis critiques contemporains, car ceux du siècle dernier ou du XVIIe siècle tenaient Eschyle en médiocre estime – en quoi ils avaient tort.
Mais revenons à Prométhée, auquel je veux borner ce travail, et que nous ne pourrons pas même étudier sous tous ses aspects. Car c’est au point de vue dogmatique, plutôt qu’au point de vue littéraire, que nous voulons en rechercher le sens mythologique et les mystérieux enseignements.
Comme la plupart des tragédies d’Eschyle, son Prométhée était une trilogie ; c’est-à-dire, qu’il se composait en réalité de trois drames, dont les titres indiquent suffisamment les sujets : Prométhée porte-feu – Prométhée enchaîné – Prométhée délivré.
Malheureusement le premier et le dernier de ces trois drames sont perdus, et le Prométhée enchaîné est le seul qui nous reste. Nous n’assistons donc qu’au châtiment ; mais le récit du châtiment fait connaître la faute, et laisse entrevoir la délivrance.
Qu’est-ce donc que Prométhée, et quel était son crime ?
Les Grecs font naître Prométhée de Japet, fils d’Ouranos et de Ghéa, c’est-à-dire du Ciel et de la Terre. Vous savez que l’histoire fait descendre les Grecs de Japhet, et pour eux Japhet devait être le premier homme.
Pour nous qui croyons à la Bible, le premier homme est Adam, qui fut formé par Dieu d’un peu de terre, et qui par conséquent est né, comme le Japet des Grecs, du ciel et de la terre.
C’est le premier rapprochement à faire entre Prométhée et Adam. Mais vous allez voir que la ressemblance du héros d’Eschyle va s’accentuer et devenir très frappante, non seulement avec le premier Adam et l’homme en général, mais aussi avec le second Adam, c’est-à-dire avec Jésus-Christ.
Prométhée serait donc à la fois un souvenir du passé, et une figure de l’avenir, un être plus grand que l’homme, un Titan, participant de la nature humaine et de la nature divine. C’est ce qui va ressortir de l’étude de son crime et de son châtiment.
Son crime, vous le connaissez : il avait enlevé le feu du ciel. Mais que signifie ce mot, le feu du ciel ? Est-ce le feu matériel, que les anciens désignaient comme un des quatre éléments ?
Ce n’est pas vraisemblable. L’homme primitif n’avait pas besoin d’aller au ciel pour faire jaillir une étincelle de la pierre, et les arts n’auraient pas célébré avec tant d’enthousiasme un simple inventeur du briquet.
Non, le feu du ciel enlevé par Prométhée devait être un élément immatériel, aussi nécessaire à l’âme, à l’intelligence, que le feu matériel est nécessaire au corps. Ce devait être la lumière intellectuelle, la science, la sagesse.
C’est pourquoi Hésiode raconte que Prométhée est monté au ciel sur le char ailé de Pallas-Athénè, pour aller dérober une étincelle au soleil. Or Pallas-Athénè, c’était Minerve, la déesse de la science.
C’est pourquoi d’autres mythologues l’appellent la sagesse du Pire, ce qui est un des noms de Jésus-Christ, et représentent Prométhée créant les hommes et façonnant leurs corps, auxquels Pallas apporte l’étincelle divine de la vie.
C’est pourquoi, enfin, Eschyle le représente comme un sage sublime, qui est devenu le flambeau de l’humanité, et lui fait dire du haut de son rocher sanglant, qu’il a doué les hommes de science, et leur a donné le secret de tous les arts.
Duris de Samos soutient que le crime de Prométhée fut d’aspirer à épouser Minerve, déesse de la sagesse, ou de la science. Adam a commis la même faute, en touchant à l’arbre de la science du bien et du mal.
Nicandre de Colophon prétend que Prométhée aurait voulu la gloire du serpent. C’est bien encore le crime d’Adam, qui a glorifié le serpent, en cédant à ses inspirations plutôt qu’à celles de Dieu !
Écoutez le prophète Baruch, et dites-moi si l’on ne croirait pas que les Grecs l’ont copié en imaginant la fable de Prométhée :
Qui est monté au ciel, et y a pris la sagesse, et l’a amenée des nuées ?
« Qui a passé la mer et trouvé la sagesse, et l’a rapportée de préférence à l’or le plus pur ? »
Et le même prophète répond :
C’est lui qui est notre Dieu, et nul autre ne sera estimé auprès de lui. C’est lui qui a trouvé toute voie de vraie science, et qui l’a donnée à Jacob son serviteur, et à Israël son bien-aimé.
« Après cela, il a été vu sur la terre, et il a demeuré avec les hommes. »
Le Prométhée des Grecs est donc à la fois un mythe du premier homme, et une figure païenne du Christ. Le feu qu’il a dérobé, et apporté aux hommes, est, dans le passé, la science du bien et du mal, et sera dans l’avenir, la charité, l’amour, la vraie sagesse.
Les philosophes modernes et les libres penseurs ont voulu voir dans Prométhée le premier et le plus grand des révolutionnaires. Ils en ont fait le type de l’humanité luttant contre Dieu, le verbe humain en révolte contre le verbe divin !
Mais les traits principaux du Prométhée d’Eschyle contredisent cette hypothèse ; et nous allons voir, en entrant dans les détails du drame, que des ressemblances multiples et frappantes le rapprochent plutôt de ces deux types qui partagent l’histoire du monde en deux grandes périodes : Adam, pécheur et châtié, mais attendant sa rédemption avec confiance, et Jésus-Christ, chargé des péchés des hommes, souffrant pour leur expiation, et détrônant Jupiter pour jamais.
Comment Eschyle a-t-il pu connaître ces deux types, dont l’un ne devait apparaître aux hommes que cinq cents ans plus tard ? C’est une question que nous examinerons en terminant. Pour le moment, veuillez bien suivre avec attention l’analyse que je vais faire du drame. Et si vous ne perdez pas de vue que les tableaux et les paroles que je vais reproduire sont l’œuvre d’un poète qui vivait cinq siècles avant Jésus-Christ, votre étonnement devra égaler le mien.
Condamné par Zeus, Prométhée est conduit au lieu du supplice par la Force et la Puissance. La Force est muette et insouciante, tandis que la Puissance s’agite, s’exalte, accuse, et réclame instamment le châtiment.
Si vous étudiez ces deux agents de Zeus, en vous représentant Prométhée comme une figure du Christ, vous remarquerez que la Puissance a tous les traits de la Synagogue – et que la Force ressemble à Ponce Pilate, qui cède aux menaces et aux objurgations de la Synagogue, et qui croit laver son crime en lavant ses mains.
Vous serez-frappés des paroles de la Puissance, qui prétend exprimer la pensée de Zeus ou Jupiter, comme la Synagogue prétendait défendre les intérêts de Dieu dans sa lutte contre le Christ. Représentez-vous notre Jésus dans son double rôle de Rédempteur et de Docteur, et vous reconnaîtrez que la Synagogue a pu et dû adresser à Pilate des paroles semblables à celles-ci, que la Puissance adresse à la Force : « Fais ce que le Père t’ordonne d’accomplir ! Enchaîne ce malfaiteur ; châtie-le d’avoir outragé les dieux… (Caïphe disait : Il a blasphémé !) Qu’il apprenne à respecter la tyrannie de Zeus, et à ne plus tant aimer les hommes ! »
C’est bien le crime de Jésus d’avoir trop aimé les hommes, et c’est bien pour cela qu’il a été mis à mort. La loi ancienne était une loi de crainte sous laquelle les hommes gémissaient en servitude : il est venu la remplacer par la loi d’amour !
L’exécuteur des hautes œuvres de la Puissance, qui doit clouer le Titan sur son rocher, est Héphestos. Il balance entre la compassion et la sensibilité. Il plie sous le joug, il obéit, mais en même temps il est tenté de s’apitoyer. Il est cependant convaincu des torts de Prométhée, et il dit à sa victime : « Voilà le fruit de ton amour pour les hommes. Tu as fait de trop grands dons aux mortels. » Puis, il se retourne vers la Puissance, et, tout en exécutant la sentence, il gémit en disant :
« Tu es sans pitié et pleine d’audace… Ta parole est aussi dure que ton visage… Cette tâche, que n’est-il donné à un autre de l’accomplir !… Hélas ! Prométhée, je me lamente sur tes maux… Habileté de mes mains, que je te déteste ! »
Les bourreaux du Christ ont dû éprouver ces sentiments, et c’est pourquoi il a prié pour eux en disant : « Ils ne savent pas ce qu’ils font ! »
Cependant la crucifixion cruelle est terminée. Prométhée est suspendu entre ciel et terre sur une cime farouche du Caucase, et la Puissance le raille :
« Maintenant, brave encore les dieux, vole ce qui est aux Immortels pour le donner à des Éphémères ! Que peuvent-ils ces êtres d’un jour pour alléger tes souffrances ? On t’a mal nommé en t’appelant Prométhée, car c’est un Prométhée qu’il te faudrait pour briser tes chaînes. »
Au sommet du Calvaire, les princes des prêtres trouvaient aussi que Jésus avait été mal nommé, puisque ce nom signifie sauveur, et ils disaient en le raillant : « Il en sauve d’autres, et il ne saurait se sauver lui-même ! »
Nouvelle ressemblance avec Jésus-Christ – Prométhée, qui pourrait jeter à la face de ses ennemis de si foudroyantes répliques, garde un silence absolu. Tant qu’ils sont là, autour de son gibet, leurs sarcasmes, leurs outrages, ajoutés à ses souffrances, ne lui arrachent pas une parole, pas un gémissement.
Mais quand l’infortuné est resté seul, étendu sur sa croix renversée qui domine l’horizon sans bornes, sans autres compagnons que les bêtes fauves, sans autre témoin que la nature immense toute peuplée d’êtres insensibles, il lui semble que les astres sont des yeux qui le regardent, que les flots de la mer qui mugissent au loin, et les vents qui se plaignent en effleurant son rocher, sont une foule qui va le comprendre ; alors une plainte formidable et solennelle s’échappe de sa poitrine, et c’est aux cieux et à la terre qu’il l’adresse :
« Ô divin Éther, vents aux ailes rapides, sources des fleuves, rires innombrables des flots de la mer ! Et toi, Terre, mère de toutes choses ! Et toi aussi, Soleil, qui vois tout ! Je vous atteste ! regardez-moi ! Voyez ce que, dieu moi-même, je souffre par les dieux ! Voyez ces outrages, et combien je devrai gémir durant des années innombrables !… J’ai fait du bien aux hommes et me voici lié à ces tourmente. J’ai pris pour eux, comme à la chasse, l’étincelle, source de la flamme… C’est pour ce crime que je souffre, suspendu en l’air par ces chaînes. »
David (psaume 108) fait dire à Jésus : « J’ai aimé ceux qui me haïssaient, et ils se sont déclarés mes ennemis. »
La nature a entendu ces lamentations lugubres et sublimes.
Un battement d’ailes se fait entendre ; des voix harmonieuses caressent son oreille, et lui murmurent des paroles consolatrices. Ce sont les Océanides, divinités des eaux, qui se tiennent au pied de sa croix, comme les saintes femmes sur le Calvaire. Mais, en même temps qu’elles cherchent à le consoler, elles lui conseillent la soumission à Zeus.
Ce conseil révolte Prométhée : « ni incantations, ni paroles de miel, ni violences ne le fléchiront… »
Alors, le chœur, qui joue un grand rôle dans toutes les tragédies d’Eschyle, l’interroge sur son histoire et sur son crime, cause de son châtiment.
Le récit de Prométhée est un écho lointain des traditions primitives, et de la première révélation. Tout naturellement, c’est un écho très affaibli, très imparfait, mais il se rapproche cependant beaucoup des récits bibliques.
Prométhée raconte une lutte qui a eu lieu dans le ciel entre Cronos, le dieu antique, et Zeus, le dieu nouveau, et l’on croirait entendre saint Jean racontant dans l’Apocalypse la lutte de Lucifer contre Jéhovah. C’est Zeus qui triomphe, grâce à l’appui de Prométhée.
Ici, vous le voyez, Prométhée n’a plus Jésus. Christ pour type, mais Adam, puisqu’il lutte avec le nouveau dieu, Zeus, ou Lucifer, contre l’ancien Cronos ou Jéhovah. « Mais, me direz-vous, dans nos croyances, c’est Jéhovah qui triomphe et non pas Lucifer ? » Au ciel, oui ; mais plus tard, dans le paradis terrestre, c’est Lucifer qui remporte, grâce à la défection d’Adam.
À l’aide de Prométhée, ayant le premier Adam pour type, Lucifer ou Zeus devient donc le souverain des hommes. Bientôt il les tyrannise, et les fait gémir sous le poids des douleurs. Alors Prométhée intervient ; mais, cette fois, il prend fait et cause pour les hommes contre Zeus et il les sauve. C’est le second Adam. Le Verbe devient alors son type, et il raconte aux Océanides comment il a apporté la lumière aux hommes, et comment il les a sauvés. En décrivant leurs misères avant sa venue, il en parle comme le Prophète-Roi : « Ils regardaient et ne voyaient pas, ils écoutaient et n’entendaient pas. » Oculos habent et non videbunt, aures habent et non audient.
Quand son récit est terminé, les Océanides lui demandent : « N’as-tu rien fait de plus pour eux ? » Il répond : « Je les ai empêchés de prévoir la mort. – Par quel remède les as-tu guéris de ce mal ? – J’ai mis en eux l’aveugle espérance. »
Quel merveilleux écho des promesses de l’Éden ! Quelle annonce prophétique de la rédemption !
Les Océanides ne comprennent rien à cet amour extraordinaire de Prométhée pour les hommes, et elles le lui reprochent : « Tu les as aidés plus qu’il ne convenait… Tu as trop aimé les mortels. Vois le salaire ingrat de tes bienfaits… »
Prométhée répond : « J’ai eu pitié des hommes, c’est pourquoi l’on n’a pas eu pitié de moi… » David (ps 108) fait dire au Christ : « Ils m’ont rendu le mal pour le bien, et la haine pour l’amour dont je les entourais. »
Réponse mystérieuse et sublime, dont la tristesse rappelle la grotte de Gethsémani et le Calvaire ! Car le Christ aussi a eu pitié des hommes et l’on n’a pas eu pitié de lui, ni Dieu qui l’a soumis à toutes les souffrances de la passion et de la croix, ni les hommes, qui ont été ses bourreaux, et qui le sont encore. Il me semble évident qu’une pareille idée, exprimée par un païen, cinq siècles avant Jésus-Christ, dépasse l’imagination même du génie.
Et Prométhée ajouté : « Pour secourir les mortels, je me suis perdu moi-même. Je n’ignorais rien, j’ai voulu, sachant ce que je voulais. » Jésus n’a pas parlé autrement.
Ici survient Océanos, touché comme ses filles du sort de Prométhée. Il lui fait des remontrances d’un ton bonasse. Il est le type de ces sages et de ces prudents qui ne comprennent rien aux œuvres du génie, ni de la Providence, et qui ne s’élèvent jamais au-dessus du terre à terre.
Prométhée l’éconduit assez rudement.
C’est alors que la vierge Io entre en scène.
Le type de la vierge Io, c’est Ève, maudite et poursuivie par la colère des dieux. C’est la femme, traversant cette vie dans le cortège de douleurs qui la suivaient partout, avant la venue du Christ.
Mais c’est aussi Marie, la seconde Ève, car vous allez voir que Prométhée lui parle, comme l’ange Gabriel à la vierge de Nazareth cinq cents ans plus tard.
Elle se lamente, et vient se plaindre à Prométhée, vers lequel un châtiment commun, ayant le même auteur, l’attire :
« C’est par Zeus, lui dit-elle, que je suis malheureuse ! »
Alors Prométhée lui prédit la chute de ce dieu, dans des termes que l’on dirait copiés de la Bible :
« Sois-en sûre, il sera dépouillé de son sceptre royal ; une femme enfantera un fils qui le détrônera.
– Cette révolution, reprend Io, est-elle donc inévitable ?
– Zeus ne l’évitera pas. Il faut que je sois délivré.
– Qui donc te délivrera, malgré lui ?
– Femme, un fils de ta race.
– Que dis-tu ? Mon fils te délivrera ! »
C’est la pudeur de la vierge qui s’alarme et s’étonne. Prométhée répond : « Il est une terre promise par les destins, à toi et à tes descendants, pour de longues années ; c’est là, dans cette région triangulaire que baigne le Nil sacré, que doit s’accomplir la parole prodigieuse de l’oracle, qui naguère t’appela franchement future épouse de Dieu. C’est là qu’une main divine te touchera seulement, et tu deviendras mère sans avoir connu l’homme, ô vierge d’Inachus… Puis de ta race naîtra un Fort qui sera mon libérateur…
De ce Fort, qui, suivant les prédictions de Prométhée, devait le délivrer, les païens, avec leurs idées matérialistes, ont fait Hercule. C’est lui en effet qui, d’après Eschyle, vint délivrer Prométhée.
Pour nous, chrétiens, qui dédaignons la force matérielle, le Fort nous est apparu sous l’apparence de la faiblesse. Au reste l’épithète de Fort convient également à Jésus, et il est vainqueur du serpent, comme Hercule est vainqueur de l’hydre.
Après le départ d’Io, Prométhée répète aux Océanides ses prédictions de malheurs contre Zeus, et l’on croirait entendre Daniel expliquant au roi Balthazar la terrible inscription qu’une main mystérieuse avait tracée sur la muraille.
« Qu’il siège maintenant sur les hauteurs, confiant dans le fracas des nues qu’il agite, fier de lancer le trait enflammé. Ces armes ne défendront pas sa chute misérable. Voici venir un adversaire invincible qu’il se prépare contre lui-même. »
Ces prédictions sinistres pour Zeus, si souvent renouvelées avec une énergie croissante, finissent par troubler la paix de l’Olympe. Zeus s’émeut, il croit déjà son trône ébranlé, et il envoie vers Prométhée son messager Hermès, afin d’apprendre les secrets du supplicié, et comment le pouvoir de Zeus pourrait jamais être détruit.
Hermès descend donc vers le rocher où Prométhée agonise, et il lui adresse la parole. Le dialogue est plein de sarcasmes et d’injures. Prométhée a des réponses d’une fierté et d’une audace effrayantes.
Après l’avoir appelé menteur, rebelle, offenseur des dieux, Hermès le somme, au nom de Zeus, d’avoir à lui dire quel est cet hymen d’une vierge avec un dieu, dont il parle avec tant d’insolence, et qui doit renverser Zeus de son trône.
Le Titan lui répond : qu’il n’est qu’un esclave des dieux ; que son maître Zeus se croit inaccessible au malheur dans ses citadelles, mais qu’il tombera bientôt. Comment tombera-t-il ? Il refuse de le lui dire : –
« Reprends donc le chemin qui t’a conduit vers moi, tu ne sauras rien… Sache-le bien : contre ta servitude je ne changerais pas mon supplice. J’aime mieux être le captif de ce rocher que le serviteur de ton maître. »
– On dirait, reprend Hermès, que tu te réjouis de tes maux.
– Puissé-je voir mes ennemis se réjouir ainsi, toi surtout !
– Ta raison se trouble, tu délires.
– Qu’il dure donc ce délire, si c’en est un de haïr ses ennemis.
À un moment donné, Prométhée dit en gémissant : « Hélas !
– Hélas ! reprend Hermès railleur, voilà un mot que Zeus ne connaît pas !
– Le temps qui va toujours aura raison de toute chose.
– Il ne t’a pas appris à être sage.
– Non, certes, sans quoi te répondrais-je, esclave ? »
Et comme Hermès insiste, et le presse encore, après cette réplique méprisante, Prométhée lui dit avec un ennui plein de calme :
« C’est comme si tu haranguais un flot de la mer. »
Alors comprenant que ses instances sont inutiles, Hermès lui prédit que son supplice va s’aggraver pour punir son refus de répondre aux demandes de Zeus ; qu’un coup de foudre de ce dieu va retourner son rocher et l’ensevelir dessous, et que lorsqu’il sera tiré de ce sépulcre l’aigle vorace de Zeus fondra sur lui, fouillera sa chair, et mangera son foie noir. Puis le messager de Jupiter ajoute en terminant :
« N’espère point la fin de ton supplice, avant qu’un des dieux veuille bien prendre ta place, et descendre vers le sombre Hadès. »
Le sombre Hadès est l’enfer païen, dans lequel gémissaient, d’après Eschyle, les Titans, frères de Prométhée, c’est-à-dire les hommes primitifs, et que Prométhée allait délivrer en y descendant.
En écoutant la terrible prédiction de cette aggravation de peine, et de la délivrance, ne vous semble-t-il pas apercevoir, comme à travers un nuage, la vision lointaine du Christ descendu de la croix, mis au sépulcre, puis ressuscitant et descendant aux enfers pour y délivrer les âmes des justes qui y étaient détenues depuis le commencement du monde ?
Ce qui rend ce rapprochement plus frappant encore, c’est la description de la catastrophe finale, qui rappelle les phénomènes du Calvaire. Écoutez :
Le ciel se couvre de nuages sombres, la tempête se déchaîne, les vents mugissent, la foudre gronde, les éclairs sillonnent les nues, la terre tremble et va s’ouvrir pour engloutir le Titan. Mais lui, reste calme et dit : « Que le glaive de feu me déchire, que la terre soulevée m’étouffe, que la mer montante me submerge ; Zeus avec tout cela ne me tuera pas ! »
De même, en voyant approcher la mort avec son cortège d’horreurs, le Christ devait se dire au sommet du Calvaire : Avec tout cela, les forces coalisées de l’enfer ne me tueront pas !
Enfin, une dernière convulsion de la montagne se produit, et au moment d’être englouti dans l’abîme, Prométhée pousse un dernier cri qui est une protestation solennelle :
« Ô Terre ! ô ma mère ! ô Éther où roule la lumière ! voyez ce que je souffre pour la justice ! »
Ainsi se termine le Prométhée enchaîné, et c’est après cette brève analyse que l’on comprend quelle perte l’art a faite dans le Prométhée délivré, troisième et dernière partie de la trilogie.
Car tout cela me paraît prodigieux – non pas précisément comme tragédie, car le théâtre n’existait pas encore, ou ne faisait que de naître – mais comme philosophie, comme théologie, comme prophétie, comme témoignage païen de la vérité et de l’authenticité des récits bibliques.
Comme sujet dramatique, c’est colossal !
La scène se passe entre ciel et terre, et l’on y voit figurer la nature et les éléments, notre globe et les êtres qui l’habitent, l’Olympe et les divinités. Je ne connais rien de plus grand dans la poésie d’aucun peuple.
Les règles de l’art y sont inconnues – elles n’existaient pas encore – et l’on ne saurait y trouver en conséquence la perfection de forme, que Sophocle allait bientôt donner à la tragédie grecque.
Mais la conception en est titanes que, comme le héros. C’est un abîme d’élévation et de profondeur, enveloppé d’ombre et de mystère, mais dans lequel flottent des reflets du passé, et des visions de l’avenir.
Le langage en est rude, hardi, original, saisissant. Il est d’une énergie et d’une force surhumaines. Il éclate comme une fanfare, il mugit comme un roulement de tonnerre.
Les images abondent ; mais elles manquent quelquefois de vérité et de mesure. Les antithèses s’entrechoquent souvent comme un cliquetis d’armes. Elles sont parfois d’une audace qui fait bondir les professeurs de rhétorique ; et les mots qui les expriment sont de temps à autre d’une grossièreté et d’une crudité choquantes. Voulez-vous avoir une idée de ses métaphores ? Écoutez celles-ci reproduites par Paul de Saint-Victor : il appelle la poussière sœur altérée de la boue, ou messager muet de l’armée ; la fumée, sœur chatoyante du feu… La mer est la marâtre des vaisseaux ; elle ouvre pour les engloutir une âpre mâchoire. Il la voit après les naufrages des Grecs revenant de Troie, toute fleurie de cadavres. Le pont jeté par Xerxès sur le détroit, est-un joug au cou du Bosphore… Le fer est un dur répartisseur d’héritages qui jette aux guerriers les dés de la terre.
Je ne conseille pas aux jeunes théoriciens d’essayer de ce genre.
Mais ne nous attardons pas à ces questions de style, et scrutons encore le fond même du drame.
Qui donc est Prométhée ? Que représentent son crime, son châtiment et sa délivrance ?
Si vous consultez l’école libre penseuse et révolutionnaire, elle vous répondra :
Prométhée, c’est l’humanité luttant pour la science et la liberté contre l’autorité soit ecclésiastique soit civile. C’est le génie humain civilisant le monde en dépit des persécutions de l’envie, des préjugés et de la superstition. C’est Roger Bacon emprisonné, c’est Averroès au pilori, c’est Colomb dans les chaînes, c’est Galilée condamné par le Saint-Office, c’est Giordano Bruno montant sur le bûcher !
Mais cette réponse n’en est pas une.
Que l’on puisse, à certains égards, faire un rapprochement entre quelques-uns de ces hommes et Prométhée, je le concède. Qu’on le donne comme un type de tous ceux qui ont souffert pour le droit et la justice, je le veux bien.
Mais quel que soit le lustre plus ou moins grand des hommes qui par leurs travaux ont fait progresser les arts, les lettres et les sciences, Prométhée est bien plus grand que toutes ces personnifications, et son rôle est bien supérieur au leur. Il y a dans sa mission un caractère d’universalité et de durée séculaire, qui l’élève au-dessus de toute mission individuelle.
Tout le drame répugne d’ailleurs à l’étroite application que j’ai citée, et la vérité historique la contredit.
Il est plus que douteux que la science eût été persécutée par l’autorité à l’époque d’Eschyle ; en tout cas, elle n’avait pu l’être par l’Église catholique qui n’existait pas encore ; et quand son fondateur parut, ce ne fut pas pour la persécuter, mais pour la sauver.
Non, en plongeant son regard d’aigle dans l’avenir, Eschyle n’a pu y découvrir ni Galilée, ni Giordano Bruno qui ne fut qu’un moine apostat. Mais il a pu apercevoir le Christ, parce que le Messie était alors promis et annoncé, depuis des siècles, à l’homme plongé dans l’infortune.
Comment a-t-il pu acquérir la connaissance de ce grand avènement si longtemps attendu, et si ardemment désiré par le peuple juif ?
Nous n’en savons rien positivement, et nous en sommes réduits à des conjectures.
Est-ce par la tradition transmise de générations en générations ? Est-ce par l’étude des livres des Juifs, des œuvres de Moïse et des Prophètes ?
Les deux hypothèses peuvent être vraies et sont même très vraisemblables. Il ne nous semble pas possible que le génie d’Eschyle, si grand qu’on le suppose, ait pu, de lui-même, livré à ses inspirations, imaginer un drame aussi gigantesque dans ses proportions, aussi surnaturel dans ses personnages et dans son action, et aussi prophétique dans ses tableaux d’avenir.
Sans doute, la chute de l’homme, sa faute originelle, son châtiment et l’espérance de sa rédemption, étaient alors autant de croyances que la tradition avait transmises et conservées. Les lettrés d’Athènes paraissent y avoir ajouté foi, et le grand poète pouvait posséder là-dessus les mêmes données que Socrate et Platon, qui vinrent après lui.
Mais son drame va bien au-delà de ces données générales. Il prédit que Prométhée sera délivré par un dieu, lequel naîtra d’un mariage mystique entre une vierge et un dieu ! Ce n’est pas tout. Comme vous avez pu le voir, en décrivant le supplice de Prométhée, le poète raconte en quelque sorte la passion de Jésus-Christ, avec une précision de détails qu’on dirait empruntés au prophète Daniel.
Voilà ce que le génie humain n’a pas pu inventer ; et pour ma part, je crois qu’Eschyle n’a pas trouvé le sujet et les grandes lignes de son drame dans les traditions populaires seulement ; mais qu’il a dû connaître et lire les livres de Moïse, le Prophète-Roi, Isaïe et Daniel. Sa parenté intellectuelle avec Isaïe est d’ailleurs frappante.
Est-ce à dire qu’il faille ranger Eschyle parmi les Prophètes ? – Évidemment non. Quelles que soient les grandes vérités qui sillonnent son drame, comme des éclairs, il faut bien reconnaître qu’elles sont encore enveloppées d’ombres mythologiques, et noyées dans les brouillards inconsistants et insaisissables des fables du paganisme.
Mais ce qu’il faut conclure, c’est qu’on peut invoquer Eschyle comme la plus grande autorité païenne en faveur de nos dogmes chrétiens ; et cette autorité a d’autant plus de valeur qu’elle émane d’un génie transcendant, et qu’elle remonte à cinq siècles avant Jésus-Christ.
Après le Prométhée d’Eschyle, on comprend que saint Paul ait trouvé dans Athènes le temple du dieu inconnu, et nous pouvons conjecturer que ce temple avait dû être élevé par la classe lettrée. Car c’est après Eschyle que les sages et les philosophes de la Grèce commencèrent à dépeupler l’Olympe de ses innombrables divinités.
On comprend aussi qu’en bâtissant au sommet du Capitole un temple magnifique en l’honneur de Jupiter, l’empereur Auguste y ait dédié un autel à la vierge qui devait enfanter : virgini pariturœ !
Enfin, on ne s’étonne plus d’entendre Virgile annoncer dans sa quatrième églogue « que les derniers temps prédits par la Sibylle de Cumes, sont enfin arrivés… qu’une race nouvelle descend du haut des cieux… qu’un enfant, fils des dieux, va clore le siècle de fer, et rouvrir l’âge d’or au monde entier… que les temps approchent où l’enfant chéri des dieux, noble rejeton de Jupiter, va monter aux honneurs suprêmes… et que tout l’univers tressaille dans l’attente de ce nouveau siècle !… »
Tout extraordinaires que sont ces prédictions dans la bouche de Virgile, elles ne surprennent plus quand on voit avec quelle précision Eschyle avait annoncé ces évènements dans son Prométhée.
Tertullien l’avait lu sans doute, et il avait été frappé comme nous de la ressemblance mythique qui existe entre le héros d’Eschyle et notre Dieu. Car, un jour, il s’est écrié en montrant le Christ aux païens : Verus Prometheus, Deus omnipoteus, blasphemiis lancinatus !
Oui, le vrai Prométhée, c’est notre Dieu, non plus le Prométhée enchaîné ou crucifié, mais le Prométhée délivré, et vainqueur à jamais.
Les Juifs ont possédé le Christ vivant ; nous possédons le Christ ressuscité et triomphant ; les anciens, moins heureux que nous, n’ont pu en connaître que des figures très imparfaites. Néanmoins ! le Prométhée d’Eschyle en est une preuve, ils ont cru à un Rédempteur promis par leurs oracles, et ils l’ont attendu avec confiance pendant des siècles et des siècles.
Non seulement les Grecs et les Romains ont cru à ces oracles et à l’avènement d’un Rédempteur, mais si vous étudiez des littératures plus anciennes encore, celles des Indiens, des Chinois, des Égyptiens et des Perses, vous y trouverez les mêmes croyances plus ou moins défigurées, mais assez concordantes pour qu’on puisse leur assigner une origine commune.
Nous pouvons en conclure que tous les hommes sont les enfants d’un même père, que ce père a péché contre le Dieu qui l’avait créé-que cette faute a attiré un terrible châtiment sur lui-même et sur ses descendants, mais qu’avec son héritage de douleurs il a transmis à ses enfants la promesse et l’espérance d’une Rédemption.
Grâces soient rendues à Dieu ! nous, chrétiens, ne sommes plus au nombre des générations qui attendent encore. Nous savons qu’il est venu parmi les hommes, cet enfant qui devait naître du mariage d’une vierge avec un Dieu ; nous savons que le Prométhée divin est venu délivrer le Prométhée humain, et nous jouissons des immenses bienfaits de cette délivrance, depuis que le règne de Zeus a pris fin.
Est-ce à dire que l’homme soit maintenant arrivé au bonheur parfait ? Non certes, la terre n’a jamais connu et ne connaîtra jamais un tel bonheur ; et c’est ici qu’un dernier trait du Prométhée vient ajouter encore à sa ressemblance avec le premier Adam, c’est-à-dire avec le genre humain.
Le héros d’Eschyle, en effet, même après sa délivrance, dut porter à son doigt un anneau de fer fait d’un morceau de sa chaîne, et dans le chaton duquel était incrustée une parcelle du roc de son pilori. Dernier vestige de sa captivité, et permanent emblème du cortège de douleurs qu’il devait continuer de traîner après lui !
Ah ! qu’il est touchant et qu’il est vrai ce dernier rapprochement allégorique entre l’homme pécheur et Prométhée ! Qui de nous ne porte pas encore un anneau de cette chaîne de fer qui liait l’humanité au démon et à la mort, et que le Christ est venu briser ? Qui de nous ne porte pas dans son cœur et même dans son corps les stigmates du châtiment ? Qui de nous ne sent pas à son doigt une parcelle de ce rocher sanglant auquel fut rivé le genre humain, et que le Christ est venu sanctifier en l’arrosant de son sang ?
C’est l’arrêt éternel et divin ; soumettons-nous. Portons généreusement ces cicatrices qui nous font ressembler davantage à l’Homme-Dieu, et grâce auxquelles il nous reconnaîtra pour ses frères !
N’allons pas nous imaginer qu’en détrônant Jupiter, le Christ a détrôné tous les faux dieux. Il y en a, et il y en aura toujours sur cette terre qui, parvenus aux sommets du pouvoir, persécuteront le droit et la justice !
Contre ces oppresseurs, quel que soit leur titre, quel que soit leur nom, quel que soit leur drapeau, il faut lutter toujours, comme Prométhée contre l’empire tyrannique de Zeus.
Toute faible qu’elle paraît quelquefois, la vérité est toute-puissante quand elle est servie par la patience, l’énergie, la persévérance. Il vient toujours un temps où les faux dieux sont renversés, pour faire place au règne du droit et de la justice.
ŒDIPE
La grandeur est un des traits caractéristiques du Beau, celui qui séduit les esprits supérieurs, et qui fait pardonner les fautes de détail.
C’est la grandeur qui distingue Eschyle ; c’est la perfection de la forme qui fait la gloire de Sophocle.
Les personnages d’Eschyle sont plus grands que nature et se meuvent dans un monde surhumain. Ceux de Sophocle sont hommes et vivent de notre vie. Le premier a plus de force, le second a plus de grâce. L’un semble dédaigner la beauté des formes, tandis que l’autre la recherche.
Eschyle fut malheureux, et sa patrie ne reconnut pas suffisamment ses mérites.
Sophocle fut heureux : il n’eut qu’à se montrer pour recevoir des couronnes. Sa vie fut une série de triomphes, depuis l’âge de 25 ans jusqu’à 90 ans. La gloire illumina son adolescence, et couronna sa mort.
Il vint à son heure, à l’époque la plus brillante de l’histoire de sa patrie, alors qu’Athènes, victorieuse de l’Asie, marchait à la tête de la civilisation et se couvrait de monuments et de statues.