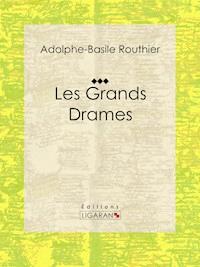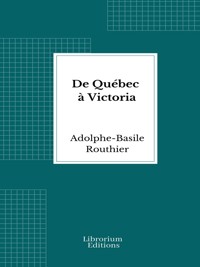
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Il y a quelques années, le R. P. Lacombe, l’organisateur de l’excursion que nous allons raconter, était missionnaire dans l’extrême-ouest de la région des prairies, à Calgary.
Un jour, il reçut de Winnipeg une dépêche ainsi conçue : « Venez dîner avec moi, demain soir, dans mon char-palais, à Calgary. — Geo. Stephen.» Le P. Lacombe en croyait à peine ses yeux ; car le chemin de fer, plus ou moins complété dans la prairie, n’était pas encore en opération. Mais, le lendemain, il n’y avait plus à douter : un train spécial arrivait à Calgary, après avoir franchi l’immense prairie en 32 heures. Le bon missionnaire se hâta de venir souhaiter la bienvenue aux distingués visiteurs. Sir George Stephen — qui à cette époque n’était pas encore arrivé à la prairie — vint au devant de lui, et lui serra la main ; et comme le Père le félicitait sur sa course rapide à travers les prairies, et sur les progrès de sa grande entreprise, sir George, avec un entrain plein de gaieté et d’humour, lui montra la formidable chaîne des Rocheuses, dont les cimes blanches et grises dentelaient l’horizon d’azur..
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
DE
QUÉBEC À VICTORIA
PAR
A.-B. ROUTHIER
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385744328
DÉDICACE
À M. Van Horne,
Président de la Compagnie
du Chemin de fer canadien du Pacifique
etc., etc., etc., etc,
À vous, dont la bienveillance et la libéralité ont permis à l’auteur et à ses illustres compagnons de faire le voyage dont ce livre est le récit ;
À vous, qui présidez si habilement aux destinées de ce grand chemin de fer du Pacifique canadien dont notre pays est fier à si juste titre, et dont j’ai tenté de décrire les grandeurs et les pittoresques beautés ;
À vous, dont le nom se trouve uni à celui du R. P. Lacombe dans un commun sentiment de gratitude de la part des touristes dont je suis l’interprète ;
Ce livre est respectueusement dédié.
A. B. R.
ICHAPITRE PRÉLIMINAIRE
Les relations du R. P. Lacombe avec la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique. — Comment il en devint le président pendant une heure. — Services rendus et reconnus. — Organisation de l’excursion épiscopale. — Son but et ses résultats probables.
I
Il y a quelques années, le R. P. Lacombe, l’organisateur de l’excursion que nous allons raconter, était missionnaire dans l’extrême-ouest de la région des prairies, à Calgary.
Un jour, il reçut de Winnipeg une dépêche ainsi conçue : « Venez dîner avec moi, demain soir, dans mon char-palais, à Calgary. — Geo. Stephen.» Le P. Lacombe en croyait à peine ses yeux ; car le chemin de fer, plus ou moins complété dans la prairie, n’était pas encore en opération. Mais, le lendemain, il n’y avait plus à douter : un train spécial arrivait à Calgary, après avoir franchi l’immense prairie en 32 heures.
Le bon missionnaire se hâta de venir souhaiter la bienvenue aux distingués visiteurs. Sir George Stephen — qui à cette époque n’était pas encore arrivé à la prairie — vint au devant de lui, et lui serra la main ; et comme le Père le félicitait sur sa course rapide à travers les prairies, et sur les progrès de sa grande entreprise, sir George, avec un entrain plein de gaieté et d’humour, lui montra la formidable chaîne des Rocheuses, dont les cimes blanches et grises dentelaient l’horizon d’azur :
— Qu’est-ce que c’est que cela, demanda-t-il ?
— Ce sont les Montagnes Rocheuses, Sir George.
— Est-ce qu’elles prétendent nous barrer le chemin ?
— Peut-être.
— Nous le verrons bien ; mais si elles ne s’écartent pas, nous leur passerons sur le dos.
Dans ce voyage, Sir George Stephen avait avec lui plusieurs autres membres du syndicat du Pacifique, trois présidents de compagnies américaines de chemin de fer, quelques Lords anglais et un comte allemand, frère du cardinal Hohenlohe.
Dans un magnifique char, vide de bancs, une table somptueuse était servie, et le président du Pacifique plaça le P. Lacombe à sa droite. Le dîner fut princier et des plus gais.
Plusieurs santés furent proposées, entre autres celle du P. Lacombe, qui n’aime guère faire des discours, mais qui dut prendre la parole :
« Dans les coutumes de nos sauvages, dit-il, on ne doit pas commencer un discours sans donner d’abord une poignée de main à son hôte, et comme un vieux sauvage que je suis, je demande, M. le Président, de vous serrer la main. »
Cette formalité chaleureusement remplie, l’orateur remercia les illustres visiteurs de l’honneur qui lui était fait, mais il restitua cet honneur à ceux qu’il était présumé représenter, à l’Église catholique, dont il était l’humble ministre, à ses compatriotes Canadiens-Français, les premiers maîtres du Canada, à ses chers Indiens, les premiers habitants des vastes territoires du Nord-Ouest.
Il félicita les membres du Syndicat du Pacifique de l’esprit d’entreprise et de l’activité qu’ils déployaient dans la construction de leur merveilleux chemin de fer, et il leur montra la mission civilisatrice qu’ils auraient à remplir dans l’immense pays qu’ils allaient traverser.
Il s’applaudit de les avoir aidés de son influence dans une circonstance récente, et il exprima l’espoir qu’ils l’aideraient à leur tour dans son œuvre d’évangélisation…
M. Angus se leva alors, et, dans les termes les plus aimables, remercia le missionnaire de ses bonnes paroles. Puis, après quelques phrases élogieuses, il proposa que le R. P. Lacombe fût élu président de la compagnie du Pacifique, et il ajouta que Sir George Stephen pourrait peut-être le remplacer comme chapelain de la mission de Calgary.
La proposition fut accueillie avec enthousiasme. Tous les convives, debout, verres en mains, acclamèrent le nouveau président.
Sir George Stephens déclara qu’il cédait de bonne grâce tous ses droits et privilèges au nouvel élu, et qu’il acceptait la nouvelle position qu’on lui proposait. Et, se tournant vers Calgary, il termina en disant : “ Poor souls of Calgary, I pity you ! ”
Le lendemain matin, les distingués touristes reprenaient la route de Winnipeg, emmenant avec eux le P. Lacombe, qu’ils déposèrent à 40 milles de Calgary, au milieu de la prairie, où l’appelait son ministère de missionnaire.
Il avait été président de la compagnie du Pacifique Canadien pendant une heure ; mais ce grand honneur l’avait peut-être empêché de dormir, et il revenait à des fonctions à la fois plus humbles et plus élevées. Car lorsqu’il traversait à cheval ces immenses solitudes, devenues sa patrie, les Indiens disaient de lui : c’est le représentant du Grand Esprit qui passe !
Quels ambitieux que ces missionnaires ! Ils ont des aspirations bien plus hautes que la présidence d’une compagnie de chemin de fer — fût-elle la compagnie du Pacifique Canadien. Et quand, chevauchant dans la prairie à la recherche des âmes, ils se demandent avec la sainte ambition des apôtres : quo non ascendam ? Ils peuvent se répondre à eux-mêmes : Je monterai sur la montagne de Sion, auprès de laquelle les Rocheuses ne sont que des grains de sable !
II
Évidemment, la cordialité de cette rencontre entre les membres du syndicat et le P. Lacombe fait présumer des relations antérieures ; et, de fait, ces relations remontaient déjà à quelques années.
Dès les commencements de l’exécution de cette vaste entreprise, et alors que le tracé du chemin n’était pas encore définitivement fixé, le P. Lacombe avait rencontré au Portage-du-Rat plusieurs des directeurs du Pacifique qui s’y trouvaient réunis. Ils délibéraient sur la route à suivre à partir de Winnipeg, et ils avaient mandé le vieux missionnaire pour connaître son avis.
Le Père conseillait d’aller tout droit de Winnipeg à Brandon ; mais, à partir de Brandon, il croyait que le chemin devrait se diriger vers le Nord pour atteindre la Saskatchewan, passer par Edmonton, gagner vers la rivière Athabaska et franchir les Rocheuses. C’était l’ancienne route suivie par les Bourgeois du Nord-Ouest, par les voyageurs, et par les missionnaires.
Après l’avoir entendu, Sir George Stephen dit : vos raisons, Père, sont excellentes, sans doute, au point de vue de la colonisation des Territoires ; car nous traverserions ainsi, d’après ce que vous nous dîtes, des régions plus avantageuses comme pays agricole. Mais nous pourrons atteindre plus tard ces régions-là par des embranchements. Pour le moment, il nous faut une ligne plus courte. Et, prenant un crayon, Sir George traça sur la carte étendue devant lui une grande ligne presque droite de Winnipeg à Calgary, et dit : voilà le tracé que nous devons suivre.
Quelque temps après, les travaux se poursuivaient avec une rapidité étonnante, et le chemin s’étendait à travers les prairies, à raison de 6 à 7 milles par jour.
Un personnel nombreux d’ingénieurs, d’entrepreneurs, de terrassiers et autres travailleurs sillonnait la plaine, entraînant avec eux des voituriers et des marchands de provisions. En même temps une ligne télégraphique était construite le long de la voie, afin que les travailleurs pussent rester en communication avec le bureau général, et recevoir ses ordres.
Mais, arrivés auprès de l’endroit où se trouve aujourd’hui Gleichen, les travailleurs allaient entrer sur la réserve des sauvages établis à Blackfoot Crossing (gué sur la rivière de l’Arc), et qui avaient pour chef le célèbre Pied-de-Corbeau (Crowfoot).
Naturellement, ces sauvages n’étaient pas du tout disposés à souffrir qu’on s’emparât d’une lisière de leur réserve. Tout préparés à la résistance, ils pouvaient mettre sur pieds quinze cents guerriers bien armés, et massacrer les travailleurs du Pacifique.
Mis au courant de qui se passait, le P. Lacombe monta à cheval, et courut avertir les travailleurs du danger qui les menaçait. En même temps, il leur demanda quelque délai pour apaiser les sauvages, et les disposer à quelqu’arrangement. Mais les travailleurs répondirent que cela ne les regardait pas, et quelques-uns dirent : “ Let your dirty Indians go to the devil ! ”
Un massacre paraissait inévitable, et il n’y avait pas une heure à perdre pour le prévenir. Le P. Lacombe adressa dépêches sur dépêches aux autorités du Pacifique, et, quand il eut obtenu les réponses qu’il désirait, voici ce qu’il fit.
Il acheta 200 livres de sucre, autant de tabac, du thé, et plusieurs sacs de farine ; et, de retour à la mission, il convoqua tous ses Indiens à un Grand Conseil.
Quand ils furent réunis, il donna toutes ces provisions aux chefs pour être distribués entre les familles ; et quand le partage fut fait, il prit la parole : « Maintenant, leur dit-il, j’ai la bouche ouverte, (car pour avoir le droit de parler, d’après les coutumes sauvages, il faut d’abord faire un présent), et je vous prie de prêter l’oreille à mes paroles.
« S’il y en a un parmi vous qui puisse dire que pendant les quinze années que j’ai passées au milieu de vous je lui ai donné un mauvais conseil, qu’il se lève et le dise sans crainte. » — Personne ne se leva. —
« Eh ! bien, mes amis, j’ai aujourd’hui un conseil à vous donner : laissez passer les Blancs sur vos terres, et y faire les travaux nécessaires à leur chemin ; ils ne peuvent toujours pas vous les enlever.
« D’ailleurs, ces Blancs qui passent ne sont que des travailleurs, obéissant à des chefs, et c’est avec ces chefs qu’il faut régler la difficulté.
« Je leur ai fait connaître votre mécontentement, et dans quelques jours le Gouverneur lui-même viendra vous voir. Il entendra vos plaintes, et, si l’arrangement qu’il vous proposera ne vous convient pas, il sera temps encore de garder vos terres et d’en expulser les travailleurs… »
Crowfoot — ce sauvage intelligent qui a visité depuis la province de Québec, et que toute la presse a loué — prit alors la parole, et déclara que le conseil du Chef-de-la-Prière était bon, et qu’il faillait le suivre.
En conséquence, les projets de résistance furent abandonnés ; et les employés du chemin de fer purent traverser la Réserve sans être aucunement molestés.
Quelques jours après, comme l’avait annoncé le P. Lacombe, le Lieutenant-Gouverneur Dewdney vint rendre visite aux sauvages, et leur dit : « Vous avez bien agi, et je vous en remercie, Voici maintenant ce que je viens vous proposer : en échange de la terre que le chemin de fer va prendre sur la lisière de votre Réserve, je vais vous en donner cent fois autant en arrière de cette Réserve ; et, si vous ne voulez pas, nous allons défaire les travaux commencés, et tracer le chemin en dehors. »
Tous se déclarèrent satisfaits, et la Réserve fut agrandie en conséquence du côté du Nord.
Mais, en même temps, les directeurs du chemin de fer du Pacifique Canadien comprirent qu’ils devaient quelque reconnaissance au P. Lacombe, et ils la lui témoignèrent à plusieurs reprises, de diverses manières.
III
Un jour — il y a 7 ou 8 ans — le R. Père se trouvant à Montréal, fut mandé dans les magnifiques bureaux de la grande Compagnie, où la plupart des directeurs étaient réunis.
Après les salutations d’usage, et l’échange de quelques paroles courtoises, on lui fit une surprise fort agréable.
Une porte à deux battants s’ouvrit, et deux domestiques entrèrent, portant une grande peinture, magnifiquement encadrée. C’était un tableau de grand prix, importé de Florence, et représentant la Madone portant l’enfant Jésus dans ses bras.
M. Angus adressa alors au P. Lacombe quelques phrases pleines de tact et d’esprit, appropriées à la circonstance, et lui offrit le tableau, au nom des directeurs, pour la chapelle de Notre-Dame de Calgary.
Depuis lors, l’intimité des rapports amicaux entre les magnats du Pacifique et le P. Lacombe n’a fait que s’accroître, et il va sans dire que l’excellent missionnaire voyage gratis sur leur chemin aussi souvent qu’il lui plaît.
Cette année, il a fait le projet de mettre à contribution, la libéralité et la généreuse bienveillance que lui témoigne le président actuel de la compagnie, M. Van Horne ; et il a organisé une excursion épiscopale qui a été couronnée d’un plein succès.
Évidemment, il avait en vue autre chose qu’un voyage de plaisir, et l’idée mère qui a présidé à cette organisation était d’un ordre plus élevé.
C’est l’Église de la province de Québec qui a donné naissance aux missions du Nord-Ouest. C’est elle qui a délégué vers les tribus païennes de ces immenses territoires de nombreux messagers de la Bonne Nouvelle, et sous son égide l’œuvre évangélisatrice a prospéré — avec l’aide de l’Église de France et de l’admirable congrégation des Oblats de Marie Immaculée.
Aujourd’hui, l’Église de l’Ouest a voulu montrer ses œuvres à celle de l’Est, et lui témoigner sa gratitude. C’étaient les enfants qui voulaient donner l’hospitalité à leurs pères, en leur disant : venez voir ce que nous sommes devenus, grâce à votre impulsion paternelle, et ce que nous pouvons devenir, si vous voulez favoriser notre développement par les moyens à votre disposition.
Il y avait donc autre chose qu’un tableau touchant, dans cette affectueuse accolade des pères et des enfants, que le P. Lacombe a préparée, et dont nous avons été l’heureux témoin. Un tel rapprochement avait un côté pratique, et produira certainement des résultats appréciables dans l’avenir.
Resserrer les liens qui unissent déjà les catholiques de l’Est à ceux de l’Ouest, faire mieux connaître dans les provinces de l’Est les incontestables richesses inexploitées de l’Ouest, développer le sentiment d’émulation patriotique qui doit nous animer tous pour l’agrandissement de notre commune patrie — le Canada — tels sont les fruits que le promoteur de l’excursion pouvait espérer produire.
M. Van Horne a accueilli ce projet avec un empressement et une courtoisie qui lui font honneur ; et, disons-le, en agissant comme il l’a fait, il a donné une nouvelle preuve, non-seulement de sa libéralité, mais aussi de sa haute intelligence des affaires. Il n’a pas vu seulement aujourd’hui, il a vu demain.
Un magnifique char-palais a été mis gratuitement à la disposition des excursionnistes, et sur tout le parcours de la voie des ordres ont été donnés pour qu’ils fussent traités convenablement.
Aussi le voyage a-t-il été des plus agréables, comme ce récit en fera foi.
Voici les noms de tous ceux qui prirent part à cette excursion, avec l’auteur de ce livre :
S. G. Mgr Taché, archevêque de Saint-Boniface ;
S. G. Mgr Duhamel, archevêque d’Ottawa ;
S. G. Mgr Laflêche, évêque de Trois-Rivières ;
S. G. Mgr Macdonald, évêque d’Alexandria ;
S. G. Mgr Brondel, évêque d’Helena, Montana ;
S. G. Mgr Grouard, vicaire apostolique d’Athabaska-Mackenzie ;
S. G. Mgr Lorrain, évêque de. Pontiac ;
Mgr Hamel, protonotaire apostolique, représentant S. E. le cardinal archevêque de Québec ;
M. le vicaire général Maréchal, représentant Mgr l’archevêque de Montréal ;
M. le chanoine Bouleau, représentant Mgr l’évêque de Bimouski ;
Le R. P. McGuckin, 0. M. I., recteur de l’Université d’Ottawa ;
Le R. P. Royer, 0. M. I., de la maison des Pères, à Québec ;
Le R. P. Gendreau, 0. M. I., procureur de la maison des Pères, à Montréal ;
Le Rév. M. Leclerc, curé de Saint-Joseph de Montréal ;
Le Rév. M. Vézina, curé des Trois-Pistoles ;
Le Rév. M. Séguin, curé de Sainte-Cunégonde ;
Le Rév. M. Collet, préfet des études, au collège de Sainte-Anne ;
Le Rév. M. Auclair, curé de Saint-Jean-Baptiste ;
Le Rév. M. Marchand, des Trois-Rivières ;
Le R. P. Catulle, Supérieur de la Congrégation des P. P. Rédemptoristes, de Belgique ;
Le Rév. P. Allard, V. G. de Saint-Boniface ;
Enfin, le R. P. Lacombe, 0. M. I. — the last but not the least — notre infatigable capitaine, et notre chef à tous dans ce char pittoresque, que nous appelions le char d’Israël.
D’autres Religieux et prêtres se joignirent à nous, à diverses étapes de notre excursion, et firent avec nous une partie du trajet ; mentionnons entre autres les Rév. MM. Morin, Caron et Blanchet, et les PP. Beaudin, du Portage-du-Rat, Leduc, de Calgary, Gabillon, du Lac aux Canards, Chirouse et Lejeune des missions de la Colombie.
D’autres encore, accompagnant Mgr Durieu, évêque de New-Westminster, et Mgr Lemmens, évêque de Victoria, vinrent nous rencontrer à la mission Sainte-Marie.
On devra reconnaître qu’une pareille réunion d’hommes est fort rare, et qu’il s’écoulera peut-être des siècles avant que les territoires du Nord-Ouest revoient des spectacles comme ceux qui leur ont alors été donnés.
La presse entière du Canada, et beaucoup de journaux des États-Unis en ont parlé comme d’un événement de la plus grande importance, et ce livre, n’eût-il pour objet que d’en perpétuer le souvenir, aurait sa raison d’être et son utilité.
IILES PAYS-D’EN-HAUT
Le départ. — Notre char-palais. — L’Outaouais supérieur. — Voyageurs et colons. — Le grand Nord. — Mattawa. — Rivières et lacs. — Le panier d’un Grand-Vicaire.
C’était un spectacle fort animé que notre départ de Montréal, le 16 mai 1892, à 8 h. P. M.
Le char-palais que la Compagnie du Pacifique avait généreusement mis à notre disposition était pavoisé, bien illuminé ; et, sur une draperie tendue à chaque extrémité, on lisait les mots : episcopal excursion, excursion épiscopale. À l’intérieur, une double rangée de pancartes roses, accrochées au plafond comme des pavillons, indiquait les noms des touristes et les compartiments assignés à chacun.
Sur le quai, une foule énorme, composée d’amis et de curieux, attendait l’heure du départ. Les touristes saluaient leurs amis, échangeaient des poignées de mains et des paroles d’amitié, tout en s’occupant de leur installation et de leurs bagages. Les prêtres venaient dire adieu à leurs évêques, et solliciter une dernière bénédiction.
Très affairé, le R. P. Lacombe — notre capitaine — allait de l’un à l’autre, s’occupant du confort de tous, et s’oubliant lui-même.
Enfin, l’heure est arrivée. M. Shaughnessey, l’intelligent et aimable vice-président de la Compagnie vient s’assurer que nous sommes tous bien installés. Il distribue à tous de bons sourires et des shake-hands pleins de cordialité. La cloche sonne, et le train s’ébranle.
D’immenses acclamations nous souhaitent bon voyage, et nous sortons lentement de la gare, en route pour les Pays-d’en-Haut.
Notre habitation, je veux dire notre char-palais, s’appelle Canton. Est-ce pour nous donner l’illusion que nous partons pour la Chine ? — Si nous avions cet espoir, il serait mieux justifié que celui de Champlain, de LaSalle et d’autres, quand ils s’aventuraient vers l’Ouest. Car, une fois à Vancouver où nous courons, il ne nous resterait plus qu’une étape à franchir pour aller voir le vrai Canton chinois.
Pour le moment, nous sommes satisfaits du Canton que M. Van Horne nous a concédé, et nous nous y établissons pour un mois. Pendant trente jours il va être à la fois un hôtel, un presbytère et un évêché.
Ouvrons un peu les journaux du soir. Tous annoncent notre départ, comme un événement, et franchement c’est bien cela. Une excursion comme celle-ci ne s’est pas encore vue, et ne se verra probablement pas de longtemps.
Nous arrêtons une minute à Sainte-Thérèse. Que de souvenirs cet endroit me rappelle ! C’est ici que j’ai passé huit années de ma vie, dont je n’ai pas profité comme j’aurais dû, et que je n’ai pas sû apprécier.
Ah ! si jeunesse savait ?
J’ai le cœur serré en pensant que le collège où j’ai fait mes études classiques a été incendié et démoli, et quand je jette un regard sur le village actuel avec ses nouveaux édifices je ne le reconnais plus. Il n’y a donc pas que l’homme qui change ; les choses aussi subissent des métamorphoses. Mais en changeant elles rajeunissent, tandis que l’homme…
Les stations suivantes, Sainte-Scholastique, LaChute, me rappellent d’autres souvenirs d’enfance, et je crois revoir mon beau lac des Deux-Montagnes aux bords duquel je suis né.
Quand tous les lits sont faits dans notre char-palais-il ressemble au dortoir d’un couvent avec sa double rangée d’alcôves. C’est le moment ennuyeux de la journée à bord d’un train de chemin de fer ; et, lors même qu’on ne s’endort pas, ce qu’on a de mieux à faire est encore de se coucher.
Mais le sommeil arrive bien vite, et c’est en dormant que nous traversons Ottawa et Pembrooke.
Le 17 au matin nous étions arrivés dans la région la plus accidentée de l’Outaouais Supérieur. De hautes montagnes avec leurs cimes boisées, et des blocs de rochers encadrant des lacs sauvages, défilaient rapidement à nos côtés.
Ça et là quelques établissements, des scieries, des fermes, ou des chantiers. À droite la rivière des Outaouais descend, tantôt calme et tantôt rapide, au fond d’un large ravin, et charrie des millions de billots de pin et d’épinette.
Tous les habitants de Canton se sont levés frais et dispos, et consacrent quelque temps à la récitation du bréviaire — excepté moi, bien entendu. Ce n’est pas que le bréviaire soit à mon avis un livre ennuyeux ; au contraire, je le crois plus intéressant que la plupart des récits de voyage — celui-ci compris. C’est même un livre plein de poésie qui chante à la fois les beautés de la nature, et celles de la surnature, les grandeurs de Dieu, et les gloires des saints.
Quand nos arrêts le permettent, nous sortons un peu prendre quelques bouffées d’air frais.
La région que nous traversons est ce qu’on appelait autrefois les Pays-d’en-Haut, et les voyageurs qui la fréquentaient n’y venaient pas en douze heures en char-palais.
Ils remontaient l’Outaouais et ses nombreux affluents en canots d’écorces, maniant joyeusement l’aviron, et chantant à tous les échos des forêts nos vieilles chansons populaires. De distance en distance, ils s’échelonnaient par groupes le long de toutes les rivières flottables, et y construisaient des chantiers dans lesquels ils passaient les hivers, transformés en bûcherons.
Toute cette partie du pays était alors couverte de riches forêts, et pendant tout l’hiver la hache impitoyable abattait les pins, les chênes et les cèdres séculaires, détruisant d’immenses richesses forestières, sans que personne ne se préoccupât du lendemain.
Au printemps, les bûcherons devenaient des hommes de cage, rassemblaient les bois coupés, en confectionnaient de vastes radeaux ou cages, y construisaient de jolies cabanes bien groupées, et ces villages flottants descendaient la rivière Outaouais et le fleuve Saint-Laurent jusqu’à Québec.
Aujourd’hui, le nombre des voyageurs a bien diminué, et leur vie n’est plus la même. Des moulins à scies s’élèvent partout le long des rivières, et le bois scié est expédié par les chemins de fer.
Les pessimistes disent toujours que nous ne progressons pas. Mais quel ne serait pas l’étonnement de nos pères s’ils revoyaient aujourd’hui ces contrées ! Quels développements et quels changements se sont opérés depuis 25 ans, surtout depuis la construction du chemin de fer du Pacifique !
Que d’établissements nouveaux ? Que d’exploitations forestières, minières, agricoles sont en voie de transformer ce grand Nord, que M. Buies décrivait comme insaisissable dans son livre intitulé « L’Outaouais supérieur !
« On ne peut, s’écriait-il dans son style imagé et pittoresque, ni le saisir ni l’embrasser dans un cadre. Ses horizons sont trop vastes ; et pendant que le regard cherche à le fixer et à le retenir, il grandit incessamment devant lui, s’élève et gagne de plus en plus la nue, comme une lente et solennelle gravitation de notre planète vers un espace toujours plus reculé. Les vagues de ses forêts, de ses collines et de ses montagnes flottent et montent dans un ciel sans limites, vers des rivages dont nul ne voit la trace, et dont la ligne de l’horizon lointain ne peut donner qu’une illusion passagère… »
Aujourd’hui, notre grand Nord n’a plus cet aspect de l’inconnu sans limites et du rêve insaisissable. On l’explore, on le sillonne, et on l’exploite, non pas encore dans toute son étendue, mais graduellement.
Voici Mattawa, qui n’était, il y a vingt-cinq ou trente ans, qu’un simple poste de traite de la Compagnie de la Baie d’Hudson, et qui est resté une pauvre mission jusqu’à la construction du chemin de fer. Mais aujourd’hui, c’est une petite ville de plusieurs milliers d’âmes et qui se développe rapidement.
Elle occupe un site très pittoresque au confluent de la Mattawan et de l’Outaouais, sur une espèce de promontoire rocheux. Elle domine la grande rivière qui s’élargit en face d’elle pour la mirer toute entière ; et en même temps elle s’adosse à une montagne sombre qui sert de repoussoir à sa belle église à deux clochers.
L’un des Pères Oblats qui desservent cette église est venu à la gare saluer les évêques, et il se joint à l’expédition.
Si nous remontions plus haut l’Outaouais nous arriverions au lac Témiscaming, où la colonisation a fait de grands progrès. C’était autrefois un long et difficile trajet ; aujourd’hui, grâce aux efforts et à l’habileté de notre compagnon de voyage, le R. P. Gendreau, nous pourrions atteindre le lac en quelques heures, par un service alternatif de petits bateaux et de tramways.
Mais c’est vers l’Ouest et non vers le Nord que nous tendons, et nous quittons l’Outaouais derrière nous en prenant la direction du lac Nipissing.
La voie suit d’abord la rivière Mattawan ; puis elle longe le lac La Tortue, et le lac La Truite, et nous conduit ainsi jusqu’à la hauteur des terres. De là, une autre petite rivière nous indique la route à suivre pour arriver au lac Nipissing.
Tout ce pays est très accidenté, et en pleine voie de colonisation. Il ne faut pas oublier que nous avons traversé la frontière provinciale, et que depuis Mattawa nous sommes entrés dans la province d’Ontario.
L’établissement le plus considérable de ceux que nous touchons jusqu’au lac Nipissing est Callendar. C’est le chemin de fer qui a créé ce grand village qui compte déjà près de 2,000 âmes et qui grandit rapidement. Là, comme dans la plupart des centres qui prennent de l’importance, il y a une école et une chapelle catholique. La majorité de la population est d’ailleurs canadienne-française.
L’air des lacs et des montagnes nous ouvre l’appétit, et nous soupirons après le déjeuner. Les paysages sont beaux, mais les rivières qui scintillent au soleil ne nous offrent que de l’eau claire, et si elles réjouissent nos yeux, elles ne rassasient pas nos estomacs qui crient famine.
Nous rejoindrons bientôt, à North-Bay, un char à dîner qui embellira considérablement le point de vue. Mais en attendant ce réfectoire ambulant, qui fuit devant nous, un de nos plus gais compagnons de voyage, M. Séguin, me propose de dévaliser l’un de nos Vicaires Généraux, qui a près de lui un panier des plus appétissants.
Ce sont les Dames Religieuses d’un couvent dont il est le Bienfaiteur qui ont préparé ce panier, et c’est un vrai chef-d’œuvre. Nous lui proposons d’en faire l’inventaire ; et quand vient le moment de la prisée des articles inventoriés, il en est plusieurs que nous nous déclarons incapables d’évaluer sans les goûter.
L’excellent Grand-Vicaire sourit, et nous laisse faire. Naturellement nous vantons et évaluons très haut les précieuses victuailles. Mais, notre estimation faite, voici que le Révérend Monsieur nous réclame le prix de celles que nous avons consommées, suivant la prisée de l’inventaire.
Un procès devenait menaçant lorsque l’attention de tous fut attirée par la vue du lac Nipissing. L’immense nappe d’eau s’étendait à perte de vue à notre gauche, et notre train en côtoyait le rivage. Un coup de sifflet prolongé nous annonça North-Bay.
IIILE CANADA INCONNU
Northbay. — Sturgeon’s Falls. — Le lac Timagami, paradis des sportmen. Sudbury. — Chapleau. — Les bords du lac Supérieur. — Tunnels, baies et promontoires. — Gais propos. — Nepigon.
Le site de North-Bay est vraiment joli, et plein de promesses pour l’avenir. En avant, le lac qui est magnifique, et qui lui donne des communications par eau avec différentes villes naissantes. En arrière, de bonnes terres à cultiver et des forêts à exploiter.
Mise en communication directe avec les villes de l’Est et de l’Ouest par le chemin de fer du Pacifique, la ville naissante est reliée à Toronto par un embranchement du Grand Tronc.
Sa population dépasse 5000 âmes, dont près d’un quart sont de race canadienne-française, et y possèdent une école et une chapelle.
Il y a à North-Bay une Cour de District et une prison, une belle gare, de grandes usines, deux scieries, plusieurs hôtels, et quelques églises.
C’est un excellent marché pour les colons des cantons voisins.
À partir de cette station, la voie ferrée suit encore les bords du lac Nipissing pendant quelque temps, et nous arrivons bientôt à Sturgeon’s Falls. C’est un village florissant contenant plus de 400 familles, dont près de la moitié sont canadiennes-françaises.
La jolie rivière de l’Esturgeon, qui se décharge dans le lac Nipissing, se précipite ici entre deux rochers, et forme une belle chute qui fait mouvoir plusieurs moulins.
Mais d’où vient donc cette rivière, et où va-t-elle puiser l’énorme volume d’eau qu’elle verse dans le lac Nipissing ? Si vous remontiez un peu son cours, vous découvririez qu’elle sert de décharge à un autre lac très vaste et presque inconnu, qui se nomme Timagami, et que les Anglais appellent Tamagamany.
On assure que ce lac mesure trois cents milles de circonférence, et que plus de treize cents îles y ont été jetées par la main de Dieu comme autant de fleurs flottantes sur le cristal de ses eaux.
Que de pointes ! Que de baies ! Que de rochers couverts de mousses ! Que de collines ombragées de beaux arbres ! Que d’horizons qui s’ouvrent et se referment comme les plis ondoyants de riches tentures ! Quelle variété dans les paysages et les décors ! Quel paradis pour les pêcheurs et les chasseurs que cette immense oasis sauvage où surabondent les poissons et le gibier !
Mais qu’ils se hâtent les sportmen qui veulent profiter du bon temps ! Car l’agriculture et l’industrie menacent d’envahir ce beau pays de chasse et de pêche, et dans quelques années les chemins de fer en chasseront le chevreuil et l’orignal, la marte et le vison. L’ours lui-même s’enfuira devant la locomotive, et cherchera plus au Nord quelque retraite plus paisible.
Et pourquoi laisserait-on en possession des bêtes fauves un sol qui, dans certains endroits peut produire du blé, et qui ailleurs contient de l’or, de l’argent et du nickel ?
Sans doute, il y a des industriels qui sont des sportmen ; mais l’intérêt de l’industrie prime le sport et ce ne sera pas ceci qui tuera cela. Aussi parle-t-on déjà de deux chemins de fer qui relieraient le lac Timagami, l’un à North-Bay, et l’autre à Sudbury.
Le bassin du lac Timagami a, dit-on, une superficie d’environ deux cents milles carrés et un climat comme celui de Montréal. Le gouvernement d’Ontario y a fait arpenter 68 cantons, et en offre les lots au prix de 50 centins par acre. Les colons qui se dirigent de ce côté sont en grande majorité des Canadiens-français, et c’est le R. P. Paradis qui a trouvé là un vaste champ d’activité.
À dix milles de l’Esturgeon, nous traversons une petite colonie de Canadiens-français dont plusieurs viennent des États-Unis. C’est la station de Verner. Le sol et le climat y sont excellents.
Puis, nous entrons dans une contrée encore sauvage, accidentée de rochers, de lacs et de forêts, et nous arrivons à Sudbury.
La plupart de ces établissements datent de la construction du chemin de fer, et sont des créations de la Compagnie du Pacifique.
Il y a trois ans, Sudbury n’était encore qu’un petit village ; mais c’est aujourd’hui une ville qui prend beaucoup d’extension, grâce aux mines de cuivre et de nickel que l’on a découvertes dans l’intérieur des cantons voisins, et dont l’exploitation promet des résultats magnifiques.
Une ligne du chemin de fer relie Sudbury au Sault-Sainte-Marie, ainsi qu’aux grandes voies ferrées des États-Unis, et le trafic y prend des développements étonnants.
En construisant cette ligne, qui a une longueur de prés de 200 milles, la Compagnie du Pacifique a ouvert à la colonisation le magnifique territoire d’Algoma, et fourni aux villes du Canada-Est une nouvelle voie de communication avec Duluth, Saint-Paul et Minneapolis.
Plus nous avançons vers l’Ouest, plus la nature se fait sauvage et plus la solitude grandit. Cependant nous rencontrons encore quelques stations où la colonisation commence à s’implanter — entre autres Cartier, Biscotasing et Chapleau.
La nuit est venue lorsque nous faisons halte à cette dernière ; mais j’y suis passé de jour en 1891, et j’ai pu constater qu’il y a ici beaucoup de mouvement et d’activité.
Chapleau est déjà un grand village, agréablement situé aux bords du lac Kinogama, et deviendra bientôt une ville florissante.
Une première journée en chemin de fer est toujours fatiguante, et je trouve mon lit si bon que je m’y suis endormi instantanément ; et quand je me suis levé, le 18 mai, il n’était pas loin de 8 heures.
Tout en dormant nous avons fait une course de trois cents milles ; et si nous ne regardons qu’à droite, nous n’avons pas changé d’horizon. C’est toujours la solitude, la nature sauvage, un entassement de rochers, des arbres rabougris sur des sommets ravagés par le feu, des montagnes tantôt boisées et tantôt nues, entrecoupées de petits lacs et de torrents.
Mais si nous jetons les regards à gauche, l’aspect est tout autre, et le contraste tire l’œil.
Ce sont de larges échappées de vue sur une véritable mer intérieure, des promontoires escarpés, des îles boisées en forme de cônes, de pyramides et de châteaux-forts. Ce sont des baies ravissantes où des flots clairs laissent voir de grandes roches d’azur, et des lits de sable rougeâtre. Qu’il ferait bon s’y baigner, semble-t-il ! Mais gare aux crampes ! Car il paraît que cette eau est absolument glacée.
Dans ma chère Malbaie, où les bains sont aussi excessivement froids, on raconte qu’une de nos plus loquaces baigneuses a été prise d’un tel frisson, après un bain au Cap-à-L’Aigle, qu’elle en est devenue muette. Depuis lors un grand nombre de maris y mênent leurs femmes, dit-on.
La côte nord-est du Lac Supérieur offrirait sans doute les mêmes chances, et les touristes mariés y viendront plus tard ; mais aujourd’hui les seuls touristes qui fréquentent ces rivages déserts sont les goëlands et les poissons — ceux-ci mangés par ceux-là.
Nous circulons au milieu d’énormes blocs de granit rouge et gris, décrivant des arcs, des S, des courbes en tout sens. Nous courons sur le versant des monts, sous les rayons du soleil matinal ; nous descendons au fond des anses pour entendre chanter les flots sombres, bordés d’écume blanche ; puis, nous remontons sur les cimes pour découvrir les horizons infinis du grand lac. Ici un immense viaduc nous fait traverser des ravins à plus de cent pieds au-dessus du sol ; là nous perçons les rochers, et nous nous enfonçons dans des tunnels ténébreux ; plus loin nous faisons halte au fond d’une rade sauvage où vivent quelques hommes aussi sauvages qu’elle dans des huttes en bois rond. Ce sont des pêcheurs sans doute, et leur existence isolée n’est pas sans charme quand vient la belle saison.
Ces rives de notre mer intérieure me rappellent beaucoup celles de la Méditerrannée, et le chemin de la Corniche, avec cette différence qu’ici la civilisation n’a pas encore transformé la nature. Mais elle y viendra, et déjà l’œuvre de transformation est commencée.
Voici Schrieber, ville naissante, que la Compagnie du Pacifique a jetée ici en pleine sauvagerie, et qui sera peut-être une grande ville dans vingt ans. Déjà elle empiète sur la forêt, et elle ouvre des routes vers l’intérieur. Déjà plusieurs clochers dominent ses boutiques, ses ateliers, ses cottages ; et sur une petite colline isolée je vois s’élever une chapelle en bois desservie par un Jésuite.
C’est ainsi qu’on retrouve partout la religion, au couronnement comme à la base de toute fondation.
Après Schrieber, où nous avons déjeuné, tout le monde est disposé à causer, et les gais propos vont leur train — un train de chemin de fer.
Un excellent chanoine, dont la santé est florissante et joviale, contribue à l’amusement par ses histoires et ses chansons. Mais hier soir il était indisposé, et vu son embonpoint et ses belles couleurs personne n’en avait pitié.
Ses amis intimes cherchaient la cause de sa maladie, et l’attribuaient les uns aux émotions violentes du départ, les autres à ses jeûnes et privations, d’autres encore à la consommation qu’il fait du tabac à priser.
Quoiqu’il en soit, tout le monde s’intéressait à son sort, et pour augmenter encore l’intérêt qu’on paraissait lui porter le malin chanoine parla de faire son testament.
Nous fûmes bientôt une dizaine autour de son lit sollicitant des legs particuliers. Quant au R. P. Lacombe il disait : « Moi, je suis habitué à vivre de peu, je me contenterai d’être légataire universel ! »
Pour ma part, je tenais à quelques agneaux et à certaines génisses dont il m’avait parlé avec tendresse, et que j’aurais expédiés dans mon ranche de Pincher Creek.
— « En tout cas, lui disais-je, comme chroniqueur de l’excursion il me faudrait quelques incidents dramatiques, et je vous serais obligé si vous vouliez bien mourrir un peu tragiquement. »
— Je comprends cela, me répondait-il, et je vais faire en sorte que vous soyez content de moi.
Tous les légataires en expectative se sont retirés contents. Mais, ce matin, notre gai chanoine s’est levé plus gras et plus rose que jamais, et tous nos rêves de fortune sont devenus des rêves de Perrette !
Notre convoi roule toujours sans se lasser, et nous faisons le tour de la baie Nepigon. Encore quelques tours de roues, et nous traversons, sur un beau pont en fer, la rivière du même nom, profonde comme un abîme, rapide comme un torrent. Quel regret de ne pouvoir s’arrêter ici, et remonter la rivière jusqu’au lac Nepigon, qu’ont fréquenté jadis les Bourgeois du Nord-Ouest et nos missionnaires ! Quelles émotions j’aurais à descendre en canot cette rivière aussi pittoresque que le Saguenay, avec mes anciens camarades Montagnais, Tienniche et Thomachiche !
Hélas ! je n’ai ni les loisirs ni les dollars des sportmen millionnaires, et dans tous mes voyages je ne fais qu’effleurer du regard maints endroits ravissants, où je voudrais dresser ma tente !
Toutefois, je ne me plains pas trop de mon sort. La vie est trop courte pour qu’on puisse voir toutes les beautés de la terre, si petite qu’elle soit, et il faut savoir en sacrifier un grand nombre.
En laissant derrière nous Nepigon, nous pouvons d’ailleurs contempler les superbes points de vue de la Baie du Tonnerre au fond de laquelle s’élève en amphithéâtre la jolie ville de Port-Arthur.
IVLA ROUTE DES LACS
De Montréal à Toronto. — La capitale d’Ontario. — Owen Sound. — À bord de l’Alberta. — Rengough et ses caricatures. — Sault Sainte-Marie. — Sur le Lac Supérieur.
Quand je suis venu ici pour la première fois, en 1889, Port-Arthur portait bien son nom : c’était un port véritable, non pas précisément fait par la nature, mais confectionné par le gouvernement du Canada. Une immense jetée construite à grands frais y protége, contre les grandes vagues du large, la baie trop ouverte, au bord de laquelle s’est élevée la nouvelle ville.
Mais ce port artificiel paraît avoir été abandonné, au moins par les steamers de la compagnie du Pacifique, et c’est maintenant Fort-William qui est devenu le terminus de la navigation des lacs.
C’est donc ici, aux quais de Port-Arthur, que les voyageurs qui avaient suivi la route des lacs, venaient, en 1889, rejoindre les trains du Pacifique en destination de l’Ouest.
Cette route des grands lacs est sans contredit la plus variée, la plus intéressante et en même temps la plus agréable — quand il fait beau.