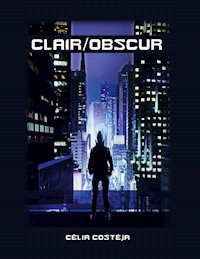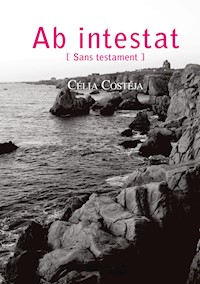
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
A la suite de la découverte d'un vieux journal intime, deux étudiants se lancent à la rechercher d'un livre perdu. Ce qui commençait comme une simple occupation de vacances se transforme peu à peu en une course obsédante dans laquelle les deux amis s'engouffrent, hantés par la figure d'un jeune homme mystérieusement disparu. Que s'est-il passé en cette veillée de Noël 1952 ? Quelle énigme se cache derrière ces quelques feuilles jaunies tirées de l'oubli ? Ce roman décrit un véritable cheminement personnel, une quête intérieure, douloureuse, celle du passage de l'adolescence à l'âge adulte, où les fantômes du passé viennent se mêler aux ombres menaçantes de secrets inavouables.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sommaire
PROLOGUE
Partie 1
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Partie 2
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
PROLOGUE
Bretagne, le 23 décembre 1952
J’ai peur… Chaque jour un peu plus. J’ai peur des sentiments et des pulsions qui m’assaillent. J’ai peur de ce démon qui m’habite et qui semble me gouverner. J’ai peur de cette main qui tremble et que je ne saurais retenir… Ne suis-je donc là que pour souffrir ? Faire souffrir ?
Cette vie m’est devenue insupportable. Chaque jour me frustre encore davantage. Chaque minute crispe mes nerfs jusqu’à l’épuisement. Je ne le supporte plus. Il m’est insupportable. Il va me falloir agir. Il va falloir que je me libère. Mais en aurai-je seulement le courage ? Aurai-je la force d’accomplir ce que mon esprit me dicte, me crie depuis si longtemps ? Vaisje enfin pouvoir aller au-devant de cette délivrance salvatrice à laquelle j’aspire en secret ?
Pourtant, le torturer chaque jour un peu plus me procure une jouissance délicieuse… Et cependant, je ne fais que contenir davantage ma rage et mon désespoir dans ce cynisme sans issue ! Il faut que cela cesse… En aurai-je la force ?…
Est-ce la meilleure solution ? Est-ce bien ce que je pourrais lui faire de pire ? Et si on m’en empêchait ? Et si quelqu’un décryptait en moi cette chose terrible qui me ronge depuis tant de mois, d’années ? Non, non ! Personne ne doit jamais savoir. Personne ne saura jamais.
Ce sera pour demain… Ou après-demain… Le temps que je me fasse à cette idée… Le temps de m’y habituer… Suis-je bien sûr ?… Je tremble seulement d’y penser… Mais je n’en peux plus ! Je dois me défaire de cette existence misérable, nuisible ! Je me dégoûte ! Je dois accepter mon échec ! Je ne suis pas celui qu’on pourrait croire ! Je ne serai jamais celui qu’on a cru ! Je vais laisser ce démon qui est en moi me submerger et m’engloutir. Ce sera le plus beau spectacle jamais vu ! Ha ! Ha ! Le plus beau déluge ! La mort la plus grandiose, la plus splendide, celle que je mérite et qu’ils méritent tous ! Mystérieuse. Sournoise. Et personne ne saura jamais. Le secret de famille le mieux gardé… Cette maudite famille qu’il nous faut préserver, hein ? Qu’elle aille au diable, avec tous ces requins ! Et moi avec ! Et qu’on me laisse en paix…
Tout devra disparaître avec moi. Jusqu’au souvenir de cette vie misérable… De cette vie que je hais ! Personne ne devra te pleurer, mon vieux ! Personne ne te pleurera jamais, JAMAIS !
J’ai peur… Seigneur… Aidez-moi ! J’ai peur de moi-même… De cet autre moi-même… Est-ce vraiment moi qui parle ? Ou est-ce encore lui ?
Que dois-je faire ?… Trouverai-je seulement le courage ?…
Me sauvera-t-on un jour ?
1
Chapitre I
Il devait avoir une vingtaine d’années environ. Sa posture était noble et fière et il tenait dans ses mains un livre épais. Il portait une veste sombre, qui masquait en partie un gilet de soie et une chemise blanche au col droit et large. Son visage, aux traits délicats, semblait dévoiler une personnalité sensible et honnête, rêveuse et fantaisiste. Ses cheveux bruns trop longs tombaient nonchalamment sur ses épaules et il y avait dans son regard comme un soupçon de mélancolie, de souffrance, peut-être. Ses yeux clairs, dans lesquels se reflétait une étrange lumière, fixaient un point de l’horizon hors de la feuille.
La photo était tombée du cahier lorsque je l’avais ouvert. C’était un de ces vieux clichés sépia datant du milieu du siècle, cerné d’une bordure blanche et dentelée que le temps avait jaunie. Les coins étaient légèrement cornés, mais l’image était d’une impeccable netteté. Un portrait énigmatique, égaré dans les méandres du temps... J’avais trouvé le mystérieux cahier dans ma boîte aux lettres le matin-même, en rentrant de mon jogging. Il était simplement accompagné de ces quelques mots : « Je suis tombé là-dessus chez grand-père. Appelle-moi quand tu l’auras lu. Nico. »
Je n’avais aucun indice sur le contenu du cahier, ni sur l’identité du jeune homme sur la photo. Cela ne m’étonnait pas de la part de Nicolas, j’étais bien habituée à ses jeux et à ses mystères. Peut-être avait-il pensé que je ne me donnerais pas la peine de lire, s’il me donnait la moindre piste. Ou peut-être me laissait-il tout simplement le plaisir de la découverte. Je souris devant sa petite mise en scène, le cahier négligemment glissé dans ma boîte aux lettres, accompagné d’un message délicieusement imprécis et du portrait d’un charmant inconnu…
Les femmes sont curieuses par nature et bien que Nicolas ne fût pas nécessairement un fin connaisseur en matière de psychologie féminine, un brin de flair lui suffisait pour savoir qu’une telle stratégie fonctionnerait !
Nicolas Thulins était mon meilleur ami. Nous nous étions connus à l’université, alors qu’il était le petit ami de l’une de mes camarades, Laura Manet. Leur relation s’était un jour brutalement interrompue, mais Nicolas et moi avions gardé contact, avant de devenir peu à peu de véritables complices. Nos factures téléphoniques en faisaient d’ailleurs souvent les frais. Nicolas était capable de m’appeler vingt fois par jour et de rester plusieurs heures à papoter au téléphone, chose assez inhabituelle pour un homme. Nous nous efforcions de nous retrouver le plus souvent possible, afin de nous raconter mille choses en détail et de partager nos découvertes autour d’un café ou d’un modeste repas, nos finances d’étudiants ne nous permettant pas le luxe des grands restaurants parisiens. Nous avions beaucoup de passions en commun : la Littérature (matière que j’étudiais), l’Histoire (celle qu’étudiait Nicolas), ainsi que la musique et un certain goût pour ce que nous avions coutume d’appeler « l’aventure ». Nicolas était par ailleurs un excellent pianiste, ce qui l’avait longtemps fait hésiter entre la musique et l’Histoire.
Il était le fils unique d’une famille très aisée, ce dont il ne se vantait jamais. Il semblait par moments avoir gardé quelques séquelles d’une enfance trop gâtée, mais cela m’amusait plus qu’autre chose. J’aimais bien son côté enfantin et immature. Les hommes ont toujours cette fâcheuse manie de chercher une mère en chaque femme qu’ils rencontrent et de ne jamais sembler pouvoir se débrouiller tout seul. Nicolas n’échappait pas à cette règle. Depuis le début de ses études, il habitait seul dans un appartement du VIIe arrondissement de Paris, que ses parents lui avaient offert, en toute simplicité, pour ses dix-huit ans ! Ils savaient soigner leur unique petit ange…
Les relations entre Nicolas et sa famille n’étaient pourtant pas perpétuellement au beau fixe. Chez les Thulins, la tradition voulait que l’on soit médecin de père en fils, et se détourner de « la voie royale » ne pouvait manquer de poser problème. Dans un premier temps, la famille de Nicolas semblait avoir mal accepté les orientations universitaires de leur unique héritier, mais celui-ci avait su trouver les arguments nécessaires pour les convaincre et imposer ses choix.
Je partis immédiatement me rafraîchir sous la douche, délaissant un instant le mystérieux cahier. Que pouvait-il bien renfermer de si extraordinaire ? J’étais curieuse de découvrir ce que cachaient ces vieilles feuilles. Je me préparai rapidement et m’installai aussitôt sur mon canapé.
Le cahier ressemblait à ceux qu’utilisaient nos grandsparents à l’école, avec ce papier sombre et ces lignes discrètes pour guider les plumes incertaines des jeunes élèves. Les feuilles, épaisses et poussiéreuses, semblaient pourtant fragiles sous mes doigts et je pris beaucoup de précaution en tournant les pages. Je goûtai un instant ce toucher si particulier qui donne tout leur charme aux vieux papiers, puis remarquai les premières lignes écrites à l’encre noire, d’une écriture ronde et enfantine. La feuille était datée du 26 juin 1947, et je pus lire :
« Bonjour ! Je m’appelle Alexandre. Aujourd’hui, il m’est arrivé quelque chose d’extraordinaire : j’ai reçu mon premier prix de piano ! J’étais très anxieux avant l’audition, mais la peur est passée dès que je me suis assis au piano et que j’ai commencé à jouer. Comme si la grâce m’avait touché ! Mes parents et mon grand frère Constant étaient présents dans la salle et je crois qu’ils avaient encore plus le trac que moi ! … »
Constant… n’était-ce pas le prénom du grand-père de Nicolas ?
Le récit se poursuivait, dans le même style un peu naïf, mais on sentait de la part de l’auteur une recherche constante de poésie et de lyrisme. Chaque phrase y semblait étudiée et construite avec soin. J’appris bientôt que l’auteur de ces lignes avait douze ans et je saluai intérieurement une telle maîtrise chez un enfant de cet âge.
Alexandre racontait sa vie paisible dans une famille bourgeoise au milieu du vingtième siècle. Il habitait une grande propriété au sud de Paris avec son père qui, bien entendu, était médecin, sa mère et son frère Constant, de onze ans son aîné. Le garçon s’attardait surtout sur les nouveaux morceaux de musique qu’il découvrait et les nombreux livres qu’il lisait. Il admirait Frédéric Chopin, Victor Hugo et les tableaux d’artistes comme Kaspar Friedrich ou William Blake, qu’il découvrait dans ses livres scolaires. Il paraissait être un enfant assez solitaire, trop écrasé, peut-être, par la rigueur familiale. Il parlait toujours de ses parents dans les meilleurs termes, même lorsque les années d’adolescences arrivèrent. Son père et sa mère avaient l’air de beaucoup l’encourager à laisser s’exprimer ses nombreux talents artistiques. Leur plus jeune fils ne semblait vivre qu’en compagnie de musique et de livres, sans cesse avide de découvertes et de nouvelles fictions pour décorer son quotidien.
Au fur et à mesure que les récits se succédaient, son style se faisait plus fluide. Il contait sa vie comme une histoire fabuleuse à laquelle il prenait part. Et la lectrice que j’étais se laissait volontiers emporter par le flot de la narration.
Septembre 1951. Alexandre entrait à la Sorbonne pour des études littéraires, en faisant le vœu secret de devenir écrivain. Il avait déjà écrit plusieurs poèmes, dont certains avaient été récompensés au lycée. Enthousiasmé par toutes ses lectures, il découvrait en chaque nouvel écrivain un modèle supplémentaire pour ses propres œuvres. En septembre de l’année suivante, il assista à la soutenance de thèse de son frère Constant, qui devint alors à son tour médecin. Alexandre se montrait fier de son aîné, qui l’avait sans doute délivré du poids de suivre la profession de tant de ses aïeux ! De son côté, le jeune artiste recevait l’encouragement de ses professeurs de Lettres, et les blâmes de son professeur de piano, un certain monsieur Julien, parce que les études avaient peu à peu forcé le jeune prodige à délaisser la musique !
Mais Alexandre, n’écoutant que ce qu’il voulait bien entendre, ne se souciait guère de ces obstacles. Il écrivait plus que jamais, en vers, en prose, en s’excusant parfois auprès de son journal, qu’il ne pouvait plus tenir avec la même assiduité. Son style avait incroyablement mûri. Je m’attristais secrètement qu’il n’eût pas pris le soin de citer quelques-unes de ses œuvres. Toutes les portes lui semblaient désormais ouvertes. Il n’avait plus qu’à les franchir.
Mais les Dieux sont souvent jaloux des présents qu’ils nous offrent. En novembre, ses parents mourraient dans un accident de voiture, non loin du domicile familial. La perte fut terrible pour le jeune homme. Son écriture se teinta alors d’un réalisme cruel, puis la colère et la peine semblèrent avoir troublé son âme à tel point qu’il était parfois impossible de le suivre dans ses pensées : il passait sans cesse d’un sujet à l’autre, partant d’une idée sans jamais prendre la peine de mener sa réflexion jusqu’au bout. Il associait des mots sans lien apparent et les juxtaposait comme au hasard. Recherchait-il des sonorités nouvelles, comme un Mallarmé un peu fou ?
Et puis, tout d’un coup, l’écriture devint illisible. L’encre avait pâli, comme si de l’eau avait coulé sur les feuilles ou tout simplement par la malédiction du temps. J’approchai le cahier de la lumière, mais ne pus lire davantage. Seuls quelques mots, par-ci par-là, demeuraient déchiffrables. Je parcourus le cahier jusqu’à la fin, mais au bout d’une vingtaine de pages, le récit s’arrêtait brusquement.
Qu’était-il arrivé ? La dernière date lisible était celle du 28 octobre 1952. Qu’était devenu le jeune homme après la mort tragique de ses parents ? Alexandre avait-il délibérément arrêté son journal pour se consacrer à ses œuvres ? Et comment se faisait-il que Nicolas n’ait jamais mentionné un tel personnage, qui avait de surcroît suivi un parcours si semblable au sien ?
Alors que je m’apprêtais à me lever, mon regard se reposa sur la photo. Ce visage prenait une tout autre signification à présent. Était-ce Alexandre ? Très probablement. En regardant avec un peu plus d’attention, je décelai une certaine ressemblance entre ce jeune homme et le père de Nicolas, ou Nicolas lui-même. Je percevais mieux cette mélancolie et cette souffrance, le jeune homme de la photo me parut encore plus distant, perdu dans des pensées que je devinais tristes et sombres.
Un bruit dans la rue me tira brutalement de ma rêverie. Le moment était venu de faire parler l’instigateur de tous ces mystères. Je composai le numéro de téléphone de mon ami à toute vitesse, sachant qu’il devait attendre mon appel en tournant comme un ours en cage. Mon intuition ne m’avait trompée, Nicolas décrocha dès la première sonnerie.
— Marina ?
— Tiens, tiens ! Tu dormais sur ton téléphone ? plaisantai-je.
— Tu as trouvé le cahier ? Tu l’as lu ?
Sa voix trahissait son excitation et son impatience. Un vrai gamin à qui l’on a promis une surprise et qui ne peut attendre.
— Bonjour, Nicolas, tout d’abord ! poursuivis-je sans le moindre scrupule. Oui, je viens juste de terminer.
J’aurais bien pu maintenir le suspense plus longtemps mais il ne faut jamais plagier ses amis, surtout dans leurs plus beaux défauts !
— Alors ? Qu’est-ce que tu en penses ?
Je n’arrivais pas à comprendre un tel empressement. Que se passait-il donc ? J’avais tant de questions et de remarques à faire que je ne savais par où commencer.
— Pas grand-chose, dis-je bêtement. Qu’est-ce qu’on peut bien penser du journal intime d’une personne dont on ne sait rien ? Je n’ai pas tous les éléments en main, moi !
— Moi non plus, Marina, rétorqua-t-il.
Il y eut un grand silence. J’avais commencé sur le ton de la plaisanterie, mais quelque chose dans le ton employé par Nicolas me disait qu’il prenait tout cela beaucoup
plus au sérieux.
— Comment ça, toi non plus ?
— Moi non plus, répéta-t-il, pour la bonne et simple raison que, jusqu’à hier, je n’étais pas au courant que mon grand-père avait un frère.
Cette fois, ce fut moi qui me tus.
— Tu veux dire que personne ne te l’avait jamais dit ?
— Non, et il y a pire que ça. Mon père ne le savait pas non plus. Ça n’a même pas eu l’air de l’intéresser.
J’aurais pu aussi bien lui dire que j’étais une fille, ça lui aurait fait le même effet !
Je comprenais mieux sa surprise. Sa voix suppliante résonna à nouveau dans le combiné :
— Marina, j’aimerais vraiment en discuter avec toi, si ça t’embête pas. Ça m’a un peu retourné, tout ça. Tu viens manger à la maison ?
— Ça marche ! répondis-je aussitôt. J’apporte des pizzas, ça te va ?
— S’il y a des champignons, ça me va toujours ! Et moi, je m’occupe du dessert ! Son ton était redevenu normal. Peut-être était-ce
l’évocation des pizzas.
— J’arrive tout de suite ! lui lançai-je avant de raccrocher précipitamment.
Mon ami me paraissait anormalement soucieux et j’avais hâte de pouvoir connaître toutes les raisons de son agitation. Un grand-oncle inconnu… À première vue, ça n’avait rien de bien dramatique, mais comment expliquer un tel silence de la part de sa famille et un tel désintéressement de la part de son père ? Je ne pris pourtant pas le temps de cogiter. Nicolas m’attendait, il était inquiet et je ne pouvais pas le faire attendre. Je mis le journal d’Alexandre dans mon sac et me ruai aussitôt vers la station de métro.
Chapitre II
Dès mon arrivée, Nicolas se précipita vers moi, sans prendre la peine de m’embrasser :
— Tu en as pris une aux champignons, au moins ?
Je me sentis rassurée par le ton qu’il employait et ignorai sa question.
Je remarquai qu’il avait pris la peine de ranger son appartement, ce dont je le félicitai immédiatement. Il avait légèrement tiré les rideaux pour contrer les rayons du soleil, ce qui rendait l’atmosphère plus mystérieuse, idéale pour discuter d’un journal intime oublié. Je m’installai sur son canapé et posai les cartons à pizzas sur la table basse. Nicolas prit place en face de moi et me fixa d’un air interrogateur, détournant un instant son attention du fameux met italien qui embaumait toute la pièce. Il portait une chemise à manches courtes écrue avec de fines rayures roses que j’aimais bien. Le col était déboutonné et je distinguai la fine chaîne en or qu’il portait toujours autour du cou. Elle avait autrefois appartenu à sa grand-mère et il ne s’en séparait jamais. C’était pour lui une sorte de talisman, une protection contre toutes les menaces, réelles ou imaginaires.
— Je suis content que tu sois venue, me dit-il avec une sorte de tendresse fraternelle. Cette histoire m’a complètement chamboulé, je ne sais vraiment pas quoi penser.
— Tu n’as pas encore pu questionner ton grand-père ? demandai-je.
— Non, il rentre seulement aujourd’hui de voyage. Tu sais, il a fait le tour du monde avec son Club.
Je ne savais pas. Mais je fis tout comme.
Je sortis le cahier de mon sac et regardai un instant la photo.
— Tu penses que c’est lui ?
Nicolas hocha la tête.
— Mouais. J’ai d’abord cru que c’était grand-père. Avant de lire le journal.
Je confirmai certaines similitudes entre Alexandre et mon ami, quelque chose dans le regard ou peut-être le port de tête, même si Nicolas avait les cheveux blonds et bouclés, toujours en bataille autour de son visage au milieu duquel brillaient deux grands yeux bleu azur, sans cesse préoccupés ou rêveurs.
— Il y a quand même une ressemblance, fis-je, en reposant la photo.
Il eut un sourire distant. Apparemment, mon compliment ne l’avait pas atteint. Je pris ma première part de pizza et l’invitai à tout me raconter depuis le début. Pour ce genre de choses, en général, il ne se faisait pas prier.
— Eh bien, voilà : hier, je suis allé chez mon grand-père pour lui emprunter quelques bouquins, il en a des centaines et de tous les styles. J’aime surtout y aller quand il n’est pas là ̶ ça m’évite de l’avoir sur le dos sans arrêt pour me donner des conseils ou me raconter toujours les mêmes histoires en long, en large et en travers. Une fois là-bas, j’ai eu envie d’aller fouiller dans le grenier. J’adore regarder dans les vieilles malles, retrouver plein de vieux trucs qui ont appartenu à mon père ou à mes grands-parents. Ça t’aide à te rappeler que tu es jeune mais que le temps file, et en même temps, ça me donne l’impression de communiquer avec le passé (petit réflexe d’historien !). Mon grand-père est un vrai conservateur, il a gardé des tonnes de trucs appartenant à ses grands-parents à lui, t’imagines ? Des objets du XIXe siècle ! Enfin, bref, j’ai fouillé un moment et j’ai dégoté une vieille malle dans laquelle il y avait des livres scolaires du début du siècle et des cahiers d’école de mon père et mon grand-père. Quand j’ai voulu ranger, j’ai remarqué un cahier que je n’avais pas encore vu. Je l’ai ouvert et c’est là que j’ai trouvé la photo. J’ai d’abord cru que c’était grand-père, et puis, j’ai commencé à lire. Je n’ai pas pu bouger jusqu’à ce j’ai tout lu. Combien d’heures je suis resté assis là, j’en sais rien. Tout ce que je peux dire, c’est que j’avais les jambes et l’esprit complètement engourdis quand je suis revenu à la réalité.
Tu parles d’un choc ! J’ai carrément halluciné…
Nicolas avait retrouvé un air mélancolique comme s’il avait revécu la scène en me la contant. Son regard se perdait dans le vide comme celui de son mystérieux ancêtre.
— Tu en as parlé à ton père et tu dis qu’il ne savait rien ?
— Non ! Mais je ne sais pas s’il a vraiment réalisé. Il a dû croire que j’avais bu et ça avait plutôt l’air de l’emmerder que je lui parle de ça. Pourtant, un scoop sur la famille c’est assez rare !
Je souris devant sa remarque. Je connaissais peu monsieur Thulins, mais il n’avait effectivement pas l’air d’avoir un tempérament « sanguin ». Il était plutôt du genre mollasson, toujours dans la lune, et il alignait rarement plus de trois mots à la suite. En cela, Nicolas avait plutôt hérité de sa mère, qui était une vraie pipelette…
— Nicolas, fis-je en avalant, après tout, ce n’est pas si grave …
— Pas si grave ! coupa-t-il. Si tu avais eu un frère comme lui, tu en aurais parlé à tes enfants, non ? Et puis, qu’est-ce qu’il est devenu ? Il est mort ? Il s’est volatilisé ? Je veux savoir, moi ! Je dois savoir…
Il avait sans doute raison. Pourquoi avoir caché cela ?
Alexandre semblait avoir beaucoup de points communs avec Nicolas : le piano, la musique, certains aspects de sa personnalité. Je ne pouvais m’empêcher de penser qu’une main invisible l’avait conduit jusqu’à cette malle, que son ancêtre l’avait choisi pour refaire surface, lui, le seul qui avait su ébranler les antiques conventions familiales. Je le regardais, à nouveau perdu dans ses pensées, et l’imaginais en veste sombre, gilet de soie et chemise blanche à col droit et large, comme le jeune homme de la photo. Le même air rêveur, pensif, mais avec une intensité dans le regard qui ne pouvait se confondre avec de l’oisiveté. Nicolas avait trouvé en Alexandre une sorte d’alter ego, un frère imaginaire. Que s’était-il passé ? Pourquoi Alexandre avait-il subitement arrêté d’écrire ? Une seule réponse semblait s’imposer.
— Il est mort, sans doute, m’entendis-je soudain murmurer.
— Bien sûr qu’il est mort ! railla Nicolas. Et assez tôt, si on en croit le journal.
Il prit le cahier et le feuilleta machinalement.
— Quel dommage que la fin soit illisible, se lamenta-t-il.
J’approuvai d’un signe de tête. Nicolas se leva alors brusquement et se mit au piano, comme guidé par une force intérieure. Il joua un air plaintif, du Tchaïkovski, me sembla-t-il lire sur la partition. La musique enveloppa la pièce d’une sorte de brume magique. Nicolas laissa ses doigts traîner sur le dernier accord, tout en regardant devant lui, absorbé par des visions secrètes. Cette imperceptible tristesse l’habitait depuis sa rupture avec Laura, même s’il savait bien la cacher derrière un sourire forcé. Il m’était difficile de décrire la tendresse que j’éprouvais pour ce garçon. J’avais toujours senti en lui une détresse affective, comme un abandon. Il parlait peu de lui, ce qui en disait parfois beaucoup plus long que des paroles. Ce n’était pas étonnant que la découverte de ce journal l’ait perturbé de façon démesurée.
— Tu as raison, dis-je, en suivant le cours de mes pensées. Pourquoi cacher l’existence d’un frère tel que lui ?
Nicolas me regardait attentivement et je vis briller dans ses yeux une lueur nouvelle.
— Ça, me répondit-il, il n’y a qu’une seule façon de le savoir !
Il vint s’asseoir près de moi, comme pour m’empêcher de fuir.
— Et tu vas m’accompagner !
Je savais bien ce qu’il avait en tête. C’était en effet la seule solution. Une seule personne savait. Son grandpère, Constant Thulins.
— Tu ne crois pas que c’est un peu brutal de débarquer chez lui et de lui poser toutes ces questions ? raisonnai-je.
S’il n’a rien dit, c’est qu’il avait une raison…
— … qu’il ne peut plus cacher maintenant ! coupa Nicolas. Je sais que ça risque d’être douloureux pour lui mais je n’ai pas le choix. Alexandre ne me laisse pas le choix.
C’était si curieux. Il parlait d’Alexandre comme d’un être encore vivant, comme si le mort réclamait un sursis pour
les années d’oubli passées au fond de cette malle.
Je savais qu’il était inutile de contrarier Nicolas et que rien ne le ferait changer d’avis. J’aurais bien aimé éviter cette petite visite chez son grand-père mais je comprenais à quel point cela lui était difficile de faire la démarche seul. Ma présence lui donnerait du courage et je ne pouvais pas l’abandonner.
—- Tu comptes faire quoi ? lui demandai-je.
Il se leva d’un bond.
— L’appeler, tout bêtement, dit-il en se dirigeant vers le téléphone et en jetant un coup d’œil à sa montre. Il doit être rentré de voyage maintenant.
Je le regardai décrocher le combiné et composer le numéro sans bouger. Pourtant, j’aurais voulu trouver la force de retenir son bras en cet instant, comme si un doute superstitieux m’avait soudain effleurée. Mais j’étais comme clouée au canapé, et je contemplais, impuissante, la mise en marche des événements.
— Grand-père ? C’est Nicolas. Tu es bien rentré ?
Je suivais les moindres expressions sur le visage de mon ami, comme pour y lire les réponses de cet homme que je ne connaissais pas. Un médecin retraité, sévère et droit, membre d’un Club très chic. Un vieil homme qui portait en lui la réponse à toutes nos questions.
— Oui, je me disais qu’on aurait pu passer demain avec
Marina, ça t’ennuie ?
Demain ? Déjà ? Pas le temps de se retourner. Plus le temps de se défiler. Trop tard !
— Parfait ! Je te rapporte quelques bouquins ! À demain !
Il raccrocha.
— Et voilà ! me lança-t-il satisfait. Prête pour demain ?
— Il faut bien, répondis-je sans enthousiasme. Le système est en marche.
Il me regardait en souriant, décelant sans doute mon appréhension.
— Tu as peur ?
—- Je ne sais pas, soupirai-je. C’est peut-être un peu périlleux de réveiller les morts.
— Quel pessimisme ! On verra bien. Mais au moins, on saura.
— Et si ton grand-père refuse de parler ?
—- Il ne pourra pas refuser. Il sera piégé.
Cette idée ne me plaisait pas. Débarquer chez un pauvre vieil homme pour le piéger !
— Tu es injuste Nicolas, tu ne vas là-bas que pour l’interroger comme un coupable, alors qu’il t’attend sûrement avec impatience, comme tout grand-père qui reçoit son unique petit-fils après un voyage !
— Oh ! Ne lui prête pas plus de sensibilité qu’il n’en a, va !
Je le regardai, interloquée.
— Pourquoi tu dis ça ? Il est si terrible que ça ?
— C’est… un Thulins.
— Ah…
Nicolas rit devant mon air anxieux.
— Eh, t’en fais pas ! lança-t-il. Il va pas te manger ! Il est juste… un peu vieille école, les vieux principes, le prestige, ce genre de trucs ! Il va sûrement te regarder de haut en bas, te poser dix mille questions pour mesurer ta culture et ton intelligence, mais à part ça, tout ira bien !
Je ne goûtai pas vraiment sa plaisanterie, mais il était vain de protester. J’étais moi aussi prise au piège.
— Tu ne veux pas venir ? demanda Nicolas, gêné.
— Si, répondis-je, sans conviction. Je viendrai.
L’incident était clos. Nous restâmes un instant sans rien dire, contemplant les restes de pizzas d’un air hagard, chacun perdu dans ses pensées.
Mais Nicolas ne demeura pas longtemps dans cet état de léthargie trop éloigné de sa vraie nature. Il se redressa brusquement et sans prévenir, il s’écria :
— Et maintenant, deuxième étape ! Après sa vie, ses œuvres !
Mon air consterné parut l’amuser et la bonne humeur me regagna à mon tour.
— Ses œuvres ? répétai-je, sceptique. Mais on ne sait même pas s’il en a réellement écrit ! On ne connaît aucun titre et…
— Ra-bat-joie ! scanda-t-il. Tu cherches vraiment à me contredire par tous les moyens ! Tu l’as lu comme moi, non ?
Lu quoi ? Le journal ? Bien sûr, mais il ne donnait pas vraiment de réponse à tout ça.
— Tu n’as pas lu les dernières pages ? insista-t-il.
— Je ne lis pas l’encre invisible, moi ! rétorquai-je, un brin vexée.
— Eh bien, tu as tort !
Il se leva et me fit signe de le suivre. Il s’installa à son bureau avec le journal et alluma une lampe halogène. Je m’assis à côté de lui et le regardai tourner les pages à toute vitesse, ses yeux courant comme des fourmis affolées. Je me demandais ce qui avait bien pu m’échapper de si important dans mon rapide parcours du livre. Enfin, Nicolas pointa le doigt sur un bas de page.
— Tiens, me dit-il, lis !
Je pris le journal et le regardai attentivement à la lumière blanche de l’halogène. Je cherchai un mot, un indice. Et puis je vis, en bas de la page : « … mon premier livre… beaucoup de moi-même… publication. »
Nicolas jubilait.
— C’est dingue ! fis-je. Je dois être à moitié aveugle !
— Ou seulement à moitié attentive, corrigea-t-il.
— Ça ne veut pas dire que son livre a réellement été publié, mais tout espoir est permis. Tu as vu autre chose ?
— Non, mais il n’est pas trop tard !
Et nous reprîmes tout le cahier depuis le début, page par page. Sans succès. L’encre avait, par endroits, complètement disparu et nous ne pûmes déceler que quelques mots épars et sans grand intérêt. Mais l’essentiel était dit et notre aventure prenait soudain pour moi un nouvel intérêt. La découverte d’un livre était peut-être en jeu. Où se trouvait-il, s’il existait ? Toutes les suppositions les plus saugrenues me traversaient l’esprit. Le manuscrit se trouvait peut-être dans le cercueil de l’écrivain. Dans ce cas, où était-il enterré ? À côté de la maison familiale ? À l’autre bout du monde ? Qu’était-il arrivé à cet homme, auteur insoupçonné d’un livre englouti par le temps ? Car un livre ne vit que tant qu’on le lit. Comme un homme ne vit que tant qu’il reste d’autres hommes pour se souvenir et parler de lui.
Je sentis soudain qu’une autre personne avait été injustement oubliée dans cette histoire.
— Et ta grand-mère ? demandai-je à Nicolas. Comment était-elle ?
Mon ami parut surpris par ma question. Il se mit à réfléchir, comme pour forcer des souvenirs lointains à resurgir.
— Je ne l’ai pas très bien connue, me confia-t-il. J’avais quatre ans quand elle est morte. Mais je me souviens un peu d’elle, physiquement, surtout. Elle était petite, toute douce, avec une petite voix. Elle portait toujours un chignon bas sur sa nuque et un tablier noir.
Il s’arrêta.
— C’est con, les souvenirs ! poursuivit-il en riant. Le tablier noir, ça n’avait aucune importance, et pourtant, ce détail m’a marqué plus que tous les autres…
— De quoi est-elle morte ?
— D’un cancer. Ou d’un truc cérébral, je ne sais plus exactement.
Je souris intérieurement à l’idée que le descendant d’une si longue lignée de médecins ne fût pas capable de désigner la maladie qui avait emporté son aïeule par un terme un peu plus scientifique que « truc cérébral ». Je constatai qu’il ne semblait pas en savoir davantage sur sa grand-mère, qu’il avait connue, que sur son grand-oncle dont l’histoire venait de resurgir de façon inattendue. J’étais frappée par le manque de dialogue au sein de sa famille, même si ce n’était guère mieux dans la mienne...
Mes parents tenaient une auberge, La Transhumance, dans un petit village des Cévennes, L’Espérou. Ils n’avaient jamais beaucoup voyagé et le département voisin, c’était déjà le bout du monde ! Lorsque j’avais décidé de faire une classe préparatoire à Paris, ils m’avaient d’abord regardée avec incrédulité. Mais après tout, n’étais-je pas « l’intello » de la famille, comme ils se plaisaient tant à le dire ? Je vivais dans les livres, selon eux. Incapable de cuisiner, de reconnaître les champignons, d’arranger un feu de bois ou de planter la moindre graine. Et puis, la capitale, c’était dangereux, et loin. Pourquoi ne pas aller à Nîmes ou Montpellier ? Ils n’avaient pu comprendre que c’était là tout ce que je recherchais : l’éloignement et le danger, la nouveauté et un peu d’animation, moi qui avais grandi enfermée dans ma chambre avec des livres pendant que ma mère s’occupait de nos chèvres et que mon père partait ramasser des champignons. Ils auraient préféré que je reste au pays, pour les aider à l’auberge, pour que je me marie avec un jeune homme du coin, que j’ai des enfants, leurs petits-enfants, qui hériteraient du patrimoine. Et de mon côté, j’avais toujours rêvé de m’échapper, de partir à Paris, dans la capitale, ville de Lettres et d’Histoire. Je n’aurais jamais osé leur demander un tel sacrifice si j’avais su qu’ils n’avaient pas les moyens de financer mes études. Leur réticence ne concernait pourtant pas l’argent. Ils savaient que j’étais sérieuse, trop, peut-être, et vivre dans une grande ville leur semblait inconcevable. Ils m’avaient cependant accordé une année d’essai, afin de tester ma résistance à la pollution, au stress et au vacarme. J’avais été délivrée et je n’avais jamais émis le souhait de retourner à la montagne.
J’aimais pourtant les Cévennes. La nature y était belle et le rude climat me manquait parfois. Les soirées au coin du feu, la neige, le bruit du vent dans la cheminée et les craquements de l’escalier en bois… Mais la perspective d’une vie avec mes parents me paraissait inenvisageable. Mon frère aîné, Denis, avait beaucoup œuvré en ma faveur, car lui seul avait compris les rêves qui m’animaient. Lui-même était resté au pays où il était facteur. Il vivait toujours à l’auberge et ne semblait pas envisager d’en partir, malgré ses vingt-sept ans révolus. Mes parents avaient abandonné l’espoir de le voir se marier un jour et leur attention s’était donc naturellement portée sur moi. Quant à ma sœur Lydie, elle n’avait que quatorze ans et n’était pas encore consciente de son privilège de benjamine.
Nous étions au mois de juillet. Cette année, j’avais pris pour prétexte de terminer mon mémoire de Maîtrise afin de pouvoir rester à Paris un peu plus. J’aurais aussi bien pu travailler à l’Espérou où la chaleur était certainement bien moins désagréable que dans la capitale. Mais je n’avais pas trouvé le courage en moi pour me résoudre à faire le voyage. Et je savais aussi que Nicolas ne partait qu’au mois d’août et c’était une raison suffisante pour rester à Paris.
Il était plus de sept heures lorsque je pris congé de Nicolas. Nous avions beaucoup discuté au sujet de la visite du lendemain. Chacun de nous avait ses craintes et ses espoirs : pour Nicolas, la peur du refus ou de la colère d’un grand-père avec lequel il n’avait jamais pu communiquer, et pour moi, celle de ne pas être à la hauteur pour soutenir mon ami, ou pour faire face à l’aïeul sévère. Je comprenais l’empressement de Nicolas, son désir d’être accompagné pour la confrontation qui se préparait, mais j’aurais aimé pouvoir rester en dehors d’histoires de famille qui ne me concernaient pas. Et pourtant, je sentais que je n’avais pas le choix et qu’il me faudrait continuer, malgré tout, aussi loin que cela mènerait mon ami. Tel était mon rôle.
Chapitre III
Le matin suivant, je me réveillai très tôt, avec la curieuse impression d’avoir été hantée par des rêves étranges toute la nuit. Sachant que je ne pourrais plus me rendormir, je m’assis sur mon lit et regardai anxieusement les aiguilles se déplacer sur le cadran de mon réveil. Il me restait trois heures avant que Nicolas ne vienne me chercher pour aller rendre visite à son grand-père. Trois heures… Qu’allais-je donc bien pouvoir faire en attendant, à part tourner en rond ?
Je me sentais profondément mal à l’aise. J’étais totalement intruse dans cette histoire, et pourtant, je ne pouvais nier que j’étais monstrueusement curieuse de connaître la vérité sur Alexandre Thulins. Et si nous étions déçus par cet entretien ? Et si Constant ne nous apprenait rien ? Non, c’était impossible. Il savait. Il savait tout. Mais il ne parlerait peut-être pas.
Je m’accoudai un instant à ma fenêtre. La ville commençait à s’agiter en dessous de moi. Le trafic était déjà dense, des camions livraient, des enfants couraient et criaient. Paris, l’été. Vide et curieusement envahie à la fois. Témoin neutre de la vie de tous ces gens. Toujours majestueuse et grandiose. Si peuplée, et pourtant, si seule. N’était-ce pas moi qui étais seule ? Pourquoi n’étais-je pas rentrée chez mes parents ? Pourquoi rester dans la canicule et la pollution parisiennes, alors que j’aurais pu me prélasser au bord de la piscine, me promener avec mon frère et mon chien Tootsie ? Certes, il y avait le mémoire de Maîtrise. Une excuse parfaite pour rester plus longtemps à Paris.
J’avais maintenant peut-être une vraie raison de ne pas partir. Aurais-je pu m’éloigner avec toutes ces questions sans réponse ? Aurais-je pu laisser Nicolas gérer seul ce problème ? Non, j’étais son amie et il avait besoin de moi. Mais n’avais-je pas moi aussi besoin de lui, aujourd’hui plus que jamais ?
Le temps ne s’accélérant malheureusement pas, je mis la bouilloire en marche et tâchai de me préparer le plus lentement possible. Quelle pouvait être la meilleure tenue pour faire la connaissance de Constant Thulins ? Je devais faire bonne impression à un vieil homme distingué, très pointilleux sur les principes d’avantguerre. Je sortis une dizaine de tenues différentes de mon armoire, sans pouvoir pour autant me décider pour l’une d’entre elles. Trop court ! Trop jeune ! Trop kitsch ! Trop rétro ! Trop classe ! Je me décidai enfin pour une jupe mi-longue des plus simples et un T-shirt léger, assorti. L’essentiel était, après-tout, que je me sente à l’aise, surtout par la chaleur qui, déjà, menaçait. Le choix de la coiffure fut beaucoup plus aisé, relever mes cheveux étant presque une question de survie ! Je m’aperçus petit à petit que, tant bien que mal, l’heure tournait, et je fus bientôt soulagée d’apercevoir la voiture de Nicolas tourner au coin de la rue.
Il était à l’heure. J’imaginais qu’il s’était lui aussi levé de bonne heure et avait fait les cent pas devant son piano. Il me fit signe de descendre et je me précipitai d’un trait en bas des escaliers.
— Prête ? me lança mon ami par la fenêtre.
Que pouvais-je répondre ? Prête ou pas, je n’avais plus le choix. Je fis simplement un signe de tête qui pouvait à la fois signifier « oui », « non », « peut-être » ou « pas du tout ». Le soleil était déjà haut dans le ciel. Les vitres fermées et la climatisation à pleine puissance, nous nous mîmes aussitôt en route pour la maison familiale des Thulins. Le trajet allait durer une petite heure, j’avais donc un peu de temps devant moi pour me détendre… Ou pour alimenter davantage mon appréhension.
Nous sortîmes de Paris sans que l’un de nous ne prononce le moindre mot. Chacun semblait suivre le cours de ses pensées et l’apparente anxiété de Nicolas ne faisait qu’accroître la mienne. De quoi avais-je donc si peur ? J’allais être présentée au grand-père de Nicolas en tant qu’amie et quoi qui puisse se passer par la suite, je n’en serais nullement tenue pour responsable. Pourtant, j’aurais tout donné à cet instant pour descendre de la voiture et laisser mon ami poursuivre seul, et je m’en voulais de ne pas avoir eu le courage de dire « non » lorsqu’il était encore temps. Les raisons qui avaient poussé Constant Thulins à ne jamais parler de son frère n’appartenaient qu’à lui, et je ne pouvais m’empêcher de penser qu’elles devaient être bonnes. Un homme droit comme lui n’aurait jamais pris de telles décisions à la légère.
Nicolas brisa bientôt le silence, comme s’il avait lu dans mes pensées.
— Tu avais peut-être raison, Nina, commença-t-il. Ce n’est pas forcément une super idée de se jeter sur mon grand-père pour lui tirer les vers du nez. D’un côté, je meurs d’envie de savoir, et d’un autre, je ne peux pas m’empêcher de penser que j’aurais peut-être mieux fait de laisser le journal au fond de cette malle.
— Nicolas, tu prends tout ça beaucoup trop au sérieux. Attends de voir. Il n’y en a plus pour longtemps !
Il haussa simplement les épaules.
— T’as sûrement raison, encore une fois. Alors, j’irai jusqu’au bout.
Il me sourit.
— Et encore merci d’être venue avec moi !
Je lui rendis son sourire, sans conviction, et me perdis alors dans une contemplation passive du paysage.
Nous arrivâmes bientôt dans une petite ville coquette, où s’alignaient de charmantes villas en meulière. Nous contournâmes la place centrale avant d’emprunter une étroite ruelle pentue, qui menait à une grande maison en partie cachée par deux grands arbres au feuillage encore bien vert. Un lierre grimpait le long de la façade. Je remarquai une table et quelques chaises impeccablement rangées dans un coin du jardin, au bout duquel je distinguai une minuscule fontaine.
— C’est là, dit Nicolas.
La maison des Thulins. La maison où Constant, Alexandre et le père de mon ami avaient grandi. C’était là-haut, dans ce grenier, que le mystérieux cahier avait réapparu et que toute cette histoire avait commencé.
Nicolas arrêta la voiture devant le portail en fer peint en blanc et me précéda dans le jardin. Tout semblait parfaitement entretenu. Les haies étaient soigneusement taillées, les rosiers couraient le long des murs latéraux, délimitant ainsi la propriété. On entendait quelques oiseaux chanter et se perdre dans les branches, se cachant sous l’ombre des feuillages. L’endroit était charmant, si calme et reposant en comparaison du tintamarre des boulevards parisiens. Je fus pourtant vite réveillée de ma contemplation béate. Un bruit sourd me fit sursauter et me ramena immédiatement à la réalité. La porte d’entrée de la maison venait de s’ouvrir et Constant Thulins était paru sur le seuil.
C’était un homme grand et distingué, au regard dur et sévère. Mais la finesse préservée de ses traits montrait le vestige d’une grande beauté passée. Je fus immédiatement frappée par la ressemblance entre cet homme et Alexandre tel que j’avais pu le voir sur la photo. Je retrouvais en Constant les yeux bleus caractéristiques, ceux de Nicolas et de son père. Son sourire était coiffé d’une large et impeccable moustache blanche.
— Bonjour, petit prince ! s’écria-t-il en s’approchant de Nicolas.
Les deux hommes s’embrassèrent longuement et mon ami me présenta à son aïeul, qui me serra la main aussi chaleureusement qu’il put.
— Voilà la petite « sorbonnienne » ! s’exclama-t-il avec bienveillance. J’ai beaucoup entendu parler de vous et je suis heureux de pouvoir enfin vous rencontrer.
Je répondis par un sourire gêné, qui me parut un peu niais. J’eus cependant confirmation que rien n’avait autant d’importance pour Constant que le statut social, comme me l’avait annoncé Nicolas : n’avait-il pas vu en moi l’étudiante d’une université soi-disant prestigieuse plutôt que la meilleure amie de son petit-fils ?
Constant nous invita à entrer, disant qu’il ferait plus frais à l’intérieur, ce que nous crûmes volontiers. Il nous conduisit donc dans le salon, une vaste pièce sombre, malgré la présence de deux portes fenêtres. Nicolas paraissait très nerveux. Il respirait bruyamment et ne cessait de passer la main dans ses cheveux ébouriffés, comme pour se donner une contenance.
— Nicolas, intervint le grand-père, pourquoi ne montrerais-tu pas la bibliothèque à ton amie, pendant que je m’occupe des rafraîchissements ?
Le jeune homme ne se le fit pas dire deux fois, tant il voyait là un moyen efficace de retarder la confrontation avec son aïeul. Il me convia dans la pièce voisine tandis que Constant se retirait dans la cuisine.
Nous pénétrâmes dans une large pièce dont le haut plafond donnait presque le vertige. Deux pans entiers de murs étaient masqués par d’immenses bibliothèques en bois massif. Un tapis sobre et sombre recouvrait le sol. Sur le mur de gauche, je distinguai un cadre dans lequel je reconnus un diplôme de médecin datant de 1952. C’était celui de Constant Thulins, celui qu’Alexandre mentionnait dans son journal. Un divan et un fauteuil second Empire semblaient inviter le lecteur curieux à faire une petite halte et à se perdre dans les tourbillons de la lecture. De larges rideaux tombaient de part et d’autre de la fenêtre haute, l’étouffant sous le poids des tissus.
Si le jardin m’avait tout de suite plu, rien ne me parut plus austère que cette bibliothèque. Tout y était trop strict et militairement bien rangé pour inviter à la détente. Les bois assombrissaient la pièce, le divan semblait des plus durs. Il y manquait la chaleur de quelques coussins, d’une lampe à l’abat-jour coloré, de tableaux représentant des paysages capables de faire voyager par leur simple contemplation. Je m’approchai de l’une des bibliothèques et observai le rayonnage. Les étagères étaient couvertes d’éditions originales, de livres de médecine, d’anthologies diverses, dont la seule vue, il fallait bien l’admettre, ne pouvait que faire rêver une étudiante en Lettres, habituée aux livres de poche et aux éditions bon marché des presses universitaires. Je me perdis dans l’exploration de tous ces volumes, oubliant un instant l’endroit où je me trouvais, ainsi que le but de notre visite. La main de Nicolas m’agrippa brusquement et me tira de ma rêverie.
— Marina, je tremble de peur ! me confia-t-il à voix basse. Comment je peux amener le sujet ?
— Calme-toi, Nicolas, lui fis-je doucement. Je ne sais pas trop, tu pourrais lui dire un truc du genre…
— Alors, Marina, que pensez-vous de ma petite collection ?
La voix grave de Constant Thulins m’interrompit soudain et je ne pus que me tourner vers lui avec mon éternel sourire de godiche, essayant de paraître la plus naturelle possible.
— C’est impressionnant ! m’exclamai-je, d’un ton que je sentis forcé.
Il eut un sourire satisfait.
— Si l’un de mes livres vous intéresse, n’hésitez surtout pas à me le demander. Je vous le prêterais bien volontiers.
Je le remerciai le plus poliment que je pus, puis nous regagnâmes le salon. Plusieurs bouteilles de jus de fruit nous attendaient sur une table basse. Nicolas et moi nous installâmes sur le canapé, tandis que Constant nous servait. Il prit enfin place dans le fauteuil en cuir qui nous faisait face. Un silence embarrassé régnait dans la pièce, ce qui ne faisait qu’accroître notre anxiété.
— Eh bien, les jeunes ! Qu’est-ce que vous racontez ?
Nicolas se souvint alors qu’il était soi-disant venu pour rapporter quelques livres. Il les posa sur la table et échangea quelques paroles à leur sujet avec son grandpère. Je sentais que mon ami reprenait peu à peu confiance en lui. J’étais bien contente de voir que l’on m’avait un peu oubliée mais ce statut privilégié de « plante verte » ne dura malheureusement que peu de temps. Constant Thulins ne tarda pas à se tourner vers moi et à me bombarder de questions, auxquelles j’aurais, pour ma part, volontiers échappé.
— Vous êtes originaires des Cévennes, n’est-ce pas ? commença-t-il.
— C’est exact, fut la réponse la plus fournie que je pus lui donner. Accompagnée, bien entendu, du sourire le plus niais que j’avais alors en stock.