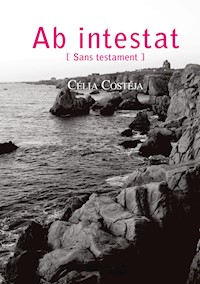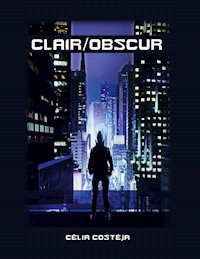Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le jeune Danny arrive de Seattle avec une bourse d’études pour le prestigieux Trinity College de Dublin. Il n’a qu’un seul rêve : devenir écrivain. Danny est convaincu que la terre de ses ancêtres sera une inépuisable source d’inspiration. Toutefois, son enthousiasme s’étiole dès qu’il retrouve son cousin Paul, brillant pianiste et personnage magnétique qui exerce sur tous uneétrange fascination. Entre attirance et répulsion se tisse une amitié aussi profonde que tumultueuse. À l’âge où les certitudes vacillent et tout est à construire, comment trouver sa place face à tant de perfection ? Danny perçoit pourtant de nombreuses fissures derrière le rempart savamment dressé par ce garçon mystérieux et inaccessible qui semble prêt à tout pour protéger ses secrets. Qui est véritablement Paul Kinsella ? Et quelles menaces pèsent sur lui ? Dans une Irlande à la fois authentique et romanesque, Second rôle nous convie à un voyage initiatique où l’apparence et le regard de l’autre ont trop de poids, la différence est forcément suspecte, la beauté est une malédiction.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
PREMIER MOUVEMENT
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
DEUXIÈME MOUVEMENT
Chapitre XIX
Chapitre XX
Chapitre XXI
Chapitre XXII
Chapitre XXIII
Chapitre XXIV
TROISIÈME MOUVEMENT
QUATRIÈME MOUVEMENT
Chapitre XXV
Chapitre XXVI
Chapitre XXVII
Chapitre XXVIII
PREMIER MOUVEMENT
Prélude, ou la partition indéchiffrable
« Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. »
Oscar Wilde
« Viens-tu du ciel profond ou sors-tu de l’abîme Ô Beauté ? ton regard, infernal et divin, Verse confusément le bienfait et le crime […] Que tu viennes du ciel ou de l’enfer, qu’importe, Ô Beauté ! monstre énorme, effrayant, ingénu ! Si ton œil, ton souris, ton pied, m’ouvrent la porte D’un Infini que j’aime et n’ai jamais connu ? »
Charles Baudelaire, Hymne à la Beauté.
« Nous faisons cas du Beau, nous méprisons l’Utile : Et le Beau souvent nous détruit. »
Jean de la Fontaine, Le cerf se voyant dans l’eau.
I
C’est alors qu’elle apparut devant moi : l’Irlande ! Aussi verte que dans mes souvenirs. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Je me sentais épuisé par ces lourdes heures de vol, mais l’émotion qui me submergeait semblait décupler le peu de force qui me restait. Enfin ! Enfin de retour, après dix longues années. Dix ans…
La mer d’Irlande était agitée. Le soleil se reflétait sur son immense lit sombre et dansant. Je regardais les vagues se briser sur les côtes rocheuses et je distinguai bientôt, au loin, la baie de Dublin. La ville aurait-elle beaucoup changé ? Y trouverais-je ma place ? Je l’espérais. J’étais tout disposé à replonger au cœur de mes racines après tant d’années d’exil. Venant de Seattle, état de Washington, une ville telle que Dublin ne pouvait me faire peur. Et pourtant… L’Irlande m’intimidait. J’en avais rêvé pendant des années, et c’était maintenant devenu une réalité. J’en tremblais de bonheur autant que d’appréhension. L’Irlande m’avait toujours appelé. Enfin je retournais vers elle. Vers le pays de ma mère…
Cette décision avait surpris autant qu’elle avait enthousiasmé mes parents. Moi qui étais d’habitude si réservé, si académique, voilà que je prenais, pour la première fois de ma vie, une initiative qui ne me ressemblait pas. Pourtant, j’avais nourri ce désir au fond de moi pendant dix ans, depuis nos dernières vacances en Europe, les meilleures de ma vie, me semblait-il. J’avais toujours su qu’un jour je reviendrais en Irlande pour explorer tous ces chapitres inconnus de mon histoire et me réapproprier cette autre partie de moi-même qui m’attendait depuis si longtemps. C’était écrit. Prémédité. Depuis le moment où, un an plus tôt, j’avais apposé ma signature au bas du formulaire d’inscription au séminaire du professeur Geoffrey Murphy à l’université d’art et de sciences de Seattle : Littérature irlandaise : contrastes et paradoxes. J’avais sauté sur l’occasion. Il me suffisait ensuite de terminer brillamment et d’obtenir une bourse d’études très convoitée pour le Trinity College de Dublin. Cela paraissait si simple, dit comme cela. Mon assiduité et ma motivation, associées à une bonne dose de chance, avaient été mes seuls mais précieux atouts. Mes parents avaient approuvé le choix du séminaire – ma mère en était même enchantée –, mais je m’étais bien gardé de mentionner la bourse. J’avais maintenu le secret jusqu’au jour où je trouvai dans la boîte aux lettres l’enveloppe bleu et rouge qui allait changer ma vie. Ma demande était acceptée ! Je partais en Irlande !
Ma mère s’était précipitée pour écrire à sa sœur et lui annoncer la nouvelle : son neveu avait obtenu une bourse d’études pour le Trinity College et il allait passer les deux prochains semestres à Dublin. Tante Mary avait aussitôt répondu qu’elle serait ravie de m’accueillir chez elle et je devais admettre que me retrouver dans un cadre familier et chaleureux me rassurait. Ma pauvre mère avait bientôt réalisé que son fils unique allait quitter la maison. Mon père, stoïque et pragmatique, se contenta de me taper sur l’épaule, fier de ma réussite, mais toujours aussi perplexe devant ce fils qui se passionnait pour la littérature et l’écriture, domaines si éloignés de ses préoccupations quotidiennes chez Microsoft. Mais qu’y pouvait-il ? Le bambin tenait de la mère irlandaise et personne n’était à blâmer. N’était-ce pas lui qui l’avait enlevée à cette île lointaine, où il était un jour allé donner une série de conférences ? Mon père n’était certes pas un grand romantique, mais il avait toujours rendu ma mère heureuse. Je ne lui reprochais qu’une seule chose : d’avoir transformé Miss O’Sullivan (nom si poétique !) en Mrs Jones (nom affreusement terne et commun, que j’avais par conséquent l’immense joie de porter moi-même !). Je m’étais juré de reprendre le nom maternel si j’étais un jour amené à publier des ouvrages littéraires… Car là était mon véritable objectif : je ne voulais pas me contenter d’étudier les grands auteurs, je voulais ÉCRIRE ! Et quelle meilleure terre d’inspiration que l’Irlande, contrée des bardes et des poètes ! J’avais commencé à écrire de médiocres poèmes étant enfant, d’autres terriblement noirs et souvent maladroits à l’adolescence, je n’avais encore trouvé ni mon style, ni mon genre de prédilection. De toute façon, je montrais rarement mon travail à qui que ce fût… Pourtant, je m’étais un jour lancé en acceptant de participer à un concours de poésie organisé par l’université de Seattle. J’avais préparé et présenté trois poèmes et, à ma grande surprise, j’avais remporté le premier prix. Rouge de timidité et la voix mal assurée, j’avais dû lire mon sonnet devant une assistance bienveillante de professeurs et d’étudiants. Moi qui aimais justement le côté solitaire et intime de l’écriture, voilà que je m’étais retrouvé sur une scène, devant des centaines de personnes. Je gardais bien évidemment un excellent souvenir de cette expérience pourtant terrifiante de premier abord et, sans rejeter ces poèmes de jeunesse, j’étais bien conscient qu’il me faudrait encore beaucoup de temps et de tâtonnements avant de trouver ma voie et la véritable inspiration. Ce retour aux sources était un moyen idéal de me mettre à l’épreuve et j’avais la ferme intention d’écrire un peu tous les jours pendant mon escapade irlandaise.
« Mesdames et messieurs, dans quelques instants, nous allons atterrir à Dublin. Vérifiez que votre ceinture est bien attachée, que votre tablette et votre siège sont relevés, et que vos bagages à main sont placés dans les coffres à bagages ou sous le siège devant vous… ».
L’avion pivota légèrement sur la gauche. Nous allions atterrir par le nord. Je regardai les vertes prairies qui s’étendaient à perte de vue et me demandai ce que cette nouvelle vie me réservait. Comment serait le College, les autres étudiants ? Est-ce que le fait d’être à moitié américain serait mal perçu, ou au contraire, un atout ? Me sentirais-je perdu devant tant de nouveautés ? Je n’étais jamais parti tout seul. Bien sûr, j’avais arpenté toute la côte ouest des États-Unis avec un bon groupe d’amis quelques étés auparavant, mais je n’avais jamais vécu loin de chez moi.
Je gardais quelques souvenirs confus de la maison de tante Mary. Je revoyais une bâtisse blanche qui me semblait à l’époque typiquement irlandaise, ou, en tout cas, proche de l’idée que je m’étais faite d’une maison irlandaise. De la moquette sombre dans toutes les pièces, de vieilles baignoires sans mélangeur, un escalier feutré au centre du hall d’entrée et ces fameuses vieilles fenêtres à guillotine, impossibles à ouvrir autant qu’à fermer ! Je revoyais aussi un grand jardin qui donnait, si mes souvenirs étaient intacts, sur un sentier menant à la mer. Nous allions souvent jouer sur cette plage, mes cousins et moi. L’aîné, Owen, avait déjà quitté la maison. Il s’était marié un an auparavant et travaillait désormais dans une banque. Le plus jeune, Paul, y vivait encore.
Paul et moi avions le même âge, et pourtant, j’avais toujours senti qu’un monde entier nous séparait. Aurait-il changé ? Je n’avais que quelques lointains souvenirs d’un garçon étrange et fascinant, ce genre de personnes que l’on ne peut s’empêcher de regarder et d’admirer en secret. Paul faisait partie de ces êtres qui en imposent tant et de façon si naturelle qu’ils nous renvoient irrémédiablement à nos propres doutes et à nos failles les plus profondes. Je gardais l’image d’un garçon silencieux, mais au regard perçant et intimidant. Des yeux bleus comme la nuit. Je me souvenais aussi qu’il jouait du piano. C’était en l’écoutant qu’avait surgi en moi l’envie d’apprendre la musique à mon tour. Je savais que Paul étudiait lui aussi à Trinity, au département de musique. Il serait sans doute mon premier guide dans les méandres de cette université mystérieuse et mythique. J’appréhendais un peu de le revoir après tant d’années. Paul avait toujours été pour moi comme un lointain modèle, idéalisé et irréel. Nous étions cousins mais nous savions si peu de choses l’un sur l’autre. Qui sait s’il ne se posait pas lui aussi les mêmes questions à mon sujet. Peut-être étais-je resté pour lui ce garçon timide et sage, qui se cachait bien souvent dans les jupes de sa mère. Il me tardait de tous les revoir et de profiter de ce temps privilégié ensemble.
« Cabin crew, take seat for landing, please! »
Lorsque les roues touchèrent le sol, je ne pus m’empêcher de penser que je vivais là l’une des premières grandes aventures de ma vie. Je rêvais de découvrir l’Europe, Londres, Paris, Amsterdam, Prague, Moscou ! Mais avant tout, je devais apprendre à connaître le pays de ma mère, cette terre verte qui m’attirait tant. Ironie du sort, l’Irlande est souvent surnommée « L’île émeraude » et Seattle « La ville émeraude ». Pas grand-chose de comparable entre ces deux lieux, pourtant. J’avais toujours cultivé mon originalité irlandaise auprès des gens de Seattle. C’était une particularité dont j’étais fier. Pourquoi alors n’y étais-je pas retourné chaque été, puisque j’y étais tant attaché, m’avaient demandé certains ? J’étais incapable de leur répondre. La peur, sans doute. La peur de gâcher un si beau retour.
« Mesdames et messieurs, nous venons d’atterrir à Dublin. Veuillez garder votre ceinture attachée jusqu’à l’extinction du signal lumineux et l’arrêt complet de l’appareil… »
C’était un rêve devenu réalité. Mesdames et messieurs, Danny Jones était de retour en Irlande !
♪: Morghan MeaghanLaurie Riley & Bob McNally
II
« Malgré tout ce froid mystère de son aspect et le plaisir apparent de rester indéchiffrable, il avait […] l’art de graver son souvenir dans le cœur des autres […] ceux qui le voyaient ne le voyaient pas en vain et l’avaient-ils vu une fois qu’ils le recherchaient encore. […] Nul ne savait comment ni pourquoi, […] une fois perçu, il y restait imprimé, qu’on l’aimât ou qu’on le haït. »
Lord Byron, Lara, Chant I.
Je fus l’un des premiers à sortir de l’avion, heureux de me dégourdir enfin les jambes après onze heures de vol depuis Seattle et une courte escale à London Heathrow. Je ne m’étais pas attendu à débarquer en Irlande sous un tel soleil, mais puisque la vie semblait me sourire tout entière, je la remerciai en silence et jurai d’en profiter. Au vu des prairies vertes que nous avions survolées, il était facile de comprendre que ce temps magnifique n’allait pas durer. J’empruntai une série de couloirs interminables où, déjà, les publicités de Guinness et de Jameson couvraient les murs. Au-dessus d’une porte, je lus une inscription étrange qui disait : Céad míle fáilte. Cela ressemblait à des vœux de bienvenue en gaélique. J’avais oublié l’attachement des Irlandais à cette langue bizarre et imprononçable, mais je me promis de faire des efforts pour en apprendre quelques phrases. Je réalisai soudain qu’il me faudrait aussi travailler mon accent pour ne pas être démasqué trop vite. Si je pouvais même parvenir à prendre un léger accent irlandais, ça ne serait pas pour me déplaire ! C’était simple : remplacer les « u » par des « o » ouverts, ajouter des « ch » après les « t », et surtout, ne pas prononcer les « th » à l’anglaise. Oui, règle numéro un : ne jamais rien faire comme les Anglais, ça, je m’en souvenais !
Après avoir fait la queue pendant plus d’une demiheure au contrôle des passeports, je parvins enfin au tapis de livraison des bagages, où je trouvai un chariot. Deux grosses valises avaient normalement suivi depuis Seattle, sans compter les nombreux paquets déjà livrés chez ma tante. La première valise arriva parmi les premières, mais la seconde se fit cruellement attendre. Je commençais à douter qu’elle ait quitté Heathrow ou même Seattle, lorsque je la vis apparaître, à mon grand soulagement. Pour la première fois, je sentis la fatigue m’envahir. Douze heures d’avion et huit heures de décalage horaire n’y étaient pas étrangères. Mais j’appréhendais surtout les retrouvailles avec la famille. Qui serait là à m’attendre ? Les reconnaîtrais-je après tant d’années ? Brandiraient-ils une pancarte avec mon nom ? C’est avec cette idée saugrenue en tête que je m’engouffrai dans le sas de sortie, le cœur battant.
Des dizaines de personnes attendaient de l’autre côté des barrières. Je commençais à penser que l’idée de la pancarte n’était pas si mauvaise, après tout. Je m’attardai un moment sur une dame avec les cheveux roux tenant un petit chien dans les bras, je cherchais désespérément une ressemblance avec ma tante… Non… Alors, peut-être…
— Danny !
On m’appelait ! Je me retournai et vis une petite dame aux cheveux blonds, le visage illuminé.
— Danny, c’est bien toi !
Tante Mary ! Je la reconnus instantanément. Les mêmes yeux doux et bienveillants que dans mon souvenir.
— Hello, tante Mary !
Elle me serra fort dans ses bras et scruta un instant mon visage qu’elle tenait entre ses mains.
— Heureusement que tu m’as reconnu, fis-je. J’étais un peu perdu !
— Oh, tu ressembles tellement à ton père que je n’ai aucun mérite ! Je t’ai reconnu dès que tu as passé la porte !
Elle m’embrassa à nouveau.
— Tu es chargé, dis-moi ! J’espère que tout ça rentrera dans le coffre !
— Moi aussi, parce que je ne me sens pas la force de faire rouler ces valises jusque chez vous.
Elle rit de bon cœur et me prit par le bras, tandis que je poussais le lourd chariot.
— Je suis si heureuse que tu sois là ! Cela faisait tellement longtemps ! Comment va Lynn ?
— Très bien ! Enfin, elle allait bien quand je suis parti.
— Félicitations pour ta bourse ! On est tous très fiers de toi !
Je la remerciai poliment. Ma tante était une femme très chaleureuse et je savais qu’elle serait comme une mère pour moi pendant ce séjour. Elle et ma mère avaient toujours été très proches l’une de l’autre et les deux sœurs échangeaient régulièrement de longues lettres, dans lesquelles je soupçonnais ma mère de raconter ma vie dans ses moindres détails.
Le parking de l’aéroport était balayé par un petit air frais qui me fit du bien. Je rêvais d’une bonne douche et d’une tasse de thé ! La voiture de ma tante nous attendait bien sagement. Le coffre était plus vaste qu’il ne paraissait à vue d’œil et mes deux valises finirent par entrer, en déployant un peu d’astuce et après plusieurs tentatives ratées.
C’est à ce moment-là que je fis ma première gaffe, indépendante de la fatigue qui me terrassait. Une fois les bagages rangés, je me dirigeai inéluctablement vers… le siège du conducteur !
— Tu veux la prendre ? se moqua gentiment tante Mary en me secouant les clés sous le nez.
Je ne pus que rire devant ma distraction et faire le tour du véhicule en maugréant :
— Ah oui… J’avais oublié que vous conduisiez à l’envers !
— Tu t’y feras vite, me rassura-t-elle. Nous avons deux voitures et dès que tu te sentiras de les prendre, elles seront à toi !
Je n’étais pas si confiant et songeai qu’il me faudrait des mois avant de savoir de quel maudit côté arrivaient les véhicules. Mais j’avais bien le temps de penser à tout cela ! Je m’assis confortablement à la place du passager et étirai péniblement les jambes. Le trajet ne serait pas long, ma tante habitait dans la petite ville de Malahide, au nord de Dublin, juste après l’aéroport. Elle prit bientôt un grand rond-point (à l’envers !) et tourna à gauche. Le panneau indiquait Mullach Íde et j’en conclus que nous étions presque arrivés.
— Tu te souviens du château ? demanda ma tante en me désignant une vaste allée au bout de laquelle se dressait un manoir gris et blanc.
— Je me souviens du fantôme, fis-je en riant. Pas grand-chose de plus.
— Tu pourras retourner le visiter autant que tu le veux, il n’est pas loin de la maison.
La route continuait tout droit et bientôt, la maison familière apparut en haut d’une petite côte, comme dans mes souvenirs.
— Paul n’est pas encore rentré, constata tristement tante Mary. Il m’avait pourtant promis qu’il serait là pour t’accueillir.
— Ce n’est pas grave, la rassurai-je, on aura bien le temps de se voir, il va devoir me supporter pendant un an !
L’absence de mon cousin m’attristait, pourtant. J’étais impatient de le revoir. Je comprenais bien que la vie ne s’arrêtait pas parce que le cousin d’Amérique débarquait, mais j’avais secrètement espéré un plus grand comité d’accueil. Ma tante manœuvra habilement et arrêta la voiture devant la maison. En ouvrant la portière, je m’imprégnai déjà de l’odeur lointaine de la mer. Je me débattis un moment avec les valises avant de suivre tante Mary dans la maison.
Tout était comme dans mes souvenirs : la moquette vieux rose et l’escalier abrupt, la cuisine sur la droite, le salonsalle à manger sur la gauche. Je ne reconnaissais pas les meubles, mais l’atmosphère n’avait pas changé. Tout invitait à se cocooner dans le canapé en dégustant une bonne tasse de thé et des cookies maison.
Tante Mary dut lire dans mes pensées puisqu’elle s’exclama aussitôt :
— Je vais te montrer ta chambre et ensuite je prépare le thé !
— Tout ce dont je rêve ! applaudis-je. Mais si tu permets, je prendrai d’abord une bonne douche !
— Tu es ici chez toi, mon neveu, fit-elle en me précédant dans les escaliers.
Je la suivis péniblement avec une première valise. L’étage avait peu changé, lui aussi. Les chambres étaient disposées autour de l’escalier, avec la salle de bain dans le fond. La chambre des parents sur la droite, et les deux autres sur la gauche. Je me souvins que celle de Paul avait vue sur le jardin et la mer. J’allais dormir dans l’ancienne chambre de mon cousin Owen, qui donnait sur le devant de la maison. Elle était petite mais cosy. Le grand lit sembla m’appeler, mais je ne devais pas encore dormir. Ma tante ouvrit l’armoire et m’invita à ranger mes affaires. Elle me laissa ensuite un grand drap de bain et se retira au rez-de-chaussée. Je pris quelques instants pour regarder par la fenêtre puis ouvris ma valise et en sortis ma trousse de toilette ainsi que des vêtements de rechange. En entrant dans la salle de bains, j’eus l’heureuse surprise de constater qu’une douche avait été ajoutée à côté de l’antique baignoire. Je fis immédiatement couler l’eau sur ma tête endormie. La chaleur m’enveloppa d’un voile bienfaiteur et je soupirai de bonheur. Je saisis la bouteille de shampoing et me frottai énergiquement la tête. Le parfum du savon était tonique et vivifiant et je restai quelques instants de plus sous le jet d’eau, sans pouvoir me résoudre à sortir de cet endroit salvateur. Puis, l’image d’une tasse de thé fumante me vint à l’esprit et je coupai le robinet en un clin d’œil. Le miroir embué me renvoya l’image d’un visage fatigué mais curieusement radieux. Je me souris bêtement à moimême et à ma barbe naissante, que je résolus de laisser en paix jusqu’au lendemain. J’avais presque l’air d’un jeune marin irlandais ! Il ne me manquait que les bottes, le pull et le bonnet en laine d’Aran. Sans oublier le bateau, bien sûr.
Des éclats de voix me tirèrent soudain de ma rêverie. Mon cousin avait dû rentrer et j’entendais comme une dispute au rez-de-chaussée.
— Ce n’est pas très gentil de ta part, disait Tante Mary. Tu aurais pu faire un effort !
— J’ai fait ce que j’ai pu, M’an, répondit une voix claire et assurée. J’avais des choses à faire, c’est tout !
— Oui, mais tu aurais pu les faire à un autre moment !
— Maman, Danny va rester là les douze prochains mois, j’aurai bien le temps de le voir, non ?
Paul avait utilisé les mêmes mots que moi un peu plus tôt, mais son ton était différent. Il ne paraissait pas ravi de me savoir là. Même la façon dont il avait prononcé mon prénom le laissait transparaître. Il pensait sans doute qu’il allait devoir s’occuper de moi, me traîner partout comme un boulet, sous prétexte que je ne connaissais personne d’autre. Indécis, je restai un instant devant la porte de ma chambre. L’heure de la confrontation avait pourtant sonné. J’habitais ici désormais. Je pris donc mon courage à deux mains et m’avançai vers l’escalier.
La dispute n’avait pas cessé. Elle se déroulait même en bas des escaliers. Lorsque ma tante me vit apparaître, elle changea immédiatement d’expression.
— Ah, Paul, voilà ton cousin ! s’écria-t-elle, d’un ton faussement enjoué.
Je lui fis un sourire que je voulus rassurant et mon attention se porta aussitôt vers le jeune homme qui se tenait à ses côtés. J’eus à peine le temps de l’apercevoir qu’il se mettait déjà à monter les escaliers à contresens. Paul me bouscula presque et me lança d’un ton glacial :
— Salut, Danny. Bienvenue en Irlande.
Cela ne dura qu’une poignée de secondes, mais son regard m’avait transpercé avec une expression de défi presque insultante. Je frissonnai, comme si un courant d’air m’avait brusquement enveloppé. Le temps semblait s’être distendu et je perçus tous nos mouvements comme au ralenti. Je ne pouvais dire si je venais de croiser un ange ou un démon. Sa beauté était comme un affront, une insulte à l’ordinaire et au commun. Elle mêlait quelque chose de fantastique, d’inhumain et de tragique. Plus honteuse qu’une balafre, plus scandaleuse qu’un crime inavoué. J’en ressentis l’emprise bien après que sa silhouette eut disparu derrière moi. J’étais blessé par son attitude, mais je pouvais la comprendre. Paul avait anticipé ma réaction, comme celle, inévitable, de tant de milliers d’autres avant moi. Son regard avait laissé sur moi une empreinte à la fois brûlante et glacée, un malaise indicible qui combinait des sentiments contradictoires d’angoisse et de compassion. Je mis un moment à reprendre mes esprits et restai immobile au milieu de l’escalier, comme si je me réveillais péniblement d’une vision irréelle et délicieusement maléfique. Tante Mary me fixait tristement et je lus dans ses yeux toute sa souffrance devant un fils qui lui échappait et qu’elle n’avait jamais pu dompter. Étant d’un naturel positif et joyeux, un nouveau sourire ne tarda pas à venir se peindre sur son visage.
— Le thé est prêt ! Installe-toi dans le salon !
Cette nouvelle me ramena à la réalité et j’en fus grandement soulagé. Je passai dans le salon et m’imprégnai de son odeur et de sa lumière. Le grand piano noir attira immédiatement mon attention. Celui de mes parents n’était pas aussi beau et je m’en approchai timidement, comme d’un jouet trop précieux qu’on n’ose pas toucher. Ma tante arriva chargée d’un lourd plateau et me vit perplexe devant l’instrument.
— Tu peux jouer, si tu veux, m’encouragea-t-elle. Profites-en tant qu’il est libre.
Elle se retira poliment et je soulevai le couvercle tout doucement. Je n’avais jamais approché un quart-de-queue de si près, j’avais presque honte de m’asseoir sur le tabouret en cuir, qui émit un léger craquement. Allais-je oser ? L’envie m’en démangeait les doigts et je me mis à pianoter maladroitement. Je testai les basses, qui résonnèrent avec force et détermination. Rassemblant mon timide courage, j’égrenai le début d’une valse de Chopin, l’un des rares morceaux que je pouvais jouer en entier. Porté par le son et la puissance de l’instrument, je pris progressivement confiance et me laissai aller au plaisir de jouer de la musique. Le son était perlé et rond. Quel bonheur d’avoir un tel piano chez soi !
Un léger frottement derrière moi me fit soudain sursauter. Paul était appuyé contre le cadre de la porte. Depuis combien de temps se tenait-il là, à m’écouter ? Je me sentis rougir et me levai précipitamment.
— Non, non, continue ! s’exclama-t-il. C’était bien.
Je balbutiai une série de sons sans véritable sens.
— Non, il… il vaut mieux que ce soit toi qui joues. Tu veux bien ?
Ma proposition ne parut pas le gêner le moins du monde.
— Bien sûr ! s’enthousiasma-t-il en prenant place sur sa banquette avec assurance. Qu’est-ce qui te ferait plaisir ?
Sa demande me prit de cours.
— Je sais pas… quelque chose, euh… d’irlandais, fis-je bêtement.
— D’irlandais ? Un quadrille ? Une gigue ? Riverdance ? se moqua-t-il gentiment. Voyons… Que dirais-tu de… Schumann ?
Il me posait la question, mais je vis bien que mon avis lui importait autant que sa première paire de chaussettes. Il se lança alors dans un morceau lent en mode mineur et je constatai immédiatement que j’avais affaire à un véritable professionnel. Le son qu’il extrayait de son instrument était bien plus rond que celui dont j’avais tiré tant d’orgueil quelques minutes auparavant. Son visage était impassible, concentré, comme dans une sorte de bulle. Une mèche tombait délicatement devant ses yeux, comme si elle avait soigneusement été préparée pour réagir à la musique. Soudain, la mèche s’anima et les doigts se mirent à courir sur le clavier avec une agilité étonnante. Faisaitil cela pour m’impressionner ou était-ce la véritable suite du morceau ? Paul poursuivit avec virtuosité, puis plaqua trois lourds accords en grande pompe et éclata de rire.
— Allez, le thé va refroidir !
Il se leva d’un bond agile qui me rappela mes douze heures d’avion et mes huit heures de décalage horaire. Je m’assis en face de lui, encore sous le charme de la musique.
— Je crois bien que je ne toucherai plus jamais ce piano, déclarai-je, vaincu.
Paul me regarda, amusé.
— Tu n’en auras pas beaucoup l’occasion, de toute façon, la place est souvent prise. Je travaille plusieurs heures par jour.
— Vraiment ? Et tu donnes des concerts ? Pas de lait, merci !
Paul me dévisagea comme s’il venait d’apercevoir une bête étrange. Quoi ? Je ne prenais pas de lait avec mon thé, étaitce un crime ? Il reposa le pot et s’enfonça dans son fauteuil, tout en remuant sa cuillère dans la tasse.
— Oui, bien sûr. Une à deux fois par an. Cette année, je joue pour la première fois un concerto au National Concert Hall.
— Un concerto ? fis-je admiratif. Lequel ?
— Le deuxième concerto d’un certain Sir Charles Villiers Stanford ˗ il avait accentué le Sir ˗ un Irlandais, tiens ! Enfin, un protestant et collabo du début du XXe siècle, qui non seulement a relancé la tradition musicale en Angleterre, mais qui considérait aussi que l’Irlande et la Grande-Bretagne étaient un seul et même pays… Il fit une pause théâtrale, un sourcil légèrement haussé, comme s’il attendait une réaction de ma part. Il ne reçut qu’un sourire amusé.
— Il a écrit de la belle musique, cela dit, poursuivit mon cousin. Ça sonne un peu comme du Rachmaninov, même tonalité que l’opus 18, en do mineur. Oh, tu auras l’occasion de l’entendre, crois-moi ! Avec et surtout sans orchestre !
— Je m’en réjouis d’avance, affirmai-je en toute sincérité. Je suis vraiment admiratif, tu peux être fier de toi.
Paul haussa les épaules et but sa tasse d’un trait.
— J’ai un truc à faire en ville. Ça te dit de venir ?
Sa question me prit de court, j’avais à peine avalé ma première gorgée de thé, que le lait n’avait pas refroidi. Ma tante intervint.
— Enfin, Paul ! Ton cousin vient tout juste d’arriver, il doit être épuisé et puis…
— Ne t’en fais pas, Tante Mary, la coupai-je. Je tiens le choc et j’ai très envie de revoir Dublin.
J’avais répondu presque malgré moi. J’étais en effet mort de fatigue, mais je ne pouvais pas refuser une telle occasion de briser la glace entre mon cousin et moi. J’étais surpris autant que flatté par sa proposition. Il n’était peut-être pas si terrible, une fois qu’on savait le prendre. Et le plus tôt je serais à l’aise en sa présence, le plus simple tout le reste me paraîtrait. Paul me fixait, visiblement satisfait que j’accepte.
— Alors, en route !
— Paul…
— Mais oui, ma maman chérie, promis, on fait vite, on sera de retour pour dîner, je ne fatigue pas mon cousin et je fais attention sur la route !
Il l’embrassa sur les deux joues et ma tante soupira en riant, pendant que je montais rapidement prendre mon portefeuille puis dévalais les escaliers en sens inverse pour rejoindre mon cousin dans la voiture.
♪: Valse op.69 n° 1 « Valse de l’Adieu » Frédéric Chopin.
III
« J’ai trouvé la définition du Beau, de mon Beau. ]Une belle tête d’homme… contiendra aussi quelque chose d’ardent et triste, – des besoins spirituels, – des ambitions ténébreusement refoulées, – l’idée d’une puissance grondante et sans emploi, – quelquefois l’idée d’une insensibilité vengeresse […] quelquefois aussi […] le mystère, et enfin […] le malheur. »
Charles Baudelaire, Journaux intimes.
— Classique ou rock ?
Paul tenait un CD dans chaque main et il semblait les soupeser en attendant que je me prononce. J’étais trop fatigué pour réfléchir.
— Comme tu veux, répondis-je, ça m’est égal.
Ses bras retombèrent et il me toisa comme si je venais de l’abandonner cruellement à son triste sort.
— Ça t’arrive de prendre des décisions, des fois, dans la vie ? me balança-t-il alors à la figure.
Je fus stupéfié par cette agressivité gratuite et soudaine, la dernière chose dont j’avais besoin dans mon état. Sans prendre le temps de réfléchir, je rétorquai :
— Et toi, ça t’arrive de dire des choses sympas aux gens ?
Il ne s’attendait sans doute pas à ça. Moi non plus, pour être tout à fait franc. C’était sorti tout seul et ça venait du cœur, mais, curieusement, ma réaction sembla beaucoup l’amuser. Son regard s’illumina d’une lueur malicieuse et satisfaite.
— Parfois, répondit-il simplement.
Paul choisit lui-même le CD et je reconnus du bon vieux rock irlandais. Sa remarque m’avait malgré tout blessé plus qu’elle ne l’aurait dû et la fatigue n’était pas la seule en cause. Était-ce réellement l’image que Paul avait de moi, un gars mou et sans personnalité ? Il ne m’avait pas revu depuis dix ans, comment pouvait-il prétendre me connaître ? Je n’étais pas un garçon très sûr de moi et mon cousin avait bien dû le sentir. Alors, me testait-il ? Et pourquoi ? Cela faisait sans doute partie de son personnage. Désarmer son adversaire avec sa beauté maléfique et son extrême assurance pour ensuite se délecter de nous voir tous ramper à ses pieds. Lui arrivait-il parfois de faire tomber le masque et d’être un peu naturel ?
Paul démarra le moteur et manœuvra pour sortir du jardin. Notre petit échange avait jeté un froid dans la voiture et je commençais à me demander si j’avais bien fait de l’accompagner. J’allais devoir dresser rapidement des murs de défense si je ne voulais pas me faire bouffer en un clin d’œil. Je n’étais pas venu là pour me battre, mais, si on me déclarait la guerre, il allait bien falloir que je riposte.
Au premier rond-point, je sursautai à nouveau. Je n’allais donc jamais m’y faire, à ce foutu sens de circulation ! Paul tourna la tête vers moi et éclata de rire.
— J’aimerais bien t’y voir ! me défendis-je, un brin vexé.
— Tu dois penser qu’on roule à l’envers, pas vrai ? Que vous autres Américains avez raison, comme toujours ?
— Tu m’as l’air de bien les connaître, les Américains, pour les juger ainsi, me permis-je de lui répliquer. Tu y es allé souvent aux États-Unis ?
Il haussa les épaules.
— Pas la peine d’aller là-bas, mon grand, c’est vous qui dominez le monde ! Vous envahissez tout et imposez votre style de vie : McDonald’s, Coca-Cola, Disneyland, Hollywood et compagnie ! Vos films, vos séries télé, votre musique, comme si le reste du monde n’existait pas ! Par contre, ce qui se fait dans le reste du monde, ça ne vous intéresse pas. Enfin, si, s’il y a du pétrole, ça vous intéresse toujours.
Il fit une brève pause.
— Et le pire, c’est que la moitié de vos bureaucrates sont des Irlandais ! Et comme l’autre moitié est italienne, je ne te dresse pas le tableau !
Je ricanai à mon tour.
— Quel brillant exposé ! Je parie que t’as jamais mis les pieds hors d’Irlande de peur de te heurter à la bêtise humaine !
Une fois de plus, il se mit à rire.
— La bêtise humaine existe même en Irlande, mon pauvre ami ! s’écria-t-il. Tu auras largement le temps de t’en apercevoir. Et pour répondre à ta question, si, je suis déjà sorti d’Irlande ! Je suis allé à Paris !
Je sifflai pour manifester mon admiration, non sans ironie.
— Mon cher ! Paris, rien que ça ! Et alors, vos impressions ?
Il ne se fit pas prier.
— Un grand pays, la France… Ils ont eu l’intelligence de séparer l’Église et l’État, eux, ce qui ne ferait pas de mal chez nous, mais bon, là, je rêve en technicolor… Et puis, n’oublions pas que la France et l’Irlande ont un ennemi en commun.
Son argument de poids me fit délicieusement sourire.
— Mouais, bon, je ne sais pas si manger des escargots et des grenouilles est un signe de grandeur… Paul n’eut pas l’air d’apprécier ma remarque, assez idiote, je l’avoue. Il me lança son regard de tueur n° 3 et porta à nouveau toute son attention sur la route. Il me semblait tout aussi rempli de clichés et de préjugés que ceux qu’il condamnait. Même si ces propos avaient un certain second degré, il pensait sans doute en grande partie ce qu’il disait. Je savais que les Américains n’étaient pas toujours très bien vus en Europe, mais je n’étais pas responsable de tous ces maux dont on les accablait, et j’avais peut-être bien plus à les subir que la plupart des gens qui s’en plaignaient avec tant de ferveur. Étaitce là la raison pour laquelle Paul s’acharnait sur moi depuis mon arrivée ? Peut-être s’imaginait-il que j’allais débarquer en superhéros yankee, prêt à conquérir l’Irlande ? Il était mal tombé. J’étais seulement un pauvre petit gars qui n’avait d’autre prétention que de renouer avec la culture maternelle, qui me semblait bien plus proche de moi que celle que mon pays de résidence m’avait imposée depuis ma plus tendre enfance. Mais ça, qui était-il, lui, pour le comprendre, alors qu’il avait toujours bénéficié de ce que moi, justement, je recherchais ?
J’observai à nouveau son profil parfait avec une certaine jalousie, mêlée à de la rancœur. Il le savait bien tout ça, n’est-ce pas ? Il lisait en moi comme dans un livre ouvert et il voyait parfaitement où il devait appuyer pour faire mal. Il paraissait inattaquable du haut de sa beauté insolente, et pourtant, combien de personnes devaient le juger comme lui se permettait de juger les autres ? Ne nous arrêtions-nous pas tous à ce physique extraordinaire, sans prendre la peine d’aller audelà ? Paul se renfermait derrière un cynisme provocateur, mais que cachaient donc ces regards assassins et ces étranges sourires ? Je percevais une sorte de mélancolie dans cette fuite volontaire. De la peur. De la souffrance. De l’orgueil, aussi, beaucoup d’orgueil. Et un grand mépris pour les autres. Pour tous ces autres qui lui renvoyaient un miroir en deux dimensions, une image plate et superficielle de sa personnalité complexe et secrète.
Je ne sais pourquoi je me sentis soudain obligé de lui faire des excuses.
— Eh, j’ai pas voulu te vexer ! dis-je. Je savais pas que tu les aimais tant les Franç… — T’as pas à te justifier, coupa-t-il, mais sans la moindre colère. T’es amerloque, après tout. On peut pas s’attendre à ce que tu sois spirituel.
Et c’était reparti ! Il ne se lassait donc jamais !
— Pour ton information, ajouta-t-il, les cuisses de grenouille, c’est très bon. J’en ai goûté dans un restaurant très chic à Paris.
Je n’avais aucun mal à me représenter mon cousin dans un restaurant très chic de Paris. Ce snobisme lui allait comme un gant. Un nouveau sourire énigmatique et malicieux vint se peindre sur ses lèvres.
— Évidemment, poursuivit-il, ça ne vaut pas un bon hamburger dégoulinant de ketchup, avec de délicieuses frites bien graisseuses. Sans oublier le succulent milk-shake et les donuts arrosés d’un Pepsi grand cru…
Je me mis à rire franchement. Il avait fait sa tirade sur un ton théâtral et grandiloquent, comme s’il faisait une parodie de réclame. Tout cela sans se défaire de son sourire ironique et de ce regard plein d’insolence. Il avait un talent indéniable pour le spectacle, mais il ne se prenait pas au sérieux pour autant. Il avait simplement tenu à avoir le dernier mot. J’étais bon public pour ces choses-là, et il me regardait, satisfait et riant de luimême.
Nous venions d’entrer dans Dublin. Je vis les premières avenues bordées de maisons en briques rouges, avec ces petits jardins fleuris et les bow-windows blanches, comme celles de la maison de Tante Mary. Les enseignes de Bed and Breakfast pullulaient de chaque côté de la voie. Au loin, je distinguai les deux tours bicolores du port, avant qu’elles ne disparaissent derrière les arbres. J’avais le souvenir d’une ville grouillante de touristes et de pubs, dont le centre était structuré autour de quelques édifices incontournables aux façades grises et aux toits verts. Des rues piétonnes pavées où abondaient les musiciens de fortune, parfois très jeunes, qui paraient la ville de chansons traditionnelles ou de morceaux classiques, ravissant autant le touriste que les autochtones. C’était probablement là la vision idéaliste d’un estivant. Dublin devait être bien moins vivante et colorée au milieu de l’hiver… Peut-être était-ce à ce moment-là qu’il fallait justement percer son âme pour en sortir tout le charme authentique.
Paul avait une conduite très nerveuse, mais rudement efficace dans le chaos de voitures qui s’était peu à peu formé autour de nous. Il traversa le fleuve Liffey et longea les quais sur quelques mètres avant de s’enfoncer un peu plus loin dans la ville. Nous arrivâmes bientôt devant les grilles d’un parc qui me parut familier.
— Merrion Square ! s’écria-t-il. Un des seuls endroits de cette foutue ville où l’on arrive parfois à se garer !
Il tourna quelques minutes avant de repérer une place. Il manœuvra en un clin d’œil et coupa le moteur. L’air frais me fit du bien. Je sentais la fatigue du voyage s’appesantir de plus en plus, mais je devais tenir le coup si je voulais m’habituer au décalage horaire. Paul se dirigea vers le parcmètre, une antiquité telle que je n’en avais vu que dans les films en noir en blanc, mais je me gardai bien de faire la moindre remarque sous peine de me voir traiter une nouvelle fois de « bloody Yankee ».
— Règle numéro un, fit Paul, toujours payer le stationnement, même si ça te paraît excessif, parce que les amendes, elles, sont vraiment dissuasives !
Il s’arrêta.
— Non, règle numéro un, quand tu viens à Dublin, évite de prendre la voiture !
Je le suivis le long de la grille et regardai avec grand intérêt l’alignement de portes géorgiennes colorées tout autour du parc. Mon cousin désigna alors la maison qui faisait l’angle.
— Ça, c’était la maison d’Oscar Wilde, me confia-t-il. Enfin, maintenant, c’est le Collège américain, ajouta-t-il en haussant les sourcils et en accentuant ce dernier mot.
Je lui souris distraitement et nous poursuivîmes notre marche le long d’une avenue qui était encore envahie par les touristes, malgré la saison tardive. Je dévorais tout ce qui m’entourait et tentais de m’en imprégner totalement, comme si cela pouvait disparaître d’un instant à l’autre. J’allais avoir bien des occasions de parcourir ces avenues au cours des prochains mois, mais je savourais chaque parcelle avec délice, tant j’avais attendu ce moment. Je reconnus bientôt Grafton Street, l’une des rues les plus commerçantes, qui montait sur la gauche, mais Paul me tira par le bras et m’attira vers une statue en bronze devant laquelle plusieurs personnes se faisaient prendre en photo.
— La principale attraction de Dublin, s’exclama-t-il, le décolleté de Molly Malone !
Je jetai un coup d’œil, amusé. Il valait en effet le détour.
— Dommage qu’il soit en bronze, hein ? ajouta mon cousin en rigolant.
Il s’était déjà remis en marche et je le suivis en me frayant un passage dans la marée humaine qui montait à contrecourant.
Nous traversâmes la rue et nous plantâmes devant un imposant bâtiment qui m’était familier, lui aussi. Paul avait levé la tête pour le contempler et je l’imitai. Je regardai la froide architecture néoclassique et fixai surtout mon attention sur l’horloge bleue au centre du tympan qui marquait dix-sept heures. Il était donc neuf heures du matin à Seattle.
Mon cousin me tira de ma rêverie.
— Ça te plaît ? demanda-t-il.
— Ouais, répondis-je sans savoir si je le pensais véritablement.
— Ben y’a intérêt, c’est là que tu vas passer les douze prochains mois !
C’était donc ça ! Trinity College ! Bien sûr ! Je l’avais visité il y a dix ans et j’avais revu bien des photos depuis, mais ma fatigue m’avait brouillé l’esprit. Évidemment ! Je le reconnaissais à présent. Je fus envahi par une sorte de jubilation puérile tant j’étais content. C’était effectivement là que j’allais passer les prochains mois de ma vie. C’était à l’intérieur de ces murs que j’allais concrétiser tous mes rêves d’adolescents. Paul me tapa sur l’épaule.
— Allez, viens, on va entrer. J’ai des choses à régler.
Je passai l’immense porte en bois, le cœur battant. Nous nous trouvâmes bientôt dans la première cour intérieure où se tenait la célèbre gloriette qui, selon la légende, porte malheur aux étudiants qui osent s’aventurer sous son ombre maléfique. Je n’avais pas l’intention de mettre les superstitions irlandaises à l’épreuve et je suivis mon cousin dans l’un des bâtiments, qui abritait l’administration. L’intérieur paraissait aussi vétuste que l’extérieur, mais ce contraste avec les universités américaines ne me déplut pas. Nous montâmes au premier étage et Paul poussa une lourde porte en bois derrière laquelle se trouvait un vaste bureau qui ressemblait à un secrétariat. Une dame rousse se tenait derrière le comptoir et elle changea d’expression lorsqu’elle vit mon cousin s’approcher d’elle.
— Monsieur Kinsella, quelle surprise ! s’exclama-telle, sur un ton faussement enjoué. Vous avez passé de bonnes vacances ?
Je souris de voir qu’il était une célébrité, ce qui ne m’étonna guère. Paul répondit sur le même ton.
— Excellentes ! Et vous-même ?
— Oui, oui. Vous venez pour le piano, je suppose ? Je n’ai pas encore de réponse, mais…
— Vous vous moquez de moi ! coupa Paul. C’est commandé depuis le mois de juin et vous me dites qu’il n’est pas encore là ?
Je fus surpris par le ton qu’il employait. Il n’était pas le supérieur de cette pauvre femme et je ne voyais pas de quel droit il s’adressait à elle de cette façon. La pauvre employée bégaya quelques excuses.
— C’est que… ils étaient en congé, eux aussi, vous comprenez ? Ils ne nous l’ont pas encore livré mais il devrait être là la semaine prochaine, sans faute…
— J’espère bien ! fit mon cousin. Ça fait plus d’une semaine que j’appelle et qu’on me dit la même chose ! Quand on s’engage…
Une porte venait de s’ouvrir sur la droite et un petit homme au visage rouge parut dans la pièce, le regard fatigué, mais dans lequel brillait une pointe d’amusement.
— Il m’avait bien semblé reconnaître votre voix, Mr Kinsella, dit-il à mon cousin en lui tendant la main. Vous devriez vous mettre à l’opéra, cela vous réussirait tout aussi bien !
J’aurais couru me cacher sous un bureau si on m’avait parlé de la sorte, mais mon cousin serra la main tendue avec fermeté, tout en regardant son interlocuteur droit dans les yeux, sans le moindre signe de honte.
— Mr Logan, heureux de vous voir ! s’écria-t-il. Désolé de paraître insistant, mais permettez-moi de manifester une certaine inquiétude…
— Je me chargerai personnellement de ce maudit piano, coupa l’homme. Vous avez ma parole qu’il sera là dans les temps, installé, dépoussiéré et accordé ! La pauvre Sinéad n’y est pour rien, fit-il en désignant la secrétaire. Ces gars-là sont de vraies têtes de mule, mais je saurai les secouer !
Paul n’avait pas l’air convaincu. Il fit une moue agacée.
— Parfait. Alors, je compte sur vous, résuma-t-il avec une certaine arrogance.
En se retournant, son regard se posa sur moi et il sembla soudain se souvenir de ma présence.
— Ah, je vous présente mon cousin, Danny Jones. Il a obtenu une bourse de l’université de Seattle, il va terminer son cycle en littérature ici cette année.
Mr Logan s’approcha de moi et me tendit la main avec un sourire chaleureux.
— Bienvenue à Trinity College, Mr Jones ! J’espère que vous vous y sentirez bien !
— Je n’en doute pas, fis-je poliment. Puis je fis un signe de tête à la secrétaire, qui me renvoya un sourire frileux.
— Eh bien, messieurs, au plaisir de vous revoir.
Paul goûta moyennement la plaisanterie, mais il salua néanmoins Mr Logan avec déférence et nous prîmes congé.
— C’est quoi, cette histoire de piano ? m’enquis-je dès que nous eûmes passé la porte.
— Tous les ans, c’est la même chose ! se lança Paul. Ils promettent, ils promettent et il faut leur sonner les cloches quinze fois avant qu’ils ne se bougent le cul ! J’ai besoin d’un piano convenable pour répéter pour le concert de novembre, ils le savent depuis des mois, mais ils s’y prennent toujours au dernier moment. Ce Logan-là, il est toujours plein de bonnes paroles, « je m’en charge personnellement », « vous avez ma parole d’honneur, sur le Christ et tous les saints », mais quand il faut agir, y’a plus personne !
Mon cousin faisait déjà des caprices de star, mais je connaissais suffisamment l’inertie des universités pour savoir qu’il n’avait certainement pas tout à fait tort de monter un peu au créneau de temps en temps. C’était bien souvent la seule façon d’obtenir des résultats, malheureusement.
Paul me proposa d’aller au pub et j’acceptai de bon cœur. Je mourais d’envie de goûter de la vraie Guinness de Dublin, non pas ce breuvage immonde qui était exporté dans le reste du monde, mais cette bière unique qui ne coule qu’en Irlande. Une foule compacte se pressait encore devant Trinity College. Des conversations fusaient et je souris en distinguant certains accents au milieu du brouhaha. Je me pris à penser que Paul n’avait pas un très fort accent irlandais. Certains mots le trahissaient, comme « pub », qu’il avait prononcé « pob », comme tout Irlandais qui se respecte, mais ce n’était pas si flagrant. Je m’amusais à imiter intérieurement cette prononciation si particulière quand un homme attira mon attention. Il se tenait devant nous, mais curieusement, il n’avançait pas, contrairement au reste de la foule. Il avait des cheveux filasse d’un blond incertain et une barbe de quelques jours. Il portait un blouson de cuir noir et un anneau brillait à son oreille. Ce fut surtout son regard qui m’intrigua, car il était fixe et insistant. Non, je ne me trompais pas, c’était bien Paul qu’il fixait ainsi. Je détournai alors l’attention vers mon cousin et vis que lui aussi regardait cet homme étrange. Je lus dans son regard qu’il le connaissait et qu’il n’était pas ravi de le voir. Il le défiait de ses yeux bleu-noir, comme s’il le sommait de ne pas faire le moindre geste dans notre direction. L’autre semblait vouloir l’intimider et il mâchait nerveusement un chewing-gum, en le faisant passer d’un côté et de l’autre à l’intérieur de sa bouche. Ce type avait l’air tout droit sorti d’un film de gangsters et son attitude était réellement menaçante. Paul soutint un peu plus son regard puis détourna lentement les yeux pour couper court à cette entrevue désagréable. Je ne pus m’empêcher de tourner légèrement la tête au moment où nous le dépassâmes et je vis que l’autre continuait à nous dévisager. Ses yeux se posèrent un instant sur moi, mais son visage demeura impassible et agressif.
Je rattrapai mon cousin qui avait pris un peu d’avance.
— C’était qui, ce type ? m’empressai-je de demander.
Paul s’arrêta et me regarda comme s’il se réveillait après un rêve.
— Hein ? Quel type ?
Il fit mine de regarder derrière lui. L’homme avait disparu.
— Le type patibulaire qui te regardait bizarrement, là !
Paul faisait semblant de ne pas comprendre, je le voyais bien.
— J’ai pas fait gaffe, mentit-il. Sans doute un junkie, il y en a plein dans les parages, faudra t’y faire. Ma tête ne devait pas lui plaire.
Il haussa les épaules et se remit à marcher. Je restai un moment immobile. Cette étrange apparition m’avait mis mal à l’aise. Pourquoi Paul niait-il avoir vu cet homme, alors qu’il savait très bien que j’avais été témoin de la scène ? Je le suivis dans un pub, sans conviction. Il commanda deux pintes et resta silencieux, les yeux perdus dans le reflet du comptoir. La bière avait un goût amer, peut-être était-ce la fatigue ou les nerfs, mais aucun de nous deux ne semblait en mesure de l’apprécier. J’avais à peine entamé ma pinte que Paul avait déjà vidé la sienne. Il m’attendit patiemment, sans décrocher un mot, sans que je pusse déchiffrer l’expression sur son visage. Était-ce de l’inquiétude ? De l’ennui ? De la tristesse ? Paul était vraiment capable de passer d’un état à un autre avec une facilité déconcertante. En l’espace de quelques heures, je l’avais vu glacial, concentré, chaleureux, taquin, drôle, extraverti, énervé, menaçant et soucieux. Il venait à présent de s’enfermer dans un mutisme impénétrable duquel il me parut bien inutile et improbable de le soustraire. Dès que j’eus avalé ma dernière gorgée, Paul tourna les talons et s’avança vers la sortie du pub. Je le suivis sans rien dire, le laissant seul à sa réflexion.
* * *
Mon oncle Ryan était rentré lorsque nous arrivâmes à la maison. Je reconnus son visage large et sa profonde fossette, ainsi que sa forte voix grave qui me terrorisait lorsque j’étais enfant. Il m’accueillit chaleureusement et me pressa immédiatement de questions en tout genre sur les États-Unis, le travail de mon père, les systèmes d’assurance et de santé de l’autre côté de l’Atlantique. L’Amérique le fascinait, mais j’aurais bien préféré, pour ma part, m’enfermer dans un cocon et me mettre rapidement au lit. Mon cousin Owen et sa femme Emma se joignirent à nous pour le dîner. Owen était devenu un grand et bel homme, même si, de ce côté-là, il ne pouvait rivaliser avec son frère. Emma, quant à elle, était une femme discrète. Elle avait le visage couvert de tâches de rousseur, des petits yeux verts et un charmant sourire, qui s’efforçait de cacher une rangée de dents très irrégulière. Tante Mary avait préparé un ragoût irlandais que je mangeai avec peu d’appétit, l’épuisement ayant peu à peu eu raison de moi.
Le repas ne s’éternisa pas. Les jeunes mariés prirent bientôt congé et je me retirai à mon tour, après avoir bu une bonne camomille.
La fatigue me terrassait, mais je ne parvenais pas à m’endormir. Je tournais et tournais dans mon lit, épuisé et fébrile, comme si l’heure de dormir était passée et que mon corps refusait de se laisser aller. Je résolus alors de me lever et m’assis à mon bureau pour écrire quelques lignes dans un carnet vierge que j’avais apporté avec moi.
« 25 août 1998. Première nuit à Malahide. Le voyage s’est bien passé. J’ai retrouvé Tante Mary à l’aéroport. Revu leur maison avec plaisir. Courte visite à Dublin et au Trinity College. Paul m’intrigue. Je meurs de sommeil. Ce que j’écris est vraiment nul. Ferai mieux demain ».
Je posai le stylo et ris devant ces quelques phrases décousues que j’allais probablement mettre à la poubelle dès le lendemain. Je me levai en m’étirant et m’approchai instinctivement de la fenêtre. Tout était calme et je laissai mon attention se fondre dans le paysage, au fur et à mesure que mes yeux s’habituaient à l’obscurité extérieure. Tout d’un coup, je vis une silhouette se glisser dans le jardin. Je sursautai. Quelqu’un venait de sortir de la maison. Je collai mon nez contre la vitre pour mieux voir. Il n’y avait aucun doute. C’était Paul. Il se dirigeait vers la barrière qu’il sauta avec une agilité étonnante. Pourquoi n’avait-il pas ouvert le portail ? Sans doute parce qu’il grinçait, je l’avais remarqué lorsque je l’avais fermé en rentrant le soir. Je l’observai, fasciné et curieux, me demandant ce qu’il pouvait bien faire dehors à une heure pareille. Il était adulte et ses parents ne l’auraient sans doute pas empêché de sortir. Alors, pourquoi s’enfuyait-il ainsi au milieu de la nuit ?
Soudain, Paul se retourna comme guidé par son instinct et regarda en direction de ma fenêtre. Évidemment, la lumière avait dû attirer son attention, que j’étais stupide ! Je me retirai immédiatement de la fenêtre, honteux d’avoir été découvert. Car il ne pouvait manquer d’avoir vu mon ombre. Il m’avait surpris en train de l’espionner. Je restai un instant immobile, le cœur battant, me demandant ce qu’il fallait faire. Rien. Il était même inutile d’attendre. Je pouvais bien éteindre la lumière pour faire croire que je dormais, ça ne servirait à rien. Paul m’avait vu. Je pris mon courage à deux mains et jetai un nouveau coup d’œil par la fenêtre. Il avait disparu. Je ne savais pas dans quelle direction il était allé. Sur la plage ? Vers le centre-ville ? Cela ne me regardait pas… Mais je brûlais pourtant d’envie de le savoir. Je repensai soudain à l’homme à la boucle d’oreille que nous avions croisé devant Trinity College. Cette escapade nocturne avait-elle un lien avec ce mystérieux individu ? Que manigançait Paul ? Où pouvait-il bien aller tout seul au milieu de la nuit ?
J’éteignis la lumière et me glissai à nouveau dans mon lit. Cette première journée en Irlande ne m’avait pas épargné. Je me demandai ce que la suite allait bien pouvoir me réserver. Je ne sais pas pourquoi, mais je me mis à penser que j’allais compter les moutons pour m’endormir. Des moutons irlandais à tête noire, il y en aurait des milliers. Cette idée stupide me parut hilarante dans l’obscurité de ma chambre et je me mis à rire tout seul comme un imbécile. Je n’eus pourtant pas besoin de rassembler un bon troupeau pour pouvoir enfin m’endormir.
♪ Molly MaloneThe Dubliners
IV
« Vous ne pouviez pénétrer son âme, mais vous découvriez avec stupeur qu’il avait trouvé le chemin de la vôtre. Sa présence ne cessait de vous hanter. »
Lord Byron, Lara, Chant I.
Je me réveillai avec un mal de tête épouvantable. Je ne savais si j’avais trop ou pas assez dormi, mais le jetlag se faisait bien plus cruellement sentir que la veille. En jetant un œil au réveil posé sur ma table de nuit, je constatai qu’il était déjà dix heures passées. Il était temps que je me lève.
Je m’étirai longuement, sans pouvoir me résoudre à quitter ma couette. Je perçus des bruits de voix en bas, je reconnus celles de ma tante et de Paul. Paul était donc déjà levé… À quelle heure était-il rentré ? Les événements de la veille me revinrent en mémoire, Paul m’avait surpris alors que je l’espionnais. Voilà qui allait le rendre d’excellente humeur ! Je soupirai péniblement et m’assis sur le bord du lit, regardant un instant mes jambes maigres pendre dans le vide. Allait-il me rendre la vie impossible ? Lui accordais-je plus d’importance qu’il n’en méritait ? Une demi-journée avait suffi pour me montrer un panel d’humeurs variées et ce n’était certainement pas l’épisode de la nuit précédente qui allait en faire un allié. Je n’y étais pour rien, après tout, si j’avais justement regardé par la fenêtre au moment où il sautait par-dessus la barrière. Paul était adulte et faisait ce qu’il voulait. Alors, était-ce moi que cette échappée dérangeait ? Non, c’était un tout. L’homme étrange et son regard inquiétant devant Trinity College, le brusque changement d’attitude de mon cousin, son silence renfrogné au pub et enfin, cette mystérieuse escapade nocturne. Son attitude avait tout pour me rendre soupçonneux. Je n’avais pas à me sentir coupable de ce qu’avait fait un autre et du fait qu’il se soit fait prendre. Il n’avait qu’à s’assurer que je dormais avant de faire des acrobaties sous mes fenêtres !
La salle de bain était libre et je m’y engouffrai comme dans un refuge, tout en prenant le soin de faire suffisamment de bruit pour avertir le reste de la maisonnée que j’étais debout. Deux impitoyables cernes creusaient mon visage, que je rinçai à l’eau glacée en grognant comme un ours. Je m’habillai en hâte avant de descendre les escaliers, essayant de me convaincre que j’étais des plus naturels.
Tante Mary s’apprêtait à sortir. Elle était accroupie devant la porte d’entrée et enfilait ses chaussures.
— Ah, Danny ! Bonjour ! Tu es réveillé ?
— Bonjour, tante Mary ! Belle journée !
— Je suis désolée, il faut que j’y aille. Je ne reviendrai pas… Enfin, je rentrerai tard… Paul ! Paul, s’il te plaît ! Ton cousin est levé !
Je vis son ombre se dessiner par l’ouverture de la porte du salon.
— Salut ! lançai-je le plus franchement possible.
Il ne me répondit pas. Ses yeux bleu-noir se contentèrent de planter leurs griffes acérées dans mon visage, avec un calme parfaitement maîtrisé.
Ma tante s’était relevée.
— Paul, s’il te plaît, occupe-toi du petit déjeuner de ton cousin. Danny, tu es ici chez toi, ne l’oublie pas ! Oh, je suis en retard !
— Ne t’inquiète pas, tante Mary. Je me débrouille. File vite !
Elle était déjà dehors et courait vers la voiture que nous avions utilisée la veille, Paul et moi. Je la regardai s’éloigner en souriant, figé devant la porte d’entrée ouverte. Paul passa devant moi et la fit bruyamment claquer avec son pied. Il se retourna alors d’un pivotement du buste qui paraissait presque chorégraphié et me regarda droit dans les yeux avec une expression qui mêlait le défi et la colère.
— Tu avais du mal à t’endormir ? me lança-t-il sur un ton glacial.
— Pas autant que toi, apparemment, répliquai-je, sans fléchir.
Il me précéda dans la cuisine.
— Effectivement, je suis un couche-tard. Mais ce que tu vois, tu le gardes pour toi !
— Tu es un grand garçon, Paul, fis-je, conciliant. Tu peux bien faire ce que tu veux, ça ne me regarde pas.
Et j’ajoutai.
— Promis. J’en parle à personne.
Je mourais d’envie de le voir se confier à moi, ne seraitce que pour satisfaire ma curiosité, mais Paul n’eut pas l’air d’apprécier ma clémence. Il soutenait simplement mon regard, avec un calme apparent, comme s’il cherchait à m’impressionner.
— Ça vaudrait mieux, finit-il par cracher.
Il se retourna brusquement et se mit à ouvrir tous les placards.
— Le pain est là, le thé et les céréales ici. La bouilloire est chaude. Le lait, le beurre et la confiture sont dans le frigo. Comme toi aussi tu es un grand garçon, tu vas pouvoir te préparer ton petit déjeuner tout seul, hein ? Moi, j’ai du boulot !