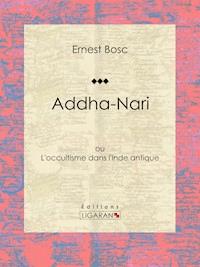
Extrait : "Grâce aux travaux encore trop peu connus des Indianistes modernes, on ne peut plus mettre en doute en ce moment la très haute antiquité de la civilisation hindoue. Il y a cinquante ans environ, des hommes de grande valeur et dont l'esprit pénétrant devançait celui de leur époque, se doutaient bien que l'Inde avait été le berceau du Monde, ..."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 330
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335030228
©Ligaran 2015
Dans un précédent ouvrage nous avons étudié l’Occultisme Égyptien ; dans le présent volume nous nous occupons de l’Occultisme Hindou, l’ancêtre de l’Occultisme Égyptien.
Nous n’avons pas l’intention et moins encore la prétention d’étudier à fond l’Occultisme de l’Inde, notre ambition est moins grande. En effet, il n’est pas possible, à l’heure présente de pouvoir établir d’une manière certaine l’Ésotérisme Hindou, d’après les livres de l’Inde Antique mis actuellement en notre possession.
La plupart des livres importants sont cachés aux yeux des profanes, d’autres sont perdus ou ruinés, d’autres enfin, écrits dans des dialectes connus de nom seulement depuis quelques années.
Ce qui rend encore les recherches sur l’Occultisme dans l’Inde très difficiles, presque impossibles, c’est que les Bons Pères Jésuites, Franciscains, missionnaires et autres gens de robe, s’entendent à merveille et s’unissent dans un louchant accord pour accomplir une œuvre de destruction à laquelle devrait s’opposer de toutes ses forces le public lettré.
Tout manuscrit ancien sanskrit, Tamoul ou de dialecte ancien quelconque, est immédiatement incinéré par les Bons Pères ; c’est, on l’avouera, un moyen bien commode de n’avoir pas à y répondre plus tard, le jour où il aurait pu être traduit dans une de nos langues européennes, c’est-à-dire dans une langue accessible à un grand nombre de lecteurs.
Cette rage de destruction a déjà produit des fruits très appréciés de nos bons Pères ; elle est cause que les Brahmes ne communiquent plus à nos savants Orientalistes les ouvrages d’une très haute antiquité qui seraient si utiles pour leurs études. C’est ce vandalisme implacable, monstrueux qui fait qu’à l’heure présente, la Société Asiatique de Calcutta n’a pu encore recueillir en entier les Vêdas ou les traduire d’après une excellente copie ; d’après un texte tout à fait correct, les copies mises entre les mains de ses membres sont loin d’être exemples de fautes, elles renferment en outre de nombreuses interpolations.
Nous devons ajouter pour être complet et rassurer aussi le public instruit, qui se plaît à l’étude de tout ce qui nous vient de l’Orient, que si la destruction des Bons Pères arrête quelque peu en ce moment les travaux scientifiques, cette destruction n’empêchera pas la lumière de se faire un jour tout à fait complète, car les Brahmes possèdent dans les dépôts sacrés de leurs sanctuaires d’immenses richesses littéraires et philosophiques qu’ils finiront bien par communiquer un jour ou l’autre, et qui parviendront ainsi jusqu’à nous.
Mais pour le moment nous ne possédons en Europe que fort peu de documents historiques sur l’Inde Antique. – Les inscriptions commencent bien à nous livrer certaines dates importantes, mais les travaux les concernant sont encore bien incomplets, ainsi le RECUEIL DES INSCRIPTIONS DE L’INDE, entrepris par l’ordre du Gouvernement Britannique n’a publié que deux volumes édités par les soins de savants tel que Cunningham et Fleet, préparés à cette lâche par leurs précédents travaux.
Il existe aussi un Recueil spécial des inscriptions de l’Inde Méridionale commencé par le Dr Hullsch ; enfin des Revues très importantes de l’Inde, nous livrent des trésors épigraphiques écrits en sanskrit vieux Canara et en Sanskrit-Tamoul.
Celle dernière langue commence à nous fournir des traductions françaises d’œuvres sanskrites mais d’un intérêt secondaire.
Il serait à désirer qu’on traduisit au plus vite parmi les œuvres de littérature tamoule des poèmes de premier ordre, tels que les traductions des Parânas primitivement écrits en sanskrit par des Brahmes pieux et qui sont le Madhurà Sthala-purâna et le Kauchi-purâna.
Enfin nous voudrions pouvoir lire en français des nombreux poèmes qui appartiennent à la classe de ces compositions versifiées, dénommées en tamoul KOVAI, ULA, PURANI et KALAMBAKAM.
Par les lignes qui précédent le lecteur peut entrevoir la difficulté de l’œuvre que nous entreprenons et tes obstacles qui se dressent devant nous, pour donner des aperçus exacts sur l’Occultisme de l’Inde Antique.
Aussi dans l’œuvre nouvelle que nous publions, nous ne voulons pour ainsi dira qu’ouvrir la voie à ceux qui viendront après nous. Ceux-ci mieux armés pourront la parcourir avec plus de succès ; nous ne sommes guère qu’un simple pionnier, abattant les ronces, les lianes et les broussailles qui obstruent la voie vers celle haute antiquité hindoue, ceux qui viendront après nous, pourront aplanir celle voie, l’élargir, la rendre certainement superbe.
Notre œuvre est donc modeste, mais elle a le mérite d’être une œuvre de courage, en effet, quand il s’agit de démolir les vieux préjugés, montrer des civilisations d’une antiquité si reculée quelle parait invraisemblable, on n’est pas sans soulever bien des haines, mais peu importe, si nous avons pu conduire à la découverte de la vérité ?
Si nous parlons ainsi, c’est que notre dernière œuvre, Isis dévoilée nous a attiré des critiques amères et bien injustes.
Ainsi dans une Revue Théosophique dirigée par une dame du grand monde, un rédacteur en rendant compte de notre livre nous a présenté à ses lecteurs comme « un esprit crédule admettant comme vérités indiscutables des assertions qui peuvent sembler tout au moins douteuses au commun des mortels. Au commun des mortels, nous le croyons bien !
« Il (M. Bosc) croit fermement que la pierre philosophale existe et il est persuadé que les prêtres Égyptiens la connaissaient, car dit-il, cela seul peut expliquer l’énorme profusion d’or que possédaient les Pharaons. »
Nous n’avons jamais dit que la pierre Philosophale existât aujourd’hui, mais quelle a existé, ce qui n’est pas tout à fait la même chose, de nombreux ouvrages peuvent témoigner de ce fait ; les citer tous, serait peut-être un peu long et fastidieux ; mais nous en mentionnerons quelques-uns, entre autres l’Œdipus du Père Kircher, le savant jésuite, voici ce qu’il dit.
« Il est si constant que ces premiers hommes possédaient L’ART DE FAIRE DE L’OR, soit en le tirant de toutes sortes de matières, soit en transmutant les métaux, que celui qui en douterait ou qui voudrait le nier se montrerait parfaitement ignorant dans l’histoire. Les prêtres, les rois et les chefs de famille en étaient seuls instruits, cet art fut toujours conservé dans le plus grand secret, et ceux qui en étaient possesseurs, gardèrent toujours un profond silence, de peur que les laboratoires et le sanctuaire la plus caché de la nature, étant découvert au peuple ignorant, il ne tournât cette connaissance au détriment et à la ruine de la République. L’ingénieur et prudent HERMÉS prévoyant ce danger qui menaçait l’État, eut donc raison de cacher cet art de FAIRE DE L’OR sous les mêmes voiles et les mêmes obscurités hiéroglyphiques, dont il se servait pour cacher au peuple profane la partie de la philosophie qui concernait DIEU les ANGES et L’UNIVERS. »
Après Hermès et le P. Kircher, nous mentionnerons Helvétius cité par Figuier, CylianiFiguierPapusTiffereau.
Le même critique nous fait dire que les magnétiseurs font bouillir l’eau en imposant les mains au-dessus de sa surface, c’eut encore là une erreur, car nous avons affirmé et affirmons que les magnétiseurs font bouillonner l’eau et non bouillir ce qui est bien différent, du reste non seulement nous avons vu des vases remplis d’eau bouillonner sous l’influx magnétique, mais des milliers de personnes peuvent attester le fait, le nier aujourd’hui, ne prouve qu’une chose, c’est qu’on l’ignore, rien de plus. Enfin, le même critique dit que pour nous « l’âme est une flamme. » Il s’agit de s’entendre et de ne pas jouer sur les mois ; oui nous pensons que l’âme est une sorte de flamme brillante éclairante même, mais qui ne brûle pas.
Ceci peut paraître difficile à admettre c’est possible, mais il y a tant de choses que l’on n’admettait pas il y a quelques années encore, et que les hommes de science sont obligés de reconnaître aujourd’hui, comme des faits absolument réels.
Ainsi que n’a-t-on pas dit et écrit par exemple, contre les spirites et le spiritisme et cependant les premiers savants de l’Europe reconnaissent pour vrais et authentiques des faits qui se passent en spiritisme.
M. Varley, ingénieur des lignes télégraphiques de la Grande Bretagne, membre de la Société Royale de Londres a dit et écrit : « Les phénomènes spirites sont de toute évidence. Son collègue de la même Société, l’illustre chimiste William Crookes, a écrit : « après quatre années d’études, je ne dis pas « cela est possible » je dis « cela est. »
Et l’illustre astronome F. Zœttner n’a-t-il pas écrit ; « J’ai acquis la preuve certaine par le medium Ilade, d’un monde invisible qui peut être en relation avec l’humanité. »
Et le premier homme d’État contemporain, le vénéré doyen Gladstone n’a-t-il pas dit : « Je crois que les faits spirites sont dus à des forces intelligentes que nous connaissons peu ou point.
Et la grave REVUE DES DEUX-MONDES n’insérait-elle pas sous la signature de M. Guyau, au sujet de la possibilité d’existence d’êtres différents du de l’homme, les lignes suivantes :
« … Malgré l’imagination qu’a montrée la nature sur notre Globe même, dans la variété de ses flores et de ses faunes, on peut supposer que le génie de la vie sur notre terre offre des points de similitude avec le génie qui travaille sur les autres globes. Malgré l’intervention des différences de température, de lumière, d’attraction, d’électricité, les espèces sidérales si différentes qu’elles soient des nôtres ont dû être poussées par les éternelles nécessités de la vie dans le développement intellectuel et scientifique, et, dans cette voie elles ont dû aller tantôt plus loin que nous, tantôt moins loin. On peut donc admettre sans trop d’invraisemblance, une infinité d’humanités analogues à la nôtre pour les facultés essentielles, quoique peut-être différentes pour la forme des organes, et supérieures ou inférieures en intelligence. Ce sont nos frères planétaires, Vent-être quelques-uns d’entre eux sont-ils comme des Dieux par rapport à nous. »
Terminons enfin, ces citations en donnant les opinions d’Alfred Russel Wallace de la Société Royale, de Londres, de Vacquerie et de notre illustre poète Victor Hugo.
Le premier nous dit : « J’étais un matérialiste si complet et si convaincu, qu’il ne pouvait y avoir dans mon esprit aucune place pour une existence spirituelle, et pour aucun autre agent dans l’Univers que la matière et la force. Les faits cependant sont des choses opiniâtres, les faits me vainquirent. »
« Je crois aux esprits frappeurs d’Amérique attestés par 14 000 signatures, nous dit Vacquerie. Enfin, Victor-Hugo déclare : « qu’éviter le phénomène spirite, lui faire banqueroute de l’attention, c’est faire banqueroute à la vérité. »
Et nunc crudimini !
S’emparant ensuite d’une note paye 270 de notre Isis Dévoilée à propos d’une découverte de Keely le critique de l’AURORE a l’air de mettre en doute le nouveau principe de force que prétend avoir découvert l’inventeur de Philadelphie, libre à lui ; cependant des personnes fort sensées, des hommes de très grande valeur, des occultistes même, ne croient pas que la découverte de M. Keely soit un mythe : voici en effet ce qu’en dit l’éminent écrivain E.J. Coulomb (Amaravella) :
« Le surnaturel n’existe pas, mais il serait présomptueux d’affirmer que nous connaissons toutes les lois et toutes les forces de la nature. Il n’y a pas si longtemps qu’a été redécouverte l’électricité jadis reconnue, comme une faculté de Jupiter Elicius. Le Kapilahsha des Puranas, le Mash-Mak de l’Ashtur Vidya, cette force akasique qui réduisait en cendres une armée de 100 000 hommes et ses éléphants, était peut-être l’ancêtre de la force éthérique ou interétherique que découvrira quelque Keely de l’avenir. »
Donc, si nous avons cru à ta découverte de l’honorable Américain, nous ne sommes pas seul naïf ; nous sommes même très honoré que notre naïveté soit partagée par des hommes d’une érudition aussi profonde que celle de M. E.J. Coulomb ; ainsi que pour nos autres griefs, par des hommes, tels que Hermès, Kircher, Helvelius, Cyliani, Figuier, Papus, Tiffereau et tant d’autres encore que nous aurions pu citer.
Mais nous n’insisterons pas plus que de raison sur des faits qui peuvent paraître aujourd’hui quelque peu extraordinaires, et qui demain feront partie des connaissances usuelles.
Les phénomènes Spirites étudiés aujourd’hui par les représentants les plus éminents de la science, étaient connus depuis des milliers et des milliers d’années en Égypte et dans l’Inde et réétudiés depuis plus de quarante ans par un grand nombre, de chercheurs ; ceux-ci sapaient et savent fort bien que la télépathie, la claire-voyance, la claire-audience, la lévitation, en un mut le dégagement astral de l’homme sont des faits réels, palpables, patents et non des subjectivités d’une imagination en délire. Aussi nous ne doutons pas que les savants officiels ne reconnaissent et ne constatent l’existence de ces faits. Ils discuteront encore longtemps leur cause, ils lui donneront des noms divers, le Spiritisme deviendra le Psychisme, comme le magnétisme animal de Mesmer est devenu le Bradisme, l’Hypnotisme, le Neurisme etc., etc. ; mais par cette habile substitution de noms, les diplômes, les parchemins et les peaux d’âne seront sauvés et la science officielle reconnaîtra enfin, ce que, de modestes chercheurs avaient reconnu, un demi-siècle avant eux.
Et tandis que ceux-ci auront été raillés, bafoués, outragés, lundis qu’ils auront subi toutes les misères et toutes les humiliations des inventeurs, on élèvera à ceux-là des statues. Telle est la marche de notre pauvre humanité aux pionniers le mépris, aux parasites la gloire. Le SIC VOS, NON VOBIS de l’immortel Virgite sera encore longtemps de mise.
Mais peu importe !
Et constatons en terminant cet avant-propos, que si l’on est tant soit peu hors rang, un peu en avant de ses contemporains, on n’est pas toujours sur un lit de roses, le grand poêle anglais Edgard Poë l’a depuis longtemps constaté, quand il dit :
« Je me suis demandé quelque fois, quel serait le sort d’un homme, doué ou plutôt affligé d’une intelligence de beaucoup supérieure à celle de ses semblables. Naturellement il serait conscient de sa supériorité, et ne pourrait guère s’empêcher de manifester qu’il le sent ; aussi, se ferait-il des ennemis partout, et comme ses idées et théories différeraient grandement de celles de toute l’humanité, il est évident qu’il serait considéré, comme fou. Quelle condition horrible et douloureuse serait la sienne ! »
Aujourd’hui, quand on est un peu plus clairvoyant que la généralité de ses contemporains on est un naïf, ce qui veut dire un niais ; mais enfin c’est un progrès, autrefois, il y a un ou deux siècles, en était traité de fou ou d’hérétique et comme tel, on était suivant le cas, enfermé dans un cabanon ou bridé sur un bûcher. Nous avons donc un peu progressé ; aussi, ne nous décourageons pas ; que les pionniers de la science, que les hommes de progrès ne se découragent pas et se remémorent, ce vieux texte de Manou :
« De même que le dernier soldat d’une armée peut quelque fois d’un trait embrasé mettre le feu à la plus formidable forteresse de l’ennemi et la détruire ; de même, l’homme le plus faible, quand il se fait le valeureux défenseur de la vérité peut renverser les plus solides remparts de la superstition et de l’erreur. »
En publiant hier Isis Dévoilée et aujourd’hui Addha-Nari, nous n’avons eu d’autre mobile que de contribuer à l’étude de l’occultisme ancien, de l’art sacré, source de tout bien pour l’humanité ; nous n’avons donc, voulu travailler qu’à ta destruction de la superstition et de l’erreur, et par suite au triomphe de la VÉRITÉ.
E.B.
Nice, 5 Décembre 1892.
Grâce aux travaux encore trop peu connus des Indianistes modernes, on ne peut plus mettre en doute en ce moment la très haute antiquité de la civilisation hindoue.
Il y a cinquante ans environ, des hommes de grande valeur et dont l’esprit pénétrant devançait celui de leur époque, se doutaient bien que l’Inde avait été le berceau du Monde, cependant, ils n’osaient pas encore l’avouer ouvertement.
Ainsi Bâtissier, dans son Histoire de l’Art Monumental disait : « Il n’est pas de pays qui se présente à notre imagination entouré de plus d’intérêt et de prestige que l’Indoustan. C’est par cette contrée que commence l’histoire du monde, et c’est là qu’ont dû vivre et s’assembler les premières familles humaines. Il est vrai de dire aussi, que la nature n’a effort nulle part à l’homme un séjour aussi riche, aussi délicieux… Si l’Inde ne fut pas le berceau du genre humain, comme le prétendent quelques érudits, elle offre à coup sûr une des premières civilisations que les peuples aient consignées dans leurs annales. Dès les temps les plus reculés, elle envoyait déjà aux autres nations du monde, ses pierres précieuses, ses bois rares, ses suaves parfums et ses étoffes qui nous semblent aujourd’hui tissées par la main des fées. Plus d’un sage de l’antiquité païenne est allé puiser auprès des Brahmanes l’enseignement d’une haute morale et emprunter à leur Panthéon les Dieux et les symboles des puissances célestes qui gouvernent l’univers. Demandez à certains auteurs, et ils vous diront avec quelles divinités, l’Égypte, la Perse, l’Etrurie et l’Attique ont peuplé leur Olympe. ».
Par les lignes qui précèdent écrites il y a 50 ans environ, Bâtissier reconnaissait, sinon ouvertement du moins d’une manière tacite, que l’Inde a été le berceau du genre humain. Mais depuis cette époque les travaux des Indianistes, tels que ceux de William Jones, de Colbrooko, de Weber, de Lasson, de Bird, de Roth, de Max Müller, de Stevenson, de Windischman, de Burnouf, de Lenonnant et d’autres encore, tous les travaux de ces éminents auteurs ne peuvent laisser subsister aucun doute sur la très ancienne civilisation de l’Inde.
Louis Jacolliot dans sa Bible dans l’Inde, nous apprend que ce pays « est le berceau du monde, que c’est de là, que la mère commune en faisant rayonner ses fils jusque dans les contrées occidentales, nous a légué à tout jamais comme signe de notre origine sa langue, ses lois, sa morale, sa littérature et sa religion. »
Et, Jacolliot ne se contente pas d’affirmer simplement, il donne des preuves à l’appui de ses affirmations ; il passe en revue les lois, les usages, les coutumes, la langue et la religion des hindous, et il montre les traces, et les empreintes caractéristiques, et pour ainsi dire indélébiles que l’on retrouve dans la civilisation hindoue, dans la législation, les usages, les coutumes, la langue et les religions des peuples anciens et modernes de l’Europe.
Ne pouvant citer en entier la préface du livre en question, nous nous bornerons à donner quelques lignes qui la terminent et lui servent pour ainsi dire de conclusion.
« La science admet aujourd’hui, y est-il dit, et cela comme une vérité qui n’a plus besoin de démonstration, que tous les idiomes de l’Antiquité ont pris naissance dans l’Extrême Orient ; grâce aux travaux des Indianistes, nos langues modernes y retrouvent leurs racines et leurs bases, – N’est-ce pas hier que le regretté Burnouf disait à ses élèves, à la suite d’un cours ; « Combien nous comprenons mieux le grec et le latin depuis que nous étudions le Sanskrit. »
« N’est-ce pas aujourd’hui qu’on rattache à la même origine les langues slaves et germaniques ?
« Manou a inspiré les législations égyptienne, hébraïque, grecque et romaine, et son esprit domine encore l’économie entière de nos lois européennes. – Cousin a dit quelque part : « L’histoire de la philosophie de l’Inde est l’abrégé de l’histoire philosophique du monde. »
« Le Sanskrit, voilà la preuve la plus irréfutable et en même temps la plus simple de l’origine des races européennes et de la maternité de l’Inde. »
Ce premier point établi, nous allons étudier la littérature hindoue, puis ses mythes, son art et mentionner ses religions.
L’Inde est la contrée du monde ancien, qui a produit le plus grand nombre d’œuvres littéraires. Aujourd’hui encore, nous ne possédons pas en Europe, la moitié des livres composés soit dans l’Inde ancienne, soit dans l’Inde moderne.
En ce qui concerne les livres anciens, après les Vêdas bien entendu, nous ne connaissons même pas les titres de ces ouvrages.
À l’heure actuelle en France, une des plus riches, sinon la plus riche Bibliothèque orientale de l’Inde est sans contredit celle du Musée des religions, au Trocadére. Elle renferme un nombre très considérable de manuscrits et de textes imprimés, près de quatorze mille volumes, tous relatifs à l’histoire, à la philosophie, aux religions, à la littérature des différents peuples de l’Orient.
Beaucoup de manuscrits sont écrits en points sur des feuilles de palmier de l’Inde, de Siam et autres contrées ; quelques-uns de ces manuscrits sont laqués d’or et ont leurs caractères en noir et rouge.
Malheureusement parmi le grand nombre d’ouvrages hindous répandus dans les diverses bibliothèques de l’Europe, beaucoup, la majeure partie pouvons-nous dire, ne sont pas traduits dans les langues de l’Europe. – L’Angleterre et l’Allemagne ont déjà commencé de nombreuses traductions, la France ne vient qu’en troisième ligne et la plupart des traductions françaises sont faites d’après des traductions anglaises ou allemandes, ce qui est regrettable, car il est très fâcheux, que les Français soient obligés de recourir à des langues étrangères pour connaître et apprécier la littérature, les mythes, les religions, la philosophie en un mot, la civilisation orientale, d’autant que l’étude de l’Inde, par sa littérature est très difficile par suite de l’absence de toute chronologie et par l’impossibilité absolue de déterminer à mille ans près, la date des principaux ouvrages Sanskrits, très anciens.
Voilà pourquoi nous nous méfions de traductions faites sur d’autres traductions ; le sens littéral y perd toujours.
Les Lassens, les Burnouf et les autres indianistes cités plus haut ont montré par leurs travaux que l’examen critique des doctrines que ces ouvrages renfermaient, pouvait seul permettre d’assigner une date relative à un grand nombre d’ouvrages.
Le Bouddhisme, on le sait, a commencé dans l’Inde la période historique ; sa chronologie est conservée dans un grand nombre de contrées orientales, et elle présente avec les histoires des chinois et autres peuples du midi de l’Asie des synchronismes très précieux, qui permettent ainsi d’établir des rapprochements certains. Ajoutons aussi, que le caractère des dogmes et de la langue Védiques, permettent d’affirmer qu’un grand nombre d’hymnes du Rig-Vêda est antérieur à Homère et à Zoroastre.
On voit donc par là, que sans pouvoir préciser des dates fixes et certaines, on peut du moins déterminer d’une manière très approximative, diverses époques entre lesquelles s’opérèrent de grands changements, soit dans les idées, soit dans la civilisation de l’Inde ; ce qui permet d’assigner une date aux ouvrages hindous qui mentionnent ces changements. – Or, quatre mouvements religieux se remarquent dans la littérature hindoue et donnent lieu à quatre catégories d’ouvrages ; la religion primitive, le VEDISME, contenue dans les Vêdas ; le BRAHMANISME (orthodoxe et sectaire) qui seul a inspiré la grande littérature classique de l’Inde ; le BOUDDHISME, dont la philosophie a donné lieu à un grand nombre d’ouvrages écrits en Sanskrit ou dans des idiomes qui en dérivent directement ; enfin le JAÏNISME qui lui aussi a fourni un grand nombre d’ouvrages sur sa doctrine.
Les quatre mouvements religieux que nous venons de signaler, correspondent respectivement chacun à un état particulier de la civilisation hindoue. Trois de ces religions se sont presque conservées intactes jusqu’à nous ; de simples modifications de détails ont été apportées dans les croyances primitives.
Le Vêdisme tire son nom des Vêdas. Ce terme qui signifie science, sert à désigner l’ensemble des livres sacrés des Hindous.
Il y a quatre Vêdas : le Rig, le Sama, le Yaour et l’Athàrva.
De ces quatre recueils (sanhita), les trois premiers sont considérés non seulement comme livres authentiques, mais encore comme livres canoniques de la primitive religion de l’Inde : du Vêdisme. Ces trois livres passent pour l’œuvre de Brahma ou du moins auraient été composés sous l’inspiration de ce dieu.
Connaître le Triple-Vêda, c’est posséder la science parfaite. Les croyances qu’il renferme ont été conservées d’âges en âges par la tradition orale jusqu’au jour, où ces traditions ont été écrites, c’est-à-dire à une époque qui remonte au moins à deux-mille ans avant l’être vulgaire, et du reste le triple-vêda n’a jamais été écrit d’un seul coup, il a fallu certainement trois cents ans pour rétablir complet ou du moins tel que nous le possédons et le connaissons en Europe ; nous aurons occasion de reparler de ceci un peu plus loin.
L’Athârva-Vêda a été écrit postérieurement aux trois autres Vêdas à une époque qu’il n’est pas possible d’indiquer, même approximativement ; aussi ce dernier livre, a-t-il une autorité moindre auprès des savants de l’Inde et des Indianistes en général. Ajoutons que les Vêdas et deux autres recueils ; les Brahmans et les Sûtras qui en sont les commentaires forment ensemble le corps entier des livres sacrés, des Saintes Écritures de la primitive religion des Hindous, du Vêdisme, religion des conquérants Aryas, qui passe avec raison pour la mère, la génératrice des religions de l’Occident.
Nous ne connaissons rien des croyances indigènes des Hindous antérieurement à l’arrivée des Aryas dans l’Inde ; mais il est probable qu’elles ont exercé une certaine influence sur la religion même des conquérants, c’est un fait que nous retrouvons souvent dans l’histoire, nous voyons en effet, que presque toujours, le vainqueur accepte par goût ou par diplomatie peut-être, une partie de la religion du vaincu, ou du moins de ses principales croyances.
Ce qui est probable, si non certain, c’est que les croyances indigènes ont vécu parallèlement et pour ainsi dire côte à côte avec le Vêdisme, importé dans l’Inde par les Aryas.
On admet généralement aujourd’hui, qu’il n’a pas fallu moins de trois siècles, nous venons de le dire pour composer et recueillir les hymnes védiques, et ce laps de temps de trois cents ans a été précédé d’une période signalée partout dans les Vêdas, période qui rattache les traditions hindoues à celle des Perses et à d’autres habitants de contrées européennes envahies par les Aryas.
Le Rig-Vêda qui est à la fois le plus ancien et le plus vénéré des livres sacrés hindous renferme des hymnes en vers (rik) d’où son nom de Rig ; le Sama-Vêda également en vers, formant en quelque sorte le rituel sacré, se compose de cantilènes, dont un grand nombre de vers empruntés au Rig ne sont presque qu’une reproduction de celui-ci, arrangée avec variantes pour les besoins du culte.
Le Yajour-Vêda, écrit en partie en vers et partie en prose, est divisé en yajour-blanc et yajour-noir. Ces recueils contiennent des formules appartenant à des écoles diverses ; les sujets traités sont presque identiques, mais ils ne se présentent pas sous la même forme. Dans le yajour-blanc, on ne trouve que les formules du sacrifice, dans le yajour-noir, ces formules sont suivies de commentaires, d’explications dogmatiques et de nombreux renseignements au sujet du rite et du cérémonial.
Enfin, l’Atharva-Vêda est comme le Rig, un recueil d’hymnes en vers, ceux-ci sont au nombre de sept cents environ.
L’Atharva traite principalement des puissances malfaisantes de la nature et comme ce recueil est de date beaucoup plus récente que le Rig, on y trouve des superstitions grossières ; du reste, les trois derniers Vêdas renferment beaucoup de redites et de paraphrases qui font qu’en ne doit s’appuyer exclusivement que sur le texte du Rig pour déterminer les traits saillants et caractéristiques du Vêdisme.
C’est dans le Rig seul, qu’en peut voir se développer toute la conception religieuse du Vêdisme.
Comme tous les livres écrits d’après la tradition, le Rig-Vêda n’est pas l’œuvre d’un seul homme, presque chaque hymne est signée d’un nom, dont beaucoup paraissent authentiques, puisqu’ils appartiennent à des familles, à des époques et à des localités du Septasindhu, très différentes.
Le Septasindhu (sept rivières) est une contrée dans laquelle ont été chantés les hymnes du Rig-Vêda, conservés dans les familles sacerdotales, ces hymnes témoignent fort souvent de ce fait.
Quelles sont ces sept rivières si fréquemment nommées dans le Rig-Vêda, dans leur ordre géographique même ? Ce sont celles qui portent encore au temps d’Alexandre-le-Grand, des noms identiques, que quelques-unes ont conservé de nos jours. Le Rig-Vêda, nous dit qu’elles coulent vers le sud et se réunissent dans un bassin commun, qui porte le nom de Sindhu.
Il ressort très évidemment des faits que nous venons de relater que les hymnes du Rig-Vêda ont été composés dans la vallée de l’indus et non dans celle du Gange comme l’ont déclaré quelques auteurs.
Nous venons de dire que c’est dans le Rig seul, qu’en peut trouver la conception religieuse du Vêdisme dans ses développements ; en effet, nous y voyons, que le culte s’adresse aux grandes forces de la nature ; ce sont les phénomènes du jour naissant, (le Soleil) des vents et de la foudre (principe du feu) ; ce culte s’adresse aussi à la voûte sombre, bien qu’étoilée du ciel, à la pluie bienfaisante (principe de l’eau) etc.
La poésie de ces hymnes est toute empruntée à la vie ordinaire des populations Aryennes : c’est la marche des Aryas à travers les peuples barbares, la naissance, le mariage, les travaux champêtres, la mort. Mais à côté de la vie matérielle, les hymnes présentent dans leur poésie tout un monde de conceptions symboliques, dans lequel les mythologies Étrusque, Grecque, Romaine et autres des peuples occidentaux ont beaucoup emprunté ; c’est un fait de toute évidence.
Par ce qui précède, on voit clairement que dans l’Inde, le Vêda est le fondement de la doctrine religieuse, comme la Kabbalah, l’Évangile et le Koran sont les fondements de la constitution religieuse des Juifs, des Chrétiens et des Mahométans.
Mais le Vêda est en outre, la base de toute la constitution civile et politique des Hindous, ainsi que du système social des castes ; c’est ce qui fait que le Vêda est le livre sacré, le livre révéré par excellence et qui devint le point de départ du mouvement religieux qui produisit les divers cultes Brahmaniques.
On peut voir en effet, en germe dans ce livre sacré, les écoles dissidentes ; on y sent pour ainsi dire leurs doctrines ultérieurement signalées ans le Rig-Vêda.
Ce n’est du reste, que dans le Vêda, dans le Rig-Vêda et dans eux seuls, qu’en peut suivre le courant des idées qui se propagent et se poursuivent de siècle en siècle pendant l’espace de plus de trois mille ans, à travers la civilisation Hindoue.
Ajoutons ici, que le Vêda éclaire de sa vive lumière les temps primitifs et les anciennes croyances et institutions des autres peuples d’origine Aryenne : Mèdes, Perses en Asie, Grecs, latins en Europe.
Aussi, pouvons-nous dire avec raison, que l’apparition du Vêda en Europe, en 1833, a résolu d’une manière certaine et définitive, une question longuement controversée, celle de l’origine de nos langues modernes et de leur parenté.
On les faisait toutes dériver du Sanskrit et l’on attribuait au grec une origine beaucoup plus ancienne qu’au latin et qu’aux langues du Nord de l’Europe, mais quand on a eu reconnu que le Vêda primitif, originel n’était pas en Sanskrit, mais dans une langue plus ancienne, de laquelle dérive le Sanskrit et qui se rapprochait de l’Avesta, on a commencé par restituer cette dernière langue de l’Orient et de l’Occident, on a pu se convaincre que le grec et le latin ne sont pas venus l’un de l’autre, en un mot ne sont pas des dérivés. On a reconnu que le Celte est beaucoup plus ancien que l’étrusque, le grec, le latin et par suite que le gothique et l’allemand ancien, ainsi que les langues Slaves et Scandinaves ; on a reconnu enfin, que tous les idiomes parlés, même très anciennement en Europe, tirent leur origine de la langue parlée anciennement sur les rives de l’Oxus ; et c’est ainsi qu’en a pu rétablir dans ses véritables éléments la vaste famille Aryenne, autrefois dénommée à tort Indo-Germanique ; c’est Indo-Celtique qu’en pourrait dire avec plus de vérité.
Quelle était donc cette langue plus ancienne que le sanskrit ? C’était probablement le prâkrit, la langue vulgaire de l’Inde, bien moins parfaite que le sanskrit ; aussi dans les drames hindous, tandis que les classes supérieures parlent le sanskrit, les castes inférieures parlent le prâkrit. Ce qui prouve l’antiquité de cette dernière langue qui a cessé d’être la langue vulgaire vers le IIIe siècle avant l’ère chrétienne, c’est que les Djaïnas l’emploient comme langue sacrée pour les cérémonies du culte ; enfin nous ne doutons pas que le prâkrit n’ait donné naissance à divers dialectes modernes tels que le Maghadi, le Mahratte et le Païcachi, lesquels dialectes ont fourni à leur tour d’autres dialectes, ainsi le Mahratte par exemple, a donné le Basapuri, le Ouadi, le Desh, le Kokuni, etc.
Beaucoup d’œuvres littéraires de l’Inde offrent dans une même composition divers dialectes ; par exemple les Dieux parlent sanskrit, les héros en les génies le prâkrit, les esprits le païcachi et les castes inférieures le Maghadi.
Après cette digression, qui a bien son utilité, si nous revenons à la doctrine védique, nous voyons qu’elle consiste dans la théorie des Asuras ou principe de la vie (Asu).
Les Aryas primitifs avaient été frappés du spectacle de la vie partout répandue sur notre globe ; aussi en cherchèrent-ils l’explication ; ils crurent la trouver en admettant que le principe qui prédomine dans la nature est un principe vital qui fait que tous les êtres s’enchaînent les uns aux autres par une chaîne ininterrompue. Ils remarquèrent en outre que la vie est enchaînée au mouvement et que celle-là et celui-ci sont solidaires, c’est-à-dire que si l’un s’arrête, l’autre s’arrête également.
De là, à considérer que le principe vital est doué de mouvement, il n’y avait qu’un pas à franchir, et les Aryas le franchirent, en admettant que les principes de la vie étaient doués de mouvement et par suite d’un corps ; mais celui-ci pour répondra à des dons d’ubiquité devait être éternel et pour ainsi dire universel, or en voyant les phénomènes de la nature qui bien souvent insaisissables, invisibles n’en agissent pas moins, ils furent amenés à concevoir l’idée de corps éthérés qu’ils donneront aux Asuras, mais auxquels ils prêtèrent tous les dons de l’intelligence et qui firent d’eux les maîtres et les ordonnateurs du monde.
Cet ordre d’idées devait amener l’anthropomorphisme, aussi voyons-nous dans les Vêdas que le nom d’Asura s’applique indistinctement aux êtres éthérés, spirituels de l’espace et aux êtres matériels, en un mot à tous les êtres vivants, à tous les êtres ayant un principe en une cause de vie.
Les principaux Asuras sont Agni, le fou terrestre, celui qui brûle, qu’en entretient sur l’autel, mais c’est aussi le fou de la vie, celui qui se condense dans l’être vivant (animal ou végétal), le feu de la foudre (Vajri) qui se mêle, s’unit et se confond avec les nuages et la pluie, et qui vivifie tout, les animaux, les plantes, les métaux. Ce même principe vivifiant se retrouve dans le beurre consacré, qui est extrait du lait, première nourriture des animaux, bourre qui sert d’aliment à la première étincelle destinée à allumer le feu sacré. – Mais Agni joue encore un autre rôle ; comme principe de vie ; il est le créateur des formes, par suite le producteur de tout bien ; Agni, on le voit remplit donc aussi les rôles de Prométhée et de Vulcain.
En ce qui concerne les animaux, Agni se transmet des uns aux autres avec la semence et porte alors le nom de Purushà, c’est le principe masculin, l’autour des générations ; mais Agni a d’autres noms encore, il est Indra dieu de la foudre et des airs ; par suite de son énergie atmosphérique, c’est le Soleil qui paraît le matin tout revêtu d’or, porté sur un char d’or, traîné par des coursiers jaunes précédés eux-mêmes de cavaliers célestes et par l’Aurore aux doigts de rose ; les Maruts (vents) forment son escorte.
Les Asuras du ciel sont étroitement liés à Agni-Indra ; les uns Mitra, Varuna, Aryaman, identifient les énergies célestes du jour et de la nuit ; les autres, colles du Soleil dont le nom Sûria, signifie brillant.
Comme astre, c’est d’abord un nain (Soleil levant) qui grandit peu à peu et qui en trois pas parcourt tout le ciel ; à son point culminant il se nomme Vishnu, c’est-à-dire le pénétrant ; mais quand il pénètre tous les êtres et réside en eux, il prend le nom de Vivaswat, enfin il porte les noms de Savitri, comme producteur de formes et de Purushâ, comme père nourricier.
Vivaswat, passe pour le père de la race humaine et celui de Manu, le premier être pensant ; il est aussi père de Yama, Dieu de la Justice et des morts.
Les prêtres Aryas ayant établi une étroite corrélation entre Agni, Indra et Sûria, le feu, la foudre et le Soleil, finiront par l’identifier et n’en firent qu’un dieu unique, principe suprême ; et cependant le Rig-Vêda ne donne pas de nom à ce dieu unique, à cause d’une tendance panthéistique qui est consigné du reste dans plusieurs hymnes, de même que la croyance à la réincarnation ; plusieurs hymnes en effet, donnent des formules de résurrection et en présentent des scènes.
Examinons maintenant, comment la société Aryenne de l’Inde si divisée à son origine » pu parvenir à l’unité de croyance, affirmée par les Vêdas. C’est ce livre sacré lui-même, qui va répondre. Il nous montre que le culte a été d’abord privé, mais que bientôt il est devenu public, il se forma alors des familles sacerdotales exclusivement attachées au culte, qui officiaient pour tout le monde. Or, le culte primitif s’est perpétué dans ces familles sacerdotales, par l’enseignement du chef de la famille qui transmettait ainsi à ses enfants la tradition ; ces chefs éloignés les uns des autres maintinrent l’unité de la doctrine par un accord fait entre eux.
Plusieurs hymnes démontrent ce que nous venons de rapporter.
Voici comment s’opérait l’entente.
Les Brahmanes étaient tous égaux entre eux, le petit nombre qui existait dans chaque bourg en village les rapprochaient facilement les uns des autres ; quand ils se réunissaient à la Cour des Seigneurs féodaux pour des cérémonies solennelles, ils avaient ainsi l’occasion de s’entendre sur les matières religieuses ou de les discuter, enfin les voyages qu’ils faisaient parfois dans des contrées lointaines aux fleuves et aux lacs sacrés, leur fournissaient les moyens de se réunir dans des sortes de conciles, de synodes, dans lesquels on ne discutait guère que les questions religieuses ; or, comme ces sortes de pèlerinages s’accomplissaient chaque année aux mêmes époques, tous les brahmanes pouvaient étudier les divers systèmes des écoles philosophiques.
Les védas nous font également connaître l’origine du pouvoir spirituel de la caste sacerdotale chez les Aryas hindous.
Par ce que nous venons de dire, on voit que le pouvoir spirituel se confondit à l’origine avec l’autorité paternelle, parce que si le culte était public, l’enseignement de la doctrine ne se transmettait dans la famille, qu’avec l’aide des hymnes ; or, l’instructeur des enfants était le père.
Celui-ci après leur avoir donné l’existence matérielle, leur donnait par l’enseignement sacré, une seconde vie spirituelle qui les faisait nommer





























