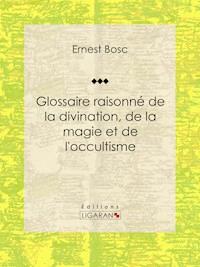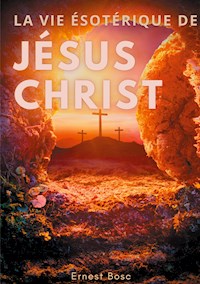
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Théosophie et anthroposophie
- Sprache: Französisch
RÉSUMÉ : "La vie ésotérique de Jésus-Christ" d'Ernest Bosc propose une exploration fascinante et profonde de la vie de Jésus à travers le prisme de la théosophie et de l'anthroposophie. Cet ouvrage se distingue par son approche unique qui allie des interprétations mystiques et philosophiques, offrant ainsi une perspective alternative à la biographie traditionnelle de Jésus. Bosc examine les enseignements de Jésus sous un angle ésotérique, cherchant à révéler des vérités cachées qui résonnent avec les courants spirituels modernes. Le texte s'intéresse particulièrement aux influences spirituelles qui auraient façonné la vie et l'oeuvre de Jésus, et comment ces influences peuvent être comprises dans le contexte de la sagesse ésotérique. L'auteur s'appuie sur des textes anciens et des traditions mystiques pour enrichir son analyse, tout en invitant le lecteur à une réflexion personnelle sur la nature du divin et son impact sur l'humanité. Ce livre s'adresse à ceux qui cherchent à approfondir leur compréhension de la figure de Jésus au-delà des récits conventionnels, en explorant les dimensions cachées de son existence et de son message. En intégrant des concepts issus de la théosophie et de l'anthroposophie, Bosc ouvre une voie vers une compréhension plus holistique et spirituelle de l'histoire de Jésus, suscitant la curiosité et l'émerveillement chez le lecteur. L'AUTEUR : Ernest Bosc est un auteur dont les travaux se concentrent sur l'exploration des dimensions ésotériques et spirituelles de figures historiques et religieuses. Peu d'informations biographiques détaillées sont disponibles sur Bosc, mais ses écrits témoignent d'une profonde connaissance des traditions mystiques et philosophiques. Il s'inscrit dans une lignée d'auteurs qui cherchent à réconcilier la spiritualité avec la compréhension moderne du monde, en s'appuyant sur des courants tels que la théosophie et l'anthroposophie. Ces mouvements, initiés respectivement par Helena Blavatsky et Rudolf Steiner, visent à intégrer la sagesse ancienne avec des perspectives contemporaines, un objectif que Bosc poursuit dans ses travaux. En tant qu'auteur, il s'efforce de rendre accessibles des concepts souvent complexes et de stimuler la réflexion sur la nature du divin et son interaction avec l'humanité. Ses ouvrages, bien que peu nombreux, sont prisés par les lecteurs en quête de spiritualité et de compréhension ésotérique.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 446
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Avant-propos
PREMIÈRE PARTIE : DE LA PERSONNALITÉ DE JÉSUS DE NAZARETH
Chapitre Premier : De la personnalité de Jésus. — Jésus ésotérique
Jésus Ésotérique
Chapitre II : Divers récits sur la naissance de Jésus
Chapitre III : Jésus est-il sémite ou aryen ?
Chapitre IV : Les esséniens ou thérapeutes ou contemplatifs
Chapitre V : Jésus essénien
Chapitre VI : Naissance, enfance et éducation de Jésus
La fontaine de Marie
L’enfance de Jésus
Chronologie de la naissance et des principaux actes de Jésus
DEUXIÈME PARTIE : VOYAGES, MISSION ET PASSION DE JÉSUS
Chapitre VII : Les voyages de Jésus
Chapitre VIII : État de judée avant Jésus
Écoles juives
Chapitre IX : Mission, baptême et prédications de Jésus
Baptême de Jésus
Les prédications de Jésus
Chapitre X : Méthode d’enseignement de Jésus
Une journée de Jésus
Rendez à César
Chapitre XI : Autour du lac de Tibériade. Localités préférées de Jésus.
Sermon sur la montagne.
Le lac de Tibériade
Le Sermon de la Montagne
Pater
Chapitre XII : Les miracles de Jésus, leur explication logique et scientifique, sa thaumaturgie, sa psychurgie
La psychopathologie de J.-C.
Chapitre XIII : Les principaux miracles de Jésus
Guérison d’un lépreux
Guérison d’un enfant
Le Centurion du Capharnaüm
Le fils de la veuve de Naïm
Guérison d’un paralytique à Capharnaüm
La piscine de Béthesda
Guérison d’une forte fièvre
L’homme à la main desséchée
Marie de Magdala
L’enrôlement d’un nouveau disciple
Chapitre XIV : Visite de Jésus chez Lazare
Chapitre XV : Dernière semaine de Jésus ; son arrestation
Le Cénacle
Chapitre XVI : Jugement, condamnation et exécution de Jésus
Chapitre XVII : Jésus-Christ est-il mort sur la croix ?
TROISIÈME PARTIE : ACTION ET INFLUENCE DE JÉSUS SUR LE MONDE NOUVELLES ORIGINES ORIENTALES DU CHRISTIANISME
Chapitre XVIII : Action et influence de Jésus sur le monde
Chapitre XIX : Ésotérisme et mysticisme du christianisme
Le mystère du Christ
Chapitre XX : Nouvelles origines du christianisme
Le Sauveur du monde dans l’Inde
Chapitre XXI : Les historiens de Jésus de Nazareth
Postface
AVANT-PROPOS
Encore une nouvelle Vie de Jésus, dira tout d’abord le lecteur ? A quoi bon ? Il en existe déjà un si grand nombre que le besoin ne s’en faisait nullement sentir !…
Tel n’est pas notre avis ; et voici pourquoi :
Évidemment, écrire une nouvelle « Vie de Jésus » banale (orthodoxe ou hérotodoxe) comme il en existe delà des milliers, ce ne serait vraiment pas la peine de le faire et le besoin ne s’en faisait pas sentir ; mais nous avons la prétention de présenter à un public tout spécial, au public occultiste et théosophique1 une œuvre qui ne ressemble en rien à celles qui l’ont précédée, car au milieu de la quantité innumérable d’Écrits sur l’admirable personnalité du divin Nazaréen, aucun n’est traité au point de vue qui nous occupe et auquel nous nous sommes placés, c’est-à-dire au point de vue ésotérique, au point de vue du pur Ésotérisme.
En effet, parmi les éminents auteurs qui nous ont précédés, aucun n’a traité la Vie ésotérique de N.-S. Jésus-Christ.
Voilà pourquoi nous avons jugé utile et d’un réel intérêt, en ce moment surtout, de traiter à nouveau un sujet qui paraît inépuisable, en nous plaçant à un nouveau point de vue ; du reste, dans le courant de notre étude, nous aurons l’occasion de parler d’un grand nombre d’auteurs, qui ont traité, avant nous, ce sujet captivant entre tous, et de réfuter des théories, parfois singulières, car pour les uns Jésus est Dieu, fils de Dieu, et pour d’autres ce n’est qu’un homme ordinaire, vulgaire même, un simple prestidigitateur pour la plupart, accomplissant des miracles par truquage, par simulation, dit M. Renan.
Pour beaucoup de gens, Jésus n’a jamais existé, c’est un mythe, une légende !
Parmi ces derniers se trouve H.-P. Blavatsky, la co-fondatrice de la Société théosophique anglaise, qui a son siège à Madras, dans l’Inde. Or, c’est là une donnée fausse et qui n’a pu traverser que des esprits singulièrement portés au paradoxe.
On trouvera un peu plus loin l’article en question de madame Blavatsky.
D’un autre côté, des théosophes éminents, M. Leadbeater, entre autres, affirment que la Vie de Jésus peut être racontée heure par heure, étant écrite dans les clichés akasiques, et que si on ne l’a pas publiée, c’est qu’une pareille vie apporterait certainement un grand trouble dans les consciences chrétiennes. Ceci nous paraît un argument singulier, car pouvoir dire la vérité, la vérité historique sur ce personnage qui a bouleversé le monde de la pensée, nous ne voyons pas en quoi cela peut troubler les consciences ; ce qui trouble, c’est la fausseté, c’est le mensonge et tous les troubles du monde doivent passer après la vérité !…
Anna Kingsford et M. Maitland2 deux théosophes aussi reconnaissent eux, qu’il y a un Christ historique ; ils nous disent que pour eux, la révélation a cessé d’être un privilège sacerdotal et est destinée à devenir de plus en plus universelle, mais graduée selon les capacités. Ce n’est pas le Christ historique qu’ils ont voulu nous montrer, mais le Christ-Principe, le Verbe humain et divin, le fils de l’homme devenant, par sa Régénération, le Fils de Dieu dont chaque homme porte en lui le germe latent.
Enfin le colonel américain M. Olcott, le co-fondateur de la S. T. à qui nous avons fait part de ces divergences d’opinions au sujet de Jésus, nous a répondu que comme Initié, Jésus n’ayant pas prévu, comme il aurait dû, le résultat final de sa mission, s’étant trompé à son sujet, avait pu être considéré par H.-P. Blavatsky comme un être mythique, surtout à cause de son histoire arrangée par les Pères de l’Église ; il y a ici, nous l’admettons volontiers, une idée qui pourrait être victorieusement défendue ; mais pour nous, comme pour bien d’autres, comme pour tous les esprits indépendants et de bonne foi, Jésus a existé, mais pas à l’époque exacte, à quelques années près, indiquée par les Livres Saints ; mais enfin, son existence est un fait incontestable !
Une preuve formelle de son existence nous est fournie par un grimoire syro-chal-daïque presque contemporain de Jésus-Christ, le Sepher Toldos Jeschu, dans lequel les Juifs prétendent que tous les miracles du Christ doivent être attribués à la Magie kabbalistique de nom Incommunicable ! Ce nom pouvait être un puissant Mantra, nous le voulons bien, et Jésus le connaissait, comme nous le verrons ultérieurement, mais ce n’était pas la cause unique de la thaumaturgie de Jésus.
La vérité est donc que Jésus a bien existé, qu’il était essénien et un haut Initié de l’Ordre, ce qui lui a permis de posséder des connaissances approfondies sur les phénomènes de la Nature et de produire des faits absolument merveilleux pour la majorité des humains ; ajoutons qu’armé des vastes connaissances que possédait l’Ordre des Esséniens, Jésus était un Thaumaturge et un Thérapeute tout à fait hors de pair.
Voilà ce dont il faut bien se persuader. Ceci établi, formellement admis, la plupart des actes et des faits de Jésus s’expliquent naturellement pour ceux de nos lecteurs, surtout, qui connaissent bien ce qu’est réellement la grande Fraternité essénienne sur laquelle nous fournirons des renseignements certains presque inconnus, pour la plupart.
Beaucoup d’auteurs ont parlé des Esséniens, mais ne nous ont fourni que des données fausses, erronées, auxquelles nous avons substitué des renseignements certains, authentiques, nous nous plaisons à le répéter.
Dans Action de Jésus sur le monde, Daniel Ramée dit avec raison (Introd. x ) : « Les vérités éternelles sont aussi claires pour des cerveaux bien organisés, que les propositions mathématiques, puisque toutes ensembles elles offrent la théologie des choses et n’ont jamais eu besoin du glaive de la justice pour se maintenir intactes dans le monde. C’est que ces vérités ne sont pas uniquement réputées divines, c’est qu’elles sont véritablement divines, et ce qui est divin se conserve et trouve en lui-même sa propre sauvegarde. L’erreur seule a besoin de la défense extérieure et matérielle.
« Depuis les grands travaux de la critique allemande, depuis les ouvrages consciencieux et substantiels de H. C. G. Paulus, en 1828 ; de X. A. Hase, en 1829, D. F. Strauss en 1835, Bruno Bauer en 184i, et autres, la Vie de Jésus est rendue à la vérité historique…
« La Vie de Jésus a donné naissance à une prodigieuse quantité de brochures, au nombre desquelles, on n’en distingue que deux3 réellement sérieuses. Quant au reste, il semble avoir été écrit au temps où la scolastique était en décadence, ces réfutations cléricales ne réfutent rien ; les arguments qu’elles opposent à leurs adversaires ne sont que des sentences, des affirmations, sans preuve et sans science. »
Notre confrère et regretté ami, Daniel Ramée oublie évidemment une étude hors pair du p. Gratry, qui est une réfutation honnête, loyale et des plus consciencieuse de l’œuvre de Renan ; nous aurons l’occasion d’en citer quelques passages dans notre œuvre ; il oublie également la meilleure brochure peut-être sur Renan de l’abbé Mi-chon.
La grande et noble figure de Jésus de Nazareth a tenté bien des érudits et un grand nombre d’écrivains, mais aucun d’eux, nous nous plaisons à le répéter, n’a étudié la Vie ésotérique de Jésus4, et cependant c’était celle-ci qui était de beaucoup la plus vraie, la plus intéressante, mais aussi de beaucoup la plus difficile à étudier ; aussi nous a-t-il fallu de longues années d’études pour constituer et parfaire notre œuvre, afin de pouvoir étayer l’ensemble de nos données sur des preuves tellement concluantes, certaines, qu’elles puissent passer, auprès des lecteurs même très difficiles à satisfaire, pour des preuves véritables, d’autant que la vie de Jésus ne fournit que de rares matériaux d’une origine certaine, et ces matériaux sont difficiles à souder entre eux, à réunir en un bloc parfait pour restituer la Personnalité historique du divin Nazaréen.
Les sources originelles, documentaires, se réduisent à fort peu de chose, quelques lignes de Tacite, qui parle même avec un grand dédain « d’un certain Christus condamne à mort sous le règne de Tibère par ordre du Procurator Ponce Pilate ».
Et Tacite écrivait les lignes qui précédent trois quarts de siècle après l’exécution du jugement.
Suétone n’est guère plus explicite ; quant à la lettre de Pline à Trajan, personne n’ignore aujourd’hui qu’elle est apocryphe.
L’historien Josèphe le juif ne nous donne que fort peu de renseignements ; un seul passage de ses œuvres, très certainement interpolé ; quant à d’autres sources, la plupart ne peuvent avoir aucune espèce d’autorité, car trop souvent elles affectent le caractère d’une polémique plutôt injurieuse ; on ne saurait donc y puiser des données de quelque valeur.
Nous sommes donc limités dans nos matériaux aux seuls livres du Nouveau Testament, et parmi ceux-ci aux seuls Évangiles dont la valeur historique est non seulement des plus contestée, mais des plus contestable.
Ainsi, l’Évangile de Marc, disciple et interprète de l’apôtre Pierre, nous donne un résumé de la prédication de celui-ci. Cet Évangile remonte vers l’an 65 ou 70 de l’ère chrétienne. On peut contrôler ledit résumé par les Évangiles de Mathieu et de Luc, car l’un et l’autre de ces apôtres ont reproduit celui de Marc ; mais nous possédons aussi un Recueil de discours, sentences et paraboles de Jésus, écrit par Mathieu même, en langue araméenne. Ce Recueil, d’un prix inestimable, remonte à dix ans plus haut que l’Évangile de Mathieu et nous permet de nous faire, jusqu’à un certain point, une idée à peu près exacte de l’Enseignement de Jésus.
Dans l’Évangile de Luc, nous trouvons, indépendamment du récit primitif de Marc et des Logia de Mathieu, au document de premier ordre ; nous voulons parler « de l’Évangile des Voyages de Jésus 5 », fragment important et original de Luc dans lequel nous voyons en particulier la visite de Jésus aux deux sœurs Marthe et Marie, l’histoire de Zachée le Péager, ainsi que les paraboles du bon Samaritain, de l’Enfant prodigue, du Pharisien et du Péager, celle du mauvais Riche, celle du Figuier stérile, et d’autres encore.
Dans l’Évangile de saint Jean, nous puiserons des renseignements en plus grand nombre que dans les autres apôtres, parce que cet Évangile nous paraît de beaucoup le plus authentique, se rapprochant certainement le plus de la vérité ; malheureusement, il a été singulièrement été travesti, on y voit des traces évidentes de fraudes qu’il nous a été facile d’effacer pour y substituer ce que devait fournir le texte primitif.
L’Évangile de Jean date probablement de la fin du premier siècle ; ce dont on est certain, c’est que vers l’an 150 environ, personne ne se doutait de son existence. Pour nous, cet Évangile représente la plus belle version de la vie de N.-S., c’est pourquoi nous l’avons préférée aux Évangiles synoptiques, et cela en toute connaissance de cause, car nous n’ignorons pas que Renan a dit au sujet de cet Évangile que :
« Toute personne qui se mettra à écrire la vie de Jésus sans théorie arrêtée sur la valeur relative des Évangiles, se laissant uniquement guider par le sentiment du sujet, sera ramenée dans une foule de cas à préférer la narration de Jean à celle des synoptiques. Les derniers mois de la vie de Jésus en particulier ne s’expliquent que par Jean ; une foule de traits de la Passion, inintelligibles dans les synoptiques6, reprennent dans le récit du quatrième Évangile la vraisemblance et la possibilité. »
Et après avoir écrit les lignes qui précèdent, Renan dit ce qui suit, qui semble contredire, en partie, ce que nous venons de voir de cet auteur :
« C’est l’auteur du quatrième Évangile, en effet, qui est le meilleur biographe de Jésus7.
« Le canevas historique du quatrième Évangile est la vie de Jésus, telle qu’on la savait dans l’École de Jean ; c’est le récit qu’Aristion et Presbyteros Joannes firent à Papias, sans lui dire qu’il était écrit, ou plutôt n’attachant aucune importance à cette particularité. J’ajoute que, dans mon opinion, cette École savait mieux les circonstances extérieures de la vie du Fondateur que le groupe dont les souvenirs ont constitué les Évangiles synoptiques. Elle avait, notamment sur les séjours de Jésus à Jérusalem, des données que les autres ne possédaient pas. Les affiliés de l’école traitaient Marc de biographe médiocre, et avaient imaginé un système pour expliquer ses lacunes8 . Certains passages de Luc, où il y a comme un écho des traditions johanniques9 , prouvent du reste que ces traditions n’étaient pas pour le reste de la famille chrétienne quelque chose de tout à fait inconnu…
« En somme, j’admets comme authentiques les quatre Évangiles canoniques. Tous, selon moi, remontent au premier siècle, et ils sont à peu près des auteurs à qui on les attribue ; mais leur valeur historique est fort diverse. »
Ceci est incontestable, c’est pourquoi nous avons préféré l’Évangile de Jean, dans lequel on retrouve des traits, des éclairs de lumière qui viennent réellement du divin Maître ; puis c’est bien dans cet Évangile et non dans les autres qu’on retrouve tout le mysticisme, tout l’Ésotérisme du divin Nazaréen.
Du reste, des textes formels nous en parlent comme d’un document de premier ordre ; c’est Justin10, Athénagore11, Tatien12, Théophile d’Antioche13et Irénée14.
Le rôle qu’a joué l’Évangile de Jean dont le Gnosticisme est très visible principalement dans le Montanisme15, dans le système de Valentin16ainsi que dans la controverse des quartodécimans17.
On peut suivre l’École de Jean pendant tout le second siècle.
On admet généralement que la Première Épître attribuée à Jean est bien de lui ou de l’auteur de son Évangile, le fait est confirmé par Polycarpe18.
Les documents johanniques renferment aussi, d’après nous, des renseignements très utiles, très importants, qui complètent et corrigent parfois les traditions de cette époque si intéressante.
Enfin en ce qui concerne la Passion de Jésus. Nous avons cru devoir nous inspirer d’un livre écrit par une Visionnaire, par Anne Catherine Emmerich, car bien des révélations de la pieuse religieuse nous paraissent empreintes de vérité ; nous ne pouvons regretter qu’une chose, c’est que l’auteur qui a rédigé ces visions ait certainement apporté bien des changements, qu’un œil exercé peut parfaitement reconnaître ; nous avons donc agi avec la plus extrême prudence dans les emprunts faits dans ce livre très remarquable au point de vue historique, nous ne craignons pas de l’affirmer.
Nous avons puisé beaucoup de faits anecdotiques dans l’Évangile de Marc, car les détails et les anecdotes sur un personnage en vue peuvent fournir des renseignements instructifs, ils reproduisent souvent en effet, des choses de tradition et sont dès lors plus vrais que de longs discours, d’amples dissertations tels que ceux qui figurent par exemple dans l’Évangile de Mathieu.
Un ou deux siècles après J.-C., il a paru de nombreux évangiles : Évangile selon les hébreux, Évangile suivant les Égyptiens, etc. Que les Évangiles en général et ces derniers surtout, soient en partie légendaires, c’est là un fait incontestable, mais tous, disons-le franchement, contiennent un grand fond de vérité et on peut le constater souvent ; on peut avec un peu d’intuition séparer le bon grain de l’ivraie ; on peut voir ce que le sectarisme passionné a pu ajouter et soupçonner, ce qu’il a pu retrancher. Ce qu’il faut surtout examiner et étudier avec le plus grand soin, c’est l’époque à laquelle ont été faits les divers Évangiles et par qui ils ont été faits ou inspirés.
Tels sont les éléments à l’aide desquels on peut reconstituer une synthèse de la vie de Jésus, sinon à peu près véridique, au moins en tout cas vraisemblable, et pouvant commencer à entrer dans le domaine de l’histoire.
De la quantité des documents sérieux, étudiés soigneusement par nous, il résulte que :
Jamais Jésus ne songea à créer un mouvement révolutionnaire pour soustraire les Juifs au joug romain ; il voulait seulement inaugurer une révolution sociale pour assurer aux déshérités les moyens d’existence qui leur faisaient alors, comme aujourd’hui, complètement défaut.
Il annonçait bien l’avènement du Règne de Dieu, mais ne pensa jamais avoir été le Messie ; ce n’est qu’après sa crucifixion, que ses disciples lui attribuèrent cette qualité. Jésus fit une grande propagande pour ses idées, mais sans aucun plan préconçu. Ses discours exaspérèrent les représentants de la Théologie officielle, surtout quand il annonçait l’imminente, d’une révolution sociale. Ces sentiments du Novateur Nazaréen irritaient les détours de la Synagogue, qui finirent par obtenir son supplice, en y employant toutes sortes de moyens iniques et perfides, mais surtout en agitant devant le Procurator romain, le spectre rouge de la révolution contre Rome, contre César ; voilà son crime.
Après le crucifiement de leur Maître, les disciples retournent en Galilée et y élaborent la doctrine de Jésus, qui est bien, malgré tout ce qu’on a pu dire, l’œuvre d’un philosophe, d’un penseur profond, humanitaire, car il a été surtout puissant par la passion, la bonté, le cœur.
Sa vie n’a été qu’une lutte, un combat ferme et sans violence. Il savait, il voulait, il osait, mais il ne sut pas se taire.
Voilà pourquoi sa mission ne fut pas entièrement accomplie !…
Du reste, il ne pouvait pas se taire, puisque sa mission consistait précisément à prêcher à tous et partout la vérité, à répandre la parole de son père.
Après la disparition de Jésus, il se forma un Parti dit des Nazaréens qui pratiqua les traditions du Maître.
Qu’étaient au juste ces Nazaréens
C’était une secte ou société secrète, qui avait beaucoup d’affinité avec les kabbalistes. Cette Confrérie on Fraternité, comme on voudra l’appeler, étudiait la Loi de Moise et la commentait. Elle ne prit guère naissance qu’un peu avant la venue de J.-C. ; on suppose que celui-ci était un de ses affiliés. Mosheim19fait naître cette secte au ive siècle. C’est très certainement une erreur, car saint Jérôme et saint Épiphane la font remonter au commencement du christianisme20.
Pour écrire notre œuvre, nous avons travaillé avec une autre méthode, nous avons noté avec la plus scrupuleuse attention tous les faits qu’affirment les Évangiles et nous avons admis ceux qui ne paraissent pas avoir été ajoutés par des interpolateurs ou des sectaires intéressés à altérer leur vérité.
Nous avons écarté pour l’écrire tout sentiment personnel, toute émotion exagérée, passionnée, ainsi que tous les systèmes et théories préconçues, pour n’envisager « que le critère absolument impersonnel » comme dirait M. Strada.
Nous avons suivi tous les principaux faits de la vie du Nazaréen, nous les avons réunis, groupés entre eux d’une façon probante et nous les avons amenés jusqu’à la conclusion logique qu’ils commandent, et cela, sans nous préoccuper des résultats qu’ils témoignent en faveur d’une thèse ou d’une théorie, même de celles qui pourraient aider ou favoriser un sectarisme quelconque.
Avec un grand nombre d’auteurs, M. Strada21attribue au divin Maître une ambition temporelle qu’il n’a jamais eue, il le montre comme voulant s’emparer du pouvoir temporel afin de se faire élire le chef du peuple juif, puis n’ayant pas réussi dans cette tentative, il se serait contenté, d’après cet auteur, de poursuivre un pouvoir spirituel pour remplacer à lui seul la hiérarchie des prêtres et créer, pour ainsi dire, une organisation théocratique et papale, qui aurait été soutenue par ses douze disciples ou apôtres, un pour chaque tribu.
Ces données ne reposent sur aucune base solide.
Quand on a bien médité et réfléchi sur l’homme et sur son noble caractère, on peut certainement affirmer ceci :
Jésus est venu apporter à la terre l’étincelle du pur amour. Il a accepté, au sein même du Père, le courant du feu divin, qui seul peut régénérer l’humanité.
Ce feu supra-sensible est le feu Principe-créateur ; lui seul donne la vie. Il anime la matière dans tous les règnes et dans tous les cieux. — Dans l’âme, où ce feu céleste a une fois pénétré, il ne peut y avoir de souillures, car tout ce qui est contraire à l’amour est enlevé, dès qu’il agit sur une âme. Le processus de l’amour dans celle qui se donne entièrement à lui, est le plus merveilleux des phénomènes les, et de celui-là on peut dire qu’il est surnaturel, car plus rien de matériel, dépendant de la nature objective à n’importe quel état de subtilité, n’existe plus ! Et l’être ainsi sanctifié par ce feu divin, bien que vivant parmi les humains, n’appartient déjà plus à leur race. Son enveloppe charnelle n’est qu’un véhicule purement automatique qui lui permet de prendre contact avec les Terriens ; son système psychique même, est modifié, il est en état de somnolence ; seul le Corps Causal22est en pleine activité, mais toutefois, ne fait pas sentir sa puissance au corps physique que dans de fugaces éclairs, pas toujours d’une manière régulière dans le commerce de l’être (ainsi élevé) avec les humains. Ce n’est que par l’amour que l’homme peut vaincre ses mauvaises tendances, qu’il a cultivées lui lui-même et cela forcément durant sa longue période d’évolution, alors que l’instinct qui lui était fourni par la nature inférieure pour sa sauvegarde l’y incitait constamment.
Jésus donc est venu sur la terre pour accomplir une seule mission : Prêcher à l’homme l’amour de son prochain, lui faire comprendre la grande Loi de solidarité.
Tout son enseignement pourrait être formulé et résumé dans ces deux sentences essentiellement esséniennes :
Aimez-vous les uns les autres ! Que la Paix soit avec vous !
Il y a de nombreuses années que nous voulions écrire la Vie du divin Maître, de l’Esprit protecteur de notre Planète, au point de vue ésotérique ; en agissant ainsi nous pensions réaliser le vœu magnifique exprimé par Proudhon23en ces termes : « Jésus est une individualité à retrouver, à restituer, à refaire presque, tant il a été dissous, pulvérisé par la religion même, dont il a été l’auteur.
« Rétablir cette grande figure dans sa vérité humaine et dans la réalité de son œu-vre est aujourd’hui un travail de première nécessité. Et le moment approche où Jésus ainsi représenté au public obtiendra un succès égal à celui qu’il eut, il y a 1830 ans, dans les campagnes de Galilée.
« Or Jésus dépouillé de ses miracles, de sa messianité, de sa divinité, de tout prestige surnaturel, ramené à la vérité de sa nature, à sa pure individualité, devient un homme prodigieux.
« Sa carrière publique est à peine d’un an ; tout ce qui la précède est inconnu, mais heureusement n’a pas besoin d’être connu. De sa vie privée, de son caractère, de son individualité, même pendant sa mission, on ne sait rien, que juste ce qu’il faut pour constater que ce Jésus fut très positivement un homme, non un Dieu, ni un fantôme ; non une création de la légende, une ombre.
« Ce qu’on sait ensuite, non complètement, mais suffisamment, c’est son Œu-vre, œuvre à la fois humanitaire et individuelle et c’est ici que se manifeste la grandeur immense du sujet.
Telle est bien l’idée que nous avons eue, le projet que nous avons caressé en écrivant cette nouvelle œuvre.
Avons-nous réussi dans notre délicate et périlleuse entreprise ?
Avons-nous retrouvé, restitué, refait, cette grandiose Personnalité ?
Nous en faisons juge le Lecteur !
E. D. Paris, 25 octobre 1901
1 Sous ce terme Théosophique, nous englobons toutes les personnes qui s’occupent et qui étudient la sagesse divine, l’antique Sagesse, qu’il vaudrait mieux dénommer Cosmosophie, nous comprenons également sous ce même terme, toutes les personnes qui s’occupent purement de religion ou de philosophie spiritualiste.
2 La voie parfaite, traduit de l’anglais : vol. in-8, Paris 1892, Félix. Alcan, éditeur ; préface page ii.
3 Lettre adressée à M. Ernest Renan, par Henri Disdier, Genève, 1863, in-8°. Jésus devant l’histoire ou examen de la vie de Jésus de M. Renan, par Havet in-8°, 1863. — Voyez aussi une critique de Charles Selles dans la Revue du Progrès, n° de juillet 1863, page 48i.
4 Le beau livre de Anna Kingsford et de Maitlsand, La Voie parfaite, dont nous venons de parler a pour sous-titre ; ou Le Christ ésotérique, c’est-à-dire le type Christ pris non dans le sens historique, mais dans le sens ésotérique, ce qui est tout différent d’une Vie ésotérique de J.-C.
5 ix, 5 ; xviii, 44.
6 Par exemple ce qui concerne l’annonce de la trahison de Judas.
7 Vie de Jésus. Introd, XXXVI.
8 Papias, loc. cit. (c’est-à-dire dans Eusèbe, Hist. Eccl, III. 39).
9 Ainsi le pardon de la femme pécheresse, la connaissance qu’a Luc de la famille de Béthanie, son type de caractère de Marthe répondant au dihkÒnei de Jean (xii, 2), le trait de la femme qui essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux, etc., etc.
10 Apol., I, 32, 6I Dialog. cum. Tryph., 88.
11 Legatio pro Christ., IO.
12 Adv. Græc. 5, 7.,cf. Théodoret, Hæretic. fabul.,l, 20. Eusèbe H. E., IV, 29.
13 Ad autolycum.
14 Adv. hær., II, xxii, 5; III, i.
15Irénée, adv. hær., III, xi, 9. Eusèbe, Hist. Eccl., V, 24.
16Ibid. III, i; II, xxii.
17Eusèbe, Hist. Eccl., V,24; Papias in Eusèbe, Hist. Eccl.III, 39; Irénée, adv. hær., III, xvi, 5-8.
18 Epist, ad Philipp., 7-9.
19 Indice antique christianorum disciplinæ, Sect I, chap. V.
20Ceux de nos lecteurs, qui voudraient des renseignements sur la secte n’auraient qu’à consulter le Codex Nazareus, 3 vol., publié par Mathieu Norberg, 1815.
21Dans Jésus et l’Être de la science, in-12, Paris, Oliendord, 1895.
22En théosophie, ou nomme Corps Causal un agrégat de substance subtile que constitue le manas supérieur (Ego supérieur) — On dénomme cet Ego « Corps Causal » parce qu’il porte en lui les germes des autres principes huamins et toutes les causes crées par les actes de la vie individuelle qu’il représente.
23 Jésus et les Origines du Christianisme, p. 138 et 140.
PREMIÈRE PARTIE :
DE LA PERSONNALITÉ DE JÉSUS DE NAZARETH
CHAPITRE PREMIER :
DE LA PERSONNALITÉ DE JÉSUS. — JÉSUS ÉSOTÉRIQUE
C’est avec beaucoup de raison que l’on a dit qu’il fallait le recul du temps pour bien juger d’une époque ; a fortiori, dirons-nous, pour bien juger d’une Personnalité, surtout quand elle a occupé dans l’histoire, dans la philosophie et dans la religion une très grande situation, ce qui est bien dans le cas de N. S. Jésus-Christ.
La religion, celle-ci, appartient l’humanité, comme l’a fort bien dit Proudhon, et c’est pourquoi tout le monde a le droit d’en parler, ce qu’en aucun temps et sous aucun climat, le prêtre n’a voulu permettre.
« Je cherche les lois du juste, du bien et du vrai 24 ; ce n’est qu’à ce titre que je me permets d’interroger la religion. Elle appartient à l’humanité ; elle est le fruit de ses entrailles. A qui serait-elle méprisable ? Honorons en toute foi, en toute Église reconnue ou non reconnue par l’État, honorons jusque dans le Dieu qu’elle adore, la conscience humaine : gardons la charité, la paix avec les personnes à qui cette foi est chère. C’est notre devoir et je n’y manquerai pas. Mais la piété publique satisfaite, le système de la théologie appartient à ma critique ; la loi de l’État me l’abandonne ».
Ces idées de Proudhon sont fort justes et permettent de traiter la question, pouvons-nous dire, avec toute liberté d’action, il faut, du reste, pour la traiter, posséder une sorte d’intuition, de prescience et d’inspiration.
Proudhon nous dit que le système de la Théologie appartient à sa critique, mais nous devons ajouter que beaucoup d’auteurs ont voulu faire de la théologie, la Boussole de la science ; c’est là une grave erreur, car la théologie et la science sont des ennemies implacables. Aussi nous ne pouvons que partager absolument l’avis de M. Charles Naudin, l’honorable et regretté membre de l’Académie des sciences quand il dit 25 :
« Ce que je ne puis concéder, c’est que la théologie serve de flambeau à la science. Toutes deux sont légitimes, mais elles correspondent à des aspirations différentes ; toutes deux doivent rester indépendantes dans leurs allures, pour que leurs décisions fassent autorité.
« La théologie et la science ont toujours fait mauvais ménage et se sont nui mutuellement toutes les fois qu’on a voulu les enchaîner l’une à l’autre. Il y a entre elles incompatibilité d’humeur. Le propre de la science est la libre recherche dans toutes les voies accessibles à l’esprit humain, et tant qu’elle reste sur son domaine, toutes les audaces du libre penseur doivent lui être permises. Les erreurs, quand elle en commet, c’est à elle-même de les redresser et il n’est pas à craindre que ses erreurs s’éternisent dans un temps où toutes les théories sont discutées et contredites. Mais malgré leur antagonisme, qui est plus apparent que réel, la théologie et la science convergent à une même fin, qui est, si je ne me trompe, de résoudre le problème de la destinée humaine. »
Mettant à profit les idées qui précèdent, nous entrerons immédiatement dans le vif de notre sujet.
Et tout d’abord, la première pensée qui se présente à l’esprit est celle-ci : Jésus est-il Dieu ou bien n’est-il qu’un homme ?
Pour les uns, Jésus est Dieu, le fils de Dieu, la seconde personne de la Trinité !
Pour les autres, Jésus n’est qu’un homme, qu’une créature humaine ne comportant dans sa personne rien autre de divin, que n’en comporte tout le reste des humains.
Or, nous ne saurions partager complètement l’une ou l’autre de ces opinions.
Pour nous, Jésus est un être humain et Dieu à la fois, mais pas de la façon que le croit et l’admet l’Église catholique et avec elle le bon vulgaire.
Pour nous, Jésus est ce que l’on nomme dans la science hindoue un Nirmana-kaya, c’est-à-dire un être humain très avancé, très évolué qui, par une série d’existences, a atteint le Nirvâna, mais qui n’a pas voulu user de la haute situation que lui a mérité son Karma, pour être utile à ses frères en humanité, qui a voulu les aider à racheter leurs fautes par une expiation imméritée. C’est là le sacrifice sublime fait par Jésus pour le bonheur, pour l’avancement et le plus grand progrès de ses Frères terriens.
Le sacrifice par lui une fois accepté, il se réincarne sur la terre et là, il oublie sa grande Personnalité, sa qualité de Nirmanakaya (une sorte de Divinité) pour ne rester qu’un simple humain comme tous ses frères en humanité. Et c’est ceci, qui explique son beau rôle envers l’humanité, de même que le mérite de ses souffrances.
Avant de poursuivre cette thèse, nous parlerons de la question de la réincarnation de Jésus. Bien des personnes se sont demandé et se demandent journellement, si le Christ a été soumis à la Loi de la réincarnation, puisque ce n’était qu’un être humain et non un Dieu ?
Comme dans toutes les graves questions les uns sont pour la réincarnation, les autres s’inscrivent contre elle. Parmi ceux-ci, nous devons mentionner l’opinion de Roustaing dans son ouvrage intitulé : Les Quatre Évangiles, « la Vie médiani-mique dictée, dit l’auteur, par ceux qui ont préparé la mission terrestre de Jésus et qui ont participé à son accomplissement » (Mathieu, Marc, Luc et Jean).
Nos lecteurs sont évidemment libres de ne point ajouter foi à cette hypothèse.
« Jésus, y dit-on, était et est infaillible, comme étant en rapport direct et constant avec Dieu. Sa pureté parfaite lui permettait d’approcher du centre de toute pureté ; il était et il est son Verbe auprès de nous, en ce sens qu’il était et qu’il est, et par, et pour son Dieu et votre Dieu son père, votre maître. »
Pour bien comprendre ce terme infaillible que Roustaing applique à Jésus, nous mentionnerons ce qu’il écrit à ce sujet :
« Les Esprits, dit-il, qui, dociles aux esprits chargés de les conduire, de les développer, ne faillissent point, continuent à progresser à l’état fluidique. »
Ceci est généralement admis par tous les occultistes réincarnationistes.
Dès lors, d’après Roustaing, pas d’incarnation pour ceux-là et partant pas de réincarnation, et d’après cet auteur Jésus aurait été de ceux-là.
Nous n’hésitons pas à nous inscrire en faux contre une pareille thèse. — Jésus, en effet, avait fini, en tant qu’humain, la série de ses existences, quand il est venu accomplir bénévolement, volontairement sa mission angélique ; il était, suivant la philosophie bouddhique, nous l’avons déjà dit, un Nirmanakaya, c’est-à-dire un Saint ayant atteint le Nirvâna, et il a sacrifié sans regret, sans aucune hésitation, cet état de béatitude, auquel il avait droit pour venir instruire ses frères et améliorer leur sort, comme nous l’avons dit précédemment. Or, si nous admettions la thèse catholique : Jésus est Dieu, Fils de Dieu ; dans ce cas où serait son mérite ?
Sa personnalité divine lui permettant de supprimer toute douleur, toute souffrance, Jésus, dans sa Passion, n’aurait rien, absolument rien souffert, il aurait donc joué une infâme comédie, ce qu’admet Renan l’athée, ce qui est de toute impossibilité, ce qui est absolument inadmissible ; et c’est cependant ce qu’ad-mettent implicitement certains écrivains catholiques ! Tandis qu’au contraire, Jésus n’étant qu’un homme, un simple humain (dès lors, rien de ce qui est humain ne lui est étranger), il éprouve donc la joie, les tristesses, la douleur, les humiliations et les souffrances de tous genres. Rien ne lui est épargné ; au contraire, sa nature sensitive, hautement sensitive, lui fait éprouver une plus grande acuité de sensation. S’il résiste aux tentations, il en a tout le mérite ; s’il porte sa croix, il en souffre, il en supporte le poids réel, la charge tout entière ; s’il est injurié, souffleté, tourné en dérision, s’il subit toute sorte d’opprobres et d’avanies, il éprouve réellement dans son esprit, dans son cœur, dans son âme, dans sa chair, toutes les avanies, toutes les douleurs, toutes les souffrances, et il ressent toutes ces émotions avec une intensité inconcevable, comme les ressentent les natures sensibles et généreuses. Étant libre d’échapper à toutes ces épreuves, s’il les surmonte victorieusement il doit récolter et il récolte effectivement tout le mérite de son immense sacrifice, et c’est la Douloureuse Passion, qu’il subit dans son extrême rigueur, qui sert d’exemple aux hommes et qui rachète ainsi tous les crimes de l’humanité.
Donc, ceux qui considèrent Jésus comme un simple humain l’exaltent beaucoup plus et le glorifient bien autrement que les catholiques orthodoxes qui le considèrent comme Dieu ; de plus, ils sont beaucoup plus logiques, puisque, pour souffrir réellement, intégralement sa Passion, il lui faut n’être qu’un homme, le fils d’une femme, d’une Vierge devenue mère par le moyen ésotérique que nous expliquons plus loin, car Joseph n’a jamais été que le père nourricier de Jésus.
Nous partageons complètement en ceci les vues de l’Église catholique, apostolique et romaine.
Il n’y a guère que Paul, l’apôtre des Gentils, qui ait bien compris la personnalité de Jésus ; il la considère comme humaine, mais d’une humanité transcendante ; pour Paul, comme pour nous, Jésus est le plus grand des hommes parmi les grands hommes et à quoi faut-il attribuer cette transcendance ? A la pluralité de ses existences ; dans chacune de celles-ci, Jésus a pu atteindre une évolution supérieure, l’évolution finale, celle des Nirmanakayas.
Or, les évangélistes eux-mêmes reconnaissent que Jésus était venu d’autrefois sur la terre, donc il n’est pas venu il y a dix-neuf siècles pour la première fois ; c’est là un fait irréfutable. Si donc il s’est réincarné plusieurs fois, il n’était pas Dieu, mais simplement un homme. Ceci est généralement admis par des philosophes et des exégètes catholiques, chrétiens.
Du reste, la divinité de J.-C. n’était pas formellement admise dans les premiers siècles du christianisme.
Voici, à ce sujet, l’opinion d’un pasteur, protestant il est vrai, M. Albert Ré-ville, mais précisément à cause de sa qualité, très compétent et très versé dans les questions religieuses et notamment dans celle qui nous occupe.
Or, d’après M. Réville 26, la croyance à la divinité de J.-C. commença à se former chez les Gnostiques, en vacillant longtemps dans les écrits des ères apostoliques ; elle s’affermit avec Justinien le martyr et l’Évangile attribué à Jean, et elle ne triompha contre la doctrine plus rationnelle d’Arius au concile de Nicée en 325, que par la pression purement politique de l’Empereur.
Le catholicisme a marqué le premier pas vers le polythéisme, les autres en sont la conséquence ; ce n’est que le premier pas qui coûte. Du dithéisme, avec le Christ du ive siècle, nous passons au trithéisme avec le Saint-Esprit dans le symbole Quicumque du viiie siècle, et nous aboutissons au tétrathéisme du Concile du Vatican avec Marie l’immaculée : « C’est logique, avec les papes infaillibles, ils augmenteront encore le catalogue, si on leur en laisse le temps. »
En envisageant, ainsi que nous venons de le faire, la belle personnalité de Jésus, nous entrons par là en plein ésotérisme ; nous sortons des sentiers faux et battus, nous entrons dans la saine tradition, dans la vérité ésotérique.
Et c’est dans celle-ci et par celle-ci que nous allons écrire la Vie du grand martyr, du grand Crucifié, par la haine et la méchanceté des sacerdotes, des rabbins de l’ancienne et despotique loi de Mosché (Moïse), sacerdotes, eux, qui n’ont jamais changé, dans tous les temps et dans tous les pays, et qui semblent avoir adopté une devise célèbre : Ut sint, aut non sint.
Ils sont tels, sans cela ils ne seraient pas !
C’est précisément pour détruire cet état de choses, que Jésus est venu en ce monde comme Sauveur.
Telle est nettement caractérisée la personnalité du doux Nazaréen, telle était bien sa véritable mission :
Réformer les abus, donner à chacun sa part de soleil, proclamer la fraternité et la solidarité humaines et n’employer pour tout ce vaste effort que l’amour, ces simples mots :
Aimez-vous les uns les autres.
JÉSUS ÉSOTÉRIQUE
Nous avons dit dans notre Avant-Propos qu’aucun auteur n’avait écrit une Vie ésotérique de Notre Seigneur Jésus-Christ, qu’aucun n’avait jusqu’ici envisagé la vie de Jésus au point de vue ésotérique. Ceci est exactement vrai, mais ne signifie pas qu’aucun auteur n’ait jamais voulu effleurer le sujet. Au contraire, ces derniers sont très nombreux.
Ainsi, quand nous parlerons des Esséniens, nous mentionnerons un volume de MM. R. Girard et Garredi, qui renferme quelques données assez timides sur l’ésotérisme de la vie de Jésus ; nous reconnaissons également que notre collègue de la société théosophique, Franz Hartmann, dans son Jehosuah von Nazareth, a traité subsidiairement de l’ésotérisme de la vie de Jésus 27.
Un auteur français, un jeune philosophe catholique, M. Albert Jhouney, dans un opuscule intéressant, a esquissé quelques idées ésotériques au sujet du Christ, mais n’a jamais eu la prétention d’écrire une Vie ésotérique de Jésus.
Nous analyserons brièvement les rages écrites par cet auteur avant sa conversion complète au catholicisme, de sorte qu’aujourd’hui, Albert Jounet n’écrirait peut-être pas ce qu’a écrit l’ésotériste Albert Jhouney.
Quoi qu’il en soit, voici la thèse soutenue par notre honoré confrère et ami.
Il débute en nous disant que le nom et l’œuvre de Jésus de Nazareth a déjà passionné et passionnera encore longtemps l’humanité, et qu’un politicien de l’Église dit un jour à un saint prêtre (à l’abbé Rocca, pensons-nous) :
Vous ne savez que racler cette vieille guitare de l’Évangile ! Mais n’insistons pas.
A. Jhouney dit que le Christ, tel que nous l’ont montré les prêtres, est méconnaissable, ce n’est pas l’esprit de charité et de fraternité qu’il a toujours été et que, quand l’Évangile aura trouvé un bon interprète, il deviendra tellement lumineux que tout le monde et jusqu’aux prêtres eux-mêmes seront chrétiens.
C’est bien là notre opinion, de même que nous partageons pleinement les idées suivantes, si bien exprimées.
« Mais ce Christ vivant, ce Christ lumineux, ressuscité dans le cœur des peuples et adoré par le Sacerdoce des temps nouveaux, ce Verbe de gloire est-il celui que le dogme obscurcit et que la négation repousse ? Je ne le crois pas ! Et je suis convaincu que la victoire du christianisme serait impossible sans une conception plus vraie, plus évangélique et plus profonde du Christ. »
M. Jhouney ajoute quelques lignes après :
« Le désir israélite pur n’eut de fidèles que les millénaires attendant le retour visible et triomphant du Roi, qui régnerait mille ans sur le peuple des Elus. »
Les douteurs modernes qui ont traité de notre sujet, dont le plus célèbre est M. Ernest Renan, nous montrent le Christ comme un homme, tout simplement ; ils ne reconnaissent ni n’admettent la dualité de sa nature, dit notre auteur ; pour ces gens-là, ce n’est qu’un homme exalté d’une haute moralité, bien que capable de simuler le miracle, afin de frapper les esprits et pouvoir ainsi propager sa doctrine avec plus de fruits. Ils vont même jusqu’à nous représenter cette noble figure comme un inconscient devenant Messie par déférence, par complaisance envers ses disciples, et heureusement sauvé du ridicule par sa mort.
En ce qui concerne sa mission, ils veulent bien reconnaître que, malgré ses faiblesses, il eut de beaux élans de prophète et de thaumaturge.
« Pour Renan, le Christ est un homme dont l’idéalisme a contribué à parer l’humanité, et dont le caractère mêlé de grandeur et de défaillances le fait le premier et le plus illustre de ces mystiques capables d’héroïsme et de ruses, comme l’histoire nous en montre. C’est un Mahomet sans la chair et sans le sabre ; un Savonarole plus puissant, peut-être moins pur, un moraliste, un idéaliste et un charmeur dans le sens oriental, un peu Magicien, un peu équivoque.
« Telle est l’image que le doute moderne se forme du Christ. »
Un peu plus loin, A. Jhouney partage, sans le dire ouvertement, notre idée que le Christ est un Nirmanakaya, quand il dit que l’action des âmes supérieures dans notre monde est la cause de tout ce qui arrive de beau et de bien.
Puis, Jhouney trouve dans Jésus une sûreté dans ses affirmations essentielles, un équilibre parfait, un caractère de vie et de perfection admirables. Le comparant avec les prophètes d’Israël, il nous dit que ceux-ci ont bien une élévation robuste, mais non pas la tendresse et le charme profond de Jésus ; ils n’ont pas non plus sa douceur et en même temps son énergique fermeté.
Au point de vue ésotérique, Jhouney reconnaît que le Christ est né de Dieu comme toutes les âmes et… qu’il subsiste de son être humain tout ce qui est nécessaire pour que son sacrifice fût réel. En ce qui concerne la Trinité, le Christ, étant un homme, correspond naturellement au principe masculin de ladite Trinité… Et le Christ ésotérique embrasse et incarne toute la Trinité ésotérique… La doctrine de Jésus fit rayonner les vérités essentielles qui suffirent à réunir l’homme et Dieu. Il effaça de la religion toutes les vaines pratiques, tous les rites et cérémonies extérieurs et inutiles, pour ne laisser subsister que la charité, l’observation, les commandements venant du cœur pour honorer Dieu… Quant à sa prédication directe, elle fut uniquement, essentiellement morale.
« Nul mieux que Jésus n’eut le sens de l’âme, ne connut plus intimement que lui, que l’âme, le fond de l’être, ne vit que d’amour, de pureté et de justice, et que tout le reste est du superflu, qui vient par surcroît. »
« Dieu lui avait donné cœur à cœur la vérité réelle. Et il était trop sûr que Dieu seul peut la donner pour enseigner aux hommes une autre voie. La vérité profonde n’est qu’en Dieu et pour aller à Dieu il n’y a que le bien.
Puis, notre confrère ajoute :
Dans ses Paraboles sur le royaume de Dieu, Jésus nous indique les vérités que le Père enseigne, ainsi que tout ce qu’il révèle aux humbles et qu’il cache aux puissants. Le fond de cet enseignement, c’est la Régénération de l’homme, sa fusion en Dieu qui devient sa récompense : c’est absolument la doctrine hindoue du Nirvâna !
Jésus montre cette régénération comme devant éveiller dans l’âme un instinct de l’invisible, une perception intérieure, qui aide grandement à l’avancement de l’homme.
Dans l’ordre moral, Jésus a mis au-dessus de tout : la Charité ! Hors la charité, pas de salut, a-t-il dit en quelque sorte !
Toutes les hypocrisies, tous les pharisaïsmes, il les a également rejetés.
Les quatre principes primordiaux de sa morale ont été : Sincérité, Charité, Amour, Perfection.
Et toute science vient de Dieu, voilà pour l’ordre intellectuel.
Un fait curieux à retenir est celui-ci : que la pensée est une force, la prière une accumulation, puis une dépense et une projection de force !
Et, revenant sur une idée émise dans le début de son étude, notre confrère dit avec raison que Renan a montré trop souvent Jésus comme un prestidigitateur, et considère ses miracles et ses prodiges comme un résultat de simulation. Or, quelques années plus tard, des savants véritables ont démontré la réalité de faits surprenants qu’on considérait à tort comme des prodiges : faits de lévitation, de psychométrie, de télépathie, etc.
« Cherchons maintenant comment le Christ sauve les hommes et comment il faut entendre, d’après la doctrine ésotérique, ce qu’on dit des mérites du Rédempteur.
« Jésus sauve les hommes en leur ouvrant, par sa doctrine, la voie unique ; il les sauve encore en ayant incarné dans sa vie et sa passion la réalité vécue de sa doctrine. Enfin, il contribue au salut de la planète non seulement par le dévouement de sa vie, mais encore par une activité continuée après sa mort, car, réuni à Dieu, il est devenu un des organes de son rayonnement, un des actes spirituels de sa Providence qui dirige spécialement ses efforts sur la Planète à qui son passage a refait une âme.
« De plus, le Christ de notre planète est à la fois un symbole et un élément du Christ universel, du principe général qui, dans la pensée de Dieu, correspond à l’humanité parfaite et qui s’unit avec les âmes parfaites à mesure qu’elles rentrent dans ce principe… Ainsi, les mérites du Christ ne nous sont applicables qu’après un effort de notre part et, là-dessus, l’Église n’est pas en désaccord avec la doctrine ésotérique. »
Dans les lignes qui précèdent, nous venons de résumer ce qui a été écrit à notre époque sur le Christ ésotérique ; c’est bien peu de chose, comme peut en juger le lecteur ; aussi pouvons-nous dire avec raison que rien ou presque rien n’a été dit sur le sujet que nous allons traiter.
Un auteur éminent qui a écrit une Œuvre des plus remarquables, M. Saint-Yves d’Alveydre nous avait promis une Vie ésotérique de Jésus, et nous allons voir comment il s’est acquitté de sa promesse.
Voici ce que nous dit cet auteur dans sa Mission des Juifs :
« Dans le chapitre suivant, je conduirai le lecteur en Judée à Jérusalem ; je lui ferai lire clairement tous les signes historiques de la Société juive de ce temps, pénétrer toutes ces catégories, depuis le monde officiel, toujours déprimé par la politique, toujours inféodé bon gré mal gré, au Nemrodisme divinisé, toujours aveugle à l’Esprit de Moïse et des Abramides sur ce point comme sur bien d’autres.
« Puis, nous entrerons pieusement dans le Temple, à l’ombre duquel vit Marie, dans les Communautés laïques des Nazaréens, des Esséniens de Palestine et de Kaldée, dans celles des Thérapeutes d’Égypte et dans leurs ramifications avec les Ordres et les Sanctuaires de l’Agneau.
« Je montrerai comment Marie, comment Jésus reprendront par l’Initiation la grande Tradition des Abramides et de Moïse, et je dévoilerai à ce sujet certaines profondeurs ésotériques peu connues.
« Nous verrons naître le christianisme, nous écouterons la pensée secrète de son divin Fondateur sur les trois phases de son action : Purification morale des individus, Rectification intellectuelle des gouvernements par l’Esprit scientifique, vivant, de la Promesse, Restauration enfin de la Synarchie universelle de Adveniat Regnum Tuum28.
Voilà certes un fort beau programme et très alléchant, nous allons voir comment va le développer notre auteur dans le chapitre suivant 29.
Jésus, Marie, les Partis Politiques, le Judaïsme et le Mosaïsme ouvert. Les ordres laïques, Vie publique de Jésus, sa science, ses miracles, sa promesse, sa mort, sa résurrection. Le christianisme des apôtres et l’Israélitisme messianique. Le Christ crucifié et le Christ glorieux. — La loi de sa promesse sociale est la Synarchie.
Voilà certes un titre de chapitre splendide, des plus alléchants ; on pourrait même faire un livre sur cet en-tête, sur ce programme.
Nous allons voir comment s’en tire M. Saint-Yves d’Alveydre.
Ah ! mes amis, quelle désillusion, écoutez plutôt :
« Ce chapitre était terminé, et j’allais l’envoyer à l’imprimerie, quand je fus pris d’un grand trouble d’âme, dont voici quelques raisons :
« Depuis des siècles la vie et la mort du Christ, Ses Enseignements, Son Évangile sont l’objet d’une guerre ardente entre les Talmudistes et les Théologiens.
« Depuis près d’un demi-siècle, c’est entre les Exégètes naturalistes et la Dogmatique des clercs, que cette querelle passionnée a été reprise, au nom de l’érudition et de l’Histoire élémentaires.
« Derrière les combattants, toutes les anarchies universitaires et politiques se pressent sous des drapeaux divers, se fusillent de polémiques, se bombardent de controverses.
« Pour moi, sur ce terrain sacré, je vois tout autre chose qu’un champ de bataille.
« J’y vois la Paix annoncée par les Prophètes, et je ne dois pas alimenter la guerre par une nouvelle Vie de Jésus, étudiée cette fois, au point de vue ésotérique et à la clarté des principes.
« Sans doute, il m’est pénible de brûler mon travail, mais je sens avec trop de force la nécessité de cet holocauste, pour ne pas m’y résigner joyeusement.
« Ce livre est le protocole de la Paix du Monde, et, tôt ou tard, il la déterminera invinciblement d’un bout à l’autre, en démontrant scientifiquement la Loi sociale de cette Paix.
« Aurais-je écrit cette Mission et les deux précédentes, si je n’étais pas à la fois Universaliste et Chrétien ?
Certainement non.
« J’ai donc rendu témoignage à Jésus-Christ, et ce chapitre ne ferait qu’enfon-cer l’épée sur la terre sainte, où je ne dois déposer qu’un rameau d’olivier.
« C’est à un Israélite que je lègue le soin de combler cette lacune de cent et quelques pages.
« C’est à lui de venger Jésus de ses détracteurs et aussi, hélas ! d’un grand nombre de ses défenseurs ; c’est à lui de glorifier le Christ dans la lumière scientifique et dans la vérité sociale où j’ai glorifié Moïse.
« C’est à lui de toucher aux plaies de sa nation crucifiée, elle aussi depuis près de vingt-cinq siècles par le Nemrodisme, et qui n’a pas d’espérance de résurrection possible, en Palestine, que dans et par l’accomplissement des promesses de Jésus-Christ.
« Je lui ai d’avance indiqué les causes des maux de sa patrie avec une précision mathématique, ne laissant place à aucune équivoque, à aucune confusion entre les choses politiques et l’Ordre religieux et social.
« Que le noble esprit que j’appelle, et qui viendra, médite mes œuvres : une grande lumière se fera en lui, et en sortira pour le bien des siens, et de toute la judéo-chrétienté, puis de toute l’humanité.
« Il verra Jésus dans Son éblouissante splendeur, et le Christ Glorieux lui apparaîtra dans ce Christ Douloureux, comme la Fin dans le principe, comme la moisson dans le froment.
« Alors, il retrouvera Israël dans le Genre humain, sa promesse dans celle de Jésus-Christ, sa loi sociale dans la Synarchie trinitaire.
« Que le Dieu de la totale Connaissance inspire cet homme, et bénisse en lui tous les siens, membres du Christ, au même titre que tous les hommes de cette Terre
Un point d’exclamation et c’est tout.
Mais si M. de Saint-Yves ne tient pas ses promesses, il passe la plume à un Israélite et il lui donne d’excellents conseils !… pour écrire ce qu’un scrupule de conscience l’a sans doute empêché de le faire.
Ce conseil n’est-il pas un peu d’un Pince-sans-rire ?
24 P.-J. Proudhon, De la Justice dans la Révolution et dans l’Eglise, i, p. 3. — Œuvres complètes, Paris, 1570
25Bulletin de la Société botanique de France