
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Sudarènes Editions
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
125 000 divorces en une année, c'est 125 000 drames. Parmi eux, celui d'Abby.
À 12 ans, son insouciance s'évanouit soudainement et elle doit alors dire adieu à son enfance. Ce n'est pas facile de vivre le divorce de ses parents. Le monde perd tout son sens et Abby, elle, perd son sourire. Déjà blessée par ces "histoires d'adultes", elle va apprendre à ses dépens que l'univers des collégiens est souvent cruel.
Un roman bouleversant sur une réalité qui touche de plus en plus de familles chaque années
EXTRAIT
Tout a commencé lorsque j’avais 12 ans. À l’époque, la vie rimait pour moi avec bonheur. J’étais heureuse, simplement heureuse. Évidemment, j’avais eu quelques chagrins, quelques larmes et quelques colères, mais rien d’exceptionnel. Pour résumer le chemin que j’avais mené jusque-là, pour résumer mon court vécu, je pense qu’il suffirait d’un mot : innocence. Les douze premières années de mon existence sont certainement les douze plus belles que le destin aura à m’offrir. Je vivais sous le doux et beau soleil de la Côte d’Azur, bercée par le bruit des vagues qui s’écrasent sur le sable, et j’occupais mon temps en rires ou en jeux. De toutes ces belles choses, le joyau était ma famille. Il n’y a rien dans ce monde que j’aimais plus qu’eux. Mon frère, d’abord. Oh, on peut dire que l’on s’en est donné, des coups, lui et moi. On s’est tiré les cheveux, on s’est pincé, on s’est mordu, et on s’est aimé. On s’aime profondément. Je sais qu’il sera mon allié de toujours, et le premier à prendre ma défense. J’ai le meilleur grand-frère que l’on puisse avoir. Malgré tout, pendant ces douze ans, j’ai été une petite peste avec lui.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Lisa Szafraniec est une jeune auteure de 16 ans, vivant à Vallauris sur la côte d'Azur. Toujours intéressée par l'écriture, elle se passionne pour la Fantasy à travers ses lectures et plus particulièrement la saga du "poison écarlate". Avec "Dans les pas de l'ange", elle publie son premier roman et vous fait partager ses rêveries.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prologue
Voilà. J’en suis sortie vivante. Peut-être même plus forte. Ce qui est sûr, en tout cas, c’est que ce sont des images qui vont me hanter longtemps. Toujours. Ces souvenirs vont influencer mon destin et je sais déjà qu’ils joueront un rôle dans mes relations, mes amours de femme et de mère. C’est un fait, ça fait partie de moi. Désormais, je devrai franchir les obstacles de ma vie en portant ce lourd fardeau.
Chapitre 1 : « L’exposition des enfants ne produit pas le divorce ; le divorce produit l’abandon des enfants, et souvent compromet leur vie. »Louis Gabriel Ambroise, essai analytique sur les lois naturelles de l’ordre social.
L’histoire que je m’apprête à vous raconter n’a rien d‘extraordinaire, malheureusement. Elle est commune, aujourd’hui. Bien trop commune. C’est mon histoire comme cela pourrait être la vôtre, ou celle de l’un de vos proches. C’est peut-être le cas, d’ailleurs, et c’est peut-être l’une des raisons qui vous ont poussé à la lire. Ce n’est cependant pas parce qu’elle est banale qu’elle ne parle pas d’un drame. Pour vous, ce ne seront peut-être que quelques mots, mais pour moi, Abby, c’est une déchirure. Peut-être trouverez-vous entre ces lignes les réponses à vos questions, ou prendrez-vous conscience que le divorce n’est pas simplement la fin d’un contrat. Il y a des dommages collatéraux. Nous, les enfants, en sommes les premières victimes.
Chapitre 2 : “L’enfance trouve son paradis dans l’instant. Elle ne demande pas du bonheur. Elle est le bonheur.”Louis Pauwels, Ce que je crois.
Tout a commencé lorsque j’avais 12 ans. À l’époque, la vie rimait pour moi avec bonheur. J’étais heureuse, simplement heureuse. Évidemment, j’avais eu quelques chagrins, quelques larmes et quelques colères, mais rien d’exceptionnel. Pour résumer le chemin que j’avais mené jusque-là, pour résumer mon court vécu, je pense qu’il suffirait d’un mot : innocence. Les douze premières années de mon existence sont certainement les douze plus belles que le destin aura à m’offrir. Je vivais sous le doux et beau soleil de la Côte d’Azur, bercée par le bruit des vagues qui s’écrasent sur le sable, et j’occupais mon temps en rires ou en jeux. De toutes ces belles choses, le joyau était ma famille. Il n’y a rien dans ce monde que j’aimais plus qu’eux. Mon frère, d’abord. Oh, on peut dire que l’on s’en est donné, des coups, lui et moi. On s’est tiré les cheveux, on s’est pincé, on s’est mordu, et on s’est aimé. On s’aime profondément. Je sais qu’il sera mon allié de toujours, et le premier à prendre ma défense. J’ai le meilleur grand-frère que l’on puisse avoir. Malgré tout, pendant ces douze ans, j’ai été une petite peste avec lui. J’aimais bien me plaindre, pleurer pour de petites choses, et être la préférée. Il est vrai que j’ai été la préférée de ma mère pendant toutes ces années et j’en profitais bien, avant de comprendre à quel point Baptiste en souffrait. Ma mère, elle, a toujours été étrange. J’étais persuadée, à l’époque, que c’était normal. Elle avait des airs de fantôme, et même quand elle était là, elle n’était jamais réellement avec nous. Malgré tout, j’étais sa fille, et une fille aime sa mère. C’est dans l’ordre des choses. C’est naturel. On passait du temps ensemble, et ces instants étaient pour moi précieux. On regardait souvent des films, et parfois, même, on allait faire du shoping. Cela n’a jamais été mon activité préférée, mais être avec elle me suffisait. Les disputes entre elle et mon père étaient régulières, parfois sans raison, mais toujours de son fait. Elle lui reprochait sans cesse les mêmes vieilles histoires, de travail et d’argent. Ah ça, lorsqu’il s’agissait du portefeuille, elle n’oubliait jamais. Son rêve, elle me le racontait parfois, était d’être entretenue par un riche mari. Malheureusement pour elle, notre famille a toujours été plus riche d’amour que d’argent. Ainsi, elle rentrait toujours tard du travail, et préférait occuper son temps autrement qu’en venant nous chercher à l’école. Elle répétait que bientôt, une fois la maison payée, elle pourrait démissionner, et divorcer. Elle le disait si souvent que finalement, sa menace n’était prise au sérieux par personne. Elle avait les caprices d’un enfant, et les sautes d’humeur d’une adolescente. Elle me murmurait parfois, alors que l’on marchait côte à côte, que l’on ressemblait à deux copines. Je n’ai jamais aimé qu’elle nous compare à cela. Je n’ai jamais été son amie. J’aurais simplement aimé pouvoir être sa fille.
Mon père, lui, a toujours été le parfait opposé de ma mère. Il ne manquait jamais une occasion d’être à nos côtés et n’oubliait jamais la petite attention qui donne le sourire. J’adorais, plus que tout, nos petites promenades du matin, avant l’école, où nous passions acheter un pain au chocolat. Jamais, au grand jamais, je ne pourrai oublier l’odeur de pain chaud, dans le froid de la rue, et ma petite main dans la sienne. Jamais je n’oublierai que c’est ainsi, avec la monnaie, que j’ai appris à compter. Jamais je ne pourrai oublier tout ce que l’on a partagé.
Chaque jour, à la sortie des cours, ce sont mes grands-parents paternels qui venaient nous chercher. Ils sont d’une gentillesse sans limite et incroyablement serviables. Je ne saurais compter combien d’heures j’ai passées dans les bras de mon grand-père lorsqu’il essayait de sécher mes larmes ou de m’endormir, et je ne saurais exprimer combien les copieux petits plats et les goûters onctueux de ma grand-mère sont délicieux. J’avais vraiment tout pour être heureuse, et je ne voulais, pour rien au monde, quitter ce nid douillet qu’on appelle l’enfance. Qu’aurais-je pu vouloir changer ? J’étais comblée sur tous les plans et je faisais tout pour être une petite fille modèle. J’étais aimée par mes professeurs, ainsi que par la plupart des élèves, mes camarades. Mon amie la plus proche, à l’époque, s’appelait Lucie. Nous nous étions rencontrées par hasard, sur un quiproquo, mais dès le premier regard nous avions compris l’une et l’autre que nous étions faites pour être amies. Je peux affirmer, avec cette rencontre, qu’il existe en amitié comme en amour, des coups de foudre. L’un comme l’autre, cependant, peuvent être passionnels, imprévisibles et douloureux. La suite de mon aventure me l’a prouvé.
J’étais aussi entourée, à cette époque, par Sarah, une fille légèrement écervelée avec qui je partageais des moments de folie, Alice, la plus fidèle de toutes, et de nombreuses autres amies. Le plus surprenant, c’est que j’étais populaire tout en restant moi-même. Je ne me forçais pas à répondre aux critères de beauté qui évitent d’être rejeté. Mais, malgré tout mon entourage, je ne souhaitais en réalité la compagnie que d’une seule personne, Julien. J’étais éperdument amoureuse de lui. Je l’aimais aussi fort qu’il est possible d’aimer, lorsque l’on a douze ans.
Je l’avais rencontré un an plus tôt, à l’arrêt de bus, et la première impression qu’il m’avait faite n’avait pas été bonne. C’était une après-midi d’octobre, et après une longue journée de cours, je n’avais pas apprécié qu’il vienne me couper la parole pour saluer mon frère. J’avais eu l’impression qu’il était typiquement le genre de garçon que je ne pourrais apprécier. Il avait l’air trop fier, presque hautain. Je l’avais trouvé charmant, c’est vrai, mais le physique n’a jamais été pour moi une qualité primordiale. J’ai toujours pensé que les trésors étaient à découvrir et que les vitrines ne savaient attirer que le regard, pas l’intérêt. Peut-être faudrait-il que je songe à faire plus souvent confiance à mon instinct mais nos rencontres quotidiennes avaient su me faire penser que je m’étais trompée à son sujet. Il était, pour moi, un trésor à découvrir. Chaque instant que je passais avec lui révélait à mes yeux toute la beauté de l’âme, sous la belle façade. Il avait de magnifiques yeux noisette que de jolis reflets verts semblaient traverser lorsqu’il souriait, et je m’amusais à penser, alors, que des trouvailles plus délicieuses encore m’attendaient si je m’y plongeais. Julien avait cette beauté sauvage, celle qui ne supporte pas d’être domptée et j’étais émerveillée par sa grâce naturelle. Il était beau parce qu’il était lui, ou peut-être parce que je le voyais à travers mes yeux aimants.
Je me rappelle avoir retenu son prénom dès que je l’ai entendu, mais le mien lui a été inconnu pendant longtemps. J’étais discrète. Je ne laissais jamais transparaître mon amour, ni en geste, ni en parole. Je ne parlais pas, ou peu, et je l’écoutais, seulement, en lui jetant régulièrement des regards furtifs. Quelques mots, parfois, m’étaient tout de même accordés, et j’avais fini par devenir son amie. Je n’avais pas le courage d’être moi-même en sa présence, et c’était par les réseaux sociaux que nous avions fini par nous lier réellement. Tous les jours, alors, je me pressais de m’y connecter pour pouvoir lui parler un peu. Lucie s’était mêlée à nos discussions, et elle essayait sans cesse de me forcer à avouer mes sentiments. Je pense qu’il avait dû deviner, d’ailleurs, l’intérêt que je lui portais, et peut-être même le partageait-il, mais à nos âges, nous ne savions pas mettre des mots sur nos sentiments et je puisais un certain plaisir dans le secret. Sans doute, je rêvais qu’il me fasse une déclaration digne des plus beaux romans d’amour, et je rêvais de partager avec lui l’aventure de la vie. J’en rêvais. Et c’était ça le plus important.
Chapitre 3 : “Qu’on se le dise, la jalousie est un zèle égoïste et malheureux.”André Comte-Sponville
Enfant, je n’aimais pas dormir. Je considérais que le sommeil nous faisait perdre un temps précieux, un temps que l’on aurait pu passer à découvrir le monde. La nuit m’effrayait parfois, comme elle effraie tous les enfants, mais je me plaisais tout de même à admirer les paillettes d’or qui couvrent l’infini de l’espace, et à m’imaginer mille histoires que l’obscurité rendait réelles. Finalement, le sommeil n’était pour moi qu’un moyen d’arriver plus rapidement au lendemain, c’était un moyen de calmer l’impatience. Il était donc habituel que je me lève tôt, vers huit heures, même le dimanche, comme le jour où commence ma triste aventure.
Je n’ai jamais aimé les dimanches. Je ne les ai jamais aimés parce que le lendemain, c’est lundi, et que le lundi, on reprend notre lassante routine. Pourtant, c’était généralement une bonne journée en soi. C’était un jour que l’on passait en famille, un jour au grand air, ou un jour de repos. Lorsque le ciel se montrait capricieux, nous avions l’habitude de nous refugier tous ensemble, au chaud, devant la télévision. Si en revanche, le soleil venait illuminer le spectacle maritime et les flux de touristes, nous nous échappions un peu pour aller marcher sur les longs sentiers forestiers, ou sur le littoral.
Ce dimanche-là, cependant, j’aurais préféré rester à la maison. Et seule, si possible. Ce dimanche a laissé une première cicatrice dans ma mémoire. Un prélude à ce qui allait suivre. Pourtant, tout commençait plutôt bien. J’étais heureuse, ce matin-là. Comme tous les autres. Ma mère avait l’air jovial, et cela faisait plusieurs jours qu’elle ne s’était pas disputée avec mon père. J’avais commencé la matinée en zappant entre les dessins animés de Super-héros qui m’ennuyaient et les nombreuses émissions de téléachat où les présentateurs s’extasiaient toujours sur des produits inutiles, puis je m’étais empressée, dès mon petit-déjeuner avalé, d’aller prendre des nouvelles de Julien via MSN. J’essayais de faire mes devoirs, mais en réalité, rien d’autre que lui n’occupait mon esprit et j’avançais trop lentement. Lorsqu’enfin j’avais pu fermer mes cahiers, nous avions décidé d’aller faire la promenade « des trois ports ». C’était une balade assez longue, mais magnifique. Elle longeait la mer à travers les roches rouges de l’Esterel.
Pendant la promenade, mon père et moi nous tenions par la main, comme à notre habitude puisque je n’étais pas de ces adolescentes qui ont honte d’être vues avec leurs parents. Je n’avais jamais caché l’amour que je portais à ma famille et j’en étais même plutôt fière car je considérais nos relations comme une chance. Ma mère marchait devant, comme elle le faisait toujours. Personne ne s’en était soucié, et la journée me paraissait toujours être belle. J’avais profité de la promenade pour parler avec mon père des nouveaux amis que je m’étais faits, et plus particulièrement d’Alice. Je la connaissais depuis plusieurs années déjà, mais nous n’avions jamais été très proches. Nos relations respectives et nos occupations différentes nous avaient toujours limitées à n’être que des connaissances. J’avais compris, cependant, que son âme était d’une fidélité rare et que si nous avions l’occasion de mieux nous connaître, je pourrais puiser en elle une amitié sans faille. Nous répondions à la fois à l’attirance des contraires et à l’association des points communs. J’étais une fille douce, populaire, et calme. Elle était plus vive, plus timide, et moins docile. En revanche, nous n’étions ni l’une, ni l’autre, symboles de féminité. Nous aimions être nous-mêmes, sans maquillage, à l’aise, et sans cigarette. Répondre à des critères ne nous convenait pas. Nous ne voulions pas être rangées dans des cases avec les autres. Nous recherchions, naïvement, la différence, et nous espérions même être aimées pour cela.
Je trouvais que mon père avait un certain talent pour sonder les gens, et je m’intéressais à son avis. Je l’écoutais, souvent, malgré nos quelques désaccords. Je ne supportais pas, par exemple, son avis sur Lucie. Il me répétait sans cesse que nous n’étions pas du même monde et que mon amitié n’était pas réciproque. Bien sûr, attachée à elle comme je l’étais, je n’en croyais rien. Je considérais Lucie comme ma sœur, et j’affirmais toujours, avec une conviction qui frôlait la candeur, que notre amitié si profonde ne pourrait jamais sombrer. Finalement, ma mère avait disparu au loin, et nous nous sommes un peu pressés pour la rejoindre. Nous nous sommes doutés, en voyant son air pincé, que quelque chose ne lui convenait pas, et qu’elle avait trouvé un nouveau reproche à faire. À peine l’avait-on rejointe qu’elle s’était mise à crier, en désignant mon père :
— Tu n’as pas honte ?!
Les passants nous dévisageaient car son éclat de voix avait brisé la paix qui régnait sur le sentier. Mon père était plus las que surpris et cela transparaissait dans sa voix.
— Mais de quoi tu parles ? Qu’est-ce que j’ai fait, encore ? Elle n’avait rien répondu mais son regard, plus noir qu’à l’ordinaire, était venu se poser sur nos mains, mêlées l’une à l’autre.
— Tu n’es tout de même pas jalouse de ta fille ? Je me souviens du choc que j’ai ressenti, à cet instant. Je ne comprenais pas. Etre jalouse ? De quoi ? Je m’étais demandé ce qu’elle pouvait trouver à m’envier, et pourquoi, soudainement, elle avait quelque chose à me reprocher. Ma mère pestait, et son regard s’assombrissait encore.
— Tu trouves cela normal de me laisser seule ? Sa colère ne s’atténuait pas et j’en étais la cible malheureuse. Un sentiment d’injustice et de colère bouillonnait en moi, alors que j’étais d’ordinaire si calme. J’ai hurlé, à mon tour, comme pour extérioriser une pression trop importante :
— Tu es jalouse de ta fille ? Mais quelle bonne mère tu fais, dis-moi ! C’est toi qui devrais avoir honte ! Elle a levé la main, comme pour me menacer d’une gifle.
— Toi, tu n’as rien à dire. Tu n’es qu’une peste. Mes yeux se sont emplis des larmes amères de la fureur alors qu’elle tournait les talons pour s’éloigner à nouveau. Elle avait gâché ma journée et je la haïssais, de tout cœur, comme on peut haïr lorsqu’on est en colère.
Nous avions dépassé le second port et nous venions d’atteindre le dernier. C’était là-bas, à l’une des tables du petit bistro italien, que nous nous octroyions généralement une pause. Ce bar vendait d’excellentes glaces, artisanales et variées qui nous servaient de goûter. Cela remontait le moral des troupes avant de reprendre la marche, pendant près de deux heures, afin de retourner au parking où était garée la voiture. Ma mère était déjà installée au moment où nous arrivions. Une fois de plus, elle m’exaspéra. Elle avait cette façon insupportable de soudainement tout effacer, de faire comme s’il ne s’était rien passé, et d’oublier rapidement les malentendus. Plusieurs fois, cela m’avait rendu service, mais pas cette fois. Il ne fallait pas qu’elle espère que ma mémoire soit aussi défaillante que la sienne. J’étais vraiment furieuse, à ce moment-là, et ceux qui me connaissaient savaient que mes colères, bien que rares, étaient souvent violentes. Passagères aussi, car la haine n’appartenait pas à mes aptitudes. À cet instant, pourtant, c’était encore trop tôt, et j’avais refusé de commander ma glace. C’était une bien piètre révolte, je le savais, mais cela illustrait mon mécontentement et je ne souhaitais pas qu’elle s’imagine qu’il était possible de m’acheter. Mon père, toujours aussi attentionné, m’en avait tout de même apporté une. Et c’est parce que c’est lui qui me l’avait offerte que je l’avais mangée. Pour cela, et parce qu’il avait choisi mon parfum préféré.
La tension ne s’était pas encore atténuée lorsque nous avions décidé de reprendre la route et, pendant tout le chemin du retour, ma mère m’avait lancé mille regards haineux. Tout, dans son expression, illustrait l’arrogance, la prétention et la raillerie. Elle me regardait comme si j’étais un obstacle à sa réussite, à son bonheur, comme si je ne valais rien. Le mépris qu’elle avait à mon égard n’avait permis que de nourrir le mien. Elle n’allait pas parvenir à me faire culpabiliser. Pas cette fois. Pour le lui faire comprendre, je lui avais lancé un sourire semblable au sien, un sourire dérisoire qui ressemble plus à une grimace et j’avais repris la main de mon père. Je me souviens avoir espéré qu’il lui en veuille comme je lui en voulais, et avoir été déçue lorsqu’il m’avait murmuré :
— Ne la provoque pas…
Je savais qu’il évitait les disputes. Pas moi. Je ne pouvais pas me résoudre à laisser à ma mère cette victoire. Les regards accusateurs n’avaient pas cessé, et ma détermination, elle, n’avait pas cédé.
Pour me calmer, cependant, je m’étais intéressée au paysage. Cet endroit était magnifique : la roche écarlate plongeait dans l’azur de la mer. C’était le choc des éléments, l’eau, limpide, apaisante et l’indomptable feu. Je trouvais ce lieu extraordinaire. Le soleil réchauffait les rares promeneurs, les enfants qui couraient sur la plage, les derniers parasols, et pardessus tout, il réchauffait mon cœur. Je m’étais apaisée et j’étais tout à fait calme au moment de grimper dans la voiture. Calme, mais toujours aussi déterminée à ne pas lui pardonner, à ne pas lui parler. J’étais têtue, et je n’avais pas l’intention de céder.
La journée avait déjà été mauvaise, et je n’imaginais pas que cela pouvait être encore pire. En arrivant à la maison, il n’y avait plus de soleil. Il faisait sombre et frais. Comme je grelottais, je m’étais dépêchée d’aller m’installer sous ma couette douillette. Julien n’était pas connecté sur internet, mais comme j’avais envie de me changer les idées, j’avais téléphoné à Lucie. C’était une fille joviale, et une amie avenante, alors notre discussion m’avait mis du baume au cœur. Je sentais cependant dans sa voix un trémolo inhabituel. Quelque chose n’allait pas. Je me suis rendue compte, à cet instant, que je la connaissais par cœur. J’avais découvert à la simple écoute de son intonation un problème qu’elle tentait de me cacher avec application. Elle était trop enjouée, ou alors différemment, mais cela m’avait fait comprendre que quelque chose la blessait. Elle allait mal, et il était de mon devoir de m’en inquiéter. C’était pour moi, à l’époque, le rôle d’une meilleure amie, que de panser les blessures. J’avais dû insister pour qu’elle se confie à moi, mais elle m’avait finalement fait part d’sms, anonymes paraît-il, qu’elle avait reçus. Sa voix était gênée en m’avouant qu’ils parlaient de moi. D’après eux, je n’étais pas une bonne fréquentation car mon immaturité l’empêchait de grandir. J’étais vexée par ces mots, mais je savais que les personnes qui les avaient envoyés portaient ce jugement parce que je me refusais à ressembler à une femme. Je n’avais que douze ans, et Lucie en avait treize, mais j’étais attachée à mon enfance. Ce qui me séparait de ces amies, ce n’était pas l’intelligence, simplement l’apparence. L’idée que Lucie puisse être rejetée par ma faute me blessait terriblement et comme je ne voulais pas la voir souffrir, j’avais feint de n’être pas touchée par les reproches qui m’étaient faits. En réalité, j’avais terriblement peur de la perdre, pour la première fois. Elle s’était efforcée de m’assurer que rien ne pourrait nous séparer et que le regard des autres importait peu. Naïve par nature, je la croyais. Ce soir-là, avant de raccrocher nos téléphones, nous avions récité notre hymne, le symbole de notre amitié : « À la vie, à la mort, on se promettra qu’on s’aime fort ». Ce soir-là, après avoir pleuré pendant des heures, je m’étais endormie en affirmant que c’était une fille exceptionnelle, et que si notre amitié survivait à cela, rien ne nous arrêterait jamais. J’avais tout de même utilisé le conditionnel.
Chapitre 4 : “La pire souffrance est dans la solitude qui l’accompagne.”André Malraux,La condition humaine
Les jours suivants m’avaient semblé interminables. Soudain, j’étais toute seule. Lucie ne répondait pas à mes appels et refusait de me voir. Elle ne s’était pas montrée au cours de danse, n’était pas venue me chercher à l’arrêt de bus, et ne s’était pas, non plus, installée à son balcon. Je croyais qu’elle avait disparu de ma vie aussi vite qu’elle y était entrée. Je me sentais affreusement mal. J’avais l’impression que tout était ma faute. C’était de moi que parlaient ces sms. C’était moi l’origine de son problème. Je me refusais à être, pour elle, un poids, et je n’aimais pas l’idée d’être impuissante face à sa douleur. Je passais mes journées à tourner en rond et à pleurer en me répétant que je ne pouvais pas l’avoir perdue. Il me semblait impossible d’envisager ma vie sans elle. J’étais déjà, à l’époque, sujette à la dépendance affective. Je m’attachais et je posais à chaque fois tous mes espoirs sur les épaules de ceux que j’aimais. C’était une erreur fatale. C’est une grande faiblesse que de ne trouver son bonheur que dans le regard de nos proches.
Mes heures de cours, pendant ces quelques jours, étaient une torture. Je les passais à gratter le papier, et en cachette, je faisais couler sur mes cahiers le sang de mon cœur blessé. Je voulais croire qu’elle avait simplement besoin d’un peu de temps pour trouver un moyen de concilier notre amitié et celle des élèves de son collège.
Seule. Je me sentais terriblement seule. Julien aussi avait pris une allure fantomatique. Il me manquait terriblement. Il me manquait toujours, lorsqu’il n’était pas à mes côtés, mais son absence accentuait cette fois ma douleur, déjà profonde. J’espérais qu’il n’avait pas de problème, qu’il allait bien, mais je n’osais pas m’en assurer en lui téléphonant. Je craignais qu’il devine, si je le faisais, mon amour pour lui. Bien sûr, je me doutais que s’il était malade, avoir l’attention de quelqu’un pourrait lui remonter le moral. Mais non. Je n’en avais pas le courage. C’était lâche. Et cette lâcheté m’amenait à me juger sévèrement. Qu’est-ce que je pouvais risquer de si terrible ? Rien. Toutes les personnes qui nous téléphonent ne sont pas amoureuses de nous. J’aurais pu m’intéresser à lui en tant qu’amie. J’aurais pu, mais par peur qu’il puisse entendre dans mes paroles une déclaration d’amour, je ne l’avais pas fait.
Je n’avais rien à faire. J’avais l’impression que je perdais mes repères. Ce n’était que quelques jours, mais ils étaient difficiles à supporter. Sarah tentait, comme elle le pouvait, de me remonter le moral mais c’est Alice, qui sans connaître les raisons de mon chagrin parvenait à me tirer quelques sourires. Alice était celle dont je n’attendais rien, celle à qui je ne promettais pas l’amitié éternelle, mais c’était inutile de faire des serments. Je savais qu’elle serait là pour moi. Notre relation n’était pas sous le signe de la passion : je ne ressentais pas un besoin obsessionnel d’être sans cesse à ses côtés. C’était différent de mon amitié avec Lucie. Nous n’avions pas de serment, pas de promesses, et finalement, j’aimais cela. C’était une amitié construite, profonde et apaisée. Je pense aujourd’hui que l’amitié, tout comme l’amour, qui naît soudainement, n’a pas d’avenir. Alice était une véritable amie. Je le pensais sincèrement, mais je n’avais d’yeux que pour Lucie. Je me demandais sans cesse l’erreur que j’avais pu commettre. Etre moi-même ? Bien sûr…
C’est à ce moment-là que les paroles de Brassens, que je chantonnais depuis toute petite sans les comprendre, ont pris tout leur sens :
« Mais les braves gens n’aiment pas que, L’on suive une autre route qu’eux. »
Pour la première fois de ma vie, je doutais de la grâce de l’âme humaine.
Chapitre 5 : “ Une amitié est perdue quand il faut penser à la défendre. ”Charles Péguy, Cahiers de la Quinzaine
Lucie s’était finalement montrée à la danse la semaine suivante. Les effusions d’amitié habituelles à nos retrouvailles avaient été plus froides. Nous étions, l’une comme l’autre, plus réservées qu’à l’ordinaire. Durant de longues minutes, elle avait fui mon regard et elle répondait laconiquement à mes questions. Cette retenue s’était cependant envolée au bout de quelque temps. S’inquiétant des cernes violâtres sous mes yeux, elle m’avait questionnée sur les relations avec ma mère qu’elle savait difficiles depuis notre promenade aux trois ports. En faisant mes étirements, j’avais remarqué les regards insistants de Célia, une des amies de Lucie, et je m’étais alors doutée que les messages devaient venir d’elle. J’avais déjà entendu ses moqueries à mon égard, et ses nombreux reproches. Pour elle, j’étais une enfant, « une gamine ». Nous avions pourtant le même âge, malgré les apparences. Son visage était en effet tellement maquillé qu’il semblait appartenir à une adulte, et ses vêtements échancrés étaient choisis de façon à mettre en valeur sa poitrine presque inexistante. Elle avait une démarche de femme et sa cambrure excessive devait, d’après ses dires, la rendre « sexy ». Je ne comprenais pas qu’à douze ans, on puisse souhaiter être sexy. Je pensais qu’au lieu de vouloir déjà être une femme, elle aurait dû un peu profiter de son enfance. Elle essayait déjà d’être une autre, avant même d’avoir appris à être elle-même.
En quittant la salle de danse, Célia avait murmuré quelques mots à l’oreille de Lucie qui, sauf un regard dans ma direction, n’avait pas eu de réaction. Je n’ai jamais su les mots qu’elle avait prononcés, mais je me doutais tristement qu’il s’agissait d’injures à mon égard. Ce que Célia pensait m’importait peu, mais le silence de ma meilleure amie, lui, m’était insupportable. J’étais malgré cela trop attachée à elle pour risquer de lui en faire le reproche alors, comme j’avais envie de pleurer, de crier, et que je ne voulais pas me montrer faible devant Célia, je m’étais empressée de quitter les lieux. Alors que je laissais la porte se fermer derrière moi, Lucie m’avait interpellée. Ses yeux semblaient s’excuser et elle me tendait une petite boîte, emballée dans un papier cadeau coloré. Je n’avais pris le temps de l’ouvrir que plus tard dans la soirée, une fois la menace des larmes atténuée. La boîte contenait un bracelet imitation argent duquel pendait une clé sur laquelle était écrit « forever ». « Pour toujours ». Il me semblait être le parfait symbole de notre amitié puisqu’il signifiait que j’étais la seule à avoir la clé de son cœur. Je pense toujours aujourd’hui qu’il était à l’image de notre amitié, mais pour d’autres raisons. La promesse qui y était inscrite était comme l’argent du bracelet : fausse.
Je m’étais endormie, ce soir-là, en serrant ce présent entre mes mains, et je m’étais réveillée heureuse le lendemain matin.
Cette joie avait été nourrie par la présence de Julien à l’arrêt de bus. Il s’était blessé en faisant du sport, et s’excusait de ne pas s’être connecté sur les réseaux sociaux. Je m’étais contentée de sourire un peu naïvement, désolée de ne pas l’avoir contacté pour lui souhaiter un bon rétablissement. Nous avions finalement partagé notre trajet en écoutant de la musique. Je n’aimais pas vraiment ce qu’il faisait tourner, en boucle, dans nos écouteurs, mais j’adorais avoir des choses à partager avec lui. Je me sentais bien à ses côtés, et sa présence me faisait oublier mon chagrin de ces quelques jours. Il souriait, et je le trouvais encore plus beau qu’à l’ordinaire. Il y avait une petite étincelle de malice qui brillait dans son regard lorsqu’il m’avait récité quelques mots en m’assurant qu’ils allaient me plaire :
« Gentille gomme cherche petit crayon pour tout effacer et tout recommencer. »
Il avait trouvé cette phrase sur internet et avait tenu à me la faire partager. Je n’avais rien trouvé à répondre et je m’étais contentée de rougir, bêtement. Évidemment, cela semblait être une déclaration d’amour, mais je n’osais me risquer à y répondre alors je m’étais seulement contentée de penser que j’aurais aimé être le « petit crayon ».
Je croyais mes problèmes résolus puisque je m’étais, en plus, réconciliée avec ma mère et qu’on avait prévu d’aller faire du shopping ensemble, le samedi. Ce n’était pas mon activité préférée mais j’attendais quand même d’y aller avec impatience. Je voulais en profiter pour acheter le nouveau DVD de Twilight. J’étais en effet, à l’époque, une grande fan de la saga et je n’avais jamais vu ce troisième volet. J’avais retrouvé mon sourire et je pensais que les jours suivants ne pourraient qu’être beaux.
Chapitre 6 : “ La moitié d’un ami, c’est la moitié d’un traître.”Victor Hugo, La légende des siècles
Ce week-end-là, les idées noires ne quittaient pas mon esprit et la journée « shopping » avec ma mère m’avait laissé trop de temps pour éviter d’y songer. J’étais restée assise plus d’une heure sur le confortable fauteuil du magasin de vêtements favori de ma mère, et je savais que ce n’était encore que le début. Ce qu’elle avait l’habitude d’appeler « nos » journées shopping, étaient en fait SES journées à elle car, si je n’avais jamais été, de nature, une adepte des achats compulsifs de vêtements, j’étais à peine invitée à participer, en sa compagnie. Je restais donc assise et je la regardais essayer, tour à tour, toutes les tenues que renfermait le magasin.
J’étais tourmentée par les évènements récents qui concernaient Lucie. Je l’avais vue, la veille, lors du cours de danse, et j’avais décidé de lui parler. Je ressentais depuis ces quelques jours d’absence, et bien malgré moi, une rancœur grandir dans mon cœur. Elle n’avait formulé aucune excuse, et ne s’était même pas expliquée sur son comportement. Nous étions sorties un moment, et nous nous étions assises sur le banc qui avait souvent été notre point de rendez-vous. Anxieuse, je lui avais demandé des explications sur ce qui c’était passé et sur sa courte disparition. Soudain, son expression avait changé, elle avait pris l’air hautin et m’avait rétorqué avec, dans la voix, des traces de mépris :
— J’avais besoin de faire une pause dans notre amitié. Je n’avais pas trouvé quoi répondre, et je m’étais contentée de froncer les sourcils :
— Ça n’a pas l’air de te plaire, mais de toute façon, c’est comme ça. Je suis libre de ne pas te parler si je le souhaite. J’étais restée pantoise, bouche bée, pendant plus d’une minute. Malgré toutes les alternatives que j’avais planifiées, je ne m’étais absolument pas attendue à une telle réponse. J’étais profondément vexée par l’amertume de ces paroles. Je m’étais levée et j’avais plongé mon regard dans le sien. Ma voix s’était emplie de colère et de sanglots, malgré ma tentative de paraître stoïque, lorsque je lui demandais :
— Alors, c’est ça, pour toi, être meilleures amies ? Il te suffit d’un SMS de Celia pour douter de ton amitié ? Et tu crois que je vais rester là, moi, quand tu ne te préoccupes pas des blessures que tu me causes ? Tu n’as pas disparu longtemps, certes, mais assez pour que je m’inquiète, et assez pour que j’en souffre. Tu sais, Lucie, je t’aime vraiment, mais je ne suis pas un jouet que l’on jette et que l’on récupère quand on veut.
Il y avait soudain eu un long silence. Ses yeux s’étaient emplis de larmes et j’avais eu énormément de peine à terminer ma phrase. J’avais finalement ajouté, dans un murmure :
— Je crois que c’est fini.
Je lui avais tourné le dos et je me m’étais dirigée vers la salle de danse. D’abord, elle s’était murée dans le silence, mais avant que je n’atteigne la porte, elle m’avait interpellée :
— Vraiment Abby ? Vraiment ? C’est fini ? Je n’osais pas la regarder, mais je savais qu’elle pleurait. J’avais eu du mal à ne pas faire demi-tour pour la serrer dans mes bras quand elle avait ajouté :
— Je tiens à toi, moi.
Je me battais contre l’instinct protecteur qui me poussait à aller sécher ses larmes. Cet instinct qui était né de mon amitié si profonde, de mon empathie démesurée, et de mon altruisme sans faille.
— Oui, j’en ai peur. Tu ne me respectes même pas, comment pourrais-tu me considérer comme ta meilleure amie ? J’avais mal, elle aussi, et les rivières salées que j’imaginais sans difficulté sur ses joues arrachaient mon cœur déjà brisé. Je ne lui en voulais pas vraiment. Je n’avais pas envie de la blesser, mais je voulais qu’elle comprenne certaines choses. Je ne voulais pas qu’elle se laisse berner par Célia, et je voulais lui faire savoir qu’elle me perdrait si elle venait à se ranger de son côté. Elle tentait de me supplier de ne pas la laisser, mais malgré moi et cette force qui m’attirait à ses côtés, je suis partie. Je ne pouvais pas céder. Pas encore. C’était parce que je tenais à elle et à notre amitié que j’agissais ainsi. Je savais que si je ne faisais rien, nous allions droit dans le mur. J’ignore si, finalement, tout n’était pas déjà perdu. Enfin, à l’époque, j’y croyais encore. Je prévoyais de retourner lui parler à la fin du cours pour le lui dire, pour lui avouer que je n’avais jamais réellement souhaité l’abandonner. Elle n’était pas revenue immédiatement, et lorsqu’enfin, elle était apparue, le maquillage qu’elle avait l’habitude de porter depuis peu avait coulé le long de sa joue et rendait son regard encore plus sombre. Je m’en voulais déjà. J’étais rongée par le remord et j’avais envie de me confondre en excuses. La tension avait été palpable pendant toute la leçon, et pour la première fois de l’année, notre professeur nous avait fait sortir en avance. Elle avait évidemment senti que nous n’arriverions à rien ce jour-là. Dans le vestiaire, je m’étais changée le plus lentement possible, espérant que Lucie et moi serions les dernières à quitter la pièce. Je lui avais demandé de lui parler et, comme elle avait refusé, c’était devant ma nouvelle ennemie, Célia, que je lui avais avoué ne pas souhaiter rompre une si belle amitié, en être incapable et avoir simplement espéré qu’elle comprenne que j’avais un cœur et qu’elle pouvait facilement le détruire. Je voulais juste ne pas la perdre mais, à cause de mon esprit revanchard, j’espérais lui montrer comme j’avais été touchée. Lucie n’avait rien répondu mais Célia, elle, avait ri. Je ne voulais pas pleurer devant cet être sans cœur, alors j’étais partie le plus rapidement possible et une fois chez moi, je m’étais enfermée dans ma chambre pour pleurer toutes les larmes de mon cœur. Je ne voulais pas croire que c’était peut- être réellement fini, et j’avais honte de mes agissements. Je refusais d’admettre que la grande amitié dont j’étais si fière était durement fragilisée, en sursis.
Je pleurais sur le fauteuil du magasin, et j’essayais vaguement de le cacher à ma mère. J’avais cependant compris assez rapidement qu’elle n’y verrait rien. Elle ne s’intéressait pas à moi, trop occupée par ses robes et ses pulls au décolleté plongeant. Il m’avait semblé étrange que ma mère essaye ce genre de vêtements. D’habitude, elle portait plutôt des tailleurs, sombres et sérieux, comme le nécessitait son emploi dans l’administration, ou bien des vêtements simples et confortables pour la maison. Il est vrai qu’elle craignait le temps qui passe, qu’elle se maquillait, qu’elle aimait ses cheveux longs et qu’elle lisait assez régulièrement les magazines de mode. Le changement était cependant assez radical : en effet, je ne l’avais vue que rarement porter des robes, et celles qu’elle portait étaient plus longues d’au moins vingt centimètres par rapport à celle qu’elle essayait, en se déhanchant, devant le miroir. Je ne m’étais cependant pas posé de questions, trop absorbée par mes propres problèmes. Elle me lançait régulièrement des : « Ça me va bien ? », et sans un regard, sans attendre de réponse, elle se complimentait elle-même et reprenait la pose devant son reflet. Je trouvais ce spectacle, cette superficialité, pathétique, mais je réalisais que si j’avais été comme elle, j’aurais eu plus d’amis encore, et que même Célia m’aimerait alors. Plus le temps passait, et plus je songeais qu‘être une fille « lambda » avait des avantages.
Chapitre 7 : « Prononcées à voix hautes, certaines paroles sont susceptibles de révéler des secrets d’une intensité que nous serions peut-être incapables d’assumer »,Albert Espinosa Puig
Plus tard dans la journée, après avoir reçu un message de Lucie m’annonçant que malgré sa colère elle acceptait de me pardonner, j’avais décidé de me changer les idées. Évidemment, je m’en voulais beaucoup de ma réaction enfantine et égoïste, mais mon erreur n’était que la conséquence des siennes. Je savais, sans oser me l’avouer, que notre amitié ne serait jamais plus si belle, ni si lisse qu’auparavant, et cette réalité m’affectait durement. Pour oublier cela, je m’étais décidée à jeter un coup d’œil dans les rayons : j’avais soudain eu la conviction qu’il fallait être à la mode pour être acceptée. Je ne l’avouais pas à voix haute, mais j’avais effectivement envie que ma popularité dépasse ma classe et mon collège et je voulais que tout le monde m’admire. C’était, je le sais avec le recul, une terrible erreur. Mais il faut du temps pour l’apprendre. Il fallait que je grandisse encore, que je mûrisse.



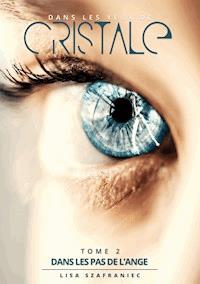














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)










