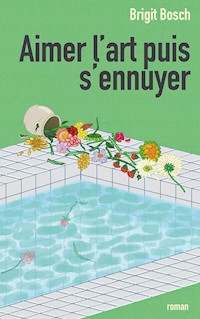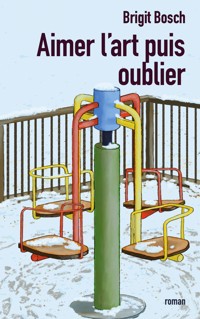
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Aimer l'art puis...
- Sprache: Französisch
Jeter les clefs dans le fleuve, découvrir sa famille, oublier le passé, se remettre à peindre, affronter ses peurs, accepter d'aimer... Il faut du temps pour échapper aux conséquences de l'affaire Grosmann. Elle n'a épargné personne, laissant des cicatrices plus ou moins profondes dont chacun va se débarrasser à sa manière. Estelle, Cassandre, Marcus, Jason, Cillian et Eduardo, devenus d'inséparables amis et complices, vont trouver des réponses auprès de leurs "meilleurs" ennemis. Des réponses qui ne sont peut-être pas celles qu'ils attendaient. Aimer l'art puis oublier veille sur ses "héros". L'art y dénoue presque tout et fait encore une fois tourner le manège des doutes, des révélations et des espoirs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Aimer l’art puis s’ennuyer (tome I)
Aimer l’art puis s’en aller (tome II)
Dimanche 28 octobre
Lundi 29 octobre
Mardi 30 octobre
Mercredi 31 octobre
Vendredi 2 novembre
Samedi 3 novembre
Dimanche 4 novembre
Mardi 6 novembre
Mercredi 7 novembre
Jeudi 8 novembre
Vendredi 9 novembre
Samedi 10 novembre
Lundi 12 novembre
Mardi 13 novembre
Mercredi 14 novembre
Jeudi 15 novembre
Vendredi 16 novembre
Samedi 17 novembre
Mardi 20 novembre
Jeudi 22 novembre
Vendredi 23 novembre
Samedi 24 novembre
Dimanche 25 novembre
Lundi 26 novembre
Jeudi 29 novembre
Dimanche 2 décembre
Mardi 4 décembre
Vendredi 7 décembre
Lundi 10 décembre
Mercredi 12 décembre
Jeudi 13 décembre
Samedi 15 décembre
Lundi 31 décembre
Portrait de groupe
Aimer l’art puis s’ennuyer (tome I)
Des œuvres d’art inestimables sont détruites aux quatre coins du monde. Une mystérieuse et redoutable organisation est à l’origine des attentats spectaculaires. Elle menace bientôt le célèbre critique d’art Jason Gloves et la jeune artiste Cassandre Jeanson, sa nièce. Estelle Rambrant, audacieuse et indéfectible amie, Marcus Garbot, admirateur dévoué et imprudent, et Cillian O’Lochlainn, compagnon pragmatique et fougueux, vont avec eux affronter l’impensable pour tenter de déjouer ces plans diaboliques.
Ils s’embarquent, sans connaître leurs ennemis, dans une enquête énigmatique et périlleuse et le terrain sur lequel ils avancent est semé d’embûches. Les menaces, les agressions et les trahisons n’épargnent aucun d’entre eux. Résolus à dénoncer la machination, à défendre les valeurs de l’art et à protéger Cassandre, ils n’hésitent pas à prendre des risques pour découvrir qui se cache derrière ce funeste projet. Entre New York et Belfast, Los Angeles et Venise, ils échafaudent un plan audacieux pour confondre les extravagants criminels. La peur, la colère, l’amour et l’amitié les révèlent à eux-mêmes et leur permettent d’accomplir ce qu’ils n’auraient jamais cru possible. Mais ils ne peuvent imaginer à quel point ces jours intenses vont bouleverser leurs vies.
Ce premier récit en forme de thriller réunit tout ce qu’aime l’auteure : l’art et les artistes, les voyages, l’Irlande, le café du matin et le whiskey du soir, la fantaisie, l’amitié et l’amour.
Aimer l’art puis s’en aller (tome II)
Estelle Rambrant et Jason Gloves se rejoignent à New York pour les expertises de la collection de Georges Grosmann, le galeriste criminel. Une mystérieuse découverte vient bouleverser les recherches et le terrible secret qu’elle révèle risque bien de changer l’issue de l’invraisemblable affaire qu’ils croyaient résolue.
Quelques mois à peine se sont écoulés depuis les événements déroutants qui les ont réunis. Estelle, Cillian, Jason, Marcus et Eduardo, plus que jamais liés les uns aux autres, se retrouvent face à la folie destructrice du grand collectionneur et celle, vengeresse, de son entourage. Confrontés malgré eux à leurs propres faiblesses, ils s’apprêtent à relever ce nouveau défi avec une détermination et une énergie intactes. La mystérieuse apparition de Benedict Grosman, petit-neveu du galeriste, et les petites vendettas de Suzann Lennon, fantasque collectionneuse anglaise qui a échappé à la prison, relancent l’enquête.
L’Art demeure au cœur de cet épisode, au cœur de l’énigme. Il dévoile les esprits les plus obscurs, comme les plus lumineux. Il ressuscite les passés les plus troubles et enflamme les futurs les plus exaltants.
Ce deuxième opus, plus sombre, plus psychologique, observe ses personnages de plus près, les transforme et les emporte.
Dimanche 28 octobre
Toulouse
Trois secondes. Trois secondes et une ridicule éclaboussure avant que les clefs ne soient englouties par les eaux nerveuses de la Garonne. Appuyé sur le parapet en pierre du pont Neuf, Marcus fixait l’endroit précis où le trousseau avait disparu, hébété, mais déjà conscient de la stupidité de son geste.
Sue était dans l’avion pour Chicago. Il n’avait pas su la retenir et se demandait s’il avait vraiment tenté de le faire. Happé par sa nouvelle vie depuis l’affaire Grosmann, il n’avait pas mesuré à quel point l’attention qu’il lui portait ressemblait si peu à celle du sentiment amoureux. Il avait bredouillé des mots maladroits lors d’un dîner catastrophique, posant devant elle les clefs de son nouvel appartement, comme une invitation, une déclaration sans préambule. Elle était restée parfaitement silencieuse, son regard trahissant un grand malaise. Il s’était alors empêtré dans des excuses aussi incompréhensibles qu’inutiles. Et plus il savait qu’il devait se taire, plus il déversait des mots urgents et accablants. C’est Sue qui l’arrêta, posant une main glacée sur la sienne et prononçant un « s’il te plaît » telle une prière. Il s’était senti presque soulagé avant qu’une avalanche de questions ne le laissent égaré et stupide devant l’évidence cinglante de son inconséquence. Pourquoi n’avaient-ils jamais dîné ensemble ? Pourquoi ne lui avait-il jamais exprimé son attachement ? Pourquoi avait-il toujours esquivé sa main qu’elle glissait sur la sienne ? Elle avait parlé calmement, mais ne put éviter que sa voix tremble lorsqu’elle lui avoua que sa confusion et sa fragilité l’effrayaient, qu’elle ne souhaitait pas une relation amoureuse soudain précipitée, qu’elle gardait précieusement le goût de leur amitié si particulière, qu’elle serait toujours là pour lui et que Chicago n’était pas si loin. Puis elle se tut, parce qu’il n’y avait évidemment rien d’autre à ajouter. Marcus ne l’avait pas quittée des yeux et il reprit son souffle bruyamment, comme s’il avait oublié de respirer en l’écoutant. Elle lui sourit tristement et lui suggéra qu’il était temps de rentrer. Il était pétrifié par la culpabilité et acquiesça d’un hochement de tête. Il la raccompagna jusque chez elle. Il ne savait que dire ni que faire. C’est elle qui le serra dans ses bras. Il se laissa alors emporter par un flot d’émotions et l’enlaça à son tour en ne pouvant retenir ses larmes. Il renifla avant de lâcher son étreinte et lui adressa un sourire timide en lui disant qu’il la verrait bientôt à Chicago.
Son portable retentit dans sa poche. Il fuit son hébétude en sursautant et attrapa le téléphone. C’était Eduardo.
— Salut mon ami de Toulouse, comment vas-tu ?
— Sue est rentrée à Chicago ce matin.
— Oh, je suis désolé…
— Et je viens de balancer les clefs de mon nouvel appartement dans la Garonne !
— Tu es un garçon surprenant, Marcus.
— Je ne suis qu’un imbécile doublé d’un arrogant.
— Tu es blessé et un peu ridicule… non ?
— Tu as toujours les mots justes, Eduardo. Excuse-moi, ne parlons plus de cela… J’espère que tu vas bien. J’arrive mercredi comme prévu.
— Nous en parlerons, crois-moi. Jason t’attrape à JFK.
— Parfait. J’arrive à treize heures.
— Vous serez à Wellfleet vers dix-neuf heures. J’ai hâte. J’ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Marcus ?
— Oui ?
— Ce n’est pas si facile de dire à quelqu’un qu’on l’aime…
— Il semblerait.
— Et tu n’es peut-être pas très doué…
— Il semblerait aussi.
— Laisse poser tout ça un moment et puis… tu ferais bien de récupérer des clefs pour ton appartement, non ?
— Tu as raison, mon lit et mon canapé arrivent en début d’après-midi… Il ne faudrait pas manquer ça !
— Si tu continues, je vais venir faire ta déco. Je sens que tu as besoin d’un peu de fantaisie…
— Tu es le bienvenu, quand tu veux.
— OK, on va programmer ça alors. On se retrouve mercredi.
Appelle-moi si tu as besoin, d’accord ?
— Merci. C’était bien de te parler, Eduardo.
La bonne humeur d’Eduardo n’avait pas réussi à libérer Marcus de son malaise. Ce malaise qu’il traînait depuis la fin de l’affaire Grosmann, piégé entre une forme insidieuse de culpabilité et une fierté déplacée d’avoir joué un de ses plus beaux rôles. La regrettable scène avec Sue avait attisé sa confusion et la fragilité encombrante qu’il combattait depuis des mois s’emparait à nouveau de lui. Parce qu’elle n’était pour lui qu’une faiblesse, il avait soigneusement évité de parler à ses amis de son angoisse latente. Il vivait une aventure inespérée avec des personnes qu’il admirait, qui lui faisaient confiance et qui le considéraient aujourd’hui comme un véritable ami. Comment aurait-il pu solliciter leur attention, pire encore, leur bienveillance ?
Sa prétention et sa traîtrise avaient été les armes redoutables qui avaient mis inutilement Estelle en danger. Il ruminait les choix qu’il n’avait pas faits, les risques qu’il n’avait pas pris, et méprisait l’ambition arrogante qui l’avait précipité dans ce tourbillon incontrôlable.
Son explication avec Estelle, ses échanges avec Eduardo et Jason, ses voyages, les liens uniques qui les unissaient tous et même son engagement enthousiaste et expert dans le projet brésilien ne parvenaient pas à soulager son malaise. Personne n’imaginait à quel point cette affliction le rongeait, si ce n’est Sue qui avait perçu, bien avant l’issue de l’affaire Grosmann, qu’il ne serait peut-être pas taillé pour le rôle. Mais Sue était partie et il avait manqué son dernier rendez-vous avec elle.
Il était temps de passer à l’agence pour récupérer un jeu de clefs et de rejoindre son nouvel appartement. Vue sur La Grave et sur la Garonne, du parquet blond et craquant, une vaste pièce lumineuse, deux chambres spacieuses, une vraie cuisine… Il ne savait plus très bien s’il avait envie de ça ni même s’il avait envie de rester à Toulouse. Curieusement, il ne se sentait bien qu’en compagnie de ceux qui avaient vécu cette invraisemblable histoire avec lui. Et son récent rapprochement avec Suzann Lennon n’était pas étranger à ce besoin de plus en plus envahissant. Il n’avait pas eu de nouvelles de la collectionneuse depuis sa visite surprise au Royal Brompton Hospital et il espérait sincèrement la revoir. Elle l’avait toujours intrigué, sa folie habillée de méchanceté, son excentricité arrogante comme un écran protecteur. Il la contacterait avant de partir pour New York.
L’averse le sortit de ses pensées flottantes. La pluie était fraîche sur son visage et un sourire imperceptible s’y accrocha. Il soupira bruyamment et pressa le pas.
Lundi 29 octobre
New York
Une quarantaine de céramiques étaient disposées sur deux immenses tables au milieu de la galerie. Un travail phénoménal de restauration avait été réalisé et c’était un vrai miracle que tant de pièces aient pu être reconstituées avec autant de précision en si peu de temps. La lumière pâle que filtraient les verrières translucides exacerbait la sensualité et la morbidité des sculptures de Nathan Grosmann. Jason goûtait le trouble intact que les œuvres lui procuraient. Jeremiah Masson s’avança vers lui lentement. Ils attendaient Cecilia Kanno, la fille de Georges Grosmann.
— Vous pensez qu’elle va accepter de monter cette exposition ?
— Elle a déjà accepté.
— Son empressement est étonnant.
— Elle est bouleversée. Savoir que son père est un criminel est une chose, découvrir qu’il est un monstre en est une autre. Elle veut faire vite, s’assurer qu’il ne fera pas un dernier caprice répugnant.
— Il n’y aura plus aucun problème.
Jason jeta un œil à sa montre qui indiquait quatorze heures.
— Ils ne vont plus tarder.
— « Ils » ?
— Herbert Kanno l’accompagne.
Sa haute silhouette apparut derrière celle de Cecilia. Ils s’avancèrent en silence. Elle se tenait droite, raidie par la contrariété, et malgré le sourire qu’elle adressa à Jason, c’est la colère qui éclairait son regard.
— Bonjour Jason. J’aurais préféré vous revoir dans d’autres circonstances, mais la folie de mon père en a décidé autrement.
Sans sa haine et son admiration pour vous, nous n’aurions rien su de sa misérable vie. J’ai cru un instant à une dernière provocation, mais j’ai dû me résoudre à découvrir le pire.
— Je suis sincèrement désolé.
— Je n’aurais jamais accepté cette exposition sans votre intervention et j’ai bien l’intention de rendre hommage à mon demi-frère. Ce mot m’écorche encore la bouche. Mon père l’a trahi, a effacé sa vie, amputé une partie de la mienne et fracassé celle de son petit-fils.
Elle aperçut les sculptures et s’avança dans la galerie sans une autre parole. Herbert Kanno serra chaleureusement la main de Jason et adressa un signe de tête à Jeremiah Masson.
— Je vous prie d’excuser Cecilia. Elle est tellement perturbée et je suis inquiet de la voir si… déterminée…
— Je serai près d’elle pour mener à bien ce projet. Vous pouvez compter sur moi.
Il sourit timidement.
— Elle souhaite absolument rencontrer Benedict Grosmann.
Masson haussa les sourcils.
— Ça n’est peut-être pas une bonne idée.
— Personne ne la fera changer d’avis.
— Il va être transféré dans un établissement psychiatrique dans quelques jours. Combien de temps restez-vous à New York ?
— Trois jours.
Il y eut un bref silence.
— Vous ne pourrez pas accompagner votre épouse et la visite ne durera que trente minutes. Je vous appellerai dans la journée.
— Merci infiniment.
Les images reçues la semaine précédente ne l’avaient pas suffisamment préparée à cette confrontation avec l’œuvre de Nathan Grosmann. Sa boussole de galeriste s’était soudain déréglée et ses repères habituels s’étaient volatilisés. Elle était subjuguée par l’étrange puissance qui émanait des céramiques.
Elle savait qu’elle ne pouvait pas regarder cette œuvre comme n’importe quelle autre. Elle se demandait si elle devait se méfier de ses sentiments ou juste se laisser submerger par l’émotion.
Cecilia avait hérité de son père cette façon pragmatique et apparemment détachée d’appréhender le travail des artistes. Elle était attentive, mais avare de paroles en leur présence quel que soit l’intérêt que suscitaient leurs œuvres. Ses visites d’ateliers étaient longues et silencieuses, mais elle savait dans les quinze premières minutes si elle envisagerait une exposition.
Ses choix audacieux avaient rapidement fait de l’encombrant cadeau de mariage de Georges Grosmann une galerie estimée et reconnue comme l’un des lieux les plus emblématiques pour la jeune création angeline. Même si le monde de l’art savait pertinemment qui elle était, elle avait eu la bonne idée de ne pas utiliser son célèbre nom de famille. La galerie s’appelait « Équations », en souvenir de la fameuse conférence du mathématicien Herbert Kanno qui était devenu son mari quelques mois plus tard au grand désespoir de son père.
Ses larmes avaient jailli sans prévenir, sans bruit, sans spasmes et ruisselaient sur ses joues qu’elle frottait maladroitement entre ses paumes. Jason s’était approché et ne vit pas immédiatement qu’elle pleurait. Lorsqu’elle tourna vers lui son visage inondé, son regard débordait de tristesse et de rage mêlées.
— Comment peut-on effacer la vie d’un homme, d’un fils ?
Comment cela a-t-il pu arriver ? Pourquoi n’ai-je pas vu sa folie ?
— Personne ne pouvait la voir. Il ne l’a pas vue lui-même, à aucun moment ni encore aujourd’hui.
— Je me demande depuis des jours si j’ai pu rencontrer Nathan ou apercevoir une de ses pièces, mais je n’ai aucun souvenir… Je ne lui pardonnerai jamais.
— Cecilia, nous devons prendre notre temps pour penser et organiser cet hommage. Si vous décidez de dévoiler l’identité de votre frère, vous serez totalement exposée et les critiques d’art ne seront pas les seuls à s’intéresser à lui.
— Nous ne sommes pas obligés de raconter toute l’histoire…
Jeremiah Masson et Herbert Kanno les avaient rejoints.
— N’y comptez pas, madame Kanno. Un autre procès Grosmann a commencé. L’histoire sera rendue publique et plus vite que l’on ne croit. Vous pouvez encore renoncer. Vous héritez légalement de l’ensemble des œuvres et vous en disposez librement.
— Je n’ai pas l’intention de renoncer et peu m’importe que l’on découvre qui était mon père. Tout ce qui pourra être dit ou écrit ne sera jamais aussi sordide que la vérité. Ce que je viens de découvrir ici est unique et révéler l’œuvre de Nathan Grosmann est aujourd’hui ma priorité absolue. Rien ni personne ne m’en empêchera.
— Je n’en avais pas l’intention. Je voulais juste vous épargner des moments pénibles.
— Herbert et moi avons déjà largement subi les conséquences des récentes frasques de mon père.
Elle lança un regard crispé à son mari avant de se tourner à nouveau vers les sculptures.
— Je souhaiterais rencontrer Benedict Grosmann.
Il y eut un court silence. Elle fit face à Jeremiah Masson.
— Vous devez certainement savoir ce qu’il risque. Comment peut-on l’aider ? Il y a sûrement quelque chose que je peux faire pour lui. Combien de temps va-t-il rester en prison ? …
— Madame Kanno, je crains qu’il n’ait plus toute sa raison. La haine qu’il voue à Georges Grosmann depuis quelques années l’a rongé et sa volonté farouche de venger son père lui a fait perdre pied avec la réalité. Il a préféré se dénoncer plutôt que d’accepter d’être le petit-fils de… Je ne saurais dire s’il s’agit là de courage ou de folie. Un peu des deux, je suppose. Toujours est-il qu’il est très perturbé et que son état réclame un sérieux suivi médical. Les conclusions des experts sont formelles. Il n’y aura pas de procès. Le juge a ordonné son transfert vers un établissement spécialisé.
— Un établissement carcéral ?
— Pas du tout. Benedict Grosmann n’est pas considéré comme dangereux, si ce n’est pour lui-même. C’est une clinique psychiatrique, une des meilleures…
— Je ne comprends pas très bien. Je suppose que ce n’est pas l’État de New York qui va financer les soins ?
Jeremiah Masson soupira lentement.
— Non, c’est votre père.
Elle blêmit, lança des regards incrédules à Jason et Herbert.
— Ça n’est pas possible ! Comment peut-il encore intervenir dans cette affaire ? C’est inacceptable !
— Remerciez plutôt l’avocat désigné de votre neveu qui a défendu ses intérêts avec beaucoup d’intelligence. C’est un jeune gars très doué qui ne s’est pas laissé impressionner par les avocats de Grosmann. L’arrogance de votre père s’est retournée contre lui. En jouant les aveux explosifs sur son passé trouble, il n’a fait qu’alourdir sa condamnation. Il n’a jamais douté de son pouvoir et encore moins lorsqu’il a découvert qu’il avait un petit-fils qui pourrait porter son héritage et sa renommée. C’était sans compter sur sa fragilité et sa névrose. Il n’avait pas prévu sa réaction et il a dû agir dans l’urgence. Entre la pression exercée par Jason sur l’avenir de sa collection criminelle et le reniement total et inattendu de sa filiation par Benedict, il a feint de perdre la face une dernière fois avec panache. Offrir sa collection au Whitney Museum, confier l’œuvre de Nathan Grosmann à sa chère fille dont il sait qu’elle n’aura de cesse de réhabiliter le nom et la création de son demi-frère, veiller enfin à ce que Benedict ne manque de rien à sa sortie de prison. Il avait déjà pris des dispositions dans ce sens. Le jeune avocat de votre neveu a quelque peu contrarié ses plans en laissant planer la menace de sa responsabilité dans la détérioration rapide de son état. Il lui a proposé un arrangement à l’amiable, si on peut dire. Éviter de charger son dossier déjà lourd et permettre à Benedict d’échapper à un internement arbitraire dans une institution d’État. Il n’y a pas eu de négociation. Les conditions et le financement des soins ont été acceptés par Grosmann et par les autorités.
— Benedict est au courant ?
— Pas encore.
— C’est sans conteste une bonne chose, mais cela risque de ne pas lui plaire, non ?
— Il n’est pas en état de prendre une décision pour le moment.
Ce que son avocat a obtenu dans ce contexte est exceptionnel.
— Comment s’appelle-t-il ?
— Enis Pavan. Il est au barreau de New York depuis à peine un an.
— J’espère que je pourrai le rencontrer. En attendant, puis-je voir Benedict ? J’ai besoin de le voir, de lui dire qui je suis et qu’il peut compter sur moi.
— Vous savez certainement que nous ne pouvons pas lui imposer une visite. Mais je pense que Me Pavan y sera favorable.
Je vous organise cette rencontre.
— Je vous remercie infiniment.
— Vu votre emploi du temps, nous pouvons prévoir la visite mercredi après-midi. Cela vous convient ?
— Parfaitement.
— Madame Kanno, je vous conseille de ne pas trop espérer de cette rencontre. Je ne crois pas qu’il soit prêt.
— Je ne ferai rien qui puisse le perturber davantage, mais j’ai l’intime conviction que je dois être à ses côtés.
— Comme vous voudrez. Il est au Metropolitan Correctional Center jusqu’à vendredi et intégrera la clinique Calm Tree samedi matin. Je vous communique les détails de la visite dans l’après-midi.
— Merci encore. Puis-je prendre quelques photos des pièces ?
— Je vous en prie.
Alors que Cecilia et Herbert Kanno photographiaient méthodiquement les sculptures, Jeremiah Masson saisit le bras de Jason Gloves et l’entraîna vers l’ancien bureau de Grosmann.
— J’ai quelque chose à vous montrer.
Il tendit la main vers une vingtaine de photographies étalées sur la grande table. Jason s’approcha en levant les sourcils.
— Une autre surprise ?
— Peut-être bien. Vous connaissez sans doute certaines des personnes photographiées.
Il s’agissait d’un vernissage. On devinait des fragments de peintures que la foule des visiteurs empêchait d’identifier. Jason reconnut rapidement Georges Grosmann, plus jeune, sur l’un des clichés. Un énorme cigare nuageux à la main, il roulait des yeux sombres vers l’objectif alors qu’il accueillait une femme blonde, serrée dans un tailleur bleu électrique et argent. La silhouette lui parut vaguement familière, mais il avait croisé tant d’invités aux tenues flamboyantes ou extravagantes lors de ces grands vernissages. Il continua d’explorer les images. Tout le gratin new-yorkais devait être réuni ici. Il identifia Charles Braunstein, un collectionneur américain renommé, décédé il y a plus de dix ans. Il leva la tête vers Jeremiah Masson.
— Vous savez de quand datent ces photos ?
— 3 juin 2002. L’ensemble se trouvait dans une enveloppe cachée dans une des sculptures de Nathan Grosmann.
— Le photographe ?
— Probablement.
— 2002… Grosmann a cinquante-cinq ans.
— Et Nathan en a trente, Cecilia douze, Benedict huit, Grosmann quant à lui est divorcé depuis cinq ans et collectionne les maîtresses.
— Vous savez tant de choses sur lui. Ces images ont-elles vraiment encore quelque chose à nous dire ?
— Regardez la dernière série de ce côté.
Il se pencha en soupirant sur les derniers clichés. Des plans plus rapprochés de Grosmann, souriant – il ne l’avait jamais vu sourire –, en compagnie de cette femme au tailleur bleu qui lui tenait la main qu’il avait gardée le long du corps, comme pour plus de discrétion. Le photographe n’avait pas lâché le couple sur les dernières images. Jason posa lentement ses deux mains sur le bord de la table et ouvrit grand les yeux.
— Suzann Lennon ! C’est Suzann Lennon qui tient la main de Grosmann, n’est-ce pas ?
— Exactement.
— Vous en déduisez qu’elle était sa maîtresse ?
— Je n’en sais rien. En tout cas, elle était très proche de lui.
— Si nous considérons que Nathan Grosmann est le photographe, alors notre chère Suzann a menti. Vous ignorez peut-être qu’elle a acquis une pièce de Nathan, ici même, sans que Grosmann l’apprenne. Je ne sais pas à quelle époque, mais elle a affirmé qu’elle ne l’avait jamais revu. Il semblerait que si… Mais quelle importance ! Ça ne change pas grand-chose à cette affaire, non ?
— Je m’interroge. L’implication de Suzann Lennon dans l’affaire Grosmann a été la plus spectaculaire et je me demandais si elle n’en avait pas été complice dès sa conception.
— Vous faites fausse route, Jeremiah. Grosmann n’a jamais partagé sa folie avec d’autres et encore moins avec Suzann, aussi proches qu’ils aient pu être à un moment de leur vie. Les dates ne collent pas. Son grand projet a été pensé bien plus tard. Et la rancœur obstinée que nourrit Suzann à son égard est celle d’une femme trahie et méprisée. Croyez-moi ! Je suis certain que sa rage d’avoir été sous-estimée n’a d’égal que son extravagante vanité.
— Vous semblez bien la connaître…
— Disons que nous avons eu récemment une conversation qui m’a permis de mieux la cerner.
Jason soupira et passa lentement les doigts dans ses cheveux. Il sentit un terrible ennui s’abattre sur ses épaules. Il se demandait soudain pourquoi il regardait ces photographies, réduit à deviner si Suzann Lennon avait été la maîtresse de Grosmann ou pas. Quand serait-il définitivement débarrassé de cette affaire si encombrante ? Jeremiah Masson avait perçu son agacement. Il ramassa les images sur la table.
— Votre avis compte toujours beaucoup pour moi, Jason. Je suis désolé de vous importuner pour si peu.
— Non, c’est un plaisir de pouvoir vous aider, mais vous comprendrez certainement que je souhaite passer à autre chose.
J’ai promis à Cecilia de l’accompagner dans la réalisation de l’exposition de Nathan, mais ce sera ma dernière collaboration ayant un lien avec l’affaire Grosmann.
— Vous n’assisterez pas à l’inauguration de « Collection G » au Whitney Museum ?
— Je ne crois pas, non. Je viendrai plus tard. Ce sera une magnifique exposition.
— J’espère que vous changerez d’avis.
Il tendit une main chaleureuse à Masson. Dans la galerie, la séance photos était achevée. Cecilia et Herbert tournaient encore autour de la grande table, comme s’ils ne pouvaient se détacher des sculptures hypnotiques de Nathan Grosman. Il se retourna précipitamment.
— Voudriez-vous les saluer de ma part et leur dire que j’attends leur appel ?
— Comptez sur moi !
Ils échangèrent un dernier sourire avant que Jason ne s’éclipse.
Se retrouver dans la galerie l’avait un peu troublé et il ne l’avait pas prévu. Il regrettait sa précipitation à sortir, mais une lassitude soudaine l’avait submergé, l’empêchant de faire face aux questionnements et au désarroi de Cecilia. Il respira longuement. Il avait aimé défier Georges Grosmann, bien plus qu’il ne l’avait imaginé, et à présent que rien ne devait plus les opposer, il éprouvait un véritable ennui. Les images de la tendresse inattendue entre la collectionneuse et le galeriste ne l’intéressaient pas. Il aurait préféré une nouvelle révélation, plus accordée à la sombre personnalité de son adversaire. Il prit conscience de la vanité de ses pensées et sut qu’elle avait été la cause de son départ si cavalier. Il refusait ce sentiment si étranger, mais il n’avait pas tenté de le contrôler, juste cet affolement devant l’évidence avant de fuir comme un voleur. Il souhaita un instant qu’Eduardo l’attende sur le trottoir d’en face.
Il pourrait lui dire qu’il venait de reconnaître la sensation pesante qui l’avait gagné au fil de ses rencontres avec Grosmann.
Ce poison qui avait parfois occulté la monstruosité au profit de la fascination et qui venait de ressurgir, déguisé en prétention encombrante. Il réagissait toujours avec excès devant ce qu’il croyait être sa pire faiblesse, tout en sachant la futilité de ses emportements. Il tenta alors d’imaginer le couple improbable formé par Suzann Lennon et Georges Grosmann, tellement improbable qu’il n’y parvint pas. Il s’excuserait plus tard.
Sintra
La pluie n’avait pas cessé depuis une heure et les rafales la poussaient à l’intérieur du grand salon dont une des fenêtres était ouverte. Joachim da Silva regardait les flots tremper les lourds rideaux jaunes et le dossier d’un immense canapé recouvert de chintz à motifs floraux. Il détestait chaque meuble, chaque tapis, chaque objet de cette maison. Et elle en était remplie. La propriété était grande, mais il se cognait à chacun de ses pas dans une table de jeux branlante, une console en acajou encombrée de vases et de coupes, une desserte en verre napperonnée de dentelles fanées, un petit bureau bancal, un fauteuil en cuir, un fauteuil crapaud, un fauteuil à velours frangé… Il semblait que les meubles s’étaient multipliés, profitant de l’absence de leurs propriétaires pour engendrer une troupe bâtarde de sofas et de divans plus vilains les uns que les autres. Les murs n’avaient rien à envier au désordre défraîchi, poussiéreux et malodorant qui se répandait dans toutes les pièces. Des cadres énormes, rutilants et kitch, emprisonnaient d’ennuyeuses gravures paysagères. Des miroirs par dizaine n’avaient pas été épargnés par l’invasion des dorures et des volutes. D’immenses vitrines en bois sombre exhibaient sans égard des porcelaines chinoises, de l’argenterie française ou une collection de pierres dont certaines ne manquaient certainement pas d’être précieuses. Les huit chambres de l’étage n’échappaient pas au désastre décoratif. Commodes bombées, armoires pompeuses, chevets torsadés, coiffeuses chargées de bonbonnières et de boîtes à bijoux musicales, chauffeuses, lits et rideaux en cretonne inlassablement fleurie… Les salles de bains en marbre avec frises d’azulejos courant sur tous les murs achevaient le florilège de laideur et d’inélégance.
Joachim n’avait jamais aimé cette demeure où ses parents avaient si peu séjourné. Elle n’avait aucune personnalité, ne possédait ni l’extravagance, ni la monumentalité, ni le tragique des palais romantiques bâtis au XIXe siècle à Sintra pour l’aristocratie portugaise. Les silhouettes dramatiques et fantasques de ces édifices l’avaient toujours subjugué. Lorsqu’il venait, plus jeune, s’isoler à la villa, il ne manquait jamais de les visiter, de renifler encore et encore leur atmosphère mélancolique, exotique ou ténébreuse.
Il n’avait pas mis les pieds ici depuis bien longtemps. Il se décida à fermer la fenêtre et se promit de jeter tous les meubles qui gisaient dans la maison dès que possible. Il se dirigea vers l’office, non sans bousculer un tas de chaises longues empilées négligemment dans l’immense cuisine. Il décrocha un trousseau de clefs au-dessus duquel était inscrit : « la maison des invités ».
Il sortit par une des portes arrière qui ouvraient sur le jardin. Il aperçut le palais de Monserrate et eut la sensation de retrouver un vieil ami. Il marcha d’un pas vif vers la maison des hôtes, vers sa maison. Il avait laissé le rez-de-chaussée dans son jus suranné et avait transformé les quatre chambres de l’étage et le grenier en un grand appartement nettement plus à son goût. Il grimpa l’imposant escalier en chêne et déposa son bagage sur le plancher du large couloir, plongé dans l’obscurité. Il s’empressa d’ouvrir les volets et apprécia un instant la lumière pâle et fragile du jour déclinant sur le palais voisin.
Il demeura immobile, droit, épiant un signe annonciateur de l’émotion qu’il espérait ; un infime tremblement de la lèvre, un léger picotement de la paupière, un frisson le long du dos, un hoquet inattendu du diaphragme… La nausée le saisit brutalement et il vomit douloureusement, plié en deux devant la fenêtre, ne pouvant contrôler les spasmes qui secouaient son corps. Une bile âcre s’échappait à chaque haut-le-cœur et durant quelques longues secondes, il crut s’étouffer en crachant ces humeurs mousseuses et acides. Lorsqu’il put enfin se redresser, les larmes brouillaient son regard et il n’eut pas la force de les empêcher d’inonder son visage et de saler ses lèvres encore aigres. Puis il renifla bruyamment, s’essuya le nez et les yeux du revers de la main et cracha vers le jardin. Il croisa les bras sous ses côtes et soupira longuement pour calmer sa respiration toujours saccadée. Il ôta lentement sa veste souillée, la laissant choir à ses pieds et s’assit sur une chaise solitaire, oubliée sur le palier. Il posa les mains sur ses genoux et ferma les yeux un instant. Lorsqu’il les rouvrit, presque écarquillés, un sourire était accroché à ses lèvres.
Il n’avait pas souri depuis plus de quatre mois, depuis qu’il avait été incarcéré à la prison de Wandsworth à Londres. Vécus comme un inconcevable outrage à sa personne, sa condamnation et son emprisonnement l’avaient laissé léthargique plusieurs jours et ses avocats avaient craint un instant la démence. Le réveil avait été éprouvant mais lucide. Sa participation insolente au grand complot Grosmanien avait bel et bien brisé sa carrière. Il n’aurait pu imaginer pire humiliation que celle de son intelligence et de son inventivité ignorées au seul profit de sa servilité sordide et de son inqualifiable comportement. Il avait mis du temps à assimiler les mots « brute » et « sadique ». Il s’était toujours considéré comme l’une des ordures les plus cultivées et sophistiquées dans son domaine. Il avait indéniablement changé de statut pour embrasser celui moins glorieux de criminel. Sa prétention farouche l’avait aveuglé.
L’espoir de se voir confier une mission essentielle à la grande machination s’était vite transformé en mauvais rêve, un rôle de petit chef d’orchestre cynique de la déconfiture finale de Jason Gloves. Il avait failli renoncer, estimant que la partition, un peu vulgaire, n’était pas loin de l’affront à sa personnalité et à sa réputation. Son arrogance et sa haine insatiable pour Gloves avaient eu raison de ses hésitations et il avait alors donné le meilleur de lui-même. Il avait organisé le plus brillant des pièges et avait savouré sans réserve la confiance et l’admiration que lui portait son commanditaire. Mais il n’avait pas été assez perspicace ni assez vigilant. Il avait repéré trop tard la fragilité feinte de ce Marcus Garbot, de ce traître qui avait réussi à les tromper, presque avec maladresse. Il s’en voudrait toujours d’avoir été abusé par cet homme sans classe.
C’était donc en simple criminel qu’il avait commencé à purger sa peine. Il avait froidement réfléchi à sa condition de prisonnier et imaginé la façon la plus pertinente pour supporter douze mois dans sa cellule. Se rappeler qu’Oscar Wilde avait séjourné dans la sinistre prison londonienne avait piteusement satisfait son érudition, superflue en la circonstance. Ses deux avocats avaient fait appel dès l’annonce du verdict et avaient obtenu rapidement un sursis de six mois. La renommée des da Silva avait facilité la transaction judiciaire en métamorphosant un semestre de prison ferme en sursis, réglée par une copieuse amende. Fernando da Silva, son père, lui avait adressé peu après une redoutable lettre dans laquelle il lui faisait part de sa honte et de son intention de le priver de tout héritage. Il n’eut pas l’occasion de mettre à exécution son projet. En août, il fut emporté, ainsi que son épouse, par un virus foudroyant à leur retour d’un voyage en Asie.
Joachim devenait le seul héritier de la colossale fortune de la famille da Silva, érigée sur un commerce florissant entretenu sans relâche avec les anciennes colonies portugaises, le Brésil, l’Angola ou Macao. Il avait grandi dans un petit palais à Lisbonne où la débauche et l’exubérance esthétique adoucissaient la solitude d’une éducation toxique bercée par la violence de son père et le silence égaré de sa mère. Les œuvres d’art, les objets, les livres, les fontaines rococo du jardin avaient été son refuge merveilleux, son étrange barrage contre la folie. À dix-huit ans, son départ pour Londres fut une délivrance. Sa résistance avait été extravagante et avait eu raison de l’autorité de son père qui n’avait pas envisagé d’autre avenir pour lui que celui de ses juteuses affaires postcoloniales. Il était son portrait craché, grand, les cheveux noirs, le regard sombre, mais son élégance élaborée et impertinente était une provocation permanente à la morne rigueur vestimentaire de son géniteur. Il avait certainement hérité ce gène de sa mère, le seul d’ailleurs qu’elle lui ait jamais transmis.
Londres fut un éblouissement. L’enseignement et la galerie du Courtauld Institute of Art étaient à la hauteur de ses ambitions et il était certain qu’il deviendrait l’un des plus grands spécialistes en histoire de l’art. Il avait rencontré un étudiant aussi brillant que lui, l’Américain Jason Gloves. Leurs divergences esthétiques avaient rapidement pris des allures d’hostilités compétitives et présomptueuses qu’il prenait soin d’entretenir avec jubilation.
C’est à ce moment et à cet endroit qu’il avait commencé à perdre pied. Il le savait aujourd’hui, seulement aujourd’hui, et comprenait aussi ce qu’il y avait abandonné. Il se redressa et entra dans la pièce qui lui avait servi de bureau, de chambre, de bibliothèque pendant de longues années. Son père avait acheté la villa à Sintra parce qu’il estimait que son rang – son titre de noblesse n’était qu’un privilège obtenu auprès de la monarchie – et sa fortune lui permettaient de s’afficher aux côtés des grands noms de l’aristocratie lisboète. Quitte à se satisfaire d’une grande demeure qu’il laissa dans le jus désuet des anciens propriétaires et qu’il ne fréquenta que rarement mais opportunément. Joachim s’était installé dans la maison spacieuse derrière la villa à l’autre bout du jardin. Il rentrait plus ou moins deux fois par an de Londres. Il passait embrasser sa mère à Lisbonne. Ils prenaient un thé presque silencieux qui se terminait immanquablement par des larmes. Son père ne l’avait plus salué depuis sa décision d’étudier en Angleterre. Alors il s’échappait aussitôt. Il empruntait une des voitures, se chargeait de quelques vivres et rejoignait Sintra. Il ne manquait pas d’argent et avait entrepris dès son premier été là-bas d’aménager une partie de la maison. La frénésie avec laquelle il avait remodelé l’étage était celle de l’indépendance qu’il savourait loin de la prison familiale. Une liberté solitaire. Joachim n’avait pas d’amis, tout au plus des collègues étudiants qu’il ne fréquentait pas en dehors de l’institut. Il se souvenait parfaitement de ces trois mois ardents, les premiers qui inaugurèrent les nombreuses retraites hallucinées qui rythmeraient sa vie pendant dix ans.
Il avait encore du mal à croire qu’il se trouvait ici aujourd’hui, une quinzaine de jours à peine après sa sortie de prison. La mort de ses parents et sa conduite « exemplaire » avaient joué en sa faveur et ses avocats s’étaient empressés de le faire sortir. Il passa quelques jours dans son appartement sur Brick Lane et rejoignit Lisbonne où le notaire et l’avocat de son père lui énumérèrent froidement la liste impressionnante des biens dont il disposait. Il venait de passer près de quatre mois en prison et son retour au monde l’étourdissait, le bouleversait. Lui que rien ne semblait atteindre depuis si longtemps était soudain désemparé et n’avait eu d’autre désir immédiat que de se réfugier à Sintra.
Il s’approcha d’une porte blanche à deux battants et respira profondément avant de l’ouvrir. Une puissante odeur d’essence de térébenthine et d’huile de lin s’engouffra dans ses narines et il ferma les yeux brièvement en se laissant pénétrer par l’effluve.
Il grimpa les marches qui menaient aux combles spacieux, faiblement éclairés par quatre lucarnes. Une centaine de toiles de formats divers étaient alignées le long des murs ou posées sur une longue table au fond de la pièce. Trois chevalets semblaient monter la garde et des dessertes roulantes chargées de pinceaux, de tubes de couleur et de pigments s’étaient immobilisées dans l’atelier abandonné. Il régnait un désordre indescriptible et la peinture qui jonchait le sol semblait encore fraîche. Il se dirigea vers le fond du grenier, attrapa un épais morceau de carton et s’approcha d’un vieux fauteuil en cuir maculé. Il s’y enfonça, le carton dans les mains. Un rayon de lumière vint animer la transparence dorée d’une bouteille d’huile et révéler la présence d’un miroir adossé au mur. Le bref éclat lui fit tourner la tête et il s’aperçut alors, observant son reflet. Il laissa glisser le panneau sur ses genoux. Ses cheveux noirs avaient poussé, accentuant la minceur et la pâleur de son visage. Il les plaqua en arrière, se redressa dans le fauteuil et scruta encore un instant son image.
Puis il détourna son regard et posa le carton devant lui. C’est un autre reflet de lui qu’il contempla alors, le premier autoportrait qu’il avait peint, ici même, lors de ce premier été après Londres.
La peinture était arrivée presque par hasard, mais dès qu’il avait fait sa connaissance, il ne l’avait plus quittée. Son installation à l’étage de la maison s’était accompagnée d’un inventaire exhaustif de tout ce qui se trouvait dans chaque pièce. Il avait vidé les armoires, les commodes, les secrétaires, les boîtes et son butin exposé soigneusement dans le grand couloir avait pris l’allure d’un champ de fouilles hétéroclite et intemporel.
Lorsqu’il avait fait disparaître la plupart de ses trouvailles dans un gigantesque sac-poubelle, il ne demeurait plus que quelques objets alignés sur le plancher. Une dizaine de grandes feuilles cartonnées, un coffret en bois contenant des gouaches, deux pinceaux, un flacon de vernis et une palette encore vierge, deux pots de peinture acrylique blanche et un panier rempli de