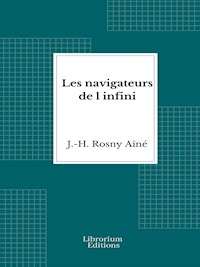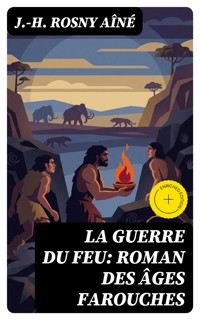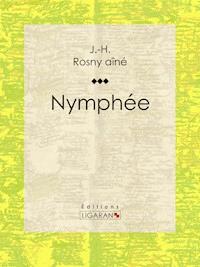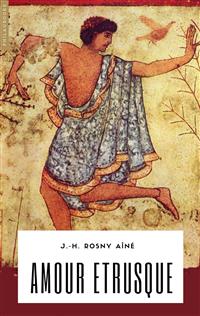
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
J’ai placé le lieu de ce récit dans un village étrusque de la Campanie, sous le régime de Vespasien. Il devait y avoir un assez grand nombre de ces villages. Mais les habitants, en général, ignoraient leur origine. Ceux que je mets en scène ont gardé quelques traditions. Mais on ne s’attendra pas à les trouver semblables à leurs ancêtres du temps des lucumons. Ils ont étrangement mêlé les légendes, les coutumes, les rites étrusques, grecs, romains et asiatiques. Puis, leur race n’est point pure : le Latin aussi bien que l’Hellène, et les esclaves d’Orient, ont transformé plus ou moins leur idiome, leurs goûts et leurs noms propres. C’est pourtant une population étrusque. Le lecteur qui a quelque érudition s’en apercevra bien. Mais à ce lecteur-là, il est facile de plaire. C’est l’autre que j’aimerais atteindre, – celui qui sait des Étrusques ce qu’il en apprit vaguement dans l’histoire romaine. Je lui adresse ce petit avertissement, afin qu’il se défie, pour la critique, des souvenirs de lycée : il devra avoir soin de se persuader qu’il ne sait rien des Étrusques. À la vérité, nul n’en sait davantage, mais, tout de même, pour bien goûter ce récit, qu’il fasse une distinction entre sa « pure » ignorance et l’ignorance pervertie de ceux qui ont longtemps pratiqué la matière. Enacryos (pseudonyme de J.-H. Rosny aîné)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Amour étrusque
J.-H. Rosny aîné
Table des matières
Avertissement
Avertissement
Livre I
1. Le voyageur
2. Le repas
3. Le refuge
4. Les potiers
5. La fête des mânes
6. Les dieux voilés
7. L’ombrienne
Livre II
1. L’aventure
2. La volupté
3. La joie sacrée
4. La clairière
5. Le supplice
Appendice
Notes
À propos de l’auteur
Couverture
Avertissement
AVERTISSEMENTde la première édition
J’ai placé le lieu de ce récit dans un village étrusque de la Campanie, sous le régime de Vespasien.
Il devait y avoir un assez grand nombre de ces villages. Mais les habitants, en général, ignoraient leur origine.
Ceux que je mets en scène ont gardé quelques traditions. Mais on ne s’attendra pas à les trouver semblables à leurs ancêtres du temps des lucumons 1. Ils ont étrangement mêlé les légendes, les coutumes, les rites étrusques, grecs, romains et asiatiques.
Puis, leur race n’est point pure : le Latin aussi bien que l’Hellène, et les esclaves d’Orient, ont transformé plus ou moins leur idiome, leurs goûts et leurs noms propres. C’est pourtant une population étrusque. Le lecteur qui a quelque érudition s’en apercevra bien. Mais à ce lecteur-là, il est facile de plaire. C’est l’autre que j’aimerais atteindre, – celui qui sait des Étrusques ce qu’il en apprit vaguement dans l’histoire romaine. Je lui adresse ce petit avertissement, afin qu’il se défie, pour la critique, des souvenirs de lycée : il devra avoir soin de se persuader qu’il ne sait rien des Étrusques. À la vérité, nul n’en sait davantage, mais, tout de même, pour bien goûter ce récit, qu’il fasse une distinction entre sa « pure » ignorance et l’ignorance pervertie de ceux qui ont longtemps pratiqué la matière.
Enacryos
Avertissement
AVERTISSEMENTde l’édition définitive
Par le style de cet ouvrage, je me suis proposé de rendre sensible mon amour pour la tradition classique, à laquelle, comme chacun sait, on m’a parfois reproché d’être infidèle. Le lecteur ingénieux retrouvera pourtant des tournures et surtout des images qui me sont familières. Quant au sujet, je pense qu’il m’est personnel. En faisant vivre mes personnages dans une bourgade de la Campanie, habitée par des familles étrusques, je m’écarte des routes fréquentées par mes confrères ; je m’en écarte plus encore par maintes particularités du récit, comme celles qu’on trouvera dans les chapitres intitulés : La Fête des Mânes, Les Dieux Voilés, La Clairière, etc.
Enacryos
Livre I
Chapitre 1
Le voyageur
Le voyageur s’arrêta près du Volturne1 aux grands roseaux. C’était l’heure terrible où les cigales sont heureuses de vivre et chantent toutes ensemble leur hymne à Phoïbos. Les peupliers noirs et les sycomores se pâmaient sous la fournaise du ciel ; les vastes étangs, sauvages comme au jour où ils sortirent du Chaos, enveloppaient Veïla mollement endormie sur la terre campanienne.
Le voyageur rejeta sa chlamyde2 et déposa sur une racine son pilos3 lamentable. Il portait un bâton d’olivier poli par plusieurs générations, et la flûte que Pan tira du corps mélancolique de Syrinx. Car il cultivait l’art magique des sons. Parti de Syracuse sur une trirème phocéenne, il avait marché de ville en ville, de bourgade en bourgade, dans la volonté d’atteindre Rome. Il était jeune, fait comme les hommes d’Argos ou de Mycènes, agile, les yeux vifs, la chevelure ardente et noire. Son âme avait reçu la culture délicate des philosophes, des aèdes et des courtisanes. Mais l’aveugle fortune ayant englouti son patrimoine, il vivait de son art.
L’excès de sa fatigue lui cachait la beauté du paysage. Il n’avait guère dormi, dans une bourgade farouche, et marchait depuis l’aube.
Les yeux entreclos, il eut la vision chagrine et merveilleuse de son bonheur évanoui sur la mer infatigable, où cinglent les vaisseaux de Libye, d’Asie-Mineure et de la Gaule. Alors l’abondance rendait les nuits plus voluptueuses ; la séduction des hétaïres se mêlait à la joie des cargaisons étendues sur les rivages ; la vie était facile et lumineuse comme les vagues palpitantes.
Dans la maison d’Archimède, tous les peuples versaient à la fois de l’or, des convives, des esclaves dressés aux souplesses du luxe, des rhéteurs à la voix sonore, des sophistes et les formes harmonieuses de l’art. Mais à l’heure écrite, la mer dévora les richesses. Archimède s’ouvrit les veines ; son fils errait pauvre sur la terre.
Il n’y trouvait aucun plaisir. Il s’irritait de distraire des imbéciles, il prenait avec chagrin le salaire de son art, il avait en exécration la brutalité de ceux qui donnent.
À mesure qu’il avançait vers Rome, les âmes devenaient plus âpres, les oreilles moins fines. Il ne rencontrait pas toujours l’hospitalité. Dédaigneux de la ruse, il avait connu la faim odieuse, reposé sur la terre nue ses membres à la peau délicate.
– Hermès ! s’écria-t-il, dieu cruel, tu ne m’as pas été secourable !
Ses yeux se remplirent de larmes. Il sentit la tristesse du monde, plus amère pour son âme accoutumée au luxe. Et il eut la vision des petites tables bleues, des viandes découpées par l’écuyer tranchant. Il y touchait d’une lèvre dédaigneuse, ne prenant plaisir qu’aux mets très déguisés, aux vives épices, aux vins vieillis dans des vases clos. Maintenant son souvenir ne lui retraçait ni cervelles de faisans, ni murènes siciliennes, mais la nourriture abondante : le pulmentum4, le speusticus 5, la polenta d’orge, les hachis de viandes.
Sa souffrance l’humiliait. Il souriait avec le sourire ironique d’un homme accoutumé aux leçons des sophistes. Peu à peu, la fatigue dominant la faim, ses idées se confondirent. Il s’endormit.
Quand il s’éveilla, les ombres étaient allongées. Tout le pays avait subi une métamorphose. Un charme plus tendre descendait sur le Volturne, sur les prairies renaissantes, sur les jeunes sources accourant des collines avec une rumeur qui dominait celle des cigales. Les feuilles argentines des peupliers sortaient de leur silence.
Le voyageur avait aussi le corps moins triste et l’âme plus courageuse. Il considéra les vignes, les oliviers et les rizières qui enveloppaient les habitations du clair village. On apercevait des potiers tournant leur roue, d’autres disposant les vases au soleil, et, vers le centre, la gueule rouge d’un four, entr’ouverte.
Veïla était renommée à Tarente, à Capoue, à Pompéi, jusqu’à Syracuse et les îles de l’Archipel, pour ses vases charmants, aux contours rythmés, aux subtiles peintures. Elle unissait les grâces hellènes, les secrets étrusques, la naïveté des temps fabuleux et la délicatesse des prochaines décadences.
Le voyageur s’écria :
– Dionys, fils d’Archimède, vous salue, Terre divine et toi Volturne aux doux abîmes : il serait doux de s’oublier ici comme une ombre harmonieuse ! Mais sans doute vos habitants sont malveillants et rudes.
Une aimable mélancolie passa dans son cœur. Elle éveilla l’art. Il éleva la flûte à ses lèvres, il soupira son admiration, sa jeunesse et sa pauvreté. Les âmes sonores s’élevèrent et moururent, parmi le bruit des eaux, comme les moucherons d’orage.
Dionys sentit quelque chose en lui d’âpre et de charmant, de fier, de tendre et de courageux. C’était la beauté, mère des dieux, l’océan véritable dont sortit Aphrodite. L’exilé portait un peu de sa magnifique écume. Puis il chanta la nymphe Syrinx, poursuivie par le dieu velu. Les sons jaillissaient de la flûte, comme les contours du ciseau de Praxitèle, comme les paroles ailées des lèvres homériques.
Le monde fut moins amer, la faim moins cruelle. Dionys comprenait la légende, et quels monstres domptait Orphée.
Il se tut, il entendit un frémissement dans le silence.
Puis une voix s’éleva, qui était plus douce encore que la flûte du dieu Pan et comme mêlée de cristal et d’eau vive.
– Que Séléné et Phoïbos protègent tes pas, voyageur aux beaux accents ! Que toute porte te soit hospitalière, toute rencontre bienfaisante !
Il se tourna, il vit contre la haie d’épine une fille qui montrait encore des traces de l’enfance, mais avec des lignes fières de jeune statue, un voluptueux contour partant des épaules à la taille ronde et mêlant la hanche en lyre aux plis lâches du vêtement.
Elle rappelait à Dionys l’Anadyomène gracile qu’on adore à Syracuse, dans un petit temple de marbre vert.
Elle était vêtue d’une stola6 de laine blanche et coiffée de cheveux admirables, herbe noire où courait une lumière violette, onde de volupté brillante comme un fleuve sous les étoiles. Ses yeux contenaient toute la splendeur des poèmes : ils avaient la couleur de la mer Tyrrhénienne lorsqu’ils reflétaient le jour ; les cils, en s’abaissant à demi, les rendaient plus mystérieux et tendrement redoutables.
Un dieu s’était complu, dans ce village lointain, à sculpter la forme des déesses. Chaque geste de la fille décelait sa beauté.
Dionys considérait les joues aux courbes délicates, la bouche parée de feu et de neige, le cou étincelant qui changeait amoureusement de forme, selon qu’elle levait, abaissait ou retournait son visage, et la jeune poitrine qui renflait la stola à chaque respiration. Cette présence magnifique enchaînait les mouvements du voyageur. Son cœur grondait, non de volupté ni d’amour, mais du trouble de l’art. Il connaissait qu’aucune des subtiles et souples hétaïres venues sur les vaisseaux de son père n’avait été accomplie par un si fier ciseau.
Il répondit enfin.
– Tes paroles me porteront bonheur, jeune fille, car la beauté est propice. Ses vœux sont exaucés. Déjà la route m’apparaît moins rude, l’avenir plus exorable !
Elle sourit, elle parut plus enfantine. Puis, familière et curieuse :
– D’où viens-tu ?
Il s’empressa de satisfaire cette curiosité, impatient de paraître ce qu’il était :
– Je viens de Syracuse. Mon père avait des vaisseaux sur la mer, chargés d’huile, de blé et de vins noirs. L’abîme a tout pris. Je suis parti pour Rome où je pense trouver l’emploi de mon art. Sans doute, le voyage ne m’apparaît si dur que parce j’ai été accoutumé à vivre sans peine. Je m’y ferai.
Elle répondit avec vivacité :
– Je suis Dehva, petite-fille de Tarao, le maître-potier de Veïla, dont les vases sont recherchés jusqu’à Syracuse. Ce village est hospitalier. Si tu désires y prendre du repos, va jusqu’à la maison que tu aperçois derrière le mur des Ancêtres. Avec tes beaux accents tu charmeras l’âme de Tarao. Il n’y a pas d’homme plus attaché aux choses divines.
La poitrine de Dionys s’emplit de fraîcheur. Son regard brillant enveloppait Dehva. Il lui parut impossible de ne pas s’arrêter dans ce village :
– J’obéirai, murmura-t-il à cette voix si douce.
– Va, reprit-elle. Tu rediras, j’espère, pendant la cena7, ce que tu jouais aux roseaux du Volturne.
Elle dit et repartit. Il écouta la fuite des petites sandales et le frémissement de la stola contre les branches d’olivier. Puis la figure élégante disparut au tournant d’un chemin.
Et Dionys connut l’espérance de Jason au bord du jardin des Hespérides.
Dionys traversa un champ d’herbes et des vignes bleues. Il se trouva devant le mur des Ancêtres, vieux de mille ans, et fait de blocs de Carrare disposés à la manière cyclopéenne. De là on apercevait mieux le village. Dans le soleil ambré, dans les ombres longues et violescentes, les oliviers, les pins, les rizières, les beaux vergers, les bœufs de Campanie rêvant parmi les pâturages et les demeures des hommes, figuraient l’image du bonheur.
Les maisons et les cabanes n’émergeaient qu’à demi de la toison des vignes vierges ou des grands sycomores. Elles étaient presque toutes de pierres volcaniques, de laves et de basaltes tirés de ce sol qui, pendant vingt mille ans, trembla de feux terribles. Quelques-unes, en panchina, semblaient faites de coquilles et l’étaient véritablement, mais de coquilles nées avant tous les siècles de l’homme.
Dans les vergers, devant les façades ombreuses, sous les branches abondantes, on voyait tourner les roues, les ébauchoirs façonner la terre docile, les pinceaux poser le vernis noir.
Un groupe de filles, sur une terrasse, traçait l’ornement des vases. Attentives, elles répétaient de la pointe du style quelque jeu de faunes, quelque scène rustique ou simplement des lignes harmonieuses.
Toutes semblaient pétries de grâce dans leurs stolas légères et parmi les pampres qui ne les laissaient voir qu’à moitié. L’une, la jambe nue élevée sur un trépied, la chevelure un peu retombante, la tête inclinée, montrait les vases clairs de sa poitrine, dans une pose ensemble ingénue et lascive.
Dionys tourna la muraille et devint visible à tous. Les têtes se levèrent, les têtes étrusques aux yeux de rêve, les visages qui avaient accoutumé d’être sur cette terre mille ans avant la fondation de Rome. Méfiantes, hantées de traditions mélancoliques, elles ne souriaient pas à l’étranger. Plutôt le repoussaient-elles. On les sentait souvenantes de l’infortune des ancêtres, pleines encore de légendes dans ce district où Rome n’avait pas, comme ailleurs, dispersé les hommes, insulté les sépultures, anéanti les usages.
La maison apparut, tout ombreuse de vignes vierges et d’oliviers centenaires. Elle était bâtie en travertin et en silex blanc de Tarquinii. On apercevait, sculpté dans un bloc, sur la porte, le dieu étrusque au nom perdu qui avait enseigné l’art de cuire l’argile. Deux fontaines coulaient à mi-voix.
Devant les larges baies ouvertes, des jeunes hommes et des jeunes filles s’essayaient à façonner la glaise brune ou bleue, à découvrir la forme d’une lampe, d’une urne, d’une écuelle, ou à tracer des figures.
Un grand vieillard chauve veillait sur cette école. Il était passionné, il reprenait ou louait ardemment. Sa voix était rude, son geste nerveux. Une flamme profonde demeurait dans ses yeux creux, la force de vivre habitait son visage plein de plis et ses lèvres violettes.
Et les durs étés n’avaient pas courbé sa taille.
Dionys le considéra avec crainte, car la faim était revenue, avec le désir d’une halte, d’un doux repas, de la compagnie d’hommes moins frustes que ceux qu’il avait hantés sur les routes.
Il éleva doucement sa flûte, il joua un hymne qu’il avait composé pour la mer cruelle et le glauque Poséidon.
À cette voix, le vieillard s’arrêta et tendit l’oreille droite. Il ne montra ni plaisir, ni ennui, mais une attention profonde. Quand les cris de la syrinx se furent évanouis dans l’air bleu, il s’écria :
– Par les Dieux complices, étranger, tu m’as rappelé les routes poudreuses de l’Attique et les soirs clairs sur l’Agora. Tu mérites la louange des sages ! Dis-moi d’où tu viens et quel fut ton maître : certes il reçut en partage une habileté peu commune.
Dionys répondit :
– J’ai nom Dionys, et je viens de Syracuse. Mon père Archimède avait des vaisseaux sur la mer. La mer dévora ses biens, et les créanciers plus durs que la mer. Beaucoup de maîtres m’ont enseigné l’art des sons. Je vais à Rome où la vie est vaste.
– Elle est vaste, mais point douce ! répondit le vieillard.
Il était venu sur le pas de la porte. Il souriait, plein de souvenirs. Il lui plaisait que Dionys ne fût pas un vagabond élevé à l’aventure, car il espérait pouvoir dépenser un peu de ces paroles qui s’accumulaient en lui et que sa vieillesse lui rendait plus insupportable de ne pouvoir dire. Il entrevit une soirée éloquente, un convive à l’oreille attentive.
Il demanda avec avidité, dans la langue grecque :
– Tu as sans doute connu à Syracuse des artistes, des rhéteurs et des sophistes ?
– Archimède se plaisait à les voir, répondit le Sicilien. J’ai depuis l’enfance goûté leurs propos.