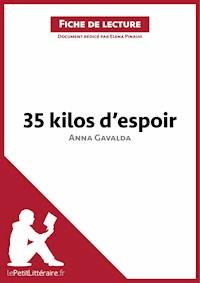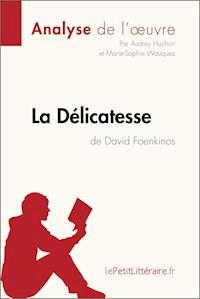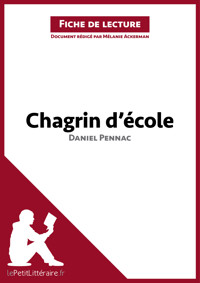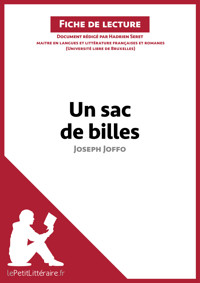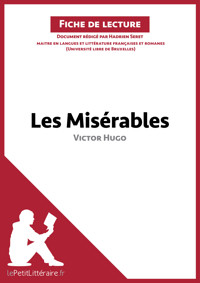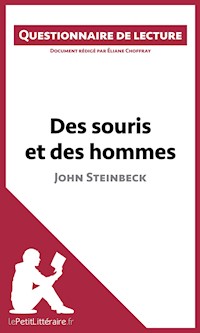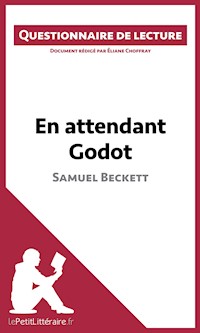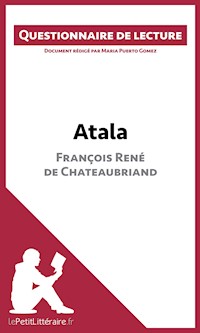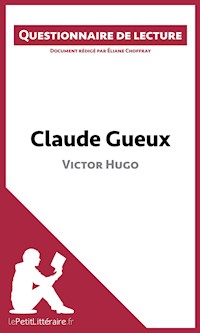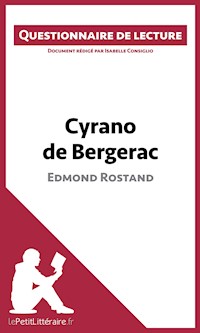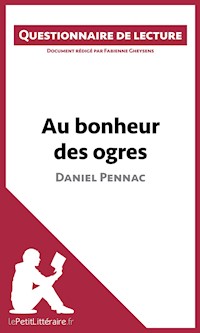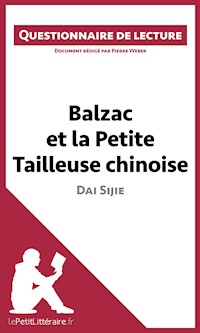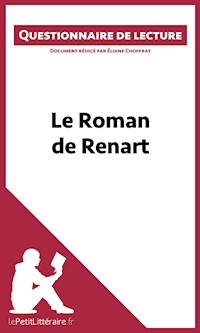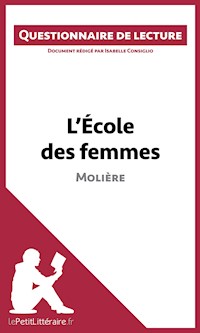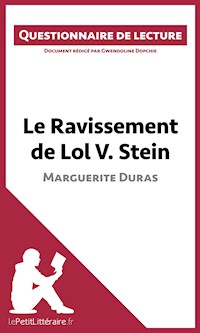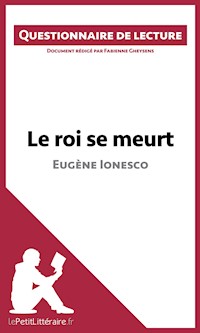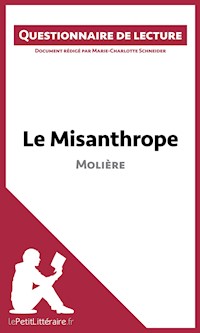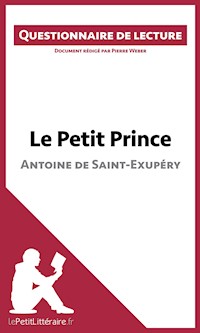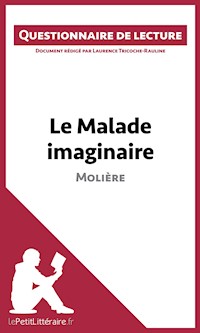Annales 2011 Série ES/S "Le roman et ses personnages : visions de l'homme et du monde" (Bac de français) E-Book
lePetitLittéraire
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: lePetitLitteraire.fr
- Kategorie: Bildung
- Serie: Réussir le bac de français
- Sprache: Französisch
Ce document propose un corrigé clair et détaillé des épreuves du bac de français 2011, série ES/S, sur le thème du roman et de ses personnages. Après la retranscription des trois textes qui composent le corpus sur lequel portent les épreuves, on trouve la réponse à la question, puis une proposition de commentaire, de dissertation et d’invention.
Un corrigé est le moyen le plus efficace pour vous rendre compte de ce qu’on attend de vous au bac et pour vous exercer. En plus, la structure des épreuves ne change jamais et certaines questions reviennent d’année en année…
Un dossier de référence, l’idéal pour préparer efficacement le bac !
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 45
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
INTRODUCTION
Pour le bac de français 2011 série ES/S, il s’agissait d’explorer le thème suivant : « Le roman et ses personnages : visions de l’homme et du monde. »
La littérature française offre, en effet, un large panel de figures emblématiques familière telles que le fameux Tartuffe de Molière, Julien Sorel de Stendhal ou encore la belle Héloïse de Rousseau. Mais parmi l’ensemble des genres littéraires qui existent, le roman reste sans conteste le genre idéal permettant aux auteurs de développer leurs personnages et leurs caractéristiques afin de les rendre aimables, détestables, amoureux ou héroïques.
En lien avec cet objet d’étude, trois auteurs sont mis à l’honneur, plus particulièrement leurs personnages, qu’ils traitent avec beaucoup de dissemblance, à travers trois extraits d’œuvres : le premier représente le jeune Gavroche des Misérables de Victor Hugo ; le deuxième met en scène Frédéric et Hussonnet, les héros de L’Éducation sentimentale de Gustave Flaubert ; enfin, le dernier illustre la troupe de révoltés qui s’insurge dans La Fortune des Rougon d’Émile Zola.
L’étudiant tâchera tout d’abord de répondre à une question imposée selon une argumentation élaborée. Cette question porte directement sur les textes du corpus et permet notamment de vérifier les compétences de lecture du lycéen. Puis il devra, dans un deuxième temps, choisir entre trois travaux d’écriture : un commentaire, dans lequel il s’agit d’analyser un des textes du corpus ; une dissertation, qui porte sur une problématique plus vaste, tout en faisant appel aussi bien au corpus qu’à la culture générale de l’étudiant ; ou une invention, qui requiert davantage d’imagination.
Quel que soit le sujet choisi, l’étudiant dispose de quatre heures pour réaliser l’ensemble de ses rédactions.
CORPUS DE TEXTES
TEXTE A : HUGO, LES MISÉRABLES (1862), QUATRIÈME PARTIE, LIVRE 12
GAVROCHE, UN GAMIN DE PARIS, AIDE LES INSURGÉS QUI CONSTRUISENT UNE BARRICADE, AU COURS DE L’ÉMEUTE PARISIENNE DE JUIN 1832.
Gavroche, complètement envolé et radieux, s’était chargé de la mise en train. Il allait, venait, montait, descendait, remontait, bruissait, étincelait. Il semblait être là pour l’encouragement de tous. Avait-il un aiguillon ? oui certes, sa misère ; avait-il des ailes ? oui certes, sa joie. Gavroche était un tourbillonnement. On le voyait sans cesse, on l’entendait toujours. Il remplissait l’air, étant partout à la fois. C’était une espèce d’ubiquité[1] presque irritante ; pas d’arrêt possible avec lui. L’énorme barricade le sentait sur sa croupe. Il gênait les flâneurs, il excitait les paresseux, il ranimait les fatigués, il impatientait les pensifs, mettait les uns en gaieté, les autres en haleine, les autres en colère, tous en mouvement, piquait un étudiant, mordait un ouvrier ; se posait, s’arrêtait, repartait, volait au-dessus du tumulte et de l’effort, sautait de ceux-ci à ceux-là, murmurait, bourdonnait, et harcelait tout l’attelage ; mouche de l’immense Coche révolutionnaire.
Le mouvement perpétuel était dans ses petits bras et la clameur perpétuelle dans ses petits poumons :
« Hardi ! encore des pavés ! encore des tonneaux ! encore des machins ! où y en a-t-il ? Une hottée[2] de plâtras pour me boucher ce trou-là. C’est tout petit votre barricade. Il faut que ça monte. Mettez-y tout, flanquez-y tout, fichez-y tout. Cassez la maison. Une barricade, c’est le thé de la mère Gibou[3]. Tenez, voilà une porte vitrée. »
Ceci fit exclamer les travailleurs.
« Une porte vitrée ! Qu’est-ce que tu veux qu’on fasse d’une porte vitrée, tubercule[4] ?
– Hercules vous-mêmes ! riposta Gavroche. Une porte vitrée dans une barricade, c’est excellent. Ça n’empêche pas de l’attaquer, mais ça gêne pour la prendre. Vous n’avez donc jamais chipé des pommes par-dessus un mur où il y avait des culs de bouteilles ? Une porte vitrée, ça coupe les cors aux pieds de la garde nationale[5] quand elle veut monter sur une barricade. Pardi ! le verre est traître. Ah ça, vous n’avez pas une imagination effrénée, mes camarades ! »
TEXTE B : FLAUBERT, L'ÉDUCATION SENTIMENTALE (1869), TROISIÈME PARTIE, CHAPITRE 1
FRÉDÉRIC, LE HÉROS DE L’ÉDUCATION SENTIMENTALE, ASSISTE AVEC SON AMI HUSSONNET AU SACCAGE DU PALAIS DES TUILERIES, AU COURS DE LA RÉVOLUTION DE 1848.
Tout à coup la Marseillaise retentit. Hussonnet et Frédéric se penchèrent sur la rampe. C’était le peuple. Il se précipita dans l’escalier, en secouant à flots vertigineux des têtes nues, des casques, des bonnets rouges, des baïonnettes et des épaules, si impétueusement, que des gens disparaissaient dans cette masse grouillante qui montait toujours, comme un fleuve refoulé par une marée d’équinoxe, avec un long mugissement, sous une impulsion irrésistible. En haut, elle se répandit, et le chant tomba.
On n’entendait plus que les piétinements de tous les souliers, avec le clapotement des voix. La foule inoffensive se contentait de regarder. Mais, de temps à autre, un coude trop à l’étroit enfonçait une vitre ; ou bien un vase, une statuette déroulait d’une console, par terre. Les boiseries pressées craquaient. Tous les visages étaient rouges ; la sueur en coulait à larges gouttes ; Hussonnet fit cette remarque :
« Les héros ne sentent pas bon !
– Ah ! vous êtes agaçant », reprit Frédéric.
Et poussés malgré eux, ils entrèrent dans un appartement où s’étendait, au plafond, un dais de velours rouge. Sur le trône, en dessous, était assis un prolétaire à barbe noire, la chemise entr’ouverte, l’air hilare et stupide comme un magot[6]. D’autres gravissaient l’estrade pour s’asseoir à sa place.
« Quel mythe ! dit Hussonnet. Voilà le peuple souverain ! »
Le fauteuil fut enlevé à bout de bras, et traversa toute la salle en se balançant.