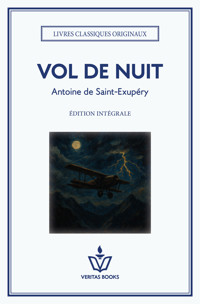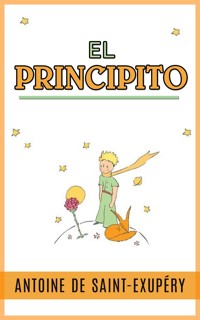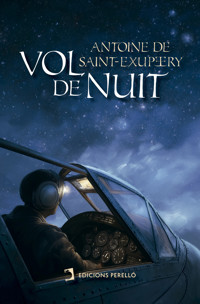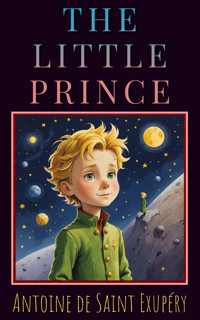1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: e-artnow
- Sprache: Französisch
Cette édition prestigieuse rassemble les textes les plus significatifs d'Antoine de Saint-Exupéry, figure majeure de la littérature française du XXe siècle, connu autant pour son génie littéraire que pour sa vie aventureuse et énigmatique. Saint-Exupéry, aviateur émérite, mena une existence profondément marquée par ses expériences aériennes, qui imprégnèrent son œuvre d'une philosophie humaniste et introspective. Né en 1900 à Lyon, il participa activement aux débuts héroïques de l'aviation civile en tant que pilote postal sur des lignes dangereuses à travers l'Afrique et l'Amérique du Sud, accumulant expériences et réflexions profondes. Ses écrits sont traversés par des réflexions sur le sens de l'existence, l'amitié, la solidarité humaine et la quête perpétuelle d'idéal. Disparu mystérieusement au cours d'une mission de reconnaissance aérienne durant la Seconde Guerre mondiale, l'auteur laisse derrière lui un héritage littéraire durable et une aura mythique qui continue de fasciner lecteurs et chercheurs. Son style poétique, subtil et profondément sensible, combiné à une écriture limpide et évocatrice, lui assure une place unique et incontournable dans l'histoire littéraire mondiale. L'édition présente un éventail complet des œuvres les plus influentes de l'auteur, offrant ainsi une vue d'ensemble précieuse sur son parcours créatif et intellectuel. Parmi celles-ci figure "L'Aviateur", récit poignant qui explore le courage et l'esprit de sacrifice d'un pilote confronté aux limites humaines et techniques. Dans "La Paix ou la Guerre ?", Saint-Exupéry médite sur les dilemmes moraux et philosophiques que posent les conflits armés et leurs conséquences sur la société. "Courrier sud", inspiré de ses propres expériences comme pilote postal, dépeint les périls et les joies d'une vie vouée à la communication et à l'exploration de nouveaux horizons, thématique également centrale dans "Vol de nuit", qui expose la tension dramatique entre responsabilité individuelle et impératifs collectifs au sein d'une entreprise pionnière de l'aéropostale. "Terre des hommes" se présente comme une méditation profonde sur la condition humaine, exaltant la camaraderie et l'héroïsme discret des pilotes face à la grandeur intimidante de la nature. Ce livre influença fortement la pensée humaniste du XXe siècle. "Pilote de guerre" est une réflexion intense sur l'engagement et la guerre, illustrant la solitude existentielle et les responsabilités morales inhérentes à l'acte de combattre. Dans "Lettre à un otage", l'auteur délivre un vibrant plaidoyer pour la fraternité universelle, exhortant à préserver l'humanité face à la barbarie. "Le Petit Prince", sans doute l'œuvre la plus connue et la plus traduite de Saint-Exupéry, est une fable philosophique et poétique qui traite avec délicatesse de l'amour, de l'amitié et de la quête de vérité intérieure, adressant subtilement aussi bien les enfants que les adultes. Enfin, "Citadelle", œuvre posthume inachevée, rassemble pensées et aphorismes, esquissant une réflexion sur la société idéale et les fondements spirituels nécessaires à l'épanouissement collectif et individuel. Cette anthologie permet de redécouvrir et d'apprécier pleinement la richesse et la profondeur d'un auteur dont l'œuvre demeure d'une surprenante actualité.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Antoine de Saint-Exupéry: Oeuvres Majeures
Table des matières
L'Aviateur
Les roues puissantes écrasent les cales.
Battue par le vent de l'hélice, l'herbe jusqu'à vingt mètres en arrière semble couler. Le pilote, d'un mouvement de son poignet, déchaîne ou retient l'orage.
Le bruit s'enfle maintenant dans les reprises répétées jusqu'à devenir un milieu dense, presque solide, où le corps se trouve enfermé. Quand le pilote le sent combler en lui tout ce qu'il y a d'inassouvi, il pense : « C'est bien » puis, du revers des doigts, frôle la carlingue : rien ne vibre. Il jouit de cette énergie si condensée.
Il se penche : « Adieu mes amis... » Pour cet adieu dans l'aube ils traînent des ombres immenses. Mais au seuil de ce bond de plus de trois mille kilomètres, le pilote est déjà loin d'eux:... Il regarde le capot noir appuyé sur le ciel, à contre-jour, en obusier. Derrière l'hélice un paysage de gaze tremble.
Le moteur tourne maintenant au ralenti. On dénoue les poignées de main comme des amarres, les dernières. Le silence est étrange quand on agrafe sa ceinture et les deux courroies du parachute, puis quand d'un mouvement des épaules, du buste on ajuste à son corps la carlingue. C'est le départ même : dès lors on est d'un autre monde.
Un dernier coup d'oeil au tablier, horizon de cadrans, étroit mais expressif — on ramène, soigneux, l'altimètre au zéro — un dernier coup d'oeil aux ailes épaisses et courtes, un signe de la tête : « Ça va... », le voilà libre.
Ayant roulé lentement vent debout il tire à lui la manette des gaz, le moteur, décharge de poudre, s'embrase, l'avion, happé par l'hélice; fonce. Les premiers bonds sur l'air élastique s'amortissent et le pilote, qui mesure sa vitesse aux réactions des commandes, se propage en elles, se sent grandir.
Le sol maintenant paraît se tendre, filer sous les roues comme une courroie. Ayant enfin jugé l'air d'abord impalpable puis fluide, devenu maintenant solide, le pilot s'y appuie et monte.
Les hangars qui bordent la piste, les arbres puis les collines livrent l'horizon et se dérobent. A deux cents mètres on se penche encore sur une bergerie d'enfant aux arbres posés droits, aux maisons peintes, les forêts sont encore épaisses comme une fourrure. Puis le sol se dénude.
L'atmosphère est houleuse, faite de vagues courtes et dures sur lesquelles l'avion bute et cabre, les remous le frappent aux ailes et tout entier il résonne. Mais le pilote le tient dans la main comme par le centre un balancier.
A trois mille il gagne le calme. Le soleil se prend dans la mâture, aucun remous ne l'y agite. La terre, si loin, se fige, immobile. Le pilote règle les volets, le correcteur d'air et le cap sur Paris calcule sa dérive. Puis, se laissant engourdir pour dix heures, il ne se meut plus que dans le temps.
Les vagues déploient, immobiles, un grand éventail sur la mer.
Le soleil a doublé enfin le mât extrême.
Un malaise physique a surpris le pilote. Il regarde : l'aiguille du compte-tours balance. Il regarde : la mer. Puis un hoquet rauque du moteur fait un trou dans sa conscience comme une syncope. Il brasse d'instinct la manette des gaz.
Ce n'était rien... une goutte d'eau. Il ramène doucement le moteur à cette note qui le comblait. N'était une sueur froide, il ne croirait pas avoir eu peur.
Il retrouve peu à peu l'inclinaison du dos, le point d'appui exact du coude nécessaires à sa paix.
Le soleil maintenant le surplombe. La fatigue est bonne si l'on ne fait pas de mouvement, si l'on ne détruit pas dans un membre l'engourdissement qui le protège, s'il suffit de pesées très douces sur les commandes.
La pression d'huile descend, remonte, que se passe-t-il là-dedans ?
Le moteur vibre. Salaud. Le soleil a tourné à gauche, rougit déjà.
Le bruit du moteur est métallique. Non... ce n'est pas une bielle. La distribution ?
L'écrou de la manette des gaz s'est desserré. Il faut la garder à fa main, quelle gêne!
C'est peut-être une bielle.
Ainsi l'on s'aperçoit à l'essoufflement, aux dents qui branlent, aux cheveux gris, que tout le corps à la fois a vieilli.
Pourvu qu'il tienne jusqu'à la terre.
La terre est rassurante avec ses champs bien découpés et ses forêts géométriques et ses villages. Le pilote plonge pour mieux la savourer. La terre de là-haut paraissait nue et morte, l'avion descend : elle s'habille. Les bois de nouveau la capitonnent, les vallées, les coteaux impriment en elle une houle : elle respire. Une montagne qu'il survole, poitrine de géant couché, se gonfle presque jusqu'à lui. Un jardin, sur lequel il pointe son capot, élargit ses massifs, s'ouvre à l'échelle de l'homme.
« Mon moteur gaze le tonnerre ! » les bruits qu'il entendait ? Il n'y croit plus. Si près du sol c'est pourtant la vie même.
Il épouse les courbes des plaines, s'en rapproche comme d'un laminoir et s'y aiguise, comme un drap, tire à lui les champs et derrière lui les rejette, tente les peupliers, coup de raquette, leur échappe et quelquefois écarte largement la terre comme un lutteur reprend sa respiration.
Il cingle maintenant vers le port au ras des verrières d'usine, déjà de lumière, au ras des parcs, déjà d'ombre. Le sol torrentiel charrie sous lui des toits, des murs, des arbres issus de l'horizon inépuisable.
L'atterrissage est décevant. On troque le torrent du vent, le grondement de son moteur et l'écrasement du dernier virage contre
une province silencieuse où l'on étouffe, un paysage d'affiche aux hangars très blancs, aux tapis très verts, aux peupliers bien découpés où de jeunes Anglaises descendent, une raquette sous le bras, des avions bleus de Paris-Londres.
Il se laisse choir le long de la carlingue gluante. On se précipite vers lui : « Splendide ! Splendide !... » Des officiers, des amis, des badauds. La fatigue lui serre soudain les épaules : « On vous enlève !... » Il baisse le front, regarde ses mains luisantes d'huile, se sent dégrisé, triste à mourir.
Il n'est plus que Jacques Bernis habillé d'un veston qui sent le camphre. Il se meut dans un corps engourdi, maladroit, demande à ses cantines trop bien rangées dans un coin de la chambre tout ce qu'elles révèlent d'instable, de provisoire. Cette chambre n'est pas conquise encore par du linge blanc, par des livres.
« Allo... c'est toi ? » Il recense les amitiés. On s'exclame, on le félicite : « Un revenant ! Bravo ! — Eh oui... Quand verrai-je ? » On n'est justement pas libre aujourd'hui. Demain ?
Demain on joue au golf mais qu'il vienne aussi. Il ne veut pas ? Alors après-demain — dîner — huit heures précises.
Bernis remonte les boulevards. Il lui semble remonter toute la foule comme un courant. Il lui semble affronter tous les visages. Certains lui font du mal comme l'image même du repos. Cette femme conquise et la vie serait calme... calme... Certains visages d'hommes sont lâches et il se sent fort.
Il entre pesant dans un dancing, garde parmi les gigolos son manteau épais comme un vêtement d'explorateur. Ils vivent leur nuit dans cette enceinte comme des goujons dans un aquarium, tournent un madrigal, dansent, reviennent boire. Bernis dans ce milieu flou où seul il conserve sa raison se sent lourd comme un portefaix, pèse droit sur ses jambes, ses pensées n'ont point de halo. Il avance parmi les tables vers une place libre. Les yeux des femmes qu'il touche des siens se dérobent, semblent s'éteindre. Les jeunes gens s'écartent, flexibles, pour qu'il passe. Ainsi, dans les rondes de
nuit, les cigarettes des sentinelles, à mesure qu'il avance, tombent des doigts.
Affecté à la formation d'élèves pilotes, il déjeune aujourd'hui dans l'unique auberge près du terrain. Des sous-officiers boivent leur café et causent. Bernis les écoute.
« Ils font un métier. J'aime ces hommes. »
Ils parlent de la piste qui est trop boueuse, des indemnités de convoyage puis de l'aventure d'aujourd'hui. « A cent mètres, une bielle dans le carter. Quelle salade. Pas un terrain... En arrière une cour de ferme. Je me fous en glissade, je redresse, je rentre percutant dans le fumier. » On rit. « C'est comme le jour, raconte un adjudant, que j'ai embouti une meule de foin. Je cherche mon passager, un lieutenant, penses-tu... vidé. Je le retrouve assis derrière la meule. »
Bernis pense : d'autres y ont laissé leur peau mais ce ne sont pour eux que des accidents du travail. J'aime assez leurs récits nus comme des feuilles de rapport. Ces hommes me plaisent, non que j'aie l'esprit de famille, mais il est possible, entre soi, d'être simple.
Racontez-nous vos impressions disent les femmes.
« C'est vous l'élève Pichon ? — Oui. — Vous n'avez encore jamais volé ? — Non. » Bien : il n'aura pas d'idées préconçues. Les anciens observateurs croient tout savoir : ils ont retenu des formules « Manche à gauche... Pied contraire... » Ce sont pas des élèves souples.
« Je vous emmène : au premier tour vous regarderez simplement. » Ils s'installent.
Le mécano au rabais de la section d'avions-école brasse l'hélice avec une lenteur irréparable. Il a encore six mois huit jours à tirer, il l'a même gravé ce matin sur le mur des W. C. Cela fait, il l'a calculé, environ dix mille tours d'hélice. Rien n'y changera rien. Alors...
L'élève regarde le ciel bleu, les arbres bêtes, un troupeau de vaches qui broutent la piste. Son moniteur astique de la manche la manette des gaz : ça fait plaisir de la voir luire. Le mécano compte les tours : que d'énergie perdue, il en est déjà à vingt-deux! « Si tu décrassais les bougies ? » Cela permet au mécano de réfléchir.
Un moteur ça part si ça veut. Vaut mieux le laisser libre. Trente. Trente et un... le moteur part.
L'élève ne comprend plus rien aux mots de danger, d'héroïsme, d'ivresse de l'air.
L'avion roule, l'élève le croit encore au sol quand il aperçoit les hangars sous lui. Un vent dur lui masse les joues, il fixe le dos du moniteur...
Bon Dieu... quoi ? On descend. La terre verse à droite, à gauche. Il se cramponne. Où est le terrain ? Il ne voit plus que des forêts qui tournent, se rapprochent, une voie de chemin de fer suspendue droite, le ciel... et tout à coup le champ se range devant eux horizontal, paisible, au ras des roues. L'élève sent le contact de l'herbe ; le vent tombe, voilà... le moniteur se retourne et rit, l'élève cherche à comprendre.
« Principes élémentaires, lui enseigne Bernis, quoi qu'il arrive d'anormal, primo: coupez, secundo: retirez vos lunettes, tertio : cramponnez-vous. En cas d'incendie seulement détachez-vous. Compris ? — Compris. »
Voilà enfin les mots que l'élève attendait, ceux qui matérialisent le danger, l'en jugent digne. Aux civils on dirait « Rien à craindre ». Pichon, dépositaire d'un tel secret, est fier... « D'ailleurs, achève le moniteur, l'aviation ça n'est pas dangereux. »
On attend Mortier. Bernis bourre sa pipe. Un mécano assis sur un bidon, la tête dans les mains, regarde avec surprise son pied gauche, battre la mesure.
« Dites donc, Bernis, le temps se bouche! » Le mécano lève les yeux et voit l'horizon déjà flou. Deux ou trois arbres s'y profilent mais la brume déjà les cimente. Bernis ne lève pas les yeux, continue de bourrer sa pipe : « Je sais. Ça m'ennuie. » Mortier achève son brevet et devrait avoir atterri.
« Bernis vous devriez téléphoner là-bas... — C'est fait. Il a décollé à quatre heures vingt. — Depuis, pas de nouvelles ? — Pas de nouvelles. »
Le colonel s'éloigne.
Bernis pose alors ses poings sur les hanches, regarde avec défi la brume qui choit doucement comme un filet, traque l'élève, Dieu sait où, contre la terre : « Et Mortier qui manque de sang-froid, qui pilote comme un cochon... c'est malheureux! »
« Écoute... » non, ce n'est rien : une voiture.
« Mortier, si tu t'en tires, je te promets... je ... je t'embrasse. »
« Bernis !... au téléphone. »
« Allô... quel est cet imbécile qui rase les toits de Donazelle ? — C'est un imbécile qui est en train de se tuer. Foutez-lui la paix, engueulez la brume ! — Mais... dites donc... — Allez le chercher avec une échelle ! » Bernis raccroche. Mortier s'est perdu, tente de trouver un repère.
La brume cède comme une voûte molle : on ne se distingue plus à dix mètres.
« Va dire aux infirmiers de préparer la camionnette, S'ils ne sont pas ici dans cinq minutes, je leur fous quinze jours de tôle. »,
« Le voilà ! » Tout le monde s'est levé. Il fonce vers eux invisible et aveugle. Le colonel les a rejoints : « Bon Dieu de Bon Dieu de Bon Dieu... » Bernis murmure inlassablement entre ses dents : « Coupe mais coupe donc le contact... mais coupe donc... tu ne peux pas éviter d'emboutir ! »
Il ne dut voir l'obstacle qu'à dix mètres de lui mais personne n'en sut jamais rien.
On court vers l'avion effondré. Il y a déjà là des soldats attirés par ce fait divers imprévu, des sous-officiers trop zélés, des officiers que leur autorité soudain encombre. Il y a l'officier de jour qui, n'ayant rien vu, explique tout, il y a le colonel qui s'incline trop car il tient le rôle ingrat de père.
Le pilote est enfin dégagé, la face verte, l'oeil gauche énorme, les dents cassées. On l'étend sur l'herbe, on fait le cercle. « On pourrait peut-être... », dit le colonel ; « on pourrait peut-être... » dit un lieutenant et un sous-officier dégrafe le col du blessé, ce qui ne lui fait aucun mal et calme les consciences. «L'ambulance ? L'ambulance ?... », interroge encore le colonel qui cherche une décision à prendre, par métier. On lui répond : « Elle arrive » sans rien en savoir, ce qui l'apaise. Puis il s'écrie : « A propos... » et s'éloigne d'un pas rapide, d'ailleurs sans but.
La situation cependant gêne Bernis. Ce cercle autour du moribond lui paraît même inconvenant. « Allons, mes enfants, allez-vous-en... allez-vous-en... » Et, par groupes, on s'éloigne dans la brume à travers les potagers et les vergers où l'avion prosaïque a chu.
L'élève pilote Pichon a compris quelque chose : on meurt et cela ne fait pas grand bruit. Il est presque fier de cette intimité avec la mort. Il revoit son premier vol avec Bernis, sa déception de ce paysage si plat, de ce calme, il n'y découvrait pas cette présence. Elle était là mais elle était là toute simple, nullement emphatique, derrière le sourire de Bernis et l'inertie du mécano, derrière le premier plan de ce soleil, de ce ciel bleu. Il a pris le bras de Bernis : « Vous savez... je volerai demain. Je n'ai pas peur. » Mais Bernis refuse d'admirer « Naturellement. Vous ferez demain vos spirales. » Pichon comprend encore quelque chose : « Ils n'avaient pas l'air très émus mais pour ne pas faire de phrases... -C'est un accident du travail », répond Bernis.
Bernis se saoule.
Ce monoplace de chasse gaze le tonnerre. Le sol sous lui est laid : une terre si vieille, si usée, rapiécée à l'infini : on dirait un lotissement.
Quatre mille trois cents mètres : Bernis est seul. Il regarde ce monde carrelé à la façon d'une Europe d'atlas. Les terres jaunes de blé ou rouges de trèfle, qui sont l'orgueil des hommes et leur souci, se juxtaposent, hostiles. Dix siècles de luttes, de jalousies, de procès ont stabilisé chaque contour : le bonheur des hommes est bien parqué !
Bernis pense qu'il ne faut plus demander son ivresse aux rêves qui bercent et qui anémient mais qu'il faut là tirer de sa force : il la mesure.
Il prend de la vitesse, réservoir d'énergie, fonce, pleins gaz, puis lentement tire le manche à lui. L'horizon bascule, la terre se retire comme une marée, droit vers le ciel l'avion fuse. Puis au sommet de la parabole il se renverse sur lui-même et le ventre en l'air, poisson mort, vacille...
Le pilote noyé dans le ciel voit la terre au-dessus de lui comme une plage s'allonger puis face à lui tomber de tout son poids : vertigineuse. Il coupe ; elle s'immobilise verticale, comme un mur : l'avion coule à pic. Bernis le hâle doucement jusqu'à retrouver devant lui le lac calme de l'horizon.
Des virages l'écrasent sur le siège, des chandelles l'allègent, l'allègent comme une bulle qui va crever, un flux retire l'horizon et le ramène, le moteur souple gronde, s'apaise, reprend...
Un craquement sec : l'aile gauche !
Le pilote pris en traître croit donner dans un croc en jambes : l'air s'est dérobé sous les ailes. L'avion, foreuse, plonge en vrille.
L'horizon d'un seul coup passe sur sa tête comme un drap. La terre l'enveloppe et, manège, tourne, entraînant ses bois, ses
clochers, ses plaines. Le pilote voit passer encore, lancée par une fronde, une villa blanche...
Vers le pilote assassiné, comme la mer vers le plongeur, jaillit la terre.
La Paix ou la Guerre ?
HOMME DE GUERRE, QUI ES-TU ?
Pour guérir un malaise, il faut l’éclairer. Et, certes, nous vivons dans le malaise. Nous avons choisi de sauver la Paix. Mais, en sauvant la paix, nous avons mutilé des amis. Et, sans doute, beaucoup parmi nous étaient disposés à risquer leur vie pour les devoirs de l’amitié. Ceux-là connaissent une sorte de honte. Mais, s’ils avaient sacrifié la paix, ils connaîtraient la même honte. Car ils auraient alors sacrifié l’homme : ils auraient accepté l’irréparable éboulement des bibliothèques, des cathédrales, des laboratoires d’Europe. Ils auraient accepté de ruiner ses traditions, ils auraient accepté de changer le monde en nuage de cendres. Et c’est pourquoi nous avons oscillé d’une opinion à l’autre. Quand la Paix nous semblait menacée, nous découvrions la honte de la guerre. Quand la guerre nous semblait épargnée, nous ressentions la honte de la Paix.
Il ne faut pas nous laisser aller à ce dégoût de nous-mêmes : aucune décision ne nous l’eût épargné. Il faut nous ressaisir et chercher le sens de ce dégoût. Quand l’homme se heurte à une contradiction si profonde, c’est qu’il a mal posé le problème. Lorsque le physicien découvre que la terre entraîne, dans son mouvement, l’éther où la lumière se meut, et quand, dans le même temps, il découvre que cet éther est immobile, il ne renonce pas à la science, il change de langage et renonce à l’éther.
Pour découvrir où loge ce malaise, il faut sans doute dominer les événements. Il faut, pour quelques heures, oublier les Sudètes. Nous sommes aveugles, si nous regardons de trop près. Il nous faut réfléchir un peu sur la guerre, puisque, à la fois, nous la refusons et l’acceptons.
* * *
Je sais quels reproches on m’adressera. Les lecteurs d’un journal réclament des reportages concrets, non des réflexions. Les réflexions sont bonnes pour les revues ou pour les livres. Mais j’ai, là-dessus, une autre opinion.
J’ai toujours dans les yeux l’image de ma première nuit de vol en Argentine. Une nuit d’encre. Mais, dans ce néant, vaguement lumineuses comme des étoiles, les lumières des hommes dans la plaine.
Chaque étoile signifiait qu’en pleine nuit, là en bas, on réfléchissait, on lisait, on poursuivait des confidences. Chaque étoile, comme un fanal, signalait la présence d’une conscience humaine. Dans celle-là peut-être on méditait sur le bonheur des hommes, sur la justice, sur la paix. Perdue dans ce troupeau d’étoiles, c’était l’étoile du berger. Là peut-être on entrait en communication avec les astres, on s’usait en calculs sur la nébuleuse d’Andromède. Ailleurs, on aimait. Partout brûlaient ces feux dans la campagne, qui réclamaient leur nourriture, jusqu’aux plus humbles. Celui du poète, de l’instituteur, du charpentier. Mais, parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d’étoiles éteintes, combien d’hommes endormis, combien de feux qui ne donnaient plus leur lumière, faute d’avoir été alimentés.
Que le journaliste se trompe dans ses réflexions, peu importe, nul n’est infaillible. Qu’il ne pénètre pas toutes ces demeures, peu importe, ce sont les demeures où l’on veille qui font le sens d’un territoire. Le journaliste ignore quels sont ceux qui communieront avec lui, mais peu importe, il espère quand il jette des sarments au vent entretenir quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne.
Elles furent pesantes, les journées que nous avons vécues devant les haut-parleurs. C’était comme une attente d’embauches au portail de fer d’une usine. Les hommes, massés pour écouter parler Hitler, se voyaient déjà entassés dans les wagons de marchandises, puis répartis derrière des outils d’acier, au service de l’usine qu’est devenue la guerre. Déjà comme enrôlés dans la gigantesque corvée, le chercheur renonçait aux calculs qui le faisaient communiquer avec l’univers, le père renonçait aux soupes du soir qui embaument la maison et le cœur, le jardinier, qui avait vécu pour une rose nouvelle, acceptait de ne point en embellir la terre. Tous nous étions déjà déracinés, confondus et jetés en vrac sous la meule.
Non par esprit de sacrifice, mais par abandon à l’absurde. Noyés dans les contradictions que nous ne savons plus résoudre, découragés par l’incohérence d’événements que nul langage n’éclaire plus, nous admettions obscurément le drame sanglant qui nous eût imposé, enfin, des devoirs simples.
Nous connaissions pourtant que toute guerre, depuis qu’elle se traite avec la torpille et l’ypérite, ne saurait aboutir qu’à l’écroulement de l’Europe. Mais nous sommes peu sensibles, bien moins qu’on l’imagine, à la description d’un cataclysme. Nous assistons chaque semaine, du fond de nos fauteuils de cinéma, aux bombardements d’Espagne ou de Chine. Sans en être ébranlés nous-mêmes, nous pouvons entendre les coups qui frappent les villes dans leurs profondeurs. Nous admirons les torsades de suie et de cendres que ces terres à volcans débitent lentement vers le ciel. Et cependant ! C’est le grain des greniers, ce sont les trésors familiaux, c’est l’héritage des générations, c’est la chair des enfants brûlés qui, dilapidés en fumées, engraissent lentement ce cumulus noir.
Je les ai parcourues à Madrid les rues de l’Arguelez, dont les fenêtres, semblables à des yeux crevés, n’enfermaient plus que du ciel blanc. Les murs seuls avaient résisté et, derrière ces façades fantômes, le contenu des six étages s’était réduit à cinq ou six mètres de gravats. Du faîte à la base, les planchers de chêne massif sur l’assise desquels des générations avaient vécu leur longue histoire familiale, où la servante, à l’instant même du tonnerre, tirait, peut-être, les draps blancs pour servir le repos du soir et l’amour, où des mères, peut-être, posaient des mains fraîches sur des fronts brûlants d’enfants malades, où le père méditait l’invention de demain, ces assises que chacun eût pu croire éternelles, d’un seul coup, dans la nuit, avaient basculé comme des bennes, et versé leur charge à la fondrière.
Mais l’horreur ne passe point la rampe, et sous nos yeux, dans l’indifférence des spectateurs, les torpilles d’avion coulent sans bruit, à la verticale, comme des sondes, vers ces demeures vivantes qu’elles videront de leurs entrailles.
Je ne veux pas m’en indigner, il nous manque ici la clef d’un langage. Nous sommes les mêmes hommes qui accepterions de risquer la mort pour un seul mineur enseveli ou pour un seul enfant désespéré. L’horreur ne prouve rien. Je ne crois guère à l’efficacité de ces réactions animales. Le chirurgien visite l’hôpital et ne connaît pas ce serrement de cœur que le spectacle de la souffrance déclenche chez les filles. Sa pitié, autrement haute, passe au-dessus de cet ulcère qu’il va guérir. Il palpe et n’écoute pas les plaintes.
Ainsi à l’heure de l’accouchement, quand les gémissements s’éveillent, une grande ferveur secoue la maison. Ce sont des pas précipités dans le vestibule, des préparatifs, des appels, et personne ne s’épouvante de ces cris que la jeune mère, elle-même, oubliera, qui s’enkysteront dans la mémoire, qui ne comptent pas. Et cependant celle-là se tord et saigne. Et des bras noueux la maintiennent, des bras de bourreaux, qui aident à l’expulsion du fruit, qui arrachent la chair de sa chair. Mais l’on s’affaire ; mais l’on sourit. Mais l’on chuchote : « Tout se passe bien. » On prépare un berceau ; on prépare un bain tiède ; on court brusquement vers la porte ; on la fait éclater toute grande, et l’on crie : « Le ciel soit béni, c’est un fils ! »
Si nous ne disposons que des descriptions de l’horreur, nous n’aurons point raison contre la guerre, mais nous n’aurons point non plus raison si nous nous contentons d’exalter la douceur de vivre et la cruauté des deuils inutiles. Voilà quelques milliers d’années que l’on parle des larmes des mères. Il faut bien admettre que ce langage n’empêche point les fils de mourir.
Ce n’est point dans les raisonnements que nous trouverons le sauvetage. Plus ou moins nombreuses, les morts... À partir de quel nombre sont-elles acceptables ? Nous ne fonderons pas la paix sur cette misérable arithmétique. Nous dirons : « Sacrifice nécessaire... Grandeur et tragique de la guerre... » Ou, plutôt, nous ne dirons rien. Nous ne possédons point de langage qui permette de nous débrouiller sans raisonnements compliqués, entre ces différentes morts. Et notre instinct, et notre expérience nous font nous défier des raisonnements : on démontre tout. Une vérité, ce n’est point ce qui se démontre : c’est ce qui simplifie le monde.
Notre tourment est un tourment vieux comme l’espèce humaine. II a présidé aux progrès de l’homme. Une Société évolue et l’on cherche encore à saisir, par l’instrument d’un langage périmé, les réalités présentes. Valable ou non, on est prisonnier d’un langage et des images qu’il charrie. C’est le langage insuffisant qui se fait, peu à peu, contradictoire : ce ne sont jamais les réalités. Quand l’homme forge un concept nouveau, alors seulement il se délivre. L’opération qui fait progresser n’est point celle qui consiste à imaginer un monde futur : comment saurons-nous tenir compte des contradictions inattendues qui naîtront demain de nos prémices, et, imposant la nécessité de synthèses nouvelles, changeront la marche de l’histoire ? Le monde futur échappe à l’analyse. L’homme progresse en forgeant un langage pour penser le monde de son temps. Newton n’a point préparé la découverte des rayons X en prévoyant les rayons X. Newton a créé, pour décrire les phénomènes connus de lui, un langage simple. Et les rayons X, de création en création, en sont issus. Toute autre démarche est utopie.
Ne cherchez point quelles mesures sauvèrent l’homme de la guerre. Dites-vous : « Pourquoi faisons-nous la guerre puisqu’en même temps nous connaissons qu’elle est absurde et monstrueuse. Où loge la contradiction ? Où loge la vérité de la guerre, une vérité si impérieuse qu’elle domine l’horreur et la mort ? » Si nous y parvenons, alors seulement nous ne nous abandonnerons plus, comme à plus fort que nous, à la fatalité aveugle. Alors, seulement, nous serons sauvés de la guerre.
Certes, vous pouvez me répondre que le risque de guerre réside dans la folie de l’homme. Mais vous renoncez, du même coup, à votre pouvoir de comprendre. Vous pourriez affirmer de même : la terre tourne autour du soleil parce que telle fut la volonté de Dieu. Peut-être. Mais par quelles équations cette volonté se traduit-elle ? En quel langage clair pouvons-nous traduire cette folie, et ainsi nous en délivrer ?
Il me semble aussi que les instincts sauvages, la rapacité ou le goût du sang demeurent des clefs insuffisantes. C’est négliger ce qui est peut-être l’essentiel. C’est oublier tout l’ascétisme qui entoure les valeurs de guerre. C’est oublier le sacrifice de la vie. C’est oublier la discipline. C’est oublier la fraternité dans le danger. C’est oublier, en fin de compte, tout ce qui nous frappe chez les hommes de guerre, chez tous les hommes de guerre qui ont accepté les privations et la mort.
L’année dernière, je visitais le front de Madrid et il me semblait que le contact avec les réalités de la guerre était plus fertile que les livres. Il me semblait que, de l’homme de guerre seul, il était possible de tirer des enseignements sur la guerre.
Mais, pour le rencontrer dans ce qu’il a d’universel, il faut oublier qu’il est des camps et ne point discuter les idéologies. Les langages charrient des contradictions tellement inextricables qu’elles font désespérer du salut de l’homme. Franco bombarde Barcelone parce que Barcelone, dit-il, a massacré des religieux. Franco protège donc les valeurs chrétiennes. Mais le chrétien assiste, au nom de ces valeurs chrétiennes, dans Barcelone bombardée, à des bûchers de femmes et d’enfants. Et il ne comprend plus. Ce sont, me direz-vous, les tristes nécessités de la guerre... La guerre est absurde. Il faut cependant choisir un camp. Mais il me semble que d’abord est absurde un langage qui oblige les hommes à se contredire.
N’objectez point non plus l’évidence de vos vérités, vous avez raison. Vous avez tous raison. Il a raison celui-là même qui rejette les malheurs du monde sur les bossus. Si nous déclarons la guerre aux bossus, si nous lançons l’image d’une race des bossus, nous apprendrons vite à nous exalter. Toutes les vilenies, tous les crimes, toutes les prévarications des bossus, nous les porterons à leur débit. Et ce sera justice. Et, quand nous noierons dans son sang un pauvre bossu innocent, nous hausserons tristement les épaules : « Ce sont là les horreurs de la guerre... Il paie pour les autres... Il paie pour les crimes des bossus... » Car, certes, les bossus aussi commettent des crimes.
Oubliez donc ces divisions qui, une fois admises, entraînent tout un Coran de vérités inébranlables et le fanatisme qui en découle. On peut ranger les hommes en hommes de droite et en hommes de gauche, en bossus et en non-bossus, en fascistes on en démocrates, et ces distinctions sont inattaquables ; mais la vérité, vous le savez, c’est ce qui simplifie le monde, et non ce qui crée le chaos.
Si nous demandions à l’homme de guerre, quel qu’il soit, non en l’écoutant se justifier dans Son langage insuffisant, mais en le regardant vivre, le sens de ses aspirations profondes ?
DANS LA NUIT, LES VOIX ENNEMIES D'UNE TRANCHÉE À L’AUTRE S’APPELLENT ET SE RÉPONDENT
Au fond de l’abri souterrain, les hommes, un lieutenant, un sergent, trois soldats, se harnachent en vue d’une patrouille. L’un d’eux, qui endosse un tricot de laine – il fait très froid, – m’apparaît dans l’ombre, la tête enfouie encore, les bras mal engagés, remuant lentement avec une lourdeur d’ours. Jurons étouffés, barbes de trois heures du matin, explosions lointaines... Tout cela compose un étrange mélange de sommeil, de réveil et de mort. Lente préparation de chemineaux qui vont reprendre le lourd bâton et le voyage. Pris dans la terre, peints par la terre, montrant des mains de jardiniers, ces hommes-là ne sont point pétris pour le plaisir. Les femmes s’en détourneraient. Mais, lentement, ils se dégagent de leur boue et vont émerger aux étoiles. La pensée s’éveille sous la terre, dans ces blocs de glaise durcie, et je songe que là-bas, en face, à la même heure, d’autres hommes se harnachent ainsi et s’épaississent des mêmes tricots de laine, imbibés de la même terre, émergeant de la même terre dont ils sont faits. Là-bas, en face, la même terre s’éveille aussi à la conscience, à travers l’homme.
Ainsi, en face de toi, se dresse lentement, lieutenant, pour mourir de ta main, ta propre image. Ayant tout renoncé, pour servir comme toi, sa foi. Sa foi qui est la tienne. Qui accepterait de mourir sinon pour la vérité, la justice et l’amour des hommes ?
« On les trompait, ou bien l’on trompait ceux d’en face », me direz-vous. Mais je me moque bien ici des politiciens, des profiteurs et des théoriciens en chambre de l’un ou l’autre des deux camps. Ils tirent les ficelles, lâchent les grands mots et croient qu’ils conduisent les hommes. Ils croient à la naïveté des hommes. Mais si les grands mots prennent comme des semences livrées au vent, c’est qu’il se trouvait, au large des vents, des terres épaisses, pétries pour le poids des moissons. Qu’importe le cynique qui s’imagine jeter du sable en nourriture : ce sont les terres qui savent reconnaître le blé.
La patrouille est formée, et nous avançons à travers champs. Une herbe rase craque sous nos pas, et nous butons, de temps à autre, dans la nuit, contre, des pierres. J’accompagne jusqu’à la lisière de ce monde ceux qui ont reçu pour mission de descendre au fond de l’étroite vallée qui nous sépare ici de l’adversaire. Elle est large de huit cents mètres. Pris sous le feu des deux artilleries, à la verticale, les paysans l’ont évacuée. Elle est vide, noyée sous les eaux de la guerre, un village y dort englouti. Il n’est plus habité que par des fantômes, car les chiens seuls y sont restés, qui, sans doute, chassent, le jour, des viandes pitoyables, et, la nuit, faméliques, s’épouvantent. C’est, vers quatre heures du matin, un village entier qui hurle à la mort vers la lune qui monte, blanche comme un os. « Vous descendrez, a ordonné le commandant, pour connaître si l’ennemi s’y dissimule. » Sans doute, chez l’adversaire, la même question s’est-elle posée, et la même patrouille est-elle en marche.
Il nous accompagne, ce commissaire dont j’ai oublié le nom, mais dont je n’oublierai jamais le visage : « Tu les entendras, me dit-il. Quand nous serons en première ligne, nous interrogerons l’ennemi qui occupe l’autre versant de la vallée... Parfois il parle... »
Je le revois, un peu rhumatisant, pesant sur son bâton noueux, cet homme au masque de vieil ouvrier consciencieux. Celui-là, je le jure, s’est haussé au-dessus de la politique et des partis. Celui-là s’est haussé au-dessus des rivalités confessionnelles. « Il est dommage que, dans les circonstances présentes, nous ne puissions point exposer notre point de vue à l’adversaire... »
Et il va, lourd de sa doctrine, comme un évangéliste. Et, en face, je le sais, vous le savez bien, il y a l’autre évangéliste, quelque croyant, éclairé aussi par sa doctrine, et qui dépêtre ses grosses bottes de la même boue, marchant aussi vers ce rendez-vous qu’il ignore.
Nous voici donc en route vers cette lèvre de terre qui domine la vallée, vers le promontoire le plus avancé, vers la dernière terrasse, vers ce cri d’interrogation que nous jetterons à l’ennemi, comme l’on s’interroge soi-même.
Une nuit bâtie comme une cathédrale, et quel silence ! Pas un coup de fusil ! Une trêve ? Oh ! non. Mais quelque chose qui ressemble au sentiment d’une présence. Chez les deux adversaires, c’est la même voix que l’on écoute. Fraternisation ? Non, bien sûr, s’il s’agit par là. de cette lassitude qui, un jour, désagrège les hommes et les incline à se partager des cigarettes, et à se confondre dans le sentiment d’une même déchéance. Essayez donc de faire un pas vers l’ennemi... Fraternisation peut-être, mais à une telle altitude qu’elle n’engage de l’esprit qu’une part encore inexprimable, et ici, en bas, ne nous sauve point du carnage. Puisque, ce qui nous unit, nous n’avons pas encore de langage pour nous le dire.
Ce commissaire qui nous accompagne, je crois bien le comprendre. D’où vient-il avec ce visage qui regarde droit, qui a d’abord longtemps maintenu sa charrue dans l’axe ? Il a regardé, avec les paysans d’où il sort, vivre la terre. Puis il est parti pour l’usine et il a regardé vivre les hommes. « Métallurgiste... j’ai été vingt ans métallurgiste... » Jamais encore je n’ai entendu de confidences plus hautes que les confidences de cet homme-là. « Moi... un homme rude... j’ai eu tellement de mal à me former... Les outils... vois-tu, j’en connaissais bien le maniement, je savais en parler, je sentais juste... Mais quand je voulais m’exposer les choses, les idées, la vie, les exposer aux autres... Vous qui êtes habitués à abstraire... Vous que l’on a entraînés tout petits à évoluer dans les contradictions verbales, vous n’imaginez pas combien c’est dur, cela : abstraire ! Mais j’ai travaillé, travaillé... Je sens mon ankylose peu à peu qui s’en va... Oh ! ne crois pas que je ne sache point me juger... Je suis encore un rustre, je n’ai même pas encore appris la courtoisie, et la courtoisie, vois-tu, ça juge l’homme... »
Je revoyais, en l’écoutant, cette école du front installée à l’abri de quelques pierres, comme un village primitif. Un caporal y enseignait la botanique. Démontant de ses mains les pétales d’un coquelicot, il mêlait ses disciples barbus aux doux mystères naturels. Mais les soldats montraient une angoisse naïve : ils faisaient tant d’efforts pour comprendre, si vieux déjà, si durcis par la vie ! On leur avait dit : « Vous êtes des brutes, vous sortez à peine de vos tanières, il faut rattraper l’humanité... » Et ils se hâtaient, de leurs gros pas lourds, pour la rejoindre.
Ainsi j’avais assisté à cette ascension de la conscience semblable à une montée de sève et qui, née de la glaise, dans la nuit de la préhistoire, s’était peu à peu élevée jusqu’à Descartes, Bach ou Pascal, ces hautes cimes. Qu’il était pathétique, raconté par ce commissaire, cet effort pour abstraire. Ce besoin de grandir. Ainsi un arbre monte. Et c’est bien là le mystère de la vie. Seule la vie tire ses matériaux du sol, et, contre la pesanteur, les élève.
Quel souvenir ! cette nuit de cathédrale... L’âme de l’homme qui se montre avec ses ogives et ses flèches... L’ennemi que l’on se prépare à interroger. Et nous-mêmes, caravane de pèlerins, qui cheminons sur une terre craquante et noire, ensemencée d’étoiles.
Nous sommes, sans le savoir, à la recherche d’un évangile qui surmonte nos évangiles provisoires. Ils font trop couler le sang des hommes. Nous sommes en marche vers un Sinaï orageux.
Nous y sommes, nous avons buté sur une sentinelle engourdie, qui somnole à l’abri d’un petit mur de pierre :
« Oui, ici, des fois, ils répondent... D’autres fois, c’est eux qui appellent... D’autres fois ils ne répondent pas. Ça dépend comment ils se trouvent lunés... »
... Ainsi sont les dieux.
Les tranchées de première ligne serpentent à cent mètres en arrière de nous. Ces murs bas, qui protègent l’homme, jusqu’à la poitrine, sont des postes de veille, abandonnés pendant le jour, et qui surplombent directement l’abîme. Il nous semble ainsi être accoudés, comme à un parapet ou à une rambarde, devant le vide et l’inconnu. Je viens d’allumer une cigarette et aussitôt des mains puissantes me font plonger. Tous, autour de moi, plongent ainsi. À l’instant même, j’entends siffler cinq ou six balles, qui passent d’ailleurs trop haut, et ne sont suivies d’aucune autre salve. Ce n’est qu’un rappel à la correction : on n’allume pas sa cigarette face à l’ennemi.
Trois ou quatre hommes emmitouflés de couvertures, qui veillaient dans les environs, à l’abri de fortins semblables, nous ont rejoints :
« Sont bien réveillés ceux d’en face...
– Oui, mais, parlent-ils ? On voudrait entendre...
– Il y a l’un d’eux... Antonio... Quelquefois il parle.
– Fais-le parler... »
L’homme redresse et gonfle sa poitrine, puis, les mains jointes en porte-voix, lance avec puissance et lenteur :
« An...to...nio...o ! »
Le cri s’enfle, se déroule, se répercute dans la vallée...
« Penche-toi, me dit mon voisin, quelquefois, quand on les appelle, ça les fait tirer... »
Nous nous sommes abrités, l’épaule collée à la pierre, et nous écoutons. Point de coups de fusil. Quant à une réponse... Nous ne pourrions jurer que nous n’entendons rien, la nuit tout entière chante, comme un coquillage.
« Eh ! Antonio...o !... Est-ce que tu... »
Et il reprend son souffle, le grand gaillard qui s’époumone !
« Est-ce que tu... dors ?... »
Tu dors... répète l’écho de l’autre rive... Tu dors... répète la vallée,.. Tu dors, répète la nuit tout entière. Ça remplit tout. Et nous restons debout avec une confiance extraordinaire ils n’ont pas tiré ! Et je les imagine là-bas qui écoutent, qui entendent, qui reçoivent cette voix humaine. Et cette voix ne les révolte pas, puisqu’ils ne pressent pas sur les gâchettes. Certes, ils se taisent, mais quelle attention, quelle audience exprime ce silence, puisqu’une simple allumette déclenche le tir. Je ne sais quelles semences invisibles tombent au large des terres noires, portées par notre voix. Ils ont soif de notre parole comme nous avons soif de la leur. Mais nous ignorons tout de notre soif, sinon qu’elle s’exprime, évidente, dans cette audience même. Cependant ils gardent le doigt sur la gâchette, et je revois ces petits fauves que nous tentions d’apprivoiser dans le désert. Ils nous regardaient. Ils nous écoutaient. Ils attendaient de recevoir de nous leur nourriture. Et cependant, au moindre geste, ils nous eussent sauté à la gorge.
Nous nous abritons bien et, les mains dressées au-dessus du mur, nous faisons craquer une allumette. Trois balles cinglent vers la brève étoile.
Ah ! cette allumette aimantée... Et ça veut dire : « Nous sommes en guerre, ne l’oubliez pas ! Mais nous vous écoutons. Cette rigueur ne gêne pas l’amour... »
Quelqu’un pousse le grand gaillard.
« Tu ne sais pas le faire parler, laisse-moi lui dire... »
Le paysan massif pose son fusil contre la pierre, prend son souffle et lâche :
« C’est moi, Léon... Antonio...o ! »
Et ça s’en va, démesuré.
Je n’ai encore jamais entendu la voix prendre ainsi le large. Dans l’abîme noir qui nous sépare, c’est comme un lancer de navire. Huit cents mètres d’ici l’autre rive, autant pour le retour : seize cents. S’ils nous répondent, il s’écoulera près de cinq secondes entre nos questions et les réponses. Il s’écoulera chaque fois cinq secondes d’un silence où toute vie sera suspendue. Ce sera chaque fois comme une ambassade en voyage. Ainsi, même s’ils nous répondent, nous n’éprouverons pas le sentiment d’être joints les uns aux autres. Il s'interposera, entre eux et nous, l’inertie d’un monde invisible à mettre en branle. La voix est lâchée, transportée, elle aborde l’autre rivage... Une seconde... Deux secondes... Nous sommes semblables à des naufragés qui ont lancé leur bouteille à la mer... Trois secondes... Quatre secondes... Nous sommes semblables à des naufragés qui ignorent si des sauveteurs vont répondre... Cinq secondes...
« … Oh ! »
Une voix lointaine est venue mourir sur notre rivage. La phrase s’est perdue en route, il n’en subsiste qu’un indéchiffrable message. Mais je l’ai reçu comme un coup. Nous sommes perdus dans une obscurité d’abord impénétrable, mais éclairée soudain par un « ohé » de bateliers.
Une stupide ferveur nous secoue. Nous découvrons une évidence. Devant nous, il y a des hommes !
Comment m’expliquerais-je ? Il me semble qu’invisible une fissure vient de s’ouvrir. Imaginez une maison la nuit, toutes portes closes. Et voici que, dans l’obscurité, vous êtes frôlé par un souffle d’air froid. Un seul. Quelle présence !
Vous êtes-vous penché sur un abîme ? Je me souviens de la faille de Chézery, une fente noire perdue dans les bois, large d’un mètre ou deux, sur trente mètres de longueur. Peu de chose. On se couche à plat ventre sur les aiguilles de sapin, et, de la main, dans cette fissure sans relief on laisse couler une pierre. Rien ne répond. Il s’écoule une seconde, deux secondes, trois secondes, et après cette éternité on perçoit enfin un grondement faible, d’autant plus. bouleversant qu’il est plus tardif, qu’il est plus faible, là, sous le ventre. Quel abîme ! Ainsi, cette nuit-là, un écho retardé vient de bâtir un monde. L’ennemi, nous, la vie, la mort, la guerre, nous sommes exprimés par quelques secondes de silence.
De nouveau, une fois déclenché ce signal, une fois mis en branle ce navire, une fois dépêchée à travers le désert cette caravane, nous attendons. Et sans doute, en face comme ici, on se prépare à la recevoir, cette voix qui porte comme une balle au cœur. Et voici l’écho de retour :
« ... heure.... heure de dormir ! »
Elle nous parvient mutilée, déchirée comme un message de toute urgence, mais salé, mais lavé, mais usé par la mer. Quel conseil maternel ceux-là mêmes, qui tirent au vol nos cigarettes, ont lancé de toutes leurs poitrines :
« Taisez-vous... Couchez-vous... il est l’heure de dormir. »
Un frémissement léger nous agite. Et sans doute croirez-vous à un jeu. Et sans doute croyaient-ils à un jeu, ces hommes simples. C’est ce qu’ils vous eussent expliqué, dans leur pudeur. Mais le jeu toujours couvre un sens profond, sinon d’où proviendraient l’angoisse et le plaisir et le pouvoir du jeu ? Le jeu que peut-être nous pensions jouer répondait trop bien à cette nuit de cathédrale, à cette marche vers le Sinaï, et nous faisait trop fort battre le cœur pour ne point répondre à quelque besoin informulé. Elle nous exaltait, cette communication enfin rétablie. Ainsi frémit le physicien lorsque l’expérience cruciale est en marche et qu’il va peser la molécule. Il va noter une constante parmi cent mille, il semble qu’il n’ajoute qu’un grain de sable à l’édifice de la science, et cependant le cœur lui bat, car il ne s’agit point d’un grain de sable. Il tient un fil. Il tient le fil par quoi l’on ramène, en tirant, la connaissance de l’univers, car tout est lié. Ainsi frémissent les sauveteurs quand ils ont lancé leur filin, une fois, vingt fois... et qu’ils apprennent, par une saccade presque imperceptible, que les naufragés l’ont enfin saisi. Il y avait là-bas un petit groupe d’hommes, perdus dans la brume, les récifs, et coupés du monde. Et les voici, par la magie d’un fil d’acier, liés à tous les hommes et toutes les femmes de tous les ports. Ici nous avons jeté dans la nuit, vers l’inconnu, une passerelle légère, et voici qu’elle relie l’une à l’autre les deux rives du monde. Voici que nous épousons notre ennemi avant d’en mourir.
Mais si légère, si fragile, que pouvons-nous lui confier ? Une question, une réponse trop lourdes, et notre passerelle chavire. L’urgence exige de ne transmettre que l’essentiel, que la vérité des vérités. Je crois l’entendre, celui qui a pris en main la manœuvre et qui nous groupe sous sa responsabilité, comme l’homme de barre ; celui qui devient notre ambassadeur d’avoir su faire parler Antonio. Je le vois qui, se haussant de tout son buste au-dessus du mur, les mains pesant, grandes ouvertes, sur les pierres, lance, à toute volée, la question fondamentale :
« Antonio ! Pour quel idéal te bas-tu ? »
N’en doutez pas, ils s’excuseraient encore, dans leur pudeur :
« Nous faisons là de l’ironie... » Ils le croiront plus tard s’ils s’emploient à traduire, dans leur pauvre langage, des mouvements qu’il n’est point de langage pour traduire. Les mouvements d’un homme qui est en nous, et sur le point de s’éveiller... Mais il faut qu’un effort le délivre.
Ce soldat qui attend le choc en retour, je prétends, j’ai vu son regard, qu’il s’ouvre à la réponse de toute son âme, comme l’on s’ouvre à l’eau du puits dans le désert. Et le voilà, ce message tronqué, cette confidence rongée par cinq secondes de voyage comme une inscription par les siècles :
« ... Espagne ! »
Puis j’entends
« ... toi. »
Je suppose qu’il interroge à son tour celui de là-bas.
On lui répond. J’entends jeter cette grande réponse :
« ... Le pain de nos frères ! »
Puis l’étonnant :
« ... Bonne nuit, amigo ! »
Auquel répond, de l’autre côté de la terre :
« ... Bonne nuit, amigo ! »
Et tout rentre dans le silence. Sans doute, en face, n’ont-ils saisi, comme nous, que des mots épars. La conversation échangée, le fruit d’une heure de marche, de dangers et d’efforts, le voici... Il n’en manque rien. Le voici, tel qu’il a été balancé par les échos sous les étoiles : « » Idéal... Espagne... Pain de nos frères... »
Alors, l’heure étant venue, la patrouille s’est remise en marche. Elle a commencé cette plongée vers le village du rendez-vous. Car, en face, la même patrouille, gouvernée par les mêmes nécessités, s’enfonce vers le même abîme. Sous l’apparence de mots divers, ces deux équipes ont crié les mêmes vérités... Mais une si haute communion n’exclut pas de mourir ensemble.
IL FAUT DONNER UN SENS À LA VIE DES HOMMES
Tous, sous les mots contradictoires, nous exprimons les mêmes élans. Dignité des hommes, pain de nos frères. Nous nous divisons sur des méthodes qui sont des fruits de nos raisonnements, non sur les buts. Et nous partons en guerre les uns contre les autres dans la direction des mêmes terres promises.
Il suffit, pour le reconnaître, de nous regarder d’un peu loin. Alors on nous découvre en guerre contre nous-mêmes. Alors, nos divisions, nos luttes, nos injures sont celles d’un même corps qui se contracte contre soi-même et se déchire dans le sang de l’enfantement. Quelque chose naîtra, qui surmontera ces images diverses, mais hâtons-nous de forger la synthèse. Il faut aider la délivrance, de peur qu’elle n’entraîne la mort. N’oubliez pas qu’aujourd’hui la guerre se traite avec la torpille et l’ypérite. Le soin de la guerre n’est plus confié à une délégation de la nation, qui cueille des lauriers sur les frontières, et, à un prix plus ou moins onéreux, enrichit, je veux bien l’admettre, le patrimoine spirituel d’un peuple. La guerre n’est plus aujourd’hui qu’une chirurgie d’insecte qui porte ses piqûres sur les ganglions de l’adversaire. Dès la déclaration d’une guerre, sauteront nos gares, nos ponts, nos usines. Nos villes asphyxiées répandront leur population dans les campagnes. Et, dès la première heure, l’Europe, un organisme de deux cent millions d’hommes, aura perdu son système nerveux, comme brûlé par un acide, ses centres de contrôle, ses glandes régulatrices, ses canaux chilifères, ne constituera plus qu’un énorme cancer et commencera, sur place, de pourrir. Comment nourrirez-vous ces deux cent millions d’hommes ? Ils ne déterreront jamais assez de racines.
Quand la contradiction se fait si urgente, il faut se hâter de la surmonter. Car rien ne l’emporte sur un besoin qui cherche son expression. S’il trouve, faute de mieux, cette expression dans l’idéologie qui conduit à la guerre, n’en doutons point, nous ferons la guerre. Nous pouvons répondre mieux que par la guerre aux besoins qui tourmentent l’homme, mais il est stérile de les nier. Vous pouvez crier vos raisons de haïr la guerre à cet officier du sud marocain que j’ai connu, mais dont je n’ose dire le nom, de peur de le gêner. S’il n’est pas convaincu, ne le traitez point de barbare. Écoutez d’abord ce souvenir.
Il commandait, lors de la guerre du Rif, un petit poste planté en coin entre deux montagnes dissidentes. Il recevait, un soir, des parlementaires descendus du massif de l’ouest. Et l’on buvait du thé, comme il se doit, quand la fusillade éclata, Les tribus du massif de l’Est chargeaient le poste. Au capitaine qui les expulsait pour combattre, les parlementaires ennemis répondirent : « Nous sommes tes hôtes aujourd’hui, Dieu ne permet pas que l’on t’abandonne... » Ils se joignirent donc à ses hommes, sauvèrent le poste et rentrèrent dans leur dissidence.
Mais la veille du jour où, à leur tour, ils se préparent à attaquer le capitaine, les voilà qui reviennent :
« L’autre soir, nous t’avons aidé...
– C’est vrai.
– Nous avons brûlé pour toi trois cents cartouches...
– C’est vrai.
– Il serait juste de nous les rendre. »
Et le capitaine, grand seigneur, ne peut exploiter un avantage qu’il tirerait de leur noblesse. Il leur rend ces cartouches dont il va peut-être mourir...
La vérité, pour l’homme, c’est ce qui fait de lui un homme. Quand celui-là, qui ‘a connu cette altitude des relations, cette loyauté dans le jeu, ce don mutuel d’une estime qui- engage la vie, compare cette expansion, qui lui fut permise, à la médiocre qualité du démagogue qui eût exprimé sa fraternité aux mêmes Arabes par des grandes claques sur les épaules, qui eût flatté, peut-être, l’individu, mais humilié l’homme à travers lui, celui-là n’éprouvera à votre égard, si vous le blâmez, qu’une pitié un peu méprisante. Et il aura raison.
N’essayez pas d’expliquer à un Mermoz qui plonge vers le versant chilien des Andes, avec sa victoire dans le cœur, qu’il s’est trompé, qu’une lettre, de marchand peut-être, ne valait pas le risque de la vie. Mermoz rira de vous. La vérité c’est l’homme qui est né en lui, quand il passait les Andes.
Et si l’Allemand, aujourd’hui, est prêt à verset son sang pour Hitler, comprenez donc qu’il est inutile de discuter Hitler. C’est parce que l’Allemand trouve en Hitler l’occasion de s’enthousiasmer et d’offrir sa vie que, pour cet Allemand, tout est grand. Ne comprenez-vous point que la puissance d’un mouvement repose sur l’homme qu’il délivre ?
Ne comprenez-vous pas que le don de soi, le risque, la fidélité jusqu’à la mort, voilà des exercices qui ont largement contribué à fonder la noblesse de l’homme ? Quand vous cherchez un modèle à proposer, vous le découvrez chez le pilote qui se sacrifie pour son courrier, chez le médecin qui succombe sur le front des épidémies, ou chez le méhariste qui, à la tête de son peloton maure, s’enfonce vers le dénuement et la solitude. Quelques-uns meurent chaque année. Si même leur sacrifice est en apparence inutile, croyez-vous qu’ils n’ont point servi ? ils ont frappé dans la pâte vierge que nous sommes d’abord une belle image, ils ont ensemencé jusqu’à la conscience du petit enfant, bercé par des contes nés de leurs gestes. Rien ne se perd et le monastère clos de murs, lui-même, rayonne.
Ne comprenez-vous pas que, quelque part, nous avons fait fausse route ? La termitière humaine est plus riche qu’auparavant, nous disposons de plus de biens et de loisir, et, cependant, quelque chose d’essentiel nous manque que nous savons mal définir. Nous nous sentons moins hommes, nous avons perdu quelque part de mystérieuses prérogatives.
J’ai élevé des gazelles à Juby. Nous avons tous, là-bas, élevé des gazelles. Nous les enfermions dans une maison de treillage, en plein air, car il faut aux gazelles l’eau courante des vents, et rien autant qu’elles n’est fragile. Capturées jeunes, elles vivent cependant et broutent dans votre main. Elles se laissent caresser et plongent leur museau humide dans le creux de la paume. Et on les croit apprivoisées. On croit les avoir abritées du chagrin inconnu qui éteint sans bruit les gazelles, et leur fait la mort la plus tendre... Mais vient le jour où vous les retrouvez, pesant de leurs petites cornes contre l’enclos, dans la direction du désert. Elles sont aimantées. Elles ne savent pas qu’elles vous fuient ; le lait que vous leur apportez, elles viennent le boire, elles se laissent encore caresser, elles enfoncent plus tendrement encore le museau dans votre paume... Mais, à peine les lâchez-vous, vous découvrez qu’après un semblant de galop heureux elles sont ramenées contre le treillage. Et, si vous n’intervenez plus, elles demeurent là, n’essayant même pas de lutter contre la barrière, mais pesant simplement contre elle, la nuque basse, de leurs petites cornes, jusqu’à mourir. Est-ce la saison des amours, ou le simple besoin d’un grand galop à perdre haleine ? Elles l’ignorent. Leurs yeux ne s’étaient pas ouverts encore, quand vous les avez capturées. Elles ignorent tout de la liberté dans les sables, comme de l’odeur du mâle. Mais vous êtes bien plus intelligents qu’elles. Ce qu’elles cherchent, vous le savez, c’est l’étendue qui les accomplira. Elles veulent devenir gazelles et danser leur danse. À cent trente kilomètres à l’heure, elles veulent connaître la fuite rectiligne, coupée de brusques jaillissements, comme si, çà et là, des flammes s’échappaient du sable. Peu importent les chacals, si la vérité des gazelles est de goûter la peur qui les contraint seule à se surpasser, et tire d’elles les plus hautes voltiges ! Qu’importe le lion si la vérité des gazelles est d’être ouvertes d’un coup de griffes dans le soleil. Vous les regardez et vous songez : les voilà prises de nostalgie... La nostalgie, c’est le désir d’on ne sait quoi. Il existe, l’objet du désir, mais il n’est point de mots pour le dire.
Et à nous, que nous manque-t-il ?
Quels sont donc les espaces que nous demandons que l’on nous ouvre ? Nous cherchons à nous délivrer des murs d’une prison qui s’épaissit autour de nous. On a cru que, pour nous grandir, il suffi. sait de nous vêtir, de nous nourrir, de répondre à tous nos besoins. Et l’on a peu à peu fondé en nous le petit bourgeois de Courteline, le politicien de village, le technicien fermé à toute vie intérieure. « On nous instruit, me répondrez-vous, on nous éclaire, on nous enrichit mieux qu’autrefois des conquêtes de notre raison. » Mais il se fait une piètre idée de la culture de l’esprit, celui qui croit qu’elle repose sur la connaissance de formules, sur la mémoire de résultats acquis. Le médiocre sorti le dernier de Polytechnique en sait plus long sur la nature et sur ses lois que Descartes, Pascal et Newton. Il demeure cependant incapable d’une seule des démarches de l’esprit dont furent capables Descartes, Pascal et Newton. Ceux-là on les a d’abord cultivés, Pascal, avant tout, c’est un style. Newton, avant tout, c’est un homme. Il s’est fait miroir de l’univers. La pomme mûre qui tombe dans un pré, les étoiles des nuits de juillet, il les a entendues qui parlaient le même langage. La science, pour lui, c’était la vie.
Et voici que nous découvrons avec surprise qu’il est des conditions mystérieuses qui nous fertilisent. Liés aux autres par un but commun, et qui se situe cri dehors de nous, alors seulement nous respirons. Nous, les fils de l’âge du confort, nous ressentons un inexplicable bien-être à partager nos derniers vivres dans le désert. À tous ceux d’entre nous qui ont connu la grande joie des dépannages sahariens, tout autre plaisir a paru futile.
Dès lors, ne vous étonnez pas. Celui qui ne soupçonnait point l’inconnu endormi en lui, mais l’a senti se réveiller, une fois, dans une cave d’anarchiste, à Barcelone, à cause du sacrifice de la vie, de l’entraide, d’une image rigide de la justice, celui-là ne connaîtra plus qu’une vérité : la vérité des anarchistes. Et celui qui aura une fois monté la garde pour protéger un peuple de petites nonnes agenouillées, épouvantées, dans les monastères d’Espagne, celui-là mourra pour l’église d’Espagne.
Nous voulons être délivrés. Celui qui donne un coup de pioche veut connaître un sens à son coup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard n’est point le même que le coup de pioche du prospecteur qui grandit celui qui le donne. Le bagne ne réside point là où des coups de pioche sont donnés. Il n’est point d’horreur matérielle. Le bagne réside là où des coups de pioche sont donnés, qui n’ont point de sens, qui ne relient pas celui qui les donne à la communauté des hommes.
Et nous voulons nous évader du bagne.
Il est deux cent millions d’hommes, en Europe, qui n’ont point de sens et voudraient naître. L’industrie les a arrachés au langage des lignées paysannes et les a enfermés dans ces ghettos énormes qui ressemblent à des gares de triage, encombrées de rames de wagons noirs. Du fond des cités ouvrières, ils voudraient être réveillés.