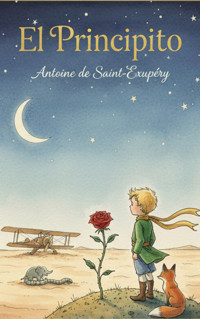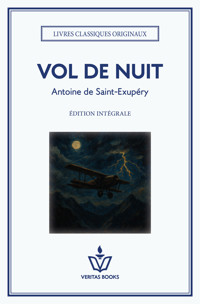0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Paperless
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Citadelle est une œuvre posthume d'Antoine de Saint-Exupéry, parue en 1948. Citadelle est un livre qui n'a jamais été achevé ni retouché (ou très peu) par Saint-Exupéry. L'œuvre est restée à l'état de brouillon dactylographié imparfait avant d'être mis en forme, tant bien que mal, par l'éditeur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 939
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Table des Matières
Note des éditeurs
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
LV
LVI
LVII
LVIII
LIX
LX
LXI
LXII
LXIII
LXIV
LXV
LXVI
LXVII
LXVIII
LXIX
LXX
LXXI
LXXII
LXXIII
LXXIV
LXXV
LXXVI
LXXVII
LXXVIII
LXXIX
LXXX
LXXXI
LXXXII
LXXXIII
LXXXIV
LXXXV
LXXXVI
LXXXVII
LXXXVIII
LXXXIX
XC
XCI
XCII
XCIII
XCIV
XCV
XCVI
XCVII
XCVIII
XCIX
CI
CII
CIII
CIV
CV
CVI
CVII
CVIII
CIX
CX
CXI
CXII
CXIII
CXIV
CXV
CXVI
CXVII
CXVIII
CXIX
CXX
CXXI
CXXII
CXXIII
CXXIV
CXXV
CXXVI
CXXVII
CXXVIII
CXXIX
CXXX
CXXXI
CXXXII
CXXXIII
CXXXIV
CXXXV
CXXXVI
CXXXVII
CXXXVIII
CXXXIX
CXL
CXLI
CXLII
CXLIII
CXLIV
CXLV
CXLVI
CXLVII
CXLVIII
CXLIX
CL
CLI
CLII
CLIII
CLIV
CLV
CLVI
CLVII
CLVIII
CLIX
CLX
CLXI
CLXII
CLXIII
CLXIV
CLXV
CLXVI
CLXVII
CLXVIII
CLXIX
CLXX
CLXXI
CLXXII
CLXXIII
CLXXIV
CLXXV
CLXXVI
CLXXVII
CLXXVIII
CLXXIX
CLXXX
CLXXXI
CLXXXII
CLXXXIII
CLXXXIV
CLXXXV
CLXXXVI
CLXXXVII
CLXXXVIII
CLXXXIX
CXC
CXCI
CXCII
CXCIII
CXCIV
CXCV
CXCVI
CXCVII
CXCVIII
CXCIX
CC
CCI
CCII
CCIII
CCIV
CCV
CCVI
CCVII
CCVIII
CCIX
CCX
CCXI
CCXII
CCXIII
CCXIV
CCXV
CCXVI
CCXVII
CCXVIIl
CCXIX
Note des éditeurs
Les premières pages de cette œuvre furent écrites en 1936. Elles commençaient ainsi : « J’étais seigneur berbère et je rentrais chez moi. Je venais d’assister à la tonte des laines des mille brebis de mon patrimoine. Elles ne portent point là-bas ces clochettes qui, du versant de leurs collines vers les étoiles, répandent leur bénédiction. Elles imitent seulement le bruit d’une eau courante, et nous qu’assiège la soif, cette musique seule nous rassure… » Le cadre de l’œuvre est demeuré le même si le ton n’a pas tout à fait la même distance.
Drieu la Rochelle et Crémieux, auxquels Saint-Exupéry lut les premières pages, se montrèrent réservés. Pour eux Saint-Exupéry était le poète de l’action, un écrivain viril dont le monde attendait de nouveaux récits d’aventures. La modestie de Saint-Exupéry le rendait susceptible aux critiques. Il revint fort déprimé de cette lecture, s’inquiétant de savoir s’il s’était égaré dans une voie qui ne lui convenait pas, lui que seule l’aventure intérieure intéressait.
Le souvenir de son existence dans le Sahara exaltait sa pensée et l’incitait à choisir le désert comme unité de lieu de sa méditation.
Si nous considérons l’œuvre de Saint-Exupéry dans son ensemble, nous sommes frappés de la persévérance du mouvement qui la conduit de la forme du roman de Courrier Sud jusqu’à la forme dépouillée de Citadelle. La préoccupation morale qui est celle de l’auteur envahit peu à peu ses écrits, chassant tous les effets littéraires. Les personnages cependant demeurent. Saint-Exupéry reconnaît la nécessité de la parabole mais — dans la mesure où ce terme reste lié au Nouveau Testament — une parabole directe, sans le double temps de l’image et de l’évocation.
Jamais désincarnée, sa conception éthique ne se cherche qu’à l’intérieur d’un « langage » déjà créé. Il ne met jamais en doute la nécessité de l’univers qui a formé tel type d’homme. L’homme responsable envers les autres en tant que membre de cet univers. Car s’il souhaite l’indépendance de l’esprit, il n’admet pas l’homme irresponsable à l’égard de sa communauté :
« … Car tu demandes à être bien planté, bien lourd de droits et de devoirs, et responsable, mais tu ne prends pas une charge d’homme dans la vie comme une charge de maçon dans un chantier, sur l’engagement d’un maître d’esclaves. Te voilà vide si tu te fais transfuge. »
Cherchant à établir les conditions d’une vie riche de ferveur, Saint-Exupéry explore les étapes essentielles qui lient l’individu à Dieu : la famille, la maison, le métier, la communauté des hommes, et leur transcendance par l’effort en une grandeur qui les dépasse. « L’homme veut donner un sens à son coup de pioche. » Mais que propose-t-il à l’homme pour charger de sens son coup de pioche ? Il n’offre qu’un mouvement de transcendance de l’homme vers Dieu au mépris de la possession et de la jouissance statiques. Dès Vol de Nuit, il a formulé sa pensée : échanger son corps périssable… Il la répète dans Citadelle : « Qu’y a-t-il, savetier, qui te rende si joyeux ? Mais je n’écoutai point la réponse sachant qu’il se tromperait et me parlerait de l’argent gagné ou du repas qui l’attendait ou du repos. Ne sachant point que son bonheur était de se transfigurer en babouches d’or. » Cette image de l’échange revient constamment : « Ainsi ont-ils travaillé toute leur vie pour un enrichissement sans usage, tout entiers échangés contre l’incorruptible broderie… »
Par cette seule conception, Saint-Exupéry désavoue tout système qui aurait le bien-être matériel comme seule fin.
Son humanisme avait permis aux hommes les plus opposés dans l’ordre politique et social de se réclamer de lui, dans leurs polémiques, ou de le citer à l’appui de leurs thèses.
Désormais, de telles approximations de la pensée ne seront plus possibles. Dans Citadelle, Saint-Exupéry reprend inlassablement ses thèmes, comme s’il craignait qu’un malentendu pût exister dans l’interprétation de ses croyances. Pour démontrer son enseignement, il le « recoupe » avec autant d’exemples qu’il en peut trouver. Si bien que, si l’on veut user d’une citation, on pourra, bien sûr, la sortir de son contexte et la brandir telle une épigraphe, mais Saint-Exupéry n’ayant laissé dans le vague aucune de ses convictions, ses citations ne pourront plus lui être empruntées pour appuyer quelque postulat politique ou moral, avec la même facilité.
L’œuvre posthume laissée par Saint-Exupéry est demeurée dans l’état qu’il appelait la « gangue ». A ceux qui l’interrogeaient sur la date de parution de cette œuvre, il répondait en riant : « Je n’aurai jamais fini… C’est mon œuvre posthume ! »
Lors de son départ pour tes États-Unis, en décembre 1940, Saint-Exupéry emportait des pages dactylographiées, d’autres manuscrites, représentant environ une quinzaine de chapitres de l’œuvre actuelle. Certains de ces chapitres corrigés avaient une forme presque définitive, notamment ceux sur « le Palais de mon Père », « la Suppliciée », « les Femmes », mais ils n’avaient pas la force didactique de ceux qui allaient suivre. Ils avaient été conçus à une époque de facilité, dans laquelle le désordre spirituel, moins apparent, ne lui faisait pas aussi violemment sentir la nécessité d’exprimer ses convictions morales.
La guerre, la défaite qu’il a vécue, cette division de ses compatriotes et les événements dont il est témoin aux États-Unis modifient le cours de ses réflexions et orientent son éthique vers une construction sociale.
Au début de 1941, Saint-Exupéry quitte New York pour la Californie afin de s’y faire soigner. Durant sa convalescence, il prend des notes et travaille à la structure de Citadelle.
De retour à New York, il écrit la première partie de Pilote de guerre, le récit de ses souvenirs d’une mission sur Arras, puis il s’arrête.
Dans une époque où l’esprit partisan accroît la confusion des idées, où la plupart réclament des slogans, des cris de guerre, Saint-Exupéry veut transmettre claires et intelligibles les convictions qui commandent ses actes et sa pensée.
Le « credo » qui compose la fin de Pilote de guerre marque le passage de son style antérieur à celui qui lui est désormais le plus naturel, celui de l’œuvre posthume.
L’incompréhension qu’il rencontre auprès de certains Français, les calomnies dont il est l’objet font de ces années d’exil les plus cruelles de son existence.
Sans amertume ni colère, Saint-Exupéry transpose sa propre position : « Ce chanteur accusé de chanter faux car il chantait de façon pathétique dans l’empire délabré et ainsi célébrait un Dieu mort… » // ne dira jamais rien contre ses ennemis mais il parlera des réfugiés berbères : « Ils se surveillaient les uns les autres comme des chiens qui tournent autour de l’auge » et de lui-même : « Me situant à l’extérieur des faux litiges dans mon irréparable exil, n’étant ni pour les uns ni pour les autres. Ni pour les seconds contre les premiers, dominant les clans, les partis, les factions, luttant pour l’arbre seul contre les éléments de l’arbre et pour les éléments de l’arbre, au nom de l’arbre, qui protestera contre moi ? »
Ainsi, bien que Citadelle n’atteigne pas le lecteur par ce ton confidentiel du Petit Prince qui révèle la délicatesse d’âme de Saint-Exupéry, cette œuvre n’est pas, en dépit de sa forme, plus distante de l’écrivain, et quiconque eût suivi de près l’existence de Saint-Exupéry retrouverait à travers ces pages tes événements, les heurts et les constantes de sa vie.
L’unité de Citadelle est créée par la voix du personnage central qui s’y exprime. Au cours de ses premiers chants, jeune encore, ce chef s’instruit aux côtés de son père, maître de l’empire, du maniement des hommes. Humble, il écoute et se laisse éclairer par celui qui va lui léguer le pouvoir. Maître suprême à son tour, il observe ce qui rend son peuple fervent ou désabusé, ce qui fortifie ou décompose son empire.
Le ton plus que l’enchaînement des faits maintient la continuité de l’œuvre. Certains reprocheront précisément à ce texte sa forme qui peut être qualifiée de biblique. Nous ne croyons pas qu’il faille pour autant en déduire quelque influence d’écrits orientalistes subie par Saint-Exupéry. C’est un mouvement naturel de son cœur qui l’inclinait vers ce style. Dans les moments d’exaltation, il avait tendance à s’exprimer sous forme de récitatif lyrique et, lorsqu’il expliquait une de ses conceptions favorites (le maintien de la qualité, par exemple), il se plaçait à l’égard de son sujet à la distance du chef de Citadelle considérant son peuple.
Cette œuvre qui constitue la « somme » de Saint-Exupéry et qui rassemble ses méditations au cours de plusieurs années, nous fut laissée par lui sous forme de brouillons incomplets et pour la plupart illisibles, et de neuf cent quatre-vingt-cinq pages dactylographiées. Saint-Exupéry travaillait fort avant dans la nuit puis, avant de se coucher, dictait dans son dictaphone le travail de la soirée. La dactylo venait prendre au matin les rouleaux et transcrivait au plus juste ce quelle entendait. Mais de ces neuf cent quatre-vingt-cinq pages, Saint-Exupéry ne relut que quelques-unes. Il considérait avoir encore beaucoup à dire avant de commencer à couper, à corriger. Le texte n’est pas condensé et comporte en outre de nombreuses fautes faites phonétiquement : homonymes, erreurs de liaisons, etc. Le lecteur trouvera donc au cours de sa lecture bien des phrases d’un sens obscur ainsi que des chapitres qui ne sont que des versions différentes d’un même thème. Nous n’avons pas considéré possible de nous substituer à Saint-Exupéry pour effectuer le choix des chapitres ou corriger le sens et la rédaction de certaines phrases.
Saint-Exupéry avait rejoint l’Afrique du Nord en mars 1943. Il fut mis en réserve de commandement en août de la même année. Aussitôt, il se débattit pour reprendre du service, mais ce ne fut qu’en février 1944 que l’occasion lui en fut donnée : ayant appris la présence du général Eaker à Naples (le général américain Eaker commandait les forces aériennes du théâtre d’opérations méditerranéen dont dépendait le groupe 2/33), Saint-Exupéry voulut à toute force le rencontrer.
Grâce à la complaisance d’un ami, il décolla de Maison Blanche et se rendit à Naples. Il allait jouer sa dernière chance : tout plutôt que de retourner à Alger.
A Naples, devant le P. C. du général, il attendit une audience avec la patience et la ténacité dont lui seul était capable quand il désirait fortement. Le commandant en chef accueillit avec gaieté ce grand diable chauve, aux tempes grisonnantes, qui le suppliait comme un enfant de le laisser voler.
Ainsi, par la voie américaine, obtint-il de retourner au 2/33. Le général Eaker lui avait autorisé cinq missions. A la fin de juillet, il en avait accompli huit et ne cessait de se proposer comme volontaire, inquiétant ses camarades. Afin de le protéger, son chef d’escadrille avait comploté avec d’autres officiers de mettre Saint-Ex dans le secret du débarquement Sud afin de l’empêcher de voler. L’initiation était prévue pour le 31 juillet au soir. Mais le 31 au matin, Saint-Exupéry décollait pour une mission de reconnaissance sur la région de Grenoble et d’Annecy, proche de celle où il avait passé son enfance. Il avait tant insisté pour qu’on lui accordât cette mission…
Il partit en toute sérénité, son outil bien en main et par un temps magnifique. Aucun message n’ayant été capté, il est permis de croire que sa chute fut rapide et consécutive à une attaque de chasse allemande. Mais il était prêt et entièrement calme :
« Daigne faire l’unité pour ta gloire, en m’endormant au creux de ces sables déserts où j’ai bien travaillé. »
N. B. — En 1948, lorsque fut composée la première édition de Citadelle, les éditeurs n’avaient à leur disposition qu’un texte dactylographié très imparfait. Saint-Exupéry avait coutume de travailler durant la nuit. Il rédigeait des brouillons très peu lisibles puis, avant de se coucher, il dictait au dictaphone le travail de la soirée qu’une secrétaire, au matin, transcrivait tant bien que mal. Durant les derniers mois de sa vie, il ne put relever que partiellement les erreurs nombreuses de ces textes.
C’est seulement dix ans plus tard, en 1958, que les brouillons, constituant les manuscrits de cette œuvre, furent restitués. La confrontation de ces manuscrits avec les textes dactylographiés révéla que Saint-Exupéry modifiait tant de paragraphes en les dictant que certaines fautes demeureraient à jamais incontrôlables.
Cependant, la plupart des erreurs ont pu être corrigées et tes rébus résolus. Ce difficile et long travail de mise au point a été entrepris et mené à bien par Simone Lamblin, Pierre Chevrier et Léon Wencelius, que nous tenons à remercier. C’est en effet grâce à leurs soins diligents que pour la première fois nous sommes en mesure d’offrir au lecteur un texte qui peut être considéré comme définitif.
I
Car j’ai vu trop souvent la pitié s’égarer. Mais nous qui gouvernons les hommes, nous avons appris à sonder leurs cœurs afin de n’accorder notre sollicitude qu’à l’objet digne d’égards. Mais cette pitié, je la refuse aux blessures ostentatoires qui tourmentent le cœur des femmes, comme aux moribonds, et comme aux morts. Et je sais pourquoi.
Il fut un âge de ma jeunesse où j’eus pitié des mendiants et de leurs ulcères. Je louais pour eux des guérisseurs et j’achetais des baumes. Les caravanes me ramenaient d’une île des onguents à base d’or qui recousent la peau sur la chair. Ainsi ai-je agi jusqu’au jour où j’ai compris qu’ils tenaient comme luxe rare à leur puanteur, les ayant surpris se grattant et s’humectant de fiente comme celui-là qui fume une terre pour en arracher la fleur pourpre. Ils se montraient l’un à l’autre leur pourriture avec orgueil, tirant vanité des offrandes reçues, car celui qui gagnait le plus s’égalait en soi-même au grand prêtre qui expose la plus belle idole. S’ils consentaient à consulter mon médecin, c’était dans l’espoir que leur chancre le surprendrait par sa pestilence et par son ampleur. Et ils agitaient leurs moignons pour tenir de la place dans le monde. Ainsi acceptaient-ils les soins comme un hommage, offrant leurs membres aux ablutions qui les flattaient, mais à peine le mal était-il effacé qu’ils se découvraient sans importance, ne nourrissant plus rien de soi, comme inutiles, et qu’ils s’occupaient désormais de ressusciter d’abord cet ulcère qui vivait d’eux. Et, une fois bien drapés de nouveau dans leur mal, glorieux et vains, ils reprenaient, la sébile à la main, la route des caravanes et, au nom de leur dieu malpropre, rançonnaient les voyageurs.
Il fut un âge aussi où j’eus pitié des morts. Croyant que celui-là que je sacrifiais dans son désert sombrait dans une solitude désespérée, n’ayant point encore entrevu qu’il n’est jamais de solitude pour ceux qui meurent. Ne m’étant point heurté encore à leur condescendance. Mais j’ai vu l’égoïste ou l’avare, celui-là même qui criait si fort contre toute spoliation, parvenu à sa dernière heure, prier qu’autour de lui l’on rassemblât les familiers de sa maison, puis partager ses biens dans une équité dédaigneuse comme des jouets futiles à des enfants. J’ai vu le blessé pusillanime, le même qui eût hurlé pour appeler à l’aide au cœur d’un danger sans grandeur, une fois rompu véritablement, repousser d’autrui toute assistance s’il se trouvait que cette assistance eût fait courir à ses compagnons quelque péril. Nous célébrons une telle abnégation. Mais je n’ai trouvé là encore que signe discret de mépris. Je connais celui-là qui partage sa gourde quand déjà il sèche au soleil, ou sa croûte de pain à l’apogée de la famine. Et c’est d’abord qu’il n’en connaît plus le besoin et, plein d’une royale ignorance, abandonne à autrui cet os à ronger.
J’ai vu les femmes plaindre les guerriers morts. Mais c’est nous-mêmes qui les avons trompées ! Tu les a vus rentrer, les survivants, glorieux et encombrants, faisant bien du tapage à crier leurs exploits, apportant, en caution du risque accepté, la mort des autres, mort qu’ils disent épouvantable, car elle aurait pu leur survenir. Moi-même ainsi, dans ma jeunesse, j’ai aimé autour de mon front cette auréole des coups de sabre reçus par d’autres. Je revenais, brandissant mes compagnons morts et leur terrible désespoir. Mais celui-là que la mort a choisi, occupé de vomir son sang ou de retenir ses entrailles, découvre seul la vérité — à savoir qu’il n’est point d’horreur de la mort. Son propre corps lui apparaît comme un instrument désormais vain et qui a fini de servir et qu’il rejette. Un corps démantelé qui se montre dans son usure. Et s’il a soif, ce corps, le mourant n’y reconnaît plus qu’une occasion de soif, dont il serait bon d’être délivré. Et tous les biens deviennent inutiles qui servaient à parer, à nourrir, à fêter cette chair à demi étrangère, qui n’est plus que propriété domestique, comme l’âne attaché à son pieu.
Alors commence l’agonie qui n’est plus que balancement d’une conscience tour à tour vidée puis remplie par les marées de la mémoire. Elles vont et viennent comme le flux et le reflux, rapportant, comme elles les avaient emportés, toutes les provisions d’images, tous les coquillages du souvenir, toutes les conques de toutes les voix entendues. Elles remontent, elles baignent à nouveau les algues du cœur et voilà toutes les tendresses ranimées. Mais l’équinoxe prépare son reflux décisif, le cœur se vide, la marée et ses provisions rentrent en Dieu.
Certes, j’ai vu des hommes fuir la mort, saisis d’avance par la confrontation. Mais celui-là qui meurt, détrompez-vous, je ne l’ai jamais vu s’épouvanter.
Pourquoi donc les plaindrais-je ? Pourquoi perdrais-je mon temps à pleurer leur achèvement ? J’ai trop connu la perfection des morts. Qu’ai-je côtoyé de plus léger que la mort de cette captive dont on égaya mes seize ans et qui, lorsqu’on me l’apporta, s’occupait déjà de mourir, respirant par souffles si courts et cachant sa toux dans les linges, à bout de course comme la gazelle, déjà forcée, mais l’ignorant puisqu’elle aimait sourire. Mais ce sourire était vent sur une rivière, trace d’un songe, sillage d’un cygne, et de jour en jour s’épurant, et plus précieux, et plus difficile à retenir, jusqu’à devenir cette simple ligne tellement pure, une fois le cygne envolé.
Mort aussi de mon père. De mon père accompli et devenu de pierre. Les cheveux de l’assassin blanchirent, dit-on, quand son poignard, au lieu de vider ce corps périssable, l’eut empli d’une telle majesté. Le meurtrier, caché dans la chambre royale, face à face, non avec sa victime, mais avec le granit géant d’un sarcophage, pris au piège d’un silence dont il était lui-même la cause, on le découvrit au petit jour réduit à la prosternation par la seule immobilité du mort.
Ainsi mon père qu’un régicide installa d’emblée dans l’éternité, quand il eut ravalé son souffle suspendit le souffle des autres durant trois jours. Si bien que les langues ne se délièrent, que les épaules ne cessèrent d’être écrasées qu’après que nous l’eûmes porté en terre. Mais il nous parut si important, lui qui ne gouverna pas mais pesa et fonda sa marque, que nous crûmes, quand nous le descendîmes dans la fosse, au long de cordes qui craquaient, non ensevelir un cadavre, mais engranger une provision. Il pesait, suspendu, comme la première dalle d’un temple. Et nous ne l’enterrâmes point, mais le scellâmes dans la terre, enfin devenu ce qu’il est, cette assise.
C’est lui qui m’enseigna la mort et m’obligea quand j’étais jeune de la regarder bien en face, car il ne baissa jamais les yeux. Mon père était du sang des aigles.
Ce fut au cours de l’année maudite, celle que l’on surnomma « le Festin du Soleil », car le soleil, cette année-là, élargit le désert. Rayonnant sur les sables parmi les ossements, les ronces sèches, les peaux transparentes des lézards morts et cette herbe à chameaux changée en crin. Lui par qui se bâtissent les tiges des fleurs avait dévoré ses créatures, et il trônait, sur leurs cadavres éparpillés, comme l’enfant parmi les jouets qu’il a détruits.
Il absorba jusqu’aux réserves souterraines et but l’eau des puits rares. Il absorba jusqu’à la dorure des sables, lesquels se firent si vides, si blancs, que nous baptisâmes cette contrée du nom de Miroir. Car un miroir ne contient rien non plus et les images dont il s’emplit n’ont ni poids ni durée. Car un miroir parfois, comme un lac de sel, brûle les yeux.
Les chameliers, lorsqu’ils s’égarent, s’ils se prennent à ce piège qui n’a jamais rendu son bien, ne le reconnaissent pas d’abord, car rien ne le distingue, et ils y traînent, comme une ombre au soleil, le fantôme de leur présence. Collés à cette glu de lumière ils croient marcher, engloutis déjà dans l’éternité ils croient vivre. Ils poussent en avant leur caravane là où nul effort ne prévaut contre l’inertie de l’étendue. Marchant sur un puits qui n’existe pas, ils se réjouissent de la fraîcheur du crépuscule, quand désormais elle n’est plus qu’inutile sursis. Ils se plaignent peut-être, ô naïfs, de la lenteur des nuits, quand les nuits bientôt passeront sur eux comme battements de paupières. Et, s’injuriant de leurs voix gutturales, à cause de tendres injustices, ils ignorent que déjà, pour eux, justice est faite.
Tu crois qu’ici une caravane se hâte ? Laisse couler vingt siècles et reviens voir !
Fondus dans le temps et changés en sable, fantômes bus par le miroir, ainsi les ai-je moi-même découverts quand mon père, pour m’enseigner la mort, me prit en croupe et m’emporta.
« Là, me dit-il, il fut un puits. »
Au fond de l’une de ces cheminées verticales, qui ne reflètent, tant elles sont profondes, qu’une seule étoile, la boue même s’était durcie et l’étoile prise s’y était éteinte. Or, l’absence d’une seule étoile suffit pour culbuter une caravane sur sa route aussi sûrement qu’une embuscade.
Autour de l’étroit orifice, comme autour du cordon ombilical rompu, hommes et bêtes s’étaient en vain agglutinés pour recevoir du ventre de la terre l’eau de leur sang. Mais les ouvriers les plus sûrs, haies jusqu’au plancher de cet abîme, avaient en vain gratté la croûte dure. Semblable à l’insecte épingle vivant et qui, dans le tremblement de la mort, a répandu autour de lui la soie, le pollen et l’or de ses ailes, la caravane, clouée au sol par un seul puits vide, commençait déjà de blanchir dans l’immobilité des attelages rompus, des malles éventrées, des diamants déversés en gravats, et des lourdes barres d’or qui s’ensablaient.
Comme je les considérais, mon père parla :
« Tu connais le festin des noces, une fois que l’ont déserté les convives et les amants. Le petit jour expose le désordre qu’ils ont laissé. Les jarres brisées, les tables bousculées, la braise éteinte, tout conserve l’empreinte d’un tumulte qui s’est durci. Mais à lire ces marques, me dit mon père, tu n’apprendras rien sur l’amour.
« A peser, retourner le livre du Prophète, me dit-il encore, à s’attarder sur le dessin des caractères ou sur l’or des enluminures, l’illettré manque l’essentiel qui est non l’objet vain mais la sagesse divine. Ainsi l’essentiel du cierge n’est point la cire qui laisse des traces, mais la lumière. »
Cependant, comme je tremblais d’avoir affronté au large d’un plateau désert, semblable aux tables des anciens sacrifices, ces reliefs du repas de Dieu, mon père me dit encore :
« Ce qui importe ne se montre point dans la cendre.
Ne t’attarde plus sur ces cadavres. Il n’y a rien ici que chariots embourbés pour l’éternité faute de conducteurs.
— Alors, lui criai-je, qui m’enseignera ? »
Et mon père me répondit :
« L’essentiel de la caravane, tu le découvres quand elle se consume. Oublie le vain bruit des paroles et vois : si le précipice s’oppose à sa marche, elle contourne le précipice, si le roc se dresse, elle l’évite, si le sable est trop fin, elle cherche ailleurs un sable dur, mais toujours elle reprend la même direction. Si le sel d’une saline craque sous le poids de ses fardeaux, tu la vois qui s’agite, désembourbe ses bêtes, tâtonne pour trouver une assise solide, mais bientôt rentre en ordre, une fois de plus, dans sa direction primitive. Si une monture s’abat on fait halte, on ramasse les caisses brisées, on en charge une autre monture, on tire pour les amarrer bien sur le nœud de corde craquante, puis l’on reprend la même route. Parfois meurt celui-là qui servait de guide. On l’entoure. On l’enfouit dans le sable. On dispute. Puis on en pousse un autre au rang de conducteur et l’on met le cap une fois encore sur le même astre. La caravane se meut ainsi nécessairement dans une direction qui la domine, elle est pierre pesante sur une pente invisible. »
Les juges de la ville condamnèrent une fois une jeune femme, qui avait commis quelque crime, à se dévêtir au soleil de sa tendre écorce de chair, et la firent simplement lier à un pieu dans le désert.
« Je t’enseignerai, me dit mon père, vers quoi tendent les hommes. »
Et de nouveau il m’emporta.
Comme nous voyagions, le jour entier passa sur elle, et le soleil but son sang tiède, sa salive et la sueur de ses aisselles. But dans ses yeux l’eau de lumière. La nuit tombait et sa courte miséricorde quand nous parvînmes, mon père et moi, au seuil du plateau interdit où, émergeant blanche et nue de l’assise du roc, plus fragile qu’une tige nourrie d’humidité mais désormais tranchée d’avec les provisions d’eaux lourdes qui font dans la terre leur silence épais, tordant ses bras comme un sarment qui déjà craque dans l’incendie, elle criait vers la pitié de Dieu.
« Écoute-la, me dit mon père. Elle découvre l’essentiel… »
Mais j’étais enfant et pusillanime :
« Peut-être qu’elle souffre, lui répondis-je, et peut-être aussi qu’elle a peur…
— Elle a dépassé, me dit mon père, la souffrance et la peur qui sont maladies de l’étable, faites pour l’humble troupeau. Elle découvre la vérité. »
Et je l’entendis qui se plaignait. Prise dans cette nuit sans frontières, elle appelait à elle la lampe du soir dans la maison, et la chambre qui l’eût rassemblée, et la porte qui se fût bien fermée sur elle. Offerte à l’univers entier qui ne montrait point de visage, elle appelait l’enfant que l’on embrasse avant de s’endormir et qui résume le monde. Soumise, sur ce plateau désert, au passage de l’inconnu, elle chantait le pas de l’époux qui sonne le soir sur le seuil et que l’on reconnaît et qui rassure. Étalée dans l’immensité et n’ayant plus rien à saisir, elle suppliait qu’on lui rendît les digues qui seules permettent d’exister, ce paquet de laine à carder, cette écuelle à laver, celle-là seule, cet enfant à endormir et non un autre. Elle criait vers l’éternité de la maison, coiffée avec tout le village par la même prière du soir.
Mon père me reprit en croupe, quand la tête de la condamnée eut fléchi sur l’épaule. Et nous fûmes dans le vent.
« Tu entendras, me dit mon père, leur rumeur ce soir sous les tentes et leurs reproches de cruauté. Mais les tentatives de rébellion, je les leur rentrerai dans la gorge : je forge l’homme. » Je devinais pourtant la bonté de mon père : « Je veux qu’ils aiment, achevait-il, les eaux vives des fontaines. Et la surface unie de l’orge verte recousue sur les craquelures de l’été. Je veux qu’ils glorifient le retour des saisons. Je veux qu’ils se nourrissent, pareils à des fruits qui s’achèvent, de silence et de lenteur. Je veux qu’ils pleurent longtemps leurs deuils et qu’ils honorent longtemps les morts, car l’héritage passe lentement d’une génération à l’autre et je ne veux pas qu’ils perdent leur miel sur le chemin. Je veux qu’ils soient semblables à la branche de l’olivier. Celle qui attend. Alors commencera de se faire sentir en eux le grand balancement de Dieu qui vient comme un souffle essayer l’arbre. Il les conduit puis les ramène de l’aube à la nuit, de l’été à l’hiver, des moissons qui lèvent aux moissons engrangées, de la jeunesse à la vieillesse, puis de la vieillesse aux enfants nouveaux.
« Car ainsi que de l’arbre, tu ne sais rien de l’homme si tu l’étalés dans sa durée et le distribues dans ses différences. L’arbre n’est point semence, puis tige, puis tronc flexible, puis bois mort. Il ne faut point le diviser pour le connaître. L’arbre, c’est cette puissance qui lentement épouse le ciel. Ainsi de toi, mon petit d’homme. Dieu te fait naître, te fait grandir, te remplit successivement de désirs, de regrets, de joies et de souffrances, de colères et de pardons, puis Il te rentre en Lui. Cependant, tu n’es ni cet écolier, ni Cet époux, ni cet enfant, ni ce vieillard. Tu es celui qui s’accomplit. Et si tu sais te découvrir branche balancée, bien accrochée à l’olivier, tu goûteras dans tes mouvements l’éternité. Et tout autour de toi se fera éternel. Éternelle la fontaine qui chante et a su abreuver tes pères, éternelle la lumière des yeux quand te sourira la bien-aimée, éternelle la fraîcheur des nuits.
Le temps n’est plus un sablier qui use son sable, mais un moissonneur qui noue sa gerbe. »
II
Ainsi, du sommet de la tour la plus haute de la citadelle, j’ai découvert que ni la souffrance ni la mort dans le sein de Dieu, ni le deuil même n’étaient à plaindre. Car le disparu si l’on vénère sa mémoire est plus présent et plus puissant que le vivant. Et j’ai compris l’angoisse des hommes et j’ai plaint les hommes.
Et j’ai décidé de les guérir.
J’ai pitié de celui-là seul qui se réveille dans la grande nuit patriarcale, se croyant abrité sous les étoiles de Dieu, et qui sent tout à coup le voyage.
J’interdis que l’on interroge, sachant qu’il n’est jamais de réponse qui désaltère. Celui qui interroge, ce qu’il cherche d’abord c’est l’abîme.
Je condamne l’inquiétude qui pousse les voleurs au crime, ayant appris à lire en eux et sachant ne point les sauver si je les sauve de leur misère. Car s’ils croient convoiter l’or d’autrui ils se trompent. Mais l’or brille comme une étoile. Cet amour qui s’ignore soi-même ne s’adresse qu’à une lumière qu’ils ne captureront jamais. Ils vont de reflet en reflet, dérobant des biens inutiles, comme le fou qui pour se saisir de la lune qui s’y reflète puiserait l’eau noire des fontaines. Ils vont et jettent au feu court des orgies la cendre vaine qu’ils ont dérobée. Puis ils reprennent leurs stations nocturnes, pâles comme au seuil d’un rendez-vous, immobiles de peur d’effrayer, s’imaginant qu’ici réside ce qui peut-être un jour les comblera.
Celui-là, si je le libère, demeurera fidèle à son culte et mes hommes d’armes écrasant les branches le surprendront demain encore dans les jardins d’autrui, plein du battement de son cœur et croyant sentir vers lui, cette nuit-là, la fortune fléchir.
Et certes je les couvre d’abord de mon amour, leur connaissant plus de ferveur qu’aux vertueux dans leurs boutiques. Mais je suis bâtisseur de cités. J’ai décidé d’asseoir ici les assises de ma citadelle. J’ai contenu la caravane en marche. Elle n’était que graine dans le lit du vent. Le vent charrie comme un parfum la semence du cèdre. Moi je résiste au vent et j’enterre la semence, en vue d’épanouir les cèdres pour la gloire de Dieu.
Il faut que l’amour trouve son objet. Je sauve celui-là seul qui aime ce qui est et que l’on peut rassasier.
C’est pourquoi également j’enferme la femme dans le mariage et ordonne de lapider l’épouse adultère. Et certes je comprends sa soif et combien grande est la présence dont elle se réclame. Je sais la lire, qui s’accoude sur la terrasse, quand le soir permet les miracles, fermée de toutes parts par la haute mer de l’horizon, et livrée, comme à un bourreau solitaire, au supplice d’être tendre.
Je la sens toute palpitante, jetée ici ainsi qu’une truite sur le sable, et qui attend, comme la plénitude de la vague marine, le manteau bleu du cavalier. Son appel, elle le jette à la nuit tout entière. Quiconque en surgira l’exaucera. Mais elle passera vainement de manteau en manteau, car il n’est point d’homme pour la combler. Une rive ainsi appelle, pour se rafraîchir, l’épanchement des vagues de la mer, et les vagues se succèdent éternellement. L’une après l’autre s’use. A quoi bon ratifier le changement d’époux : Quiconque aime d’abord l’approche de l’amour ne connaîtra point la rencontre…
Je sauve celle-là seule qui peut devenir, et s’ordonner autour de la cour intérieure, de même que le cèdre s’édifie autour de sa graine, et trouve, dans ses propres limites, son épanouissement. Je sauve celle-là qui n’aime point d’abord le printemps, mais l’ordonnance de telle fleur où le printemps s’est enfermé. Qui n’aime point d’abord l’amour, mais tel visage particulier qu’a pris l’amour.
C’est pourquoi cette épouse dispersée dans le soir je l’expurge ou je la rassemble. Je dispose autour d’elle, comme autant de frontières, le réchaud, la bouilloire, et le plateau de cuivre d’or, afin que peu à peu, au travers de cet assemblage, elle découvre un visage reconnaissable, familier, un sourire qui n’est que d’ici. Et ce sera pour elle l’apparition lente de Dieu. L’enfant alors criera pour obtenir d’être allaité, la laine à carder tentera les doigts, et la braise réclamera sa part de souffle. Dès lors elle sera capturée et prête à servir. Car je suis celui qui bâtit l’urne autour du parfum pour qu’il demeure. Je suis la routine qui comble le fruit. Je suis celui qui contraint la femme de prendre figure et d’exister, afin que plus tard je remette en son nom à Dieu non ce faible soupir dispersé dans le vent, mais telle ferveur, telle tendresse, telle souffrance particulière…
Ainsi ai-je longtemps médité sur le sens de la paix. Elle ne vient que des enfants nés, que des moissons faites, que de la maison enfin rangée. Elle vient de l’éternité où rentrent les choses accomplies. Paix des granges pleines, des brebis qui dorment, des linges plies, paix de la seule perfection, paix de ce qui devient cadeau à Dieu, une fois bien fait.
Car il m’est apparu que l’homme était tout semblable à la citadelle. Il renverse les murs pour s’assurer la liberté, mais il n’est plus que forteresse démantelée et ouverte aux étoiles. Alors commence l’angoisse qui est de n’être point. Qu’il fasse sa vérité de l’odeur du sarment qui grille ou de la brebis qu’il doit tondre. La vérité se creuse comme un puits. Le regard, quand il se disperse, perd la vision de Dieu. En sait plus long sur Dieu que l’épouse adultère ouverte aux promesses de la nuit, tel sage qui s’est rassemblé, et ne connaît rien que le poids des laines. Citadelle, je te construirai dans le cœur de l’homme.
Car il est un temps pour choisir parmi les semences, mais il est un temps pour se réjouir, ayant choisi une fois pour toutes, de la croissance des moissons. Il est un temps pour la création, mais il est un temps pour la créature. Il est un temps pour la foudre écarlate qui rompt les digues dans le ciel, mais il est un temps pour les citernes où les eaux rompues vont se réunir. Il est un temps pour la conquête, mais vient le temps de la stabilité des empires : moi qui suis serviteur de Dieu, j’ai le goût de l’éternité.
Je hais ce qui change. J’étrangle celui-là qui se lève dans la nuit et jette au vent des prophéties comme l’arbre touché par la semence du ciel, quand il craque et se brise et embrase avec lui la forêt. Je m’épouvante quand Dieu remue. Lui, l’immuable, qu’il se rassoie donc dans l’éternité ! Car il est un temps pour la genèse, mais il est un temps, un temps bienheureux, pour la coutume !
Il faut pacifier, cultiver et polir. Je suis celui qui recoud les fissures du sol et cache aux hommes les traces du volcan. Je suis la pelouse sur l’abîme. Je suis le cellier qui dore les fruits. Je suis le bac qui a reçu de Dieu une génération en gage et la passe d’une rive à l’autre. Dieu à son tour la recevra de mes mains, telle qu’il me la confia, plus mûrie peut-être, plus sage, et ciselant mieux les aiguières d’argent, mais non changée. J’ai enfermé mon peuple dans mon amour.
C’est pourquoi je protège celui qui reprend à la septième génération, pour la conduire à son tour vers la perfection, l’inflexion de la carène ou la courbe du bouclier. Je protège celui qui de son aïeul le chanteur hérite le poème anonyme et, le redisant à son tour, et à son tour se trompant, y ajoute son suc, son usure, sa marque. J’aime la femme enceinte ou celle qui allaite, j’aime le troupeau qui se perpétue, j’aime les saisons qui reviennent. Car je suis d’abord celui qui habite. O citadelle, ma demeure, je te sauverai des projets du sable, et je t’ornerai de clairons tout autour, pour sonner contre les barbares !
III
Car j’ai découvert une grande vérité. A savoir que les hommes habitent, et que le sens des choses change pour eux selon le sens de la maison. Et que le chemin, le champ d’orge et la courbe de la colline sont différents pour l’homme selon qu’ils composent ou non un domaine. Car voilà tout à coup cette matière disparate qui s’assemble et pèse sur le cœur. Et celui-là n’habite point le même univers qui habite ou non le royaume de Dieu. Et, qu’ils se trompent, les infidèles, qui rient de nous, et qui croient courir les richesses tangibles, quand il n’en est point. Car s’ils convoitent ce troupeau c’est déjà par orgueil. Et les joies de l’orgueil elles-mêmes ne sont point tangibles.
Ainsi de ceux qui croient le découvrir en le divisant, mon territoire. « Il y a là, disent-ils, des moutons, des chèvres, de l’orge, des demeures et des montagnes — et quoi de plus ? » Et ils sont pauvres de ne rien posséder de plus. Et ils ont froid. Et j’ai découvert qu’ils ressemblent à celui-là qui dépèce un cadavre. « La vie, dit-il, je la montre au grand jour : ce n’est que mélange d’os, de sang, de muscles et de viscères. » Quand la vie était cette lumière des yeux qui ne se lit plus dans leur cendre. Quand mon territoire est bien autre chose que ces moutons, ces champs, ces demeures et ces montagnes, mais ce qui les domine et les noue. Mais la patrie de mon amour. Et les voilà heureux s’ils le savent, car ils habitent ma maison.
Et les rites sont dans le temps ce que la demeure est dans l’espace. Car il est bon que le temps qui s’écoule ne nous paraisse point nous user et nous perdre, comme la poignée de sable, mais nous accomplir. Il est bon que le temps soit une construction. Ainsi, je marche de fête en fête, et d’anniversaire en anniversaire, de vendange en vendange, comme je marchais, enfant, de la salle du Conseil à la salle du repos, dans l’épaisseur du palais de mon père, où tous les pas avaient un sens.
J’ai imposé ma loi qui est comme la forme des murs et l’arrangement de ma demeure. L’insensé est venu me dire : « Délivre-nous de tes contraintes, alors nous deviendrons plus grands. » Mais je savais qu’ils y perdraient d’abord la connaissance d’un visage et, de ne plus l’aimer, la connaissance d’eux-mêmes, et j’ai décidé, malgré eux, de les enrichir de leur amour. Car ils me proposaient, pour s’y promener plus à l’aise, de jeter bas les murs du palais de mon père où tous les pas avaient un sens.
C’était une vaste demeure avec l’aile réservée aux femmes et le jardin secret où chantait le jet d’eau. (Et j’ordonne que l’on fasse ainsi un cœur à la maison afin que l’on y puisse et s’approcher et s’éloigner de quelque chose. Afin que l’on y puisse et sortir et rentrer. Sinon, l’on n’est plus nulle part. Et ce n’est point être libre que de n’être pas.) Il y avait aussi les granges et les étables. Et il arrivait que les granges fussent vides et les étables inoccupées. Et mon père s’opposait à ce que l’on se servît des unes pour les fins des autres. « La grange, disait-il, d’abord est une grange, et tu n’habites point une maison si tu ne sais plus où tu te trouves. Peu importe, disait-il encore, un usage plus ou moins fertile. L’homme n’est pas un bétail à l’engrais, et l’amour, pour lui, compte plus que l’usage. Tu ne peux aimer une maison qui n’a point de visage et où les pas n’ont point de sens. »
Il y avait la salle réservée aux seules grandes ambassades, et que l’on ouvrait au soleil les seuls jours où montait la poussière de sable soulevée par les cavaliers, et, à l’horizon, ces grandes oriflammes où le vent travaillait comme sur la mer. Celle-là, on la laissait déserte à l’occasion des petits princes sans importance. Il y avait la salle où l’on rendait la justice, et celle où l’on portait les morts. Il y avait la chambre vide, celle dont nul jamais ne connut l’usage — et qui peut-être n’en avait aucun, sinon d’enseigner le sens du secret et que jamais on ne pénètre toutes choses.
Et les esclaves, qui parcouraient les corridors portant leurs charges, déplaçaient de lourdes tentures qui croulaient contre leur épaule. Ils montaient des marches, poussaient des portes, et redescendaient d’autres marches, et, selon qu’ils étaient plus près ou plus loin du jet d’eau central, se faisaient plus ou moins silencieux, jusqu’à devenir inquiets comme des ombres aux lisières du domaine des femmes dont la connaissance par erreur leur eût coûté la vie. Et les femmes elles-mêmes : calmes, arrogantes, ou furtives, selon leur place dans la demeure.
J’entends la voix de l’insensé : « Que de place dilapidée, que de richesses inexploitées, que de commodités perdues par négligence ! Il faut démolir ces murs inutiles, et niveler ces courts escaliers qui compliquent la marche. Alors l’homme sera libre. » Et moi je réponds : « Alors les hommes deviendront bétail de place publique, et, de peur de tant s’ennuyer, inventeront des jeux stupides qui seront encore régis par des règles, mais par des règles sans grandeur. Car le palais peut favoriser des poèmes. Mais quel poème écrire sur la niaiserie des dés qu’ils lancent ? Longtemps peut-être encore ils vivront de l’ombre des murs, dont les poèmes leur porteront la nostalgie, puis l’ombre elle-même s’effacera et ils ne les comprendront plus. »
Et de quoi, désormais, se réjouiraient-ils ?
Ainsi de l’homme perdu dans une semaine sans jours, ou une année sans fêtes, qui ne montre point de visage. Ainsi de l’homme sans hiérarchie, et qui jalouse son voisin, si en quelque chose celui-ci le dépasse, et s’emploie à le ramener à sa mesure. Quelle joie tireront-ils ensuite de la mare étale qu’ils constitueront ?
Moi je recrée les champs de force. Je construis des barrages dans les montagnes pour soutenir les eaux. Je m’oppose ainsi, injuste, aux pentes naturelles. Je rétablis les hiérarchies là où les hommes se rassemblaient comme les eaux, une fois qu’elles se sont mêlées dans la mare. Je bande les arcs. De l’injustice d’aujourd’hui je crée la justice de demain. Je rétablis les directions, là où chacun s’installe sur place et nomme bonheur ce croupissement. Je méprise les eaux croupissantes de leur justice et délivre celui qu’une belle injustice a fondé. Et ainsi j’ennoblis mon empire.
Car je connais leurs raisonnements. Ils admiraient l’homme qu’a fondé mon père. « Comment oser brimer, se sont-ils dit, une réussite si parfaite ? » Et, au nom de celui-là que de telles contraintes avaient fondé, ils ont brisé ces contraintes. Et tant qu’elles ont duré dans le cœur, elles ont encore agi. Puis, peu à peu, on les a oubliées. Et celui-là que l’on voulait sauver est mort.
C’est pourquoi je hais l’ironie qui n’est point de l’homme mais du cancre. Car le cancre leur dit : « Vos coutumes ailleurs sont autres. Pourquoi n’en point changer ? » De même qu’il leur eût dit : « Qui vous force d’installer les moissons dans la grange et les troupeaux dans les étables ? » Mais c’est lui qui est dupe des mots, car il ignore ce que les mots ne peuvent saisir. Il ignore que les hommes habitent une maison.
Et ses victimes qui ne savent plus la reconnaître commencent de la démanteler. Les hommes dilapident ainsi leur bien le plus précieux : le sens des choses. Et ils se croient bien glorieux, les jours de fête, de ne point céder aux coutumes, de trahir leurs traditions, de fêter leur ennemi. Et certes, ils éprouvent quelques mouvements intérieurs dans les démarches de leurs sacrilèges. Tant qu’il y a sacrilège. Tant qu’ils se dressent contre quelque chose qui pèse encore contre eux. Et ils vivent de ce que leur ennemi respire encore. L’ombre des lois les gêne assez encore pour qu’ils se sentent contre les lois. Mais l’ombre elle-même bientôt s’efface. Alors ils n’éprouvent plus rien, car le goût même de la victoire est oublié. Et ils bâillent. Ils ont changé le palais en place publique, mais une fois usé le plaisir de piétiner la place avec une arrogance de matamore, ils ne savent plus ce qu’ils font là, dans cette foire. Et voilà qu’ils rêvent vaguement de reconstruire une maison aux mille portes, aux tentures qui croulent sur l’épaule, aux antichambres lentes. Voilà qu’ils rêvent d’une pièce secrète qui rendrait secrète toute la demeure. Et sans le savoir, l’ayant oublié, ils pleurent le palais de mon père où tous les pas avaient un sens.
C’est pourquoi, l’ayant bien compris, j’oppose mon arbitraire à cet effritement des choses et n’écoute point ceux qui me parlent de pentes naturelles. Car je sais trop que les pentes naturelles grossissent les mares de l’eau des glaciers, et nivellent les aspérités des montagnes, et rompent le mouvement du fleuve, quand il s’étale dans la mer, en mille remous contradictoires. Car je sais trop que les pentes naturelles font que le pouvoir se distribue et que les hommes s’égalisent. Mais je gouverne et je choisis. Sachant bien que le cèdre aussi triomphe de l’action du temps qui devrait l’étaler en poussière, et, d’année en année, édifie, contre la force même qui le tire vers le bas, l’orgueil du temple de feuillage. Je suis la vie et j’organise. J’édifie les glaciers contre les intérêts des mares. Peu m’importe si les grenouilles coassent à l’injustice. Je réarme l’homme pour qu’il soit.
C’est pourquoi je néglige le bavard imbécile qui vient reprocher au palmier de n’être point cèdre, au cèdre de n’être point palmier et, mélangeant les livres, tend vers le chaos. Et je sais bien que le bavard a raison dans sa science absurde car, hors la vie, cèdre et palmier s’unifieraient et se répandraient en poussière. Mais la vie s’oppose au désordre et aux pentes naturelles. C’est de la poussière qu’elle tire le cèdre.
La vérité de mes ordonnances, c’est l’homme qui en naîtra. Et les coutumes et les lois et le langage de mon empire, je ne cherche point en eux-mêmes leur signification. Je sais trop bien qu’en assemblant des pierres c’est du silence que l’on crée. Lequel ne se lisait point dans les pierres. Je sais trop bien qu’à force de fardeaux et de bandeaux c’est l’amour que l’on vivifie. Je sais trop bien que celui-là ne connaît rien qui a dépecé le cadavre et pesé ses os et ses viscères. Car os et viscères ne servent de rien par eux-mêmes, non plus que l’encre et la pâte du livre. Seule compte la sagesse qu’apporté le livre, mais qui n’est point de leur essence.
Et je refuse la discussion car il n’est rien ici qui se puisse démontrer. Langage de mon peuple, je te sauverai de pourrir. Je me souviens de ce mécréant qui visita mon père :
« Tu ordonnes que chez toi l’on prie avec des chapelets de treize grains. Q’importe treize grains, disait-il, le salut n’est-il pas le même si tu en changes le nombre ? »
Et il fit valoir de subtiles raisons pour que les hommes priassent sur des chapelets de douze grains. Moi, enfant, sensible à l’habileté du discours, j’observais mon père, doutant de l’éclat de sa réponse, tant les arguments invoqués m’avaient paru brillants :
« Dis-moi, reprenait l’autre, en quoi pèse plus lourd le chapelet de treize grains…
— Le chapelet de treize grains, répondit mon père, pèse le poids de toutes les têtes qu’en son nom j’ai déjà tranchées… »
Dieu éclaira le mécréant qui se convertit.
IV
Demeure des hommes, qui te fonderait sur le raisonnement ? Qui serait capable, selon la logique, de te bâtir ? Tu existes et n’existes pas. Tu es et tu n’es pas. Tu es faite de matériaux disparates, mais il faut t’inventer pour te découvrir. De même que celui-là, qui a détruit sa maison avec la prétention de la connaître, ne possède plus qu’un tas de pierres, de briques et de tuiles, ne retrouve ni l’ombre ni le silence ni l’intimité qu’elles servaient, et ne sait quel service attendre de ce tas de briques, de pierres et de tuiles, car il leur manque l’invention qui les domine, l’âme et le cœur de l’architecte. Car il manque à la pierre l’âme et le cœur de l’homme.
Mais comme il n’est de raisonnements que de la brique, de la pierre et de la tuile, non de l’âme et du cœur qui les dominent, et les changent, de par leur pouvoir, en silence, comme l’âme et le cœur échappent aux règles de la logique et aux lois des nombres, alors, moi, j’apparais avec mon arbitraire. Moi l’architecte. Moi qui possède une âme et un cœur. Moi qui seul détiens le pouvoir de changer la pierre en silence. Je viens, et je pétris cette pâte, qui n’est que matière, selon l’image créatrice qui me vient de Dieu seul et hors des voies de la logique. Moi je bâtis ma civilisation, épris du seul goût qu’elle aura, comme d’autres bâtissent leur poème et infléchissent la phrase et changent le mot, sans être contraints de justifier l’inflexion ni le changement, épris du seul goût qu’elle aura, et qu’ils connaissent par le cœur.
Car je suis le chef. Et j’écris les lois et je fonde les fêtes et j’ordonne les sacrifices, et, de leurs moutons, de leurs chèvres, de leurs demeures, de leurs montagnes, je tire cette civilisation semblable au palais de mon père où tous les pas ont un sens.
Car, sans moi, qu’en eussent-ils fait du tas de pierres, à le remuer de droite à gauche, sinon un autre tas de pierres moins bien organisé encore ? Moi je gouverne et, Je choisis. Et je suis seul à gouverner. Et voilà qu’ils peuvent prier dans le silence et l’ombre qu’ils doivent à mes pierres. A mes pierres ordonnées selon l’image de mon cœur.
Je suis le chef. Je suis le maître. Je suis le responsable. Et je les sollicite de m’aider. Ayant bien compris que le chef n’est point celui qui sauve les autres, mais celui qui les sollicite de le sauver. Car c’est par moi, par l’image que je porte, que se fonde l’unité que j’ai tirée, moi seul, de mes moutons, de mes chèvres, de mes demeures, de mes montagnes, et dont les voilà amoureux, comme ils le seraient d’une jeune divinité qui ouvrirait ses bras frais dans le soleil, et qu’ils n’auraient d’abord point reconnue. Voici qu’ils aiment la maison que j’ai inventée selon mon désir. Et à travers elle, moi, l’architecte. Comme celui-là qui aime une statue n’aime ni l’argile ni la brique ni le bronze, mais la démarche du sculpteur. Et je les accroche à leur demeure, ceux de mon peuple, afin qu’ils sachent la reconnaître. Et ils ne la reconnaîtront qu’après qu’ils l’auront nourrie de leur sang. Et parée de leurs sacrifices. Elle exigera d’eux jusqu’à leur sang, jusqu’à leur chair, car elle sera leur propre signification. Alors ils ne la pourront méconnaître, cette structure divine en forme de visage. Alors ils éprouveront pour elle l’amour. Et leurs soirées seront ferventes. Et les pères, quand leurs fils ouvriront les yeux et les oreilles, s’occuperont d’abord de la leur découvrir, afin qu’elle ne se noie point dans le disparate des choses.
Et si j’ai su bâtir ma demeure assez vaste pour donner un sens jusqu’aux étoiles, alors s’ils se hasardent la nuit sur leur seuil et qu’ils lèvent la tête, ils rendront grâce à Dieu de mener si bien ces navires. Et si je la bâtis assez durable pour qu’elle contienne la vie dans sa durée, alors ils iront de fête en fête comme de vestibule en vestibule, sachant où ils vont, et découvrant, au travers de la vie diverse, le visage de Dieu.
Citadelle ! Je t’ai donc bâtie comme un navire. Je t’ai clouée, gréée, puis lâchée dans le temps qui n’est plus qu’un vent favorable.
Navire des hommes, sans lequel ils manqueraient l’éternité !
Mais je les connais, les menaces qui pèsent contre mon navire. Toujours tourmenté par la mer obscure du dehors. Et par les autres images possibles. Car il est toujours possible de jeter bas le temple et d’en prélever les pierres pour un autre temple. Et l’autre n’est ni plus vrai, ni plus faux, ni plus juste, ni plus injuste. Et nul ne connaîtra le désastre, car la qualité du silence ne s’est pas inscrite dans le tas de pierres.
C’est pourquoi je désire qu’ils épaulent solidement les maîtres couples du navire. Afin de les sauver de génération en génération, car je n’embellirai point un temple si je le recommence à chaque instant.
V
C’est pourquoi je désire qu’ils épaulent solidement les maîtres couples du navire. Construction d’hommes. Car autour du navire il y a la nature aveugle, informulée encore et puissante. Et celui-là risque d’être exagérément en repos qui oublie la puissance de la mer.
Ils croient absolue en elle-même la demeure qui leur fut donnée. Tant l’évidence devient, une fois montrée. Quand on habite le navire, on ne voit plus la mer. Ou, si l’on aperçoit la mer, elle n’est plus qu’ornement du navire. Tel est le pouvoir de l’esprit. La mer lui parut faite pour porter le navire.
Mais il se trompe. Tel sculpteur à travers la pierre leur a montré tel visage. Mais l’autre eût montré un autre visage. Et tu l’as vu toi-même des constellations : celle-là est un cygne. Mais l’autre eût pu t’y montrer une femme couchée. Il vient trop tard. Nous ne nous évaderons jamais plus du cygne. Le cygne inventé nous a saisis.
Mais de le croire par erreur absolu on ne songe plus à le protéger. Et je sais bien par où il me menace, l’insensé. Et le jongleur. Celui qui modèle des visages avec la facilité de ses doigts. Ceux qui voient jouer perdent le sens de leur domaine. C’est pourquoi je le fais saisir et écarteler. Mais certes ce n’est point à cause de mes juristes qui me démontrent qu’il a tort. Car il n’a point tort. Mais il n’a pas raison non plus, et je lui refuse en revanche de se croire plus intelligent, plus juste que mes juristes. Et c’est à tort qu’il croit qu’il a raison. Car il propose lui aussi comme absolu ses figures nouvelles éphémères et brillantes, nées de ses mains, mais auxquelles manquent le poids, le temps, la chaîne ancienne des religions. Sa structure n’est pas devenue encore. La mienne était. Et voilà pourquoi je condamne le jongleur et sauve ainsi mon peuple de pourrir.
Car celui qui n’y prête plus attention et ne sait plus qu’il habite un navire, celui-là par avance est comme démantelé et il verra bientôt sourdre la mer dont la vague lavera ses jeux imbéciles.
Car m’a été proposée cette image même de mon empire, une fois que nous fûmes en pleine mer dans le but d’un pèlerinage, quelques-uns de mon peuple et moi-même.
Ils se trouvaient donc enfermés à bord d’un vaisseau de haute mer. Quelquefois en silence je me promenais parmi eux. Accroupis autour des plateaux de nourriture, allaitant les enfants ou pris dans l’engrenage du chapelet de la prière, ils s’étaient faits habitants du navire. Le navire s’était fait demeure.