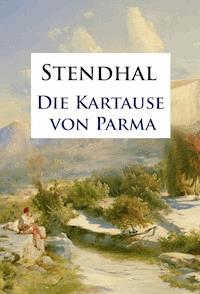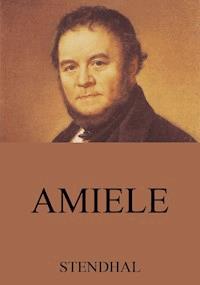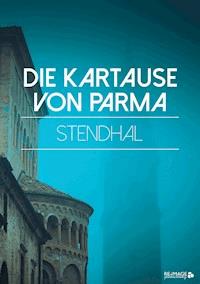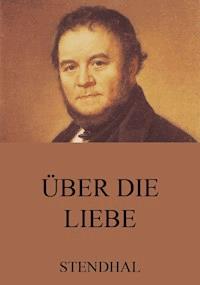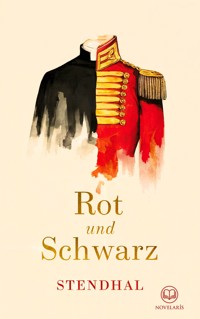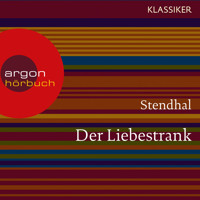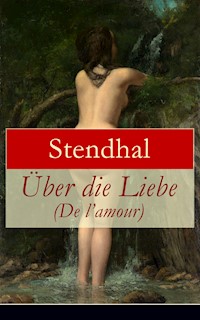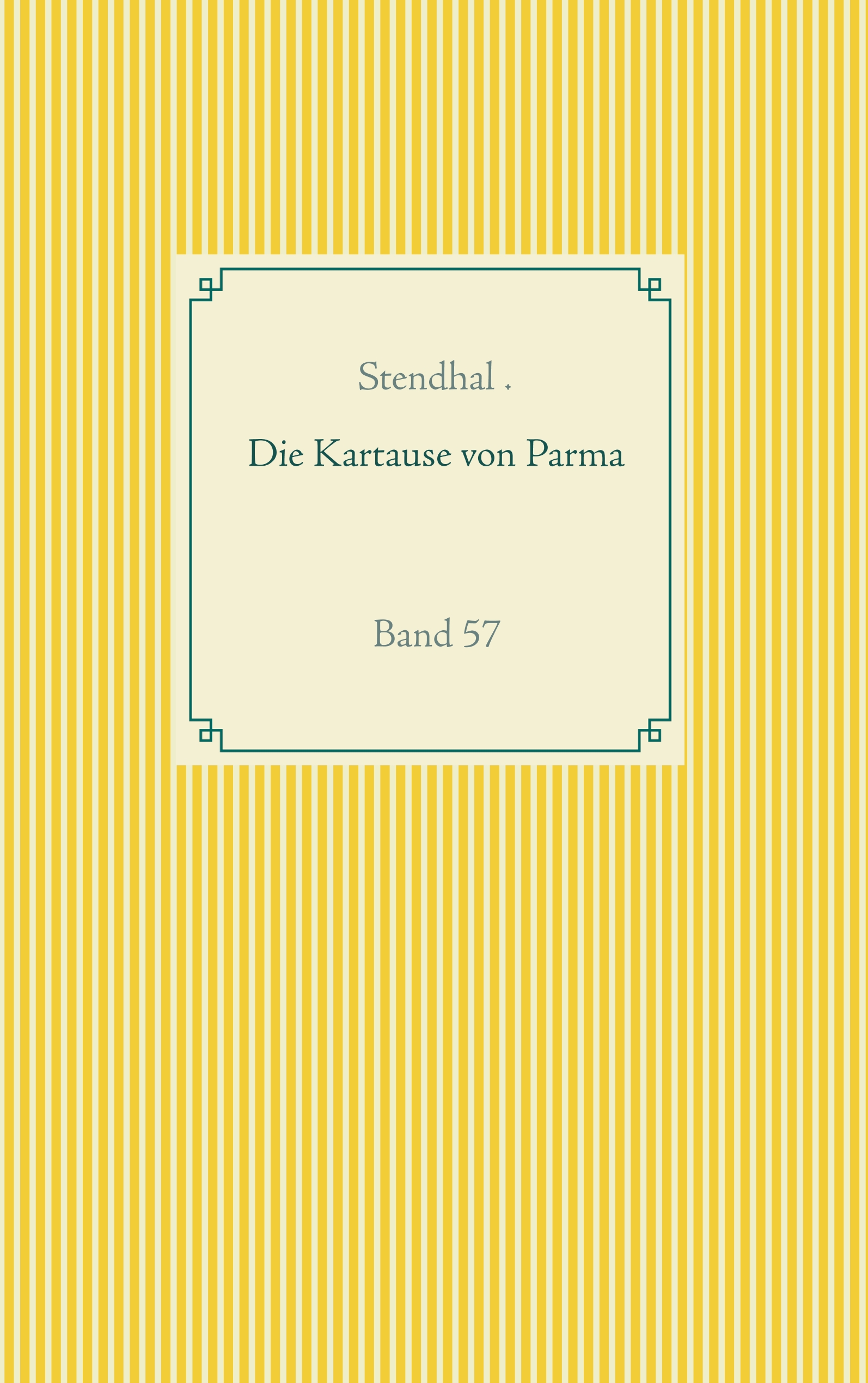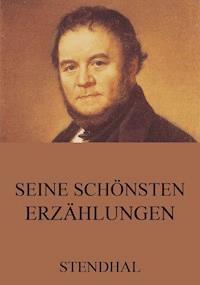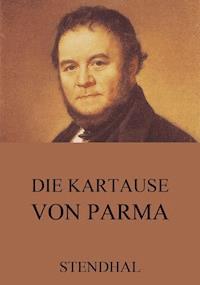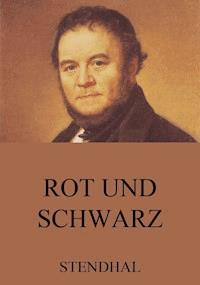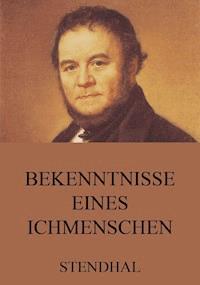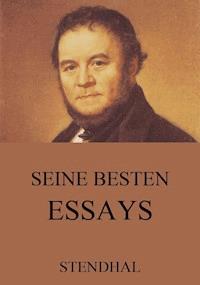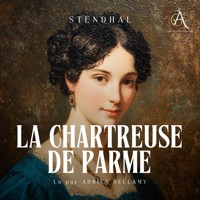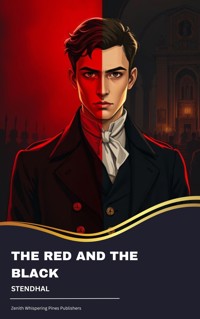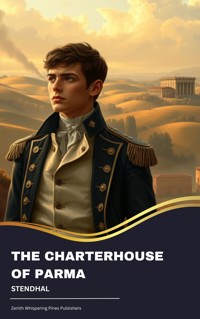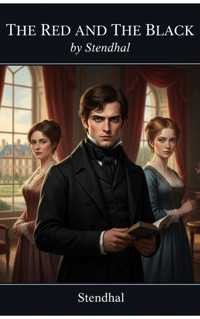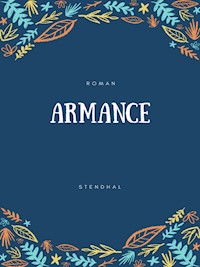
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Octave de Malivert sort de Polytechnique. Il est jeune, brillant, élégant mais son caractère étrange inquiète sa mère. Celle-ci l'invite à fréquenter le salon de mandame de Malivert pour le sortir de son isolement. Il y retrouve sa cousine, Armance de Zohiloff. Mais si la «loi d'indemnité» qui vient d'être votée pour indemniser les nobles s'estimant spoliés par la révolution fait d'Octave un parti intéressant, Armance semble rester insensible aux attraits du jeune homme. Octave réalise qu'il est amoureux d'Armance, malgré sa volonté et le serment qu'il s'est fait de ne jamais aimer. Derrière ce comportement étange, il y a le mal d'Octave, condamné au seul amour platonique...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Armance
ArmancePréface de l’éditeurAvant-proposChapitre IChapitre IIChapitre IIIChapitre IVChapitre VChapitre VIChapitre VIIChapitre VIIIChapitre IXChapitre XChapitre XIChapitre XIIChapitre XIIIChapitre XIVChapitre XVChapitre XVIChapitre XVIIChapitre XVIIIChapitre XIXChapitre XXChapitre XXIChapitre XXIIChapitre XXIIIChapitre XXIVChapitre XXVChapitre XXVIChapitre XXVIIChapitre XXVIIIChapitre XXIXChapitre XXXChapitre XXXIPage de copyrightArmance
Stendhal
Jamais livre n’eut plus besoin de préface. On ne le comprend pas sans explication. L’auteur y parle sans cesse d’un secret qu’il ne révèle jamais, afin de raconter honnêtement une histoire assez scabreuse. Il se félicitait de sa décence, mais il l’exagéra à tel point qu’elle apparaît comme une sorte de défaut dans une œuvre par ailleurs pleine d’intérêt. Amusante erreur qu’il faut bien relever une fois de plus : ce Stendhal que les Manuels représentent comme un cynique effronté, pèche ici encore par excès de pudeur.
Il est vrai qu’en 1827 on imprimait un peu moins crûment qu’aujourd’hui, ce qui avait rapport à certains détails physiologiques. Ce n’est exactement qu’un siècle après la publication d’Armance que son thème initial, sous un titre fort clair emprunté à Térence et à La Fontaine, fit les beaux jours d’une scène parisienne : le drame était travesti en bouffonnerie, et le dialogue d’une telle transparence que pas un spectateur ne pouvait ignorer la disgrâce d’un mari voué auprès de son épouse à l’abstention la plus obligée.
Qu’eût dit Henri Beyle, lorsque dans ses rêveries de jeunesse, il se voyait à Paris écrivant des comédies comme Molière, si quelqu’un fût venu lui proposer ce sujet même qu’il devait plus tard aborder dans son premier roman ? Sans doute eût-il répondu qu’il ne voyait point la matière à quelque étude de mœurs ou de caractère comme celles qu’il goûtait dans le Misanthrope ou dans les Précieuses. En revanche, à quarante-deux ans, devenu homme de lettres parce que la chute de Napoléon lui faisait des loisirs, il détesta moins jouer la difficulté. Il savait par surcroît que le roman, genre le plus libre qui soit et où toutes les préparations sont permises, peut souffrir des audaces partout ailleurs trop périlleuses. Il lui fallait néanmoins prendre toutes sortes de précautions pour traiter sous le règne vertueux de Charles X ce qu’il nommait lui-même dans sa Correspondance : « la plus grande des impossibilités de l’amour. »
Sa résolution n’était pas sans hardiesse. Il n’avait cependant pas, en la prenant, le mérite de la nouveauté.
*
* *
La duchesse de Duras venait de publier deux petits ouvrages dont on avait beaucoup parlé : Ourika en 1824, et Édouard en 1825. « Elle semblait, selon Sainte-Beuve même, avoir pris à tâche de mettre en scène toutes les impossibilités sociales : l’union d’une négresse avec un jeune homme de bonne famille, le mariage d’un roturier avec une grande dame. On alla même jusqu’à lui attribuer une troisième impossibilité. » Elle avait écrit en effet une autre nouvelle intitulée Olivier ou le Secret. Comme elle le disait à une amie « C’est un défi, un sujet qu’on prétendait ne pouvoir être traité. » On y voyait, affirmait-on, Olivier, pour cause d’insuffisance physique, s’éloigner de la femme dont il était épris.
Sans doute, Madame de Duras avait-elle emprunté son titre, M. Pierre Martino nous l’apprend, à un roman de Caroline Pichler, traduit librement de l’allemand en 1823 par Mme de Montolieu. Olivier de Hautefort, défiguré par la petite vérole, s’attirait, de la part de la jeune fille qu’il aimait, cette cruelle réplique : « Rendez-vous justice, Monsieur, pouvez-vous jamais inspirer l’amour ? » Cette phrase, répétée sur le frontispice de l’ouvrage, aurait aussi bien pu, détournée légèrement de son sens, servir d’épigraphe au livre de la duchesse, comme ensuite à celui de Stendhal.
Mme de Duras n’imprima jamais cette nouvelle, mais elle l’avait lue à quelques amis. Des indiscrétions en firent durant une saison la fable des milieux littéraires et mondains, à tel point que H. de la Touche en conçut l’idée d’une fort piquante mystification.
Hyacinthe Thabaud de la Touche n’est guère connu aujourd’hui que pour avoir établi la première édition d’André Chénier et pour avoir peut-être inspiré ses plus beaux vers à la plaintive Desbordes-Valmore. Il passait alors pour un conteur des plus distingués et pour un redoutable causeur.
Il se hâta de bâtir un petit roman sur la donnée spécieuse de Mme de Duras et il l’intitula tout naturellement Olivier. Le livre parut dans les derniers jours de 1825 ou au début de 1826. Le Journal de Librairie l’annonçait le 28 janvier 1826, mais le Mercure du XIXe siècle, dans son dernier numéro de 1825, le présentait déjà par une note telle qu’on put croire que c’était là le nouvel ouvrage, fameux avant même que d’avoir vu le jour, et dont les salons s’inquiétaient tant. Comme Ourika et comme Édouard, le roman de La Touche ne portait pas de nom d’auteur. Il avait en outre le même éditeur, la même présentation, le même format ; il arborait, à leur imitation, une épigraphe empruntée à la littérature étrangère et l’annonce que sa publication était faite au profit d’un établissement de charité.
Tant de soins égarèrent les lecteurs dans le sens voulu par l’adroit faussaire. Le scandale fut énorme. Mais bientôt, soupçonné à bon droit de la supercherie, La Touche dut publier dans la presse une lettre où il affirmait sur l’honneur qu’Olivier n’était point de lui mais qu’il en connaissait l’auteur, et que ce n’était pas celui d’Édouard et d’Ourika.
Stendhal qui fréquentait assidûment les salons littéraires, avait dû fort se réjouir de cette petite comédie. Dès le 18 janvier 1826, il envoie au New-Monthly Magazine un article dans lequel il rend copieusement compte d’Olivier comme d’une œuvre fort originale, et il feint de l’attribuer à la duchesse de Duras.
Ce fut alors qu’il résolut sans aucun doute d’entrer en personne dans le jeu et de publier une aventure analogue en affectant lui aussi de laisser croire à l’œuvre d’une femme. Il projetait même d’appeler son livre Olivier, d’autant plus que c’était, disait-il, faire « exposition et exposition non indécente. Si je mettais Edmond ou Paul, beaucoup de gens ne devineraient pas. »
Au moment où il écrivait, la précaution pouvait en effet paraître assez claire et suffisante aux yeux de quelques initiés. Mais plus tard, le principal personnage s’étant appelé Octave, une explication, devenue aujourd’hui indispensable, manqua du coup, même aux contemporains.
*
* *
Croira-t-on cependant que l’idée seule de reprendre une gageure, de prolonger une plaisanterie, ait suffi pour faire choisir à Henri Beyle le canevas dangereux de Mme de Duras et de La Touche ? En réalité, il ne détestait pas de faire allusion au délicat problème posé par ses devanciers. Il avait consacré déjà tout un chapitre de l’Amour à l’explication de ces histoires tragiques qui, d’après Mme de Sévigné, remplissent l’empire amoureux. Et il a rapporté dans ses Souvenirs d’Égotisme comment il fut lui-même victime de certaines défaillances passagères qui le firent ranger par quelques-uns dans cette caste infortunée à laquelle appartient le héros d’Armance. Injure dont, hâtons-nous de l’ajouter, des témoins non suspects l’ont depuis lors complètement lavé.
Quoi qu’il en soit, c’est en toute connaissance de cause que Beyle entreprit d’exposer la crise passionnelle d’un babilan. (Babilan est un mot d’origine italienne, emprunté au Président de Brosses et au Voyage en Italie de Lalande, et que l’on a proposé de traduire ainsi « Amoureux platonique par décret de la nature. »)
Dans le roman de Stendhal, Octave est donc un babilan, et ce qui semble à première vue paradoxal : un babilan amoureux. Jeune homme assez bizarre au demeurant et dont les singularités augmentent du jour où il aime sa cousine Armance. Il n’avoue son amour que parce que, blessé en duel, il se croit aux portes du tombeau. Guéri contre toute espérance, il essaie de rattraper son aveu. Mais Armance paraissant compromise, il l’épouse et se tue peu de jours après son mariage.
L’auteur n’a pas voulu seulement tenter dans ce livre l’analyse d’un caractère difficile, il a entendu peindre du même coup les mœurs de son temps. Ce fut toujours son ambition. Et, pour exceptionnels que soient des êtres comme Julien Sorel, Lucien Leuwen, Fabrice del Dongo, ou comme Lamiel, on peut dire qu’il ne les considère jamais qu’en fonction de leur époque. M. Raymond Lebègue, dans la sagace introduction d’Armance qu’il écrivit pour l’édition Champion, fait remarquer très justement que dans les articles adressés par Beyle au London Magazine, en 1825, et au New Monthly Magazine en 1825, il se préoccupait déjà beaucoup de l’état de la société parisienne. Les jeunes gens y sont tristes, disait-il, les femmes inoccupées se jettent dans le mysticisme et la philosophie, « la haute société française est actuellement le repaire favori de l’ennui… ». Or ce sont bien là les idées que Stendhal ne fera que reprendre et développer quand il songera dans Armance à donner un tableau des salons de la Restauration.
En outre il peignit plusieurs portraits individuels d’après nature : « J’ai copié Armance, écrira-t-il, d’après la dame de compagnie de la maîtresse de M. de Strogonoff qui, l’an passé, était toujours aux Bouffes. » Voilà pour le physique tout au moins. Pour l’âme pudique de cette suave jeune fille, il faut peut-être retrouver en elle quelque nouvelle copie de cette fière Métilde qui avait inspiré déjà les plus frappants exemples de l’Amour. Mme d’Aumale (nous l’apprenons encore par une lettre de Stendhal à Mérimée sans laquelle l’histoire d’Armance serait pleine de lacunes) est en quelque sorte une image de cette grande dame qui fut l’amie de Chateaubriand et qui fit tourner un moment la tête de Balzac : la duchesse de Castries, mais faite sage. Enfin Mme de Bonnivet a bien des chances d’être un portrait composite de la duchesse de Broglie, de Mme Swetchine et de Mme de Krudener. Plus tard l’auteur se servira des mêmes traits un peu fardés pour dessiner Mme de Fervaques dans le Rouge et le Noir.
Quant à la description du grand monde, qui sert de fond à tout le roman, Beyle la brossa en grande partie d’imagination. Il fréquentait les principaux salons littéraires, mais non point ces salons de la haute société qu’il entendait représenter et qu’il ne connaissait que par reflet. Aussi ses peintures furent-elles très critiquées quand le livre parut. Aujourd’hui on peut les juger comme ces toiles qui ne passent point pour ressemblantes quand vivent les modèles, mais qui, à mesure que le temps fait son œuvre, prennent rang parmi les documents utiles et acquièrent en fin de compte une autorité qu’on ne leur conteste plus.
Le livre de Stendhal est surtout plein de souvenirs. Beaucoup de noms de personnages y sont empruntés à ces villages dauphinois que Beyle entendait nommer dans son enfance ou à ces environs de Paris qui lui rappelaient des souvenirs agréables. Les souffrances d’Armance et les désespoirs d’Octave sont retracés, toujours au témoignage de l’auteur, d’après sa propre expérience quand se rompit sa liaison avec la comtesse Curial.
Pour une grande part il donne son caractère au héros comme il le donnera successivement, il est banal de le répéter, à tous ceux de ses autres romans. Rappelons ce qu’il dit d’Octave de Malivert : « Il dédaigne de se présenter dans un salon avec sa mémoire, et son esprit dépend des sentiments qu’on fait naître en lui. » Nous retrouvons précisément là cet Henri Beyle tel qu’il apparaît à travers tous ses ouvrages autobiographiques, tel qu’il est campé encore dans les Souvenirs de Delécluze ou dans le petit livre de Mme Ancelot sur les salons de Paris.
N’oublions pas davantage qu’Octave et Beyle ont les mêmes idées libérales qu’Octave est polytechnicien, comme Beyle faillit l’être ; enfin qu’il adore sa mère et n’aime pas son père.
Outre ces premiers traits pris en soi-même, Stendhal complète le portrait d’Octave suivant la mode du temps ; il le dessine à la ressemblance de lord Byron. Rêveur, sombre, fatal, ce jeune homme a les mêmes violences de caractère et les mêmes sautes d’humeur qu’un Manfred ou qu’un Lara. Gardons-nous cependant de ne voir en lui qu’un enfant du siècle, un de ces jeunes romantiques à tout crin victimes d’une attitude qu’ils ont imprudemment fabriquée. Octave de Malivert est tout autre chose. Nous savons à quoi nous en tenir puisque nous avons dévoilé son sort malheureux. Mais quand, au cours du roman il laisse plus d’une fois entendre à sa cousine qu’il est un monstre et qu’il lui doit l’aveu d’un secret affreux, Armance à qui personne n’a dit le mot, ne comprend absolument pas : le lecteur non prévenu fait comme elle.
Octave est un fou, un enragé suivant l’expression même de l’auteur. Il y a de telles gens par le monde et il était légitime d’en mettre un en scène. Si quelque chose nous choque en lui, ce n’est pas qu’il soit si fantasque, c’est que nous n’apercevions pas nettement la nature de son déséquilibre. Nous serions en droit d’exiger qu’on nous dît de quel mal, à la fois si violemment affiché et si profondément caché, souffre ce personnage. Est-ce un simple nerveux, un écorché à vif, ou un psychasthénique avancé ? Quelle est sa tare morale, ou son crime ? Toutes les hypothèses sont plausibles et nous pourrions errer longtemps si d’une part nous ne connaissions les origines du roman, et si d’autre part nous n’étions aujourd’hui en possession de la fameuse lettre à Mérimée du 23 décembre 1826, à laquelle nous avons déjà fait allusion. Beyle avait confié son manuscrit à son ami. Sans doute en reçut-il diverses objections, et il les discute dans cette lettre essentielle qui éclaire entièrement la matière. Malheureusement sa longueur, sa crudité d’expression nous interdisent de la reproduire ici. Du moins, nous apprend-elle de manière irréfutable l’infirmité d’Octave et nous n’avons plus qu’à nous demander si les répercussions de cette déficience sur son caractère ont été bien mises en valeur.
Fervent lecteur de Cabanis, Stendhal devait connaître depuis longtemps ce passage des Rapports du Physique et du Moral de l’Homme : « Dans les cas d’impuissance précoce, ainsi que dans certaines maladies, on remarque que toute l’existence en est singulièrement affectée. » Cabanis cite ensuite quelques exemples, et Stendhal de son côté a cherché, dans l’art et dans la vie, des prédécesseurs à Octave. Il lui en a trouvé plus d’un, au premier rang desquels le célèbre auteur de Gulliver, Swift, à qui Walter Scott avait consacré une importante étude qui ne fut certainement pas étrangère à Stendhal.
On a soutenu, et c’était l’opinion de Romain Colomb, qu’il était livresque d’imaginer un impuissant amoureux, et que son infirmité devait interdire à Octave de ressentir un sentiment qu’il était incapable de satisfaire. Ce raisonnement est contredit par les faits. Beyle le savait, et il ne craignit pas de donner à ses censeurs un démenti formel. Lui-même n’était pas babilan, nous l’avons avancé, mais il savait d’expérience personnelle que l’amour et le désir, ou tout au moins l’amour et l’assouvissement du désir, ne marchent pas toujours de pair. Cette dissociation lui était familière.
Le personnage d’Octave pour rare qu’il soit, existe dans la nature. Nous avons là-dessus des observations médicales nombreuses et, au-dessus de tout autre témoignage, celui de M. André Gide.
La physiologie d’Octave solidement établie, sa psychologie apparaît aussitôt logique et bien observée. L’idée d’aimer ne lui inspire que de l’horreur quand il songe qu’il ne peut ni se déclarer, ni conclure. Son bonheur n’a plus de limites au contraire quand, se croyant près de mourir, il s’abandonne à la joie de l’aveu sans craindre de devoir un jour dévoiler sa honte. Le voyons-nous fréquenter des maisons de joie, c’est qu’il veut à la fois douter de son infirmité et l’éprouver, c’est qu’il veut surtout donner le change à son entourage. Il aime mieux passer aux yeux de tous pour un débauché que se laisser deviner. Tout cela nous paraît, maintenant que nous connaissons la clef de son caractère, d’une parfaite évidence et d’une impeccable analyse.
Une note du 6 juin 1828, écrite de la main de Stendhal sur l’exemplaire qui a servi à établir l’édition Champion, demeure à ce propos d’un haut intérêt :
Le manque de mode fait que le vulgaire ne cristallise pas pour mon roman et, réellement, ne le sent pas. Tant pis pour le vulgaire. Quoique la mode les empêche de comprendre ce roman, qui n’a de ressemblance qu’avec des ouvrages très anciennement à la mode, tels que la Princesse de Clèves, les romans de madame de Tencin, etc., quoi de plus simple que le plan ?
Le protagoniste est troublé et enragé, parce qu’il se sent impuissant, ce dont il s’est assuré en allant chez Madame Augusta avec ses amis, puis seul, etc. Son malheur lui ôte la raison précisément dans les moments où il est à même de voir de plus près les grâces féminines.
Deux millions lui arrivent.
1° Il se voit méprisé de la seule personne à laquelle il parle de tout avec sincérité.
2° Il cherche à regagner cette estime. Cette circonstance est absolument nécessaire pour qu’il puisse prendre de l’amour et en inspirer sans s’en douter. Condition sine qua non puisqu’il est honnête homme, et que je n’en fais pas un sot.
3° Une circonstance lui apprend qu’il aime. Et de plus, j’ai fait cette circonstance gentille c’est l’action de l’aimable et folle comtesse d’Aumale.
4° Il veut parler.
5° Un duel et des blessures l’en empêchent.
6° Se croyant prêt à mourir, il avoue son amour.
7° Le hasard le sert, sa maîtresse lui fait donner sa parole de ne jamais la demander en mariage.
8° Elle se compromet pour lui de façon à être déshonorée s’il ne l’épouse pas.
9° Il se détermine à lui avouer qu’il a un défaut physique comme Louis XVIII, M. de Maurepas, M. de la Tournelle.
10° Il est détourné de ce devoir par une lettre.
11° Il épouse et se tue.
J’avoue que ce plan me semble irréprochable.
Comment ne pas donner raison à Stendhal ? En possession du secret d’Octave rien ne nous semble plus naturel et mieux agencé que ce continuel marivaudage entre Armance et lui. Les retours incessants, les balancements de leur passion illustrent à merveille les phases diverses de la cristallisation, que coupe le travail destructeur du doute mais qui renaît à chaque fois plus consciente, plus irrésistible.
*
* *
Stendhal, nous l’avons vu, songea à écrire Armance en janvier 1826 après avoir lu le roman de La Touche : Olivier.
Il en commença la rédaction le 30 ou le 31, et il la poussa fort activement jusqu’au 8 février. À ce jour, le premier jet en étant à peu près terminé, il s’arrêta brusquement sans que nous sachions au juste pour quelle cause, et si son impuissance à travailler lui vient des difficultés de son sujet ou de ses chagrins intimes.
Car cette même année voyait la fin de ses amours avec la comtesse Curial qu’il appelle d’ordinaire Menti. Il était en froid avec elle depuis octobre 1825 déjà. Le désaccord ne fit ensuite que s’accentuer. Il est même fort croyable que Stendhal n’entreprit, de fin juin à septembre 1826, son troisième voyage en Angleterre que pour trouver dans l’éloignement un palliatif à une situation qui chaque jour empirait. Néanmoins la rupture définitive lui fut signifiée peu après son retour. Le 15 septembre marque le point culminant de la crise sentimentale de Beyle. Alors, complètement désespéré, il songe au pistolet. Il lui faut un dérivatif, une puissante distraction : dès le 19 septembre il reprend Armance et se sauve à force de travail. Le 10 octobre il a terminé son livre ; il n’aura plus ensuite qu’à le polir.
Soulignons en passant la rapidité que Stendhal met toujours à composer ses œuvres d’imagination il les écrit ou les dicte à bride abattue. Du 31 janvier au 8 février : neuf jours. Du 19 septembre au 10 octobre : vingt-deux jours. Il ne lui en faut pas davantage pour mettre son roman sur pied. Encore semble-t-il à qui parcourt ses notes que durant la première période il jette sur le papier une fiévreuse rédaction plus ou moins achevée au moment où il l’abandonne, et que durant la seconde période il se remet à une nouvelle et définitive version.
De toute façon le 15 octobre il commence à revoir son manuscrit pour le style, mais il y ajoute désormais fort peu. Lui-même s’étonne du petit nombre de corrections qu’il y apporte en quatre ou cinq mois. Du moins dut-il soigneusement en surveiller la langue, et c’est certainement dans ce livre qu’elle est le plus châtiée. Plus tard, se relisant, il approuvera fréquemment la tournure choisie et la concision de sa pensée.
Paul-Jean Toulet a fait remarquer combien, en dépit d’un lui répété, la dernière phrase demeure belle, émouvante même, comme tout le paragraphe qui termine Armance : « Et à minuit, le 3 mars, comme la lune se levait derrière le mont Kalos, un mélange d’opium et de digitale préparé par lui, délivra doucement Octave de cette vie qui avait été pour lui si agitée. »
*
* *
Beyle dut composer cette œuvre au numéro 10 de la rue Richepanse où il logea toute l’année 1826. L’année suivante, après quelques mois de séjour au numéro 6 de la rue Le Peletier, il occupait rue d’Amboise une belle chambre qui donnait sur la rue Richelieu quand l’éditeur Canel lui paya mille francs le droit de publier Armance. Cette somme lui permit de partir bientôt pour l’Italie. Auparavant il s’occupa de la correction de ses épreuves dont il revoyait environ deux feuilles par semaine. Sans doute jetait-il aussi un dernier regard sur son manuscrit, car il ne fournissait sa copie qu’au fur et à mesure des besoins de l’impression. Toujours est-il que le 17 juillet il avait terminé la correction du second tome et il envoyait à l’éditeur les quelques pages signées du nom de Stendhal qui devaient servir d’introduction à l’ouvrage anonyme. Il y attribuait son roman à une femme d’esprit dont il n’aurait pour sa part que corrigé le style. Trois jours plus tard il quittait Paris.
Armance, qui parut en trois tomes et sans nom d’auteur, chez Urbain Canel, 9, rue Saint-Germain-des-Prés, fut annoncée le 18 août dans le Journal de la Librairie.
Mérimée avait rendu à Stendhal le service de chercher les épigraphes du livre, et il avait réussi à en pourvoir presque tous les chapitres. Mais il conseilla en vain à son ami de signer son roman pour ne pas sembler en avoir honte ni donner à entendre qu’il était mauvais. Il obtint seulement que le héros fut débaptisé : Olivier lui semblait avec raison un peu suranné. Ce nom fut donc changé contre celui d’Octave et l’ouvrage s’appela désormais Armance. Stendhal avait d’abord projeté d’adjoindre au titre cette mention Anecdotes du XIXe siècle. Mérimée de son côté proposait d’ajouter un mot qui laisserait entendre que le roman était en quelque sorte une illustration des deux volumes publiés antérieurement sur l’amour. Mais c’est Urbain Canel qui trouva le sous-titre définitif : Quelques scènes d’un salon de Paris en 1827, qu’il jugeait meilleur pour la vente.
Armance fut accueillie très froidement. On n’en comprit pas l’énigme et la peinture des milieux choqua toute la société parisienne. Madame de Broglie, s’étant plus ou moins reconnue, déclara que l’auteur était un homme de mauvais ton. Lamartine aurait été désappointé par le style : Stendhal lui-même nous en fait part. Sans doute le poète des Méditations fit-il entendre à son confrère sa libre opinion au cours des entretiens qu’ils eurent à Florence à la fin de 1827. Les intimes de l’auteur ne furent pas les moins sévères, au point qu’il affirmait un jour en parlant de son roman : « Tous mes amis le trouvent détestable ; moi, je les trouve grossiers. »
La presse garda un silence à peu près complet. Quatre ou cinq journaux tout au plus parlèrent de ce livre. Et si la Pandore et la Revue Encyclopédique lui furent assez indulgentes, le Globe ne le ménagea guère. Il lui consacra plusieurs colonnes anonymes mais dues, paraît-il, à la plume de Vitet. Stendhal y était accusé d’avoir pris ses personnages à Charenton. Cette même épigramme se retrouvait dans le Nouveau Journal de Paris et des Départements où l’écrivain qui signait P. relevait avec acrimonie les scènes extravagantes qui se passent dans un salon de Paris : « Je veux bien convenir que l’auteur quel qu’il soit a écouté aux portes, mais c’était assurément à celles de Charenton. » (Cité par Daniel Müller dans Le Divan, décembre 1925.)
Plus tard Sainte-Beuve ne fut pas beaucoup plus tendre : « Ce roman, énigmatique par le fond, dit-il, et sans vérité dans le détail, n’annonçait nulle invention et nul génie. » Mais Sainte-Beuve fut d’ailleurs aussi injuste pour le Rouge et La Chartreuse. Il est plus comique de voir Monselet se donner le luxe, onze ans après la mort de Beyle, de préfacer une nouvelle édition d’Armance qu’il compare à « un coco d’Amérique creusé avec un mauvais couteau ». Du moins y veut-il bien reconnaître « l’éclair soudain dans l’observation ».
La critique et les amis de Stendhal ne furent pas les seuls à bouder. La vente fut des plus médiocres. Aussi quand en août 1828 une seconde édition fut annoncée chez Auguste Boulant, 10, quai des Augustins, se contenta-t-on de brocher avec une nouvelle couverture et de nouveaux titres, faux-titres et titres de départ, les exemplaires restants de la première édition qui avait été tirée à 800 ou 1.000 exemplaires. On en profita pour supprimer partout la mention en 1827 et pour inscrire en revanche au-dessous du titre le nom de lettres de l’auteur : Stendhal.
Beyle, dans une lettre datée de Florence le 19 novembre 1827, avait demandé à son cousin Romain Colomb de faire relier quelques exemplaires d’Armance avec une feuille blanche entre chaque feuillet imprimé. Un de ces exemplaires interfoliés, couvert de nombreuses notes manuscrites, devint à sa mort, avec toute sa bibliothèque de Civita-Vecchia, la propriété de son ami Donato Bucci. Il a servi pour établir le texte de l’édition Champion où Monsieur Lebègue a incorporé les additions et corrections relevées. À mon avis, à part quelques rares changements heureux, ces corrections dans leur ensemble abîment et alourdissent presque toujours le premier texte. Stendhal les eût-il maintenues ? Rien de moins certain. Aussi fidèle au plan primitif de ces petits livres, je n’ai fait état de ces retouches ou des variantes de l’édition Lévy que lorsqu’elles réparent une erreur évidente ou quelques fautes d’impression de l’édition originale que j’ai suivie presque continuellement ici.
Le lecteur y trouvera des malheurs d’Armance et d’Octave une version plus simple et moins ampoulée que celle qui tiendrait compte de toutes les surcharges un peu tumultueuses dont l’auteur plus tard a noirci les marges de son œuvre primitive. Exactement à cent ans de distance il paraît bien préférable de redonner dans toute sa fraîcheur et dans son équilibre primitif ce petit roman tel qu’il fut établi par les soins de Stendhal et tel qu’il parut pour la première fois à l’ombre du clocher de Saint-Germain-des-Prés.
Henri MARTINEAU.
Avant-propos
Une femme d’esprit, qui n’a pas des idées bien arrêtées sur les mérites littéraires, m’a prié, moi indigne, de corriger le style de ce roman. Je suis loin d’adopter certains sentiments politiques qui semblent mêlés à la narration ; voilà ce que j’avais besoin de dire au lecteur. L’aimable auteur et moi nous pensons d’une manière opposée sur bien des choses, mais nous avons également en horreur ce qu’on appelle des applications. On fait à Londres des romans très-piquants : Vivian Grey, Almak’s, High Life, Matilda, etc., qui ont besoin d’une clé. Ce sont des caricatures fort plaisantes contre des personnes que les hasards de la naissance ou de la fortune ont placées dans une position qu’on envie.
Voilà un genre de mérite littéraire dont nous ne voulons point. L’auteur n’est pas entré, depuis 1814 au premier étage du palais des Tuileries ; il a tant d’orgueil, qu’il ne connaît pas même de nom les personnes qui se font sans doute remarquer dans un certain monde.
Mais il a mis en scène des industriels et des privilégiés, dont il a fait la satire. Si l’on demandait des nouvelles du jardin des Tuileries aux tourterelles qui soupirent au faîte des grands arbres, elles diraient : « C’est une immense plaine de verdure où l’on jouit de la plus vive clarté. » Nous, promeneurs, nous répondrions : « C’est une promenade délicieuse et sombre où l’on est à l’abri de la chaleur et surtout du grand jour désolant en été. »
C’est ainsi que la même chose, chacun la juge d’après sa position ; c’est dans des termes aussi opposés que parlent de l’état actuel de la société des personnes également respectables qui veulent suivre des routes différentes pour nous conduire au bonheur. Mais chacun prête des ridicules au parti contraire.
Imputerez-vous à un tour méchant dans l’esprit de l’auteur les descriptions malveillantes et fausses que chaque parti fait des salons du parti opposé ? Exigerez-vous que des personnages passionnés soient de sages philosophes, c’est-à-dire n’aient point de passions ? En 1760 il fallait de la grâce, de l’esprit et pas beaucoup d’humeur, ni pas beaucoup d’honneur, comme disait le régent, pour gagner la faveur du maître et de la maîtresse.
Il faut de l’économie, du travail opiniâtre, de la solidité et l’absence de toute illusion dans une tête, pour tirer parti de la machine à vapeur. Telle est la différence entre le siècle qui finit en 1789 et celui qui commença vers 1815.
Napoléon chantonnait constamment en allant en Russie ces mots qu’il avait entendus si bien dits par Porto (dans la Molinara) :
Si batte nel mio cuore
L’inchiostro e la farina[1].
C’est ce que pourraient répéter bien des jeunes gens qui ont à la fois de la naissance et de l’esprit.
En parlant de notre siècle, nous nous trouvons avoir esquissé deux des caractères principaux de la Nouvelle suivante. Elle n’a peut-être pas vingt pages qui avoisinent le danger de paraître satiriques ; mais l’auteur suit une autre route ; mais le siècle est triste, il a de l’humeur, et il faut prendre ses précautions avec lui, même en publiant une brochure qui, je l’ai déjà dit à l’auteur, sera oubliée au plus tard dans six mois, comme les meilleures de son espèce.
En attendant, nous sollicitons un peu de l’indulgence que l’on a montrée aux auteurs de la comédie des Trois Quartiers. Ils ont présenté un miroir au public ; est-ce leur faute si des gens laids ont passé devant ce miroir ? De quel parti est un miroir ?
On trouvera dans le style de ce roman des façons de parler naïves, que je n’ai pas eu le courage de changer. Rien d’ennuyeux pour moi comme l’emphase germanique et romantique. L’auteur disait : « Une trop grande recherche des tournures nobles produit à la fin du respect et de la sécheresse ; elles font lire avec plaisir une page, mais ce précieux charmant fait fermer le livre au bout du chapitre, et nous voulons qu’on lise je ne sais combien de chapitres ; laissez-moi donc ma simplicité agreste ou bourgeoise. »
Notez que l’auteur serait au désespoir que je lui crusse un style bourgeois. Il y a de la fierté à l’infini dans ce cœur-là. Ce cœur appartient à une femme qui se croirait vieillie de dix ans si l’on savait son nom. D’ailleurs un tel sujet !…
STENDHAL.
Saint-Gigouf, le 23 juillet 1827.
[1] Faut-il être meunier, faut-il être notaire ?
Chapitre I
It is old and plain
It is silly sooth
And dallies with the innocence of love.
Twelfth Night, act. II.
À peine âgé de vingt ans, Octave venait de sortir de l’École Polytechnique*. Son père, le marquis de Malivert, souhaita retenir son fils unique à Paris. Une fois qu’Octave se fut assuré que tel était le désir constant d’un père qu’il respectait et de sa mère qu’il aimait avec une sorte de passion, il renonça au projet d’entrer dans l’artillerie. Il aurait voulu passer quelques années dans un régiment, et ensuite donner sa démission jusqu’à la première guerre qu’il lui était assez égal de faire comme lieutenant ou avec le grade de colonel. C’est un exemple des singularités qui le rendaient odieux aux hommes vulgaires.
Beaucoup d’esprit, une taille élevée, des manières nobles, de grands yeux noirs les plus beaux du monde auraient marqué la place d’Octave parmi les jeunes gens les plus distingués de la société, si quelque chose de sombre, empreint dans ces yeux si doux, n’eût porté à le plaindre plus qu’à l’envier. Il eût fait sensation s’il eût désiré parler ; mais Octave ne désirait rien, rien ne semblait lui causer ni peine ni plaisir. Fort souvent malade durant sa première jeunesse, depuis qu’il avait recouvré des forces et de la santé, on l’avait toujours vu se soumettre sans balancer à ce qui lui semblait prescrit par le devoir ; mais on eût dit que si le devoir n’avait pas élevé la voix, il n’y eût pas eu chez lui de motif pour agir. Peut-être quelque principe singulier, profondément empreint dans ce jeune cœur, et qui se trouvait en contradiction avec les événements de la vie réelle, tels qu’il les voyait se développer autour de lui, le portait-il à se peindre sous des images trop sombres, et sa vie à venir et ses rapports avec les hommes. Quelle que fût la cause de sa profonde mélancolie, Octave semblait misanthrope avant l’âge. Le commandeur de Soubirane, son oncle, dit un jour devant lui qu’il était effrayé de ce caractère.
– Pourquoi me montrerais-je autre que je ne suis ? répondit froidement Octave. Votre neveu sera toujours sur la ligne de la raison.
– Mais Jamais en deçà ni au delà, reprit le commandeur avec sa vivacité provençale ; d’où je conclus que si tu n’es pas le Messie attendu par les Hébreux, tu es Lucifer en personne, revenant exprès dans ce monde pour me mettre martel en tête. Que diable es-tu ? Je ne puis te comprendre ; tu es le devoir incarné.
– Que je serais heureux de n’y jamais manquer ! dit Octave ; que je voudrais pouvoir rendre mon âme pure au Créateur comme je l’ai reçue !
– Miracle ! s’écria le commandeur : voilà depuis un an, le premier désir que je vois exprimer par cette âme si pure qu’elle en est glacée !
Et fort content de sa phrase le commandeur quitta le salon en courant.
Octave regarda sa mère avec tendresse, elle savait si cette âme était glacée. On pouvait dire de Mme de Malivert qu’elle était restée jeune quoiqu’elle approchât de cinquante ans. Ce n’est pas seulement parce qu’elle était encore belle, mais avec l’esprit le plus singulier et le plus piquant, elle avait conservé une sympathie vive et obligeante pour les intérêts de ses amis, et même pour les malheurs et les joies des jeunes gens. Elle entrait naturellement dans leurs raisons d’espérer ou de craindre, et bientôt elle semblait espérer ou craindre elle-même. Ce caractère perd de sa grâce depuis que l’opinion semble l’imposer comme une convenance aux femmes d’un certain âge qui ne sont pas dévotes, mais jamais l’affectation n’approcha de Mme de Malivert.
Ses gens remarquaient depuis un certain temps qu’elle sortait en fiacre, et souvent, en rentrant, elle n’était pas seule. Saint-Jean, un vieux valet de chambre curieux, qui avait suivi ses maîtres dans l’émigration, voulut savoir quel était un homme que plusieurs fois Mme de Malivert avait amené chez elle. Le premier jour, Saint-Jean perdit l’inconnu dans une foule ; à la seconde tentative, la curiosité de cet homme eut plus de succès : il vit le personnage qu’il suivait entrer à l’hôpital de la Charité, et apprit du portier que cet inconnu était le célèbre docteur Duquerrel. Les gens de Mme de Malivert découvrirent que leur maîtresse amenait successivement chez elle les médecins les plus célèbres de Paris, et presque toujours elle trouvait l’occasion de leur faire voir son fils.
Frappée des singularités qu’elle observait chez Octave, elle redoutait pour lui une affection de poitrine. Mais elle pensait que si elle avait le malheur de deviner juste, nommer cette maladie cruelle, ce serait hâter ses progrès. Des médecins, gens d’esprit, dirent à Mme de Malivert que son fils n’avait d’autre maladie que cette sorte de tristesse mécontente et jugeante qui caractérise les jeunes gens de son époque et de son rang ; mais ils l’avertirent qu’elle-même devait donner les plus grands soins à sa poitrine. Cette nouvelle fatale fut divulguée dans la maison par un régime auquel il fallut se soumettre, et M. de Malivert, auquel on voulut en vain cacher le nom de la maladie, entrevit pour sa vieillesse la possibilité de l’isolement.
Fort étourdi et fort riche avant la révolution, le marquis de Malivert, qui n’avait revu la France qu’en 1814, à la suite du roi, se trouvait réduit, par les confiscations, à vingt ou trente mille livres de rente. Il se croyait à la mendicité. La seule occupation de cette tête qui n’avait jamais été bien forte, était maintenant de chercher à marier Octave. Mais encore plus fidèle à l’honneur qu’à l’idée fixe qui le tourmentait, le vieux marquis de Malivert ne manquait jamais de commencer par ces mots les ouvertures qu’il faisait dans la société : « Je puis offrir un beau nom, une généalogie certaine depuis la croisade de Louis le Jeune, et je ne connais à Paris que treize familles qui puissent marcher la tête levée à cet égard ; mais du reste je me vois réduit à la misère, à l’aumône, je suis un gueux. »
Cette manière de voir chez un homme âgé n’est pas faite pour produire cette résignation douce et philosophique qui est la gaieté de la vieillesse ; et sans les incartades du vieux commandeur de Soubirane, méridional un peu fou et assez méchant, la maison où vivait Octave eût marqué, par sa tristesse, même dans le faubourg Saint-Germain. Mme de Malivert, que rien ne pouvait distraire de ses inquiétudes sur la santé de son fils, pas même ses propres dangers, prit occasion de l’état languissant où elle se trouvait pour faire sa société habituelle de deux médecins célèbres. Elle voulut gagner leur amitié. Comme ces messieurs étaient l’un le chef, et l’autre l’un des plus fervents promoteurs de deux sectes rivales, leurs discussions, quoique sur un sujet si triste pour qui n’est pas animé par l’intérêt de la science et du problème à résoudre amusaient quelquefois Mme de Malivert, qui avait conservé un esprit vif et curieux. Elle les engageait à parler, et grâce à eux, au moins, de temps à autre quelqu’un élevait la voix dans le salon si noblement décoré, mais si sombre, de l’hôtel de Malivert.
Une tenture de velours vert, surchargée d’ornements dorés, semblait faite exprès pour absorber toute la lumière que pouvaient fournir deux immenses croisées garnies de glaces au lieu de vitres. Ces croisées donnaient sur un jardin solitaire divisé en compartiments bizarres par des bordures de buis. Une rangée de tilleuls taillés régulièrement trois fois par an, en garnissait le fond, et leurs formes immobiles semblaient une image vivante de la vie morale de cette famille. La chambre du jeune vicomte, pratiquée au-dessus du salon et sacrifiée à la beauté de cette pièce essentielle, avait à peine la hauteur d’un entre-sol. Cette chambre était l’horreur d’Octave, et vingt fois, devant ses parents, il en avait fait l’éloge. Il craignait que quelque exclamation involontaire ne vînt le trahir et montrer combien cette chambre et toute la maison lui étaient insupportables.