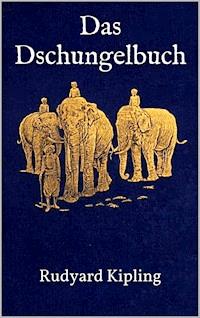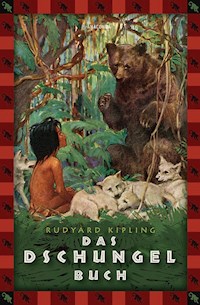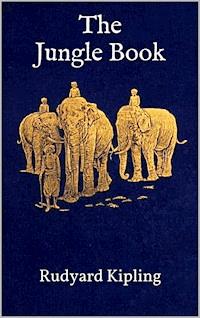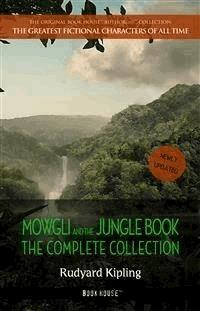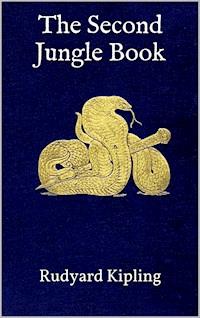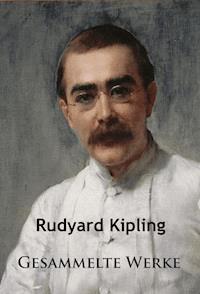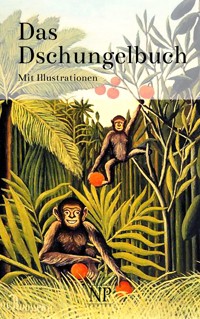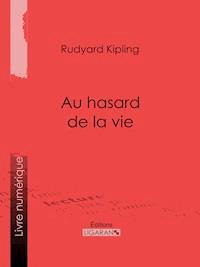
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Extrait: "Si vous admettez qu'on n'a pas le droit d'entrer dans son salon au début de la matinée, quand la femme de chambre est en train de mettre les choses en place et d'enlever la poussière, vous admettrez aussi que les gens civilisés qui mangent dans la porcelaine et sont munis de carnets de visites n'ont pas le droit d'appliquer leur table des valeurs à un pays non encore installé..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dans le nord de l’Inde il y avait un monastère appelé la Chubara de Dhunni Bhagat. Personne ne se rappelait rien concernant ce Dhunni Bhagat. Il avait passé sa vie à gagner un peu d’argent et l’avait entièrement dépensé, comme tout bon Hindou devrait faire, à une œuvre pie : la Chubara. Ce monastère était plein de cellules de brique, où s’étalaient en couleurs claires des images de dieux, de rois et d’éléphants, et où des prêtres épuisés par les macérations restaient à méditer sur les fins dernières des choses ; les allées étaient pavées de briques, et les pieds nus des milliers de pèlerins y avaient creusé des sillons. Des touffes de manguiers avaient surgi d’entre les briques, de grands pipals ombrageaient le treuil du puits qui grinçait tout le long du jour, et des hordes de perroquets jacassaient dans les branchages. Écureuils et corbeaux étaient familiers en ce lieu, car ils savaient que jamais un prêtre ne les toucherait.
Les mendigots errants, les vendeurs d’amulettes et les saints vagabonds de cinquante lieues à la ronde faisaient de la Chubara leur lieu de rendez-vous et de repos. Mahométans, Sikhs et Hindous se mêlaient indifféremment sous les arbres. C’étaient des vieillards, et quand on est arrivé aux tourniquets de la Nuit éternelle, toutes les religions du monde vous paraissent singulièrement égales et sans importance.
Voici ce que m’a raconté Gobind le borgne. Il avait été un saint homme habitant sur une île au milieu d’une rivière et nourrissant les poissons deux fois par jour avec de petites boulettes de pain. En temps de crue, quand les cadavres enflés venaient s’échouer au bout de l’île, Gobind les faisait pieusement brûler, pour l’honneur de l’humanité, et en considération des comptes que lui-même aurait à rendre à Dieu par la suite. Mais quand les deux tiers de l’île eurent été emportés d’un coup, Gobind s’en alla de l’autre côté de la rivière à la Chubara de Dhunni Bhagat, emportant son seau de cuivre avec autour du cou la corde à puits, sa courte béquille de repos constellée de clous de cuivre, son rouleau de couchage, sa grosse pipe, son parasol, et son haut chapeau en feuilles de canne à sucre sur lequel se balançaient les plumes de paon rituelles. Drapé dans sa couverture faite de pièces et de morceaux de toutes les couleurs et de tous les tissus du monde, il s’assit dans un coin ensoleillé de la très paisible Chubara, et, le bras posé sur sa béquille à courte poignée, il attendit la mort. Les gens lui apportaient de la nourriture et de petits bouquets de fleurs de souci, et en retour il leur donnait sa bénédiction. Il était presque aveugle, et sa face était creusée, plissée et ridée à ne pas le croire, car il vivait déjà en un temps qui précéda celui où les Anglais arrivèrent à moins de deux cent cinquante lieues de la Chubara de Dhunni Bhagat.
Quand nous eûmes commencé à nous mieux connaître l’un et l’autre, Gobind se mit à me raconter des histoires de sa voix creuse qui ressemblait fort à un roulement d’artillerie lourde sur un pont de bois. Ses histoires étaient vraies, mais pas une sur vingt ne pourrait être imprimée dans un livre anglais, parce que les Anglais s’appesantissent sur des choses qu’un indigène renverrait à une occasion plus favorable ; et celles à quoi il ne penserait pas deux fois, un indigène s’y appesantira indéfiniment. C’est pourquoi indigènes et Anglais se considèrent l’un l’autre avec stupeur par-dessus de tels abîmes d’incompréhension.
– Et quel est, me dit Gobind un dimanche soir, quel est ton honorable métier, et par quel moyen gagnes-tu ton pain quotidien ?
– Je suis, lui répondis-je, un kerani… quelqu’un qui écrit avec une plume sur du papier, sans être au service du gouvernement.
– Alors qu’est-ce que tu écris ? fit Gobind. Approche-toi, car le jour tombe et je ne vois plus ta figure.
– J’écris sur toutes choses qui sont à la portée de mon entendement et sur beaucoup qui ne le sont pas. Mais surtout j’écris sur la vie et la mort, sur les hommes et les femmes, sur l’amour et la destinée dans la mesure de mes capacités, en racontant l’histoire par les bouches d’une, deux personnes ou plus. Alors, par la grâce de Dieu, les histoires se vendent et me rapportent de l’argent qui me permet de vivre.
– Ainsi soit-il, dit Gobind. C’est ce que fait le conteur du bazar ; mais lui parle directement aux hommes et aux femmes et il n’écrit rien du tout. Seulement, quand l’histoire a mis ses auditeurs en suspens et que les catastrophes sont sur le point de survenir aux vertueux, il s’arrête tout d’un coup et réclame son salaire avant de continuer son récit. En va-t-il de même dans ton métier, mon fils ?
– J’ai entendu dire que cela se passe à peu près ainsi quand une histoire est de grande longueur et qu’on la débite comme un concombre, par petites tranches.
– Moi, j’étais jadis un conteur renommé, quand je mendiais sur la route entre Koshin et Etra ; avant le dernier pèlerinage que j’aie fait à Orissa. Je racontais beaucoup d’histoires et j’en entendais encore plus aux gîtes d’étape le soir quand nous nous réjouissions après la journée de marche. Je suis persuadé qu’en matière d’histoires, les hommes faits sont tout pareils à des petits enfants, et que la plus vieille histoire est celle qu’ils aiment le mieux.
– Pour ton peuple, c’est la vérité, dis-je. Mais en ce qui regarde mes compatriotes ils veulent de nouvelles histoires, et quand tout est écrit ils s’insurgent et protestent que l’histoire aurait été mieux racontée de telle et telle façon, et ils demandent si elle est vraie ou bien si c’est une invention.
– Mais quelle folie est la leur ! fit Gobind, en écartant sa main noueuse. Une histoire qu’on raconte est vraie durant tout le temps qu’on met à la raconter. Et quant à ce qu’ils en disent… Tu sais comment Bilas Khan, qui fut le prince des conteurs, a dit à celui qui se moquait de lui dans le grand gîte d’étape sur la route de Jhelum : « Continue, mon frère, et achève ce que j’ai commencé. » Et celui qui se moquait reprit l’histoire, mais comme il n’avait ni le ton ni la manière il finit par s’arrêter court, et les pèlerins qui étaient là à souper l’abreuvèrent d’injures et de coups la moitié de la nuit.
– D’accord, mais pour mes compatriotes, puisqu’ils ont donné de l’argent, c’est leur droit ; de même que nous pourrions faire des reproches à un cordonnier si les chaussures qu’ils nous a livrées se décousaient. Si jamais je fais un livre tu le verras et tu jugeras.
– Et le perroquet dit à l’arbre qui allait tomber : « Attends, frère, je m’en vais te chercher un étai ! » dit Gobind avec un sourire sarcastique. Dieu m’a accordé quatre-vingts ans et peut-être un peu plus. Arrivé où j’en suis je ne dois plus voir qu’une faveur dans chaque jour successif qui m’est accordé. Fais vite.
– De quelle façon, repris-je, vaut-il mieux se mettre à l’œuvre, dis-moi, ô le premier de ceux qui enfilent des perles avec leur langue ?
– Comment le saurais-je ? Mais après tout (il réfléchit un peu) pourquoi ne le saurais-je pas ? Dieu a fait un grand nombre de têtes, mais il n’y a qu’un seul cœur dans le monde entier, aussi bien chez tes compatriotes que chez les miens. En matière d’histoires, ce sont tous des enfants.
– Mais il n’y en a pas d’aussi terribles que les petits si on déplace un mot ou si, en racontant une seconde fois, on modifie les détails, ne fût-ce que d’un seul diablotin.
– Oui, et moi aussi j’ai raconté des histoires aux petits, mais voici comment tu dois faire… (Ses vieux yeux se portèrent sur les peintures gaies du mur, sur la coupole bleu et rouge, et plus haut sur les fleurs éclatantes des poinsetties.) Parle-leur d’abord des choses que toi et eux vous avez vues ensemble. Ainsi leur savoir remédiera à tes imperfections. Parle-leur ensuite de ce que toi seul as vu, puis de ce que tu as entendu dire, et puisque ce sont des enfants, parle-leur batailles et rois, chevaux, diables, éléphants et anges, mais n’omets pas de leur parler d’amour et de choses semblables. Toute la terre est pleine d’histoires pour celui qui écoute le pauvre et ne le chasse pas de son seuil. Il n’y a pas meilleurs diseurs d’histoires que les pauvres ; car ils sont forcés chaque nuit de poser l’oreille à terre.
Après cette conversation l’idée grandit en moi, et Gobind me pressait de questions concernant la santé du livre.
Par la suite, quand nous eûmes été séparés plusieurs mois, il arriva que je dus partir au loin, et j’allai dire au revoir à Gobind.
– À cette heure il faut nous dire adieu, lui dis-je, car je m’en vais faire un très long voyage.
– Et moi aussi. Un plus long que toi. Mais que devient le livre ? demanda-t-il.
– Il naîtra en son temps s’il en est ainsi ordonné.
– J’aurais bien aimé le voir, dit le vieillard, ramassé sous son manteau. Mais cela ne sera pas. Je mourrai dans trois jours d’ici, la nuit, un peu avant l’aube. Le terme de mes ans est accompli.
Dans neuf cas sur dix un indigène ne se trompe pas en prévoyant le jour de sa mort. Il a sous ce rapport la prescience des animaux.
– Alors tu vas partir en paix, et c’est bien parler, car tu m’as dit que la vie n’est pas un plaisir pour toi.
– Mais c’est regrettable que notre livre ne soit pas né. Comment saurai-je qu’il y est fait mention de mon nom ?
– Parce que je te promets que dans la partie préliminaire du livre, avant toute autre chose, il sera écrit, Gobind, sadhu, de l’île en la rivière et qui attend Dieu dans la Chubara de Dhunni Bhagat, et ce seront les premiers mots du livre.
– Et qui te donna conseil… le conseil d’un vieillard. Gobind, fils de Gobind, du village Chumi dans le teshil de Karaon, district de Moultan. Cela sera-t-il écrit aussi ?
– Ce sera écrit aussi.
– Et le livre s’en ira de l’autre côté de l’Eau Noire dans les maisons de ton peuple et tous les sahibs connaîtront mon nom, à moi qui ai quatre-vingt ans ?
– Tous ceux qui liront le livre le sauront. Je ne puis t’en promettre plus.
– Voilà qui est bien parler. Appelle à haute voix tous ceux qui sont dans le monastère, je veux leur dire cette chose.
Ils se rassemblèrent, fakirs, sadhus, sunnyasis, byragis, nihangs et mullahs, prêtres de toutes les religions et à tous les degrés du déguenillement, et Gobind, appuyé sur sa béquille, leur parla, si bien qu’ils étaient tous visiblement remplis d’envie, et un ancien à barbe blanche engagea Gobind à penser à ses fins dernières plutôt qu’à sa réputation éphémère dans les bouches d’étrangers. Puis Gobind me donna sa bénédiction et je m’en allai.
Ces histoires ont été recueillies en tous lieux, et je les tiens de toutes sortes de gens, des prêtres de la Chubara, d’Ala Yar le graveur et de Jiwun Singh le charpentier, de gens sans nom à bord des bateaux et des trains autour du monde, de femmes filant devant leurs demeures au crépuscule, d’officiers et de gentlemen à cette heure morts et enterrés ; et un petit nombre, mais celles-là sont de loin les meilleures, c’est mon père qui me les a transmises. La plus grande partie de ces histoires a été publiée dans des revues et des journaux, et j’en suis obligé à leurs directeurs ; mais quelques-unes sont neuves de ce côté-ci de l’eau, et quelques autres voient le jour pour la première fois.
Les histoires les plus remarquables sont, comme de juste, celles qui ne paraîtront pas – et ceci pour des raisons évidentes.
Géorgie Porgie, tarte et gâteau, Embrassait les filles et les faisait pleurer.Quand les filles arrivaient pour jouer Géorgie Porgie s’enfuyait.
Si vous admettez qu’on n’a pas le droit d’entrer dans son salon au début de la matinée, quand la femme de chambre est en train de mettre les choses en place et d’enlever la poussière, vous admettrez aussi que les gens civilisés qui mangent dans la porcelaine et sont munis de carnets de visites n’ont pas le droit d’appliquer leur table des valeurs à un pays non encore installé. Quand les lieux seront devenus propres à les recevoir, par les soins des hommes désignés pour la corvée, ils pourront y venir, et apporter dans leurs malles leurs règles mondaines avec le décalogue et tous les autres accessoires. Là où ne s’étend pas la Loi de la Reine il n’y a pas de raison de vouloir qu’on observe d’autres règles plus faibles. Les hommes qui courent en avant des chars de la Décence et du Comme-il-faut, et qui rectifient les voies de la jungle, ne peuvent être jugés de la même manière que les gens sédentaires des rangs du tchin normal.
Il y a peu de mois encore la Loi de la Reine s’arrêtait à quelques kilomètres au nord de Thayetmyo sur l’Iraouaddy. Jusqu’à cette limite il n’y avait pas d’Opinion Publique bien forte, mais elle existait néanmoins assez pour maintenir les gens dans l’ordre. Quand le gouvernement décréta que la Loi de la Reine devait s’étendre jusqu’à Bhamo et à la frontière chinoise un ordre fut donné, et quelques hommes qui avaient comme désir d’être toujours de quelques pas en avant sur la marche de la Respectabilité se déversèrent en avant avec les troupes. C’étaient là de ces hommes qui ne sauraient jamais passer d’examens et qui auraient été d’idées trop arrêtées pour l’administration des provinces sous le régime des bureaux. Le gouvernement suprême s’avança derrière eux le plus tôt possible, avec les codes et les règlements, et réduisit à peu près la Nouvelle Birmanie au niveau normal de l’Inde ; mais il y eut une brève période durant laquelle les hommes forts furent nécessaires et labourèrent le champ pour eux-mêmes.
Parmi les pionniers de la civilisation était Georgie Porgie, reconnu pour un homme fort par tous ceux qui le connaissaient. Il venait d’être nommé en Birmanie Inférieure quand l’ordre vint de déplacer la frontière, et ses amis l’appelaient Georgie Porgie à cause de la façon singulièrement birmane dont il chantait une chanson dont les premiers mots ressemblent plus ou moins à « Géorgie Porgie ». La plupart des gens qui ont été en Birmanie reconnaîtront cette chanson. Elle veut dire :« Peuf, peuf, peuf, peuf, grand bateau à vapeur ! » Georgie Porgie la chantait en s’accompagnant sur son banjo, et ses amis en poussaient des cris de joie, si bien qu’on pouvait les entendre de loin dans la forêt de tecks.
Quand il alla en Birmanie Supérieure il n’avait aucune considération spéciale pour homme ni Dieu, mais savait l’art de se faire respecter et d’accomplir les devoirs mixtes civils-militaires qui incombaient à la plupart des hommes en ces quelques mois-là. Il faisait son travail de bureau et recevait, de temps à autre, les détachements de soldats minés de fièvre qui se fourvoyaient dans sa partie du monde à la recherche d’une bande de dacoits en fuite. Parfois il faisait une sortie et rossait les dacoits pour son propre compte, car le feu couvait encore dans le pays et risquait de se rallumer à l’improviste. Il goûtait ces charivaris, mais les dacoits s’en amusaient beaucoup moins. Tous les fonctionnaires qui entraient en relation avec lui s’en allaient avec l’idée que Georgie Porgie était quelqu’un de valeur, fort capable de se débrouiller par lui-même, et, sur cette persuasion, on le laissait à sa propre initiative.
Au bout de quelques mois la solitude finit par lui peser, et il chercha autour de lui de la compagnie et de l’agrément. La Loi de la Reine avait à peine commencé à se faire sentir dans le pays, et l’Opinion Publique, laquelle est plus puissante que la Loi de la Reine, était encore à venir. En outre, il y avait dans le pays une coutume qui autorisait un homme blanc à prendre pour lui une femme des Filles de Heth contre juste paiement. Ce genre de mariage n’avait guère beaucoup plus d’efficacité que la cérémonie du nikkah chez les mahométans, mais la femme était très agréable.
Quand tous nos soldats seront rentrés de Birmanie, ils auront à la bouche ce dicton : « Aussi avide qu’une femme birmane », et les jolies madames anglaises se demanderont ce que cela peut bien signifier.
Le chef du village voisin du poste de Georgie Porgie avait une fille jolie qui connaissait Georgie Porgie et qui l’aimait de loin. Quand la nouvelle se répandit que l’Anglais à la main lourde qui habitait dans le fortin cherchait une gouvernante, le chef alla le trouver et lui expliqua que, pour cinq cents roupies comptant, il remettrait sa fille à la garde de Georgie Porgie, lequel s’engagerait à l’entretenir en tout honneur, affection et bien-être, avec de jolies robes, selon la coutume du pays. Ce qui fut fait, et Georgie Porgie n’eut jamais à s’en repentir.
Il constata que sa maison était rangée et devenue agréable, ses dépenses jusque-là effrénées réduites de moitié, et lui-même dorloté et fort apprécié par sa nouvelle acquisition, qui siégeait à la place d’honneur de sa table, lui chantait des chansons, et commandait ses domestiques de Madras. Bref, c’était de tous points la plus douce et gaie, honnête et séduisante petite femme que pût souhaiter le plus exigeant des célibataires. Nulle autre race que la birmane, au dire des gens compétents, ne produit de gouvernantes et de majordomes aussi accomplis. Quand le dernier détachement défila sur le sentier de la guerre le lieutenant qui le commandait trouva à la table de Georgie Porgie une hôtesse à traiter avec déférence, une femme à traiter sous tous rapports comme quelqu’un occupant une position assurée. Quand il rassembla ses hommes à l’aurore suivante pour replonger dans la brousse il repensa avec regret au joli petit dîner et à la jolie figure, et envia Georgie Porgie du fond du cœur. Cependant il était fiancé en Angleterre à une jeune fille, et c’est ainsi que sont faits quelques hommes.
Le nom de la jeune Birmane n’était pas très joli ; mais comme Georgie Porgie eut vite fait de la baptiser Georgina, ce défaut n’a pas d’importance. Georgie Porgie appréciait le dorlotage et tous les agréments qu’elle lui procurait, et il jurait n’avoir jamais dépensé cinq cents roupies à meilleur escient.
Au bout de trois mois de vie domestique il lui vint une idée superbe. Le mariage – le mariage anglais s’entend – n’était peut-être pas, pour finir, une si mauvaise chose. Puisqu’il éprouvait un tel agrément là-bas au bout du monde avec cette fille birmane qui fumait des cheroots, ne serait-il pas encore bien plus heureux avec une douce jeune fille anglaise qui ne fumerait pas de cheroots et qui jouerait non pas du banjo mais du piano ? Il avait aussi le désir de se retrouver chez ses compatriotes, de réentendre un orchestre, et de sentir l’effet que cela faisait de porter de nouveau l’habit. Décidément le mariage serait une très bonne chose. Il réfléchit à l’affaire pendant des soirées, tandis que Georgina chantait pour lui, ou lui demandait pourquoi il était si taciturne, et si elle avait fait quelque chose pour lui déplaire. Tout en réfléchissant, il fumait, et tout en fumant, il regardait Georgina, et dans son imagination la métamorphosait en une belle petite jeune fille anglaise, pétulante, amusante et gaie, avec des cheveux lui descendant bas sur le front et peut-être une cigarette aux lèvres. Mais à coup sûr pas un de ces gros cheroots épais de Birmanie, de la marque que fumait Georgina. Il épouserait une fille avec les yeux de Georgina et la plupart de ses façons. Mais pas toutes. On pouvait trouver mieux. Puis il soufflait par les narines de gros nuages de fumée et s’étirait. Il goûterait du mariage. Georgina l’avait aidé à économiser de l’argent, et il avait droit à six mois de congé.
– Écoute, petite fille, lui dit-il, pendant ces trois prochains mois nous devons mettre un peu plus d’argent de côté. J’en ai besoin.
C’était une injure directe à l’administration ménagère de Georgina ; car elle s’enorgueillissait de son économie ; mais puisque son dieu avait besoin d’argent elle ferait de son mieux.
– Tu veux de l’argent ? fit-elle avec un petit rire. Mais j’en ai, moi, de l’argent. Regarde ! (Elle courut à sa chambre et en rapporta un petit sac de roupies.) De tout ce que tu m’as donné, j’en ai gardé un peu. Vois ! Cent sept roupies. Peux-tu avoir besoin de plus d’argent que cela ? Prends-le. Cela me fera plaisir que tu t’en serves.
De ses vifs petits doigts jaune clair elle étala les pièces sur la table et les poussa vers son mari.
Georgie Porgie ne reparla jamais plus d’économies ménagères.
Trois mois plus tard, après l’envoi et la réception de plusieurs lettres mystérieuses que Georgina ne put comprendre, et qu’elle haït pour cette raison, Georgie Porgie lui déclara qu’il allait s’absenter, et qu’elle devait retourner chez son père et y rester.
Georgina se mit à pleurer. Elle serait allée d’un bout du monde à l’autre avec son dieu. Pourquoi la quitterait-elle ? Elle l’aimait.
– Je m’en vais seulement à Rangoun, dit Georgie Porgie. Je serai de retour dans un mois, mais il est plus sûr pour toi de rester avec ton père. Je te laisserai deux cents roupies.
– Si tu ne t’en vas que pour un mois, quel besoin ai-je de deux cents ? Avec cinquante j’en ai plus qu’assez. Es-tu donc mal ici ? Reste, ou si tu pars laisse-moi aller avec toi.
Même à présent Georgie Porgie n’aime pas se rappeler cette scène. À la fin il se débarrassa de Georgina par un compromis de soixante-quinze roupies. Elle ne voulut pas prendre davantage. Puis, par bateau et par rail il s’en alla à Rangoun.
Les lettres mystérieuses lui avaient accordé six mois de congé. Ce départ même et l’idée qu’il avait peut-être agi en traître lui furent réellement pénibles, sur le moment ; mais dès que le grand steamer fut bien en route dans le bleu, les choses s’améliorèrent. Peu à peu le visage de Georgina, la drôle de petite maison palissadée, le souvenir des raids nocturnes de dacoits, le cri et le geste du premier homme qu’il eût jamais tué de sa propre main, et cent autres détails plus intimes, s’évanouirent de la mémoire de Georgie Porgie, et furent remplacés par la vision de l’Angleterre qui s’approchait. Le steamer était plein d’hommes en congé, tous joyeux lurons qui avaient rejeté la poussière et la sueur de la Birmanie Supérieure et qui s’amusaient comme des écoliers. Ils aidèrent Georgie Porgie à oublier.
Puis ce fut l’Angleterre avec son bien-être, ses convenances et son agrément, et Georgie Porgie, en se promenant dans un beau rêve sur le pavé dont il avait presque oublié le son, se demandait comment des hommes jouissant de leur bon sens pouvaient jamais quitter la Ville. Il accepta le vif plaisir qu’il prenait à son congé comme la récompense de ses services. La Providence de plus lui ménagea un autre plaisir plus grand encore – toutes les joies de paisibles fiançailles anglaises, totalement différentes du cynique marché de l’Orient, où la moitié de la communauté suit l’affaire de loin et engage des paris sur le résultat, et où l’autre moitié se demande ce qu’en dira Mme Une Telle.
La jeune fille était agréable, et cela se passait par un été splendide, dans une grande maison de campagne près de Petworth où il y a des hectares et des hectares de bruyère violette et de prairies coupées d’eaux pour se promener dans les hautes herbes. Georgie Porgie comprit qu’il avait enfin trouvé une vie digne d’être vécue, et naturellement supposa que la première chose à faire était de demander à la jeune fille de venir dans l’Inde partager son existence. Elle, dans son ignorance, accepta d’y aller. En cette occasion il n’y eut pas à marchander avec un chef de village. Ce fut une jolie noce de la classe moyenne à la campagne, avec un papa corpulent et une maman en pleurs, un garçon d’honneur en habit rouge et linge fin, et six fillettes au nez retroussé, de l’école du dimanche, pour jeter des roses sur le chemin entre les tombes jusqu’à la porte de l’église. Le journal de la localité narra la chose en détail, et alla même jusqu’à donner les cantiques tout au long. Mais c’était parce que la rédaction manquait de copie.
Puis vint une lune de miel à Arundel, et la maman pleura copieusement avant de permettre à sa fille unique de s’embarquer pour l’Inde sous la tutelle de Georgie Porgie, le jeune marié. Sans conteste aucun, Georgie Porgie était énormément fier de sa femme, et elle lui était dévouée comme au meilleur et au plus grand homme du monde. En allant chez le gouverneur à Bombay il se crut autorisé à demander un bon poste à cause de sa femme ; et comme il s’était fait un peu remarquer en Birmanie et que l’on commençait à l’estimer, on lui accorda presque tout ce qu’il demandait, et on le casa dans un poste que nous appellerons Sutrain. Cela se trouvait dans les montagnes, et se dénommait officiellement sanatorium, pour la bonne raison que les égouts y manquaient totalement. Georgie Porgie s’y installa et découvrit que l’existence matrimoniale lui convenait par nature. Il ne s’extasia pas, comme font tant de jeunes mariés, sur la plaisante singularité de voir sa propre bien-aimée en personne s’asseoir avec lui chaque matin à déjeuner comme si c’était la chose la plus naturelle du monde ». « Il avait déjà vu ça », comme on dit, et comparant les présents mérites de sa chère Grâce à ceux de Georgina, il était de plus en plus tenté de croire qu’il avait bien agi.
Mais il n’y avait ni paix ni joie de l’autre côté du golfe du Bengale, sous les tecks où Georgina vivait avec son père, en attendant le retour de Georgie Porgie. Le chef était vieux, et se rappelait la guerre de 51. Il avait été à Rangoun, et savait quelque chose des façons des kullaks. Assis devant son seuil, dans les soirs, il enseignait à Georgina une amère sagesse qui ne la consolait pas le moins du monde.
Le mal était qu’elle aimait Georgie Porgie tout autant que la jeune Française des livres d’histoire aimait le prêtre à qui les séides du roi avaient cassé la tête. Un jour elle disparut du village avec toutes les roupies que Georgie Porgie lui avait données, et une très faible teinture d’anglais – qu’elle tenait également de Georgie Porgie.
Le chef fut fâché tout d’abord, mais il finit par allumer un autre cheroot en émettant une réflexion peu flatteuse pour le beau sexe en général. Georgina s’était mise à la recherche de Georgie Porgie, qui, à ce qu’elle en savait, pouvait aussi bien être à Rangoun que de l’autre côté de l’Eau Noire, ou mort. Le hasard la favorisa. Un vieux gendarme sikh lui dit que Georgie Porgie avait traversé l’Eau Noire. Elle prit passage en classe d’émigrants à Rangoun et s’en alla à Calcutta, gardant pour elle le secret de sa recherche.
Pendant six semaines elle fut perdue dans l’Inde sans laisser aucune trace et nous ignorons quelles peines de cœur elle dut endurer.
On la revit à sept cents kilomètres au nord de Calcutta, se dirigeant toujours vers le nord, très lasse et amaigrie mais très ferme dans sa résolution de retrouver Georgie Porgie. Elle ne comprenait pas le langage du pays ; mais l’Inde est infiniment charitable, et le long de la Grande Artère Centrale les femmes lui donnaient à manger. Quelque chose lui faisait croire qu’elle trouverait Georgie Porgie au bout de cette route impitoyable. Peut-être rencontra-t-elle un cipaye qui l’avait connu en Birmanie, mais cela n’est pas certain. Finalement elle fit la rencontre d’un régiment en ligne de marche, et y retrouva l’un des nombreux lieutenants que Georgie Porgie avait invités à dîner dans le lointain autrefois de la chasse aux dacoits. Lorsque Georgina se jeta aux pieds de l’homme et se mit à pleurer, on se divertit quelque peu parmi les tentes ; mais on cessa de se divertir quand elle eut raconté son histoire, et, ce qui valait encore mieux, on fit une collecte. L’un des lieutenants connaissait la résidence de Georgie Porgie, mais ignorait son mariage. Il raconta donc à Georgina ce qu’il savait, et elle poursuivit allégrement sa route vers le nord dans un wagon de chemin de fer où elle trouva du repos pour ses pieds fatigués et de l’ombre pour sa petite tête poudreuse. Les marches à partir de la voie ferrée jusqu’à Sutrain dans les montagnes sont fatigantes, mais Georgina avait de l’argent, et les familles voyageant en charrette à bœufs lui vinrent en aide. Ce fut un voyage quasi miraculeux, et Georgina finissait par croire que les bons génies de la Birmanie veillaient sur elle. Le parcours est froid, en montagne, sur la route de Sutrain, et Georgina y prit un mauvais rhume. Mais au bout de tous ses maux elle voyait Georgie Porgie qui la prendrait dans ses bras et la caresserait, comme il le faisait dans l’ancien temps lorsque la palissade était fermée pour la nuit et qu’il avait félicité sa petite femme pour le repas du soir. Georgina allait de l’avant aussi vite qu’elle pouvait, et ses bons génies lui firent une dernière grâce.
Un Anglais l’arrêta dans le crépuscule, au détour de la route juste avant Sutrain, et s’écria :
– Juste ciel ! que faites-vous ici ?
C’était Gillis, celui qui avait été le collègue de Georgie Porgie en Birmanie Supérieure, et qui avait occupé dans la brousse le poste voisin de celui de Georgie Porgie. Comme il plaisait à Georgie Porgie, celui-ci avait obtenu de l’avoir dans ses bureaux à Sutrain.
– Je suis venue, dit avec simplicité Georgina. La route a été bien longue, et j’ai mis bien des mois à arriver. Où est sa maison ?
Gillis resta interdit. Il avait suffisamment connu Georgina autrefois pour savoir que les explications seraient inutiles. On ne peut expliquer les choses aux Orientaux. Il faut les leur montrer.
– Je vais vous y mener, répondit Gillis.
Et entraînant Georgina hors de la route il lui fit escalader la falaise par un petit raccourci qui aboutissait derrière une maison située sur une plateforme taillée dans le rocher.
On venait d’allumer les lampes, mais les rideaux n’étaient pas tirés. Gillis s’arrêta devant la fenêtre du salon et dit :
– Maintenant, regardez.
Georgina regarda et vit Georgie Porgie avec la jeune mariée.
Elle porta la main à ses cheveux qui s’étaient échappés du chignon et lui pendillaient sur la figure. Elle tenta de rajuster son vêtement délabré, mais ce n’était plus qu’un haillon informe, et elle eut une bizarre petite toux, car elle avait en vérité pris un bien mauvais rhume. Gillis regarda lui aussi, mais tandis que Georgina, n’accordant qu’un seul regard à la jeune mariée, ne quittait pas des yeux Georgie Porgie, Gillis ne cessait de regarder la jeune mariée.
– Qu’est-ce que vous allez faire ? demanda Gillis, qui tenait Georgina par le poignet, de crainte qu’elle ne s’élançât à l’improviste dans la lumière de la lampe. Allez-vous entrer et dire à cette Anglaise que vous avez vécu avec son mari ?
– Non, répondit Georgina d’une voix défaillante. Laissez-moi aller. Je m’en vais. Je vous jure que je m’en vais.
Elle se libéra d’une secousse et s’enfuit dans les ténèbres.
– Pauvre petit animal ! dit Gillis en regagnant la grand-route. Je lui aurais bien donné quelque chose pour retourner en Birmanie. Tout de même il l’a échappé belle. Et cet ange ne lui aurait jamais pardonné.
Ce qui semble prouver que le dévouement de Gillis n’était pas uniquement dû à son amitié pour Georgie Porgie.
Après leur dîner le jeune marié et son épouse sortirent dans la véranda, afin que la fumée des cheroots de Georgie Porgie ne risquât point d’imprégner les rideaux du salon.
– Quel est ce bruit-là en bas ? demanda la jeune mariée.
Tous deux écoutèrent.
– Oh ! dit Georgie Porgie, c’est sans doute une brute de montagnard qui vient de battre sa femme.
– Battre… sa… femme ! Quelle horreur, dit la jeune mariée. Vois-tu que tu irais me battre !
Elle passa un bras autour de la taille de son mari, et appuyant la tête contre son épaule, dans la profonde sécurité de son bonheur, regarda au dehors la vallée remplie de brume.
Mais c’était Georgina qui pleurait toute seule, au bas de la pente, parmi les pierres du cours d’eau où les lavandières font la lessive.
Imray avait réalisé l’impossible. Sans avertissement, sans aucune raison plausible, en pleine jeunesse et au seuil de sa carrière il avait préféré disparaître du monde… c’est-à-dire de la petite garnison de l’Inde où il résidait. Tel jour il était là vivant, sain, heureux, et très en évidence à son club, parmi les tables de billard. Le lendemain on ne le vit plus, et toutes les recherches furent impuissantes à découvrir où il pouvait bien être. Il avait quitté son poste ; il n’avait pas paru à son bureau à l’heure réglementaire, et son dog-cart n’était pas sur les voies publiques. Pour ces motifs et parce qu’il entravait à un degré infinitésimal le fonctionnement administratif de l’Empire des Indes, ledit Empire des Indes s’arrêta un laps de temps infinitésimal à s’enquérir du sort d’Imray. On dragua les étangs, on sonda les puits, on lança des télégrammes le long des lignes de chemin de fer et jusqu’au port de mer le plus proche… à douze cents milles de là… mais pas plus au bout des filins de drague qu’à celui des télégrammes on ne retrouva Imray. Il avait disparu, et son poste cessa de le connaître. Alors, comme la besogne du grand Empire des Indes ne souffrait pas de retard, elle se remit en marche, et Imray cessa d’être un homme pour devenir une énigme… un de ces mystères dont les gens s’entretiennent aux tables du club pendant un mois, avant de les oublier à jamais. Ses fusils, chevaux et équipages furent adjugés au plus fort enchérisseur. Son chef hiérarchique écrivit une lettre stupide à la mère d’Imray, disant que celui-ci avait disparu inexplicablement, et que son bungalow restait vide sur la route.
Trois ou quatre mois d’une saison de chaleur brûlante avaient passé, lorsque mon ami Strickland, des forces policières, jugea convenable de prendre à bail le bungalow, du propriétaire indigène. Cela se passait avant ses fiançailles avec Mlle Youghal (dont l’histoire a été contée ailleurs) et alors qu’il poursuivait son enquête sur la vie indigène. Sa vie à lui était déjà passablement originale, et les gens se plaignaient de ses us et coutumes. Il y avait parfois des vivres dans son logis, mais il n’y avait pas d’heures régulières pour les repas. Il mangeait, debout et circulant, n’importe ce qui se trouvait dans le buffet, et cela ne vaut rien pour les viscères des humains. Son équipement domestique se réduisait à six carabines, trois fusils de chasse, cinq selles, et une collection de cannes à pêche à tiges rigides, plus grosses et plus fortes que les plus grosses lignes à saumon. Ces objets occupaient une moitié de son bungalow, dont l’autre était livrée à Strickland et à sa chienne Tietjens… une énorme lice rampur qui n’aboyait que quand on le lui ordonnait et qui absorbait chaque jour les rations de deux hommes. Elle parlait à Strickland dans un langage à elle, et chaque fois que dans ses promenades au dehors elle voyait des choses susceptibles de nuire à la paix de Sa Majesté l’Impératrice et Reine, elle allait retrouver son maître pour lui en donner avis. Strickland prenait aussitôt des mesures, et ses efforts aboutissaient à du tracas, de l’amende et de l’emprisonnement pour autrui. Les indigènes croyaient que Tietjens était un démon familier, et la traitaient avec tout le respect qu’engendrent la crainte et la haine. Elle avait une pièce du bungalow réservée à son usage spécial. Elle possédait un lit, une couverture et une auge à boire, et si quelqu’un entrait la nuit dans la chambre de Strickland elle ne manquait pas de jeter à terre l’intrus et de donner de la voix jusqu’à ce que l’on vînt avec une lumière. Strickland lui doit la vie. Comme il était sur la frontière à la recherche d’un assassin local, celui-ci arriva au petit jour dans l’intention d’envoyer Strickland beaucoup plus loin que les îles Andaman, mais Tietjens le surprit alors que, un coutelas entre les dents, il se glissait sous la tente de Strickland, et, la liste de ses forfaits une fois établie aux yeux de la loi, il fut pendu. À partir de cette date Tietjens porta un collier d’argent massif et usa d’une couverture de nuit à monogramme ; et, Tietjens étant une chienne raffinée, ladite couverture était en drap de Cachemire à double épaisseur.
Sous aucun prétexte elle ne voulait se séparer de Strickland, et lorsqu’il fut malade de la fièvre elle causa beaucoup d’ennuis aux médecins, car elle ne savait comment secourir son maître et refusait de laisser personne lui apporter son aide. Macarnaght, du corps médical des Indes, fut obligé de lui cogner sur le crâne avec un fusil, pour lui faire comprendre qu’elle devait céder la place aux gens qui administrent la quinine.
Peu de temps après que Strickland eut loué le bungalow d’Imray, mes occupations m’amenèrent dans cette garnison, et comme de juste, les logements du club étant pleins, je me logeai chez Strickland. C’était un agréable bungalow, pourvu de huit chambres et d’un toit de chaume épais qui le mettait à l’abri de toute infiltration pluviale. Sous le vide du toit s’étalait une toile de plafond, qui avait tout aussi bon air qu’un vrai plafond à la chaux. Le propriétaire l’avait fait repeindre lorsque Strickland était entré dans le bungalow ; et il fallait savoir comment est fait un bungalow des Indes, pour soupçonner que par-dessus la toile s’étendait la sombre caverne pyramidale du toit, où les poutres et la face inférieure du chaume donnaient asile à toute espèce de rats, chauves-souris, fourmis et autres bêtes.
Tietjens m’accueillit dans la véranda par un aboiement semblable au bourdon des cloches de Saint-Paul, et me posa ses pattes sur l’épaule, et se déclara enchantée de me voir. Strickland était parvenu à organiser cette espèce de repas qu’il dénommait lunch, et dès que nous en eûmes fini, il s’en alla à ses affaires. Je restai seul avec Tietjens et mes propres soucis. L’ardeur de l’été s’était atténuée et avait fait place à l’humidité chaude des pluies. Il n’y avait pas un souffle dans l’air brûlant, mais la pluie tombait sur la terre comme des lames de baïonnettes, et son rejaillissement faisait une buée bleuâtre. Dans le jardin, les bambous et les avocatiers, les poinsetties et les manguiers se dressaient immobiles sous l’eau chaude qui les fouaillait, et les grenouilles commençaient à croasser parmi les haies d’aloès. Un peu avant la tombée du jour, et tandis que la pluie était à son maximum, j’allai m’asseoir dans la véranda de derrière, et tout en me grattant parce que j’étais couvert de ce que l’on nomme éruption de chaleur, j’écoutai l’eau tomber en cataracte des gouttières. Tietjens sortit avec moi, et posa sa tête sur mes genoux, d’un air si mélancolique que, quand le thé fut fait, je lui donnai ses biscuits et pris mon thé dans la véranda de derrière, à cause du petit peu de fraîcheur que j’y trouvais. Derrière moi les pièces de la maison s’assombrirent. Je percevais l’odeur de la sellerie de Strickland et de la graisse de ses fusils, et ne tenait pas le moins du monde à m’installer parmi ces objets. Mon domestique personnel vint me trouver dans la pénombre ; la mousseline de ses habits trempés lui collait étroitement sur le corps, et il m’annonça qu’un gentleman était là, qui désirait voir quelqu’un. Fort à regret, et à cause de l’obscurité des chambres, je dis à mon homme d’apporter des lumières et passai dans le salon nu. J’ignore s’il y avait ou non un visiteur dans la pièce ; en tout cas je crus bien y voir une silhouette à l’une des fenêtres, mais quand les lumières arrivèrent il n’y avait plus rien dehors que les dards de la pluie et l’odeur pénétrante de la terre qui buvait. Je déclarai à mon homme qu’il n’était pas des plus malins, et m’en retournai à la véranda pour causer avec Tietjens. Elle était sortie sous l’averse et je ne réussis pas à la ramener auprès de moi, même par la séduction de biscuits avec du sucre dessus. Juste avant le dîner Strickland rentra à cheval, ruisselant d’eau, et sa première parole fut :
– Est-ce qu’il est venu quelqu’un ?
Je lui expliquai, en m’excusant, que mon domestique m’avait fait aller au salon, par suite d’une fausse alerte ; à moins que quelque vagabond n’eût tenté une visite à Strickland, et, se ravisant, n’eût pris la fuite après avoir donné son nom. Sans commentaire Strickland ordonna de servir, et, comme c’était un vrai dîner, comportant une nappe blanche, nous nous assîmes.