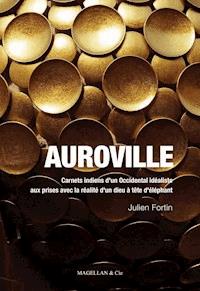
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Les Ancres contemporaines
- Sprache: Französisch
Récit autobiographique d'une quête philosophique et spirtuelle au coeur de l'Inde
Auroville : au fil des ans, cette communauté du Sud de l’Inde, fondée en 1968 par Mirra Alfassa pour concrétiser la pensée du philosophe indien Sri Aurobindo, a cristallisé de nombeux clichés et nourri tous les fantasmes. Utopie idyllique, village de hippies, repère de doux dingues ou bulle coupée du monde : quelle étiquette peut-on bien coller sur ce drôle d’Objet vivant non identifé ? Et surtout, à quoi ressemble cette expérience aujourd’hui, quarante ans après les caravanes arrivées par la route de la Soie, pour quelqu’un né longtemps après l’époque du flower power ?
Il y a autant d’Aurovilles que d’Aurovilliens, si ce n’est plus ; mais l’auteur essaie ici de trouver sa propre définition, de relier son périple extérieur à son voyage intérieur. Et dans cette quête initiatique, basée sur une expérience personnelle et non sur l’analyse théorique, il recevra l’aide d'un personnage inattendu…
Un journal intime, entre religion et méditation
A PROPOS DE L'AUTEUR
Julien Fortin, trente-deux ans, s’est installé à Auroville depuis plusieurs années, après avoir vu le jour en France, et vécu en Allemagne, au Sri Lanka et au Gabon. Il a parcouru la planète pour suivre de nombreux projets de développement. Par ailleurs, il pratique l’escalade et la plongée partout où c’est possible…
EXTRAIT
Le « début de l’histoire » est une question de choix. Quand on cherche dans sa mémoire le moment où tout a commencé, on peut toujours remonter d’un cran l’enchaînement des événements qui nous ont mené là où l’on est, chercher la cause de chaque effet jusqu’à notre naissance, et même avant : dans la rencontre de nos parents ou de nos grands-parents, et de leurs grands-parents avant eux. Aussi amusant soit-il, ce jeu ne mène à rien, et l’on se retrouve obligé de choisir, arbitrairement, un instant que l’on déclare être le « début de l’histoire ». Plutôt que de remonter mon arbre généalogique à l’infini, je décide, à la majorité absolue, que mon histoire aurovilienne commence dans un bar munichois.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Auroville est pour ceux qui veulent vivre une vie essentiellement divine mais qui renoncent à toute religion, qu’elle soit ancienne, moderne, nouvelle ou future. Je veux insister sur le fait que ceci sera une expérience, ceci sera pour faire des expériences – expériences, recherches, études.
Auroville veut abriter des gens heureux d’être à Aurovillle. Ceux qui ne sont pas satisfaits devraient retourner dans le monde où ils peuvent faire ce qu’ils veulent et où il y a de la place pour chacun. »
Mère,
le 2 octobre 1972
« Je ne voudrais à aucun prix voir quiconque adopter ma façon de vivre ; car, outre que je peux en avoir trouvé une autre pour moi-même avant qu’il ait bien appris celle-ci, je désire qu’il puisse y avoir de par le monde autant de gens différents que possible ; mais ce que je voudrais voir, c’est que chacun soit bien attentif à découvrir et suivre sa propre voie, et non celle de son père, de sa mère ou de son voisin. »
Henry David Thoreau,
Walden
PROLOGUE
Pieds nus sur le rouge de la terre, je m’approchai des chevaux d’argile. Le vieux banyan1 en ombrageait deux rangées, au bout desquelles trois briques décorées au curcuma symbolisaient la divinité de ce temple à ciel ouvert, sans toit ni murs. Né loin d’ici, je n’étais pas Hindou. Je ne savais pas si l’endroit était sacré car il y poussait cet arbre, ou si l’arbre était sacré car il poussait là. Ce que je savais, c’est que m’asseoir ici les yeux fermés me calmait. Le même mouvement semblait alors animer la sève de l’arbre et le sang de mon corps, le vent dans les chevaux et l’air dans mes poumons. Je me moquais de savoir si tout cela n’était qu’une vue de l’esprit : le calme que je ressentais était bien réel.
J’en avais besoin.
Ma vie était généralement agitée. Je ne m’en plaignais pas, puisque j’y puisais partiellement ma substance ; mais je devais parfois me poser pour digérer cette agitation. Cela faisait quatre ans que je vivais à Auroville – ou que j’y vivais à nouveau, si l’on comptait les six mois passés ici huit ans plus tôt, suivis de quelques courts séjours. Durant ces années, cette communauté utopique, héritière des aspirations des années 1960 et 1970, était devenue, sans que je m’en rende compte, l’endroit que j’appelais « chez moi » lorsque je n’y pensais pas. Je voyageais encore beaucoup, mais Auroville et l’Inde étaient mon camp de base. Cela s’était imposé de manière naturelle, sans forcer. J’avais simplement fait ce que je savais le mieux, c’est-à-dire ce dont j’avais envie au moment où j’en avais envie, et cela m’avait mené là, dans cette vie et sous cet arbre. Mais aujourd’hui, j’avais besoin d’y réfléchir.
Qu’est-ce que je faisais là ? Tant de hasards avaient été nécessaires pour m’y mener qu’il était bien plus probable que je n’y sois jamais venu. Pourtant, au nom de cet endroit de hasards, je me compliquais l’existence, créant des difficultés entre cette Américaine et moi. Elle sentait à quel point Auroville était importante pour moi, et faisait tous les efforts pour essayer de comprendre, mais je n’arrivais pas à lui expliquer, et elle restait dubitative. De petites explications en grandes discussions, les tensions résultant de cette incompréhension finissaient par mettre notre histoire en péril, et je me demandais si je n’étais pas en train de sacrifier – à nouveau ? – ma vie amoureuse sur l’autel aurovilien. Situation ambiguë : lorsque nous discutions, je défendais systématiquement la communauté, la décrivant sous son meilleur jour ; mais dans la solitude de mon crâne, je m’énervais de ce qu’un endroit que j’aurais pu ne jamais connaître m’éloigne ainsi de cette femme que j’étais pourtant sûr d’aimer.
Je voulais noyer ce dilemme dans le calme de l’arbre sacré. Je lui demandai de me débarrasser de mes tensions, écoutai le vent apprivoiser mes pensées, et laissai les chevaux emporter mes emmerdements au galop. Silence intérieur, équanimité. L’odeur de la terre.
Plus léger, j’ouvris les yeux. À la place des trois briques était assis un homme à tête d’éléphant, les jambes entourées d’un lungi2, un laddu3 dans la main, une étincelle dans les yeux : Ganesh, le dieu éléphantesque, fils de Parvati, elle-même épouse de Shiva. Incapable de comprendre, j’étais incapable de parler. Ayant lu mes pensées, il dit de sa voix grave :
– Je ne suis pas ici : je suis partout. Je suis devant toi non parce que tu m’as appelé, mais parce que cette terre est la mienne ; son énergie ne coule en toi et dans cet arbre que si mon père continue sa danse, jusqu’à ce qu’il détruise cet univers pour faire de la place au suivant. Lorsque tu parles ou laisses inconsciemment s’échapper tes pensées, j’écoute, mais ce n’est pas toi que j’entends, c’est le son du monde, le « OM »4 universel dont ta voix n’est qu’une note parmi des millions. Si ce son est immuable, aucune note n’est permanente, et l’instrument qui joue faux finira accordé ou détruit. Je suis le dieu qui anéantit les obstacles –non pas en réponse aux prières d’un individu, mais parce que c’est ainsi que fonctionne l’univers selon la loi du Dharma5. En te lamentant sur ton sort comme un enfant aveugle, tu crées en toi des obstacles, et ces obstacles, bien que nés d’une illusion minuscule, empêchent la shakti, l’énergie en toute chose, de suivre son cours harmonieux. Puisque c’est la même énergie qui coule en toi et dans cette forêt, dans les pierres des temples et dans les nuages, tout obstacle sur sa route me concerne, aussi insignifiant soit-il.
Je ne savais pas quoi répondre. J’essayais de comprendre le sens des mots, mais la présence de Ganesh désarmait ma raison. Je regardai, impuissant et muet, le divin pachyderme soulever sa trompe, mordre dans son laddu, puis laisser échapper un soupir de plaisir.
– Bien. Par où veux-tu commencer ? Par me décrire l’obstacle qui t’accable, peut-être ?…
Toujours sous le coup de la surprise, mais sentant intuitivement que quand Ganesh demandait quelque chose, il était malvenu de le faire attendre, j’essayai de formuler mes pensées :
– Il y a cette femme, à Hyderabad, elle vient souvent me voir, mais je n’arrive pas à lui montrer ce que j’aime en Auroville…
– Non. Je ne parlais pas de ça. Cette histoire-là, je l’ai entendue quand le vent t’en a débarrassé pour la donner aux chevaux. C’est une illusion. L’obstacle est en toi, pas en elle, mais tu trouves plus simple de le voir ainsi parce que cela t’évite d’y travailler. Ce n’est pas à elle que tu veux expliquer Auroville, mais à toi-même, pour mieux comprendre ces tensions que tu ressens entre vous, et surtout celles que tu portes en toi.
– Mais il n’y a pas de tensions en moi ! Ce n’est qu’un problème de communication, rien de plus…
– À d’autres! Mais pas à moi. Je ne suis pas psychanalyste. Je n’ai pas besoin d’interpréter, puisque je suis omniscient et omnisentant. Je peux sentir ce que tu ressens aussi facilement que le goût de ce laddu sur ma langue.
– Pardon. C’est vrai. Je ne sais plus trop où j’en suis. J’ai l’impression de savoir ce qu’est Auroville, mais chaque fois que j’essaie de l’expliquer, les mots s’échappent. Si ce n’était qu’un endroit ou un concept, cela ne me dérangerait pas, mais c’est devenu quelque chose de tellement essentiel pour moi que je ne supporte plus de ne pouvoir clarifier mes pensées.
– C’est cela ton obsession ? Donner la définition d’Auroville ?
– Non ! Pas une définition universelle. Il y a sûrement autant de définitions d’Auroville qu’il y a d’Auroviliens, et même plus, puisque chaque voyageur y apporte et en extrait la sienne. Nombreux sont ceux qui y ont passé plus de temps que moi et je ne pourrais jamais parler pour eux, ni donner une définition meilleure que la leur.
– Ta définition personnelle, alors ?
– Oui, quelque chose comme ça… Mais peut-être que « définition » n’est pas le bon mot. Une définition, ce sont des mots que l’on peut enfermer dans un dictionnaire, écrire sur un parchemin ou encadrer dans un musée, alors qu’Auroville est vivante et changeante. Il y a des textes, bien sûr, des citations de Sri Aurobindo et Mère, mais les lire ne suffit pas à comprendre, et pourtant personne ne dira mieux qu’eux ce qu’ils ont voulu réaliser. Ce qui manque, c’est l’expérience. Ceux qui visitent Auroville pour quelques jours seulement sont souvent déçus : ils disent qu’il n’y a rien de spécial à voir. Mais c’est un malentendu : il ne s’agit ni d’un musée ni d’un parc à thème. Il n’y a pas de ticket, pas d’attractions, pas de comité d’accueil qui fasse visiter le monde magique d’Auroville. Pour l’appréhender, il faut y vivre.
– Finalement, ce que tu veux, ce n’est pas tant la définir que comprendre ton expérience, et la comprendre pour pouvoir l’expliquer. C’est cela ?
– Voilà ! C’est ça. Je crois que c’est ça.
– Bien. Nous avons déjà mieux compris l’obstacle ; reste à trouver comment s’y prendre pour libérer les énergies qu’il obstrue.
– Comment faire ?
– L’obstacle est en toi ; la solution l’est aussi. Pour savoir ce qu’Auroville est pour toi, c’est en toi qu’il faut regarder. Dieu des conteurs, j’aime les histoires, des plus petites aux plus grandes –et qu’est-ce qu’une histoire, sinon une rivière de mots ? Commence la tienne à sa source, oublie mon omniscience, laisse couler les mots et raconte-moi comment tu es arrivé ici. Ce sera le ruisseau sur lequel débutera ta navigation. En espérant qu’il grandira jusqu’à répondre à tes questions.
La situation était étrange. J’étais assis sous un arbre sacré et parlais à un dieu à tête d’éléphant. Peut-être m’étais-je endormi au lieu de méditer ? Je ne savais pas si je rêvais de Ganesh ou s’il était vraiment là, mais ses mots résonnaient en moi. Illusions ou pas, ils étaient ce que j’avais entendu de plus sensé sur mes questions intérieures. Ils ne me donnaient pas encore de réponse, mais me montraient un chemin : je décidai de le suivre.
1. Ficus bengalensis, arbre dont certaines branches tombent sur le sol pour y devenir de nouvelles racines. L’arbre peut ainsi présenter des dizaines de troncs, et l’on en trouve en Inde sous lesquels on pourrait abriter tout un village.
2. Aussi appelé sarong, pièce de tissu portée autour des hanches dans de nombreux pays asiatiques, dont l’Inde.
3. Pâtisserie indienne, ronde, à base de farine et recouverte de sucre.
4. Om, ou Aum, est une syllabe sanskrite considérée comme l’origine du monde et utilisée dans de nombreux mantras et prières hindous ou bouddhistes.
5. Le terme dharma, qui désigne dans le bouddhisme l’ensemble des enseignements du Bouddha, est utilisé dans l’hindouisme pour décrire à la fois l’ordre cosmique universel, la loi éternelle qui régit le monde, la droiture et la vertu.
L’ARRIVÉE
Le « début de l’histoire » est une question de choix. Quand on cherche dans sa mémoire le moment où tout a commencé, on peut toujours remonter d’un cran l’enchaînement des événements qui nous ont mené là où l’on est, chercher la cause de chaque effet jusqu’à notre naissance, et même avant : dans la rencontre de nos parents ou de nos grands-parents, et de leurs grands-parents avant eux. Aussi amusant soit-il, ce jeu ne mène à rien, et l’on se retrouve obligé de choisir, arbitrairement, un instant que l’on déclare être le « début de l’histoire ». Plutôt que de remonter mon arbre généalogique à l’infini, je décide, à la majorité absolue, que mon histoire aurovilienne commence dans un bar munichois.
J’avais dix-neuf ans, c’était le printemps, et je vivais en Allemagne depuis six mois. Je découvrais, en plus de la Bavière, la vie étudiante et la grisante sensation de n’avoir de comptes à rendre à personne, loin du cocon familial. Vivre à l’étranger, même si ce n’était que de l’autre côté du Rhin, me paraîssait terriblement excitant, et la perspective de rentrer poursuivre mon cursus d’ingénierie productique en région parisienne égalait en horreur mes souvenirs enfantins de fins de grandes vacances. Il y avait cependant une lueur d’espoir : il semblait que l’école française autorisât les étudiants à repartir au bout de quelques mois s’ils dénichaient un stage dans un autre pays. Un soir, je retrouvai deux amis au bar de la Tribühne, au cœur de la cité étudiante munichoise, et leur exposai mon projet : chercher ensemble une nouvelle terre d’accueil. L’enthousiasme fleurit rapidement quand on l’arrose ; pendant que je m’occupais du mien à l’aide d’une demi-bouteille de Southern Comfort, Tim et Tom avaient nourris le leur à la bière, et leur réaction fût forcément euphorique :
– Génial ! On ne rentre pas en France ! Mais on va où ?
Je marquai une légère pause pour ménager mes effets, bus une nouvelle gorgée, claquai la langue et dis :
– En Australie.
Forcément : l’Australie, c’était ce qui se faisait de plus loin. Si le séjour allemand était à ce point jouissif, alors que nous n’étions qu’à mille kilomètres de Paris, un stage australien devait logiquement être vingt fois supérieur, puisqu’à près de vingt mille kilomètres. Le raisonnement était d’une beauté toute mathématique, et je fus surpris d’entendre Tim contester un plan aussi infaillible :
– Non ! Oublie l’Australie. Ma sœur vient de se fiancer avec un Tamoul.
– C’est quoi un Tamoul ?
– C’est un habitant de Pondichéry, dans le sud de l’Inde. J’y suis allé l’année dernière pour les fiançailles, c’était mortel. C’est là-bas qu’on doit aller : on pourrait sûrement habiter chez la famille de mon beau-frère.
« Pondichéry » ! Je savais à peine où cela se trouvait, pas du tout à quoi cela ressemblait, mais, rien qu’à l’oreille, c’était beau comme un roman de Pierre Loti. Mélangé à la liqueur de whiskey, le mot sentait la cannelle et la vanille, et me jouait déjà un air de cithare dans la tête. Rentré dans ma chambre quelques heures plus tard, je tapai sur mon ordinateur les mots-clés « Pondicherry » et « Engineering », envoyai mon C.V. aux dix premiers résultats sans même les regarder, et m’écroulai sur mon lit pour y ronfler du sommeil du juste.
Dix jours après, je reçus un e-mail du webmestre d’une entreprise indienne m’annonçant avoir bien reçu ma candidature, mais ne pas avoir de stage à me proposer ; il avait toutefois fait suivre mon message à d’autres Auroviliens, et me souhaitait bonne chance dans ma recherche. Candidature ? Inde ? Aurovilien ? Je me grattai le crâne, et mis une minute à me souvenir de la conversation de la semaine précédente. J’avais quasiment oublié cette nuit d’enthousiasme embrumé. J’allai, à tout hasard, jeter un rapide coup d’œil sur le site web de l’Auroville en question : la page d’accueil montrait une espèce de balle de golfe géante en construction, dorée à l’or fin, qui brillait dans un coucher de soleil de carte postale. Le bâtiment était posé sur une large esplanade de terre rouge, autour de laquelle se promenaient des gens en pyjama blanc. La légende de la photographie ne me paraissait pas beaucoup plus claire : « Salutations d’Auroville – une ville universelle en construction dans le sud de l’Inde. Auroville veut être une cité universelle ou hommes et femmes de tous les pays puissent vivre en paix et harmonie progressive au-dessus de toute croyance, de toute politique et de toute nationalité. Le but d’Auroville est de réaliser l’unité humaine. »
Un peu plus loin sur la page, une charte décrivait ce qui semblait être une sorte de code de conduite à l’usage des « Auroviliens », les habitants de cette « ville universelle » :
« 1. Auroville n’appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l’humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la Conscience Divine.
2. Auroville sera le lieu de l’éducation perpétuelle, du progrès constant, et d’une jeunesse qui ne vieillit point.
3. Auroville veut être le pont entre le passé et l’avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment s’élancer vers les réalisations futures.
4. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. »
Saleté de Southern Comfort ! Le concept de « Conscience Divine », avec ses majuscules, me paraissait fumeux, et je n’avais aucune intention d’aller m’enrôler dans une secte New Age. Je remerciai par politesse l’expéditeur du message, et retournai à ma vie munichoise en me promettant de freiner ma consommation d’alcool.
Deux semaines plus tard, je reçus un second e-mail : un architecte français, Satprem Maïni, répondait cette fois à ma « candidature ». Son message, en substance, m’annonçait qu’il travaillait sur des bâtiments antisismiques à bas coûts, construits autour d’arches, de voûtes et de dômes en terre, qu’il ne savait pas exactement ce qu’il pourrait faire d’un ingénieur en productique, mais que j’étais tout de même le bienvenu. Étrange : pourquoi m’inviter à venir sans savoir ce que je pourrais faire pour lui ? Cela me paraissait toujours aussi saugrenu – mais je commençais à entendre en moi un murmure : celui de la curiosité. Je retournai sur le site d’Auroville. L’endroit avait été fondé en 1968 par Mira Alfassa, une Française installée en Inde comme disciple de Sri Aurobindo, gourou et philosophe bengali, avant de devenir son alter ego spirituel féminin, et de se faire appeler « Mère ». Je lus quelques articles sur le yoga intégral, les énergies renouvelables, la reforestation, le travail spirituel, les témoignages de soixante-huitards européens arrivés là-bas dans les années 1970, ceux d’Indiens ayant décidé de se joindre au projet et de construire la « ville du futur », de matérialiser un progrès humain tout en permettant à des gens de tous horizons de s’enrichir mutuellement…
Mon cynisme et mon rationalisme occidental ruaient dans les brancards, mais la voix de la curiosité murmurait de plus en plus fort à mon oreille. Quelle était la probabilité pour que j’aie un jour une deuxième occasion de travailler sur des voûtes en terre dans une sorte de communauté hippie indienne ? Je pourrais toujours postuler dans une usine de voitures une autre fois, la procédure étant claire et connue ; mais si je laissais se refermer cette porte sur l’absurde que le « hasard » avait entrouverte, pourrais-je la retrouver plus tard ? J’avais l’impression d’être Alice au Pays des Merveilles, après avoir avalé le flacon qui disait : « Buvez-moi. » Je me trouvais sur le seuil inattendu d’une aventure qui piquait mon intérêt. Étrangement, l’enchaînement des événements menant à cette offre de stage n’était pas dénué d’une certaine logique, peu conventionnelle, mais non moins implacable : Tim assis à côté de moi dans ce bar, sa sœur mariée à un Tamoul, le Southern Comfort qui s’allie à l’informatique pour envoyer mon C.V. en Inde, une chaîne de gens inconnus qui, à l’autre bout de la Terre, font passer mon message jusqu’à cet architecte m’annonçant qu’il n’a pas besoin de moi, mais que je peux tout de même le rejoindre… Une machine semblait en marche, et je ne pouvais m’empêcher de me demander où elle voulait m’emmener.
Un an plus tard, j’atterrissais à Chennai6 – seul. Tim et Tom, une fois leur bière cuvée, avaient choisi de ne pas franchir la porte. Je ne pouvais plus loger dans la belle-famille du premier, mais Satprem m’avait entre-temps promis, en plus du stage, une chambre au-dessus de ses bureaux. Tout allait pour le mieux ; c’est en tout cas ce que je me répétais. Mais les portes de l’avion franchies, je me fis avaler tout entier par une bouffée de chaleur humide et lourde. L’odeur de moisi de la moquette de l’aéroport me prit à la gorge, et une seconde voix intérieure se mit à parler plus fort que celle de la curiosité, posant et reposant toujours la même question : « Mais qu’est-ce que tu fous là ? »
Dehors, une foule de gens regardaient les passagers fraîchement débarqués. Le jour venait à peine de se lever, mais des centaines de corps en sueur se pressaient déjà, agitant les bras en tout sens pour attirer l’attention : « Taxi ! Yes, sir ! », « Auto, noproblem ! », « Chennai, yes, welcome ! », « Come, my friend, luggage give ! » Je voulais sourire, être aimable, mais le sentiment de submersion était insupportable : ce n’était pas une foule, c’était un océan. Inondé d’odeurs, entre celles des hommes, des gaz d’échappement et des cuisines matinales, j’étais balloté en tous sens, tiré par des mains anonymes vers un taxi, un rickshaw, un marchand de thé ou je ne savais quoi d’autre. Trop fatigué pour rester poli et détendu, mais pas assez épuisé pour me laisser noyer dans ces vagues humaines, je repoussai tous ceux qui étaient à ma portée, me frayai un chemin au travers de la marée se refermant instantanément derrière moi, et débouchai sur le parking. J’avais eu, dans l’avion, tout le temps d’étudier l’inévitable Guide du Routard, et mon plan était clair : marcher jusqu’à la gare qui devait se trouver de l’autre côté de la rue, prendre un train vers la station d’Egmore au centre de Chennai, puis un rickshaw vers le New Bus Stand, et enfin un bus vers Pondichéry. Sur le papier, un jeu d’enfant…
Traverser la rue se révéla déjà une épreuve. Sur les deux voies sans ligne blanche et sans terre-plein central, quatre ou cinq files de véhicules se croisaient et se doublaient sans cesse, débordant largement sur le bas-côté. Des camions sans âge crachaient des nuages de fumée noire à chaque craquement de leur boîte de vitesses, des bus sans portes ni fenêtres fendaient le trafic sans se soucier des autres conducteurs, d’antiques Ambassadors menaçaient de tomber en morceaux dans les innombrables nidsde-poule, des centaines de motos, mobylettes, vélos constituaient le gros du courant, et au milieu de tout ça, des vaches se prélassaient sur le bitume. Le chaos était total ; et pourtant, personne ne paraissait s’en soucier ou s’en agacer. Je mis plusieurs minutes avant de me décider à traverser la route – le temps, essentiellement, d’accepter le fait que je n’avais que peu de chances d’arriver entier de l’autre côté.
Dans la gare, un vieil homme torse nu, la poitrine crevassée par ses côtes saillantes, dormait par terre devant les guichets. Les sandales des voyageurs le frôlaient lorsqu’ils allaient acheter leur ticket, puis lorsqu’ils s’en allaient vers le quai, mais aucun d’entre eux ne semblait le remarquer.
Le train arrivait tout droit des années 1950, avec ses banquettes en bois, ses ventilateurs de plafond hors service et dévorés par la rouille, ses portes ouvertes en permanence, son entassement de chair humaine le long des ouvertures où le vent, à défaut d’apporter de la fraîcheur, remuait la chaleur. Lors des passages de ponts, les wagons surplombaient le vide, sans provoquer la moindre réaction chez les passagers accrochés à l’extérieur de la carlingue usée, faute de place à l’intérieur. Serré entre deux moustachus, je me retrouvai avec une chèvre sur les pieds et un bébé dans les bras. Par les fenêtres béantes, entre les têtes des autres voyageurs, j’apercevais quelques images : des rivières à l’odeur immonde remplies de sacs plastique, des baraques de tôle dont les habitants sortaient pour déféquer le long des rails, des vaches entourées d’enfants nus et couverts de boue.
Aidé par un passager amical et par la méthode Assimil de Tamoul, je descendis à la gare d’Egmore. Je me fis escroquer par un chauffeur de rickshaw, puis par un « contrôleur » de bus qui m’attribua une place dans son véhicule pour à peine cinq fois le tarif réglementaire. J’avais une bonne demi-heure devant moi avant le départ et marchai un peu sur l’esplanade du Bus Stand. À mes yeux de jeune Occidental ayant grandi dans un cocon aseptisé, la misère et la crasse ambiante étaient écrasantes.
« Donner une barre de chocolat à un gamin des rues fait surgir de la poussière des hordes d’enfants, accompagnés de femmes crasseuses traînant leurs magnifiques saris dans des flaques à l’odeur suspecte. L’une d’elle exhibe la jambe de son petit dernier, attaquée par un genre de gangrène qui l’oblige, du haut de ses quatre-vingts centimètres, à marcher à cloche-pied. Il fait une démonstration enthousiaste de ses talents – non sans s’étaler plusieurs fois dans la boue. Le dilemme qui résulte de la situationsemble insoluble : il est impossible de donner à tout le monde, et une obole arbitraire risque de provoquer, en plus d’un accès personnel de mauvaise conscience, l’explosion d’un pugilat entre les enfants malingres. Ils se verront de toute façon probablement taxés par les grands frères, pères, oncles ou parrains – au sens mafieux du terme – qui, un peu plus loin, jouent les aiguilleurs du ciel pour des bus qui n’ont rien de céleste. »
Ganesh m’avait interrompu pour citer ces dernières phrases, que je reconnus immédiatement. Surpris, je restai un moment sans voix, puis balbutiai :
– Mais !… Ce sont mes carnets de voyage !…
– Et alors ? Cela t’étonne ? Dois-je te rappeler que non seulement j’aime les histoires, mais que je suis le dieu des écrivains ? Je connais chaque mot qui a été ou qui sera écrit ; cela inclut malheureusement les apprentis-scribes comme toi. Et dire que c’est moi qui ai écrit le Mahabharata7 avec ma défense, sous la dictée du grand Vyasa !… Ça, c’était une histoire ! La tienne est un simple laddu comparé aux somptueux buffets épiques auxquels je suis habitué. Enfin, on ne peut pas toujours tomber sur de grands sages et de grandes épopées. Continue ton histoire : j’ai beau avoir l’éternité devant moi, ce n’est pas le cas de tout le monde, et si j’étais toi, j’essaierais de finir mon récit dans cette vie-là plutôt que la prochaine.
J’aurais eu mille questions à poser à Ganesh, mais on ne dissèque pas les sentences des dieux, et je repris mon récit.
Arrivé à la gare routière de Pondichéry quatre heures après avoir quitté Chennai, je pris un rickshaw pour Auroville. À peine en route, le conducteur alluma son autoradio : ses enceintes disproportionnées me crachèrent dans les oreilles les derniers succès du cinéma indien. La musique acheva de m’abrutir, moi qui l’étais déjà suffisamment par ce nouveau monde. Le rickshaw traversa Pondichéry, suivit le littoral sous les cocotiers, et bifurqua sur une rue défoncée remontant à l’intérieur des terres. Après avoir traversé un village où des huttes en pisé s’appuyaient sur les bâtiments en ciment, nous prîmes une longue route sous les flamboyants, pour passer enfin sur un chemin de terre rouge s’enfonçant dans la forêt. Des massifs de fleurs me jetaient au visage leurs parfums – je n’en reconnaissais aucun. J’aperçus quelques maisons derrière les arbres, des Européens et des Indiens sur des vélos, et l’énorme boule dorée dont j’avais vu la photo. Saturé d’images, de sons et d’odeurs, j’étais incapable de digérer ces premières impressions d’Auroville, que j’avalais sans comprendre. Le choc culturel était comparable à la collision frontale de deux trains. Je sentais en moi une nausée provoquée par la misère entr’aperçue à Chennai, et je voyageais depuis plus de vingtquatre heures à l’aide d’une dizaine de moyens de transports différents – tout cela pour quoi ? Pour m’apercevoir à l’arrivée que Satprem, parti en urgence au Gujarat participer à la reconstruction des villages détruits lors du récent tremblement de terre, n’avait prévenu personne de ma venue, et encore moins de l’hébergement promis.
Ayyapan, son bras droit, m’ouvrit tout de même une pièce voûtée dans laquelle je pus dérouler une natte et monter ma moustiquaire. Je m’écroulai aussitôt, pour me réveiller au milieu de la nuit dans un monde de sons inconnus. Était-ce le froissement des feuilles d’arbres contre les persiennes de verre, ou la pluie qui tombait sur la voûte en terre ? Et ce hurlement, entre le miaulement de chat géant et le klaxon de traction avant ? J’étais à plusieurs kilomètres de la mer, mais quelque part, dans un coin de la pièce, un dauphin riait. J’avais atterri depuis moins d’un jour et devenais déjà fou.
Le lendemain était un dimanche. L’endroit où j’avais dormi semblait isolé dans la forêt. Il y avait bien quelques bureaux autour d’une cour commune, mais pas de véritable route, pas de village, pas de magasin où acheter de quoi manger, et personne qui vint travailler ce jour-là et qui aurait pu me déposer quelque part. Ma voûte était située en hauteur, posée sur le toit d’un entrepôt. Une passerelle en bois faisait le tour du bâtiment, jusqu’à un escalier permettant de descendre dans la cour. Un cocotier poussait près des marches ; en me penchant depuis la passerelle et en utilisant une tige de bambou trouvée là, je pouvais toucher ses fruits. Il me fallut une bonne demi-heure pour détacher une noix de coco, et une autre pour l’ouvrir à l’aide d’une pierre et de mon couteau suisse. Je n’avais pas de verre, mais une vieille canette de soda découpée à l’ouvre-boîte me permit d’en récupérer le lait. La manœuvre n’avait rien d’extraordinaire, et n’importe quel gamin du coin aurait fait de même en beaucoup moins de temps et beaucoup plus d’adresse, mais sur le moment, seul dans cet environnement inconnu, je me prenais pour Robinson Crusoé. La première gorgée de ce lait de coco, gagné sur la nature et m’ayant coûté plusieurs litres de sueur, semblait la meilleure chose que j’aie jamais goûtée.
Le lundi matin, les bureaux s’animèrent. Indiens et Européens, jeunes et vieux, hippies et employés modèles arrivaient à vélo, à mobylette et à moto. Je ne savais pas trop quoi faire ; Ayyapan me suggéra de jeter un œil au chantier derrière ma voûte. Une équipe de maçons construisait un nouvel entrepôt pour stocker outils et matériaux ; les murs étaient terminés, mais le bâtiment devait être complété par une voûte semi-circulaire de cinq mètres de portée, sous laquelle un dortoir serait installé. À défaut d’autre chose, j’imitai les maçons et à commençai à porter des briques sur le chantier. Bien que cela les amusa visiblement, ils étaient d’une gentillesse incroyable ; je ne savais rien faire ou presque, mais aucun d’entre eux ne se montra impatient. Chacun tenait à me montrer ce qu’il faisait et à me laisser essayer à mon tour. À la pause, ils partagèrent le thé et les beignets au piment que leurs femmes leur avaient apportés. Pendant quelques semaines, je passais ainsi mes journées sous le soleil, à porter des briques, des palettes de ciment, des sacs de graviers et des seaux d’eau, me brûlant les pieds sur le sol et les lèvres sur le piment. Je pensais souvent au contraste avec mon ancien quotidien. Un mois auparavant, je développais des logiciels destinés à la recherche médicale dans une petite entreprise de la région parisienne ; je hissais maintenant, à l’aide de cordes en fibres de cocos, des matériaux de construction sur un échafaudage en bambou. Était-ce encore « moi » ? Quel était le lien entre la personne qui tapait sur un clavier en France urbaine et celle qui maniait la truelle en Inde rurale ? Que restait-il de « moi » dans ce nouvel environnement, ce nouveau climat, cette nouvelle culture et ce nouveau rôle ?





























