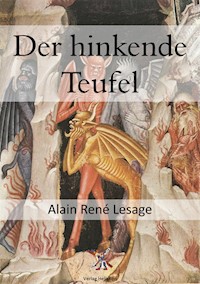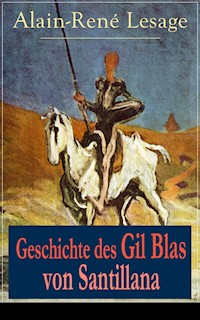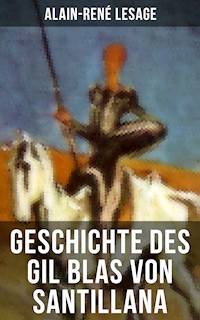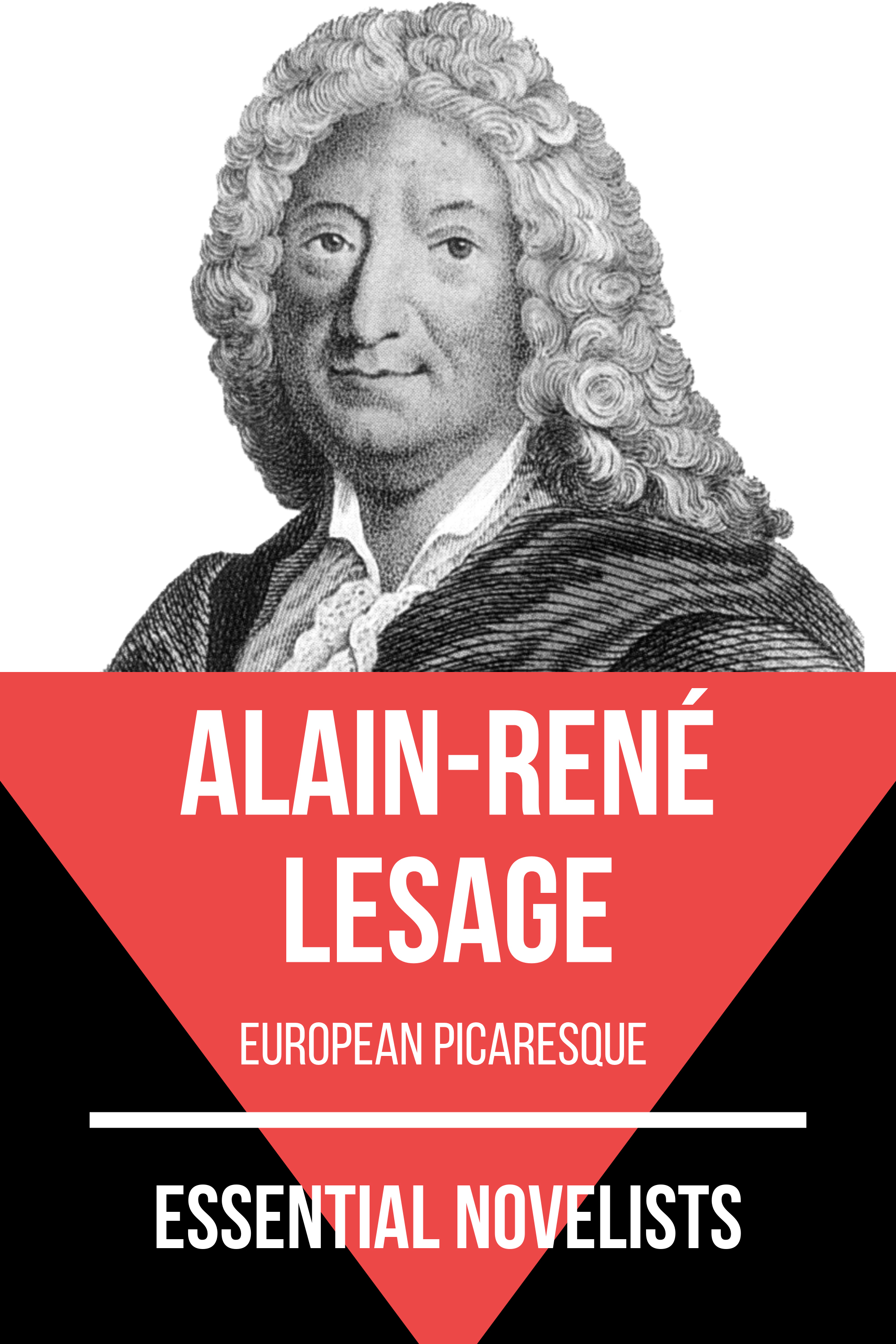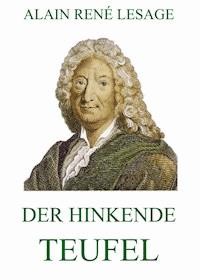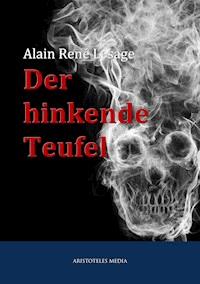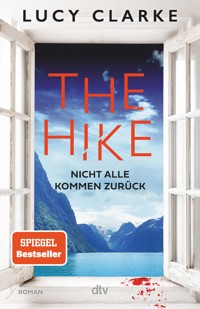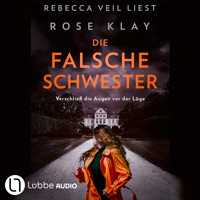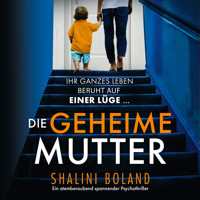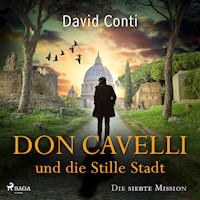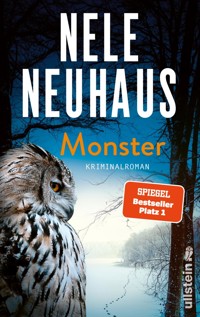Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
L'histoire étonnante d'un jeune homme élevé chez les Indiens avant de devenir un flibustier hors pair.
Édité en 1730, ce roman raconte la vie aventureuse d'un Québécois. Il quitte sa famille d’origine française à sept ans pour se faire adopter par des Iroquois. Ramené quelques années plus tard à ses parents, il n'aspire qu'à participer aux conflits qui opposent Angleterre et France sur terre comme sur mer, avant de devenir flibustier et d'écumer les mers.
Le chevalier de Beauchêne a réellement existé et ses aventures contées par Lesage sont à peine romancées. Elles sont tirées d’un brouillon de Mémoires écrit par Beauchêne.
La biographie romancée d'un jeune Québécois aventureux du 18e siècle !
EXTRAIT
Mon père et ma mère, Français d’origine, allèrent s’établir en Canada, aux environs de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent. Ils vivaient là dans cette heureuse tranquillité que procure aux Canadiens la soumission que le gouvernement exige d’eux. J’aurais été bien élevé, si j’eusse été disciplinable, mais je ne l’étais point. Dès mes premières années, je me montrais si rebelle et si mutin, qu’il y avait sujet de douter que je fisse jamais le moindre honneur à ma famille. J’étais emporté, violent, toujours prêt à frapper et à payer avec usure les coups que je recevais.
Je me souviens que ma mère voulut un jour m’attacher à un poteau pour me châtier plus à son aise, et que n’en pouvant toute seule venir à bout, tout petit que j’étais, elle pria un jeune prêtre, qui venait au logis m’apprendre à lire, de lui prêter la main. Il lui rendit ce service fort charitablement, dans la pensée que cette correction pourrait m’être utile. En quoi certes il se trompa. Bien loin de regarder son action comme un trait de charité dont je lui étais redevable, elle passa dans ma petite tête pour une injure qui me déshonorait, et que je devais laver dans son sang.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Alain-René Lesage ou Le Sage, né à Sarzeau le 8 mai 1668 et mort à Boulogne-sur-Mer le 17 novembre 1747, est un romancier et auteur dramatique français surtout connu comme étant l'auteur du roman picaresque
Histoire de Gil Blas de Santillane.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
AVERTISSEMENT DE L'EDITEUR.
Cet ouvrage respecte scrupuleusement le texte original. Cependant les coquilles typographiques et quelques fautes d'orthographe ont été corrigées. L'éditeur attire l'attention du lecteur sur le fait que cet ouvrage comporte des textes, parfois anciens. L'orthographe a donc été respectée bien qu'elle heurte souvent l'usage actuel. Il en est de même pour les noms de lieux.
© CLAAE 2007© CLAAE 2017
Aventuresdu chevalierBEAUCHÊNE
Capitainede flibustiersdans la Nouvelle-France
Alain-René Lesage
Aventures du chevalierBEAUCHÊNE
Capitaine de flibustiersdans la Nouvelle-France
CLAAE2007
EAN eBook : 9782379110627
CLAAEFrance
Les aventuresdu chevalier de BeauchêneLIVRE PREMIER
Mon père et ma mère, Français d’origine, allèrent s’établir en Canada, aux environs de Montréal, sur le fleuve Saint-Laurent. Ils vivaient là dans cette heureuse tranquillité que procure aux Canadiens la soumission que le gouvernement exige d’eux. J’aurais été bien élevé, si j’eusse été disciplinable, mais je ne l’étais point. Dès mes premières années, je me montrais si rebelle et si mutin, qu’il y avait sujet de douter que je fisse jamais le moindre honneur à ma famille. J’étais emporté, violent, toujours prêt à frapper et à payer avec usure les coups que je recevais.
Je me souviens que ma mère voulut un jour m’attacher à un poteau pour me châtier plus à son aise, et que n’en pouvant toute seule venir à bout, tout petit que j’étais, elle pria un jeune prêtre, qui venait au logis m’apprendre à lire, de lui prêter la main. Il lui rendit ce service fort charitablement, dans la pensée que cette correction pourrait m’être utile. En quoi certes il se trompa. Bien loin de regarder son action comme un trait de charité dont je lui étais redevable, elle passa dans ma petite tête pour une injure qui me déshonorait, et que je devais laver dans son sang.
Je tournai donc toute ma fureur contre ce pauvre diable de maître, et je résolus de le tuer. Me sentant trop faible pour exécuter seul un si grand projet, je le communiquai à plusieurs enfants, aussi méchants que moi, qui ne manquèrent pas de l’approuver, et de m’offrir leurs bras pour une mort si juste. Les conjurés se munirent de pierres, et assaillirent tous ensemble le misérable auquel ils en voulaient ; de façon qu’il aurait éprouvé le sort du premier martyr chrétien, si quelques personnes qui passèrent par hasard dans ce temps-là, ne l’eussent dérobé à nos coups. Ce bon ecclésiastique, nommé Periac, est revenu en France dans la suite. Il demeure actuellement à Nantes, dans un séminaire dont il est supérieur. Il n’y a pas trois mois que je l’ai vu, et c’est lui qui m’a fait souvenir de ce bel exploit, en me disant qu’il était ravi d’avoir fait une fausse prédiction, ayant prédit dans mon enfance que je me ferais tuer avant que j’eusse de la barbe.
Mes parents qui me voyaient faire tous les jours quelque espièglerie, comme celle dont je viens de parler, ne jugeaient pas de moi plus favorablement, et je m’étonne aujourd’hui que je sois encore au monde, après m’être tant de fois exposé à périr. Jamais enfant n’a fait paraître tant de disposition à devenir un querelleur furieux, un nouvel Ismaël fils d’Agar. Je n’étais pas content que je n’eusse entre les mains couteaux, flèches, épées, pistolets : c’étaient là mes poupées. On faisait de moi tout ce qu’on voulait, quand on me promettait de ces armes ; et si l’on avait l’imprudence de m’en donner, je les essayais sur les premiers animaux que je rencontrais. Je n’avais pas sept ans, qu’il ne restait ni chat, ni chien, ni porc dans le voisinage. C’est ainsi que j’exerçais ma valeur, en attendant que je fusse assez fort pour en faire un plus noble usage, et combattre avec mes trois frères contre les Iroquois.
Ces sauvages, gagnés par les présents des Anglais, faisaient quelquefois des courses jusqu’aux portes de Montréal, ils entraient dans le pays par pelotons, se tenaient cachés dans les bois pendant le jour, se rassemblaient la nuit, et venaient fondre sur quelque village. Ils le pillaient, puis se retiraient promptement avec leur butin, après avoir mis le feu aux choses qu’ils ne pouvaient emporter. Mais ils avaient grand soin, surtout, de ne pas oublier les chevelures de ceux qu’ils avaient tués. Je les ai souvent vus couper de ces chevelures, et sans contredit ils s’y prennent plus adroitement que les barbiers d’Europe pour ne point perdre de cheveux, puisqu’ils arrachent en même temps la peau de dessus le crâne. Ils étendent ces peaux sur de petits cercles d’osier, et les conservent précieusement. Voilà les drapeaux qu’ils aiment à prendre sur leurs ennemis. Il faut voir de quel œil on regarde ces trophées chez les Iroquois. On juge de leur courage par la quantité de chevelures qu’ils possèdent. Ils sont honorés et respectés à proportion, sans toutefois que la gloire d’un père qui se sera distingué des autres par son courage, influe le moins du monde, comme en Europe, sur un fils qui paraîtra indigne de lui. La troupe d’Iroquois, qui se faisait le plus redouter vers Cambry et Montréal, avait pour chef un sauvage des plus célèbres. Il aurait pu lui seul fournir de cheveux le perruquier de Paris le plus achalandé. C’était la terreur du Canada. Ce terrible mortel s’appelait La Chaudière noire. Il n’y a personne en ce pays-là qui puisse se vanter de n’avoir pas frémi à ce nom formidable. Croira-t-on bien que l’on demandait dans les prières publiques d’être délivré de sa rage ; de même qu’autrefois, dans certaines provinces de France, les peuples priaient Dieu de les délivrer de la fureur des Normands.
Tout ce que j’entendais dire de ce fameux sauvage, m’inspirait moins de crainte que d’envie de le voir. Je savais que les Iroquois, au lieu de tuer les enfants, avaient coutume de les emporter pour les élever parmi eux. Cela me fit souhaiter qu’ils m’enlevassent. Je suis curieux, disais-je, de connaître ces gens-là par moi-même, et d’éprouver si j’aurai aussi peu d’agrément dans leur habitation, que j’en ai dans ma famille, où l’on me gronde et contredit à tout moment. Les sauvages sans doute me laisseront manier des armes à discrétion ; loin de combattre, comme mes parents, le plaisir que je prends à m’en servir, ils verront avec joie mon humeur belliqueuse, et me donneront des occasions de l’exercer. Je formai donc le dessein de les aller joindre dès la première course qu’ils feraient vers Montréal ; ce qui ne manqua pas d’arriver peu de temps après, ainsi que je vais le raconter.
Monsieur de Frontenac s’embarqua pour passer en France. A peine fut-il parti, que les Iroquois voulurent profiter de son absence pour se venger des ravages qui avaient été faits l’année précédente dans un de leurs cantons1 par messieurs de Denouville, de Caillères, et de Vaudreuil. Ainsi de toutes parts on n’entendit plus parler que de villages surpris, pillés et brûlés. Pour moi, j’attendais impatiemment que la troupe de La Chaudière noire s’approchât de nous, lorsqu’un soir l’alarme se répandit dans nos quartiers. Les hommes courent aux armes, et se préparent à défendre la patrie. Quel sujet de ravissement pour mes yeux, de voir tout le monde s’apprêter au combat. Au lieu de me cacher avec les femmes, je me disposai à suivre mes frères, qui étaient en âge de se servir de leurs épées pour la défense de nos dieux pénates, et je m’écriai, dans l’excès de la joie qui me transportait, que j’étais bien aise de voir ce sauvage dont le nom retentissait de tous côtés : ce qui m’attira de la part de ma mère une réprimande précédée d’un soufflet, qu’à la vérité je n’osai rendre, mais que je me promis bien de ne pas laisser impuni. Je m’échappai de ses mains, quelques efforts qu’elle fit pour me retenir, et courant vers le lieu où j’entendais tirer, j’arrivai sur le champ de bataille, résolu de m’enfuir avec les Iroquois, ou, s’ils dédaignaient de me prendre, d’être du moins spectateur du combat, tant pour me venger de ma mère, que pour jouir d’un spectacle qui m’était agréable.
Les sauvages firent leur coup en moins d’un quart d’heure. Ils tuèrent une trentaine de personnes, avant qu’on fût en état de les repousser, mirent le feu à plusieurs maisons, et se retirèrent avec un butin plus gros que riche, et quelques prisonniers, parmi lesquels mon frère aîné eut le malheur de se trouver. Comme je cherchais des yeux les Iroquois, j’en aperçus douze ou quinze qui démeublaient une maison avant que de la brûler, et qui enlevaient deux petits enfants. Je criai aussitôt à pleine tête : « Quartier ! messieurs ! quartier ! Je me rends ; emmenez-moi avec vous ».
Je ne sais s’ils m’entendirent, mais je me présentai à eux de si bonne grâce, qu’ils ne purent me refuser la satisfaction d’être leur prisonnier. L’un d’entre eux me prit sur ses épaules, et nous rejoignîmes promptement le gros de la troupe. Ce qu’il y a de singulier, c’est qu’au lieu de pleurer comme les autres petits garçons, je tenais dans mes mains un chaudron et un vase d’étain, que le sauvage qui me portait avait quittés pour me mettre sur ses épaules.
Après une marche de huit à dix lieues, les Iroquois, remarquant l’approche du jour, s’arrêtèrent dans le bois pour s’y reposer jusqu’au soir. Comme ils allaient se remettre en chemin, ils furent tout à coup attaqués par deux cents, tant Canadiens qu’Algonquins, qui malheureusement ne s’étant pas aperçus assez tôt du lieu où les prisonniers étaient attachés, ne purent les délivrer. Les Iroquois qui les gardaient, ayant ouï le cri2 de guerre, se hâtèrent de les assommer.
On a bon marché des Iroquois lorsqu’on les surprend. Ils aiment mieux attaquer que se défendre. Aussi prirent-ils bientôt la fuite, nous emportant sur leurs épaules, et laissant neuf des leurs au pouvoir de leurs ennemis.
Les Canadiens qui venaient de faire une si brusque expédition, étaient commandés par messieurs de Maricour, de Sainte-Hélène, et de Longueil3, frères de monsieur d’Iberville, chef d’escadre ; tous trois pleins de valeur, et des premiers de Montréal. Ces braves officiers, poussés par les sollicitations de mes deux autres frères, firent cette tentative pour arracher des mains des sauvages mon aîné et moi.
Dans le canton d’Iroquois où je fus mené, l’on avait coutume de brûler les prisonniers qu’on faisait. On les liait à un poteau, autour duquel on allumait quatre feux à une distance assez grande, pour que ces misérables fussent des deux et quelquefois des trois jours entiers à rôtir avant que d’expirer. Les Canadiens souvent avaient menacé ces sauvages de les traiter de la même façon, s’ils n’abolissaient cette barbare coutume, et ne faisaient meilleure guerre. Les Iroquois avaient toujours méprisé leurs menaces ; de sorte que monsieur de Maricour et ses frères, quelque horreur qu’ils eussent pour une pareille inhumanité, crurent qu’ils devaient à leur tour l’exercer sur les neuf prisonniers qu’ils venaient de faire.
Tout le monde sait que chez ces sauvages un homme qu’ils ont pris, à quelque genre de mort qu’ils le réservent, peut être dérobé au supplice par un des assistants qui l’adopte, en lui jetant un collier au cou, et une couverture sur le corps, sans autre cérémonie. Or, il faut observer que ce monsieur de Maricour dont je viens de parler, avait autrefois été enlevé par les Iroquois, et adopté de cette sorte ; et qu’ayant trouvé moyen de s’échapper de leurs mains, il était revenu à Montréal.
Il voulait donc par représailles, comme chef de l’expédition, que les neuf sauvages qu’il avait pris fussent brûlés. Il y était encore poussé par mes parents, qui demandaient leur trépas avec de fortes instances, et tous les Canadiens y consentaient, mais monsieur de Saint-Vallier, évêque de Québec, se trouvant alors à Montréal, où il était venu donner la confirmation, s’y opposa de tout son pouvoir. Il tint au peuple un discours très pathétique, et employa jusqu’aux larmes pour exciter sa compassion. Cependant la politique rendit inutile l’éloquence du prélat. Monsieur de Maricour fut inexorable, et tous les spectateurs jugèrent aussi qu’on devait dans cette occasion préférer la cruauté à la douceur.
On attacha les prisonniers chacun à un poteau, et l’air aussitôt retentit de leurs voix. Ils commencèrent à chanter ce qu’ils appellent leur chanson de mort. Cette chanson contient ordinairement l’énumération des personnes qu’ils ont tuées dans leurs courses, et le nombre des chevelures qui parent leurs cabanes. Malgré l’appareil effrayant de la mort qui les environne, ils paraissent tranquilles ; on ne voit sur leur visage aucune impression de crainte ni de douleur. Ils regardent comme une marque de lâcheté d’avoir peur de mourir, et même de ne pas chanter quand on va perdre la vie. Il y a peu d’Européens capables d’un si grand sang-froid.
Tandis que monsieur de Maricour donnait ses ordres pour le supplice des neuf Iroquois, il s’aperçut que le plus apparent d’entre eux ne chantait pas, et qu’au lieu de témoigner autant de gaieté que ses compagnons, il était enseveli dans une profonde affliction. Il lui en fit des reproches en langue iroquoise qu’il savait bien.
« — Comment donc, ami, lui dit-il, tu manques de fermeté ! Il semble que tu finisses tes jours à regret ?
— Tu te trompes, lui répondit le sauvage : ce n’est point la mort qui m’afflige et m’empêche de chanter. Je suis plus brave que toi. Regarde mon casse-tête4 ; tu y verras les marques de cinquante-cinq ennemis que j’ai tués. Ce qui m’attriste en ce moment, ajouta-t-il, c’est de t’avoir arraché toi-même, il y a dix ans, au sort que tu me fais éprouver aujourd’hui. »
A ces mots, monsieur de Maricour envisagea l’Iroquois avec plus d’attention qu’auparavant, et le reconnut pour le sauvage qui l’avait adopté. Il court à lui d’abord en l’appelant son père ; il l’embrasse avec transports à plusieurs reprises. Ensuite se tournant vers le peuple, il lui demande la grâce de ce sauvage. Le peuple, déjà tout attendri de cette reconnaissance, commençait à crier qu’on le déliât, quand un nommé Cardinal, jeune bourgeois de Montréal, dont le frère avait été tué dans la dernière expédition, s’étant brusquement approché de l’Iroquois qu’on voulait sauver, lui plongea dans l’estomac le couteau que l’on porte attaché à la jarretière dans ces pays-là ; ce qui fit beaucoup de peine à monsieur de Maricour.
Après qu’on eut fait brûler sept des huit prisonniers qui restaient, on laissa le huitième exposé deux ou trois heures aux feux qui étaient allumés autour de lui, afin qu’il pût parler plus pertinemment des douleurs cuisantes que ses camarades avaient souffertes, lorsqu’il serait de retour dans son canton, où il fut renvoyé pour dire aux siens, que s’ils ne cessaient de brûler leurs prisonniers, ils devaient s’attendre au même traitement. Cet exemple de sévérité eut plus de force sur les Iroquois, que la douceur avec laquelle on en avait usé toujours avec ceux d’entre eux qui avaient été pris. Effectivement on les renvoyait libres, et quelquefois même chargés de présents. Ils ne brûlèrent presque plus de Canadiens depuis ce temps-là. Mais quelques Hurons, et grand nombre d’Algonquins me donnèrent cet amusement pendant les six années que je demeurai chez les Iroquois.
En arrivant dans le village, je retrouvai une mère. Une femme qui venait de perdre dans le combat un de ses enfants avec son mari, m’adopta ; faisant choix d’un autre époux, elle fut bientôt consolée. Mais je parle en Européen ; elle n’avait pas besoin de consolation : bien loin de s’affliger de la perte qu’elle venait de faire, elle s’en réjouissait : outre l’honneur infini que faisaient rejaillir sur elle les défunts qui étaient morts glorieusement pour le pays, ils lui laissaient pour succession une copieuse quantité de chevelures.
Il y avait plusieurs enfants de mon âge dans la cabane, et un assez grand nombre dans le village. Je crus n’avoir rien perdu, puisque je me voyais un père, une mère, des frères et des compagnons. Mais ce qui me plaisait le plus dans mes nouveaux parents, c’est qu’au lieu de m’em-pêcher, comme les premiers, de toucher aux armes, ils m’apprenaient à m’en servir, et m’y laissaient exercer continuellement. Je m’attirais néanmoins de temps en temps des corrections un peu rudes, parce que je cherchais souvent querelle, et que j’en venais aux mains avec d’autres petits garçons que je blessais dangereusement. Il y avait tous les jours quelque tête cassée de ma façon. Ce qui était cause que mes parents sauvages voulaient quelquefois me renvoyer en Canada, quoiqu’ils m’aimassent tendrement. Ils ne pouvaient pourtant s’y résoudre, car je leur témoignais une si grande répugnance à les quitter, quand ils me menaçaient de me faire conduire à Montréal, que je les attachais plus fortement à moi. J’allai en course contre d’autres sauvages, et l’on me mit des grandes parties de chasse dès l’âge de douze ans. Il est vrai que j’étais plus robuste et plus formé que les autres jeunes gens ne le sont à dix-huit ; sans cette force qui a toujours été en augmentant jusqu’à ce jour, et qu’on peut appeler extraordinaire, j’aurais péri dans cinquante occasions où seule elle m’a sauvé la vie.
Je pourrais mieux que personne faire ici une fidèle peinture des usages et des mœurs des Iroquois ; mais il y a tant de ces faiseurs de relations, que je laisse de bon cœur à d’autres le plaisir de faire connaître ce qu’il y a de faux dans celles qui sont entre les mains de tout le monde. Ayant été élevé parmi ce peuple sauvage, je dois être bien instruit de ses coutumes. J’en ai même tellement pris l’esprit, que je me suis regardé longtemps comme Iroquois. Il m’a fallu plusieurs années, je ne dis pas pour vaincre, mais seulement pour adoucir un peu cette férocité que j’avais contractée avec ces hommes si différents des autres, et dont le genre de vie ne flattait que trop mes inclinations.
Je n’aspirais qu’aux combats. Cependant quelque envie que j’eusse de me battre, je refusais de suivre mes parents, quand ils allaient en guerre contre les Canadiens, et même contre les Algonquins ; ce qu’ils faisaient assez souvent pour plaire aux Anglais qui les y engageaient, et leur envoyaient pour cela quantité d’armes, de quincaillerie et d’eau-de-vie. Ils firent de si fréquentes courses en Canada, que monsieur de Frontenac, qui en était gouverneur, se mit à leurs trousses vers l’année 1695 et vint piller le canton où je demeurais. Nos sauvages eurent cette obligation aux Anglais qui étaient avec nous, et qui leur avaient fait entendre que rien n’était plus aisé que d’arrêter monsieur de Frontenac sur la frontière même.
On ne saurait être plus embarrassé que je le fus dans cette occasion. Je ne voulais point absolument combattre contre les Canadiens ; les Iroquois me croyant assez fort pour payer de ma personne, menaçaient de me tuer si je ne faisais comme les autres. Quel parti prendre ? Heureusement pour moi l’amour que je conservais pour ma patrie ne fut pas mis à une forte épreuve, puisque les Canadiens entrèrent dans notre canton en si bon ordre, qu’il nous fallut reculer et le laisser ruiner, sans pouvoir rien entreprendre contre eux, ni leur faire d’autre mal que de tuer quelques sentinelles la nuit à coups de flèches.
Comme ils bornaient leurs ravages à détruire, arracher, brûler, sans profiter de nos dépouilles, ils se lassèrent bientôt d’exercer une fureur infructueuse. Ils retournèrent sur leurs pas. Ce que nous n’eûmes pas plus tôt remarqué, qu’il nous prit envie de les poursuivre, donnant plus à la vengeance que nous n’avions fait à la défense du pays. Nous ne songions nullement à des attaques générales. Chaque chef de village conduisait son monde ainsi qu’il le jugeait à propos. Divisés en trois ou quatre troupes, nous ne fîmes pendant plusieurs jours que côtoyer les ennemis, et voltiger la nuit sur leur aile gauche, sans pouvoir les entamer.
Un soir pourtant nous en aperçûmes environ deux ou trois cents, qui, ne nous croyant pas si près d’eux, s’étaient retirés dans une prairie assez loin du reste de leur armée. Nous résolûmes d’enlever ce petit corps que nous attaquâmes un peu après minuit. Je me mis de la partie, sur l’assurance qui me fut donnée que c’étaient des Hurons qui prenaient sur la gauche pour gagner leur pays le long du grand lac. Nous en tuâmes d’abord une demi-douzaine ; mais quatre ou cinq pelotons, qui étaient comme des gardes avancées, nous reçurent de si bonne grâce, qu’ils nous mirent bientôt en désordre et en fuite. Ils nous choisissaient à la lueur des feux allumés autour de leurs troupes, et ne perdaient pas un coup de fusil.
La passion que j’avais pour la guerre, ne me permettant pas d’être des premiers à me retirer, je fus enveloppé avec mon père adoptif, qui, voulant me dégager de cinq ou six Canadiens qui m’environnaient, se trouva pris avec moi. Nous fûmes attachés à des arbres, et nous comptions bien qu’on nous ferait brûler dès qu’il ferait jour. Je n’étais pas trop content de l’être si jeune ; et ce qui me mortifiait encore plus qu’une mort prématurée, c’est que, n’ayant pas tué d’ennemis, je n’avais rien à dire pour chanson de mort. Mon père sauvage entrant dans ma peine, me disait pour me consoler, qu’il suffisait pour mourir en brave homme, que j’eusse été pris les armes à la main.
Quoiqu’il dût être persuadé qu’il serait sauvé avec moi si je me faisais connaître, il m’exhortait cependant à ne pas découvrir que j’étais Canadien. Je le lui promis sans savoir pourquoi, et sans lui témoigner qu’il me semblait que c’était faire le fin fort mal à propos. Trop de vivacité néanmoins m’empêcha de lui tenir parole. Parmi ceux qui vinrent nous examiner lorsqu’il fut jour, un grand homme me prit le menton pour me regarder en face, et dit ensuite aux autres : — Parbleu ; messieurs, en voici un bien jeune ; ce serait dommage de le faire rôtir, ce n’est qu’un enfant.
A ces paroles que je ne pus souffrir patiemment ; je lui dis en colère :
— Grand benêt, on n’a qu’à me délier et me lâcher après toi, tu verras si je ne suis qu’un enfant.
Mon emportement causa une extrême surprise aux Canadiens, qui s’approchèrent de moi en foule pour me considérer avec toute l’attention que leur paraissait mériter un jeune Iroquois qui parlait si bien la langue française. Nous fûmes aussitôt détachés, mon père sauvage et moi. On nous conduisit au commandant, qui, m’ayant fait avouer que j’étais Canadien, nous offrit la vie, si nous voulions qu’il nous emmenât avec lui. J’acceptai son offre sans balancer, comptant bien que je m’enfuirais dès la première occasion qui s’en présenterait. Pour le sauvage, il refusa de me suivre, et ne cessa de me faire des reproches, jusqu’à ce que lui ayant fait donner la liberté, je lui eus promis de le rejoindre dans peu.
L’officier qui commandait la troupe des Canadiens que nous avions attaqués si mal à propos, s’appelait alors monsieur Legendre. Je dis alors, parce que je l’ai connu depuis sous le nom de comte de Monneville. J’ai couru bien des aventures avec lui, comme on le verra dans l’histoire de ma vie. Nous conçûmes dès ce temps-là l’un pour l’autre une amitié qui dure encore aujourd’hui.
Il emmenait esclaves plusieurs femmes iroquoises et beaucoup d’enfants. J’appréhendais fort d’aller avec lui sur le même pied ; et dans ce cas je me proposais de me faire connaître à mes parents de Montréal. Mais ma crainte fut vaine. Il me fit donner la paie de soldat dans une méchante bicoque où il commandait à une cinquantaine de lieues au nord de Chambly, et j’y jouis d’une entière liberté. Il fit plus, mon air dégourdi lui plut. Il me mit de toutes ses parties, m’obligea de manger à sa table, et me traita comme son égal.
Nous passions les jours dans une belle habitation qu’il avait dans le pays, et à laquelle tout autre que moi se serait trouvé trop heureux de se fixer. Monsieur Legendre menait là une vie douce et très rangée ; cela ne me convenait point. Aussi me fut-il impossible de m’en accommoder longtemps, et de répondre à l’amitié qu’il avait pour le repos ; il me fallait des fatigues, des courses, des combats, ou du moins quelques querelles pour m’amuser, et je n’en avais là aucune occasion. Cependant dans un séjour si tranquille, monsieur Legendre et moi nous pensâmes mourir de mort violente.
Un officier du fort me voyant un matin avec des soldats, qui, pour chasser le mauvais air, buvaient de l’eau-de-vie, se joignit à nous. Notre entretien roulait sur les Iroquois. Les soldats étant bien aises de s’instruire à fond des mœurs de ces sauvages, me faisaient des questions, et je prenais plaisir à satisfaire leur curiosité. L’officier, se mêlant à la conversation, se mit aussi à m’interroger. Après quoi, me priant de le suivre, il me mena dans son cabinet ; il tira d’une armoire une bouteille qu’il décoiffa, prit un verre qu’il remplit, et me le présenta :
— Buvez de ce vin, me dit-il ; je crois qu’il sera de votre goût.
Je portai le verre à ma bouche ; je mouillai seulement mes lèvres, et fis la grimace comme un homme qui n’aimait point cette liqueur.
— Comment donc, s’écria-t-il, est-ce que vous trouveriez ce vin mauvais ?
— Très mauvais, lui répondis-je, avec toute la franchise d’un sauvage qui ne sait point mentir par politesse.
— Je vois bien, reprit-il en riant, que vous ne vous y connaissez guère ; c’est un des meilleurs vins de France. Je suis persuadé que monsieur Legendre en jugerait autrement que vous. Je voudrais bien, ajouta-t-il, partager avec lui une petite provision que j’ai de ce bon vin, et dont on m’a fait présent ; mais c’est ce que je n’oserais lui proposer moi-même. Nous sommes un peu brouillés, et peut-être recevrait-il mal mon compliment. Il faut, par votre adresse, nous réconcilier tous deux.
— Je ne demande pas mieux, lui repartis-je ; apprenez-moi seulement de quelle façon je m’y dois prendre.
— Il n’y a rien de plus facile, me dit l’officier ; faites-lui goûter de mon vin, sans lui dire d’où il vient ; et s’il le trouve excellent, comme je n’en doute pas, vous m’en avertirez secrètement. Je lui en enverrai quelques barriques ; et j’ai dans la tête que ce petit présent donnera lieu à notre réconciliation.
J’approuvai fort ce projet de raccommodement, et je promis de bonne foi de travailler à le faire réussir. Je reçus de la main de l’officier une bouteille bien cachetée, et je l’assurai que j’en ferais l’usage qu’il désirait. Par le plus grand bonheur du monde, je ne quittai pas sur-le-champ l’officier ; je m’amusai encore quelque temps avec lui ; ensuite je me retirai sans emporter la bouteille que je laissai par oubli, dans le fort, et j’allai retrouver mes deux soldats avec qui je continuai jusqu’à la nuit à chasser le mauvais air. Le lendemain matin, m’étant ressouvenu que je n’avais pas fait ce que souhaitait l’officier, je me disposais à retourner chez lui, lorsqu’un soldat vint m’annoncer qu’on l’avait trouvé, ainsi que ses deux domestiques, morts dans leurs lits, et tous trois du même poison, suivant le rapport du chirurgien. Je ne doutai point que ce funeste accident ne fût l’ouvrage de la bouteille de réconciliation ; et après avoir conté à monsieur Legendre ce qui s’était passé le jour précédent entre l’officier et moi, nous fîmes là-dessus mille raisonnements, sans pouvoir comprendre comment cela s’était pu faire, et sans oser décider si le défunt était innocent ou coupable. Quoi qu’il en soit, je remerciai Dieu de ne m’avoir pas donné de ces tempéraments posés et flegmatiques, qui songent à tout, et n’oublient pas le moindre article des commissions dont ils sont chargés.
Ce triste événement, quoique monsieur Legendre n’eût rien à se reprocher, ne laissa pas de le mettre dans la nécessité d’aller à Québec. Il me proposa de faire avec lui ce petit voyage, et j’acceptai volontiers la proposition. En passant par Montréal, je voulus par curiosité voir mes parents sans me faire reconnaître. Je m’imaginais que c’était une chose aisée ; je me trompais : ma résolution ne put tenir contre les mouvements de tendresse que la nature inspire dans ces occasions. Quand j’abordai mon père et ma mère, ces deux noms sortirent de ma bouche malgré moi, au lieu de ceux de monsieur et de madame que je croyais seulement prononcer.
Je fus reçu au logis comme l’enfant prodigue. Les auteurs de ma naissance remercièrent le ciel de mon retour ; pour mes frères, qui ne m’avaient jamais aimé, ils en eurent peu de joie, et les voisins en frémirent. Ces derniers se souvenant encore de mes espiègleries, frémirent en me revoyant. Mon père et ma mère allèrent avec empressement demander ma liberté à monsieur Legendre, qui ne put la refuser à leurs instances, quelque chagrin qu’il eût de me perdre.
On juge bien qu’un garçon de mon humeur ne pouvait faire un long séjour dans la maison paternelle sans s’y ennuyer. Je regrettai bientôt mes sauvages : je n’étais pas tout à fait le maître au logis ; ce qui me paraissait un état trop gênant : je trouvais fort dure la nécessité d’être soumis au droit que mon père et ma mère avaient de me faire des réprimandes impunément à l’égard de mes frères, quoiqu’ils fussent officiers et mes aînés, je les mis sur un bon pied. Je les accoutumai à plier devant moi, aussi bien que les étrangers, qui, pour n’être pas obligés d’avoir tous les jours les armes à la main, aimaient mieux se résoudre à souffrir mes airs de hauteur.
Pour éviter l’oisiveté dans laquelle je ne pouvais manquer de tomber, je me donnai tout entier à la chasse. Pour cet effet, je m’associai avec des Algonquins ; et vivant plus en sauvage qu’en Canadien, j’étais souvent des six mois sans revenir chez mes parents, qui, loin de se plaindre de ces longues absences, m’en savaient alors fort bon gré. Quelquefois aussi je revenais avec une troupe d’Algonquins qui m’avaient choisi pour leur chef, et qui suivaient mes ordres.
En arrivant dans Montréal à leur tête, j’étais plus fier qu’un général ; et malheur aux bourgeois qui ne me saluaient pas profondément, ou qui m’osaient regarder entre deux yeux. Une affaire que j’eus dans cette ville vers le milieu de l’année 1701, m’attacha tout de bon à mes Algonquins. Voici le fait : nous nous chargeâmes environ cent canadiens et moi d’escorter monsieur de La Mothe-Cadillac, qu’on envoyait avec deux officiers subalternes, à près de deux lieues de Montréal, commander au Détroit5. Quand nous fûmes à l’endroit qu’on nomme le Saut de la Chine, parce qu’il y en a un en effet sur le fleuve de Saint-Laurent, et qu’on est obligé d’y faire le portage, monsieur de Cadillac s’avisa de visiter les canots, pour voir si nous n’emportions pas plus d’eau-de-vie qu’il n’était permis. Il en découvrit de contrebande dans plusieurs canots. Il éleva aussitôt la voix, et demanda d’un ton de maître à qui elle était. Il y avait auprès de lui un de mes frères qui lui répondit, sur le même ton, qu’elle nous appartenait, et que ce n’était point à lui à y trouver à redire.
Cadillac était gascon, et par conséquent vif. Il brusqua mon frère, qui tomba sur lui l’épée à la main. Cadillac le reçut en brave homme ; et le faisant reculer, il allait le désarmer lorsque, me jetant entre eux deux, j’écartai mon frère pour prendre sa place, et je poussai à mon tour si vivement son ennemi, que celui-ci n’eut pas sujet d’être fâché qu’on nous séparât. Je crois qu’il est encore vivant ; qu’il me donne, s’il l’ose, un démenti.
Nous n’étions qu’à trois lieues de Montréal, Cadillac y retourna pour porter ses plaintes. J’eus l’indiscrétion de l’y suivre, au lieu de me retirer avec mes sauvages. Monsieur de Champigny, qui était alors intendant, me fit dire à mon arrivée de lui aller parler. On me conseilla de m’en-fuir. Je rejetai ce conseil, qui me parut moins prudent que timide, et ne balançai pas un moment à me rendre chez l’intendant, sans être agité de la moindre frayeur. Je croyais, au contraire, qu’il devait lui-même craindre, et qu’il ne serait pas assez hardi pour me dire quelque chose de désobligeant.
J’entrai dans la salle d’un air effronté, habillé en sauvage à mon ordinaire. Je me souviens qu’il y avait autour de lui plus de cinquante officiers, outre monsieur de Ramesé, gouverneur de la place, et plusieurs dames.
— Approchez, me dit d’un air assez doux l’intendant, approchez, monsieur le mutin. C’est donc vous qui tirez l’épée contre vos officiers ?
— Oui, monsieur, lui répondis-je, c’est moi ; et je l’ai dû faire pour ne pas laisser égorger mon frère à mes yeux.
— Votre frère, reprit-il, est un rebelle qu’il ne fallait pas imiter, et qui subira la rigueur des peines portées par les ordonnances, si on le peut attraper. Pour vous, je vous condamne au cachot, où vous demeurerez, s’il vous plaît, jusqu’à ce que monsieur de La Mothe veuille bien vous pardonner.
Je suis persuadé que l’intendant ne voulait que me faire peur, et qu’on était convenu que monsieur de Ramesé avec les autres officiers demanderaient grâce pour moi, si je me soumettais sans murmure à l’arrêt prononcé ; mais il n’y eut pas moyen. Le terme de cachot me fit monter le feu à la tête ; et regardant monsieur de Champigny d’un air irrité :
— Ce ne sera pas, lui répondis-je fièrement, tandis que j’aurai mon sabre que j’irai au cachot, ni tant que mes sauvages seront dans la place.
Là-dessus je fis quelques pas pour sortir ; alors tous les officiers se mirent au-devant de moi, me désarmèrent en m’assurant qu’il ne me serait rien fait, si j’obéissais à monsieur l’intendant. Comme je n’en voulais rien faire, malgré tout ce qu’on me pouvait dire, les gardes du gouverneur me saisirent enfin, et me menèrent, ou plutôt me portèrent en prison, non sans recevoir de moi bien des gourmades, qu’ils me rendirent au centuple.
Je passai trois jours dans le cachot les fers aux pieds, et rongeant mon frein. Après cela l’intendant, dont l’intention était de ménager mes sauvages qui murmuraient de ma prison, me fit venir devant lui, et me dit qu’il était fâché que je l’eusse réduit à me punir ; qu’il m’estimait ; que je pouvais compter qu’il me servirait en tout ce qui dépendrait de lui ; qu’il m’exhortait seulement à faire tous mes efforts pour modérer ma violence, et qu’à ma considération il faisait grâce à mon frère. Grâce qui devint inutile à celui-ci, puisque la honte d’avoir été battu par Cadillac le fit passer chez les sauvages, d’où il n’est point revenu depuis ce temps-là.
Le jour que je sortis de prison, j’appris que monsieur de Ramesé avait, par amitié pour moi, fait des excuses à monsieur de La Mothe, et qu’il avait d’abord obtenu de l’intendant que je ne serais qu’une heure au cachot, mais qu’une vieille madame d’Arpentigny, qui, par malheur pour moi, grossissait alors la cour de monsieur de Champigny, avait fait surseoir mon élargissement ; que cette méchante femme avait représenté qu’on ne pouvait me traiter trop sévèrement ; qu’elle avait dit à l’intendant :
— Ah ! Monseigneur, vous devriez le laisser pourrir en prison, vous rendriez en cela un grand service au pays ; personne n’est à couvert des fureurs de ce garnement ; moi, qui vous parle, monseigneur, j’ai sujet de me plaindre de lui ; il m’a dernièrement insultée avec une insolence à mériter punition corporelle.
Voici en quoi consistait cette prétendue insulte faite à la dame d’Ar-pentigny. Je lui avais vendu des pelleteries à crédit, en lui prescrivant un temps pour me payer. Elle l’avait laissé passer sans me satisfaire ; je lui demandai de l’argent, elle m’en refusa ; je la menaçai dans des termes qu’elle ne trouva peut-être pas assez mesurés. Je ne fis pourtant que lui dire en jurant, que si je n’étais pas payé dans vingt-quatre heures, j’irais l’écorcher toute vive dans sa maison et y mettre ensuite le feu.
Indépendamment des bontés de monsieur de Ramesé à mon égard, il y avait une bonne raison pour me mettre en liberté. Je devenais nécessaire par rapport aux sauvages qui m’étaient attachés. La guerre était recommencée en Europe au sujet de la couronne d’Espagne, et par conséquent entre les Anglais de la Nouvelle-Angleterre et les Canadiens. C’était là une de ces conjonctures où il est important de ménager les sauvages. Les Iroquois avaient enterré la hache, pour parler leur langage, c’est-à-dire avaient fait la paix ; mais on craignait qu’ils ne la rompissent dès l’année 1698. Monsieur de Frontenac, peu de temps avant sa mort, avait fait une espèce de trêve avec eux, les trouvant tout étourdis de la perte de leur fameux chef La Chaudière noire, tué par un parti de jeunes Algonquins. On fit si peu de fonds sur un traité si irrégulier, que monsieur de Callières, jugeant qu’on en devait faire un autre, conclut une paix solide avec les Iroquois en 1701, par les soins et l’adresse de monsieur de Maricour, et du père Anselme, jésuite. Ces deux habiles négociateurs se transportèrent chez tous ces sauvages, dont ils connaissaient parfaitement le génie, et les engagèrent à envoyer à Montréal leurs députés, qui y plantèrent, comme ils disent, l’arbre de paix, et y dansèrent le calumet au nombre de huit à neuf cents.
Depuis ce temps-là, les Anglais n’ayant rien épargné pour déterrer la hache contre nous, y réussirent en partie, puisque à force de présents, ils gagnèrent quelques-uns de ces sauvages, qui, vers la fin de l’année 1703, mirent le feu par surprise au fort où monsieur de Cadillac commandait au Détroit.
La nation des Iroquois, en général, ne regarda pas néanmoins cette entreprise comme une infraction du traité, puisqu’en ayant rencontré dans les bois plusieurs troupes peu de temps après, nous en fûmes reçus en amis plutôt qu’en ennemis. Ils voulurent absolument fumer, et faire chaudière6 avec nous. Trente Algonquins qui m’accompagnaient avaient d’abord appréhendé qu’il ne nous fallût en venir aux mains ; mais les Iroquois nous protestèrent que jamais ils ne lèveraient la hache sur le Français ni sur ses alliés ; que pour l’Anglais, dont ils avaient sujet d’être mécontents, ils ne lui feraient point de quartier. Je fus curieux de savoir pourquoi ils se plaignaient des Anglais, et je le leur demandai. Ils me répondirent qu’ils n’en étaient pas satisfaits pour plusieurs raisons, et entre autres pour une qui leur tenait fort au cœur ; qu’ils avaient porté quelques pelleteries à Corlard dans la Nouvelle-York, où après avoir cherché pendant deux jours un des leurs qui s’y était égaré, ils l’avaient trouvé pendu dans un lieu écarté.
A ce mot de pendu, tous les Iroquois poussèrent des cris effroyables, et firent éclater une vive douleur. On eût dit qu’ils avaient encore devant les yeux le compagnon malheureux dont ils déploraient la destinée. Je ne perdis pas une si belle occasion de les exhorter à ne point laisser impuni un affront si sanglant. Je fis plus ; je m’offris à servir leur vengeance et à partir sur-le-champ avec eux pour aller tirer raison de cet outrage. Ils me prirent au mot. Ensuite réfléchissant sur notre petit nombre, ils me demandèrent si je ne pourrais pas obtenir un plus grand secours de notre père Onuntio7.
Je haranguai donc les algonquins ; près de quatre cents se laissèrent persuader ; et lorsqu’ils m’eurent donné leur parole, nous partîmes pour cette expédition sur la fin de juin 1704. Les députés iroquois s’en étaient auparavant retournés dans leurs cantons, pour donner avis à leurs frères du résultat de leur députation. Une partie devait nous venir joindre en chemin, et les autres à certain jour marqué, entrer dans le pays en plusieurs troupes. Nous arrivâmes au rendez-vous avant le jour prescrit, quoique la route fût difficile, et longue de plus de cent cinquante lieues. Malheureusement monsieur de Beaucour avait amené avec lui quelques soldats français, qui, n’étant pas accoutumés à nos canots, ne pouvaient résister à la fatigue et nous incommodaient beaucoup plus qu’ils ne nous servaient. Quand il y avait des portages à faire, comme il y en avait plusieurs, surtout un de vingt-cinq lieues, ils avaient assez de peine à se traîner eux-mêmes ; ce n’était pas le moyen de nous aider à porter nos canots et nos vivres. Cependant ce n’aurait été rien que cela, si l’un d’entre eux ne nous eût fait manquer notre coup par la plus noire des trahisons.
Ce perfide, pendant que nous nous arrêtâmes dans les bois, à trente lieues des premiers villages anglais, pour cacher nos canots, et nous reposer en attendant le jour dont nous étions convenus avec les Iroquois, ce traître ayant repris des forces nous prévint, et alla avertir nos ennemis de notre arrivée ; de sorte que nous demeurâmes fort sots, quand nous approchâmes d’un gros bourg, que nous nous étions fait fête de ravager le premier. Nous aperçûmes bien deux mille Anglais armés, qui nous y attendaient de pied ferme. Ce qui nous obligea de nous retirer promptement, et de regagner les bois. Comme nous n’étions pas éloignés d’Orange, dont la garnison pouvait nous couper, nous fûmes contraints de retourner à nos canots sans avoir tiré un coup de fusil. Cela nous piqua d’autant plus, que l’année précédente, monsieur de Beaubassin, fils de monsieur de La Valière, major de la ville de Montréal, avait ravagé plus de vingt-cinq lieues de ce même pays, quoiqu’il n’eût avec lui qu’une poignée de Canadiens, et beaucoup moins de sauvages que nous n’en avions.
Les frais de l’armement n’étaient pas si considérables que nous ne fussions aisément consolés de cette fausse démarche, si nous en avions été quittes pour perdre nos pas ; mais nous n’avions porté des vivres que pour la moitié du voyage, comptant que les magasins ennemis nous en fourniraient de reste pour notre retour. C’est ainsi que nous nous étions trompés dans notre calcul ; et notre équipée nous pensa coûter la vie à tous, du moins y périt-il plusieurs de nos compagnons, qui demeuraient en chemin sans pouvoir nous suivre, ou qui par faiblesse laissaient emporter leurs canots à la rapidité de l’eau, et se noyaient des sept ou huit hommes à la fois.
Mes sauvages se tiraient d’affaire un peu moins mal que les autres ; ils attrapaient toujours quelques poissons ou quelques pièces de gibier, mais en petite quantité, la saison n’étant pas favorable pour la pêche à cause des chaleurs. Ce qui les faisait murmurer contre messieurs de Beaubour et de Vaudreuil, et surtout contre moi, pour l’amour de qui ils s’étaient mis en campagne. L’un d’entre eux, gros garçon des plus simples, porta son ressentiment plus loin, et nous fit rire un soir, malgré la misère où nous étions. On sait que les sauvages soumis à la France, sont presque tous baptisés, et si ignorants, qu’ils ne savent pas les premiers principes de la religion chrétienne ; on les regarde comme des docteurs, et comme les théologiens du canton, lorsqu’ils poussent l’érudition jusqu’à retenir par cœur les litanies de la vierge, qu’ils disent publiquement soir et matin pour toutes prières. Quant aux autres, indociles élèves des missionnaires, ils ne savent que répondre : Ora pro nobis. Encore écorchent-ils ces trois paroles. Il arriva donc qu’un gros réjoui de ces derniers, qui nous étourdissait tous les jours de ses Ora pro nobis, ayant un soir gardé un profond silence, nous surprit tous par cette nouveauté. « Comment donc, Makina, lui dis-je après la prière, tu n’as rien dit aujourd’hui ? Tu n’as point prié l’onuntio ? Il me répondit brusquement : « matagon tarondi, matagon ora pro nobis. » « Que Dieu me donne à manger, je lui donnerai des ora pro nobis. »
La plupart des autres sauvages ne trouvaient pas qu’il eût si grand tort. Quelques-uns même l’imitèrent ; et comme nous n’avions presque rien mangé depuis trois jours, le désespoir commençait à s’emparer de nous. Personne ne se sentait assez de vertu pour exhorter les autres à la patience. Je crois que nous serions tous morts enragés dans les déserts, si nous n’eussions pas tout à coup été secourus par cette même providence, contre laquelle nous n’avions pu nous défendre de murmurer. Il nous restait encore près de la moitié du chemin à faire, lorsqu’il nous arriva des vivres.
C’était monsieur de Vaudreuil lui-même qui nous les envoyait. Averti de l’état déplorable où nous étions par un de ces sauvages, qu’on appelle jongleurs, il s’était hâté de prévenir notre perte. Ce jongleur l’avait assuré que son ouahiche, ou démon, lui avait dit pendant la nuit que ses frères étaient trahis, et revenaient sans vivres aussi bien que toute leur troupe. Nous avions en effet avec nous deux frères de ce sauvage, l’un desquels était son frère jumeau. Ceux qui me connaissent savent bien que mon défaut n’est pas d’être trop crédule ; néanmoins je confesse que des jongleurs m’ont souvent étonné, s’ils n’ont pu me persuader. Je rapporte ce fait, parce qu’il est certain que, sans ce jongleur, nous aurions tous péri dans les bois. De quelque façon qu’il eût appris l’état où nous nous trouvions, soit par magie, soit en songe, ou, comme disent nos savants, par sympathie, que nous importe ? Il le devina toujours à bon compte, et nous sauva.
Monsieur de Vaudreuil s’était moqué le premier de l’avis du jongleur, et ne s’était déterminé à nous envoyer du secours à tout hasard, qu’à la pressante sollicitation de plusieurs officiers, qui lui représentèrent que, sans avoir égard aux visions du sauvage, il fallait faire semblant de les croire mystérieuses, et le charger de conduire lui-même un petit convoi ; ce qui fut exécuté plus par plaisanterie qu’autrement. Quiconque a fréquenté monsieur de Vaudreuil, lui aura sans doute entendu raconter cette histoire, qu’il ne se lassait point de répéter, non plus que vingt-cinq Français qui furent témoins de la confiance avec laquelle le jongleur lui débita l’entretien qu’il prétendait avoir eu avec son démon.
Le mauvais succès de cette entreprise rendit mes sauvages plus circonspects, et moins empressés à se joindre aux Canadiens ; la perfidie du soldat français les prévint terriblement contre toute la nation. Ils ne voulaient plus avoir de liaison avec un peuple qui leur paraissait capable de violer ce qui doit être le plus sacré parmi les hommes ; et s’ils demeuraient encore soumis à la France, je m’apercevais que c’était plutôt par crainte que par inclination, tant ces bonnes gens, dans leur ignorante simplicité, aiment qu’on ait de la bonne foi.
Je fis moi-même quelque temps après dans leur esprit assez mal l’apologie de la nation française, en les quittant d’une manière qui ne dut pas leur faire plaisir. Ils n’auraient pas manqué de me le reprocher, si, pour me mettre à couvert de leurs reproches, je ne les eusse abandonnés pour jamais. C’est un détail que je vais faire, sans chercher à m’excuser de leur avoir faussé compagnie.
Monsieur de Subarcas, gouverneur d’Acadie, fit fréter dans son port une frégate nommée la Biche. Ensuite il s’adressa, pour avoir du monde et former son équipage, à monsieur Raudot, intendant du Canada, et à monsieur de Vaudreuil, qui envoyèrent à Montréal un officier de Québec, appelé Vincelot, avec ordre de faire cette levée. Cet officier, en arrivant, apprit que le moyen le plus sûr d’avoir des Algonquins, était de me mettre dans ses intérêts et de m’engager le premier. Il m’en fit la proposition d’une manière qui ne me permit pas de balancer un moment à l’accepter, puisqu’il débuta par me faire entendre que sur cette frégate nous ferions tous les jours des courses sur les côtes de la Nouvelle-Angleterre, et que plus nous serions de braves gens, plus nous ferions de captures considérables.
L’envie que j’avais d’essayer de la guerre sur mer, où je m’imaginais que tous les jours j’aurais occasion d’en venir aux mains, me fit employer tout le crédit que j’avais sur mes sauvages, pour les obliger à me suivre. Mais c’était un voyage à faire, plus long encore que celui que nous avions fait vers Orange, et le malheureux succès de notre entreprise, qu’ils n’avaient point eu le temps d’oublier, ne les prévenait pas en faveur d’une nouvelle. Je n’en pus enrôler que vingt, qui, ne s’engageant dans cette affaire que par amitié pour moi, exigèrent avant leur départ de n’être soumis qu’à mes ordres. Ils firent plus ; armés d’une défiance qui leur paraissait bien fondée, ils demandèrent des vivres pour eux et pour moi, avec la liberté de faire notre route en particulier, soit devant ou après les Français et les Canadiens qui se préparaient à partir au nombre de cent trente ; ce qui leur fut accordé.
C’était sur la fin de l’hiver ; et les glaces que nous avions à rompre à chaque pas nous firent employer à notre voyage près d’un mois par delà notre calcul ; si bien que monsieur de Subarcas, qui, sur la nouvelle de notre départ, avait envoyé plusieurs fois un brigantin pour nous faire passer le détroit, ou la baie française, qui sépare l’Acadie de la Nouvelle-Angleterre, apprenant qu’il ne voyait personne, le rappela dans Port-Royal, et ne nous attendit plus. Ce furent des sauvages du lieu qui, nous voyant là tous rassemblés, sans savoir quel parti prendre, nous donnèrent cet avis.
Après avoir donc attendu à notre tour neuf à dix jours, vivant des poissons que nous laissaient les marées, nous tînmes un conseil, dont le résultat fut de choisir un jour calme, et de hasarder dans un de nos canots quelques-uns des nôtres, pour aller informer de notre arrivée monsieur de Subarcas. Le danger était tel, qu’il ne pouvait être bravé que par des personnes qui ne le connaissaient point. Il y avait pour le moins trente lieues de trajet ; et pour peu que la mer s’agitât, elle devait engloutir le canot et les hommes. Les Canadiens, qui voyaient tout le péril, ne s’empressaient nullement à s’y exposer. Ils furent ravis, lorsqu’ils entendirent que je voulais bien courir le risque d’une pareille navigation avec cinq de mes sauvages. Nous nous embarquâmes tous six dans un petit canot d’écorce, et habillés en Algonquins. C’est de cette façon que je vis la mer pour la première fois.
Par bonheur pour nous, le calme fut tel que nous pouvions le désirer. On eût dit que le dieu des vents, pour favoriser notre témérité, avait enchaîné les aquilons. Nous ne sentions pas même le doux souffle des zéphyrs. La surface des eaux était unie comme une glace ; pour comble de bonne fortune, le temps ne changea point ; et, plus heureux que sages, nous fîmes notre route sans qu’il nous arrivât aucun fâcheux accident. Monsieur de Subarcas, charmé de notre venue, qui lui parut un coup du ciel, nous reçut avec autant de joie que de surprise.
La frégate la Biche était encore sur les chantiers. Elle fut lancée à l’eau devant nous ; et la manière dont cela se fit, fut, pour mes sauvages de même que pour moi, un spectacle aussi amusant qu’il était nouveau. Nous montions continuellement dessus, comme sur un brigantin qui était dans le port. Nous en admirions la construction ; et un si bel ouvrage de l’art nous donnait une furieuse impatience d’être sur mer pour voir la manœuvre de ces vaisseaux. Cependant le hasard satisfit en partie notre curiosité, en amenant au port un bâtiment sous voiles. Nous fûmes étonnés de sa vitesse et de sa légèreté ; quoiqu’il fût presque aussi gros que la frégate neuve, il semblait voler sur la mer.
C’était un vaisseau de flibustiers, dont le capitaine, qui se nommait Morpain, est présentement, je crois, capitaine de port sur les côtes de Canada. Il venait de faire du bois et de l’eau, et vendre la prise qu’il avait faite sur les Anglais, qui consistait en deux petits bâtiments chargés de farine. Monsieur de Subarcas a toujours regardé l’arrivée de ce navire et la nôtre comme un secours certain du génie qui protège la France ; puisque huit jours après nous vîmes venir mouiller à la vue de la place vingt-huit vaisseaux anglais, qui comptaient se rendre aisément maîtres de l’Acadie.
Pour leur faire voir que nous étions en état, ou du moins dans la résolution de nous opposer à leur dessein, nous eûmes la hardiesse de nous avancer vers eux trois ou quatre cents, tant Canadiens et sauvages, que flibustiers ou habitants du pays. Nous avions ordre de faire d’abord belle contenance, comme si nous eussions voulu troubler leur descente ; mais pour deux cents hommes tout au plus que nous étions de chaque côté à tirailler sur leurs chaloupes, ils mirent à terre plus de quatre à cinq mille Anglais, qui nous firent bientôt reculer. Néanmoins, en reculant, nous faisions sur eux trois ou quatre décharges avant qu’ils pussent nous débusquer de derrière les arbres, et nous obliger à nous retirer plus loin. De sorte qu’en recommençant à tirer ainsi de vingt-cinq en vingt-cinq pas, nous leur tuâmes bien du monde. Notre retraite, semblable à celle des Parthes, était funeste à nos ennemis.
Le gouverneur, craignant qu’à la fin il ne nous fût très difficile de rentrer dans la place, sortit pour nous soutenir à la tête de toute sa garnison, composée d’environ cent soldats. Nous combattîmes tous ensemble avec une extrême vigueur, jusqu’à ce que, voyant notre cavalerie démontée, nous jugeâmes à propos de nous renfermer dans la place, c’est-à-dire, après que le gouverneur eut perdu son cheval, qui fut tué sous lui, et qui était le seul que nous eussions dans notre garnison.
Pendant les premiers jours que les Anglais nous tinrent comme bloqués, ils envoyèrent le long des côtes piller et ravager tout le pays par divers partis, pour tirer quelque fruit du blocus ; ce qui pourtant ne demeura pas longtemps impuni. Le capitaine Baptiste, brave Canadien, quoiqu’il n’eût avec lui qu’une quarantaine de sauvages, les obligea bientôt à se tenir sur leurs gardes. Il leur surprenait à tout moment quelque troupe qu’il battait ; puis il se retirait dans le bois ; et harcelant ainsi l’ennemi, il ne laissait pas de l’inquiéter.
De notre côté, nous commençâmes aussi à faire des sorties, le baron de Saint-Castin avec ses sauvages, et moi avec les miens. Ce gentilhomme était fils d’un baron français, et d’une sauvagesse, que son père avait épousée étant prisonnier parmi les sauvages ; et il poussait la bravoure jusqu’à la témérité. Aussi était-il estimé de tout le monde, et regardé comme un officier fort utile à la France. Il joignait à sa valeur toute la probité d’un honnête homme, avec un mérite singulier. Il se faisait, ainsi que moi, un plaisir d’être toujours habillé en sauvage.
Enfin les Anglais, considérant que leurs ravages leur coûtaient plus de sang qu’ils n’en tiraient de profit, rappelèrent leurs partis, et firent quelques tentatives pour emporter la place ; mais ils furent repoussés à tous les assauts qu’ils y donnèrent. Monsieur de Subarcas sentit alors le besoin qu’il avait des flibustiers et des Canadiens. Outre que sa garnison n’était pas nombreuse, elle était si peu aguerrie, que sans nous elle n’aurait pas tenu vingt-quatre heures. Le soldat, principalement, avait si bien perdu l’espérance de résister longtemps, qu’il ne songeait qu’à déserter, et les officiers avaient bien de la peine à les en empêcher. Un jour il en déserta deux qui donnèrent par leur fuite occasion aux flibustiers de me connaître, et un grand désir de m’avoir pour confrère. Voici l’aventure en peu de mots.
Les deux déserteurs ayant trouvé moyen de s’écarter, tournèrent sans précipitation leurs pas vers les Anglais, devant nous et en plein midi. Le gouverneur, qui les voyait déserter si tranquillement, fut irrité de leur procédé, et marqua une extrême envie de les ravoir, pour les traiter comme ils le méritaient. J’entrai dans son ressentiment, et je m’offris à les lui ramener. Il faisait difficulté de me prendre au mot, à cause du péril où il fallait me jeter pour tenir ma parole ; mais sans m’amuser à vaincre sa répugnance par mes discours, je choisis trois de mes Algonquins les plus alertes, et me mis avec eux sur les traces des deux soldats. Nous passâmes avec une vitesse surprenante à cinquante pas des ennemis qui firent feu sur nous, et nous coupâmes les déserteurs qui s’étaient arrêtés pour nous voir courir. Nous les saisîmes et les ramenâmes au gouverneur, qui sur-le-champ leur fit couper la tête. En même temps il m’accabla de caresses, et me donna publiquement des louanges, dont ma vivacité le fit repentir une heure après.
Pour proportionner la récompense au service que je venais de rendre, il eut la bonté de m’assigner pour mes sauvages et pour moi une portion copieuse de viande et d’eau-de-vie, dont on commençait à nous faire des parts assez minces. Le garde-magasin, nommé Dégoutin, qui avait eu apparemment en France le même emploi, et qui croyait avoir encore affaire à des soldats français, nous voulut faire passer quinze livres pour vingt, et des os pour de la chair. Je m’en plaignis ; il me brusqua, et moi qui n’ai jamais été fort endurant, je lui répliquai par quelques coups de sabre qui le mirent hors d’état de m’empêcher de me faire moi-même bon poids et bonne mesure.
Ce trait fut aussitôt rapporté au gouverneur, qui sortit d’un air furieux, et vint sur moi un pistolet à chaque main, jurant, comme on dit, ses grands dieux, qu’il casserait la tête à quiconque oserait manquer de respect à ses officiers. Sa colère m’effraya si peu, que j’eus la témérité de jurer plus haut que lui, et de le défier de tirer. Il était homme à punir mon audace, et je crois qu’il aurait déchargé sur moi ses pistolets, si Morpain et quelques autres flibustiers ne lui eussent retenu les bras, et représenté qu’un sauvage était excusable d’ignorer les lois de la discipline militaire ; et que si nous les apprenions peu à peu de ses soldats, nous leur apprendrions peut-être aussi à être intrépides et fidèles.
Ces raisons, ou plutôt le besoin qu’il avait de mes sauvages, qui, jusqu’au dernier, se seraient tous fait tailler en pièces en me vengeant, ralentit son courroux. Il nous fit une longue leçon sur nos devoirs, et me dit ensuite qu’il me pardonnait mon emportement, parce qu’il était persuadé que je ne m’y serais pas laissé aller, si j’avais su que s’en prendre à un des officiers, c’était l’attaquer lui-même, qui représentait la personne du roi. Telle fut la belle action qui fit souhaiter aux flibustiers de m’avoir avec eux. Ils jugèrent par là que j’étais un téméraire qui ne connaissait point le péril, et qui était incapable de plier. En un mot, je leur parus digne d’augmenter le nombre des flibustiers. Cependant ils ne me le proposèrent pas encore.
L’entreprise que formèrent les Anglais après cela, ne leur réussit pas mieux que le reste. Ils s’efforcèrent vainement de brûler les vaisseaux qui étaient sous le canon de la place. Si bien que se voyant près de manquer de vivres, et faisant réflexion que nous les battions de leurs propres armes, en nous servant de farines que Morpain leur avaient enlevées, et qu’ils destinaient pour leur flotte, ils prirent prudemment le parti de se retirer.
Ils ne nous croyaient pas assez hardis pour oser les attaquer dans leur retraite ; et dans cette confiance ils se rembarquaient avec assez de tranquillité, lorsque, sortant brusquement de nos bois, nous tombâmes à l’improviste sur onze à douze cents hommes, qui, en attendant les chaloupes, pillaient quelques maisons situées sur le rivage. Nous en tuâmes un grand nombre avant qu’ils se missent en défense ; mais ils ne tardèrent pas à s’y mettre, et furent bientôt soutenus. Il y eut alors une action des plus chaudes, et dans laquelle nous eûmes le malheur de perdre monsieur de Saillant, l’un de nos plus braves officiers. Le baron de Saint-Castin y fut blessé dangereusement, aussi bien que monsieur de La Boularderie.
Quelques flibustiers, auprès de qui je combattais, me remarquèrent avec plaisir dans la mêlée. Ils aperçurent qu’après avoir cassé mon sabre, je me servis de la crosse de mon fusil comme d’une massue, sans m’ef-frayer d’un coup de feu que j’avais reçu dans la cuisse. Cela les confirma dans la bonne opinion qu’ils avaient de mon courage, et ils résolurent de m’engager à quelque prix que ce fût dans la flibuste. Je découvris leur dessein à la façon seule dont ils firent mon éloge à monsieur de Subarcas, qui, pour me dédommager de la perte de mon fusil que j’avais entièrement brisé sur les têtes anglaises, me fit présent de celui qu’il portait lui-même. Ce fusil était fort bon, et je m’en suis utilement servi dans la suite.
Au lieu d’employer la frégate la Biche à l’usage auquel d’abord elle avait été destinée, monsieur de Subarcas aima mieux l’envoyer en France porter la nouvelle de l’entreprise des Anglais, et il chargea monsieur de Laronde d’en aller rendre compte à la cour. Plusieurs Canadiens furent de ce voyage. Pour mes Algonquins et moi, quelque envie que nous témoignassions de nous mettre en mer, nous ne pûmes en obtenir la permission ; le gouverneur voulant nous garder jusqu’à ce qu’il eût des réponses de France, et se proposant même de ne nous renvoyer en Canada qu’à la fin de l’été, s’il ne lui venait pas des ordres contraires. Je me plaignis hautement de son procédé, disant que je ne m’étais engagé que pour faire des courses sur la Nouvelle-Angleterre, et nullement pour m’enfermer dans une place, et en grossir la garnison.