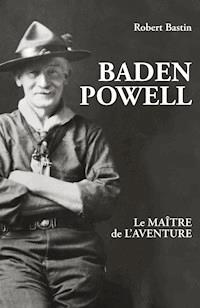
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jourdan
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Découvrez l'existence exceptionelle du fondateur du scoutisme !
Officier de la cavalerie aux Indes, chasseur en Afrique, espion en Russie et dans les Balkans, vainqueur des Zoulous, dresseur de chevaux et champion de polo, Robert Baden-Powell fut, mieux que tout autre, le « maître de l’aventure ».
« J’ai eu le bonheur de vivre heureux et je souhaite à chacun de pouvoir en dire autant. » Ce souhait, Baden-Powell ne s’est pas contenté de le formuler. Il a donné aux jeunes du monde entier la possibilité de le réaliser. Le scoutisme n’est que l’application pour tous des secrets qui lui ont permis de mener une vie passionnante. Et pour bien comprendre les ressorts de cette grande organisation mondiale, il faut remonter à la source, à l’histoire de son fondateur, à l’histoire d’un garçon curieux, inventif.
Cet ouvrage retrace la piste du scoutisme et, à tous les enfants du monde entier, ouvre la porte à la plus grande des aventures : celle de la vie.
EXTRAIT
Une voix sonore interpella le jeune homme niché dans les agrès :
—Eh, là-haut !
Le guetteur baissa la tête :
—Serait-ce à moi, monsieur, que vous adressez la parole ?
—Évidemment, jeune homme. Ce n’est pas aux mouettes ! Descendez vite. J’ai une excellente nouvelle à vous annoncer.
Et le possesseur de la voix, un gros homme en redingote, agitait les pages d’un journal, impatiemment.
Robert Baden-Powell se laissa glisser le long du mât. Déjà, le Dr Riddel, donnant le plein d’une voix célèbre pour son ampleur, déclarait, le nez dans ses feuilles :
Nouvelles militaires.
Résultats des examens pour emplois spéciaux à l’armée : Cavalerie : second, Robert Baden-Powell. Infanterie : cinquième, Robert Baden-Powell. Nomination : sous-lieutenant, Robert Baden-Powell.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Historien de formation, Robert Bastin s'est longtemps épanoui dans le scoutisme, en tant qu'animé, mais également d'animateur. Il mène de longues recherches afin d'écrire, pour d'autres jeunes scouts, la biographie de leur fondateur.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Robert Bastin
Baden
powell
Le maître de l’aventure
Chapitre premierLES VERTES ANNÉES
Une voix sonore interpella le jeune homme niché dans les agrès :
—Eh, là-haut !
Le guetteur baissa la tête :
—Serait-ce à moi, monsieur, que vous adressez la parole ?
—Évidemment, jeune homme. Ce n’est pas aux mouettes ! Descendez vite. J’ai une excellente nouvelle à vous annoncer.
Et le possesseur de la voix, un gros homme en redingote, agitait les pages d’un journal, impatiemment.
Robert Baden-Powell se laissa glisser le long du mât. Déjà, le Dr Riddel, donnant le plein d’une voix célèbre pour son ampleur, déclarait, le nez dans ses feuilles :
Nouvelles militaires.
Résultats des examens pour emplois spéciaux à l’armée : Cavalerie : second, Robert Baden-Powell. Infanterie : cinquième, Robert Baden-Powell. Nomination : sous-lieutenant, Robert Baden-Powell.
—Eh bien, mon garçon, continua-t-il, comme s’il s’adressait à la mer entière, vous êtes verni ! Vous ratez l’examen pour Balliel, la grande perte quoi ! Vous vous présentez aux petites entrées où s’écrasent tant de candidats chauffés par les écoles spécialisées. Et vous sortez dans les premiers. Il n’y a plus de justice !
Son bon rire démentait ses paroles. Il était fier de son poulain, le doyen de Christ Church, qui pour changer les idées d’un candidat malchanceux à l’Université, l’avait invité à participer à une croisière de vacances et dès la première escale pouvait lui annoncer une brillante réussite.
Robert Baden-Powell avait gagné la première course en ce « petit galop d’essai sur le terrain de la vie ».
Et pas uniquement par chance.
Toute son éducation l’y avait préparé.
Sa famille se présentait comme une vraie famille anglaise avec un mélange de rigidité, d’originalité et d’humour.
Son père, savant théologien, pasteur et écrivain religieux, mourut trop tôt que pour avoir sur lui quelqu’in-fluence. Mais sa mère était une femme remarquable et une parfaite éducatrice. À la mort de son mari, elle avait recueilli la lourde charge de placer les trois enfants que son époux avait eus d’un second mariage – il l’avait épousée en troisième noce – et d’élever les sept qui lui restaient sur les dix de son propre lit. Elle y fit face avec l’aide de son père, l’amiral Smith, vieil original qui conviait souvent ses petits-enfants à renouveler dans sa propriété de campagne les exploits aventureux d’un soi-disant ancêtre John Smith, le héros élisabéthain.
Robert Stephenson (son parrain était le fils du père de la locomotive !) Smith Baden-Powell naquit à Londres, le 22 février 1857, cinquième garçon de la famille. Et ses aînés l’aidèrent à compléter une formation que sa mère voulait surtout pratique.
—Fermez vos livres. Nous partons.
Un brouhaha de volière dérangée emplit la maison : le branle-bas des grands départs. On ne demande pas où l’on va. On le devine à la manière dont s’habille mistress Powell. Mistress Powell ? Bien sûr. Baden est un prénom qui ne sera intégré au nom de famille qu’en 1902, formant ainsi les fameuses initiales chères aux scouts : B.P. ! Mais il ne s’agit pas encore de scouts à cette époque ! Robert, qu’on nomme « Ste » en famille, apprend seulement à se débrouiller. À trois ans, il s’habille seul. À dix, il fait naufrage. Dans l’entre-temps, il s’initie à son métier de garçon. Durant l’année, on étudie. Pendant les vacances, on cabote. Sur les rivières anglaises d’abord jusqu’au jour où l’aîné mit en chantier un yacht de cinq tonnes.
À eux la mer !
Ste est évidemment le mousse.
—À la cuisine, mon petit vieux.
Dans le cagibi malodorant, ainsi pompeusement appelé, Ste s’active. Faire une soupe aux pois, c’est pas sorcier. De la farine de pois, de l’eau, un bon feu. Et bouille la marmite.
Le résultat est plutôt pâteux. Warington, capitaine, le renifle mais ne dit rien. Il laisse chacun prendre sa part, puis il se tourne vers Robert :
—Qu’est-ce que c’est ?
Ste ouvre de grands yeux étonnés :
—Une soupe aux pois !
—Une soupe aux pois ! Mais où sont les oignons, le jus de viande ?
—Tiens, s’étonne Ste, il fallait en mettre ?
La bande des matelots s’esclaffe :
—Une bouillie, une pâtée pour chien. Tu n’as pas honte ! Tiens, tu es juste assez bon pour que nous te permettions de la manger !
Robert goûte sa cuisine. C’est fade, insipide.
Tout l’équipage, la cuiller au garde-à-vous, le contemple. Il avale une bouchée, tâte une seconde. Elle passe mal. À la troisième, il hésite.
Le silence est complet.
—Tu peux la manger, articule froidement Warington, et il place devant le petit garçon les assiettes de ses frères.
Tu peux, autant dire ; tu dois !
Et tard dans la nuit, Robert, stoïque, se bourre de soupe aux pois. Jamais plus il n’en oubliera la recette.
Car les recettes, que ce soit de cuisine ou de vie, ne s’apprennent bien qu’en mettant la main à la pâte.
À la maison, chaque enfant avait son jardin. Le jardinage, pensait leur mère, est une excellente école de patience, de sincérité et de persévérance.
—C’est de chez nous que ça vient, disaient-ils en présentant à l’invité du jour les radis roses, la salade frisée ou les navets rôtis.
Et l’on dégustait avec respect d’humbles légumes qui seraient passés inaperçus s’ils étaient venus du marché.
Elle savait bien, la maman de Robert, que la valeur des choses est faite de leur poids d’amour et, dans un foyer de garçons, elle s’efforçait d’adoucir leur brutalité par plus de tendresse attentive.
Ste dessinait. Maladroitement, comme un enfant peut le faire, mais avec déjà un sens aigu de l’observation. Sa mère s’apercevant qu’il se servait de sa main gauche en fut ennuyée.
Un jour que Ruskin, le célèbre critique d’art, déjeunait à la maison, elle lui posa le problème :
—Faut-il le laisser continuer ? Un gaucher est mal à l’aise dans un monde aux objets fabriqués pour des droitiers ?
—Forcer un enfant à corriger brutalement une disposition naturelle, simplement parce qu’elle est inhabituelle, répondit le critique en tirant sur ses favoris, n’est pas éducatif. Si vous le laissiez travailler de la main gauche tout en vous efforçant de lui faire utiliser sa droite, vous en feriez un ambidextre, homme rare et précieux. Mais allons voir ses dessins.
Ruskin repoussa sa chaise et se dirigea vers la chambre des enfants. Ste avait récemment découvert les richesses du Jardin Zoologique de Londres. Depuis, les murs de la chambre et de la maison étaient ornés de silhouettes d’animaux découpés dans du papier multicolore et collées sur de forts cartons.
Il était occupé à dessiner une caravane de chameaux.
—Les chameaux ! dites, maman, ils ont combien de bosses ?
Ste savait qu’à toute heure du jour il pouvait interroger sa mère et que comme son père autrefois, elle lui répondrait toujours sérieusement.
—Tu ne les as pas bien regardés l’autre jour ? Viens vite, nous avons juste le temps d’aller les revoir.
Et mettant son chapeau, cette grande capote qui lui donnait un air si digne, mistress Powell entraîna son fils et Ruskin, enchantés, vers la solution concrète du problème.
—Quelle maîtresse femme, songea Ruskin, en tirant, une fois de plus, sur ses favoris. Et quelle excellente éducatrice.
Selon les saisons, le menu simple mais confortable était complété par les cultures familiales et la table unissait dans une même fierté producteurs et consommateurs.
L’excellente éducatrice fut bien heureuse à l’anniversaire des huit ans de Robert de voir son petit garçon lui apporter un papier :
—Maman, voulez-vous lire ?
—Elle tendit la main :
Lois pour quand je serai vieux.
Elle se mit à rire et poursuivit la lecture.
Quand je serai vieux, je ferai en sorte que les pauvres soient aussi riches que nous. Ils doivent tout autant que nous avoir droit au bonheur. Tous ceux qui traversent un carrefour donneront quelqu’argent aux pauvres balayeurs et remercieront Dieu de ce qu’il leur a donné. Dieu a fait les pauvres et les riches mais je puis vous dire ce qu’il faut pour être bon. Il faut prier Dieu chaque fois qu’on le peut. Mais comme on ne peut pas être bon par la prière seulement, il faut aussi se donner beaucoup de peine pour arriver à être bon.
En remettant le papier à son garçon, la maman de Robert ne sut si elle devait admirer davantage chez lui ce rare souci d’être bon pour compléter sa prière ou ce sens de l’honneur et de la discipline qui le lui faisait codifier.
Intelligent, précocement éveillé par l’éducation familiale, blagueur et entreprenant, Robert possédait un authentique don de sympathie. Ses années de collège allaient bien le prouver.
On s’imaginerait, à tort, un collège anglais comme un immense bâtiment ordonné ou tracé au cordeau, tels nos grands établissements d’instruction. De petites maisons, festonnées de lierre, abritent, çà et là, des groupes d’étudiants. Les fenêtres à meneaux où, coquets, des géraniums piquent des notes vives, les toits bas aux tuiles mordues de mousse, les briques aux tons chauds, tannés par des siècles d’intempéries, donnent, à ces habitations, l’aspect agréable de vieilles gravures.
Tout le passé, en elles et par elles, accueille le nouvel élève. Plus éloquents qu’un discours, les bâtiments témoignent d’une tradition.
Lorsqu’ils franchissent le seuil usé et laissent tomber, sur la porte d’un vert aigre, le lourd marteau de cuivre rouge, les « nouveaux » ont conscience de rejoindre, par delà les siècles, les plus grands hommes de leur race, venus chercher, ici, comme eux, les leçons de vie ; d’une vie rude allègre et saine, fortement marquée de réalisme, de noblesse et de continuité.
L’élite de la nation bénéficiant de cette éducation, celle-ci aura comme but d’en faire des chefs. Or un chef est celui qui joint à une valeur intellectuelle réelle un réalisme direct et concret, qui le rend acceptable dans un salon mais inestimable dans un naufrage !
Fortement marqué par sa classe sociale, plongé dès l’enfance dans cette atmosphère de jeux sains et obligatoires, qui, moralement et physiquement, le dresse à obéir et à commander, imprégné d’une claire et virile liturgie, qui associe pour jamais dans l’esprit, l’idée nationale à l’idée religieuse et plie l’âme à l’attitude du respect en l’habituant au sentiment du sacré, formé dans l’orgueil des grandes institutions historiques de l’Angleterre, dressent au fair-play, qui fait sourire ou essayer de sourire lorsqu’on reçoit, à la boxe, un coup de poing dans la figure, le jeune élève des « Public Schools » sortira de ce système d’éducation nanti d’un caractère, enrichi d’une discipline de l’âme et du corps et prêt à mettre sa valeur au service de la communauté.
Il ne faut pas s’étonner, dès lors, de la place importante que tient le sport dans le système anglais d’éducation. Le sport est la première école d’énergie. N’apprend-il pas à avoir du cran, à faire preuve d’initiative, à prendre ses responsabilités ? C’est aussi le premier contact social où l’on doit déjà plier ses fantaisies personnelles à l’ordre solidement établi. C’est, enfin, la première conscience de la place de chacun dans l’équipe, dans cette équipe de cricket, de football ou de hockey, miniature de la grande équipe britannique qui joue, sur le vaste monde, une partie réglée par des lois souples mais inexorables.
Que Robert Baden-Powell ait eu des difficultés les premières années de ses études pour s’astreindre au travail de classe et en comprendre la nécessité, semble normal. Des sciences mortes comme le latin ou le grec, d’arides études de mathématiques pouvaient-elles intéresser un jeune garçon qui avait fait naufrage, une ou deux fois, et découvert la nature dans sa réalité vivante ?
Robert prit peu d’intérêt à son travail jusqu’au jour où le principal, le Dr Haig-Brown, éducateur au grand caractère, parvint, en dépit des critiques des professeurs, à voir quelque promesse dans ce petit garçon inattentif et nota « qu’il valait mieux que ne pouvait le faire supposer son travail de classe ».
Cette étincelle d’encouragement se transforma en une flamme d’énergie et Robert se mit alors bravement au travail : un travail moyen dans les études proprement dites mais excellent dans toutes les activités qui, comme nous l’avons souligné, tiennent tant de place dans le programme anglais.
Se souvenant que Bacon affirmait que « les représentations dramatiques sont un des meilleurs moyens d’élever les enfants », le Dr Haig-Brown multipliait pour ses élèves les occasions de se montrer en public. Robert Baden-Powell fut un de ses acteurs les plus distingués.
Un jour de représentation scolaire, au moment d’entrer en scène, un des jeunes acteurs fut pris de trac. Il pâlit, rougit, trembla et s’effondra sur une chaise, incapable de surmonter son émoi. De l’autre côté du rideau, les spectateurs s’impatientaient. Le ton des conversations s’enflait outre mesure et les élèves commençaient à devenir bruyants. Agacé par le tumulte, le Dr Haig-Brown fit appeler Robert dont le rire sonore et clair dominait le coin le plus excité de la salle et il lui dit :
— Nous devons faire quelque chose ! Pouvez-vous remplacer l’acteur ou improviser à sa place ?
Baden-Powell réfléchit à peine : « Je vais improviser », s’écria-t-il, déjà à moitié sur les planches, et devant la salle soudain calmée il raconta, avec un brio endiablé, divers événements de la vie du collège. Puis, transportant ses auditeurs en classe, il décrivit, avec une mimique parfaite et un accent impayable, une leçon de français dont le professeur, malheureusement absent de la représentation, aurait tiré le plus grand profit, car il y aurait découvert ses tics, ses habitudes de langage et les gestes malheureux qui, à son insu, agrémentaient son cours. Les élèves étaient malades de rire. Ils le furent davantage, un jour, où un prestidigitateur annoncé se faisait attendre. Pour calmer l’impatience du public, on fit appel encore à Baden-Powell. Souriant, il monta en scène, retroussa ses manches et, improvisant le boniment habituel à ce genre d’exhibition, emprunta à un spectateur son chapeau haut de forme : un superbe chapeau, gris souris, tout neuf. Baden-Powell le fit admirer par l’assemblée, s’en coiffa, disparaissant à moitié sous l’imposante coiffure et après mille pirouettes, tirant de sa poche un immense canif, se mit froidement à le découper en multiples morceaux. Le propriétaire du chapeau se sentait vaguement inquiet... et Baden-Powell, plus encore, quand arriva, enfin, le prestidigitateur professionnel. Il ne pouvait mieux se présenter. La besogne était à moitié faite. Aussi, Baden-Powell, quittant la scène, déclara :
—Puisque monsieur X... vient d’arriver, c’est avec le plus grand plaisir que je lui laisse la joie de terminer cet intéressant exploit !
Ses talents, son humour, sa bonne humeur, sa serviabilité firent de « BathingTowell » (essuie-mains), comme le surnommaient les garçons de son club, le boute-en-train, l’entraîneur et le porte-parole de l’école. Réservé, il n’était pas timide. Cordial, il n’était pas sentimental et franchement à l’aise avec tous, il se tenait, devant ses professeurs, avec une aisance pleine de distinction. Net et clair, il mérita cette mention : « C’était un garçon dont on ne pouvait douter de la parole. »
Pas bien riche – lui qui ne put se payer des leçons de dessin alors qu’il aimait tellement cet art – et boursier de surcroît, il disposa d’une si réelle influence que dans l’événement le plus important qui agita son temps scolaire, le déménagement de Charterhouse, il se montra, de l’avis du directeur, un chef-né et un parfait conciliateur.
En proposant le changement de résidence de l’antique institution, le Dr Haig-Brown avait suscité une révolution. Elle s’imposait cependant, car la maison datait du XIVe siècle et avait connu diverses affectations depuis l’établissement, en 1371, des premiers propriétaires : les Chartreux.
Un siècle durant, les blanches ombres de ceshommes silencieux et profonds y poursuivirent, dans le silence, la réalité de leur amour. Henry VIII essaya de les en distraire. Le Supérieur et deux autres Pères furent pendus et écartelés avant de rendre le dernier soupir ; ceci pour servir d’exemple et d’encouragement à la communauté. La plupart des moines, refusant de signer l’acte de soumission, furent jetés en prison, attachés à un coin de leur cachot et attendirent la mort dans la pourriture, le froid et la faim. N’était-ce pas, comme le faisait remarquer un auteur anglais ; « Le bon vieux temps ! » Devenu domaine royal, le monastère de Charterhouse se transforma en hôtel particulier jusqu’au jour où, en 1611, un vieux soldat en fit l’acquisition, désireux de consacrer au service du pays une fortune gagnée par le môme moyen. Dans les petites maisons des Chartreux, vinrent se loger de valeureux vieillards sans fortune et de jeunes adolescents dans le même cas. L’école prospéra. Comme toutes les institutions destinées aux pauvres, elle s’ouvrit bientôt aux riches mais, chose extraordinaire, elle conserva, toujours, une maison pour les boursiers. Lorsque Baden-Powell s’y présenta, on parlait déjà de déménagement. Dans l’Angleterre conservatrice et solidement assise sur ses traditions, un tel projet était proprement scandaleux. Le Dr Haig-Brown, principal énergique et volontaire, profita de ce que l’époque était aux réformes pour faire admettre la sienne et, en 1872, le vieux collège émigra, pierre par pierre, du Londres brumeux et populaire, pour aller poursuivre ses rites, ses coutumes, ses traditions à Goldaming, dans la campagne fraîche, enivrante et calme à souhait.
La vie reprit, semblable à celle que nous décrit Kipling dans son BrushwoodBoy : « Six ans dans une grande école de la gentry anglaise ne sont pas propices aux facultés de rêve. » Le garçon de taille moyenne, aux cheveux roux et frisés, à la figure constellée de taches de rousseur, parmi lesquelles brillent deux yeux vifs et noirs, « grandit et sait arriver au tour de poitrine réglementaire grâce à un système de cricket, de football et de rallye-paper qui l’accapare quatre ou cinq jours par semaine, en promettant trois justes coups de verge à l’écolier qui se fût dispensé de ses plaisirs. »
Robert n’eut jamais à recevoir ces coups de verge. Il aimait le football et se montrait un goal-keeper efficace et original, car ses lazzi et ses plaisanteries contribuaient autant que sa tactique à la défense de son goal.
Comme tout jeune garçon anglais, il fut d’abord au service des grands : « Fag » de troisième d’un garçon plus âgé que lui auquel il se dévoua avec tout l’entrain dont il était capable. L’adolescent n’avait pas oublié les « lois pour quand je serai vieux » ! Son rôle exigeait de lui de menus services. Sous le manteau de la cheminée de la salle d’études, il défendait les toasts de son patron avec tant d’énergie que ce dernier devint le « fagmaster » le mieux soigné de Charterhouse. Baden-Powell devait conserver un splendide souvenir de ce garçon. « On me demandait, il y a quelques mois, ce qui m’avait fait pratiquer le football avec une telle énergie, dans ma jeunesse. Je puis dire, sans hésiter, que ce fut l’influence d’un garçon plus âgé que moi. Il devint plus tard un célèbre joueur professionnel mais, à ce moment, je venais d’arriver à l’école et j’étais chargé de ses corvées. J’avais l’honneur de garder son pardessus pendant qu’il jouait, de cirer ses chaussures et de nettoyer ses vêtements couverts de boue et encore de lui donner de l’eau chaude quand la partie était terminée. Je le vois encore maintenant, courant de son allure aisée. Il n’avait jamais l’air de se presser et, pourtant, il se plaçait toujours de façon à avoir la balle. Je me rappelle avec quel mépris fougueux il arrêta un copain qui trouvait viril de raconter des histoires malpropres. Dès les premiers jours, je brûlai du désir de l’imiter, mais bien qu’il ait, jusqu’à présent, ignoré l’influence qu’il a eue sur moi, j’ai suivi son exemple pendant une bonne partie de ma vie d’écolier. »
Pour son fagmaster que ne fit-il pas ? Pour lui, cédant à son goût profond pour la vie de plein air, trop comprimé encore par le règlement de la maison, il se glissait subrepticement dans le « copse », longue bande de terrain boisé couvrant une colline escarpée, qui s’étendait jusqu’à environ un mille des terrains de jeux. En cette jungle, s’imaginant trappeur des grands bois, éclaireur d’armée ou Indien, Robert, minutieusement, relevait les pistes des lapins et des lièvres auxquels il tendait des collets avec des ruses de vrai braconnier. Dans le taillis épais, il se glissait prudemment, car les bois étaient dangereux : des peaux-rouges sanguinaires, armés de la verge, y rôdaient en quête d’élèves en rupture de rang. Là, il connut l’ivresse de dépiauter, dans un buisson creux, un maigre lapin sauvage et de le cuire doucement sur un petit feu de bouleau, clair et sec, afin que la fumée ne le fasse pas repérer. Que d’heures délicieuses passées dans les branches noueuses à observer les maigres silhouettes des maîtres alertés et grincheux. Quelle école splendide d’observations, de déductions et de découvertes ! Il y trouva son âme.
Le Dr Haig-Brown était, sans doute, au courant de ces escapades, mais voulant favoriser un système d’éducation personnelle, il n’en laissa rien paraître. Il pensait que ce garçon original et merveilleusement doué devait faire, lui-même, son expérience de la vie et, lorsqu’un jour il le découvrit dans la maison de Mr. Girdlestone, son maître, assis sur un très haut tabouret, sans bas ni soulier, jouant solennellement du piano avec ses doigts de pied, il sourit et referma doucement la porte. Ce garçon ferait son chemin dans la vie.
Il le faisait au moins dans cette école et comme le Georgie de Kipling : « À travers les eaux dormantes de la quatrième, il gagna ses galons de football ; il connut l’honneur d’une chambre à part avec deux camarades et commença à rêver des nobles et honorables fonctions de moniteur. En 1875, il était sergent de son équipe et, un beau jour, s’épanouit, en pleine gloire, chef de l’école, ex-officio capitaine de jeux, le premier de son camp où, soutenu par ses lieutenants, il maintenait la discipline et la décence chez soixante-dix garçons de douze à dix-sept ans, arbitre des querelles et allié de Mr. le Principal lui-même.
« Quand il paraissait dans le jersey noir, la culotte blanche, les gros bas noirs des quinze, le ballon neuf sous le bras, le vieux bonnet usé, jeté sur l’arrière de la tête, le menu fretin des petits s’écartait et le vénérait ; les nouveaux de sa bande lui parlaient pour montrer au monde qu’ils lui parlaient.
« En été, quand il revenait à sa tente, après un jeu éminemment prudent et sûr, peu importait qu’il n’eût pas marqué de points où, comme à Wimbledon, qu’il en eût marqué 48, l’école l’acclamait. »
Lorsqu’en mai 1876, Baden-Powell quitta le collège pour embrasser la carrière militaire, le registre de Charterhouse s’enrichit de cette note : Septième fils du Rév. Baden-Powell, membre de la Société Royale, professeur de géométrie à Oxford. Entré à Charterhouse durant le trimestre d’oraisons, 1870. D’abord jeune étudiant, puis transféré à la maison de Mr. Girdlestone. Dans l’équipe de football du collège fut goal-keeper en 1876. Dans l’équipe de tir de l’école, en 1874 et 1875. Quitta le collège en 1876, lors du grand trimestre.
C’est concis, net... et bien britannique !
Ainsi à 19 ans, dispensé par ses places du stade d’entraînement de deux ans, le jeune homme qui descendait du yacht du Dr Riddel pouvait rêver à un commandement aux Indes.
La vraie vie commençait.
Chapitre II Les Indes
Le 30 octobre 1876, le vapeur Sérapis, fendant de l’étrave la mer houleuse et laissant derrière lui, dans la brume, les docks de Portsmouth, emportait vers le 13e Hussards, un nouveau sous-lieutenant.
Robert Baden-Powell aimait beaucoup sa mère et ce grand amour lui suggéra la délicate pensée de tenir, au jour le jour, un carnet de route qui apporterait, à la maison, un reflet vivant et détaillé de sa vie mouvementée. Durant toute la vie de sa mère, Baden-Powell continua à lui envoyer ses carnets de notes dans lesquels se révèlent, non seulement ses « découvertes », mais encore et surtout, avec un rare talent d’observateur et de dessinateur, ses préoccupations, ses intérêts et le fond même de son généreux tempérament.
Un mois plus tard, l’Inde, prestigieuse et colorée, se révélait à lui. L’Inde, dure pour l’officier à la solde de 120 livres par an qui, avec cette somme, doit subvenir à toutes les dépenses d’une vie luxueuse et large, dans un pays où les sous-lieutenants sont tenus pour de très petits garçons et où la vie est chère.
L’éducation de Baden-Powell n’avait quasi rien coûté à sa mère. Il ne voulut pas grever son budget par de nouvelles charges et décida de subvenir seul à ses propres frais, vivant de sa solde, ce qui était considéré comme généralement impossible dans la cavalerie. Il commença par couper court à toute dépense inutile. Il ne fuma plus, but le moins possible, évita les extra au menu et, s’installant davantage au mess, supprima les « coolies punkab », ces domestiques armés d’un ventilateur, indispensables dans la moiteur de la journée.
On s’imagine la somme de volonté qu’il fallut à cet adolescent de 20 ans pour ne jamais se laisser entraîner par des camarades plus fortunés ou plus insouciants qui, avec les très naturels désirs des jeunes hommes, commencent une nouvelle vie dans un pays nouveau pour eux et voudraient bien sortir un peu et prendre quelque plaisir.
Sa petite chambre solitaire dans le bungalow, voisin du mess, possédait seulement une nappe de toile cirée verte, une chaise, un châlit, une photographie, un verre à se rincer les dents très solide et très épais, et un filtre de sept roupies huit annas ; quant à ses repas, il avait un abonnement au mess et, de temps à autre, on l’invitait à dîner et il avait alors un punkab et une boisson à la glace pour rien. Ses innombrables talents de société, sa gentillesse et sa serviabilité lui valaient ces invitations. Les enfants des officiers raffolaient de lui et, par les enfants, on conquiert les parents ! N’avait-il pas fait son entrée au cantonnement de Luchnow en traînant à sa suite les enfants européens, charmés, comme leurs camarades d’Hamelin, par la musique de son ocarina ? Son colonel le jugea immédiatement original, mais il s’aperçut bientôt que cette originalité était la marque d’une joyeuse indépendance vis-à-vis du conventionnel et qu’elle adoucissait ce qu’une volonté tenace et un amour du travail auraient pu avoir de trop rude.
Baden-Powell ne réserva pas ses dons au seul amusement de ses camarades. Afin de se permettre les sports coûteux et passionnants de la chasse au sanglier, de l’équitation ou du polo, il envoya, aux journaux anglais, des esquisses du front de l’Inde. À sa surprise, mais aussi à sa grande satisfaction, il reçut du Graphie un chèque de six guinées pour, son premier « papier ».
Sans être la fortune, ce travail lui procura un appoint appréciable et un surcroît de besogne, car son horaire de jeune officier était fort chargé.
« Lever à 7h30 et chota, c’est-à-dire un plat de toasts beurrés, avec une tasse de thé. Bain, manège, puis déjeuner.
Inspection des écuries puis des cantonnements, ensuite rapport. À 2 heures, lunch puis, en tenue de campagne, instruction pendant une heure et demie, ensuite promenade, puis dîner à 7h30 ».
Les douze heures de service, (dans la moiteur tropicale), Baden-Powell les complétait par des travaux personnels. Il voulait devenir un parfait officier et approfondir sa formation technique : balistique, stratégie, géographie. Si le côté pratique de son métier le passionna, le côté moral ne lui demeura jamais étranger. Il s’efforça de développer son intelligence militaire et son cœur militaire. Comme Lyautey, son aîné de trois ans, il était né « social » et, comme lui, aurait volontiers fait un substantif de cet adjectif.
Il s’affirma comme chef dès le début, à l’occasion de sa première inspection. Le règlement militaire, qui prévoit tout, obligeait les hommes à porter, sur la peau, une ceinture de flanelle, lourde, urticante, légèrement désagréable en ce climat torride, mais indispensable pour éviter le choléra. Un règlement militaire est fait pour être tourné, dit-on, et beaucoup d’hommes mettaient leur imagination à la torture afin d’éviter d’être pris sans la ceinture de choléra. Lorsque le jeune sous-lieutenant, ayant vérifié les ceintures de la seconde ligne des hommes rassemblés en deux files, se retourna pour passer à la première, un militaire malin changea de place rapidement avec son vis-à-vis. Le nouvel officier, ignorant encore les physionomies des soldats, ne s’apercevrait pas de la substitution et ce serait, pour le débrouillard, une gêne joyeusement évitée. Baden-Powell était observateur et avait, disait-il lui-même, des yeux dans le dos. Il remarqua le manège et continua l’inspection comme si de rien n’était. Celle-ci terminée, face aux hommes, il interpella le tire-au-flanc. (Par chance, c’était l’unique nom du bataillon qu’il connût !) :
— Dites donc, Hardcastle, nous serions si contents de voir la couleur de votre ceinture !
En fait de couleur, on remarqua davantage celle du visage de l’homme ! Pour lui apprendre les avantages pratiques d’une ceinture de choléra, Baden-Powell lui en imposa une double pour un temps indéterminé.
Il venait de jouer sa réputation, avec un sang-froid peu commun chez un « bleu » fraîchement débarqué et, une fois encore, avait gagné. La vie est bonne pour ceux qui croient en elle et ce garçon exceptionnel y collait comme un cavalier à son cheval. Il avait foi en la vie parce qu’il avait d’abord foi en lui-même et dans les autres ensuite.
Lorsque, abruti de travail, débilité par le climat, rongé d’une fièvre qui lui donnait de violents bourdonnements de tête, il fut renvoyé en repos en Angleterre, deux ans, jour pour jour, après son arrivée (6 décembre 1876 – 6 décembre 1878), il était nanti d’un brevet de lieutenant (1877) avec deux ans d’avance, d’un certificat supplémentaire de topographie et d’une personnalité !





























