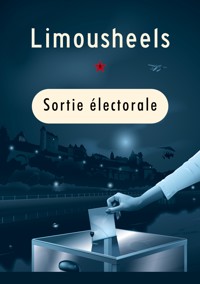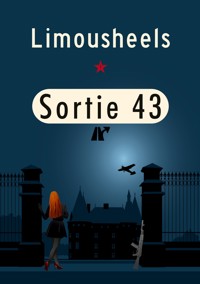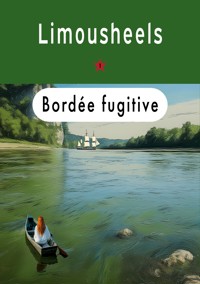
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Juillet 1615. Le royaume de France sombre dans le chaos. Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, a confisqué le pouvoir à son jeune fils, Louis XIII. La division règne, des princes de la cour aux nobliaux des contrées les plus isolées. L'ombre de la guerre civile plane. Partout, l'insécurité triomphe. Les troupes armées investissent les provinces et les brigands terrorisent les campagnes. Jeanne Lachan, une simple paysanne limousine, navigue entre ses tâches quotidiennes à la ferme, les foires et les marchés, les leçons d'un vieux marin et la science des plantes, malgré les cendres des bûchers de sorcières rousses qui flottent encore. Mais l'équilibre fragile de son bonheur est menacé par l'époque troublée et ses inévitables profiteurs aux rêves de pouvoir. Sa jeunesse suscite d'inavouables envies, sa réussite attise les désirs de fortune et l'hypothétique trésor de son mentor enflamme les imaginations. Et si, pour Jeanne, l'âpre lutte pour sa survie devenait la première étape d'une longue épopée d'aventures, de découvertes et de connaissances ?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Les aventures de Jeanne Lachan
1. Bordée fugitive
Retrouvez toute l’actualité de Limousheels sur : www.limousheels.fr
Aux aventurières !
À C., pour tout…
Sommaire
Dédicace
Personnages
Données
Glossaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Personnages
Fratrie Lachan
Jeanne, 14/15 ans, la sorcière de six pieds de haut
Joseph, 14/15 ans, frère jumeau de Jeanne
Théobald et Théodore, « les grands jumeaux », 18 ans
Michel, 22 ans, aîné, maître charpentier
En Limousin
Benezet Lynier de la Tour, 102 ans, capitaine de marine
Raoul Vaugeois, 51 ans, ancien marin
Frère Valéry, 68 ans, moine au prieuré de Lavinadière
Guichard d’Albret, 33 ans, noble limousin de Treignac
Armance d’Albret, 19 ans, épouse de Guichard d’Albret
Karl Heidenreich, 30 ans, lansquenet bavarois
Jofu Rathenau, 45 ans, notaire de Masseret
Jigond Rathenau, 24 ans, fils aîné de Jofu Rathenau
Jigunde Rathenau, 22 ans, fils cadet de Jofu Rathenau
Sylvia Bouillaguet, 13 ans, voisine des Lachan
Lizabeau Mirgesse, 22 ans, apothicaire-herboriste à Felletin
Famille Fontfaure
Enguerrand, né en 1515, mort en 1569
Isolde, née en 1519, morte en 1569
Jehanne, fille, née et morte en 1538
Descendance Fontfaure – branche Aubusson
Simon, fils, 72 ans, maître tapissier
Antoine, petit-fils, 46 ans, maître tapissier
François, arrière-petit-fils, 20 ans
Apolline, arrière-petite-fille, 15 ans
Descendance Fontfaure – branche Saint-Projet-le-Désert
Pierre, fils, né en 1545, mort en 1607
Guillaume, petit-fils, né en 1567, mort en 1607
Dagaric, arrière-petit-fils, 25 ans, batelier
Équipage écossais
Archibald Roff, 41 ans, armateur et commerçant
Cadwalader Roff, 17 ans, fils d’Archibald
Fearghas Murray, 17 ans, ami de Cadwalader
Donan Hodgkin, 45 ans, capitaine du Géar
Machar McGonagall, 29 ans, premier lieutenant du Géar
Paddy O’Carroll, 52 ans, maître pilote du Géar
Walter Ceannaideach, 12 ans, mousse du Géar
À Brouage
Crispin Bercheux, 41 ans, capitaine de la Foudre
Ermeline Bercheux, 19 ans, fille du capitaine Bercheux
Gudule Saunier, 51 ans, domestique des Bercheux
Rollon Coulon, 22 ans, maître charpentier
Philibert Mazet, 50 ans, maître d’équipage de la Foudre
Autres
Jacques Gidéon, 38 ans, négociant de Bordeaux
Humbert de Saint-Martin, baron, 25 ans, chef de l’expédition de la France équinoxiale
Données
Distances terrestres
Pouce
2,707 cm
Pied
32,48 cm
12 pouces
Toise
1,949 m
6 pieds
Lieue
3,25 km
10 000 pieds
Pouce anglais
2,54 cm
Pied anglais
30,48 cm
12 pouces anglais
Yard anglais
91,44 cm
3 pieds anglais
Distances marines
Brasse
1,62 m
5 pieds
Encablure
195 m
120 brasses
Brasse anglaise
1,83 m
6 pieds anglais
Encablure anglaise
183 m
100 brasses anglaises
Mille
1852 m
Volume
Pouce cube
1,984 cl
Chopine
48 cl
24 pouces cubes
Pinte
95 cl
48 pouces cubes
Bonbonne
1 à 2 l
Pichet
2 l
Seau
12 à 15 l
Setier
7,62 l
8 pintes
Baril
34,28 l
1 pied cube
Quartaut
68,55 l
2 barils
Feuillette
137 l
4 barils
Barrique
206 l
6 barils
Tonneau
1 440 l
42 pieds cubes
Tonneau anglais
1 133 l
40 pieds cubes anglais
Poids
Denier
1,275 g
Once
30,6 g
24 deniers
Livre
490 g
16 onces
Quintal
49 kg
100 livres
Tonneau
979 kg
2 000 livres
Livre anglaise
454 g
Monnaie
Denier
Sol
12 deniers
Livre
20 sols
240 deniers
Écu
3 livres
720 deniers
Glossaire
Abordage : manœuvre d’un navire lui permettant de s’amarrer bord à bord avec un autre pour lui donner l’assaut.
Affaler : abaisser, faire descendre une voile, une vergue.
Affût : structure en bois à quatre roues, supportant le canon et permettant de le déplacer.
Allège : petite embarcation servant au chargement et déchargement des marchandises d’un navire.
Allure : direction de la route suivie par un bateau par rapport à celle d’où vient le vent.
Amarre : cordage servant à tenir un navire à quai.
Amener : abaisser, faire descendre avec un cordage.
Amener le pavillon : abaisser le pavillon pour se rendre.
Armateur : exploitant d’un navire pour le commerce.
Artimon : mât le plus en arrière d’un voilier.
Aurique : voile quadrangulaire.
Bâbord : côté gauche du navire en regardant vers l’avant.
Barre : organe de commande du gouvernail.
Bastingage : parapet bordant le pont du navire.
Batterie : ensemble de pièces d’artillerie et du matériel nécessaire à leur fonctionnement se répartissant sur un pont.
Beaupré : mât incliné placé à l’avant.
Bordée : route parcourue par un bâtiment avec le vent contraire entre deux virements de bord ; partie de l’équipage assurant le service pour une période donnée ; ensemble des canons d’un côté du navire ; ensemble des projectiles tirés par les canons d’un même côté du navire.
Bossoir : pièce de bois placée de chaque côté de l’avant du navire pour supporter les ancres.
Branle-bas : préparatifs de combat.
Brûlot : navire sacrifié, rempli de matières inflammables et explosives, approché du navire ennemi à détruire.
Cabestan : treuil à bras, à axe vertical, utilisé pour des manœuvres nécessitant de gros efforts.
Cale : partie interne du navire, la plus basse, sous les ponts, recevant la cargaison, les vivres, les liquides, les rechanges.
Calfater : étanchéifier en garnissant d’étoupe enduite les interstices entre deux planches de la coque.
Calibre : poids du boulet, ou de la balle, tiré.
Canot : petite embarcation, à aviron et à voile.
Chaloupe : embarcation, à aviron et à voile, à un ou deux mâts, servant au transport de marchandises ou de passagers.
Château : partie surélevée à l’avant ou à l’arrière du navire.
Chef de pièce : artilleur chargé de la visée d’une pièce d’artillerie, commandant les servants de la pièce.
Civadière : voile carrée portée sous le mât de beaupré.
Corne : espar oblique au mât supportant le sommet d’une voile aurique.
Corsaire : marin pratiquant la guerre contre le commerce maritime de l’ennemi avec l’accord officiel de son roi.
Corvette : navire de guerre fin, léger et bien toilé donc rapide et maniable, à un seul pont et faux-pont, servant de bâtiment d’escorte, de liaison, de chasse ou d’exploration.
Cotre : petit navire aux formes fines et élancées, à un mât gréé d’une voile aurique, d’un flèche et de focs.
Couleuvrine : canon.
Coupée : ouverture dans le bastingage permettant de monter à bord.
Courpet : bateau à fond plat, à usage unique, utilisé pour le transport de marchandises, construit en haute Dordogne.
Dunette : partie surélevée d’un navire située au-dessus du gaillard d’arrière.
Écoutille : ouverture rectangulaire dans le pont permettant d’accéder aux ponts inférieurs et à la cale.
Embosser : amarrer un navire par l’avant et l’arrière, pour l’immobiliser, malgré le courant ou le vent.
Enfléchure : petite corde goudronnée disposée dans les haubans pour former des échelons.
Estran : partie du littoral située entre les niveaux des plus hautes et des plus basses mers.
Étai : voile triangulaire entre les mâts.
Étoupe : fragment de vieux cordages, de chanvre, de lin.
Enseigne : grade d’officier au-dessous de lieutenant.
Espar : pièce de bois permettant d’établir une voile.
Étrave : partie située à l’extrême avant de la coque.
Faux-pont : pont situé sous le pont principal.
Ferler : plier la voile autour de sa vergue.
Flèche : voile déployée au-dessus d’une voile aurique.
Flot : période pendant laquelle la marée est montante.
Flûte : trois-mâts servant au transport, gréé avec une voile latine sur le mât d’artimon.
Foc : voile triangulaire à l’avant d’un navire.
Gabare : bateau traditionnel de transport, à fond plat.
Gaillard : pont surélevé d’un navire à l’avant ou l’arrière.
Galion : gros navire de transport, à plusieurs ponts, à châteaux avant et arrière, possédant entre trois et cinq mâts, avec une voile latine sur le mât arrière.
Gargousse : sac contenant la charge de poudre d’un canon.
Gouvernail : partie mobile à l’arrière de la coque servant à diriger le navire.
Gréement : ensemble de tous les accessoires de voilure et de mâture d’un voilier, servant pour les manœuvres.
Hauban : cordage servant à tenir les mâts sur les côtés.
Hisser : établir, lever une voile, une vergue, un pavillon.
Hune : plate-forme placée à la jonction de deux mâts superposés, permettant d’accrocher les haubans.
Jusant : période pendant laquelle la marée est descendante.
Larguer : lâcher, détacher ou détendre un cordage.
Latine : voile triangulaire portée par une longue vergue en oblique, croisant de part et d’autre du mât.
Lumière : orifice sur le sommet d’un canon par lequel on met le feu à la charge de poudre.
Misaine : mât vertical le plus en avant d’un voilier.
Mitraille : paquet de balles tiré par des canons
Mouiller : mettre l’ancre à l’eau pour immobiliser le navire.
Palan : assemblage de poulies et de cordages pour effectuer des travaux de force.
Panne : navire arrêté par l’orientation contraire des voiles.
Passavant : passerelle ou zone du pont qui conduit du gaillard d’avant au gaillard d’arrière, à tribord et à bâbord.
Pavillon : drapeau.
Pic : position verticale de l’ancre.
Pierrier : petit canon, projetant de la mitraille, articulé sur une fourche plantée sur le bastingage.
Pirate : pilleur, bandit agissant pour son propre compte.
Pont : niveau ou étage d’un navire.
Pompe : appareil servant à aspirer et à refouler l’eau, pour assécher la cale.
Poulaine : plate-forme située à l’avant, sous le mât de beaupré, servant notamment de latrines à l’équipage.
Poupe : partie arrière du navire.
Proue : partie avant du navire.
Quart : période de quatre heures, de service ou de repos.
Sabord : ouverture pratiquée dans la muraille du navire de guerre pour y faire sortir le fût du canon.
Schoener : navire à deux mâts, l’arrière plus haut que l’avant, gréés d’une voile aurique, d’un flèche et de focs.
Second : adjoint du commandant du navire.
Timonier : homme tenant la barre et gouvernant le navire.
Tribord : côté droit du navire en regardant vers l’avant.
Vergue : pièce de bois établie en travers des mâts pour supporter les voiles.
Vigie : marin posté sur la hune et chargé de surveiller la terre, les récifs, les autres navires.
Virer de bord : changer de direction par rapport au vent.
1
Lundi 6 juillet 1615
09h00, Limousin, royaume de France
— Tête d’âne !
Jeanne Lachan expira entre ses dents et secoua la tête de dépit. Tout en continuant à pester, elle lança un drap à son jumeau, trempé et penaud :
— T’as encore suivi ces deux idiots !
— J’ai pas eu le choix… soupira Joseph.
Son frère se déshabilla et se sécha. Jeanne récupéra ses vêtements ruisselants et les étendit au soleil, à quelques pas de la petite ferme familiale.
— Têtes d’âne !
Même cause, même conséquence. Théobald et Théodore, les deux grands jumeaux, comme tout le monde les appelait, déboulaient à leur tour, dans un état similaire, mais avec enthousiasme. Plus vieux, plus trapus, plus courts sur pattes, moins roux et pas bien malins.
— On en a encore trouvé ! répondirent-ils fièrement.
Ils se débarrassèrent de leurs habits dégoulinants, Jeanne les déposa sur le fil.
— Je suis sûre qu’ils en cachent la moitié, murmura-telle. Sans rien en faire, juste par avarice…
Joseph approuva en silence. Jeanne et Joseph, malgré leur croissance fulgurante, restaient les petits jumeaux.
— Chez les voisins ? demanda-t-elle.
— Oui. On n’a toujours pas baptisé ce ruisseau…
Jeanne lui sourit avec affection, avec amour. Un poète. Doux, calme, posé, réfléchi, prudent, rêveur. Si proche, si semblable, mais si différent. Son double et son opposé.
— Dieu a de l’humour, il a dû nous créer un soir de fête pour avoir inversé corps et esprits, récita Joseph.
Leur rengaine habituelle. Comme toujours, il lisait dans son cerveau et dans son cœur. Fonceuse, intrépide, aventureuse, Jeanne regrettait parfois de ne pas être un garçon, pour cette liberté d’action dont elle aspirait si souvent. Elle eut une brève pensée émue pour leur aîné, Michel, parti assouvir sa passion du travail du bois et de la construction. Elle soupira en songeant à ce qu’il devait découvrir : de nouveaux horizons, de nouvelles merveilles, de nouvelles personnes. Jeanne l’aimait beaucoup, sa présence protectrice, attentionnée et bienveillante lui manquait.
— Pas comme les deux autres nigauds ! grogna-t-elle.
Les intéressés riaient et dansaient autour de leurs trouvailles matinales étalées sur la table, sans doute en imaginant des montagnes de choses à s’offrir.
— Et si on le baptisait le Joyeux ? proposa Joseph.
Il ne l’avait pas entendue, concentré sur ses réflexions aquatiques.
— Non, trancha Jeanne. Messire capitaine dit que le nom de ces cours d’eau doit contenir le son au, qui vient du latin aurum. Comme dans l’Auvézère, la Vézère de l’or.
L’Auvézère, d’abord un ruisseau à la source située à une bonne lieue du village de Masseret, puis une jolie rivière coulant vers le sud-ouest. La Vézère, plus grande, plus sauvage, plus tumultueuse, plus au sud.
— Et il faut l’écouter, confirma Joseph. Comme c’est lui qui t’a dit qu’il y en avait à cet endroit, à l’emplacement d’une ancienne mine romaine. Je trouverai…
Jeanne hocha la tête en coupant du pain et du fromage. Elle en donna la moitié à son jumeau, sans réfléchir, par habitude. Si elle avait faim, il avait faim, il en était toujours ainsi. Elle mangea, il mangea.
Comme tous les jours, elle s’était levée tôt et travaillait depuis des heures. Mais elle aimait s’occuper des bêtes, du jardin et du verger. Chèvres et boucs, brebis et béliers, truies et cochons, poules et coqs, et tous leurs petits. Les garçons se gardaient le privilège des vaches, des veaux, des bœufs et des taureaux. Sur la bonne terre limousine, les légumes poussaient en abondance et les arbres ployaient sous le poids des fruits. Les prés avaient été fauchés et le foin remisé. Après la traite, Jeanne avait passé près d’une heure dans leur fromagerie. Leurs parents avaient choisi de se diversifier. Une heureuse décision. Si le royaume de France sombrait dans le chaos, paradoxalement, la ferme prospérait, plus qu’autosuffisante et riche des ventes de ses produits.
Par la porte laissée ouverte, Jeanne aperçut la démarche solide de leur père :
— Thébado !
Une manière simple et rapide d’appeler les grands jumeaux. Ils se figèrent. Jeanne retint un sourire. Son autorité naturelle la surprenait sans cesse, malgré son statut de benjamine de la fratrie, de quelques secondes avec Joseph, d’un peu plus de trois ans avec les deux cadets.
Leur père posa à peine les yeux sur la table :
— Bien…
Ce fut la seule réaction, habituelle, d’un homme rude et taciturne, mais juste et compréhensif. Il devait estimer que les quelques pépites d’or compensaient l’absence matinale des trois garçons aux travaux de la ferme.
Il tendit un bout d’écorce, Jeanne s’en saisit, il expliqua :
— J’ai croisé le maçon, le carrier, le charpentier et le couvreur. Ce sont leurs prix si nous les employons en même temps que nos nouveaux voisins inconnus qui, comme je le craignais, font bâtir en haut de la colline.
Il se tourna vers les grands jumeaux :
— Et si vous aidez à porter les matériaux. Sans faute !
Les deux hochèrent la tête, de concert et en silence. Jeanne déchiffra les inscriptions mal gravées sur le bois.
Joseph possédait quelques bases, mais elle seule savait lire, écrire et compter sans hésitation et sans faute. Michel lui avait enseigné les notions. Le capitaine de Lynier, ancien marin et nouveau noble, connaisseur des antiques mines d’or romaines en Limousin et de tout un tas d’autres choses, avait développé ses compétences en échange d’un panier quotidien de produits de la ferme. Il ajoutait toujours quelques pièces. Trop. Jeanne adorait ces moments de découverte et d’apprentissage, parfois scolaires, parfois sur le monde, remplis d’anecdotes et d’histoires extraordinaires. Le vieux capitaine semblait y prendre aussi plaisir, ces discussions devant occuper ses longues journées solitaires.
— Mais ? s’étonna Jeanne. C’est beaucoup moins cher que ce qu’ils avaient dit le mois dernier !
— Peut-être qu’ils n’ont plus de travail avec les troubles, alors ils baissent les prix pour en décrocher, suggéra Joseph.
— Ça compense… grogna leur père.
Les terres de leurs nouveaux voisins faisaient partie d’un lot qu’il devait et qu’il aurait dû acquérir. Jeanne avait proposé de l’accompagner chez le notaire, il avait refusé, certainement à cause d’une fierté mâle mal placée. Il avait cru la parole de maître Rathenau, il avait serré sa main, il avait signé les documents, mais il n’avait obtenu que quelques bois et quelques petits champs de médiocre qualité.
— Pas de nouvelles du juge ? demanda Jeanne.
— Il trafique avec Rathenau, c’est de notoriété publique !
Sur la pointe des pieds, Jeanne récupéra cinq ardoises posées en haut du buffet construit par Michel, lui aussi très grand, et les étala sur la table. Sur chaque rectangle gris, tracé à la craie blanche, un plan pour leur future ferme, plus ou moins vaste. Elle les rangea par ordre croissant et appuya son index sur l’ardoise centrale :
— Ça, c’est ce que nous avions prévu.
Elle décala son index droit sur le projet le plus spacieux :
— Pour le même prix, on peut maintenant avoir ça.
— Et ça fait combien de ce qu’on a, déjà ? demandèrent Théobald et Théodore.
Question habituelle. Jeanne les fixa, attrapa trois pommes dans la corbeille et les aligna sur la table :
— Les deux tiers.
Elle mit deux pommes dans ses poches et laissa la dernière. Quatre yeux et deux bouches s’arrondirent, mais, comme chaque fois, Jeanne ne sut déterminer ce qu’ils comprenaient.
— Mais nous, on aura cette maison pour nous tout seuls ? demandèrent-ils encore.
Leur père acquiesça. L’hiver, ils se serraient dans la bâtisse actuelle, trop petite. Une pièce unique. Aux beaux jours, les grands jumeaux dormaient dans une cabane grossière, autant pour libérer de l’espace que pour leur plaisir et la surveillance des bêtes et de la ferme. Elle serait leur futur logement quand Jeanne, Joseph et leurs parents déménageraient à quelque distance, sur une zone plus plate, plus dégagée et moins humide. Ce relatif isolement leur permettrait peut-être de trouver une épouse, car, pour le moment, aucune femme ne voulait de l’un d’eux. Ce qui ne semblait ni les déranger ni les intéresser.
Leur père, après une brève réflexion, choisit le plus grand plan. Jeanne devança sa question :
— Oui, il y a de la place pour toutes les bêtes. Deux bâtiments attenants. Les deux parties basses pour elles, un étage pour nous, un étage pour le foin et les récoltes.
Il approuva d’un rapide mouvement de la tête. Sa décision était prise. Il leva l’ardoise :
— Je vais la donner aux artisans. Demain, nous irons à la foire de Treignac.
— Est-ce raisonnable ? osa Joseph, les lèvres pincées.
Avec justesse. Partout, l’insécurité régnait, des troupes armées investissaient le Limousin, des brigands terrorisaient la campagne, les chemins s’étaient transformés en coupe-gorges, les cités et les châteaux se barricadaient, la loi ne s’appliquait plus. À la mort du roi Henri IV, cinq ans plus tôt, en 1610, la reine, sa veuve, Marie de Médicis, s’était emparée du pouvoir, leur fils Louis XIII n’ayant que huit ans. Les décisions de la régente, les conflits religieux et financiers, les intrigues, les jalousies, les désirs de pouvoir, les rêves de fortune et l’échec des états généraux avaient poussé les grands seigneurs vers la révolte et le royaume vers une nouvelle guerre civile.
— Justement, il faut bien que les bourgeois et les villes mangent, répondit leur père. Les Vergne viendront.
Jeanne approuva, mais grimaça. Des amis et voisins. Trois solides gaillards, aussi gentils que sales et puants. Deux bonnes raisons pour fuir les avances des deux fils.
— Et peut-être les Bouillaguet.
Les joues de Joseph rosirent à peine. Certaine d’être la seule à l’avoir remarqué, Jeanne lui adressa un clin d’œil. Son frère s’empourpra. Elle savait qu’il n’était pas insensible au charme de leur fille. Jeanne l’appréciait. Un peu plus jeune qu’eux, intelligente, courageuse et dure à la tâche malgré un problème à une jambe qui la faisait boiter.
Leur père posa sa vieille arbalète et son antique sabre sur la table. Les grands jumeaux viendraient pour leurs biceps et leurs lourds gourdins, Jeanne pour son habileté à l’arc et avec les chiffres, Joseph pour sa minutie en tout. Aussi doué qu’elle, mais, trop sensible, il ne parvenait pas à décocher une flèche sur les loups et les renards qui approchaient leurs troupeaux. Il tournait même de l’œil quand il fallait saigner un cochon, plumer une volaille ou découper un mouton.
— Nous prendrons quelques bêtes et la vieille charrette, décida leur père.
Jeanne haussa les sourcils de surprise :
— Pourquoi la vieille ? Elle est si lourde…
— Parce que…
Une réponse a priori suffisante. Il justifiait rarement ses raisons. Avant de partir, Michel en avait fabriqué une nouvelle, plus légère, plus pratique, mais plus petite. Jeanne comprit, leur père visait une forte rentrée d’argent avant les travaux. Un pari risqué, mais qui pouvait s’avérer lucratif grâce à la conjoncture. Treignac organisait une foire le premier mardi de chaque mois, un événement important pour les paysans et les artisans, contre seulement quatre par an à Masseret et à Chamberet, un peu plus à Uzerche.
Les marchés étaient plus fréquents, une à deux fois par semaine. Depuis deux ans, Jeanne s’y rendait sans leur mère qui avait affirmé qu’elle était devenue leur meilleur argument de vente. Jeanne avait compris qu’il s’agissait d’une récompense pour la qualité de son travail et de ses produits. Depuis peu, elle la soupçonnait de ne pas lui avoir tout expliqué. Mais les faits lui donnaient raison, son étal se vidait le premier et elle ne ramenait jamais rien. Les grands jumeaux l’accompagnaient, pour un autre motif. Leur réputation, leur air buté et leurs lourds gourdins ôtaient à quiconque toute envie de vol ou de tromperie.
Leur père pointa le plan :
— Jeanne, Joseph, vous allez tracer au sol. Ensuite, vous irez aider votre mère à préparer tout ce qu’on peut emmener demain. Théobald et Théodore, vous continuez à défricher et vous commencez à creuser les fondations.
Tout ce qui pouvait être réalisé en avance ne serait pas fait et facturé par les artisans.
— Rends-nous l’ardoise alors, dit Jeanne. On la leur donnera quand on aura planté les piquets.
— Oui, tu as raison. Nos futurs voisins sont des nobles, ils ont dû soudoyer cette fripouille de Rathenau. Les de la Tour, d’après ce qu’on raconte.
11h00, Dundee, royaume d’Écosse
— Tête d’âne !
Le cri de dépit de son père fut le dernier son qu’entendit Cadwalader Roff avant de percuter la surface froide de l’eau du port de Dundee. Au lieu de songer à la noyade, ses pensées s’égarèrent vers les conséquences de sa chute sur la réputation familiale de malchance et de maladresse. Une longue lignée d’accidents, de malheurs et de destins contraires. De mémoire d’hommes, la malédiction remontait à la bataille d’Azincourt, exactement deux cents ans plus tôt. Leur aïeul, un archer gallois, bousculé par un chevalier anglais, était tombé le nez dans la boue alors que son postérieur recevait le carreau d’une arbalète française.
L’envie de vivre fut plus forte que la facilité de céder à la fatalité. Cadwalader hurla en silence dans le liquide inhospitalier, ses poumons brûlèrent, ses bras et ses jambes se désolidarisèrent de son cerveau et battirent en tous sens.
Quand sa tête jaillit à l’air libre, il toussa et cracha, les membres toujours en action, d’une manière désordonnée et, il en était certain, ridicule. La panique reflua, en partie. Malgré sa parfaite maîtrise de la nage, il se trouvait en fâcheuse posture entre le mur de bois d’un immense navire et le mur de bois d’un modeste navire, l’un pouvant à tout moment décider de rejoindre l’autre, de la même manière qu’ils s’étaient écartés, sans raison, sans logique, sans avertissement, mais avec célérité, emportant l’échelle de coupée permettant de passer du plus petit au plus grand bateau, avec, pour unique conséquence, le bain de celui qui l’empruntait.
— Attrape !
De nouveau, la voix de son père. Cadwalader sentit plus qu’il ne vit le cordage lancé pour le sauver. Le choc sur son crâne l’assomma à moitié.
— Mes excuses, Caddie !
Cadwalader but à nouveau de l’eau de mer, toussa et cracha encore. Ses mains fouillèrent l’espace, à la recherche du fil de vie. En manque d’appui, alourdi par ses vêtements, son corps replongea. La panique revint. Sous la surface, les deux murs remplissaient sa vue floue. Il se demanda s’il allait mourir écrasé ou noyé.
Par miracle, ses doigts se refermèrent sur le chanvre du cordage. Cadwalader se sentit tiré en avant. Ses yeux, son nez et sa bouche retrouvèrent l’air et leurs fonctionnalités.
— Dépêche-toi !
Encore son père. Cadwalader leva la tête. Une échelle pendait devant lui, il s’en saisit et grimpa comme il le put, avec lenteur et difficulté, sans agilité ni élégance.
Il toussa et cracha une dernière fois, puis s’effondra sur le pont, sans aucune prise sur les tremblements qui secouaient son corps glacé. Une bonne âme posa une couverture, lourde et grossière, sur ses épaules, il réussit à s’y envelopper.
Un vieux marin s’approcha de son père et du capitaine Hodgkin, un gros cordage déchiqueté à la main :
— Ça n’arrive jamais, monsieur Roff…
Cadwalader pinça les lèvres à son regard appuyé. La malédiction familiale allait encore alimenter les conversations et expliquer l’inexplicable. Une réponse facile au mystère de l’amarre brisée.
Cadwalader examina le bout déchiré et comprit en un instant. Le goudronnage, indispensable à la protection du chanvre contre l’humidité et la pourriture, avait disparu. Ou il n’avait pas été appliqué. Les fils s’étaient abîmés et avaient cédé. Aucun mystère.
Cadwalader ouvrit la bouche. Pas assez vite.
— Ça n’arrive jamais, monsieur Roff, répéta le vieux marin.
Et il partit. Cadwalader ferma la bouche. À leur tour, son père et le capitaine Hodgkin l’abandonnèrent à son sort. Il expira sans fin, et, seul oisif du bord, finit par se lever. De toute façon, personne n’aurait écouté son argument.
Il se trouvait au centre du pont supérieur couvrant presque toute la longueur du navire aux formes arrondies, nommé flûte par les Néerlandais. Cadwalader tenta de se souvenir des rares explications reçues la veille lors de sa première et brève visite.
Tout à l’avant, incliné, le mât de beaupré avec, au-dessous, la poulaine, une plate-forme servant notamment de latrines pour les matelots, les embruns se chargeant de les nettoyer.
Le gaillard d’avant occupait le premier quart du pont supérieur, entre les mâts de beaupré et de misaine.
Le gaillard d’arrière courait sur la seconde moitié du navire, derrière le grand-mât. Dans le troisième quart, donc entre le grand-mât et le mât d’artimon, huit pièces d’artillerie nommées faucons, de près de dix pieds de long, tirant des boulets en fonte de cinq livres. Quatre à bâbord, la gauche, et quatre à tribord, la droite. Dans le quatrième quart, la dunette, un espace surélevé de quelques marches, réservé aux officiers et à la conduite de la flûte, avec la commande du gouvernail, et deux des six pierriers, deux autres se trouvant au centre, les deux derniers à l’avant.
Dans le deuxième quart, entre le mât de misaine et le grand-mât, les deux passavants permettaient de relier, comme des passerelles, les deux gaillards et encadraient une vaste ouverture. Dans ce trou, entassés sur le pont inférieur, la chaloupe et les deux canots, plus courts.
Cadwalader y descendit. Outre ces embarcations, ce pont, dit de batterie, portait les deux rangées de dix demi-couleuvrines chacune, des pièces d’artillerie aux boulets en fonte de dix livres. Tout à l’arrière, le saint des saints : la grand- chambre, spacieuse et lumineuse grâce aux larges fenêtres, lieu du pouvoir et des décisions importantes, avec, sur les côtés, les cabines du capitaine et de son père.
Cadwalader poursuivit sa plongée dans les entrailles de la flûte. Au-dessous, dans le faux-pont, dernier étage avant la cale et ses différents compartiments, des cabines et quelques locaux particuliers, comme l’infirmerie. Cadwalader, soulagé, retrouva le chemin menant à la minuscule pièce partagée avec les trois lieutenants, accolée au pied du mât d’artimon. Le premier lieutenant McGonagall, commandant en second du navire, puis les deuxième et troisième lieutenants, dans l’ordre hiérarchique. Plus proche du grand-mât, la chambre réservée aux quatre enseignes, officiers d’un grade inférieur. Plus à l’avant, sous la chaloupe et les canots, le dortoir avec les hamacs des matelots. Encore plus vers la proue, la cabine des maîtres, experts dans leur spécialité et maillons indispensables de la liaison entre le commandement et les marins.
Plusieurs échelles et escaliers, répartis dans toute la flûte, permettaient de relier les différents ponts.
Cadwalader croisa le premier lieutenant McGonagall qui ne daigna pas lui adresser le moindre regard. L’officier ne décolérait pas du prêt forcé de sa cabine à son père. Cadwa-lader soupira, il n’y était pour rien.
Il ôta ses vêtements trempés. Alors qu’il se faisait une joie de ce voyage, il déchantait. La dure réalité le frappait de plein fouet. Il était né et avait grandi à Dundee, ville portuaire écossaise sur la rive nord de l’estuaire de la Tay. Il avait toujours été attiré par l’océan, mais, paradoxalement, il avait peu navigué.
Le mois dernier, son père, Archibald Roff, un riche commerçant, entrepreneur et armateur, était revenu d’un long périple sur le continent avec, dans ses bagages, trois énormes navires. Sa nouvelle acquisition. Trois flûtes construites par les Néerlandais. À l’occasion d’un détour par Londres, il avait obtenu une audience auprès de Jacques 1er, roi d’Angleterre et d’Irlande depuis 1603, à la mort de la grande Élisabeth 1re, et roi d’Écosse depuis 1567 sous le nom de Jacques VI. Archibald avait évoqué l’idée de fonder la Compagnie des Indes occidentales, petite sœur américaine de la Compagnie des Indes orientales, orientée vers l’Asie, née en 1600 et copiée par les Néerlandais en 1602. Il avait suggéré au monarque la possibilité d’une autre voie vers les Indes, au sud de la Terre de Feu, moins difficile que le détroit de Magellan.
Cadwalader, sec et réchauffé, s’habilla. Archibald avait donc investi dans ces trois navires, dans le but avoué de commercer avec la France. Là s’arrêtait sa compréhension de la logique paternelle. Ce n’était pas la première fois que ses choix, ses décisions et ses affaires suivaient un chemin déroutant et irrationnel. Sauf que son père réussissait tout, en parfaite contradiction avec la malédiction familiale. Peut-être que, tout simplement et de la même manière, les voies divines le dépassaient.
Cadwalader étendit ses vêtements trempés, comme il le put dans l’espace exigu, et remonta sur le pont de batterie. Il tourna la tête vers l’arrière et la grand-chambre à la porte ouverte. Il reconnut la voix du capitaine Hodgkin et s’approcha, indécis sur ce qu’il pouvait et ne pouvait pas faire.
— Entre Caddie, entre ! cria son père.
Il possédait le don de le mettre mal à l’aise. Parfois très dur, parfois trop affectueux. Cadwalader pénétra dans la pièce en tentant de masquer ses émotions et la sensation d’avoir perdu la moitié de ses dix-sept ans avec ces trois mots.
Autour de la table, le capitaine Hodgkin à l’extrémité arrière, Archibald à l’opposé, les deuxième et troisième lieutenants sur un grand côté, le premier lieutenant McGonagall et une chaise vide sur l’autre grand côté. Cadwalader s’y assit. L’attitude de son voisin exprimait une franche désapprobation. Tous les officiers portaient l’uniforme rouge imposé par son père.
Sur la table, quelques documents et une carte déroulée. L’Écosse, l’Angleterre et la France. Cadwalader pinça les lèvres, rien à voir avec les Indes ou les Amériques. Archi-bald se racla la gorge :
— Bien… Je sais que ce n’est pas la saison habituelle pour le commerce avec la France, mais ce voyage est une première, une expérimentation. Mes contacts m’assurent d’une cargaison suffisante pour remplir nos trois flûtes.
Avec un large sourire, il scruta chaque visage et poursuivit :
— Notre destination est Bordeaux. Nous y achèterons du vin et des alcools du Poitou. Si besoin, nous pourrons compléter à Libourne et à La Rochelle.
— Mille milles à parcourir, intervint le capitaine. Monsieur McGonagall ?
— Le chargement est terminé, répondit le premier lieutenant McGonagall. Les cales sont pleines. Laine, tissu, draps, saumons et harengs fumés, répartis dans les trois flûtes. Des vivres pour deux mois.
— Mes contacts français sont prévenus et disposés à les écouler, dit Archibald. Sommes-nous donc prêts à partir ?
— Parés à appareiller, monsieur Roff ! La marée est haute, la mer est calme et un léger vent souffle de l’ouest. Des conditions idéales.
Archibald et le capitaine Hodgkin se levèrent, les quatre autres l’imitèrent dans l’instant et tous quittèrent la grand-chambre, puis gagnèrent la dunette. Cadwalader, sans but ni travail, les suivit et s’accouda dans un coin.
Leur flûte, le Géar, ressemblait à ses deux sœurs, les trois ayant été baptisées avec des noms à double sens. Gear, sans l’accent, signifiait, en anglais, l’ensemble des voiles et du gréement d’un navire. Géar, avec l’accent, tranchant en écossais. Derrière le Géar, le Seas, les mers en anglais, être débout en écossais. Derrière le Seas, le Math, bon en écossais. Le Seas et le Math ne portaient que six faucons aux boulets de cinq livres et six pierriers, pour libérer un maximum de place pour le fret. Quarante hommes d’équipage, contre cent cinquante pour le Géar, une différence expliquée par les servants nécessaires aux pièces d’artillerie, trente-quatre contre douze, dont vingt de calibre supérieur.
Sur les trois navires, les marins s’activaient. Cadwalader n’y comprenait pas grand-chose. Il avait tant à apprendre, mais n’osait pas participer. Il en mourrait pourtant d’envie. Être utile plutôt que porteur de malchance.
Des matelots se dirigèrent vers le grand cabestan. Ce cylindre, installé sur le gaillard d’arrière, se prolongeait en dessous, sur le pont de batterie, et permettait la manœuvre de lourdes charges. Les hommes y insérèrent une douzaine de barres dans les orifices prévus à cet effet. Le capitaine Hodgkin hocha la tête, le premier lieutenant McGonagall lança un ordre et les marins, deux par barre, poussèrent sur ces leviers horizontaux. Cadwalader savait que la même scène se reproduisait à l’étage inférieur, doublant la force exercée.
Une activité similaire se répétait sur le Seas et le Math. Les ancres remontaient. Sur les eaux calmes, à peine ondulées et sans courant visible, plusieurs canots tournaient autour des flûtes. Cadwalader ne saisissait pas la raison de leur présence. Il remarqua, là encore sans comprendre, que le Géar semblait reculer alors que le Seas semblait avancer.
Des cris s’élevèrent de l’avant du Géar. Cadwalader ne perçut ni leur signification ni leur fondement. Des matelots galopèrent sur le pont supérieur, dans tous les sens, sans logique apparente. D’autres cris, provenant de l’arrière et d’en bas, firent tournèrent les têtes. Cadwalader imita les marins et, d’effroi, ouvrit la bouche. Le Seas se trouvait tout proche, heureusement un peu décalé. Son mât de beaupré frôla le Géar. Des claquements secs supplantèrent le brouhaha ambiant, Cadwalader se pencha. Les avirons d’un canot, coincé entre les deux monstres de bois, venaient de se briser. L’arrière de la petite embarcation, comprimé entre les navires, explosa en un craquement sinistre. Les cris redoublèrent, des mains jetèrent des cordages. Les quatre naufragés, trempés et tremblants, réussirent à grimper dans un autre canot. Cadwalader se rendit compte qu’il avait cessé de respirer. Il expira et inspira longuement, soulagé. Sur le pont du Géar, de nombreux regards accusateurs et appuyés le visèrent. Il leva les yeux au ciel, ne pouvant être responsable de tous les malheurs du monde.
Les deux flûtes, après s’être frôlées, finirent par s’éloigner. La frénésie se calma. Le capitaine Hodgkin masquait mal sa fureur sous un vernis d’impassibilité.
Cadwalader comprit la fonction des canots : reliés aux navires par de longues amarres, ils les tractaient vers l’axe du fleuve à la force de leurs avirons.
Au bout du quai, le convoi vira à bâbord, vers le large. Le capitaine Hodgkin lança quelques ordres, des marins, les gabiers, se précipitèrent vers les haubans, ces épais cordages bloquant le mât en position verticale, puis sur les vergues, ces pièces de bois allongées et horizontales supportant les voiles. Tout à l’avant, sur le mât de beaupré, le vent gonfla deux petites voiles. Sur la moitié haute du mât de misaine, un grand rectangle blanc s’affala. Les canots s’écartèrent, le Géar prit un peu de vitesse et s’inséra entre l’extrémité du quai et un brise-lame. Curieux, Cadwalader observa cette structure constituée de divers matériaux : moellons, rochers, pieux et planches.
Le brise-lame s’effondra, comme englouti par les flots dans un bref bouillonnement. Des exclamations de surprise et de peur remplacèrent les ordres. Cadwalader tourna la tête vers le pont. Tous les regards convergeaient vers lui.
15h00, Brouage, Saintonge, royaume de France
— Tête d’âne !
Ermeline Bercheux, après avoir ouvert la porte, se tenait droite, les poings sur les hanches. Une attitude sévère en contradiction avec son visage radieux.
En face d’elle, un solide gaillard, ruisselant sous la violente averse comme s’il avait plongé dans l’océan Atlantique, éclata d’un rire sonore. Sa voix grave portait autant :
— Quel accueil ! Bonjour ma fille ! Moi aussi, je suis heureux de te revoir !
Il s’avança de deux pas à l’intérieur, Ermeline sauta à son cou et l’entoura de ses bras, sans aucune considération pour sa toilette qui prit une teinte foncée au contact de la cape de pluie.
— Ne pouvais-tu pas attendre que le déluge cesse ? fit-elle semblant de grogner.
— J’étais pressé de te retrouver et de rentrer enfin à la maison.
Ermeline aida son père à se défaire de ses bagages et de sa couche supérieure de vêtements imbibés d’eau. Gudule, l’unique domestique, accourut. Une femme d’un certain âge qui l’avait élevée à la mort de sa mère et qui veillait jalousement sur la petite famille.
— Merci… soupira-t-il.
Allégé, il alla changer son pourpoint et ses hauts-de-chausses. Quand il revint, Ermeline ne le laissa pas respirer :
— Alors ?
— Avez-vous dîné, capitaine ? demanda Gudule.
Le capitaine Crispin Bercheux secoua la tête en souriant. Ermeline grogna, échouant à réfréner son impatience. Il s’attabla et Gudule entassa les victuailles. Il s’y jeta avec appétit. Ermeline grogna encore. Il rit la bouche pleine :
— Quel empressement, mademoiselle !
— Quel manque de savoir-vivre, monsieur le capitaine de Sa Majesté !
Il posa sa cuillère, ouvrit sa vieille sacoche en cuir et lui tendit un document. Ermeline le dévora. Puis elle cria en battant des mains.
— Oui, ma chère fille ! s’exclama Crispin, aux anges. Tout s’est bien passé, bien mieux que prévu. J’ai eu l’honneur d’obtenir une audience auprès de notre roi et de la régente. Le jeune Louis XIII m’a fait bonne impression, à l’écoute de mes propositions. Il a accepté de financer entièrement notre Foudre, en échange d’une mission d’escorte de l’expédition destinée à sauver la France équinoxiale.
Ermeline hocha la tête. Un nom pompeux pour désigner quelques centaines de Français partis trois ans plus tôt de Cancale, au printemps 1612, pour une île accueillante, mais isolée, d’une contrée chaude et humide à l’excès, noyée dans une forêt dense d’arbres immenses, découpée par des fleuves aussi innombrables que puissants. Ils y avaient construit un village et un fort, baptisés Saint-Louis en l’honneur du roi, et un port, baptisé Sainte-Marie en l’honneur de la régente.
— La monarchie avait déjà fourni une partie des fonds pour l’implantation des premiers colons, poursuivit Crispin. Plusieurs nobles s’étaient également engagés. D’autres relancent l’affaire, car les Portugais ont attaqué Saint-Louis en fin d’année dernière.
— Mais pourquoi ? s’étonna Ermeline.
— Parce que les Portugais et les Espagnols se sont arrangés pour se partager les nouveaux mondes et veulent imposer leurs traités aux autres.
— Et ces autres ne sont pas d’accord.
— Tu as tout compris.
— N’est-ce pas trop tard ? demanda Ermeline. Tu as parlé de la fin d’année dernière.
— C’est possible. À la cour, les décisions peuvent être ralenties par des intrigues de pouvoir.
Il la fixa d’un intense regard. Ermeline fit les gros yeux :
— Vas-y ! Quoi d’autre ?
— Pour aider la colonie, sept navires et mille hommes sont prévus, répondit Crispin. Ils s’arrêteront ici et seront bénis par monsieur l’évêque et…
— Et ?
— Et par le roi !
— Quoi ?!
Une explosion d’émotions.
— Oui mademoiselle ma chère fille ! Notre bon roi Louis le treizième a promis de nous honorer de sa présence ! Dans une dizaine de jours !
Ermeline réalisa et pâlit, les mains jointes devant ses lèvres entrouvertes. Son père éclata de rire.
— Dix jours pour que tout soit prêt ? gémit-elle.
— Nous n’allons pas beaucoup dormir ! confirma Crispin.
Il s’essuya la bouche et se leva avec un regard vers la fenêtre :
— Je te remercie, Gudule, c’était délicieux, comme toujours. La pluie a cessé, allons voir notre belle Foudre !
Ermeline suivit son père hors de leur jolie maison à un étage. Ils marchèrent à grandes enjambées sur les pavés, jus-qu’à la porte nord permettant de franchir l’enceinte fortifiée de la ville. Devant eux, le havre de Brouage, un bras de mer aussi large que la cité, environ deux cents toises. À gauche, vers l’ouest, à peut-être le double de distance, derrière des marais salants, l’océan Atlantique. Encore plus loin, à peine visible, l’île d’Oléron. Toujours sur leur gauche, au point le plus étroit du chenal, les vestiges des navires coulés trente ans plus tôt, pendant les guerres de religion. Sur la vingtaine, remplis de sable et de cailloux, envoyés par le fond par le prince de Condé pour bloquer le port de Brouage, seuls quatre ou cinq avaient été retirés, réduisant le passage pour les bateaux.
Ermeline et son père partirent à droite, le long du quai, portion de rivage aménagé pour le chargement et le déchargement des biens. Des pieux, des chaussées de planches, de petits bâtiments, tout un ensemble de choses utiles.
Tout au bout, juste avant la digue dérivant l’eau du fossé entourant Brouage, frontière artificielle protectrice entre les remparts et les marais salants, un grand navire tirait sur son ancre, à une trentaine de toises du bord, là où il ne courait aucun risque d’échouage, même à marée basse.
Ermeline sentait la fierté de son père qui ne l’avait pas vue depuis plusieurs semaines, le temps de son voyage à Paris. Leur Foudre. Si différente des autres bateaux de sa taille. Plus basse, plus élancée, plus fine que les vaisseaux traditionnels et leurs hautes structures à l’avant et à l’arrière, plusieurs étages de gaillards, parfois appelés châteaux. Elle devait ses lignes novatrices à deux jeunes maîtres charpentiers revenant des Provinces-Unies et de tous les grands ports y menant. Ils avaient donné le nom de corvette à ce nouveau type de navire. Un mot d’origine néerlandaise. Tous en parlaient donc au féminin.
Ermeline les repéra de loin, immobiles devant le trois-mâts, en pleine discussion. Elle maudit son cœur de s’emballer, ses joues de rougir, son ventre de papillonner, sa gorge de s’assécher, son cerveau de se vider. Les inséparables, Michel Lachan l’immense rouquin et Rollon Coulon le petit brun.
Les deux les aperçurent et se précipitèrent. Ermeline maudit davantage son corps qui échappait à son contrôle. Après les salutations d’usage, Crispin leur annonça la fabuleuse, mais terrifiante nouvelle. Alors que cela semblait impossible, la peau claire de Michel pâlit.
— La Foudre sera-t-elle prête ? demanda le capitaine Ber-cheux.
17h00, Treignac, Limousin, royaume de France
— Tête d’âne !
Guichard d’Albret frappa du poing le rempart en solides pierres du château. À ses côtés, son fidèle Karl Heidenreich baissa la tête :
— Elle n’était pas seule…
Une piètre excuse, mais aussi vraie que valable. L’ancien lansquenet ne mentait jamais. Ils s’étaient croisés sur le champ de bataille plus d’une dizaine d’années plus tôt et le Bavarois avait abandonné sa longue pique pour suivre le noble français. L’échec ne faisant pas partie de son vocabulaire, l’affaire serait réglée un autre jour.
Guichard se calma, rien ne pressait, rien ne justifiait une telle colère. Mais il n’arrivait pas à se satisfaire de son sort. Il ne parvenait pas à se saisir de cette réussite qu’il sentait à portée de main. Quelque chose lui échappait. Pas assez noble, pas assez riche, pas assez puissant, pas assez glorieux, pas assez influent, pas assez de femmes.
Sa vie aurait pourtant pu être pire. Ou plus courte. Il avait survécu à douze ans dans un uniforme d’officier, à combattre, à éviter les blessures et à envoyer des centaines d’hommes à la mort pour se faire un nom et une fortune. Une réussite en deçà de ses espérances.
Son existence reposait sur le mensonge, la tromperie, l’intrigue, le crime. Mais sa conscience se portait à merveille.
Par intérêt, il avait pris le parti de la régente, Marie de Médicis, contre la révolte des princes. Les dividendes tardaient à venir, mais la guerre civile approchait, avec son cortège d’aubaines. Des châteaux, des terres, des trésors et, bien sûr, des femmes.
Au pied de la muraille, sa jeune troisième épouse marchait à pas lents, comme si elle traînait une paire de boulets d’artillerie. Elle transpirait le malheur et son seul bonheur résidait dans sa promenade quotidienne le long de la Vézère.
Un excellent parti. Fille unique de riches bourgeois décédés. Elle les rejoindrait bientôt.
— Finalement, messire, avec une telle tristesse, nous ne ferons que lui rendre service, dit Karl de sa voix grave au fort accent.
Guichard s’esclaffa, sans retenue :
— Et Dieu nous en remerciera !
Karl ajouta son rire gras. Quand ils se calmèrent, le Bavarois montra la ville :
— Demain, c’est la foire. S’il y a du monde, une bousculade, un accident, une tentative de vol qui vire au drame…
Guichard acquiesça. Il savait que Karl savait qu’il devait rester au-dessus de tout soupçon. Même s’il n’ignorait pas que les gens parlaient dans son dos et l’accusaient de ne pas être étranger à son double veuvage.
Guichard tourna la tête vers l’est :
— Des nouvelles des troupes de la Marche ?
— D’après un marchand d’Aubusson, trois régiments en sont partis pour prendre Tulle. Ils doivent faire la jonction avec des forces stationnées près d’Egletons, de Brive et de Turenne.
Encore une fois, Guichard frappa le rempart du poing :
— Mordiable ! Ils ne doivent pas se regrouper ! Le Limousin ne doit pas tomber aux mains des princes. On dit que le lieutenant général arrive à marche forcée depuis Limoges et que Pompadour va le rallier.
Guichard prit quelques instants pour réfléchir.
— Il faudrait ralentir les régiments de la Marche. Demain, à la foire, essaie d’obtenir des renseignements sur leur position et leur nombre. D’autres marchands ont dû les voir ou en entendre parler. J’espère que nos hommes partis en reconnaissance les repéreront.
Il fit une pause, puis poursuivit :
— J’irai à Masseret mercredi. Le lieutenant général devrait y passer pour gagner le sud.
Karl hocha la tête. Guichard enchaîna :
— À propos de Masseret, et le vieux ?
— Aux dernières nouvelles, toujours au pied de sa tour, toujours vivant, toujours secret. Son fidèle Raoul sera à la foire demain.
Les deux éclatèrent de rire.
19h00, Masseret, Limousin, royaume de France
— Tête d’âne !
Le capitaine Benezet Lynier de la Tour s’appuya sur une pierre à peine plus stable que lui. Le souffle court, les jambes flageolantes, les muscles tétanisés, la vue troublée. Autour de lui, le monde tournait et le ciel se mélangeait à la terre.
— Tête d’âne ! répéta-t-il.
Pour lui-même et contre lui-même, seul en haut du donjon délabré. Des décennies plus tôt, il avait connu le château apte à défendre les villageois, avec ses remparts et ses sept tours. La forteresse fut le théâtre de batailles lors de la guerre des trois Henri. Depuis, ses pierres servaient aux constructions des habitants et il n’en restait presque rien, juste un édifice branlant, prêt à s’effondrer.
— Comme moi… Tomber ensemble serait une belle fin !
Cette fin, Benezet la sentait depuis plusieurs jours, peut-être depuis plusieurs semaines. Il déclinait, il glissait dans la pente sans retour, mais il tenait à l’escalade quotidienne de ce vieux donjon, une des rares choses plus âgées que lui. Pour la première fois, il s’était fait violence pour gravir les marches. Pour la première fois, il avait failli ne pas arriver en haut.
Si son cœur espérait un regain de forme, sa raison lui assénait la triste réalité. La peur de la fin l’avait déserté quand il était revenu dans son pays natal. Au réveil, il bénissait chaque journée que Dieu lui offrait. Il avait eu mille vies et le magnifique panorama lui rappelait sa bonne fortune. Il était né ici, il allait y mourir. Une chance après avoir arpenté tout le monde connu, des lieues et des lieues d’aventures.
La vue des collines, des vallons, des prés et des bois lui apportait un bonheur chaque jour renouvelé. Benezet se sentait et se savait en paix avec ce pays vert qu’il aimait tant, même s’il lui avait été infidèle pendant si longtemps, en paix avec son existence mouvementée et pas toujours chrétienne, en paix avec Dieu et sa conscience, il s’était confessé et avait été pardonné, et, enfin, en paix avec lui-même.
À deux exceptions près, ses affaires terrestres étaient en ordre. Pour la première, il avait fait tout ce qu’il avait pu et, aux dernières nouvelles, sa patience allait être récompensée. Un fait de vie injuste allait être réparé. En revanche, pour la seconde, sa bêtise le dépassait. Depuis plus de cinquante ans, il l’avait repoussée. Sans aucune véritable raison. Peut-être cette attitude puérile, mais si humaine, de l’espoir d’une réalisation divine compensant le manque de courage, dans les deux sens du terme. Il était temps.
Benezet plissa les yeux :
— Évidemment…
Il leva la tête au ciel et murmura une prière. Une bénédiction et un remerciement.
Malgré sa vue défaillante et la distance, il l’avait reconnue, gravissant la pente raide menant au château. Jeune, grande, élancée, vive. L’opposé de ce qu’il était devenu.
Benezet fronça les sourcils. Un individu l’avait arrêtée près du champ de foire, son bras et son doigt tendus vers l’est. Jeanne Lachan tourna la tête dans la direction indiquée. Benezet resta fixé sur l’inconnu et sourit.
Après un instant figé, l’homme salua, s’inclina et partit. Benezet se pencha. Entre le donjon et les premières habitations, son peu fidèle Raoul échangeait avec le lieutenant du juge.
— Bien manœuvré…
Par curiosité, il aurait aimé entendre cette conversation, sûrement des plus intéressantes.
Raoul. Plus de quarante ans à le côtoyer. Benezet l’avait enrôlé comme mousse à ses huit ans, vendu par sa famille trop nombreuse et trop pauvre. Porté sur l’alcool et les ragots, corruptible avec un simple denier, sa main gauche broyée par la culbute d’un canon lors l’un combat naval. Benezet l’avait gardé à son service, ce qui, il le reconnaissait, ne constituait pas la meilleure décision de sa longue vie. Et de loin. Mais un acte de charité chrétienne.
Le soleil plongeait vers les collines de l’ouest. Benezet fit un dernier tour d’horizon. Le dernier de la journée, c’était certain. Le dernier tout court, c’était probable. Avec lenteur, pour figer l’image dans sa mémoire qui la connaissait pourtant à ma perfection. Il s’attarda un peu plus sur le château de la Grénerie. Des souvenirs galopèrent. Une ultime vision en paix.
— C’est ainsi…
Il haussa les épaules et se lança dans la périlleuse descente, avec précaution et difficulté.
Benezet arriva en premier, et en entier, dans sa modeste demeure. Une unique pièce, simple, mais plus grande que toutes ses cabines sur ses différents navires. Il se contentait de peu.
Il s’effondra sur sa couchette et tenta de maîtriser sa respiration haletante. La porte et la fenêtre laissées ouvertes permettaient à une douce brise tiède de circuler. Trois coups.
— Entre Jeanne !
La jeune femme se baissa et pénétra dans son antre, avec sa fraîcheur et sa joie. Elle pétillait de vie. Elle ôta son fichu et libéra ses cheveux fauves.
— Bonjour messire capitaine !
Ce fut à son tour de sourire. Il lui avait maintes fois répété qu’une seule marque suffisait. Messire ou capitaine. Ou Benezet. Mais elle s’y refusait, si respectueuse.
— Vous êtes tout transpirant, messire capitaine ! Il faut vous ménager. Et la tour n’est plus sûre, c’est dangereux.
— Surtout à mon âge !
— Mais non !
Jeanne posa son panier et un grand broc dont elle se servit pour remplir un verre. Elle le lui tendit, il but avec avidité. Son corps le trahissait et oubliait parfois de l’informer de sa soif. L’eau fraîche et pure d’un puits qui n’avait jamais rendu quiconque malade le soulagea et lui donna faim.
— Je vous prie de m’excuser, messire capitaine, je suis en retard aujourd’hui. Mais notre père a décidé d’aller à la foire de Treignac. Alors il a fallu préparer. Et on a aussi dû travailler pour la nouvelle maison.
Jeanne remplit à nouveau le verre et posa le panier sur le lit. Benezet s’installa confortablement.
— C’est pour ça que je vous en ai mis plus, ajouta-t-elle. Demain, je ne pourrai sûrement pas venir. Treignac est loin.
Elle retira le torchon qui protégeait les victuailles :
— Mais ? Qu’est-ce que…
Deux yeux bleus débordant d’incompréhension. Dans son panier, un bout papier. Benezet posa sa main sur son bras et sourit pour la rassurer, il avait vu juste :
— Tu as croisé un messager malin. Que t’a-t-il dit ?
Jeanne fit une légère grimace, la lèvre relevée d’un côté, son petit nez un peu tordu, les paupières plissées.
— Ah ! l’étranger qui m’a demandé où le plus beau soleil du Limousin se levait ?
Benezet éclata de rire.
— Je n’ai pas compris, messire capitaine, grogna Jeanne.
— C’est un messager malin et flatteur. Il t’a fait un élégant compliment.
Jeanne secoua la tête, mélange de déni et, encore une fois, d’incompréhension. Il prit la petite feuille, la déplia et la posa sur le lit, face à Jeanne :
USHX ILE NZVRQKP LSFFO ISR LZSUIMKV
Benezet s’amusa de la concentration de Jeanne. Elle céda après un bref instant :
— Mais ça ne veut rien dire !
Sans cesser de sourire, il leva son index décharné et tremblant. Elle hocha la tête :
— Oui messire capitaine, toujours dépasser les apparences. Ce n’est pas parce que je ne comprends pas que ça ne veut rien dire. Mais qu’est-ce que c’est, alors ?
— C’est un code qui m’a été enseigné par un vieil ami, il y a fort longtemps…
Benezet hésita, c’était peut-être le bon moment. Il trancha, pas encore. Il se maudit intérieurement en repoussant le règlement de sa seconde dernière affaire terrestre. Bientôt.
Il délaissa le papier pour le panier. Des petits pains.
— Tout juste sortis du four banal, dit Jeanne. Nous en avons cuit beaucoup pour demain.
Le four à bois mis à la disposition des habitants par le seigneur, contre une redevance.
— Et des tartes !
Benezet en trouva plusieurs parts, aux fraises, aux framboises et aux myrtilles. Ses tripes gargouillèrent de plaisir :
— Tu me gâtes !
Des fruits, de la viande séchée et des fromages complétaient le panier. Il commença à manger.
— Mais messire capitaine ? s’étonna Jeanne.
Elle montra le bout de papier :
— N’avez-vous pas envie de savoir ce que cela signifie ?
— Si, bien sûr. Mais je serai mieux à même de le déchiffrer le ventre plein.
Il leva encore l’index et Jeanne récita :
— Le cerveau a besoin de l’estomac !
— Le message est court, il doit indiquer une conclusion, dit Benezet. Et seules deux sont possibles. Soit la réussite, soit l’échec. Je vais profiter donc de ton merveilleux repas avec le plaisir de penser à la réussite.
Il piocha dans le panier. Jeanne déposa le reste sur la petite table et le recouvrit du torchon. Elle récupéra celui laissé la veille.
— Que t’a dit Raoul quand tu es arrivée ? demanda-t-il.
— Rien messire capitaine, répondit Jeanne. Il parlait avec le lieutenant du juge et il a essayé de me voler un morceau de votre nourriture. Mais je suis trop vive pour lui !
Benezet lui tendit quelques pièces. Elle désapprouvait toujours, mais ne protestait plus ouvertement depuis longtemps.
— Ton père se serait-il décidé pour votre future maison ? s’enquit-il en feignant l’indifférence.
— Oui messire capitaine. Pour la plus grande, parce que les artisans ont baissé leurs tarifs. Nous allons profiter de leur présence chez nos nouveaux voisins.
— C’est bien.
— C’était votre idée, messire capitaine.
Benezet se retint de sourire trop ouvertement.
— Ton père doit donc être satisfait.
— Oui et non. Il peste toujours contre maître Rathenau qui l’a volé pour les nobles.
Benezet bloqua sa main et un morceau de fromage à michemin de sa bouche, surpris par ce raisonnement :
— En es-tu sûre ?
Jeanne hésita un court instant. Puis répondit :
— Non messire capitaine. C’est, je crois, une déduction.
Benezet avala le fromage et expliqua :
— Que ce pendard de Rathenau vous ait volés, c’est une certitude. Mais…
Il pesa ses mots.
— Mais ce ne fut peut-être pas au profit de vos futurs voisins. Peut-être ont-ils acheté ces terres en toute légalité à l’aide d’un autre notaire. Peut-être, encore, vous évitent-ils d’avoir ce pendard de Rathenau tous les jours dans votre entourage. Peut-être, une troisième fois, notre notaire préféré vous a-t-il menti en vous faisant croire qu’il possédait le mandat pour vendre ces champs et ces bois.
Benezet regrettait de ne pouvoir lui avouer toute la vérité. Il tentait d’insinuer le doute et de calmer les ardeurs de la colère tout en préservant la sécurité de tous. La découverte de ses secrets par les mauvaises personnes pourrait causer bien des ravages, il en était certain. Pourtant, il donnerait cher pour pouvoir les partager avec Jeanne.
— Je le dirai à notre père, dit-elle. J’espère que cela l’apaisera.
Il savait qu’elle savait qu’il était toujours bien renseigné.
— Je vous prie de m’excuser encore, messire capitaine, mais je ne peux pas rester. Je dois aider pour demain.
— Mais bien sûr, Jeanne, je comprends. File et prends soin de toi. Et profite de la foire de Treignac !
— Je vous remercie, messire capitaine !
Elle s’envola. Benezet l’imagina gambader à grandes enjambées dans la descente, se laisser aller à courir en riant. Les joies de la jeunesse insouciante.
Son propre plaisir fut chaque bouchée de son repas. Rien de comparable avec les bouillies servies sur ses navires. Dieu, en lui faisant rencontrer la famille Lachan, avait embelli les dernières années de sa vie.
— Serais-je toujours de ce monde sans eux ?
Repu, il se leva, but un nouveau verre et s’attabla devant une feuille vierge et le bout de papier avec les six mots énigmatiques. Il traça un grand tableau, avec autant de lignes que de lettres dans l’alphabet.
— Je ne suis pas encore trop rouillé !
Il ne lui fallut que quelques minutes de travail et s’esclaffa, seul, en imaginant les efforts de ceux qui lui voulaient du mal, persuadé qu’ils n’arriveraient jamais à le déchiffrer. Des heures, des jours, des semaines, des mois, des années de réflexion inutiles pour rien. Un code simple pour qui le connaissait, mais trop complexe pour eux. Impossible.
Benezet relut sa traduction avec un immense plaisir, une joie sans limite, à la limite du supportable pour son vieux cœur trop faible.
TOUT EST ARRANGE SELON VOS SOUHAITS
Il avait enfin réparé la chose dont il n’arrivait pas à trouver la définition exacte : erreur, injustice, drame, malchance. Mais une chose qui l’avait fait souffrir pendant des décennies, avec une bonne dose de mauvaise conscience, même s’il pouvait sans conteste plaider innocent.
Il brûla le tableau et, par plaisir, abandonna le message codé sur sa table. Puis il récupéra les restes de ses repas de la veille et quitta sa demeure en laissant la porte ouverte.
Il fit quelques pas et s’assit sur une grosse pierre de taille, un vestige du château. Un discret regard en arrière confirma sa prédiction : Raoul se glissait chez lui. Il en sourit. Comme tous les jours, plusieurs enfants maigres accoururent. Il partagea la nourriture et donna à chacun une part. Un autre de ses plaisirs quotidiens.