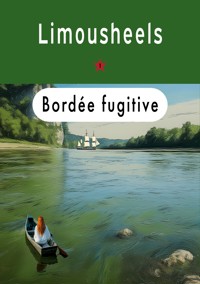Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Les aventures de Sylvie Lachan
- Sprache: Französisch
Corrèze, fin de l'été 2015. Une voiture explose au pied d'un barrage, libérant l'eau et neuf cadavres inconnus. Mais ce n'est qu'un début, les drames et les ennuis s'accumulent sur les escarpins de Sylvie Lachan, la nouvelle préfète. Terroristes surarmés, trafiquants imaginatifs, élus avides, magistrats ambitieux, fonctionnaires cupides, avions furtifs, pilotes expérimentés, ovnis nocturnes. Une pelote de fils emmêlés, soudés par ce qui fait tourner le monde : l'argent, le pouvoir et le sexe. Sylvie ne va pas hésiter à plonger dans ce tourbillon d'actions et d'émotions. Avec glamour et humour, coeur et générosité. Du fond des denses forêts limousines jusque dans les airs, des visites présidentielles à un château du XVe siècle, des kalachnikovs aux émois amoureux.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Retrouvez toute l’actualité de Limousheels sur :www.limousheels.fr
À toutes celles et à tous ceux
qui m’ont soutenue,
aidée, inspirée,
relue, corrigée…
À C., pour tout…
Personnages
Sylvie Lachan
40 ans. Préfète de la Corrèze.
Grande rousse d’un mètre quatre-vingt-un.
Pilote de talons hauts.
Franck Pomarel
36 ans. Frère adoptif de Sylvie. Agriculteur.
« Ina »
Soeur de Sylvie.
Dominique Lachan, « Domi »
Dominique Lachan, « Dom »
Parents de Sylvie, Franck et Ina.
Coumbala Fofana, « Coucou »
Myriam Belfond, « Mymy »
40 ans. Meilleures amies de Sylvie.
Pierre Dibonné
61 ans. Secrétaire général de la préfecture de la Corrèze.
Luiz Marquez, « Louitch »
49 ans. Adjudant-chef, gendarmerie de la Corrèze.
Ancien commando.
Lucie Anti
29 ans. Lieutenant, gendarmerie de la Haute-Vienne.
Keziah Chamoun
45 ans. Capitaine, gendarmerie de la Corrèze.
Gabriel Peyrat
56 ans. Garagiste et mafieux corrézien.
Propriétaire du château de la Grénerie.
Mathias Frou, « Mathou »
49 ans. Pilote de Gabriel Peyrat.
Ancien lieutenant-colonel et pilote de chasse
Pascal Deshors
53 ans. Internaute amoureux de Sylvie.
Gérant du club du château de la Grénerie.
Christian Monincourt
53 ans. Banquier de Gabriel Peyrat.
Locataire du château de la Grénerie.
Alizée Gireau
42 ans. En couple avec Christian Monincourt.
Fabio Volpi
37 ans. Avocat d’affaires.
Maxime Ralagne
51 ans. Président du conseil départemental de la Corrèze.
Nolwenn Le Plouarec
46 ans. Procureur.
Élisabeth Herlié, née Pritch
60 ans. Directrice de cabinet de la préfecture de la Corrèze.
Edmond Herlié.
62 ans. Directeur à la préfecture de la Corrèze.
Mari d’Élisabeth Herlié, née Pritch.
Sommaire
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
1
Vendredi 28 août 2015
13h30, Tulle, Corrèze
— Noooon ?!
Stupéfaction abasourdie…
Ce fut la première pensée de Pierre Dibonné lorsqu’il reconnut la femme qui toquait à la porte de son bureau. Sa grande expérience et son impassibilité légendaire faillirent ne pas suffire à masquer son étonnement.
Il était pourtant prévenu. Ses propres recherches et quelques contacts dans différents ministères l’avaient averti qu’il risquait quelques menues surprises.
Mais, outre cette arrivée impromptue et anticipée de trois jours, il n’avait absolument pas prévu cette avalanche de superlatifs, inhabituels en ce lieu : ces cheveux trop longs d’un roux trop éclatant, ce sourire trop radieux, ce décolleté trop plongeant, cette peau trop délicate, ces taches de rousseur trop nombreuses, ces ongles trop vernis, ces cuisses trop interminables dépassant de cette robe trop courte, ces mollets trop ciselés au-dessus de ces talons trop hauts.
Pierre se rendit compte du silence, trop étiré, trop figé, trop gênant, qui venait de s’installer. Il se leva précipitamment pour accueillir sa nouvelle supérieure. Tout en lui souhaitant la bienvenue et en lui tendant la main, il soupira intérieurement, sentant filer la certitude qu’il s’était forgé que ce serait à elle de s’adapter.
Quelques minutes à ses côtés suffirent pour en avoir la confirmation, tout inexpérimentée qu’elle était. Pierre craignait maintenant beaucoup plus les ravages qu’elle pourrait causer aux différents services de la préfecture.
— Les ravages qu’elle va causer… se corrigea-t-il.
13h45, Tulle, Corrèze
— Noooon ?!
Stupéfaction amusée…
Ce fut le premier mot de Sylvie Lachan en découvrant son nouveau bureau. Elle y fit quelques pas, ses hauts talons claquant sur le parquet brillant. Alors que son index glissait sur les meubles de qualité, elle tenta de saisir, d’identifier et d’assimiler l’atmosphère, les odeurs, les sons, la lumière.
Sylvie décida de ne pas s’attarder. Ses longs cheveux détachés volèrent quand elle pivota vivement vers la porte. Elle sourit en voyant le regard de Pierre Dibonné, le secrétaire général de la préfecture de la Corrèze, soixante-et-un ans tout de même, remonter une fraction de seconde trop tard de ses jambes vers son visage :
— J’aimerais faire le tour des bureaux, annonça-t-elle. J’apprécierais votre présence pour m’expliquer tout ce qui va m’échapper. Mais je comprends si vous avez des choses plus utiles ou plus urgentes à faire.
— Je vous accompagne, madame, répondit Pierre en secouant la tête. Je n’ai rien de plus important à faire en ce vendredi après-midi.
Sylvie perçut une pointe d’inquiétude dans ses mots. Elle se doutait que son attitude ne correspondait pas aux règles et aux coutumes du lieu. Mais avec son intention de poursuivre dans cette voie, entre perturbation des vieilles habitudes, époussetage de la poussière accumulée et recherche d’efficacité, son sourire devint malicieux lorsqu’elle passa devant son nouvel adjoint pour quitter le bureau et commencer la visite surprise de la préfecture. Sa préfecture.
15h00, Mérignac, Gironde
— Noooon ?!
Stupéfaction irritée…
Ce fut la réaction du lieutenant-colonel Mathias Frou, surnommé Mathou par ses pairs, en voyant la jeune sergent-chef qu’il draguait outrageusement depuis des mois lui faire deux magnifiques doigts d’honneur depuis la fenêtre de son bureau du premier étage de l’informe bâtiment gris-vert de la base aérienne de Bordeaux-Mérignac. C’était mérité, il payait son odieuse grossièreté.
Mathias soupira, ôta sa casquette et la lança dans sa voiture. Il jeta un dernier coup d’oeil vers ce poste de commandement où il avait travaillé ces trois précédentes années. La jolie militaire était toujours là, fière et majestueuse avec ses deux majeurs bien dressés. Il lui envoya un baiser du bout des doigts, desserra sa cravate et s’installa au volant.
Avant de prendre à droite vers la sortie de la base, il fit un ultime geste de la main par sa vitre grande ouverte. Un dernier au revoir au cas où quelqu’un le regarderait s’en aller en regrettant son départ. Ce dont il doutait sérieusement.
— Voilà, c’est fini, aujourd’hui ou demain c’est l’moment ou jamais… fredonna-t-il en franchissant la barrière.
Vingt-neuf ans de carrière, passés à la vitesse des Mirage qu’il avait pilotés des années durant. Il ricana de sa réussite, fier et moqueur. Avec rien, il avait fait un bond inespéré dans l’échelle sociale. Avec rien n’était pas vraiment exact, il n’avait jamais hésité à aider le destin.
Entré comme sous-officier mécanicien, avec un baccalauréat dont il n’avait brillé que dans la falsification du diplôme, Mathias s’était hissé jusqu’au grade de lieutenant-colonel et jusqu’au poste de commandant en second d’une base aérienne de près de trois mille personnes. Il n’avait aucun regret pour tous ceux qu’il avait dû pousser ou écraser pour y arriver. C’était la vie et la loi du plus fort.
— Place à l’avenir ! hurla-t-il alors qu’il s’engageait sur la rocade bordelaise déjà encombrée.
Et son avenir, il l’avait bien préparé. À seulement quarante-neuf ans, il allait toucher une grasse retraite de l’armée. Mais il en voulait plus, beaucoup plus. Et il avait trouvé un bon filon avec son nouvel associé, Gabriel Peyrat, camarade de beuverie lors d’une semaine d’orgie à la République dominicaine l’hiver dernier. L’abus d’alcool les avait fait trop parler. Beaucoup trop.
Mathias pensait devenir pilote d’une petite compagnie offrant à de riches particuliers un voyage facile, discret et rapide entre l’Europe et les Caraïbes. Un ancien collègue d’escadron, cofondateur de cette compagnie, avait sous-entendu que quelques bonus pouvaient être récoltés quand certains bagages de certains touristes embarquaient et débarquaient avec une certaine furtivité. De son côté, Gabriel Peyrat avait de nouveaux projets pour ses trafics. Ils avaient passé des heures à en discuter, bouteilles à la main, filles à leurs pieds. Et ils avaient fini par s’accorder pour modifier leur avenir, regrouper leurs compétences et effectuer quelques tests durant l’été. Avec une indéniable réussite.
16h00, Bordeaux, Gironde
— Noooon ?!
Stupéfaction étonnée…
Ce fut le premier grognement qui réussit à franchir la gorge et la bouche de Pascal Deshors lorsqu’il réalisa où il se trouvait. Il avait ouvert les yeux quelques secondes auparavant. S’en étaient suivies de l’incompréhension et de l’inquiétude dans cette chambre qu’il ne connaissait pas. Puis des indices l’avaient aidé. L’odeur caractéristique, les bruits sourds, les murs uniformément impersonnels, le lit dur et incliné, les draps rêches. L’hôpital.
Solitude. Soif. Aucune douleur. La perfusion à son bras droit gouttait régulièrement, la poche encore bien remplie. À son index gauche, une pince reliée à une boîte affichait des valeurs numériques fluctuantes. Il reconnut celle de sa pulsation cardiaque, oscillant entre quatre-vingt-dix et quatre-vingt-quatorze, ce qui lui parut un peu élevé.
— Peut-être le choc du réveil, pensa-t-il.
Il s’ausculta. Tout semblait fonctionner normalement, tout semblait bouger correctement, tout semblait cohérent. Tout sauf cette lourdeur dans le corps, cette lenteur dans le cerveau, cette viscosité dans la réflexion.
Après ce tour d’horizon physique, Pascal essaya de se rappeler pourquoi ou comment il se trouvait dans ce lit d’hôpital. Il grimaça pour lutter contre sa torpeur.
Petit à petit, des images s’assemblèrent dans son esprit. Les informations de midi : le programme de rock en Seine, l’université d’été du parti socialiste, de nouveaux débats sur les trente-cinq heures. Et, bien sûr, la découverte de cette fille sur Instagram.
— Limousheels…
Il avait savouré toutes ses photographies et les textes associés, tantôt courts, tantôt longs, racontant des états d’âme, des envies, des anecdotes. Mais toujours bien écrits et avec humour.
Il avait même osé répondre à sa publication du jour, avec, espérait-il, de l’esprit. Elle n’exhibait que ses jambes et ses escarpins, mais cela avait suffi à le toucher. Et à l’attirer. À cette pensée, son sexe se durcit à nouveau, comme cela s’était produit devant ses clichés.
— Tiens, encore une chose qui semble fonctionner normalement, murmura-t-il. Heureusement…
Si l’infirmière qui entra dans la chambre à ce moment-là aperçut la bosse gênante, elle n’en montra rien. Pascal plia les genoux et tira sur le drap pour tenter de masquer sa virilité, avec, à son goût, trop de lenteur et trop de maladresse. Il rougit en pensant à sa fréquence cardiaque qui avait dû bondir.
— Bonjour monsieur Deshors, comment vous sentez-vous ?
— Euhhhh… Bonjour… Qu’est-ce que… je fais là ?
Une voix rauque qu’il reconnut à peine, des mots douloureux au passage de ses lèvres.
— Vous êtes à l’hôpital Pellegrin. Vos collègues ont appelé les pompiers, vous étiez évanoui dans votre bureau.
En un flash, tout lui revint en mémoire : le dossier Asie, la pression de sa direction, l’horrible réunion où, une fois de plus, tout était parti de travers, la fureur de son supérieur.
Points positifs, son érection et sa gêne disparurent. Point négatif, il s’effondra sur le côté, inconscient.
18h00, Paris
— Noooon ?!
Stupéfaction sauvage…
Ce fut la première impression de Christian Monincourt lorsqu’il la vit apparaître au coin de la rue. Une bouffée de désir animal l’envahit, accompagnée d’une sensation de chaleur et d’un gonflement dans son caleçon.
Christian profita de son éloignement et des quelques secondes de répit pour souffler, contrôler sa respiration et se ressaisir. Il ne devait absolument pas montrer son trouble, cela faisait partie de la relation, du jeu. Et de son ego.
Elle était pile à l’heure, comme il se doit. Toute de noir vêtue, elle avançait avec une apparente sérénité dans sa robe mi-longue fendue qui découvrait une cuisse à chaque pas. Les talons hauts de ses escarpins vernis claquaient avec régularité sur le trottoir. Au-dessus de son décolleté, le collier caractéristique qu’il lui avait offert, une simple lanière de cuir avec un unique anneau métallique. Seules touches de couleur, son rouge à lèvres éclatant et sa longue chevelure châtain ondulant sur son épaule gauche.
— Calme-toi, calme-toi ! se répéta Christian en serrant les poings à s’en faire pâlir les articulations.
Sans être sûr de ne pas avoir parlé à haute voix. Ses yeux n’arrivaient pas à se fixer, passant à toute vitesse de la généreuse poitrine sautillante aux fines cuisses dévoilées par sa démarche chaloupée. Il en avait le tournis.
Ils se connaissaient virtuellement depuis trois mois. Christian avait déjà vu, sur écran, la moindre parcelle de son corps avec les centaines de photos et de vidéos qu’elle lui avait envoyées. Un choc. Il redécouvrait la magie de la vie réelle et d’une première rencontre. Excité comme un adolescent de cinquante-trois ans.
— Mon Dieu qu’elle est belle… s’extasia-t-il intérieurement lorsqu’elle s’arrêta devant lui.
Cette confirmation fut aussitôt suivie d’une révélation aussi surprenante qu’évidente :
— Merde, je suis amoureux…
Contrairement à Christian Monincourt, Alizée Gireau était novice. Lui, le Maître. Elle, la soumise. Elle baissa les yeux avec retard, puis, après avoir réalisé son erreur, elle rougit et espéra que son Maître n’allait pas lui en tenir rigueur. Elle attendit patiemment son bon vouloir.
Le stress était allé crescendo les jours précédents. Jusqu’à la panique au réveil de ce jour important. Alizée était restée plantée plus d’une heure devant ses sous-vêtements, incapable de choisir parmi les dizaines d’ensembles étalés en désordre sur son lit. Pour finalement décider de ne pas en porter. À cause du tremblement de ses mains, se maquiller s’était transformé en un rude combat. Mais, à sa grande surprise, elle était maintenant complètement détendue. Curieuse, attentive, mais apaisée. En paix avec elle-même.
Au fil des années, Alizée avait pris conscience qu’il lui manquait quelque chose, qu’elle n’arrivait pas à accéder au bonheur, qu’elle ne parvenait pas à la plénitude.
Un jour déprimant de mai, elle avait enfin mis un nom sur son besoin et avait osé se lancer dans la recherche d’une relation de soumission. Et elle avait trouvé.
— Suis-moi.
Le ton de Christian ne laissait place à aucune équivoque. Alizée obéit, sans réfléchir. Plus aucune nécessité de réfléchir puisqu’elle avait trouvé. Entendre sa voix l’excita au point de la faire frissonner malgré la chaleur moite des rues parisiennes. Le doute n’était pas permis, ce qui coulait entre ses cuisses n’était pas de la transpiration.
Enfin, elle était heureuse. Enfin, elle respirait. Enfin, elle profitait. Elle jouissait.
19h10, Limoges, Haute-Vienne
— Noooon ?!
Stupéfaction désespérée…
Ce fut la première réaction de Fabio Volpi à la découverte du message de sa femme. Il avait négligé de l’accompagner à son rendez-vous médical, elle l’avertissait d’une grande nouvelle. Au moins, l’absence de reproche dans ses trois mots semblait prouver que sa joie lui avait fait oublier le nouvel écart de son mari. Avec un dernier espoir, Fabio récupéra le téléphone qu’il venait de jeter violemment sur le clavier de son ordinateur et, presque avec dégoût, força ses yeux à se fixer sur l’écran :
Je suis enceinte !!!
Aucune erreur possible.
Il reposa l’appareil, avec plus de délicatesse au souvenir de son prix, se renversa sur son siège et se prit la tête entre les mains.
La soirée avait pourtant bien commencé, le moment de la journée qu’il préférait, à partir de dix-huit heures, quand les bureaux se vidaient et qu’il se retrouvait seul, ou presque, quand les honnêtes parents rentraient chez eux s’occuper de leurs enfants. Eux. Fabio avait en horreur ce devoir familial. Alors il prétextait un excès de travail pour l’éviter. Et cette excuse fonctionnait depuis des années.
La plupart du temps, il employait ces heures tardives à flirter avec ses collègues féminines, à draguer des clientes, à dévorer les photographies et les vies de jolies filles sur Facebook, Instagram et Meetic. Et à fantasmer. Car, s’il était un excellent séducteur avec son accent italien, ses vêtements coupés à la perfection, ses chaussures de marque, son bagout d’avocat et ses bonnes manières, son handicap caché et son extrême prudence l’empêchaient de passer régulièrement à l’acte.
Lorsque sa montre à plusieurs milliers d’euros sonna vingt heures, le rappel qu’il devait rentrer chez lui, Fabio se leva en pensant au dossier sur lequel il travaillait, fait inhabituel, avant l’horrible nouvelle. Un cas a priori classique, mais il sentait que quelque chose lui échappait. Depuis le début, son flair lui envoyait des signaux d’alarme. Il secoua la tête, les lèvres pincées. Malgré ces avertissements inconscients, il pressentait la bonne opportunité. Fabio ferma la pochette cartonnée et la poussa dans un coin de son bureau, seule, à l’écart des piles d’affaires en cours. Il mémorisa le nom inscrit sur la couverture :
Gabriel Peyrat
20h30, Ussac, Corrèze
— Noooon ?!
Stupéfaction mi-paniquée, mi-exaltée…
Ce fut l’unique chose que le cerveau de Gabriel Peyrat fut capable de formuler lorsqu’il découvrit le montant indiqué sur son ordinateur. La machine à compter les billets venait enfin de se taire.
Seul dans son bureau sombre, après des heures d’activité frénétique, il n’entendait plus que le tic-tac de la pendule et les chocs de son coeur dans sa poitrine oppressée.
La veille, prétextant l’envie d’un long week-end avant le rush de la rentrée, Gabriel avait renvoyé tous ses employés. Largement dépassé par les événements de ces deux derniers mois, il avait ressenti le besoin d’une journée pour faire le point et l’inventaire de ces sacs maintenant vides et jetés dans un coin. Ses profits étaient conséquents depuis des décennies, mais ils avaient explosé cet été et il n’en avait pas fait le compte depuis près d’un an.
Les heures à trier, à calculer, à chiffrer et à classer par valeur tous ces billets lui avaient fait oublier le temps et le déjeuner. Il réalisa en voyant la lumière du soleil faiblir par les hautes fenêtres. Son estomac lui confirma l’heure tardive. Gabriel s’étira, se leva, ôta les gants fins qu’il avait enfilés pour éviter de laisser ses empreintes sur l’argent, et se dirigea vers le réfrigérateur où il trouvait toujours des restes pour quelques sandwiches.
— Merde, je suis trop riche !
Ses postillons atterrirent sur les piles de billets étalés à même le sol taché du garage, entre le pont élévateur et son bureau. Un décor de film américain. Gabriel s’imagina dans Blow, sous les traits de Johnny Depp qui échouait à ranger tous ses dollars. Ironie de l’histoire, il l’avait revu à la télévision la semaine précédente.
— Un signe du destin ?
Gabriel secoua la tête et son corps. Il devait agir. Il s’essuya les doigts sur son bleu de travail, termina sa bière, jeta la bouteille vide dans l’unique poubelle du garage et se dirigea vers les quatorze et quelques millions d’euros en liquide. Ce chiffre lui donnait le vertige, mais il avait établi ses priorités et il allait s’y tenir.
Un : planquer les sept sacs de deux millions chacun.
Deux : distribuer le reste, plusieurs centaines de milliers d’euros, en prime à ses hommes de main.
Trois : leur rappeler les précautions à prendre.
Quatre : se débarrasser des six mille euros de faux billets détectés par sa machine.
Cinq : trouver comment blanchir tout cet argent.
Six : réorganiser son activité, elle aussi dépassée par l’accélération des contrats de cet été complètement dingue.
Mais Gabriel débordait d’imagination et ses talents d’organisateur n’étaient plus à démontrer. Il accompagna cette pensée rassurante d’un sourire carnassier, puis saisit le premier sac et la première poignée de billets.
23h15, Treignac, Corrèze
— Noooon ?!
Stupéfaction affolée…
Ce fut le dernier cri du chauffeur de l’Audi Q7 lorsque celle-ci percuta violemment le parapet. Il était déjà inconscient lorsque la voiture bascula et s’envola dans le vide. Et il était déjà mort lorsqu’elle s’immobilisa bien plus bas, après un rebond sur la roche et une longue glissade. Pour lui, plus rien n’avait d’importance lorsqu’elle explosa. Il n’eut même pas le temps de repenser à sa folle équipée, débutée en début de journée.
Pourtant, tout se déroulait à la perfection. Les kilomètres défilaient sans encombre. Son commanditaire avait été très clair, il ne devait pas faire la moindre bêtise et respecter les limitations. Sauf s’il risquait l’arrestation.
Mais, petit à petit, le calme, l’ennui, la fatigue, la fougue de ses dix-huit ans, la nuit tombée, l’autoroute désertée et l’avertisseur de radar muet lui donnèrent des démangeaisons dans le pied droit, de plus en plus difficiles à contenir.
Pour un gamin qui adorait parcourir ses montagnes natales à moto, les larges courbes en pente douce du Limousin furent le déclencheur. Il finit par céder et libéra les trois cent trente-trois chevaux de son bolide. Un bonheur facile. Même à fond, à plus de deux cents kilomètres par heure, la voiture glissait sans heurts sur l’asphalte. Il criait de plaisir à chaque camion doublé. Les panneaux aux noms imprononçables n’étaient que des flashs dans un coin de sa vision rétrécie. Il ne voyait que le ruban grisâtre devant lui, la belle campagne limousine plongée dans le noir n’existait plus.
Il perçut juste une modification de son environnement sonore lorsqu’il franchit le viaduc surplombant la vallée de la Vézère, ce qui ne fit qu’accroître son excitation et son taux d’adrénaline.
Bien sûr, il aperçut beaucoup trop tard les lumières bleues clignotantes qui passèrent en un clin d’oeil sur le pont au-dessus de l’autoroute A20. Alors, il paniqua et se crispa sur l’accélérateur, en pure perte puisqu’il était déjà pied au plancher. Après quarante-cinq secondes d’affolement, il eut une bouffée de soulagement en découvrant la sortie 43, qu’il engagea à une vitesse tout à fait déraisonnable. Les pneus protestèrent au freinage, au virage à droite qu’il prit en haut de la bretelle de décélération et aux deux ronds-points qui se succédèrent devant lui.
Puis ce furent vingt minutes de course folle sur les petites routes départementales corréziennes. Ses dernières vingt minutes de vie.
Il ne sut jamais que le fossé, évité de justesse dans le virage en épingle à cheveux juste après Meilhards, aurait été préférable à son plongeon fatal.
Il ne sut jamais qu’à Chamberet, il n’aurait pas dû suivre son instinct qui lui dicta de tourner à droite après la mairie et le bar où quelques touristes profitaient d’une ultime soirée d’été.
Il ne sut jamais que les gyrophares bleus vus au-dessus de l’autoroute étaient ceux du SAMU en intervention à la prison d’Uzerche.
Il ne sut jamais que les lumières intermittentes qu’il apercevait de temps en temps dans ses rétroviseurs n’étaient pas des voitures de police lancées à toute vitesse à sa poursuite.
Il ne sut jamais qu’à la sortie de Treignac, les phares accompagnés de coups de klaxon qui surgirent d’un seul coup face à lui et qui le poussèrent à prendre cette petite route sur la droite n’étaient pas un barrage des forces de l’ordre, mais des demoiselles passablement éméchées qui quittaient l’hôtel du Lac pour faire durer l’enterrement de vie de jeune fille de l’une d’elles.
Il ne sut jamais que les autres phares accompagnés d’autres coups de klaxon qui apparurent quelques secondes plus tard face à lui au bout de la large courbe et qui le forcèrent à tourner une nouvelle fois à droite sur cette espèce de chemin étaient la fin du convoi des demoiselles passablement éméchées.
Enfin, il ne sut jamais ce qu’était la première grille qu’il percuta, que le doux virage enherbé qu’il suivit n’était pas une ancienne voie ferrée comme il le crut, et que la seconde grille qu’il traversa délimitait un belvédère apprécié des touristes et des locaux.
23h30, Limoges, Haute-Vienne
— Noooon ?!
Stupéfaction outrée…
Ce fut le seul mot écrit du message de Myriam Belfond qui, dix minutes plus tôt, avait demandé à son amie d’enfance, la belle Sylvie Lachan, comment s’était passée sa visite surprise à la préfecture. Elle avait failli s’étrangler devant sa réponse :
Très intéressante, surtout en portant cette petite robe bleue qu’on a achetée ensemble le mois dernier…
Avec, en conclusion, le smiley représentant un clin d’oeil.
23h50, Saint-Pardoux-l’Ortigier, Corrèze
— Noooon ?!
Stupéfaction déçue…
Ce fut la réaction compréhensible du capitaine Keziah Chamoun, du groupement de gendarmerie de la Corrèze, à la réception du message radio de son chef :
— On remballe pour ce soir, on les a encore ratés.
Il eut du mal à masquer sa désillusion, lui d’habitude si flegmatique. Il était pourtant sûr de lui. Il devait se passer quelque chose cette nuit.
— Il aurait dû se passer quelque chose !
Keziah avait croisé les informations de ses meilleurs indics, des services parisiens, de collègues étrangers, de la douane et même d’Interpol. Et tout concordait pour qu’ils puissent faire d’une pierre trois énormes coups à la jonction des autoroutes A20 et A89 : des go fast venant d’Espagne avec certainement de la drogue, des camionnettes immatriculées en Europe de l’Est avec du butin volé lors de cambriolages dans tout le sud du pays et des camions avec de potentiels terroristes mélangés à des migrants.
Une opération d’envergure qui avait duré toute la semaine sur plusieurs sites en France. Les huiles parisiennes lui avaient dit qu’il représentait leur meilleure chance. Keziah espéra que des collègues d’autres départements avaient été plus favorisés par le destin.
Pourtant, il y avait cru jusqu’au bout. Une heure et demie plus tôt, à la fin de l’A89, un camion avait effectué un changement de voie très tardif, faisant voler les plots blancs avertissant de la séparation de direction entre les deux chaussées. Sa route vers Toulouse coupée de manière imprévue, une voiture avait dû freiner brutalement dans un grand dégagement de décibels et de fumée. Sur l’autre voie, celle de droite, une grosse berline avait, à l’inverse, poursuivi son chemin vers Limoges en accélérant malgré la pluie de plots blancs autour de son pare-brise.
Les ordres avaient fusé et les gendarmes avaient bloqué avec une célérité réconfortante les trois directions de ces deux autoroutes, ainsi que les sorties les plus proches. Une camionnette avait alors forcé l’un de ces barrages en tentant de faire les bordures. Sans succès.
Alors qu’il espérait avoir réalisé ce triple tour de force, Keziah avait rapidement déchanté.
Le chauffeur du poids lourd téléphonait et s’était rendu compte qu’il n’allait pas arriver à Bordeaux dans les temps s’il restait sur la file de droite filant vers le nord.
Le conducteur parisien de la berline, à près d’un gramme d’alcool par litre de sang, fêtait un gros contrat en deux étapes, un apéritif sérieux à Aurillac puis une maîtresse à Limoges.
Le charpentier au volant de la camionnette terminait sa semaine de chantier avec un nouveau record à l’alcootest, causé par quelques Ricard.
— Fais chaud toute la journée au soleil, vous comprenez ?
Keziah respira un grand coup et retrouva son calme naturel. Il allait devoir réfléchir à ce qu’ils avaient pu manquer. Il contacta son adjointe :
— Je t’appelle lundi matin pour débriefer. Bon week-end.
Lucie Anti, de la section de recherche de Limoges, écouta, salua et raccrocha, le sourire aux lèvres. Depuis le début, elle ne pouvait pas sentir ce capitaine. On lui avait collé ce minable mou comme chef sur cette opération.
Elle avait été constamment en désaccord avec ses choix, avec sa méthode, avec ses heures de réflexion, de doute et d’hésitation. Selon elle, ils devaient foncer, demander des renforts, faire une action coup de poing en bloquant toutes les routes, arrêter, interroger.
Et pour finir, rien, pas un suspect.
— Il fallait m’écouter !
Mais ce qui l’affligeait le plus chez le capitaine Keziah Chamoun, c’était son plus profond mépris, ou plutôt son absence totale d’intérêt, pour les conséquences de cette affaire sur leur carrière.
2
Samedi 29 août 2015
00h00, ferme les Dommages, Corrèze
Sylvie Lachan se demanda pourquoi le sommeil ne venait pas. Elle repoussa le drap et la blancheur de sa nuisette miroita dans l’obscurité. Entre la douceur de la nuit, le scintillement des milliards d’étoiles et le frémissement des sons de la nature, ses sens s’évadèrent par la fenêtre ouverte et son esprit s’envola dans ses souvenirs.
Sylvie avait appuyé sur le bouton pause au début de l’été et était revenue dans la ferme familiale. Deux mois de vacances à se vider le cerveau en s’épuisant aux travaux manuels. À se retrouver avec ses deux amies d’enfance, Coumbala Fofana et Myriam Belfond. À profiter de ses proches qu’elle n’avait que trop peu vus depuis vingt ans. À vivre entre tranquillité et sérénité, loin de la folie du monde. À vivre, tout simplement.
Son inconscient l’emmena ensuite vers Instagram. Une autre part de ses vacances avec l’habitude de poster une photographie d’elle tous les matins. Plus exactement, de ses escarpins ou de ses jambes. Guère plus. De la féminité sans vulgarité. Elle s’attachait à ne rien dévoiler qui pourrait révéler son identité ou sa peau de rousse si reconnaissable. Elle y cultivait le glamour et l’humour, le mystère et l’impertinence. Et elle y avait pris goût. Comme une thérapie, contre son passé, sa retenue, sa timidité.
Son pseudo, Limousheels, exprimait deux de ses passions : son beau Limousin et ses talons hauts.
L’idée découlait d’un pari pris avec Coumbala et Myriam lors de la soirée beaucoup trop arrosée de leurs quarante ans. Fidèles à leurs caractères, elles avaient eu des réactions opposées à cette idée, née des regards masculins appuyés sur ses habituels escarpins. Myriam avait été choquée et lui avait prédit le pire. Coumbala avait été amusée et lui avait prédit un succès foudroyant. Sylvie avait été séduite par le challenge et avait prédit l’indifférence.
Toutes les trois avaient eu tort. Le résultat mélangeait un peu de pire, un peu de succès, un peu d’indifférence. Sylvie naviguait de surprise en surprise, de découvertes en rencontres virtuelles intéressantes, bonnes comme mauvaises. Son nombre d’abonnés croissait sans excès, mais avec régularité, fait dont elle se moquait éperdument. Elle mettait cependant un point d’honneur à répondre à tous les messages et tous les commentaires.
Cette soirée du quinze août avait été enflammée par l’improbable trio : la fine petite brune agitée, la bonne vivante d’origine sénégalaise au rire contagieux et l’immense rousse. Les trois femmes avaient connu une fin de nuit différente, Myriam en vomissant, Coumbala dans les bras d’un touriste anglais, Sylvie assise sur une boule de foin à admirer le lever de soleil sur les Monédières et à méditer sur l’appel téléphonique reçu le matin même.
— Bonjour madame. Sylvie Lachan ?
— Bonjour ! Oui, c’est bien moi.
— Avant toute chose, je vous présente mes excuses de vous déranger un jour férié. Et ce n’est ni un canular ni un démarchage commercial.
— J’avoue avoir hésité à décrocher…
L’inconnu avait décliné son identité. Sylvie était restée silencieuse, de surprise.
— Je vous assure, je suis bien le ministre de l’Intérieur, avait-il poursuivi. Mais je comprends que vous puissiez avoir du mal à me croire.
— J’avoue, encore une fois…
— Je vais vous expliquer. Vous pourrez ensuite me poser toutes les questions que vous voulez. Et je vous donnerai quelques numéros au ministère et à la préfecture de la Corrèze pour que vous puissiez vérifier mes dires.
— Je vous écoute.
— Alors voilà, c’est simple, nous vous proposons le poste de préfète de la Corrèze.
— Pardon ?
— Nous vous proposons le poste de préfète de la Corrèze. Ce nous inclut le président de la République. Cela va peut-être vous paraître singulier de la part d’élus, mais certaines choses en Corrèze ne nous plaisent pas, en particulier le lien trop étroit entre les services de l’État et, justement, les élus locaux. Nous voulons donc aux manettes du département une personne étrangère à ce monde.
Proposition aussi inattendue qu’étonnante. Sylvie avait songé à un canular téléphonique. Nouveau silence. Encore une fois, le ministre l’avait brisé :
— Vous imaginez bien que nous avons accès à votre dossier complet, à votre carrière. Pour nous, vous êtes parfaite pour faire le ménage et mettre un terme à cette intolérable anarchie princière de Corrézie…
02h00, Ussac, Corrèze
Gabriel Peyrat, le garagiste devenu trop riche, terminait son rangement. La machine à compter les billets et les quatre grosses enveloppes brunes contenant les primes de ses hommes reposaient dans le coffre-fort du bureau, dissimulé derrière des piles instables de papiers. Les quatorze millions d’euros étaient entassés, deux par deux, dans les sept sacs de sport alignés devant le grand établi rouillé remplissant le centre du mur opposé.
Gabriel attrapa une puissante lampe torche et effectua le tour du bâtiment dont les seules fenêtres se trouvaient à plusieurs mètres de hauteur.
Rien, pas âme qui vive.
De retour à l’intérieur et après avoir verrouillé la porte, Gabriel saisit un crochet relié à un câble métallique, le passa dans un anneau ancré dans le mur du fond et l’attacha au bas de l’établi. Il se frotta les yeux de fatigue, prit la commande du treuil et le mit en fonctionnement. Le câble se tendit et les roulettes de l’établi bougèrent, sans heurts et sans bruit, révélant un carré de bois au sol. Une clé extraite de la poche de poitrine zippée de son bleu de travail permit d’ouvrir la serrure de la trappe. Le garagiste alluma sa torche, se glissa par le trou et descendit les quelques marches avec prudence. Pour éviter la découverte malencontreuse d’un fil, il n’avait jamais installé l’électricité dans sa cave, connue de lui seul.
Le jour de Noël 1986, quelques semaines avant son décès, son grand-père l’avait pris à part, lui avait offert une antique clé emballée dans un papier journal graisseux et lui avait alors révélé l’existence de cette cave couvrant toute la surface du garage. Son aïeul s’en était servi pendant la guerre pour cacher ce qui ne devait pas tomber aux mains des Allemands ou de la milice : juifs, prisonniers évadés, aviateurs alliés, armes pour la résistance, paiements en nature et tout ce qui pouvait être vendu au marché noir ou faire l’objet d’un trafic lucratif.
Son grand-père lui avait un jour avoué qu’il avait jugé que son propre fils, le père de Gabriel, n’avait pas les épaules pour ce secret et qu’il n’y avait donc jamais mis les pieds. Avec un sourire autant énigmatique que malicieux, il avait ajouté que, s’il savait ouvrir les yeux, il pourrait y trouver quelques petits cadeaux supplémentaires.
Il avait fallu six ans à Gabriel pour découvrir le premier de ces cadeaux. Vingt ans plus tard, il pensait avoir déniché toutes les caches, dans les murs, le sol et le plafond. Il avait pris son temps pour écouler les offrandes grand-paternelles : des lingots, des bijoux, des oeuvres d’art. Cela lui avait permis de poursuivre ce que son aïeul avait commencé, le développement des affaires familiales qui ne se limitaient plus à des garages et des casses automobiles. Lui seul savait pourquoi il conservait son bureau dans ce vieux bâtiment en pierres, froid et mal entretenu, de la banlieue nord de Brive-la-Gaillarde. Il le justifiait en argumentant que le garage était connu, rentable et proche des autoroutes. Ce qui était vrai. Il n’osait pas évoquer le côté sentimental du premier établissement de la famille, personne ne l’aurait cru.
Gabriel se secoua, déposa sa torche sur un bidon vide et déplaça lentement quelques caisses de pièces hors d’âge installées sous l’escalier, le long de la paroi contre laquelle il était descendu. À dessein, il avait encombré la cave de vieilleries inutiles, pour leurrer un éventuel curieux. Il s’agenouilla et, à l’aide d’un tournevis, descella une petite pierre. Son index fouilla la cavité et tira sur l’anneau qui s’y trouvait. Avec un bruit sourd, un pan du mur s’entrouvrit. Gabriel sourit. Derrière les apparences de délabrement du bâtiment, volontairement trompeuses, certains éléments mécaniques étaient entretenus avec soin.
En près de trente ans, Gabriel avait presque entièrement vidé ce réduit d’un mètre de profondeur sur toute la largeur du garage. Au fond, il restait encore une dizaine de tableaux en mauvais état et un peu d’argenterie piquée qui luisait dans la lumière crue de la lampe posée sur le bidon. Il jeta les sept sacs sur une palette. Puis, en prenant tout son temps, il remit tout en place.
Gabriel se dirigea ensuite vers le fond de la cave, en se contorsionnant pour se faufiler entre les entassements de débris informes. Derrière une latte du plafond, il cacha la clé USB contenant le fichier de ses comptes secrets.
Après être remonté et avoir rabattu la trappe, Gabriel se permit de souffler et d’étirer son dos douloureux. Puis il récupéra le câble, le passa dans un second anneau fixé au mur, de l’autre côté, et attacha le crochet en bas de l’établi, également de l’autre côté. Le treuil remit le meuble dans sa position initiale.
Gabriel ferma le garage, se traîna jusqu’à sa voiture et cinq minutes plus tard, il s’effondra sur son lit, toujours dans sa combinaison sale.
— Un, deux, trois, quatre, cinq…
Et ce fut tout. Comme il en avait l’habitude depuis son enfance, Gabriel venait de compter les coups de cloche de l’église d’Ussac.
Il bâilla. Rien de brillant, mais il avait réussi à dormir un peu, d’un sommeil agité. Il resta dans son lit, laissant son esprit vagabonder et espérant, sans trop y croire, se rendormir. Mais son cerveau errait dans l’unique direction qui l’obsédait, l’obligeant à reprendre les points de son plan.
Le premier, fait. Les quatorze millions d’euros étaient planqués dans la cache inviolée depuis des décennies.
Le deuxième, en bonne voie. Les primes prêtes, Gabriel envoya le même message à chacun de ses quatre hommes, avec lenteur, sur son téléphone hors d’âge, sale et rayé, sans la politesse et les bonnes manières qui n’étaient pas son fort, mais dont il se moquait :
Point 9h mardi
Le troisième, à effectuer également mardi matin. Il allait insister sur la prudence nécessaire à disposer d’une telle somme en liquide. Payer ses hommes représentait un risque, mais comme ils n’avaient pas compté leurs heures et leurs efforts, il n’avait pas le choix.
Le quatrième, un problème de conscience. Même avec des millions en poche, il avait en horreur l’idée de détruire six mille euros de fausse monnaie. Sa raison le poussait à faire une belle flambée dans la cheminée.
Les deux derniers points s’annonçaient plus complexes. Gabriel n’hésita pas longtemps et se leva en grimaçant :
— Décidément, ces folles nuits ne sont plus pour moi !
Il alluma les lumières, alla uriner en rotant, mit en route la cafetière, récupéra son téléphone, rota à nouveau, fit défiler son carnet d’adresses jusqu’au M, jura et remonta au C. Christian Monincourt. Premier contact indispensable. Son banquier, celui qui transformait du liquide en chiffres sur un compte. Tout en grognant contre ce classement par ordre alphabétique du prénom, Gabriel envoya un bref message :
Max ?
La faim jaillit, malgré l’heure matinale. Un coup d’oeil à la pendule, bientôt six heures. Il découpa une large tranche de pain et la couvrit de fromage. Tout en mastiquant la bouche ouverte, il se rappela sa rencontre avec Christian.
Au siècle dernier. Un triste matin d’hiver. Froid, gris, maussade. Neigeux. Les flocons avaient commencé à tomber sans prévenir, gros et nombreux. Gabriel avait reçu un appel du service de secours et de dépannage de l’autoroute. Avant son blocage complet par la neige, il était allé sauver l’infortuné Parisien. Ils étaient restés des heures dans le petit bureau du garage. Les langues s’étaient déliées, un don de Gabriel. Et ils avaient fini par se mettre d’accord.
Le soleil se levait. Gabriel, toujours assis dans sa cuisine, ne sut pas s’il s’était endormi, avec ses souvenirs, devant sa tasse vide, sans fromage et sans pain. Il tendit le bras pour relancer la cafetière et se rappela la fin de la journée avec Christian, juste avant son départ, voiture réparée et routes déneigées. À propos de curieux objets dans son coffre :
— Dites-moi, ces trucs, c’est quoi ? Vous travaillez pour les services secrets et vous faites de la torture ?
Christian avait éclaté de rire :
— Non, pas du tout ! C’est le but inverse ! Du plaisir !
— Ahhhh… Sado-maso, c’est ça ?
— On dit BDSM. Bondage, discipline, domination, soumission. C’est très populaire. D’ailleurs, après mon rendez-vous, j’ai une soirée dans un club perdu au milieu des montagnes basques.
Il avait ajouté avec un sourire coquin :
— Vous voulez venir essayer ?
Gabriel se leva d’un bond, sa chaise se renversa :
— Bordel de merde !
Il se frappa le front.
— Mais oui, bien sûr ! Un club privé, isolé, où des tas de choses bizarres peuvent se passer en toute normalité ! Ça, c’est une super couverture !
Il délaissa son café, se précipita sur son ordinateur et tapa sur un moteur de recherche :
Grande maison à vendre avec grand terrain en Corrèze
Une accumulation de sites internet : ceux des agences immobilières du coin, ceux des demeures de charme et de luxe, ceux des châteaux et des manoirs, celui de la SAFER, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, pour les domaines agricoles. Gabriel nota quelques offres intéressantes, mais pas complètement satisfaisantes, au dos d’une enveloppe à moitié déchirée.
À force de recherches, Gabriel tomba sur un court article de La Montagne, daté du mercredi précédent :
Le propriétaire russe du château de la Grénerie décède.
Ce millionnaire inconnu n’a pas profité de cette merveille corrézienne. En effet, seulement quatre ans après l’avoir acquise, il n’aura jamais vu son domaine, nous indique l’homme chargé de surveiller le site.
Les informations disponibles sur ce château s’avérèrent rares, mais séduisantes. Une quarantaine de pièces, plusieurs centaines d’hectares de terrain, de grandes dépendances, un emplacement idéal au milieu des bois, au nord d’Uzerche et à proximité de l’autoroute A20. Gabriel passa de longues minutes à réfléchir devant les vues aériennes de la propriété et la carte du Limousin.
Il finit par récupérer son téléphone en pensant à son avocat pédant. Il ne l’aimait pas, mais il avait besoin de lui. Il afficha la lettre V, grogna et remonta vers le F. Fabio Volpi. Il fit l’effort de mettre un minimum de formes :
Bonjour maître, je souhaiterais vous entretenir d’une affaire financière de la plus haute importance. Rappelez-moi quand vous le désirez. Merci beaucoup. Cordialement, Gabriel Peyrat.
Le temps de ses recherches, cinq enveloppes avaient germé sur son vieil écran. Ses quatre hommes lui confirmaient leur présence mardi matin et Christian répondait à sa question. Un demi-sourire naquit sur ses lèvres.
Bagnole
Gabriel apprécia la référence et compta le nombre de lettres. Sept. Surpris, il recompta. Et recompta encore. Car le code était simple. Le nombre de lettres du mot donnait le nombre de chiffres du montant transférable et la première lettre le premier chiffre. Le résultat comportait donc sept chiffres et commençait par un deux.
— Bordel ! Deux millions !
Christian pouvait blanchir deux millions d’euros. Moins sa commission, bien entendu, environ dix pour cent.
Son euphorie fut interrompue par la sonnerie de son téléphone. Fabio Volpi. Son sourire s’élargit :
— Bonjour maître !
L’avocat avait mordu à l’appât du gain. Et rapidement.
— Bonjour monsieur Peyrat. Que puis-je pour vous ?
Une voix mielleuse avec, en fond sonore, des cris d’enfants et d’une femme.
— C’est agité chez vous ! Je vous dérange peut-être ?
— Je n’ai pas fini de préparer le repas, les petits ont faim.
— Tu m’étonnes ! pensa Gabriel en levant les yeux.
La pendule approchait les quinze heures. Lui non plus n’avait pas vu la journée passer. Il se reprit en faisant l’effort de parler convenablement :
— Voilà. Je viens de découvrir que le propriétaire du château de la Grénerie était décédé récemment. C’est un lieu que j’affectionne particulièrement. Je souhaiterais savoir s’il était possible de l’acquérir.
Il laissa le temps à Fabio Volpi d’imaginer ce que cela pouvait signifier. Il poursuivit :
— J’ai l’impression que c’est un milieu fermé et que les informations ne sont pas accessibles à tout le monde. La haute, quoi ! Je me suis donc dit qu’un avocat d’affaires de votre envergure pourrait se renseigner pour moi.
La flatterie était franchement grossière, mais Gabriel savait que son interlocuteur allait y être sensible.
— Bien sûr, vous avez bien fait. Pouvez-vous me redonner le nom de ce château ?
— La Grénerie. En Corrèze.
— C’est noté, je regarde cela au plus tôt, cria joyeusement l’avocat pour couvrir les rugissements des enfants.
— Je vous remercie. Évidemment, en cas d’acquisition, il y aura une commission pour vous. Je vous laisse déjeuner !
— Merci à vous, monsieur Peyrat. Bonne journée !
Gabriel raccrocha et frappa dans ses mains, exalté :
— Bien, bien, bien !
La faim luttait avec l’impression de se sentir sale.
— Sale et avec une sale tronche ! grogna-t-il en s’observant dans le miroir de la salle de bains.
Des traits tirés, des cernes sous les yeux. Mais, avant la douche et un vrai repas, restait un dernier détail. L’organisation de sa soirée. Il se connecta sur son site de rencontres :
Grosse envie ! Qui veut un plan Q ce soir ?
3
Dimanche 30 août 2015
06h20, ferme les Dommages, Corrèze
Sylvie Lachan ouvrit les paupières, se redressa un peu, jeta un coup d’oeil au réveil et laissa retomber lourdement sa tête sur l’oreiller. Fataliste.
— Non ! C’est beaucoup trop tôt pour une fin de vacances !
Mais elle soupira, s’étira, se leva, enfila un string sous sa nuisette et un gilet au-dessus, puis descendit à la cuisine. Comme toujours, la dernière debout. Comme tous les matins, son petit déjeuner l’attendait, prêt.
— Ahhhh ces parents ! pensa-t-elle avec amour.
Dominique et Dominique. Domi, sa mère, et Dom, son père. Surnoms donnés pas seulement pour les intimes.
— Sinon comment s’y retrouver ?
La traditionnelle explication. Petite, Sylvie leur avait souvent demandé pourquoi ils ne l’avaient pas, elle aussi, prénommée Dominique. La réponse restait invariable :
— Oh oui, c’est une bonne idée, Dominique, c’est dommage, disait sa mère.
— Oh oui, dommage Dominique, complétait son père.
À dix ans, pour Noël, Sylvie avait offert à ses parents une planche qu’elle avait gravée :
Les Dommages
Et elle avait insisté pour l’installer elle-même au-dessus de la porte d’entrée. Même si elle soupçonnait son père d’être passé discrètement après elle pour consolider l’attache, la pancarte trônait toujours fièrement sur la façade. La Poste avait fini par utiliser ce nom comme adresse officielle de la ferme.
Sylvie était encore attablée lorsque Franck arriva. Il se pencha pour lui faire les quatre bises réglementaires. Car il fallait quatre bises pour que Sylvie puisse placer :
— Dans… les yeux… le bonjour… p’tit frère !
Ils avaient leurs codes, rien qu’à eux, depuis longtemps. Franck se servit un café et s’installa à côté de sa soeur. Même s’il se levait bien plus tôt, il prenait son petit déjeuner avec elle. Comme depuis le début. Car ils n’étaient pas vraiment frère et soeur. À la mort de ses parents, voisins et grands amis des Dominique, Franck Pomarel n’avait que sept ans et plus de famille proche. Putain de camion…
Adopter Franck avait semblé naturel à tout le monde. Il était venu s’installer à la ferme. Et y était resté jusqu’à reprendre l’exploitation agricole, ce qui avait aussi semblé naturel à tout le monde.
À l’adolescence, Franck avait commencé à regarder avec intérêt les formes de sa soeur aînée, en particulier ses décolletés. Il se défendait de ces regards en plaidant la différence de taille. Lui, trop petit, un mètre soixante-huit, elle, trop grande, un mètre quatre-vingt-un. Comme il le répétait, il ressemblait à ses vaches ou à ses tracteurs, court sur pattes. Il aurait pu ajouter, toujours à l’image de ses vaches ou de ses tracteurs, une force de la nature.
— Tu montes ce matin ? demanda Franck.
— Bien sûr !
Quinze minutes plus tard, le soleil encore caché, Sylvie, les cheveux attachés et simplement vêtue de baskets, d’un jeans et d’un pull, sauta du marchepied de l’engin conduit par Franck sur le bout de propriété qu’elle avait réquisitionné des années auparavant. Elle ouvrit la grande serre agricole vert bouteille adossée aux arbres et y pénétra, suivie par son frère. Ils en ressortirent en poussant, tout d’abord une plate-forme basse sur roues sur laquelle reposait une machine, sur quelques mètres, puis la machine elle-même, après l’avoir descendue et encore sur quelques mètres. Sylvie en fit le tour pour l’inspecter.
Après s’être tapé dans la main comme deux sportifs, chacun s’installa aux commandes de son bolide. Sylvie démarra le sien, apprécia le ronronnement du moteur et regarda attentivement autour d’elle. Satisfaite, elle salua militairement Franck qui lui rendit son geste, et mit les gaz à fond. Quelques secondes plus tard, après avoir poussé avec douceur et fermeté sur la barre horizontale, elle s’envola.
Lorsqu’elle stabilisa l’appareil après une courte montée, les premiers rayons de soleil la frappèrent. Sylvie cria de plaisir. Comme chaque fois, elle vira pour passer au-dessus de son frère puis de la ferme. Elle savait que Franck regardait, elle savait que ses parents regardaient.
Elle n’avait pas prévu de destination, juste profiter du peu de temps dont elle disposait. Elle se dirigea vers le sud et rejoignit la Vézère à côté d’Uzerche. Après avoir enroulé la perle du Limousin, elle mit le cap vers le soleil levant pour remonter cette superbe vallée qu’elle adorait.
Au barrage de Peyrissac, elle vira à gauche pour rentrer, goûtant au bonheur de survoler ce camaïeu de verts dans cet air si calme et si pur.
Le hasard mena l’ULM au-dessus de la ferme des Vergne. Le hasard ou une curiosité inconsciente. Une douzaine de jours auparavant, son père avait rendu visite au couple y habitant. Tout était fermé, seul un mot sur la porte indiquait leur départ au chevet d’un parent proche très malade. Dom avait été très surpris, d’une part parce qu’il ne se rappelait pas les avoir déjà vus quitter leur exploitation plus d’un week-end, d’autre part parce qu’ils avaient laissé leurs limousines dans un pré trop petit et sans eau. Par solidarité et par amour des bêtes, il s’y rendait donc régulièrement, avec Franck, pour les changer de parcelle et leur apporter à boire.
Sylvie tourna au-dessus de la maison. Toujours fermée, toujours sans le moindre mouvement. Elle élargit le cercle.
À l’extrémité nord-est de la propriété, elle ne revit pas les étranges et longues traînées bien rectilignes, remarquées deux semaines plus tôt dans la rosée d’un champ.
À l’opposé, elle repéra la maisonnette en bois où elle allait en vélo avec son frère lorsqu’ils étaient enfants. La croyant abandonnée depuis des décennies, elle fut surprise de découvrir une grosse voiture noire garée devant la façade.
Perplexe, elle mit le cap vers la ferme familiale.
Lorsqu’elle entendit le claquement d’une portière, Sylvie, dans une tenue plus adaptée à la chaleur, regarda la pendule.
— Treize heures cinquante, ça, c’est Mymy.
Pour un rendez-vous à quatorze heures. Effectivement, quelques instants plus tard, son amie Myriam Belfond entra.
— C’est quoi ce short ? demanda la fine petite brune en guise de bonjour.
Quatorze heures quinze, nouvelle voiture. Nouveau coup d’oeil à la pendule.
— Un quart d’heure de retard, ça, c’est Coucou !
Et Coumbala Fofana les rejoignit dans la cuisine, augmentant de toute son exubérance le volume sonore déjà conséquent.
— C’est quoi ce short ? demanda la plantureuse bonne vivante en guise de bonjour à Sylvie.
Toutes les trois éclatèrent de rire.
— C’est la crise, le tissu est devenu hors de prix !
— Et elle ne t’a pas parlé de sa robe de vendredi ! gronda Myriam
— Avec quoi t’es allée te montrer à ton nouveau boulot ?
— La robe bleue de cet été… répondit Sylvie.
Avec une tentative de grimace faussement honteuse.
— Noooon ? s’amusa Coumbala. Et la hauteur de talons ?
— Mmmm… Dix…
Nouvel éclat de rire.
— Tu vas les rendre fous ! s’esclaffa Coumbala. Combien de rencards ?
— Nada ! déplora Sylvie. Et pas sûre qu’il y en ait un qui ose un jour, l’ambiance a l’air tellement coincée.
— Si t’arrives à les dérider, tu m’en gardes un ou deux, susurra Coumbala avec un clin d’oeil.
— Et t’es prête ? les interrompit Myriam. Côté boulot, bien entendu !
— Pffff… Je suis larguée ! La fonction publique, c’est compliqué ! Des tas de structures, des tas de services, des tas de sigles… C’est l’enfer, je vais passer pour une débile !
— C’est pas déjà fait ?
Après la nouvelle crise de fou rire général, Sylvie ajouta :
— Mais, ma chère Mymy, je vais t’appeler sans arrêt pour que tu m’expliques, toi qui es fonctionnaire depuis vingt ans !
L’intéressée se leva en tirant la langue :
— Bon, on y va, les piles de cartons dans l’entrée ne vont pas bouger toutes seules !
— Et je suis sûre qu’il y en a au moins la moitié de chaussures ! pouffa Coumbala.
Sylvie haussa les épaules :
— C’est uniquement par obligation professionnelle !
Le chargement, la route vers Tulle et le déchargement se firent dans un joyeux désordre, bien plus bruyant qu’efficace. Mais cela n’avait aucune importance, l’essentiel pour toutes les trois était d’être ensemble.
— C’est la première fois que je découvre un placard trop grand pour toutes tes paires de talons ! se moqua Coumbala.
— Tu vois que je peux en acheter d’autres ! sourit Sylvie.
Myriam ne cessait de s’extasier :
— Ces plafonds, ce parquet, ces meubles… C’est la classe ton logement de fonction… Quel luxe !
— Il a surtout l’avantage d’être équipé, vu votre efficacité de déménageuses ! les taquina Sylvie. Je vous montre mon petit bureau ?
Elle les y emmena en leur résumant ce qu’elle avait retenu des bâtiments, le plus ancien datant du dix-neuvième siècle.
En polo et pantalon léger, Pierre Dibonné grimaça en entendant du bruit.
— Bonjour Pierre ! s’exclama sa nouvelle supérieure. Je vous présente Coumbala et Myriam, les responsables des cris qui vous dérangent.
Il s’inclina respectueusement :
— Enchanté, mesdames. Un petit tour du propriétaire, madame ?
— Exactement ! Je me pavane tant que je le peux encore.
La préfète prit ses amies par le bras, d’un coup intimidées, et les entraîna vers son bureau. Mais les pas s’arrêtèrent immédiatement et Pierre vit un grand sourire entouré de taches de rousseur réapparaître :
— La tenue décontractée vous va très bien, Pierre !
— Je n’ose vous parler de la vôtre, madame, répliqua-t-il.
Il n’obtint pour réponse qu’un rire joyeux accompagné d’un tourbillon de longs cheveux roux.
Quelques secondes plus tard, il perçut l’ouverture d’une porte suivie de quelques mots :
— Alors les filles, on la ramène moins, maintenant, hein ?
Puis des chuchotements qu’il ne comprit pas. Il soupira de dépit et tapa un message sur son téléphone :
Attention, la préfète est là.
4
Lundi 31 août 2015
07h00, Tulle
Sylvie Lachan embaucha tôt pour le premier jour de sa nouvelle vie. Avec, déjà, des centaines de mails.
— Quelle folie… soupira-t-elle.
Elle essaya d’en garder le minimum en suspens, en supprimant, classant et répondant à ce qu’elle put.
Même son agenda s’était rempli.
Pierre Dibonné arriva peu après elle. En costume-cravate, comme il se doit. Il semblait contrarié, mais Sylvie ne parvint pas à en déterminer la raison.
— Ma visite bruyante d’hier ? Mon embauche avant lui ? Mon mail de vendredi après-midi ?
Un message écrit après sa tournée des bureaux, conviant tout le personnel de la préfecture à se réunir ce lundi à huit heures. Sylvie était curieuse de découvrir l’effet de cette invitation matinale, mais tardive, sur ses nouveaux collègues. Proposition qui avait dû émouvoir certains fonctionnaires tranquilles.
— Peut-être trop tranquilles…
Fidèle à sa réputation de précision, Pierre Dibonné pénétra à huit heures dans la grande salle de réception pour répondre, comme tout le monde, à la sollicitation de la préfète. Il effectua un tour rapide de la pièce, saluant les présents, cherchant les absents.
Sylvie Lachan, sa nouvelle supérieure, ne se fit pas attendre. Mais son arrivée coïncida avec une autre surprise. Elle entra les bras chargés d’un large plateau de viennoiseries. Un murmure approbateur accompagna cette irruption inhabituelle. Elle posa son fardeau sur une table placée au centre, à côté de cafetières et de bouilloires fumantes.
— Bien vu, bien joué… songea Pierre, impressionné.
Alors qu’elle gagnait le pupitre, il la détailla et la complimenta intérieurement sur sa tenue, bien plus sage que celle de la veille. Une jupe grise à motifs discrets, juste au-dessus du genou. Un chemisier blanc. Une veste légère, également grise. Des escarpins noirs, à talons hauts, mais pas vertigineux. Même les ongles avaient subi une cure d’austérité, passant du rouge éclatant à une sobre transparence.
— Bonjour à toutes et tous, commença la nouvelle préfète d’une voix claire. Je suis très heureuse d’être parmi vous aujourd’hui, même si je ne suis pas certaine que ce soit réciproque vu l’heure matinale un lundi.
Des rires discrets lui répondirent, ainsi qu’un brouhaha de commentaires. Pierre se surprit à sourire alors qu’il se demandait toujours s’il devait s’inquiéter de ce style peut-être trop novateur. Elle reprit une fois le bruit retombé :
— Je vais faire court, ce serait dommage de faire refroidir toutes ces bonnes choses. Plutôt qu’un long discours, je préfère aller discuter avec chacun d’entre vous pour…
Pierre fut distrait par la sonnerie d’un téléphone juste derrière lui. Il reconnut la voix d’Émilie, la jeune secrétaire de la préfète, qui chuchotait pour répondre tout en se dirigeant aussi discrètement que possible vers le fond de la pièce.
Sylvie Lachan poursuivait :
— … dont il n’est pas question de changer. Du moins jusqu’à ce soir…
Pendant que de nombreux rires éclataient, Émilie traversa la foule dans l’autre sens pour gagner le premier rang. Elle leva timidement la main, se racla la gorge et, malgré deux joues rouge vif, osa prendre la parole avant sa cheffe :
— Excusez-moi, madame, je crois que c’est très important… Et très grave.
Elle lui tendit le téléphone, les doigts tremblants. Restée devant le micro, la préfète fit involontairement participer l’assemblée à sa conversation :
— Oui, Sylvie Lachan.
— …
— Bonjour monsieur.
— …
— Non, je ne suis au courant de rien. Que s’est-il passé ?
— …
— Une explosion ? Ohhhh m… ! Est-ce qu’il y a des morts, des blessés, des dégâts ?
— …
— Une tête ?
— …
— Oui, je comprends, j’arrive tout de suite.
Pas un bruit n’avait troublé l’échange et le silence se prolongeait. Personne ne parlait, personne ne bougeait. La préfète dut se rendre compte que tout le monde avait entendu :
— Bon… Vous en savez autant que moi… Je vais devoir vous laisser. Mais en charmante compagnie ! conclut-elle en désignant la table chargée de victuailles.
Pierre, curieux de voir ce qu’elle allait faire, ne la quittait pas des yeux. La haute fonctionnaire abandonna le pupitre et rendit le téléphone à son assistante :
— Merci Émilie, vous avez bien fait, c’était effectivement important.
Elle attrapa un croissant et pivota vers lui :
— Pierre, vous voulez bien m’accompagner, s’il vous plaît ?
Elle mordit dans la pâtisserie et partit à grandes enjambées, ses talons hauts tonnant dans le couloir. Après une seconde d’hésitation, Pierre se précipita à sa suite. Les mains vides.
Sylvie tourna la tête et détailla le profil du secrétaire général, assis comme elle à l’arrière de la voiture qui filait vers le nord après avoir quitté Tulle. Des cheveux crépus grisonnants coupés très courts, un teint café au lait, des traits ronds et peu marqués, un nez légèrement empâté, une fine moustache, un corps svelte. Séduisant. Un beau sexagénaire qui avait beaucoup plu à Coumbala.
Pierre était penché sur son téléphone, les sourcils froncés. La lecture de ses messages ne semblait pas l’enchanter. Sylvie lui avait expliqué le peu qu’elle savait. Elle montra son propre téléphone :
— Je n’ai rien trouvé dans la presse ou sur internet.
— Moi non plus, répondit Pierre en faisant disparaître son application de messagerie.
Sylvie ne réagit pas à ce mensonge. Ce qui le tracassait devait être personnel. Pierre secoua légèrement la tête en fermant les yeux, comme s’il voulait se remettre les idées en place et revenir au présent. Il coupa maladroitement le silence qui s’était installé :
— Treignac et son lac sont des endroits magnifiques, surtout à l’automne. C’est à découvrir absolument.
Sylvie lui posa la main sur le bras.
— Pierre… Vous savez, je suis d’ici. On va passer à quelques kilomètres de chez mes parents, de chez moi. Je fais la route les yeux fermés : Seilhac, Chamboulive, le Lonzac, la traversée de Treignac…
— Toutes mes excuses, madame, c’est vrai, j’avais oublié que vous étiez corrézienne.
Sylvie laissa la main sur son bras, tentant d’apaiser la tension de son collègue :
— Je sais ce que vous pensez. Que je n’ai rien à faire ici, que je n’y connais rien, que je n’ai pas les compétences, que vous méritez ce poste bien plus que moi, que vous seriez meilleur. Et c’est sûrement vrai. En tout cas, moi, je le crois.