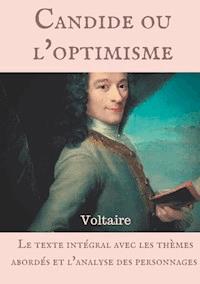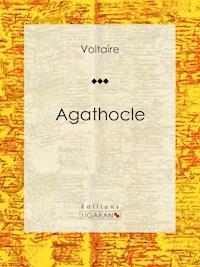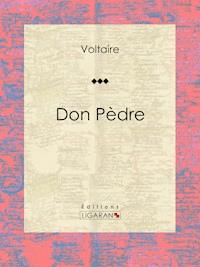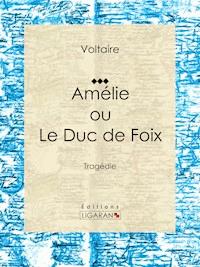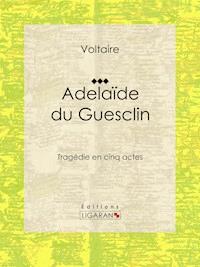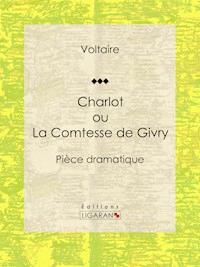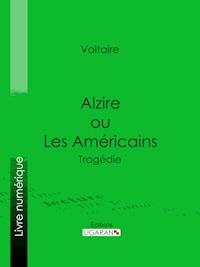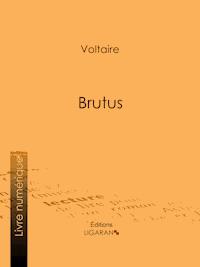
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "BRUTUS : Destructeurs des tyrans, vous qui n'avez pour rois Que les dieux de Numa, vos vertus et nos lois, Enfin notre ennemi commence à nous connaître. Ce superbe Toscan qui ne parlait qu'en maître, Porsenna, de Tarquin ce formidable appui, Ce tyran, protecteur d'un tyran comme lui, Qui couvre de son camp les rivages du Tibre, Respecte le sénat et craint le peuple libre."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335097412
©Ligaran 2015
Brutus avait été ébauché en Angleterre, et l’on dit même que le premier acte avait été d’abord écrit en anglais. C’est en Angleterre, où il venait de passer plusieurs années, que Voltaire puisa, dans le spectacle et la société d’un peuple libre en politique, le sentiment républicain qui anime cette pièce. Il se pénétra, pendant le séjour qu’il fit chez les Anglais, de cette haine du pouvoir arbitraire et de cet amour de la liberté qui forment le caractère de Brutus et balancent dans son fils les passions fougueuses de la jeunesse.
En décembre 1729, Voltaire rassemblait à dîner chez lui les comédiens et leur lisait sa pièce. Quelques jours après il écrivait à Thiériot, qui avait probablement assisté à cette lecture où La Faye était également convié : « Mon cher ami, je vous dis d’abord que j’ai retiré Brutus. On m’a assuré de tant de côtés que M. de Crébillon avait été trouver M. de Chabot (le chevalier de Rohan) et avait fait le complot de faire tomber Brutus, que je ne veux pas leur en donner le plaisir. D’ailleurs je ne crois pas la pièce digne du public. Ainsi, mon ami, si vous avez retenu des loges, envoyez chercher votre argent. »
Nous ne croyons guère, dit M. G. Desnoiresterres, à l’accusation dont l’auteur de Rhadamiste est ici l’objet. Nature indolente, paresseuse, inhabile à l’intrigue, Crébillon n’était pas homme à enchevêtrer, en dehors de ses tragédies, des trames aussi noires. Et puis, extérieurement, les deux rivaux étaient loin d’en être à couteaux tirés. Quelques jours plus tard ils font ensemble une démarche auprès de Lamotte… En somme, la cause déterminante du retrait de la pièce fut moins l’appréhension des menées de Crébillon et du chevalier de Rohan que le peu d’effet qu’elle avait produit sur Messieurs de la Comédie-Française. Lui-même avait senti la nécessité de la remanier… et il convient ailleurs que les défauts de sa pièce la lui firent refuser constamment un an entier aux comédiens. Dès la fin de novembre 1730, Brutus était en pleines répétitions et prêt à être joué. Le poète avait plus d’un souci ; il estimait l’œuvre bonne, mais il fallait faire goûter cette terrible donnée à un public de caillettes et de petits-maîtres. Il n’avait plus la Lecouvreur pour l’aider de son magique talent, et c’était à un talent inexpérimenté encore qu’il avait dû confier le rôle de Tullie. MM. Clogenson et Beuchot veulent que ce soit Mlle Gaussin, qui devait débuter un peu plus tard (28 avril 1731) dans le personnage de Junie, de Britannicus. Il nous a été facile de constater l’erreur dans les registres de la Comédie-Française, qui portent le nom de Mlle Dangeville, à laquelle reviendraient alors de droit la lettre et les vers adressés à Tullie, et dont Mlle Gaussin a bénéficié jusqu’à ce jour.
La jeune actrice, sentant toute la responsabilité qu’elle assumait en se chargeant de ce rôle, n’était rien moins que rassurée ; et il y parut. Voltaire, le lendemain matin, lui écrivit une lettre charmante où il lui donnait toutes les exhortations et tous les encouragements capables de lui rendre cette confiance en soi dont l’acteur a plus besoin que tout autre : « Ne vous découragez pas, lui marquait-il, songez que vous avez joué à merveille aux répétitions ; qu’il ne vous a manqué hier que d’être hardie. Votre timidité même vous fait honneur. Il faut prendre demain votre revanche. J’ai vu tomber Mariamne et je l’ai vue se relever. »
Au reste, Mlle Dangeville ne démentit pas ses prévisions : « Mon valet de chambre arrive dans le moment, mandait le poète à Thiériot dans un de ces billets rapides que son besoin d’expansion lui faisait griffonner à tout instant, qui me dit que Tullie a joué comme un ange. » Malgré l’émotion de l’actrice, Brutus obtint un grand succès à la première représentation (11 décembre). Mais ce succès ne se soutint pas ; la recette tomba, à la deuxième représentation, de cinq mille soixante-cinq à deux mille cinq cent quarante livres. La pièce eut quinze représentations. La recette de la dernière (17 janvier 1731) ne s’éleva pas à plus de six cent soixante livres. Le chiffre n’était que trop éloquent ; on se le tint pour dit.
Les accusations ordinaires de vol, de plagiat, s’élevèrent contre l’auteur. Les rivaux, les ennemis, prétendirent que Voltaire avait fait des emprunts à une tragédie de Brutus, de Mlle Bernard, à laquelle Fontenelle avait collaboré, et qui avait été représentée quarante ans auparavant (18 déc 1690). Piron affirme même que Fontenelle se fâcha : « Cet illustre prend la chose en très mauvaise part, écrit-il au marquis d’Orgeval, l’autre s’en moque ; l’habit est recousu de beau fil blanc et raccommodé avec de belles pièces de pourpre, la friperie triomphe, et malheur aux curieux ! »
Il est bien entendu que la tragédie de Voltaire n’était pas la première que l’histoire du premier Brutus, condamnant à mort ses enfants, eût inspirée. La première que les annalistes nous signalent est intitulée : La Mort des enfants de Brute. Elle est de La Calprenède. Elle obtint un grand succès à l’hôtel de Bourgogne en 1647, et eut deux éditions. En voici la donnée :
Tullie, fille de Tarquin, est aimée de Tite et de Tibère, fils de Brutus. On croit qu’elle a péri le jour où son père a perdu la couronne, mais c’est une erreur : elle a été sauvée par l’adresse de Vitelle, son beau-frère. Elle est donc dans Rome, à portée par conséquent d’appuyer la conjuration en faveur de Tarquin. Cette conjuration est découverte au troisième acte. Brutus apprend avec indignation que ses deux fils, séduits par les discours de Vitelle et plus encore par la passion qu’ils ont pour Tullie, ont tenté de rétablir le tyran sur le trône. Il ne s’agit, dans les deux derniers actes, que de décider du sort des coupables. L’amour de la patrie, étouffant tout autre sentiment dans le cœur de Brutus, il refuse la grâce que le sénat veut accorder à ses fils ; et Tullie, par un coup de poignard, prévient ses reproches et va rejoindre ses adorateurs.
On trouve dans cette pièce quelques vers assez beaux. Après avoir condamné ses fils, Brutus dit :
Mlle Catherine Bernard, parente des Corneille et de Fontanelle, donna, en 1690, un Brutus avec l’aide de Fontanelle. Il réussit également et n’eut pas moins de vingt-cinq représentations, ce qui était considérable en ce temps-là. « Cet ouvrage, dit Laharpe, n’a pas été inutile à Voltaire ; il en a pu emprunter son personnage d’ambassadeur, et il a évidemment imité quelques endroits. »
On y trouve une double intrigue d’amour. Les deux fils de Brutus sont amoureux d’une Aquilie, fille d’Aquilius, chef de la conspiration en faveur des rois bannis ; et une Valérie, sœur du consul Valérius, est amoureuse de Titus qui ne l’aime point. On se doute bien qu’au milieu de tous ces amours, traités dans la manière des romans, le génie de Rome et le ton du sujet ont entièrement disparu. L’idée qu’a eue Voltaire de rendre Titus amoureux d’une fille de Tarquin est bien supérieure. Il n’y a pas moins de distance entre l’audience solennelle donnée dans le sénat romain à l’envoyé de Porsenna, et la scène où les deux consuls reçoivent Octavius, qui joue dans la pièce de Mlle Bernard le même rôle qu’Arons dans celle de Voltaire. Mais ces deux personnages commencent leur discours à peu près de même pour le fond des idées :
OCTAVIUS
Arons dit de même :
On ne peut nier que l’un de ces deux morceaux n’ait pu fournir l’idée de l’autre ; mais l’obligation est assez légère et l’intervalle est immense. On peut observer le même rapport et la même distance entre ces quatre vers de Brutus à son fils, qu’il va condamner :
et ceux que Voltaire lui prête dans la même circonstance :
Acte V, scène VII (in fine).
Il faut mentionner encore un Brutus latin du P. Porée, joué au collège de Louis-le-Grand. Le dialogue, quoique semé d’antithèses, ne manque ni de vivacité ni de noblesse, mais le plan est d’un homme qui n’a aucune connaissance du théâtre. Cette pièce ressemble à toutes celles du même auteur qui ne sont que des espèces de pastiches, des copies maladroites de nos plus belles tragédies françaises. Les trois derniers actes de son Brutus sont calqués sur l’Héraclius de Corneille. Les deux fils de Brutus se disputent, comme les deux princes, à qui mourra, et chacun d’eux n’accuse que lui-même et veut justifier et sauver l’autre. Cependant cette pièce du P. Porée a fourni à son élève deux beaux mouvements. Titus, condamné, dit à son père : « Je vais mourir, mon père ; vous l’avez ordonné. Je vais mourir, et je donne volontiers ma vie en expiation de ma faute ; mais ce qui m’accable d’une juste douleur, je meurs coupable envers mon père. Ah ! du moins, que je ne meure pas haï de vous, que je n’emporte pas au tombeau ce regret affreux : accordez à un fils qui vous aime les embrassements paternels ; que j’obtienne de vous cette dernière grâce, ouvrez les bras à votre fils, etc. »
Voltaire a imité ce morceau :
Acte V, scène VII.
mais combien l’élève surpasse le maître ! Cela n’empêche pas qu’il ne lui ait obligation. Il lui doit aussi ce dernier vers qui termine si bien la tragédie de Brutus :
Mais il enchérit toujours sur le modèle. Le Brutus latin dit seulement, lorsqu’on lui annonce la mort de son fils : « Je suis content, Rome est vengée. » La beauté consiste dans ce premier sentiment donné tout entier à la patrie, et c’est là ce que Voltaire a emprunté ; car d’ailleurs « Rome est libre » a bien une autre étendue et une autre force d’idée que « Rome est vengée », et « Rendons grâces aux dieux ! » est sublime.
Enfin, il paraît que Crébillon avait fait aussi dans sa jeunesse une tragédie de la Mort des enfants de Brutus, et c’est là ce qui explique peut-être les projets de cabale que nous avons vu Voltaire prêter à ce poète. Nous lisons du moins dans les Annales dramatiques : « Le jeune Crébillon, sur les conseils du procureur Prieur chez qui il était clerc, tenta de faire une tragédie : il choisit pour son coup d’essai le sujet de la Mort des enfants de Brutus. Les comédiens à qui il alla la présenter la refusèrent ; et pour ne rien dissimuler, non seulement elle n’était pas bonne, mais encore quoiqu’on y découvrît assez de talent pour la versification, elle n’annonçait pas que son auteur pût devenir un jour un très grand poète. Cette pièce existait encore il y a trente ans (ceci est écrit en 1775) ; on l’avait retrouvée tout entière dans des papiers qu’il avait mis au rebut ; et comme on prévoyait ce qu’il voudrait en faire, si on lui eût annoncé la découverte, on se garda bien de l’en instruire ; mais le hasard la lui ayant fait rencontrer sous sa main, il la brûla. » Il est donc bien peu probable qu’il ait pu éprouver du mécontentement à voir Voltaire traiter le même sujet.
On s’est étonné que Brutus, à l’origine, ne produisit aucune sensation politique. C’est qu’il était, à l’époque où il parut, entièrement dépourvu d’actualité. Le culte monarchique n’était nullement entamé, et ce n’était que par un effort d’intelligence historique que l’on pouvait comprendre et admirer les vertus républicaines de l’ancienne Rome. Brutus, au contraire, devint une pièce de circonstance quand la lutte entre les idées républicaines et les idées monarchiques commença.
Depuis longtemps, une partie du public, racontent Étienne et Martainville, sollicitait vivement la reprise de Brutus