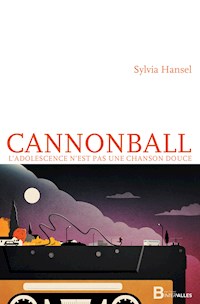
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
Quand on s’appelle Sylvie, qu’on a 12 ans, qu’on vient de Moselle et qu’on échoue avec sa mère divorcée dans un village fleuri aux portes de Meaux, la navigation à vue au long des méandres de l’adolescence risque bien de ressembler à un naufrage.
Cette chronique (1993-2001) d’une adolescence en proie à l’ennui et à la solitude au sein d’une famille recomposée défriche sans désherbant ces années ingrates. À cette époque pré-internet, c’est le hasard de rencontres initiatiques qui permet à la narratrice de ne pas sombrer : une meilleure amie compagne de fous rires épiques ; un premier amour épistolaire ; un CPE affublé d’un surnom gênant qui, pourtant, pose les fondations d’un début de confiance en soi. Tous partagent avec la jeune fille une passion qui permet d’échapper à la mélancolie : le rock.
Une chanson, un chapitre, c’est le rythme proposé par Sylvia Hansel pour relater ce cheminement vers l’âge adulte. Ces cinquante titres constituent la bande-son d’un récit autobiographique narré avec décalage, humour et sans fausse pudeur.
Sylvia Hansel livre aussi une interprétation toute personnelle de ces chansons – on découvre par exemple la notion d’album d’été ou d’hiver –, ainsi qu’un éclairage sur leur genèse, riche d’anecdotes qui raviront les adorateurs des Stones, Velvet Underground, Bowie, Nirvana, Breeders et autres groupes mythiques, ou qui inviteront à découvrir des formations plus confidentielles – qui connaît le West Coast Pop Art Experimental Band ?
Surtout, le rock possède un pouvoir cathartique qui réconforte et façonne une personnalité qui finit par s’approprier les notions d’émancipation, de féminisme, de rapport de classes ou de pression sociale. Cette musique, surtout, va nourrir peu à peu le projet de monter un groupe, et cette éducation rock’n’roll en autodidacte prendre la forme d’un projet de vie.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Sylvia Hansel travaille dans la presse musicale, chante et joue de la guitare dans des groupes de rock indé. Après deux romans très remarqués intitulés
Noël en février (éditions rue Fromentin, 2015) et
Les adultes n’existent pas (éditions Intervalles, 2018),
Cannonball, L’adolescence n’est pas une chanson douce est son troisième roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cannonball
Sylvia Hansel
Cannonball
L’adolescence n’est pas une chanson douce
Éditions Intervalles
À Laurence, Jean-Roch, Brigitte et à la mémoire de Robert Schluth.
LISTE DES CHANSONS
Chapitre 1.The Velvet Underground, « Pale Blue Eyes », The Velvet Underground, 1969, MGM Records.
Chapitre 2.The Velvet Underground, « Lady Godiva’s Operation », White Light/White Heat, 1968, Verve Records.
Chapitre 3.The Breeders, « Cannonball », Last Splash, 1993, 4AD.
Chapitre 4.The Rolling Stones, « Wild Horses », Sticky Fingers, 1971, Rolling Stones Records.
Chapitre 5.Lou Reed, « Walk on the Wild Side », Transformer, 1972, RCA.
Chapitre 6. The Velvet Underground, « Oh! Sweet Nuthin’ », Loaded, 1970, Cotillion Records.
Chapitre 7.Tommy James And The Shondells, « Crimson and Clover », parue en single en 1968, Roulette Records.
Chapitre 8.Nirvana, « Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle », In Utero, 1993, Geffen.
Chapitre 9.The Rolling Stones, « 100 Years Ago », Goats Head Soup, 1973, Rolling Stones Records.
Chapitre 10.The Rolling Stones, « Sister Morphine », Sticky Fingers, 1971, Rolling Stones Records.
Chapitre 11.The Rolling Stones, « I’ve Got the Blues », Sticky Fingers, 1971, Rolling Stones Records.
Chapitre 12.The Rolling Stones, « Sweet Black Angel », Exile on Main St., 1972, Rolling Stones Records.
Chapitre 13.Frank Zappa, « Let’s Make the Water Turn Black », sur l’album des Mothers Of Invention We’re Only in It for the Money, 1968, Verve Records, et sur la compilation Strictly Commercial, 1995, Rykodisc.
Chapitre 14.The Rolling Stones, « Hand of Fate », Black and Blue, 1976, Rolling Stones Records.
Chapitre 15.The Rolling Stones, « I Am Waiting », Aftermath, 1966, Decca.
Chapitre 16.The Rolling Stones, « 2 000 Man », Their Satanic Majesties Request, 1967, Decca.
Chapitre 17.Hole, « Miss World », Live Through This, 1994, Geffen.
Chapitre 18.The Sex Pistols, « Substitute », Better Live Than Dead, 1988, Enigma Records.
Chapitre 19.Bob Dylan, « Blowin’ in the Wind », The Freewheelin’ Bob Dylan, 1963, Columbia.
Chapitre 20.Renaud, « Les Charognards », Laisse béton, 1977, Polydor.
Chapitre 21.The Breeders, « Fortunately Gone », POD, 1990, 4AD.
Chapitre 22.The Kelley Deal 6000, « How About Hero », Go to the Sugar Altar, 1996, Nice Records/Play It Again Sam.
Chapitre 23.The Beatles, « Strawberry Fields Forever », parue en single et sur l’album Magical Mystery Tour, 1967, Parlophone.
Chapitre 23.Janis Joplin, « Little Girl Blue », I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, 1969, Columbia.
Chapitre 25.Hole, « Teenage Whore », Pretty on the Inside, 1991, Caroline Records.
Chapitre 26.Lou Reed, « Xmas in February », New York, 1989, Sire Records.
Chapitre 27.The Breeders, « No Aloha », Last Splash, 1993, 4AD.
Chapitre 28.Brendan Benson, « Sittin’ Pretty », One Mississippi, 1996, Virgin.
Chapitre 29.David Bowie, « Five Years », The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, 1972, RCA/Virgin.
Chapitre 30.Hanson, « MMMBop », single, 1997, Mercury/PolyGram.
Chapitre 31.Noir Désir, « Là-bas », paru sur le maxi « L’homme pressé », 1997, Barclay.
Chapitre 32.Radiohead, « No Surprises », OK Computer, 1997, Parlophone.
Chapitre 33.Neil Young, « Out on the Weekend », Harvest, 1972, Reprise Records.
Chapitre 34.L7, « Freak Magnet », Hungry for Stink, 1994, Slash Records.
Chapitre 35.The Who, « Go to the Mirror! », Tommy, 1969, Polydor.
Chapitre 36.Spiritualized, « Ladies and Gentlemen, We’re Floating in Space », Ladies and Gentlemen, We’re Floating in Space, 1997, Dedicated.
Chapitre 37.The Who, « I’ve Had Enough », Quadrophenia, 1973, Track Records/MCA.
Chapitre 38.The Presidents Of The United States Of America, « Video Killed the Radio Star », parue sur la compilation Pure Frosting, 1998, Columbia.
Chapitre 39.Eels, « Last Stop : This Town », Electro-Shock Blues, 1998, DreamWorks.
Chapitre 40.The Pogues, « The Band Played Waltzing Matilda », Rum Sodomy and the Lash, 1985, Stiff Records.
Chapitre 41.dEUS, « Instant Street », The Ideal Crash, 1999, Island.
Chapitre 42.Alanis Morissette, « That I Would Be Good », MTV Unplugged, 1999, Maverick.
Chapitre 43.Pixies, « Where Is My Mind? », Surfer Rosa, 1988, 4AD.
Chapitre 44.Creedence Clearwater Revival, « Who’ll Stop the Rain », Cosmo’s Factory, 1970, Fantasy Records.
Chapitre 45.The Amps, « Empty Glasses », Pacer, 1995, 4AD.
Chapitre 46.Pink Floyd, « Comfortably Numb », The Wall, 1979, Harvest/Columbia.
Chapitre 47.The Dandy Warhols, « Get Off », Thirteen Tales From Urban Bohemia, 2000, Capitol.
Chapitre 48.Syd Barrett, « Baby Lemonade », Barrett, 1970, Harvest/EMI.
Chapitre 49.The West Coast Pop Art Experimental Band, « Suppose They Give a War and No One Comes », Vol. 2, 1967, Rhino.
Chapitre 50.Rick Saucedo « Reality », Heaven Was Blue, 1978, Reality Records.
Introduction
Reprendre la formule de Lou Reed, « my life was saved by rock’n’roll », est un tel cliché que c’en est navrant. Pourtant, j’ai beau me tortiller la cervelle dans tous les sens, je ne parviens pas à imaginer à quoi aurait ressemblé ma vie sans cette musique. « My parents will be the death of us all/Two TV sets and two Cadillacs cars it doesn’t help me at all », dit la petite Jenny imaginée par Reed. Feu le songwriter exécrable a, une fois de plus, trouvé les mots à ma place – à cette nuance près que mes parents ne roulaient pas en Cadillac mais en Opel.
Comme les odeurs, les chansons possèdent le pouvoir fabuleux de vous ramener à un instant précis de votre vie. Une activité à laquelle je m’adonne depuis l’adolescence, via des compilations sur cassettes réalisées à la fin de chaque année et regroupant par ordre chronologique les chansons qui m’ont le plus marquée durant l’an écoulé. En les écoutant les unes après les autres, une tierce personne pourrait avoir une idée assez précise de ce qu’a été ma vie.
La nostalgie, pourtant, a mauvaise presse. Il faut être à l’affût de la nouveauté, s’intéresser aux sorties récentes… Quand je lis sur internet les posts de mes amis toujours en quête de découverte, je me demande s’ils les écoutent vraiment, les disques. Vu l’actuelle profusion de groupes, où trouvent-ils le temps de se pencher attentivement sur la musique, de chercher à la comprendre ? Je suis sûre qu’en cachette, ils passent toujours les disques qu’ils aimaient à l’adolescence. Et ils ont raison. La nostalgie, majoritairement perçue comme un signe de putréfaction, est l’un des sentiments les plus profonds et les plus riches que je connaisse. C’est principalement elle qui inspire mes écrits et mes chansons.
D’ailleurs, comment ça s’écrit, une chanson ? Keith Richards disait : « En un sens, tu veux pénétrer le cœur d’autres personnes. Tu veux te planter là, ou du moins obtenir une résonance, et les autres deviennent un plus grand instrument que celui dont tu joues… Écrire une chanson dont on se souvient et qu’on prend à cœur établit un lien… un fil conducteur qui nous traverse tous. »
Est-ce la chanson qui est intéressante en soi, ou est-ce le lien que l’auditeur tisse avec elle ? Les deux, mon capitaine. Comme avec un amant, de toutes les chansons que j’ai aimées, je garde le souvenir précis de notre rencontre – je veux dire, de la première fois où je les ai entendues. Mon amour pour les chansons qui suivent n’a jamais faibli, elles me rappellent qui j’étais à l’époque où je les écoutais en boucle.
Je n’entends pas dresser une liste des meilleures chansons du monde ; d’ailleurs, ce ne sont même pas mes morceaux préférés de tous les temps. Grands dieux ! Même à trois grammes du matin, il ne me viendrait jamais à l’esprit d’inclure « Video Killed the Radio Star » dans un Top 50 des titres indispensables, et d’en exclure des chefs-d’œuvre tels que « God Only Knows » des Beach Boys ou « Autumn Almanac » des Kinks ! Ai-je une tête à trouver « Hand of Fate » des Stones plus géniale que « Sympathy for the Devil » ? Non. Mais j’ai écouté « Sympathy » des milliers de fois, à des époques et dans des circonstances variées, si bien qu’elle ne me rappelle rien ni personne, tandis que j’écoutais « Hand of Fate » alors que je faisais une fugue, à 14 ans, et ne l’ai que rarement remise sur la platine depuis. (À ce propos, avec mes amis on a cette blague : quand tu retrouves Black and Blue posé sur la chaîne hi-fi le matin, tu sais que tu as trop bu la veille au soir.) La liste de chansons qui suit ne possède donc de cohérence que parce qu’elle constitue la bande-son de mon adolescence. Une adolescence que d’aucuns jugeront banale, mais qui fut, comme c’est le cas pour tout le monde, la période où j’ai vécu le plus intensément.
Bizarrement, alors que le rock est la chose la plus importante au monde et que je lis la presse spécialisée depuis l’âge de 12 ans, je n’avais jamais envisagé sérieusement d’écrire sur la musique. Jusqu’à ce qu’un jour, pour son blog, mon amie journaliste Isabelle Chelley me demande de lui parler de ma chanson préférée de tous les temps. Après des jours et des jours d’hésitation (choisir une seule chanson, vous imaginez le calvaire), j’ai fini par prendre un tel plaisir à écrire sur « Wild Horses », à me remémorer la façon dont je l’avais découverte, que j’ai eu envie de parler d’autres chansons qui ont compté pour moi. Un peu comme l’ont fait Nick Hornby avec 31 Songs, Rob Sheffield avec son poignant Bande originale : la vie et la perte, une chanson à la fois, suivi de Tomber les filles avec Duran Duran, ou Chuck Klosterman avec Fargo Rock City. Ma récente (et délectable) lecture de Basse fidélité de Philippe Dumez n’est sans doute pas non plus pour rien dans mon envie d’écrire ce livre. Parce que oui, se plonger dans les émois musicaux d’autrui est extrêmement agréable. Noircir les pages qui suivent l’a également été. Le plus dur fut le choix des titres ; je me suis trituré les neurones avec des questions d’ordre éthique telles que : a-t-on le droit de mettre plusieurs chansons d’un même groupe ? (La réponse est oui, assurément.) Mais est-il raisonnable de sélectionner huit (huit !) titres des Stones à la suite ? (Pas forcément, mais impossible de faire autrement, dans la mesure où durant l’année 1995 j’ai écouté quasi exclusivement ce groupe.) Quelle chanson choisir sur Satanic Majesties, sachant que j’écoutais toujours l’album dans son ensemble, et qu’aucune n’en ressort nettement ? Dois-je avouer mon penchant coupable pour « MMMBop » du trio prépubère Hanson ? Est-il moralement correct de faire figurer Alanis Morissette avant les Pixies ? Peut-on encore avouer qu’on aime un titre de Noir Désir ? Un manuscrit mentionnant Renaud sera-t-il automatiquement refusé par tous les éditeurs ? In fine, je me suis retrouvée avec cinquante chansons, et mon adolescence entière déballée, car comment parler de mon rapport à toutes ces chansons sans révéler mon histoire ? J’ai donc laissé la musique me guider pour une plongée dans ma mémoire.
Le livre qui suit est extrêmement subjectif. De plus, les cerveaux (le mien comme ceux des autres) ayant tendance à déformer les souvenirs, je ne peux pas jurer avoir restitué ici toute la vérité, rien que la vérité. Ce qui suit n’est pas un exutoire, ni une façon de me venger ou de nuire à qui que ce soit. C’est ma version des choses ; si certains protagonistes en ont une différente, libre à eux de la donner, si ça leur chante.
Août 1993
Quelle est la probabilité pour qu’une fillette de 12 ans née en Moselle, dont le père fait les trois-huit à l’usine de Florange et dont la mère regarde La Roue de la fortune présentée par Christian Morin, tombe sur le Velvet Underground ?
J’ai coutume de clamer que je n’ai pas de bol. Lorsque mon chat urine sur mes draps fraîchement lavés, par exemple. Ou quand mon employeur, en liquidation judiciaire, ne m’a pas versé mes deux derniers mois de salaire. Quand, sortant du Truskel – seule boîte de nuit « rock » parisienne que nous connaissions – à 5 heures du matin avec mes copines sans avoir trouvé de mec potable avec qui passer la nuit, nous hurlions à la lune que nous n’avions pas de bol. Lorsqu’à l’inverse nous avions pécho, le gars en question s’avérait cinglé ; nous n’avions vraiment pas de bol ! D’un autre côté, personne n’en a : une foule de gens prétendent, par exemple, qu’ils choisissent toujours la mauvaise file à la caisse du supermarché. Ou que s’il y a une crotte de chien sur le trottoir, c’est systématiquement eux qui marchent dedans. La vérité, c’est que ces gens mentent : c’est moi qui suis dans la queue qui n’avance pas, moi qui mets le pied droit dans la merde. Moi, pas eux. Autre explication : tout le monde estime avoir moins de chance que les autres. Prétendre que je n’ai pas de bol est donc inexact et hypocrite : il y avait 0,05 % de chances pour que je connaisse le Velvet Underground à 12 ans. Pourtant, c’est arrivé.
Écouter le Velvet aujourd’hui ne signifie plus rien. Tout le monde sait que c’est classe. Même ma collègue de bureau quinquagénaire, franchouillarde, aimant « Le Petit pain au chocolat » de Joe Dassin, a découvert le Velvet via la récente expo à la Philharmonie de Paris et a adoré. Forcément, puisque Télérama ne tarit pas d’éloges, soulignant l’importance culturelle de ce groupe… Tous nos artistes institutionnels rendent hommage au Velvet. Lou Doillon a repris « Femme fatale » – n’allez surtout pas écouter sa version, il est des souffrances qu’il vaut mieux s’épargner. La banane de Warhol a pris la place, au-dessus des canapés, des reproductions de Monet qui trônaient chez nos parents. Si l’on veut passer pour décalé dans les dîners mondains, mieux vaut prétendre ne pas aimer le Velvet. Si les membres du Velvet eux-mêmes se retrouvaient projetés, jeunes, dans notre époque, ils n’aimeraient pas le Velvet.
Mais en 1993, surtout parmi les préados mosellans, les choses étaient bien différentes. Certes, la Fondation Cartier avait accueilli une première reformation trois ans plus tôt, ce qui avait amorcé la réhabilitation du groupe de Moe Tucker. Avait suivi une seconde reformation, avec tournée européenne en première partie de U2 (!!!). La fameuse banane trônait en couverture des Inrocks, qui avaient aussi sorti le somptueux hors-série Superstars consacré au groupe et à la Factory warholienne. Le train était en marche vers l’institutionnalisation. Mais ce train était encore à Paris. Disons que s’il venait de partir de la gare de l’Est, il devait être à hauteur de Pantin – et il roulait lentement. Il mettrait un temps fou à pointer le bout de sa locomotive en Lorraine.
C’est pourtant là-bas que j’ai eu le plus gros coup de bol de ma vie en heurtant de plein fouet cette musique qui ne ressemblait à rien de connu. Et je n’ai aucune gloire à en tirer. Simplement, j’étais en sixième au collège de Fameck, situé en face de l’usine Daewoo alors en construction. (Une fois les travaux terminés, l’entreprise coréenne a embauché plein de gens – dont l’épouse de mon cousin –, empochant joyeusement les subventions que l’État offre aux compagnies étrangères qui créent de l’emploi en France, puis a déposé le bilan et retouché les sous que le contribuable file aux boîtes en difficulté. Tout bénef ! Il y a eu des grèves, des dirigeants ont été séquestrés par les ouvrières, on a mis toute la région au chômage… Mais là n’est pas la question ; dans l’Est, être au chômedu, on a l’habitude. Entendre l’alto électrique de John Cale, beaucoup moins.) C’est au collège que j’ai rencontré Nathalie, grande et jolie blonde qui était dans ma classe, et Agathe, une fille stupéfiante d’un an mon aînée, brune aux yeux noirs, charismatique et habillée façon arty (les autres élèves disaient plutôt « fringuée n’importe comment »). Si Agathe, à seulement 13 ans, portait des pantalons pattes d’eph, des chaussures à talons compensés et une multitude de bijoux hippies, c’était grâce à l’influence de son frère aîné, chanteur-guitariste de son état. Son groupe se produisait dans les bars de Metz, Nancy ou même Paris. La grande classe ! Nous étions en pleine période Hélène et les garçons, dont je ne ratais pas un épisode malgré le mépris qu’affichaient mes deux nouvelles amies pour cette sitcom. Bien qu’elles pensent que c’était un programme TV pour gamines débiles, si un groupe de rock traînait dans le coin, il fallait que nous, les filles, fussions chacune amoureuse de l’un des musiciens. Agathe avait jeté son dévolu sur le bassiste1, Nathalie préférait le batteur. Étant la nouvelle venue dans notre trio, je me suis sentie obligée de faire mieux : j’ai été successivement amoureuse des deux membres restants, le guitariste puis l’organiste. Pour espérer un jour sortir avec l’élu de notre cœur et paraître plus grandes que notre âge, nous nous appliquions à écouter la même musique qu’eux, à savoir les Doors et le Velvet Underground. Côté Doors, ça allait encore : même après des années de variété française à base de Sardou (dont ma mère était fan), Patricia Kaas (notre gloire locale) ou les idoles des jeunes Roch Voisine et Patrick Bruel, Jim Morrison, à condition de se forcer un peu, ça passait. Il était beau gosse, posters et tee-shirts à son effigie étaient disponibles dans les boutiques de Metz, la musique était propre, juste un peu plus bizarre qu’Abba dont ma mère possédait une cassette. On pouvait se payer du frisson à l’écoute du passage œdipien de « The End », se donner des airs blasés en rigolant des sous-entendus sexuels de « Light My Fire »… La poésie sombre de Morrison et sa fin tragique nous permettaient de donner libre cours au petit côté morbide allant de pair avec les hormones de l’adolescence. D’ailleurs, les rockers de nos cœurs n’étaient déjà plus tellement branchés Doors… Rapidement, la bande à Morrison nous a paru bien fade. Le Velvet, c’était autre chose. C’était le vrai truc. Pour l’honnêteté, il me faut avouer que je n’ai pas immédiatement accroché. J’ai d’abord entendu le best of tourner dans la chambre d’Agathe… une sorte de bouillie sonore qui ne se chantait pas, on aurait dit des Weetabix électriques qu’on aurait laissé tremper trop longtemps dans le lait. L’alto de John Cale m’évoquait le crissement d’une boîte de conserve qu’on aurait frottée contre un tableau noir. Mes autres copines d’école, qui écoutaient la musique appropriée pour les gosses de notre âge, Kris Kross, New Kids On The Block ou Michael Jackson, hurlaient : « Mais vous allez arrêter cette musique de shootés ?! » J’ai donc cessé de fréquenter ces filles, par loyauté envers Lou Reed dont je ne savais pas encore apprécier la musique, mais dont je savais qu’il était cool. (À quel point peut-on n’y rien comprendre quand on est très jeune… Bien sûr, Lou Reed était à peu près tout sauf cool.) Nico chantait faux. Reed (que nous surnommions « Loulou ») aussi. « All Tomorrow’s Parties » évoquait un chant médiéval sinistre. Ah, qu’il était rude de se forcer à aimer cela pour avoir l’air d’une grande !
Lorsque le frère d’Agathe était absent (ce qui arrivait souvent, car il taillait la route, guitare électrique sur le dos et longs cheveux au vent, tout le temps en répète ou en tournée), nous allions dans sa chambre et fouinions dans ses piles de magazines : Les Inrockuptibles, Rock & Folk, Best… c’était la caverne d’Ali Baba. Nous avions déniché des articles sur le Velvet, où nous découvrions un tas de mots compliqués comme « concept », « décadence », « cynisme » ou « dépravé », dont nous devinions plus ou moins le sens grâce au reste de la phrase (en nous aidant du « contexte » donc, autre mot que la presse musicale m’a appris).
C’était le bon temps. Nous passions des heures à rigoler, à nous maquiller d’étrange façon, à essayer les vieilles robes psychédéliques de la mère d’Agathe qui, dans les années 70, avait été vaguement hippie. Un jour, en cours d’anglais, alors que nous apprenions « I like/I don’t like » et devions construire une phrase contenant ces termes, Nathalie et moi avons levé la main et dit bien fort, devant la classe entière : « I like The Velvet Underground but I don’t like Nico. »
L’année scolaire terminée, j’ai dû abandonner les copines pour partir en vacances avec mon père sur la côte belge. Dans une librairie d’Ostende, merveille des merveilles, je suis tombée sur la tête de Lou Reed en couverture de Best. Mon père m’a acheté le magazine (pour faire chier ma mère dont il était divorcé, il m’offrait ce qu’elle me refusait ; c’était pratique, si je désirais un truc, je n’avais qu’à lui dire « ma mère ne veut pas ». C’est aussi lui qui, par la suite, m’a procuré ma première guitare via le comité d’entreprise de l’usine où il bossait). Dans ce Best, se trouvait une longue interview de chacun des membres du Velvet réalisée par Bruno Blum. La réponse de Reed à la première question que lui posait le journaliste (« As-tu jamais espéré que les Beatles se reformeraient ? ») m’a fait mourir de rire : « Est-ce que c’est le genre de questions que tu vas me poser aujourd’hui ? C’est de ce niveau-là ? Est-ce que tu as sombré dans le marécage de la drogue, ou de l’alcool ? Ton cerveau te laisse tomber ? Allons. Pose-moi encore une question. Ne me demande pas de conneries pareilles. » J’ai immédiatement adoré ce type.
L’été précédent, mon père m’avait déjà emmenée dans cet endroit où il n’y avait rien à faire, sinon manger des gaufres et profiter de la plage interminable. Un an auparavant, je passais des heures à me laisser joyeusement porter par les grosses vagues froides de la mer du Nord. Je ramassais des coquillages, lançais du pain aux mouettes et laissais mon papa m’enterrer dans le sable pour rire. Étendue sur ma serviette de plage, je lisais des livres de la bibliothèque Rouge et Or, Crack, chien patagon ou Ouragan, l’étalon sauvage. Mais à l’été 1993, tout avait changé : je m’ennuyais prodigieusement et relisais si inlassablement mon magazine de rock que j’en venais presque à le connaître par cœur (même l’article sur Billy Idol en cyberpunk).
Pendant ce temps, ma mère était occupée à déménager. Elle avait rencontré un homme qui habitait « à Paris » et avait décidé de partir vivre chez lui, sans trop demander mon avis. Elle m’emmenait dans ses bagages, au même titre que la soupière qu’on n’utilise jamais mais qu’on expose sur le buffet. Ce qu’elle appelait « Paris » était en réalité Villeneuve-la-Garenne – où il n’y a même pas le métro et où aucun Parisien ne met jamais les pieds car il lui faudrait pour cela franchir le boulevard périphérique. Il y avait à peine six mois que j’avais rencontré Agathe et Nathalie, et j’étais brutalement arrachée à mes nouvelles amies, les seules filles avec lesquelles je me sentais bien…
Lorsque je suis revenue de mes vacances belges, ma mère était déjà installée en région parisienne, si bien que j’ai dû crécher quelque temps chez ma grand-mère. Elle vivait dans la même ville que mes copines, alors j’ai passé le plus clair de mon temps avec elles, dans la chambre d’Agathe, où tournait en permanence une cassette du Velvet. Je rentrais d’Ostende avec un seul nom à la bouche : Lou Reed. Agathe avait une longueur d’avance, elle avait appris que son épouse se nommait Sylvia Morales. Étant donné que je m’appelle Sylvie (un prénom vieillot pour ma génération, qui équivalait à Chantal ou Monique et dont tout le monde se moquait au collège), elle s’est mise à m’appeler Sylvia, pour me chambrer. Nathalie l’a imitée. Le pli était pris. Et me voici aujourd’hui, signant mes livres Sylvia Hansel.
Le dernier après-midi que nous avons passé ensemble toutes les trois, je me suis chié dessus. Littéralement. Alors que nous écoutions la compil VU, j’ai commencé à me sentir mal. Envie de vomir. J’ai donc mis la tête dans les toilettes, longtemps attendu, mais rien n’est venu. Il était pourtant l’heure de rentrer chez ma grand-mère, qui habitait à une demi-heure de marche et ne plaisantait guère avec l’horaire. J’ai fini par dire au revoir à mes amies et me mettre en route, toujours nauséeuse, « Temptation Inside Your Heart » dans la tête. Je marchais depuis à peine dix minutes quand j’ai été prise d’une envie de faire caca d’une puissance inédite. J’ai serré les fesses. Je me suis dit que j’étais grande, je possédais la pleine « maîtrise de mon derrière » – je me souviens avoir employé cette expression dans ma tête. Il me restait un long chemin à parcourir. Et aucun bistrot où j’aurais pu m’arrêter pour utiliser les toilettes (de toute façon, j’étais trop jeune pour en avoir l’idée). Il me fallait longer une usine, puis le collège, puis le centre sportif, dépasser le centre commercial Leclerc, passer devant le commissariat de police, traverser une cité HLM… Courir était hors de question, car il aurait fallu relâcher certains muscles qui retenaient le… enfin, vous voyez. Ce trajet, que je connaissais par cœur, fut mon chemin de croix. Marchant à petits pas, j’ai vaillamment réussi à tenir. « I know where temptation lies/Inside of you heart… »Jusqu’au commissariat devant lequel, malgré moi, tout est sorti. Heureusement, je portais un jean, et non une jupe. Mais tout de même. Quelle humiliation ! Je m’étais chié dessus en pleine rue !!! Et ce n’était pas du solide. Oh, non. Il me fallait progresser lentement pour éviter que cela coule le long de mes jambes. Oh, putain de bon Dieu de merde ! Ça coulait quand même…
J’ai parcouru les loooooooongues, looooongues centaines de mètres qui me séparaient de la maison de ma grand-mère, les jambes toutes raides. Je suis entrée par la porte de derrière, qui donnait sur la buanderie, pour ne pas souiller l’entrée. J’ai retiré mes vêtements et me suis ruée dans la baignoire, pendant que ma mémé, hilare, lavait mon jean et ma culotte.
Cette anecdote a beaucoup amusé ma mère et son jules, arrivés de Paris en début de soirée. J’ai pris le parti d’en rire, moi aussi. Pour une fois qu’un de mes actes attirait l’attention des adultes… Plus tard, je suis descendue aux toilettes faire un pipi normal, et j’ai eu une sueur froide en constatant que ma nouvelle culotte était maculée de brun. Oh non, c’est pas possible ! Je me suis à nouveau chié dessus, cette fois-ci sans même m’en rendre compte ! Une vague de honte m’a submergée. Tentant de réfléchir calmement, j’ai fini par comprendre : ce n’était pas de la merde, c’étaient mes premières règles. J’étais devenue femme.
La nuit était tombée quand on est arrivés à Villeneuve-la-Garenne ; le ciel était violet. Aucune étoile en vue, malgré l’absence de nuages. Pollution lumineuse, je devais apprendre le terme plus tard. Un pont, la Seine, des péniches. Le quai d’Asnières. Un parking souterrain, situé sous quatre tours plus hautes que n’importe quel immeuble que j’avais pu voir jusque-là. Ascenseur. Odeurs de poubelles : la pièce où venaient s’amonceler les déchets qu’on jetait par le vide-ordures était au niveau -2 du parking. La fenêtre de ma chambre donnait sur le Sacré-Cœur, au loin. Avant la basilique, le périph. Des lettres publicitaires géantes et lumineuses, rouges, brillaient dans la nuit au sommet des tours. Il n’y avait pas de volets. Les premières nuits, je n’ai pas pu dormir, avec ce ciel violet qui éclairait la piaule, la chaleur, la fenêtre ouverte proclamant « open bar » pour les moustiques du fleuve tout proche, qui s’en donnaient à cœur joie…
Les premiers jours, je suis sortie me promener seule. Tout avait l’air dangereux, ici. Traverser la rue, par exemple : une épreuve digne de Fort Boyard. Quatre voies de voitures et, au milieu, deux voies de bus. Les feux piétons semblaient ne jamais passer au vert. Près de chez moi, il y avait deux ou trois machins en béton où on pouvait s’asseoir, sur la plateforme où poussaient les quatre tours Monet, Sisley, Corot et Renoir (j’ignorais alors qui étaient ces peintres, mais si j’avais connu leurs œuvres, j’aurais savouré l’ironie de voir leurs noms associés à des tours HLM hideuses. En contrebas, il y avait l’allée des Impressionnistes, que personnellement j’aurais plutôt baptisée « allée des Poubelles ». Cette manie absurde de donner des noms bucoliques à des lieux moches et sales). Un après-midi, je me suis posée sur l’un de ces bancs en béton et j’ai fini par aborder deux filles de mon âge, Nadia et Sonia, qui s’amusaient sur un conduit d’aération. Elles m’ont accueillie, j’ai partagé leur jeu, puis Nadia m’a invitée chez elle, au dix-septième étage de la tour Corot. Des cafards couraient entre les boîtes aux lettres du hall d’entrée. L’ascenseur étant en panne, j’ai décliné. Ces meufs étaient sans intérêt : elles étaient amoureuses de David Charvet et ne parlaient que d’Alerte à Malibu. Je suis donc remontée dans ma chambre écouter le best of du Velvet qu’Agathe m’avait copié sur cassette. J’ai charcuté mon magazine pour afficher aux murs de ma chambre les photos de la bande à Loulou, ce qui s’est avéré prodigieusement stupide car cela m’empêchait de relire l’interview dans son intégralité.
Jusque-là, je n’appréciais que modérément la musique du Velvet, à part quelques ballades comme « Stephanie Says » ou « Femme fatale ». Si j’avais demandé à Agathe une copie de sa cassette, c’était avant tout pour conserver un souvenir. C’est pour cette raison que je me suis mise à l’écouter à Villeneuve, le soir, assise devant la fenêtre donnant sur le périph et le Sacré-Cœur : je me sentais incroyablement seule. Perchée dans cette tour, alors que ma mère et mon beau-père, dans le salon, se câlinaient sur le canapé en regardant la télé (il y a quelque chose d’écœurant à voir sa mère se faire caresser la cuisse par un bonhomme), écouter le best of du Velvet me rapprochait de mes amies restées au pays.
« Pale Blue Eyes » m’avait toujours parue souffreteuse et monotone, j’aurais dit « neurasthénique » si j’avais connu le mot. Pourtant, ce soir-là en l’écoutant, l’émotion m’a serré la gorge. De grosses larmes se sont mises à jaillir de mes yeux comme d’un robinet. Curieusement, cela faisait du bien. Alors, la chanson finie, j’ai rembobiné la bande pour l’entendre à nouveau et continuer à pleurer. J’ai réécouté et réécouté cette chanson au moins dix fois, jusqu’à ce que mes yeux arrêtent de fuir. Ce dégât des eaux m’avait épuisée, mais je me sentais à présent soulagée.
Lou Reed l’a dit très jeune : il enregistre pour « ceux qui achètent le disque et partent l’écouter seuls dans leur chambre ». Il venait d’atteindre son but ; ses disques avaient durablement élu domicile entre mes quatre murs, en banlieue nord.
Des paroles, je comprenais seulement qu’il était question d’yeux bleu pâle. Aucune personne que j’aimais n’avait les yeux bleu pâle. Ça ne pouvait même pas s’adresser à moi, mes yeux sont marron. [D’après Reed, dans son livre Between Thought and Expression, la femme pour laquelle il a écrit cette chanson, et qui lui manquait beaucoup, avait les yeux… noisette. Il s’agissait probablement de Shelley Albin, son premier amour.] Cette chanson n’offrait aucune prise qui m’aurait permis de m’y identifier, pourtant elle provoquait un torrent de larmes salvatrices. D’où venaient-elles ? Probablement de la solitude. Du mal du pays. Ce ciel violet honni.
Ma mère affirmait qu’il fallait que je fasse repousser mes racines ailleurs. « Comme une bouture ? », ai-je demandé. « Oui, c’est à peu près ça. » Mais il n’y avait même pas de terre, à Villeneuve-la-putain-de-Garenne ! Même les arbres maigrelets qui poussaient le long du boulevard étaient contenus dans des cailloux verts et jaunes, incrustés dans le trottoir.
Ces instants nocturnes où je pleurais en écoutant « Pale Blue Eyes » sont devenus des moments privilégiés, après la rentrée des classes. Cette chanson a été la voie qui m’a menée progressivement à des morceaux plus expérimentaux. J’en suis même venue à adorer « All Tomorrow’s Parties » et « Heroin ». Le Velvet a été le premier groupe que j’ai vraiment aimé. Bien sûr, à cet âge, je n’entravais que couic aux paroles en anglais – et même si j’avais maîtrisé la langue, leur sens me serait resté opaque. Mais, et c’est là que réside la magie de la musique, je pense que j’ai compris, viscéralement, où le Velvet voulait en venir. J’étais alors totalement seule. J’écrivais de longues lettres à Agathe et Nathalie. Je n’avais réussi à me faire aucun ami dans mon nouveau collège. Les gens me trouvaient bizarre. C’était déjà souvent le cas en Moselle, mais ailleurs c’était pire, on n’avait même pas le même langage : j’étais trop cheloue. Personne ne voulait traîner avec moi, sauf Kadejah, une Mauritanienne mythomane qui se prétendait princesse (son père, héritier légitime, ayant fort logiquement renoncé au trône parce qu’il préférait habiter en HLM et envoyer sa fille étudier dans l’un des pires collèges de France). Elle disait aussi posséder un lionceau dans son appartement, comme animal de compagnie. Hormis elle, le Velvet était mon seul ami.
Le midi, je ne mangeais pas à la cantine. Ma mère n’était pas là, elle avait trouvé un emploi de secrétaire immobilier qui ne lui permettait pas de rentrer déjeuner à la maison, mais chaque soir elle me remplissait un Tupperware avec les restes du dîner, que je faisais réchauffer le lendemain midi. Environ une semaine après la rentrée, j’étais dans ma chambre en train d’écouter tranquillement « All Tomorrow’s Parties » en chantant par-dessus la bande, quand un gigantesque bruit d’explosion a retenti. Depuis ma fenêtre, j’ai vu une épaisse fumée noire et de hautes flammes sortir du toit de la tour d’à côté, celle avec les cafards. L’immeuble était en feu !!!
Il fallait se tirer de là, et vite. Sans céder à la panique, j’ai entrepris de sauver les objets les plus précieux avant de détaler me mettre à l’abri. J’ai donc réuni mes cassettes des Doors et du Velvet (il devait aussi y avoir le best of d’Abba et peut-être la BO de Dirty Dancing) dans une boîte, emporté mon Walkman, attrapé le chien par son collier, et je suis descendue par l’escalier jusqu’au parc, en bas, où étaient réunis les voisins, nez en l’air, regardant les flammes.
L’incendie, provoqué par l’explosion d’une bonbonne de gaz, a été maîtrisé au bout de deux heures. Les pompiers nous ont autorisés à remonter chez nous, l’appartement n’avait pas brûlé, ouf ! Cela dit, même si le feu avait dû le ravager, ça n’aurait pas été si grave : les cassettes étaient sauves.
C’est à cette occasion que j’ai appris ce qu’était une basse. Agathe m’a expliqué : c’est la grosse guitare à quatre cordes qui fait « toum toum toum » dans le fond.
Février 1994
J’ai passé le réveillon de Noël 1993 en Picardie, dans la famille de l’homme que j’appelais désormais mon beau-père. Je me les suis gelées sévère dans une église sentant le foin, où une pauvre jeune fille affublée d’un voile bleu et d’un poupon en plastique éternuait à n’en plus pouvoir, tandis qu’on contraignait un malheureux âne à rester en place pendant que le prêtre ânonnait son sermon (pas de bœuf en vue, ce devait être trop compliqué). La barbe de Joseph était collée de travers. Cette épreuve passée, toute la famille est rentrée en voiture dans le pavillon préfabriqué de la mère de mon beau-père pour déguster des huîtres, du foie gras de supermarché, une horrible bûche au beurre et autres tortures culinaires. Mais, sous le sapin, m’attendait un lecteur CD/double cassettes, ainsi que le LiveMCMXCIII du Velvet, l’album enregistré en public lors de leur récente reformation. Pour me faire plaisir, pendant le voyage du retour, mon beau-père a choisi de glisser mon nouveau disque dans l’autoradio. Je ne sais pourquoi il s’est emmêlé les pinceaux, mais il a mis le second CD, qui commençait par une version de « Hey, Mr. Rain » durant plus de quinze minutes. Ma mère et mon beau-père avaient coutume, en voiture, d’écouter Fredericks Goldman Jones ou Lionel Richie… autant dire que les longues expérimentations dissonantes du Velvet mettaient leurs nerfs à rude épreuve. Au bout de dix minutes ils n’en pouvaient plus ; ils ont stoppé rageusement le CD, déclarant que c’était pas Dieu possible d’écouter une vioule2 pareille.
Malgré cette mésaventure, j’ai réussi à persuader ma mère de m’emmener au Virgin Megastore des Champs-Élysées. Voilà comment le premier CD que j’ai acheté, avec l’argent reçu à Noël, a été White Light/White Heat. Depuis que Rock & Folk a lancé la rubrique « Mes disques à moi », dans laquelle le journaliste demande systématiquement à un artiste quel a été le premier disque qu’il a acheté, je rêve d’y figurer pour pouvoir fièrement répondre White Light/White Heat. (Sans compter qu’être interviewée dans le cadre de cette rubrique signifierait que je suis devenue un peu célèbre, ce qui ne serait pas pour me déplaire.) Mais cette réponse ne serait pas tout à fait honnête : techniquement, le premier disque compact que j’ai acheté a bien été White Light/White Heat, mais si l’on compte les cassettes, c’est moins glorieux… Avant cela, j’avais acheté quatre ou cinq cassettes des Doors, le Greatest Hits II de Queen et même, quand je devais avoir 8 ans, un album du groupe Début de Soirée. Il faut aussi prendre en compte le fait que j’ai acheté le deuxième Velvet par défaut : j’aurais préféré celui à la banane ou la compilation VU, mais ils n’étaient pas disponibles en rayon. Il aurait fallu passer commande auprès d’un vendeur, mais ma mère n’avait pas que ça à foutre, de revenir aux Champs-Élysées la semaine suivante. J’ai donc dû me contenter de ce qu’il y avait.
White Light/White Heat n’a rien d’un disque évident. Surtout quand on n’a pas encore soufflé ses 13 bougies. Pourtant, je ne me souviens pas avoir réagi de façon négative. J’aimais le côté crade, brouillon, du son. Cela me paraissait le summum du cool. En l’écoutant, seule sur la chaîne hi-fi du salon (pour ne rien perdre de sa qualité sonore), je me sentais grande, plus vieille que mon âge. J’ai immédiatement aimé « Lady Godiva’s Operation », dont j’essayais de jouer le riff sur la guitare classique que mon père m’avait, à ma demande, offerte pour Noël. L’instrument n’était pas accordé : je ne connaissais personne dans mon entourage qui sache accorder une guitare – sauf le grand frère d’Agathe, mais je ne le croisais presque jamais, et de toute façon j’aurais été trop intimidée pour le lui demander. Je parvenais tout de même, en tâtonnant, à jouer le riff de « Lady Godiva » et à reproduire à peu près le solo de « All Tomorrow’s Parties ». Là s’arrêtaient mes compétences guitaristiques. Elles sont restées bloquées là pendant de nombreuses années.
Pourtant, Lou Reed et plusieurs journalistes musicaux affirmaient qu’il était facile d’apprendre à jouer de la guitare. C’était écrit noir sur blanc dans Best et les Inrocks : trois accords basiques joués à l’arrache, voilà ce qu’était la musique du Velvet. A priori, tout le monde était capable de faire ça. Sauf moi.
C’est ce que je reproche aux musiciens : ils nous font croire que plaquer trois accords pour en faire une chanson, c’est terriblement facile. Le nombre de guitaristes, de Keith Richards aux meufs de L7, qui prétendent avoir appris à maîtriser leur instrument seuls, au feeling, sans prendre la moindre leçon… Ces gens mentent. Jouer du rock’n’roll sur une guitare classique désaccordée, quand personne ne vous a montré le moindre accord, ce n’est pas facile. OK, c’est sans doute beaucoup moins complexe que, je ne sais pas, jouer une symphonie de Mozart, obtenir un diplôme de chirurgien ou envoyer une fusée sur Mars… mais ce n’est pas facile. C’est pas un truc comme apprendre à nager, rouler à vélo ou faire ses lacets : ça fait très mal au bout des doigts, aux tendons et aux muscles de la paume, ça nécessite du temps, du boulot, de la patience et surtout quelqu’un qui vous explique les bases. J’ignorais cela. Je croyais sincèrement aux affirmations lues dans la presse musicale, j’étais persuadée que c’était à la portée de tout le monde, et que si je n’y arrivais pas, j’étais nulle. J’ai tout de même persévéré pendant un mois ou deux, composé une chanson intitulée « Highway Girl » qui ressemblait à « Here She Comes Now » en moins bien, et je l’ai enregistrée sur cassette. La fameuse phrase attribuée à Brian Eno, selon laquelle seules mille personnes ont acheté le premier album du Velvet à sa sortie mais que toutes ont, par la suite, fondé un groupe, s’est avérée dans mon cas. Enfin, disons que j’ai essayé. J’ai rédigé une petite annonce que j’ai demandé à ma mère de photocopier à son boulot, puis distribuée dans toutes les boîtes aux lettres de l’immeuble. Sans le moindre résultat, cela va sans dire. Je ne me souviens plus du texte exact, mais l’annonce se terminait par : « … former un groupe de rock pour faire comme les Beatles et le Velvet Underground. » Les Beatles, c’était au cas où les gens ne connaîtraient pas le Velvet. Un peu ambitieux tout de même, venant de quelqu’un qui ne savait pas du tout jouer de son instrument. La seule réponse que j’ai eue venait de la grande sœur de ma camarade de classe Lalaïna, qui possédait une guitare électrique et était fan des Guns N’Roses. Un groupe de merde, certes, mais avoir à mes côtés une fille capable de jouer pouvait être utile. D’après Lalaïna, sa sœur a jeté un bref coup d’œil à l’annonce puis l’a froissée en disant : « Pfff, laisse tomber. » Snobée par une fan de ces gros ploucs de Guns, j’ai effectivement lâché l’affaire.
La frangine hardos n’était pas la seule à me snober, loin s’en fallait. Au collège, ça ne s’arrangeait pas, au contraire. À la rentrée, j’avais été un peu bizutée – c’était normal pour une nouvelle. Toutefois, ne me connaissant pas encore, les autres m’avaient dans un premier temps laissé le bénéfice du doute ; ils devaient croire qu’à force de me faire insulter, j’allais finir par me révéler sympa. Kadejah, Lalaïna et deux autres filles, toutes plus ou moins parias car moches ou grosses ou trop petites ou simplement idiotes, me parlaient un peu – elles devaient avoir pitié de moi, car elles étaient seulement méprisées, tandis que moi, on me volait mes affaires, on me poussait dans les escaliers, on me faisait des croche-pattes, ce connard de Romuald m’appelait Suzette, me traitait de « vieille fille », hurlait des insultes à l’encontre de ma mère dans la cour de récré… Pourquoi traitait-il ma mère de pute ? Il ne l’avait jamais vue. Encore un truc que je ne pigeais pas, à Villeneuve : qu’est-ce qu’ils avaient tous à vouloir niquer les mères des autres ? Moi, si j’avais été un mec, je n’aurais pas eu envie de baiser ma génitrice ; je suppose que j’aurais préféré une fille plus jeune et plus jolie. Un matin, alors que Rudi était, une fois de plus, arrivé en retard en cours, prétextant une panne d’oreiller, la prof de maths lui a conseillé d’investir dans un réveil doté d’une sonnerie plus puissante. L’un des caïds de la classe a lancé : « Il a pas de réveil, c’est sa mère ! » et tout le monde s’est gondolé – sauf moi, qui ne voyais pas ce qu’il y avait de drôle.
Même les autres parias ont fini par ne plus me parler : me fréquenter attirait sur elles l’attention des tortionnaires. Pendant les récrés, trop fréquentes et longues à mon goût, j’essayais de rester à l’intérieur du bâtiment, assise dans l’escalier avec mon Walkman, mais souvent un pion me délogeait : « T’as pas le droit de rester là, va dans la cour t’amuser avec les autres. » Alors j’allais m’adosser contre un mur, seule, casque toujours sur les oreilles, et là, si c’était mon jour de chance on m’ignorait, sinon des gamins arrivaient en meute, me pointaient du doigt et hurlaient : « T’as pas d’amis ! » Parfois on m’arrachait mon casque, parfois on m’enlevait de force mon sac à dos, que soit on balançait quelques mètres plus loin, soit on ouvrait pour en disperser le contenu sur le sol. Je tendais la main pour ramasser ma trousse, et hop ! quelqu’un mettait un coup de pied dedans pour l’envoyer au loin, provoquant l’hilarité générale.
Je n’ai jamais pleuré. Même quand on m’a cogné la tête contre le mur, j’ai lutté pour retenir les larmes. Ma mère m’avait conseillé de ne pas leur répondre, ils finiraient par se lasser. Alors, sans un mot, je ramassais, priant pour qu’aucun surveillant ne vienne prendre ma défense, car alors ç’aurait été pire. Un jour, en salle de perm, ce connard de Romuald a tiré le cahier sur lequel j’étais en train d’écrire un poème et l’a fait passer à toute la classe. Ils se sont foutus de ma gueule des jours durant.
Je me suis mise à sécher les cours de l’après-midi. Rentrée chez moi pour déjeuner, je n’avais plus le courage d’y retourner. Chez moi j’étais bien, avec le Velvet. « Lady Godiva » était fascinante, surtout le moment où Lou Reed crache sèchement le mot « sweetly », lui donnant un sens opposé à celui qu’il est censé avoir : je reconnaissais bien là mon Loulou, toujours contrariant. Agathe m’avait expliqué que Lady Godiva était une noble anglaise d’il y a longtemps qui, pour protester contre la pauvreté dans laquelle son mari faisait vivre ses sujets, avait un jour défilé nue sur son cheval dans les rues du village. La mélodie avait, en effet, quelque chose de moyenâgeux. Et de planant à la fois. C’était un morceau si étrange, plein d’une violence rentrée… J’ignorais alors qu’il y était question d’électrochocs – un traumatisme dont Lou Reed était bien placé pour parler, lui qui, à l’adolescence, s’en est vu infliger des séances dans le but de le « guérir de ses penchants homosexuels ». Un thème récurrent dans ses chansons. Lui aussi avait eu une sale adolescence…
Je passais des heures à écrire à mes seules amies, Agathe et Nathalie, qui m’écrivaient en retour. Nath n’allait pas bien non plus. À son collège, elle vivait la même situation que moi. Sur le chemin de la maison, après les cours, les gamins ne la lâchaient pas : ils prenaient leur élan et couraient jusqu’à elle pour lui foutre des coups de pied au cul, ils lui tapaient dessus, elle pleurait, ça ne les arrêtait pas. J’avais assisté à cela, impuissante, raison pour laquelle moi, je ne pleurais pas : ça les faisait se sentir encore plus forts. Pendant les vacances de février, que j’avais passées en Lorraine, elle parlait souvent de la mort, du suicide. J’y pensais aussi.
Je suppose que tous ces après-midi passés seule chez moi, à écouter White Light/White Heat, lire les Best que j’achetais chaque mois, relire le hors-série Superstars des Inrocks, mon esprit tournait sur lui-même, en boucle. Je devais probablement devenir un peu dingue. Depuis le temps que parents et camarades me disaient que j’étais folle, il était logique que, pour me conformer à l’image qu’ils se faisaient, je finisse par le devenir. Je ne sais pas. Toujours est-il que le 15 mars 1994, peu après mon treizième anniversaire, rentrant du collège pour déjeuner, je n’ai pas supporté l’idée d’aller en sport l’après-midi. Les cours d’EPS étaient les pires. Ils fourmillaient d’occasions de violence gratuite, facile à faire passer inaperçue : on t’envoie le ballon en pleine tête et « oups, pardon, j’ai pas fait exprès ». Sans compter les vestiaires, les douches… et ces moments où tu dois présenter ton enchaînement de gym en public, et où les bruits de bouche incongrus fusent avant même que tu aies entamé la première roulade. Alors, au lieu de faire réchauffer au micro-ondes mon Tupperware de restes, je me suis servi un grand verre d’eau de Javel. Beuârk ! La première gorgée fut impossible à avaler, comme si le liquide dans ma bouche refusait de glisser plus bas. Je ne m’attendais pas à un goût agréable, mais là, c’était le pire truc que j’aie jamais eu dans la bouche, plus dégueulasse encore que du cérumen. Pour y remédier, j’ai versé une dose de sirop de menthe et mélangé à l’aide d’une touillette à cocktail volée chez Buffalo Grill. J’ai rassemblé toute ma volonté, pensé aux cours d’EPS et combien il était plus facile de se forcer à boire ce truc immonde que de supporter le collège pendant des années encore, et… impossible. Ça brûlait le palais. Je ne suis parvenue à ingurgiter que quelques gouttes.
OK, ai-je pensé en vidant le verre dans l’évier, l’eau de Javel était une mauvaise idée, mais ce n’était pas une raison pour rester en vie. Il y avait d’autres moyens… Tiens, récemment, au Monoprix, je m’étais trompée : croyant acheter du Tipp-Ex, j’avais en réalité pris du diluant à Tipp-Ex. Ne comprenant pas ce qu’était ce liquide incolore, j’avais lu l’étiquette, qui indiquait qu’inhaler ce produit « pouvait être fatal ». J’ai donc versé le contenu du flacon dans un bol et j’ai inhalé. L’odeur était agréable, comme peut l’être celle de l’essence ou de l’alcool à brûler. La tête m’a tourné, j’ai été défoncée pendant un court instant. Bien des années plus tard, lors d’une fête, on m’a fait passer un flacon de poppers ; j’ai immédiatement reconnu l’odeur familière, qui m’a renvoyée à mes 13 ans. Je pense qu’il s’agit du même produit. Bref, j’ai inhalé, inhalé, c’était vraiment cool mais je n’étais toujours pas morte. Au bout d’une heure, j’ai dû me rendre à l’évidence : ce produit était moins toxique que ne le promettait l’étiquette.
Restait l’armoire à pharmacie. Ni ma mère ni mon beau-père ne prenaient de médicaments sérieux – somnifères ou antidépresseurs. J’ai donc dû me contenter des trucs habituels, Doliprane, Spasfon et Siligaz (des gélules orange contre les ballonnements, qui provoquent des flatulences pour évacuer l’air en cas de crise d’aérophagie). J’ai tout pris et je me suis mise au lit, attendant la mort en pleurant parce que quand même, je trouvais ça dommage à présent, partir comme ça, sans avoir jamais rien connu de chouette. Mais je dois avouer que le côté tragique de la chose me séduisait. Mes larmes n’étaient pas douloureuses, c’était plutôt du soulagement. Au bout d’un long moment, j’ai fini par sombrer dans le sommeil.
Le bruit de la porte d’entrée m’a réveillée. Mon beau-père a réagi lentement en me trouvant au lit, comme s’il réfléchissait avant de me demander ce que je faisais là, à cette heure-ci. Il est resté calme, il a lu les notices des médicaments avalés, et a estimé que je ne courais aucun danger. Il s’est assis sur ma chaise de bureau et on a parlé. Cotonneuse comme je l’étais, je ne me souviens pas de l’intégralité de notre conversation, juste qu’il a secoué la tête, soupiré et dit que j’avais vraiment rien dans le crâne, on n’a pas idée de faire des trucs pareils. Il m’a aussi expliqué qu’il valait mieux ne rien dire à ma mère pour ne pas l’inquiéter. « Elle va t’engueuler, sinon. » Ça, je n’en doutais guère. J’ai donc jugé que c’était mieux ainsi, et promis de fermer ma gueule. Il a rempli un billet d’absence pour le collège. J’ignore s’il avait conscience qu’en taisant la vérité à ma mère, il la protégeait à mon détriment. Si elle avait su que j’avais tenté de me tuer, ça aurait pu débloquer la situation, j’aurais peut-être pu bénéficier d’un suivi psychologique qui m’aurait aidée… Mais il était amoureux d’elle ; ce qui comptait, c’était de ne pas la faire souffrir. Comme si j’avais décidé de mourir sans raison.
Pour dîner, ma mère a fait des frites. Elles étaient bonnes. À ses questions habituelles, j’ai répondu que oui, oui, ça s’était bien passé à l’école… Après avoir essuyé la vaisselle comme tous les soirs, je suis allée me coucher, crevée. Pour me réveiller une heure plus tard, me précipiter aux toilettes et vomir. Ce qui a inquiété ma mère ; peut-être une indigestion, mangé trop de frites ? Ou une gastro, le virus traînait en ce moment… Elle s’est montrée plus gentille avec moi ce soir-là qu’elle ne l’avait été depuis longtemps, s’asseyant sur mon lit et tenant la bassine pendant que je continuais à vomir régulièrement, toutes les dix minutes environ. Les morceaux de cachets blancs, bien visibles au fond du récipient qu’elle allait régulièrement vider et désinfecter à l’eau de Javel, ne lui ont pas mis la puce à l’oreille. Lorsqu’on ne veut pas savoir, on a beau avoir la vérité sous les yeux, dans le vomi, on ne la voit pas.
Le lendemain, rétablie, j’ai dû retourner au collège.
Littéralement, orgue de barbarie en patois lorrain. Dans la bouche de ma mère, ça signifiait plutôt bruit insupportable.
Avril 1994
Rentrée en Lorraine pour les vacances de Pâques, je suis allée rendre visite à Nathalie mais j’ai trouvé la porte et les volets clos. La maison semblait dormir. Agathe avait essayé de l’appeler plusieurs fois, le téléphone sonnait dans le vide. Nous étions inquiètes, notre copine nous aurait prévenues si elle était partie en vacances… Trois jours plus tard, on a appris qu’elle était hospitalisée. Elle venait de sortir de deux jours de coma après avoir avalé une boîte de tranquillisants.
On n’a pas pu aller la voir tout de suite, il fallait attendre que les parents d’Agathe nous y emmènent en voiture, Nancy était à plus d’une heure de route. Là-bas, dans l’aile psychiatrique du CHRU Brabois, nous avons découvert une Nath ralentie, vautrée sur son lit, plus drôle du tout, répétant en boucle qu’elle voulait recommencer. Sa mère, une bonne femme hystérique et un peu simplette, paraissait avoir pris vingt ans, avec ses cernes bleues et son visage creusé. À ses yeux, nous n’étions pas les bienvenues. De mauvaises fréquentations qui mettaient des idées noires dans la tête de sa fille. Ben voyons ! Sans nous, sans nos rigolades et notre amitié, elle se serait sans doute flinguée plus tôt. Et la musique qu’on écoutait… elle aussi avait bon dos. De la musique de drogués, morbide, malsaine. Ma mère aussi détestait le Velvet : « Tu craches sur la dance music qu’écoutent tous les jeunes de ton âge, m’avait-elle dit un jour, mais au moins c’est de la musique entraînante, ça te sortirait un peu de tes idées lugubres. »
Si la mère de Nathalie avait cessé de hurler en permanence sur ses gosses et son mari, si les gamins du collège n’en avaient pas fait leur souffre-douleur, Jim Morrison, Lou Reed et Nico auraient pu s’époumoner tout ce qu’ils savaient, mon amie n’aurait pas avalé de médicaments. Au contraire, quand on souffre, la musique de gens qui souffrent également procure un certain réconfort. Mais il est bien pratique d’accuser la musique ou de mauvaises fréquentations : ça évite de se remettre en question.
Le lit voisin était occupé par une fille dure, une fugueuse qui disait traîner avec des mecs plus âgés, des sortes de voyous. Extravertie, grande gueule, elle s’immisçait dans nos conversations pour parler d’elle. De temps à autre, des patients occupant les chambres voisines passaient voir Nath pour discuter cinq minutes ; je me souviens d’un gars très costaud d’environ 18 ans, attardé mental, venu nous montrer fièrement un livre pour enfant, Mon copain chien. Mon Dieu, elle était vraiment chez les dingues !… Flippant. Ils me mettaient mal à l’aise. Et je ne voyais pas en quoi rester enfermée un mois avec des débiles et des paumés pouvait l’aider à aller mieux.
En comparaison, mon suicide au Siligaz ressemblait à une blague. Nath, elle, avait fait un truc sérieux. Mon beau-père avait peut-être raison, mon geste avait été ridicule, et en le taisant il m’avait évité de me retrouver dans un tel endroit. Je ne l’en ai jamais remercié ; j’aurais dû. En tout cas, mesurer les conséquences d’une véritable TS m’a ôté toute envie de recommencer.
Nous sommes allées voir Nathalie deux fois, puis j’ai dû rentrer à Villeneuve. Agathe, elle, y est retournée à maintes reprises. Puis ils ont laissé sortir mon amie, j’ai passé pas mal de temps avec elle durant les vacances d’été, mais quelque chose était cassé. Après la case HP, Nath n’a plus été la même. Rien de ce que nous lui disions ne semblait l’atteindre, elle riait rarement, s’est éloignée progressivement. Je l’ai parfois croisée pendant les années qui ont suivi, mais ce qui nous avait liées au collège était mort. Peut-être deux jours de coma avaient-ils pété un truc en elle, peut-être était-ce les antidépresseurs, les psy, l’internement… On ne le saura sans doute jamais, et y penser me rend triste.
Agathe et moi, on était sonnées. Pourtant, le geste de Nathalie a eu pour effet de nous rapprocher. Cela nous a poussées à nous parler réellement, pas seulement glousser à propos de mecs qu’on trouvait mignons, mais échanger nos points de vue et nos pensées intimes. Malgré le drame, durant ces vacances, je me suis sentie mieux que depuis longtemps : je n’étais plus seule. J’avais une amie, une vraie, qui m’écoutait, essayait de me comprendre et me soutenait. Elle était intelligente et drôle, possédait des fringues excentriques trop classes et savait les associer, les combiner avec des accessoires et du maquillage de manière à avoir le look le plus cool de toute la Lorraine. Je n’en revenais pas que cette fille plus âgée, plus cultivée et plus belle que moi m’ait élue comme amie. Je peinais à comprendre pourquoi elle me trouvait si marrante, mais comme je la faisais rire (involontairement, le plus souvent), je me mis à cultiver mon humour, à en faire trop parfois. Je redoutais le moment où elle se rendrait compte de sa méprise et se détournerait de la plouque que j’étais ; je me tenais en équilibre sur une corde tendue entre la joie que me procurait son amitié et la certitude que celle-ci prendrait fin le jour où Agathe s’apercevrait de mon imposture ou rencontrerait une autre amie réellement intéressante.
Le dernier samedi des vacances, je l’ai accompagnée au Leclerc où elle voulait acheter le dernier Rock & Folk. On s’est ensuite posées sur un banc à la sortie du supermarché pour feuilleter le magazine. Un rouquin au pull plein de trous était en couverture : Johnny Rotten. Les premières pages, sur fond jaune, annonçaient la mort de Kurt Cobain. Le suicide était décidément en vogue, ces temps-ci… Je n’avais jamais entendu le moindre titre de Nirvana, mais j’avais lu une interview du groupe dans Best, l’automne précédent, pour la sortie d’In Utero, où figurait une photo montrant ce mec blond pointant le canon d’un fusil dans sa bouche. Apprendre qu’il venait de se flinguer ne m’a donc pas étonnée outre mesure. Quelques pages plus loin, Agathe a attiré mon attention sur un article illustré par des photos montrant des filles qui se livraient en riant à une bataille de boules de neige. Le papier s’intitulait « Ex-femme des Pixies » et parlait des Breeders. Mon amie m’a expliqué, montrant du doigt Kim Deal : « Avant, cette fille était la bassiste des Pixies, un groupe que mon frère aime bien, il m’a fait écouter, c’est supra cool ! Ils ont splitté, et elle a formé un nouveau groupe, The Breeders [elle prononçait “Bwiiidowz”], où elle chante et joue de la guitare. »
Le lendemain, dimanche, mon beau-père et ma mère m’ont traînée à la fête des jonquilles, à Gérardmer dans les Vosges, où je me suis fait chier comme un rat mort quand il pleut quinze jours de suite. Regarder défiler des chars recouverts de fleurs jaunes, tu parles si ça m’intéressait… Sur le chemin du retour, fait rare, je n’écoutais pas mon Walkman (les piles devaient être nazes). Fait encore plus rare, la radio a diffusé une chanson que j’ai immédiatement adorée. Je me suis redressée à l’arrière de l’Opel, ai passé la tête entre les deux sièges avant en espérant que l’écran digital indiquerait l’artiste ou le titre. « Ben qu’est-ce qu’il y a ? a demandé ma mère.
— Rien, je voulais juste savoir qui chante cette chanson.
— C’est le groupe du mec qui s’est suicidé il y a quelques jours », a déclaré mon beau-père. Nirvana, donc. Bizarre, c’était une voix féminine – douce et agréable, que j’ai aimée tout de suite. Cependant, l’interview que j’avais lue dans Best révélait un Kurt Cobain féministe. Et puis Nico chantait sur certains titres du Velvet, la batteuse Moe Tucker aussi… Il était donc tout à fait possible que Cobain ait invité une de ses copines (ou sa femme Courtney Love, peut-être ?) à chanter sur l’un de ses morceaux.
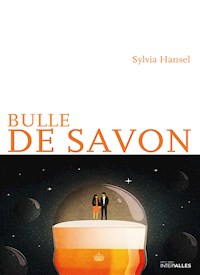














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













