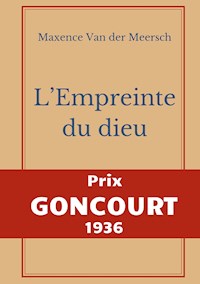1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Invasion 14 est un roman de Maxence Van der Meersch, publié en 1935.
Comme son nom l'indique, le roman retrace les années d'occupation allemande dans le Nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est un roman fresque aux personnages multiples qui s'inspire de témoignages, d'anecdotes et de faits réels recueillis par l'écrivain lors de l'occupation partielle de la France par l'armée allemande...|Wikipedia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SOMMAIRE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Postface
MAXENCE VAN DER MEERSCH
CAR ILS NE SAVENT PAS CE QU'ILS FONT...
1933
Raanan Éditeur
Livre 1023 | édition 1
Avant de juger ce livre, lecteur, attends de l’avoir achevé, sans omettre les quelques pensées qu’a inspirées le héros à son auteur, dix ans après sa création. L’usage aurait voulu qu’on les trouvât dans une préface. Mais qui lit encore les préfaces ! Du reste, il m’a toujours semblé peu logique de parler d’un livre que le lecteur n’a pas encore parcouru. C’est pourquoi on trouvera à la fin de ce volume les réflexions que j’ai cru bon d’adjoindre à ce récit, à l’occasion de sa réédition.
M.V.D.M.
I
J’arrivai au Mont-Noir, cette année-là, avant l’époque habituelle des vacances.
Une crise d’appendicite m’avait obligé d’interrompre mes cours au collège d’Armentières, où je suis professeur de lettres. Et quand je quittai la clinique où l’on m’avait débarrassé d’un accessoire viscéral encombrant et, paraît-il, totalement superflu, je jugeai inutile de reprendre des classes que les vacances arrêteraient de nouveau quinze jours plus tard. Les médecins d’ailleurs me recommandaient le repos et le grand air.
Mais le budget d’un professeur débutant ne permet pas de coûteuses villégiatures. Je dus laisser ma femme chez ses parents, où d’ordinaire nous passions le mois d’août. Et je partis seul pour le Mont-Noir.
L’endroit me plaît. C’est une éminence boisée, faite d’un sable roussâtre et ferrugineux, aggloméré en concrétions semblables à des caillots de sang séché. Des sablonnières entaillent ses flancs. Il touche à la frontière belge, fait partie de cette chaîne de buttes qui jalonnent la Flandre maritime : Kemmel, Mont-Rouge, Mont-Noir, Mont-Descats, Mont-de-Cassel, Mont-des-Récollets. La guerre, sur l’un des versants au moins, a respecté les bois qui lui donnent son aspect sévère et son nom. C’est un lieu de vacances et de promenade pour les amateurs de solitude et de tranquillité.
Au pied du mont est un village, Saint-Jans’Cappel, sur la route de Bailleul. De là, on accède au mont par deux routes. L’une, plus longue mais plus praticable, contourne la butte. L’autre, raide et mal entretenue, monte directement en passant par un cimetière de soldats anglais que, faute de mieux, les hôtes du Mont-Noir prennent pour but d’excursion.
Dans ce pays totalement dépourvu de toute espèce de distraction, j’eus vite fait l’inventaire des ressources qui m’étaient offertes contre l’ennui. J’avais la possibilité de longues promenades parmi des bois pittoresques, sur les flancs du mont. On contemplait de là un paysage sans limite. J’avais la lecture et le travail de préparation de mes cours. En fait d’excursion, j’eus vite découvert le « Military cemetery », ainsi que, de l’autre côté du mont, un préventorium, au milieu d’un vallon qui rappelait assez les collines de Normandie.
Tout aussi pauvre était l’hôtel en fait de distractions. Une enseigne vaniteuse tentait bien de faire illusion sur la qualité de son hospitalité en le baptisant emphatiquement du titre de « Grand Hôtel-Restaurant du Mont-Noir ». Mais, à vrai dire, ce n’était qu’une grande auberge. Le café, la salle à manger, n’évoquaient aucune idée de luxe. Et une propreté saine, de claires fenêtres, des peintures fraîches égayaient seules la simplicité nue des chambres.
Je ne rencontrai là qu’un groupe de sept ou huit dames, de mise et d’allures effacées, à qui devaient convenir les tarifs modestes de l’hôtel. Femmes d’employés, de petits fonctionnaires, elles usaient le temps à bavarder, à jouer de l’aiguille et des doigts sur des tricots et des broderies, tout en surveillant une bande d’enfants qui traînaient dans le sable ou vagabondaient dans les buissons. Ces braves gens trouvaient tout leur contentement dans cette tranquillité.
Le soir, après le souper, on s’attardait encore dans la salle de restaurant, transformée pour l’heure en salon. Quelqu’un tourmentait l’appareil de T. S. F., ou bien une fillette s’exerçait sur le piano. On jouait aux cartes, aux dames On buvait du tilleul ou du café. Je retrouvais là l’atmosphère d’intimité quelque peu somnolente des bourgeoises soirées de ma jeunesse.
Des étrangers, parfois, – promeneurs, touristes, ou bien habitants des quelques chalets du mont – venaient souper et passer la soirée à l’auberge. Très vite, ils nous devenaient familiers. Sylvie, la petite servante, savait, dès qu’ils étaient entrés, quelle boisson, quel journal, quel jeu elle devait apporter à leur table. Entre tous, je remarquai bientôt un homme de trente à quarante ans, grand et maigre, l’air malade, qui venait quelquefois écouter nos conversations et nos essais de concerts, sans toutefois s’y mêler jamais. Car il paraissait taciturne et quelque peu chagrin.
Certains soirs, on le voyait ainsi arriver. Il entrait sans rien dire. Quelque temps qu’il fît, il ôtait son chapeau et s’essuyait le front, comme s’il avait eu chaud. Et il allait s’asseoir dans une bergère d’osier, toujours la même, auprès du piano.
Cet isolement où il se plaisait me semblait inspiré moins par un tempérament aigri que par une espèce de gêne et de timidité qui l’empêchait de se lier à nous.
Sans que je comprisse pourquoi, une sorte d’attirance me faisait trouver en cet homme un type intéressant. J’avais l’impression, vaguement, de le reconnaître. J’aurais juré l’avoir déjà rencontré. Mais c’est inutilement que je fouillai dans mes souvenirs. Rien de précis ne confirmait cette impression de déjà vu.
Ce devait être un étrange caractère. J’interrogeai Sylvie, la servante, sur la vie qu’il menait. Les détails qu’elle me donna me confirmèrent dans l’opinion que j’avais affaire à un misanthrope ou à un grand timide. Il demeurait dans un petit chalet qu’il avait loué depuis sept ou huit mois, sur le versant sud du mont. Il vivait là, tout seul. Jamais il n’était venu manger à l’hôtel. Seulement, deux fois par jour, il se faisait apporter ses repas chez lui par Sylvie.
Volontiers, j’aurais vu naître entre cet homme et moi les premiers germes d’une amitié. Je me sentais quelque peu isolé, dans le milieu où je vivais. Je craignais que, parmi ces gens, aimables sans doute, mais très différents des étudiants et des intellectuels au milieu desquels j’avais passé tout mon temps jusqu’à ce jour, l’ennui ne me saisît bientôt. Cet homme me plaisait, m’attirait par je ne sais quoi de singulier et de frappant. Il était de haute taille, décharné ; sous le hâle qui bronzait son épiderme, on devinait l’atteinte d’une maladie cachée. Car le bistre des yeux et la saillie des pommettes, accusant le ravage des joues, décelaient quelque mal profond. Aux heures de fatigue, ou seulement d’inattention, une voussure lui courbait la nuque, lui affaissait les épaules comme sous une invisible charge. Il portait habituellement de lourds vêtements, d’amples pardessus à gros boutons, de hautes guêtres, qui lui donnaient une apparence vaguement militaire, et dissimulaient sa maigreur. Sur cette masse d’étoffes et de lainages, sa tête paraissait toute petite. Au milieu de son long cou mince, la pomme d’Adam faisait une saillie anguleuse. Derrière, les deux tendons de la nuque ressortaient, laissaient entre eux un creux profond. Ses cheveux longs et bruns, mais blanchissant déjà, clairsemés sur le front et les tempes, lui faisaient une tête de penseur ou de savant. De grosses veines bosselaient ce front hâlé, couleur d’ivoire. Souvent, d’un geste machinal, il passait le doigt sur ces veines, en suivait le cours du bout de l’index. Des tempes vers le menton descendait un collier de barbe courte et raide, emmêlée de poils noirs et roux. Laide à voir, elle complétait cependant cette étrange apparence, et convenait, malgré sa singularité, à la tête qu’elle ornait. Rare et peu fournie, plus semblable même à du crin qu’à du poil humain, elle laissait voir au travers, nu sous la peau, l’os mince du maxillaire, terminé par un menton aigu et saillant. De loin, ce détail s’effaçait, on ne voyait que l’ombre de la barbe, et on avait une impression générale de gravité, de force et d’âge. Mais plus près, ce collier de barbe laissait deviner les traits véritables. Et il me semblait lire dans l’acuité et la finesse du menton, dans la délicatesse des os, dans je ne sais quoi d’incertain et d’inquiet qu’avait le regard bleu, une certaine débilité, une nervosité maladive. Son front était coupé d’une double ride. Non pas de ces courtes barres verticales qu’imprime entre les sourcils un labeur assidu, mais de ces longues lignes horizontales qui sont là marque des soucis. Ses tempes grisonnaient. Et malgré tout, une fois oubliée cette impression du début, j’en arrivai à me dire qu’il devait être jeune, n’avoir pas de beaucoup dépassé la trentaine.
Je devinais qu’il était riche, à certains réflexes d’orgueil, à quelque chose de hautain qu’il avait parfois, en dépit de son évidente timidité. Sa tenue d’ailleurs, souvent négligée, n’en révélait pas moins le bon faiseur et les étoffes de la meilleure qualité. Et ses belles mains, fines et frêles, indiquaient le cérébral, bien plus que le travailleur manuel. Elles étaient démesurément longues et nerveuses, comme des mains de femme Mais les ongles, négligés et rognés, tachés de ces marques blanches qui sont un signe de déminéralisation, enlaidissaient l’extrémité des doigts. Fréquemment – et surtout lorsqu’une préoccupation lui travaillait l’esprit – il les grignotait du bout des dents, ce qui m’était un nouvel indice d’un certain déséquilibre nerveux. Ses poignets minces et maigres, dont les os se devinaient en saillies légères sous la peau, étaient recouverts de longs poils noirs, qui me rappelaient vaguement le pelage d’une bête.
Jamais je ne le vis rire. Quelquefois seulement, il souriait, et d’un sourire sans gaieté. Sans doute ne trouvait-il pas, au milieu de nous, la distraction qu’il venait y chercher.
J’eus, quelques jours après mon arrivée, la surprise agréable de revoir ma femme. Elle avait profité du voyage d’un ami à Dunkerque pour se faire amener en auto jusqu’au Mont-Noir. L’étranger nous aperçut ensemble, et, de cet instant, parut s’intéresser davantage à moi.
Les jours suivants, le hasard, à diverses reprises, nous fournit l’occasion d’échanger quelques mots. Mais je n’en profitai pas outre mesure, pour ne point paraître rechercher cette familiarité que je désirais.
Vouloir m’imposer me ferait perdre sûrement le peu d’avance que j’avais prise en cette voie.
Pourtant, tel quel, singulier, bizarre, d’humeur sombre et inégale, cet homme me plaisait grandement. Par malheur, si on excepte ces quelques politesses, il ne manifesta jamais d’aucune façon le désir de ce rapprochement que je souhaitais. Jamais il ne s’enquit de mon nom, ni ne m’apprit le sien.
Je devais pourtant être conduit, par la fortune, à m’occuper, presque de force, de l’existence de ce misanthrope.
Un soir, à mon ordinaire, je m’étais attardé dans la salle de restaurant, écoutant le concert que nous offrait une jeune pianiste plus zélée que talentueuse. Sylvie, la petite servante, qui avait la charge des repas de l’inconnu, était partie depuis un bon quart d’heure, portant sous le bras son panier enveloppé d’une serviette.
Brusquement, nous la vîmes revenir en courant. Elle avait l’air fort émue.
– Le monsieur est tombé malade, cria-t-elle en entrant.
Un brouhaha interrompit le concert. On se leva, on entoura Sylvie.
– On dirait qu’il est mort, expliqua-t-elle. Je l’ai vu juste en arrivant, il est tout blanc, tout raide sur sa chaise… J’ai eu peur ! Mon Dieu que j’ai eu peur !
– Il faudrait un médecin, dit une dame.
On se regarda. Une femme ne pouvait penser à faire à pied, de nuit, le chemin de Bailleul. Le patron de l’auberge, un vieil homme, souffrait de rhumatismes. Je compris qu’on attendait de moi l’acte d’obligeance que j’étais seul en mesure d’accomplir. Avouerai-je – l’homme est ainsi fait – que je saisis avec quelque empressement cette occasion de contenter une curiosité insatisfaite ?
– Menez-moi là-bas tout de suite, dis-je à Sylvie.
Et je suivis la petite bonne.
En dix minutes, nous atteignîmes le chalet. Nous entrâmes dans la première pièce. C’était une sorte de salle à manger, meublée très sommairement de lourds meubles de chêne ciré. Les murs blanchis à la chaux, la cheminée de briques rouges, l’absence de tout ornement, donnaient à cette pièce un aspect austère et presque monacal.
Près de la cheminée, affalé dans une cathèdre de genre ancien, à haut dossier, je vis l’homme. Il était en syncope, livide, les yeux clos. À bon droit, Sylvie l’avait pu croire mort.
Je courus à lui, l’allongeai sur le sol, ouvris le col de sa robe de chambre en gros drap. Un peu de vinaigre que je trouvai dans le carafon d’un huilier l’aida à revenir à lui. Il me reconnut en ouvrant les yeux et voulut se lever. Mais cet effort l’épuisa. De nouveau ses traits se décomposèrent.
– Il va retomber, dit Sylvie.
– Oui. Portons-le.
Il nous fallut, Sylvie et moi, le transporter à plat, doucement, sur son lit, où nous l’allongeâmes. Il était à la fois dans un état de faiblesse et de nervosité extraordinaires. À chaque instant, la tête lui tournait, il était menacé d’une nouvelle défaillance.
J’eus avec Sylvie une courte délibération. Il était impossible de téléphoner au docteur ce soir, la cabine téléphonique n’étant plus reliée après huit heures. Mais, par ailleurs, le malade nous inspirait une vive inquiétude. Il n’est pas si rare de voir une syncope emporter son homme. Il fallait de toute nécessité, et le plus tôt possible, l’examen d’un docteur.
– Il n’y en a pas un à Saint-Jans’-Cappel ? demandai-je.
– Non, m’expliqua la petite servante. Il faut aller jusqu’à Bailleul. Vous pourriez peut-être prendre le vélo à l’hôtel ?
– Cet homme ne peut demeurer ici tout seul. Vous aller rester pendant que je serai parti ?
– Je vous attendrai.
Elle se mit en devoir d’allumer un peu de feu, car malgré la douceur du soir le malade frissonnait de tout le corps. Et je revins à l’hôtel, où j’empruntai la bicyclette du patron.
Je n’étais encore qu’un convalescent. Pourtant je dévalai le mont à toutes pédales. Un quart d’heure me suffit pour parcourir les cinq kilomètres qui séparent le Mont-Noir de Bailleul.
Chez le docteur, je sonnai. L’homme qui vint m’ouvrir m’expliqua que le docteur était parti pour un accouchement.
– Mais on va le prévenir, dit-il, sans faute. Il viendra aussitôt qu’il aura fini.
Un peu rassuré, je revins plus lentement vers le Mont-Noir.
La nuit était tout à fait tombée, quand j’atteignis les premières rampes. Et, sans lanterne, je dus descendre de vélo, et faire l’ascension à pied, craignant de dégringoler en quelque fossé. J’eus du mal, en cette obscurité, à retrouver le chalet. Par bonheur, une vive clarté rouge me le révéla tout à coup, à travers les arbres, à cent mètres de moi, au moment où je commençais à désespérer de retrouver mon chemin.
Sylvie, ne me voyant pas rentrer, était venue sur le seuil de sa porte, sa lampe à la main.
– Comment va-t-il ? demandai-je.
– Toujours de même. Il ne dort pas, il attend. Il a encore voulu se lever, mais il est « retombé drôle » tout de suite.
– Le médecin va venir tout à l’heure.
– Vous allez l’attendre ?
– Oui.
– Alors, peut-être que je pourrais retourner. J’ai ma vaisselle à finir.
– Sans doute. Je passerai la nuit ici. Vous n’avez pas peur de l’obscurité ?
– Oh ! non, je connais bien le bois.
Sylvie sortit. J’entrai dans la chambre, m’approchai du lit. Le malade sommeillait. Ce me parut de bon augure.
Je revins dans la première pièce, m’assis dans une bergère, cherchai des yeux un journal, quelque chose qui pût me distraire en attendant le médecin. Je vis sur les rayons d’une étagère quelques volumes empilés. Je me relevai, allai les feuilleter. « Dis-moi qui tu hantes… » Le choix des lectures de cet inconnu me révélerait peut-être son caractère.
Par malheur, la singularité de cette bibliothèque me déconcerta sans rien m’apprendre. Là voisinaient pêle-mêle les œuvres d’Alexandre Dumas, de Tacite, de Lucrèce et de Paul Féval. J’ouvris des livres aux titres austères : La Science expérimentale, de Claude Bernard ; Le Transformisme, par le Pr Vialleton, de nombreux volumes d’histoire, des recueils de poètes latins. Et, à côté, je tombai sur des romans policiers, des feuilletons, des aventures de cape et d’épée. Rien de moyen. Ni romans sérieux, ni ouvrages de vulgarisation. Seulement des livres de science pure, ou bien des romans-feuilletons. Après l’examen de cette bibliothèque, j’étais encore moins renseigné qu’auparavant.
Si bien que je me demandai, ne pouvant admettre que le même homme s’intéressât à la fois aux œuvres de Malthus et d’Ausone, et aux gasconnades de Lagardère :
– N’y a-t-il pas deux habitants dans ce chalet ? Si ces livres n’appartiennent pas au malade, pourquoi les aurait-il apportés avec lui ?
J’avais replacé tous les livres sur l’étagère. Et je continuai mes investigations. Des livres, des gravures, sont en quelque sorte offerts en pâture aux visiteurs. Et je n’estimais pas commettre un acte d’indiscrétion : je ne prenais connaissance que de ce que l’on avait jugé bon de ne pas cacher.
Mais aux murs, sur les meubles, je ne trouvai aucun portrait, aucune photographie qui pût me renseigner sur la famille et les attaches que laissait derrière lui cet homme. Il n’y avait rien. Même sur le bureau, un meuble en chêne de style ancien, je cherchai vainement un de ces petits cadres où l’on aime glisser l’image d’un être cher, pour y poser parfois le regard, en relevant la tête de son travail.
Pourtant, c’est sur ce bureau que je fis une découverte. Je vis là un gros dictionnaire, un « Riemann et Goelzer », qui me rappela brusquement le souvenir de mes années de lycée. Je le pris, l’ouvris machinalement. Et sur la page de garde, je lus, écrit en une grande écriture nerveuse et laide :
« Blaise Rameau, Lycée de Lille. »
– Par exemple ! dis-je tout haut, tant était grand mon étonnement.
C’est que, tout à coup, je me souvenais. Rameau ! Rameau ! Je comprenais maintenant l’intérêt confus que je portais à cet homme. Il m’avait bien semblé, vaguement, le reconnaître et les souvenirs, brusquement, me revenaient en foule. Eh quoi ! c’était lui, Rameau, ce Rameau dont, au temps de ma sixième, le lycée de Lille était tout bruissant. J’entrais seulement au bahut, à cette époque. Et Rameau finissait son année de philosophie. Lui ne m’avait pas connu. J’étais, pour ce « grand », perdu dans la foule des « petits ». Mais moi, j’avais pour Rameau, le grand Rameau, les sentiments d’admiration, de vénération, que professait le lycée tout entier. C’était l’aigle, le futur grand homme de la maison, le triomphateur de toutes les compétitions, le lauréat de tous les concours. On citait de lui des histoires étonnantes, qui, bien longtemps après son départ, continuèrent à circuler comme une légende respectueuse. Plusieurs fois, dans les premiers temps de son arrivée, il avait été suspecté, interrogé, « cuisiné » par ses professeurs, certains qu’il copiait ses devoirs dans les livres. Plus tard seulement on avait reconnu sa sincérité. Un professeur de troisième ayant donné en devoir une pièce de vers à composer, un élève à court de lyrisme était allé implorer Rameau, alors rhétoricien, lui demandant de lui fabriquer ses vers. Et le professeur, le jour de la correction, avait déclaré :
– Vous avez dû trouver ces vers quelque part chez Victor Hugo…
De telles histoires auréolaient d’une renommée glorieuse notre grand camarade. Quand il passait dans la cour des petits, une clameur montait autour de lui. C’est qu’il était par-dessus tout aimable et obligeant, complètement dépourvu de cette prétention qui gâte trop souvent le mérite des bons élèves. Il n’hésitait jamais à jouer son rôle dans un chahut, à risquer une retenue en allant dénicher nos ballons dans les gouttières, à prendre part à quelque fumerie collective dans la « cagna » où nous serrions nos raquettes et nos filets de tennis. Pas un élève, dans tout le lycée, qui n’eût eu recours à lui pour résoudre les difficultés d’une version latine ou d’un thème anglais. Grand et leste, rapide à la course et dribbler incomparable, il était enfin – last but not least – avant-centre et capitaine de notre première équipe de football.
On le disait de famille fort riche. Il était toujours très proprement et très soigneusement vêtu, d’une mise coquette et fraîche, qui sentait la maman vigilante et amoureuse de son garçon. La dernière image que j’avais gardée de lui – il avait alors dix-huit ans et allait quitter le lycée – c’était celle d’un jeune homme élancé et svelte, toujours gai, le front haut, les yeux francs, les narines ouvertes et mobiles, la bouche rieuse, les cheveux bruns, légèrement bouclés, et rejetés en arrière. Tout en lui respirait une sorte de fière indépendance, une crânerie qui ne déplaisait pas. Été comme hiver, il portait, non pas l’uniforme inélégant du lycée, mais des vêtements de coupe nette, des chemises à grand col ouvert, dont la blancheur éclairait d’un frais reflet son jeune visage joyeux, des souliers de cuir jaune tranchant sur des bas de sport, et, campé sur l’oreille, fantaisiste et instable, un béret basque bleu marine qui lui faisait une tête d’artiste insouciant et casseur d’assiettes. Cette belle assurance d’allure donnait à tous ses gestes, à tous ses mots, une hardiesse agréable, qu’on sentait franche et dépourvue de toute morgue. Il allait vers l’avenir avec la certitude absolue de vaincre. Et tout le monde, comme lui, sentait qu’il était prédestiné à cette victoire.
– Comment, me demandais-je à présent, en est-il arrivé à ce point ? Est-ce bien Blaise Rameau que je retrouve ici, en proie à je ne sais quel mal physique et moral ?
Je feuilletai le dictionnaire, quelques autres livres, cherchant moi-même à me persuader que j’étais le jouet de quelque similitude de nom. Mais à plusieurs reprises je retrouvai la signature : B. Rameau. Et d’ailleurs, je me souvenais bien, à présent. J’avais eu plusieurs fois déjà l’impression que je connaissais cet homme, qu’il ne m’était pas complètement étranger. Et maintenant, malgré le collier de barbe, malgré l’amaigrissement et le relâchement des traits, je retrouvais, derrière cette tête de souffrance, tout proche et vivant encore dans ma mémoire, en dépit de la brume de douze années d’oubli, le visage connu de Rameau.
Mes réflexions ne s’interrompirent qu’à l’arrivée du médecin de Bailleul. J’entendis son auto s’arrêter sur la route, et j’allai tout de suite ouvrir la porte, pour permettre au docteur de retrouver son chemin. À peine entré, il demanda à voir le malade. Et je le conduisis dans la chambre de Rameau, où je le laissai.
Le docteur reparut après quelques minutes.
– Je suis venu pour rien, dit-il. Du moins, cette fois-ci…
– Vous aviez déjà été appelé, docteur ?
– Plusieurs fois.
– À quoi tenaient ces syncopes ?
– À la fièvre, la fatigue, que voulez-vous…
Il s’arrêta, me regarda, comme si une idée lui était soudain venue.
– Vous êtes un parent ? Son frère ?
– Moi ? Nullement. On m’a appelé pour aller vous chercher, faute d’un autre messager.
– Ah ! bien, très bien. Et vous pensez passer la nuit ici ?
– Ne serait-ce pas prudent ?
– Si. Ça vaudrait mieux. C’est tout de même un ami ?
– Non. Je ne le connaissais pas. Je m’intéresse à lui, voilà tout. Mais il évite tout le monde. Ce doit être un caractère singulier.
– Je le pense aussi, dit le docteur. Lorsque lui arrivent des accidents comme celui-ci, je parviens à lui imposer un traitement, pour quelques jours. Puis il m’envoie… promener. Je n’ai jamais vu un malade afficher un tel scepticisme à l’égard de la médecine et des médecins.
– Il est malade, n’est-ce pas ?
– Malade ? Ah ! oui. Ce n’est pas un secret. Il suffit de le regarder.
– La poitrine ?…
– Naturellement.
– Et aucun soin ne pourrait ?…
– Aucun, il ne veut rien savoir. Il n’admet ni docteur, ni remède. Il prétend se soigner lui-même.
– Bien traité, pourrait-il guérir ?
Le médecin fit une grimace.
– Durer, tout au plus. C’est déjà quelque chose. D’habitude, les malades ne rejettent pas ainsi cette consolation.
Il s’arrêta un instant, réfléchissant.
– On sait bien, reprit-il, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir, pour parler peuple… En tout cas, je répète qu’il pourrait durer… Il est déjà tard pour guérir. Lui, il prétend qu’il a toujours été trop tard, que les médecins ne pouvaient rien pour lui. Je pense que nous avons affaire à un grand nerveux.
Le médecin partait. Je le reconduisis jusqu’au seuil. Et l’instant d’après sa voiture descendait le mont à bonne allure, dans la direction de Bailleul.
Je rentrai, fermai le verrou de la porte, m’installai le mieux que je pus dans un fauteuil et m’apprêtai à passer ainsi ma nuit.
II
Nul incident ne vint troubler ma veille. À six heures du matin, Sylvie me releva de ma garde, et je rentrai à l’hôtel.
Le soir, j’interrogeai la petite servante sur les incidents de la journée. Sylvie m’apprit que notre malade allait tout à fait bien. Il déclarait n’avoir plus besoin de personne et me faisait présenter ses remerciements, en attendant qu’il pût venir me les offrir lui-même. Une jeune femme était d’ailleurs justement arrivée, qui pourrait passer la nuit près de lui.
Curieux, j’interrogeai Sylvie sur cette nouvelle venue.
Sylvie ne la connaissait pas. Cette dame, paraît-il, était venue quelquefois, mais repartait presque aussitôt. Aujourd’hui, elle était arrivée à midi.
L’idée me vint alors que ce pouvait bien être une dame que j’avais vue, à midi, sur le chemin du mont. Autant que j’avais pu en juger, c’était une assez jolie femme, de vingt-cinq à trente ans, d’allure robuste, les yeux bruns hardis, le nez retroussé du bout, la bouche grande et fraîche. Elle était fort bien vêtue, d’un tailleur ajusté et pincé, d’un chapeau coquet, d’un renard coûteux, et de souliers de ville qu’elle paraissait navrée d’écorcher sur les pierres du chemin.
Était-ce sa femme ?
– Je ne pense pas, me dit Sylvie. Elle ne vient pas assez souvent. Et puis, cette dame aurait peut-être bien une petite fille… Il y a une petite, d’une dizaine d’années, qui vient aussi quelquefois. Elles arrivent chacune leur tour. Des parentes, bien sûr. On ne peut rien savoir de cet homme.
J’allais pourtant bientôt, et tout naturellement, devenir l’ami et le confident de ce Blaise Rameau, sur le passé duquel je m’interrogeais avec tant de curiosité.
Le lendemain, dans l’après-midi, j’étais dans ma chambre, où je remettais au clair quelques notes de cours, avant de partir pour une de mes promenades coutumières, quand Sylvie m’annonça la visite de celui que nous avions secouru. L’instant d’après, Blaise Rameau entrait dans ma chambre.
Averti, cette fois, je le reconnus nettement. Et, je ne sais par quelle singulière idée, au salut un peu froid qu’il m’adressa, je répondis à brûle-pourpoint, en l’appelant par son nom de famille, comme il est d’usage entre camarades d’école :
– Bonjour, Rameau.
La réaction fut violente. Je le vis soudain relever la tête, se redresser. On eût dit, qu’à être reconnu, il ressentait une sorte de colère. Il me regarda d’un œil dur, presque méchant. Et je lus sur ses traits une contraction, le raidissement d’un orgueil soudainement éveillé. J’eus l’impression nette qu’il voulait se rendre impénétrable, opposer immédiatement à ma curiosité l’obstacle d’un visage fermé et froid. En même temps, avec une espèce de malaise, de gêne véritable, il me demanda d’une voix basse et presque honteuse :
– Vous me connaissez ?
– Oui, dis-je. J’étais au lycée de Lille quand vous en êtes sorti.