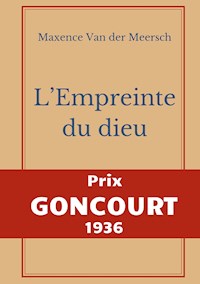1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Invasion 14 est un roman de Maxence Van der Meersch, publié en 1935. Comme son nom l'indique, le roman retrace les années d'occupation allemande dans le Nord de la France pendant la Première Guerre mondiale. C'est un roman fresque aux personnages multiples qui s'inspire de témoignages, d'anecdotes et de faits réels recueillis par l'écrivain lors de l'occupation partielle de la France par l'armée allemande...|Wikipedia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
SOMMAIRE
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
DEUXIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
TROISIÈME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
QUATRIÈME PARTIE
MAXENCE VAN DER MEERSCH
INVASION 14
1935
Raanan Éditeur
Livre 1022 | édition 1
À MA FEMME
PERSONNAGES PRINCIPAUX
ALBRECHT, soldat allemand.
BROOK, garde champêtre à Herlem.
CLAVARD, typographe à Lille.
DAVID, Barthélémy, industriel à Roubaix.
DECRAEMER, Daniel, industriel à Roubaix.
DECRAEMER, Adrienne, sa femme.
DONADIEU, Simon, forgeron à Herlem.
DONADIEU, Pascal, son fils.
DUYDT, mineur belge immigré à Roubaix.
DUYDT, Étienne, dit le Boscot, son fils.
DUYDT, Isidore, son fils.
DUYDT, Marcel, son fils.
DUYDT, Léonie et Armande, ses filles.
FEUILLEBOIS, instituteur à Roubaix.
FONTCROIX, Samuel, commerçant à Roubaix.
FONTCROIX, Édith, sa femme.
FONTCROIX. Antoinette, sa fille.
FONTCROIX, Christophe, son fils.
FONTCROIX, Gaspard, son frère.
GAURE, Professeur au Lycée de Tourcoing.
GAYET, industriel à Roubaix.
GEORGINA, maîtresse d’Isidore Duydt.
HENNEDYCK, Patrice, industriel à Roubaix.
HENNEDYCK, Émilie, sa femme.
HERARD propriétaire à Herlem.
HUMFELS, adjoint au Maire d’Herlem.
INGELBY, industriel à Roubaix.
KREMS, soldat allemand.
LACOMBE, cultivateur, Maire d’Herlem.
LACOMBE, Estelle, sa fille.
LACOMBE, Judith, sa fille.
LAUBIGIER, Félicie, la mère, ménagère à Roubaix.
LAUBIGIER, Alain et Camille, ses fils.
LAUBIGIER, Jacqueline, sa fille.
MAILLY, Albertine, maîtresse de David.
MARELLIS, propriétaire à Herlem.
MOURAUD, Henri, blanchisseur à Roubaix.
MOURAUD, Joséphine, sa femme.
MOURAUD, Georges, son fils.
MOURAUD, Annie, sa fille.
PAUL, soldat allemand.
PAURET, Gilberte, dactylographe à Roubaix.
SANCEY, Juliette, fille de négociant de Roubaix.
SENNEVILLIERS, Berthe, la mère.
SENNEVILLIERS, Jean, chaufournier à Herlem, son fils.
SENNEVILLIERS, Marc, aumônier à Tourcoing.
SENNEVILLIERS, Fannie, femme de Jean, sa belle-fille.
SENNEVILLIERS, Lise, sa fille.
SENNEVILLIERS, Pierre, fils, de Jean.
SEREZ, instituteur à Herlem.
THAUNIER, soldat français.
THEVERAND, employé à Roubaix.
THOREL, imprimeur à Lille.
VAN GROEDE, Flavie, la mère, ménagère à Roubaix.
VAN GROEDE, François et Abel, ses fils.
VAN GROEDE, Cécile, sa fille.
VILLARD, industriel à Roubaix.
VON MESNIL, médecin-major allemand
WENDIEVEL. industriel à Roubaix.
PREMIÈRE PARTIE
Chapitre I
I
Jean Sennevilliers, le chaufournier, sortait de chez lui pour descendre à la carrière.
Sa maison était bâtie au haut du mont d’Herlem. De là, on voyait vers l’Est tout le village d’Herlem, un amas disparate de maisons rouges et blanches, tassées autour d’un haut clocher de brique à flèche d’ardoise. Plus loin, s’érigeaient de somptueuses masses fauves, la splendeur d’un grand bois doré par l’automne et d’où émergeaient les tourelles royales d’un château. C’était la résidence du baron des Parges, propriétaire des neuf dixièmes des terres et des fermes du pays. Vers le sud, sur un éperon, le Fort d’Herlem, un vieux fort aux talus herbus ceinturé de hautes lignes de peupliers. À côté, trapue, énorme, toute en grands murs nus et en toits pointus, la ferme des Lacombe groupait ses granges, ses étables et ses écuries. Lacombe, gros fermier, était maire du pays. Derrière la ferme et le fort, lointaines, brumeuses, ombrées d’un sinistre brouillard de suie, s’étalaient les cités de Roubaix et de Tourcoing, fumeuses, hérissées de cheminées, de réservoirs et de gazomètres.
Au Nord, au pied du mont, s’ouvrait dans la pierre blanche un grand ravin abrupt, une espèce de faille béante, allongée, évasée en forme de vaste conque. C’était la carrière des Sennevilliers. Un étang y dormait, vert, d’un vert d’émeraude, enchâssé dans le roc blanc, parmi un fouillis de petits saules et de joncs vigoureux pressés sur ses bords. À mi-côte, on apercevait les fours, sortes de tours carrées coiffées d’éteignoirs, et qui fumaient doucement dans l’air tranquille. La perspective, de ce côté, s’ouvrait jusqu’à l’infini sur la plaine flamande. On y devinait au loin, sur le fond bleuâtre et voilé du ciel, d’insensibles ondulations : le mont de Messines et le mont Kemmel. Et il y avait aussi deux silhouettes blanches presque indiscernables, qui étaient la tour des Halles et le clocher de la cathédrale d’Ypres.
Tout cela était paisible et ne se ressentait pas de la guerre. On avait vu les Allemands déjà, au mois de septembre, une troupe de uhlans drapés dans de vastes manteaux gris, le chapska noir ciselé de cuivre sur la tête, la longue lance a flamme rouge et noire enfoncée dans la botte et le revolver au poing. Ils avançaient au pas, maintenant leurs minces chevaux fringants, aux harnachements de cuir fauve tout neuf. C’étaient de grands hommes robustes, jeunes, le visage rose et sain, la carrure athlétique. Une longue épaulette horizontale, sous le manteau, amplifiait encore leur prestance.
Ils avaient enfermé tous les hommes dans l’église, fouillé la maison de Marellis, le percepteur, pour dénicher sa caisse. Des réservistes arrivés de Lille les avaient chassés, en avaient tué deux. Lacombe, le maître, avait cloué les manteaux des morts à la porte de la Mairie, et partagé entre la foule les tuniques ensanglantées.
Depuis, les uhlans n’étaient pas revenus.
Jean Sennevilliers était descendu à la carrière. L’ordre de départ de tous les hommes venait d’arriver de Lille. On était au début d’octobre. Cette fois, les Allemands envahissaient tout le Nord. Depuis le début de septembre, le préfet du Nord demandait vainement des instructions à l’état-major de Boulogne au sujet des mobilisables. On lui répondait d’attendre, le 6 octobre enfin l’État-Major envoyait au Préfet de Lille l’ordre de repli de tous lesmobilisables. On eût pu envoyer cet ordre par auto, par estafette ou par télégramme. On le mit à la poste. Le préfet le reçut trois jours après. Les Allemands étaient aux portes de Lille. Le préfet lança des agents de police, des cyclistes, des volontaires, pour porter l’ordre de départ dans toutes les directions. Les gens hésitaient, on sentait le péril. Malgré tout, la plupart des hommes se mirent en route. Nouvel exode, après celui de septembre vers Dunkerque, de milliers et de milliers d’hommes vers le sud de la France et l’inconnu.
Jean devait s’en aller le lendemain matin, mais il voulait finir son ouvrage à la carrière. Il travailla aux fours jusqu’à la nuit. Sa sœur cadette, lise, l’aidait. Il chargea les fours, pour qu’ils achevassent de cuire leurs pierres tandis qu’il serait parti. Il étalait tour à tour un lit de calcaire, un lit de charbon. Des fours montaient une vapeur blanche, carbonique, qui faisait suffoquer. Lise, à la fourche, triait les blocs de pierre.
– Il faudra défourner ce four-ci d’abord, disait Jean, ça te fera vingt tonnes de chaux. Surveille la cuisson. Avec ça, vous pouvez vivre jusqu’à mon retour. Si tu trouves des hommes, tu peux continuer à charger. Profite de la sécheresse pour prendre la craie dans le fond de la carrière. Les eaux de l’étang sont basses, c’est de la pierre gagnée.
– Ne t’inquiète pas, disait Lise.
– Je te recommande aussi Fannie et l’enfant. Tu sais qu’elle n’est pas solide. Elle a besoin de se ménager. Qu’elle n’ait pas faim, ni le petit… On fera les comptes après la guerre…
Ils travaillèrent à charger les fours jusqu’à minuit, à la lueur des lampes à huile.
Jean revint chez lui, au mont d’Herlem, dans l’obscurité. Fannie l’attendait et pleurait en préparant ses bagages. Déjà il lisait sur ses traits les ravages du chagrin et de l’angoisse. Comment supporterait-elle l’épreuve si déjà elle en était là ?
Il avait partagé avec sa mère et Lise l’argent de la caisse. Il donna six cents francs à Fannie.
– Il ne faudra pas dépenser plus de vingt francs par semaine, disait-il. Lise te guidera si tu n’en sors pas.
Il avait l’habitude de la traiter en enfant. C’était lui qui dirigeait tout dans le ménage. Qu’adviendrait-il d’elle, lui parti ? Il eût voulu, d’avance, lui préparer tout l’ouvrage, pour qu’elle n’eût qu’à continuer à vivre comme autrefois. En attendant, il nettoya l’étable de la chèvre, des lapins. Il regrettait de laisser tant de choses à faire, les betteraves à arracher, les plafonds à blanchir, une vitre à mastiquer dans la buanderie. Il courait au plus pressé, montait de la cave quelques sacs de charbon, cassait du petit bois, sciait des bûches. Il recommandait :
– Tu ne feras pas la « buée » des couvertures de laine, c’est trop lourd la tordre. Puisque j’y pense, je vais rincer les draps dans la cuvelle… Surtout, ne soulève jamais seule le chaudron à lessive. Surveille bien Pierre, qu’il aille à l’école, et qu’il soit sage… Si tu n’as pas d’autorité sur lui, Lise t’aidera.
Il travailla jusqu’à deux heures du matin. À cette heure, las, il s’arrêta. De s’être ainsi dépensé, d’avoir revu combien il était utile, indispensable, lui montrait mieux à quel point il allait manquer.
– On va tout de même aller se reposer une heure, dit-il.
Ils montèrent. Pierre dormait. Fannie et Jean se couchèrent. Jean entendait sa femme pleurer. Il n’eut ni le courage, ni l’envie de goûter un dernier instant de joie charnelle avant ce départ. On eût dit qu’il aurait souillé une douleur si haute, cette souffrance qui était celle d’un père plus que celle d’un époux. Ils restèrent éveillés jusqu’au jour.
Tôt le matin, Jean se leva. Avant de s’en aller, il fut encore voir la carrière, noyée d’un adorable brouillard bleuâtre d’octobre. Il regarda longtemps ce long trou blanc, ce ravin élargi en forme de vaste conque sonore où la voix des vents, l’hiver, s’amplifiait. Au fond, l’eau de l’étang fumait. Et des gazes légères s’accrochaient au feuillage doré des petits saules et des buissons.
C’était pour une bonne part son œuvre, à Jean, la carrière, ce grand trou, ce sillon profond, marque de son passage sur la terre. Elle aussi avait besoin de lui, de son savoir et de sa force. Il en connaissait chaque coin, chaque veine. Il en savait les qualités et les faiblesses, les ressources et les dangers. Elle ne vivait que par lui, que de lui. Nul ne pouvait le remplacer ici sans une longue expérience, une patiente familiarité. La pensée que, s’il ne revenait pas, elle passerait aux mains d’un autre et en souffrirait, ou, plutôt, qu’elle cesserait de vivre, resterait là comme une crevasse inexplicable et inutile, un creux de pierre sauvage lentement envahi par les ronces et les eaux des sources et des pluies, le peinait comme la mort d’un être. Il revint vers sa maison.
Il partit à neuf heures. Il fit route avec Marellis, le percepteur, qui ne savait s’il devait quitter son poste et qui s’en allait à Lille chercher des instructions.
À la gare de Lille, parmi une invraisemblable agitation, il rencontra tout à coup son frère aîné, Marc Sennevilliers, aumônier au lycée de Tourcoing. Marc était accouru à Lille faire ses adieux à son frère. Ils s’embrassèrent. Et comme ils ne pouvaient se décider à se quitter, ils gagnèrent ensemble les quais. Il y régnait un grand tumulte. Un train unique attendait sous pression. Des centaines d’hommes avaient envahi les compartiments, s’entassaient comme un bétail. Une foule énorme assiégeait le train. Les employés faisaient descendre les hommes accrochés aux barres des portières, installés sur les tampons ou juchés sur les toits. Plus rien, d’ailleurs, de l’enthousiasme de la mobilisation chez ces hommes. Cela au contraire sentait la panique.
Jean, sa valise en main, courait le long du train avec son frère, cherchant vainement où monter. Il arriva ainsi jusqu’à la locomotive. Et comme il allait renoncer, une voix le héla :
– Jean !
Il reconnut avec surprise sur le tender son ami Simon Donadieu, le forgeron d’Herlem. Donadieu avait passé la nuit à Lille avec beaucoup d’autres, dormi sur le trottoir, à la belle étoile. Et il avait par miracle retrouve un camarade qui était le chauffeur de la locomotive. Par lui, Jean put monter sur le tender.
Cet exode fut le point de départ de la sinistre aventure des quarante mille mobilisables que les Allemands devaient massacrer ou emprisonner. Car l’ennemi déjà tenait le pays. Une fois de plus, des innocents devaient payer de leur vie l’incurie et la négligence de leurs maîtres.
II
Depuis trois jours, les Allemands bombardaient Lille. De Roubaix, chaque nuit, on voyait les flammes de l’incendie. Samuel Fontcroix, comme beaucoup, courait le soir vers les faubourgs regarder de loin, au fond de l’horizon, cette ligne dansante et sanglante découpée sur le gouffre noir du ciel. Cet enfer semblait tout proche. Des éclaboussements rouges en jaillissaient dans un vacarme lointain de forge, un fracas de métal où l’on croyait entendre monter une clameur désespérée.
Samuel Fontcroix pensait à sa femme et à sa fille, qui subissaient là-bas cette épouvante. Et il s’angoissait.
C’était un homme d’une quarantaine d’années. Il habitait à Roubaix le quartier de l’Épeule où il exploitait un commerce de charbons. Depuis deux ans sa femme et lui étaient séparés.
Ils s’étaient épousés sottement. Samuel travaillait chez son père. Édith était couturière. Une rencontre banale les avait liés. Lui était assez naïf. Édith, elle, mêlait étrangement la rouerie et la sentimentalité. On avait pris pour le plus bel amour ce qui n’était qu’une passion des sens. Samuel était gai, optimiste, poète à ses heures, prompt à l’enthousiasme. L’autre était matérielle et amère. Des heurts continuels les eussent fait se séparer bientôt, sans la naissance de deux enfants, qui pourtant ne ramenèrent pas la concorde. Le ménage continua d’aller cahin-caha. L’aigreur et la méchanceté d’Édith exaspéraient Samuel. Nul bonheur chez lui. Il eut le tort de le chercher au dehors, commit quelques fredaines. Et les relations entre mari et femme s’envenimèrent définitivement.
Puis Samuel s’éprit d’une jeune femme qui se disait malheureuse et l’était en vérité comme lui. Cela dura trois ans. Les amants se cachaient bien. Tout le quartier de l’Épeule était dans l’ignorance. Eux vivaient dans l’avenir. Samuel envisageait le divorce, le bonheur pour plus tard. Mais un beau jour Édith connut l’aventure. Elle eut une vengeance cruelle et sans noblesse, alla prévenir tout droit le mari de la malheureuse, et brisa du même coup le foyer d’une autre avec le sien.
C’est alors que les époux Fontcroix se séparèrent. Samuel, meurtri, écœuré, préféra mettre fin à cette vie stupide. Ils se quittèrent à l’amiable. Édith prit la fille, Antoinette, qui avait treize ans, et ouvrit une épicerie à Lille. Samuel garda le garçon. Christophe, qui avait cinq ans. Samuel allait revoir sa fille à Lille chaque mois, et portait un peu d’argent.
À présent, Édith et Antoinette étaient là-bas sous le bombardement. Et Samuel s’étonnait de démêler dans son angoisse une si large part d’inquiétude pour sa femme. On ne vit pas en vain, quels que soient les malentendus, quinze ans de vie commune.
Le siège de Lille dura trois jours. La population vécut dans les caves.
Samuel Fontcroix, le matin du quatrième jour, courut vers Lille, parvint à pénétrer dans la ville, où les Allemands avaient fait leur entrée parmi les ruines. Il fut atterré.
Lille achevait de brûler et de crouler. Les quartiers du centre, de la Gare, étaient anéantis. La population se reprenait à vivre. On sortait des caves, on courait voir l’incendie et la dévastation. La ville était pleine de fumée, de vapeur, et de l’énorme poussière rousse des écroulements. Vers la Gare et le Théâtre, on distinguait maintenant un vaste espace libre, comme un champ de bataille, où ça et là de grands squelettes noirs de pierre et de fer s’érigeaient, sinistres, avec leurs fenêtres ouvertes sur le vide et l’incendie. Plus de rues. Des montagnes de briques, de poutres et de verre pilé. Des flammes encore, ça et là, le crépitement, les ronflements du feu. Des pluies de flammèches, de cendres et de braise ; des bouffées de fumée suffocante. On avançait, la main sur les yeux, larmoyant, toussant, étouffé. Des pompiers de fortune faisaient la chaîne. Et on découvrait tout à coup sous le casque le visage noir d’un ami. De longs cortèges de fuyards s’en allaient, chargés de paquets informes, l’air égaré, des gens à demi vêtus, des femmes en chemise sous des manteaux, des gosses nus sous des couvertures. Beaucoup de pillards aussi, des hommes en espadrilles, l’air hardi, portaient des sacs et s’enfonçaient à travers les ruines. Çà et là, on évacuait des boutiques menacées, léchées par les flammes, les boutiquiers distribuaient leurs marchandises, des épiceries, des jouets, des tissus, des valises, à charge de restituer quand le péril serait écarté. Une puanteur universelle de laine brûlée, de bois carbonisé emplissait l’air. Des hommes vidaient des seaux d’eau dans les flammes, ou sur les ruines encore fumantes. Et l’on entendait l’espèce de cri aigu de cette eau vaporisée en nuages sales. Des maisons éventrées, coupées en deux, montraient à nu de petites pièces, des meubles accrochés dans le vide, des lits pendant sur des abîmes. À terre, des monceaux de briques, de verre, de fer, des meubles brisés, des casseroles et de la vaisselle, des plâtras. On ne discernait plus le pavé, ni la rue. On escaladait des collines de décombres. Autour d’un éboulement, par places, des masses humaines s’arrêtaient, regardant des sauveteurs volontaires qui déblayaient les débris, essayaient d’atteindre des malheureux engloutis dans leur abri. On en extrayait des blessés, des asphyxiés, des morts. D’un soupirail ainsi dégagé à grand’peine sortit un grand chien blanc qui s’enfuit, disparut parmi les ruines, fou d’épouvante… Il ne restait que lui de vivant dans cette cave. On trouvait par terre, on ramassait des fusils, des uniformes de soldats français et des burnous d’Arabes. Car les chasseurs du commandant de Pardieu, pour échapper à l’ennemi, avaient jeté leurs armes et leurs vêtements, et s’étaient réfugiés chez les habitants, où ils se cachaient. Les goumiers, cavaliers arabes auxiliaires, avaient égorgé leurs chevaux sur le pavé.
Sur le clocher de Saint-Maurice, sur le beffroi de la nouvelle Bourse, flottaient encore les haillons blancs, signe de la défaite et de la capitulation. Et tout au faîte pendait déjà le drapeau de l’Empire, immense et immobile symbole.
On se le montrait, on pleurait, on s’éloignait. Et parmi les rues obstruées de ruines, les plaies à vif des murs de briques, les cassures blanches de la pierre, les vapeurs noires et sales de l’incendie, le grouillement d’une foule disparate, la fuite des sinistrés, l’agitation des pompiers et des sauveteurs, les squelettes chancelants des édifices, les amas de fer tordus, passaient encore de vastes pans de brouillards roussâtres, les nuages de poussière énormes des écroulements, comme les fumées de la canonnade qui traînent sur un champ de bataille…
Au coin de la rue Saint-Sauveur, brusquement, parmi la foule, Samuel se heurta à sa femme et à sa fille, qui erraient au milieu de cette dévastation. Ils s’embrassèrent sans pouvoir dire un mot.
Chapitre II
I
Ce fut une curieuse expérience de socialisation que tentèrent à Herlem comme en tous les villages des pays envahis les autorités allemandes. Tentative d’autant plus intéressante qu’elle s’appliqua au domaine rural, habituellement considéré comme essentiellement réfractaire à tout essai de ce genre.
À peine arrivé, le colonel von Glow, commandant la région d’Herlem, convoquait dans toutes les communes les maires, adjoints, secrétaires de mairies, instituteurs, percepteurs, médecins et curés. Les représentants des onze communes ainsi assemblés dans la mairie d’Herlem reçurent les ordres du colonel et furent déclarés responsables de leur exécution. D’étape en étape, en l’espace de deux mois toute la vie rurale était sous le contrôle de l’autorité allemande.
Chaque semaine avait lieu la réunion provoquée par le colonel. Il tenait ainsi tout le pays en main, ordonnait, recueillait les plaintes et formulait ses observations. Il disait brutalement « J’ordonne », et on obéissait.
Cela commença par un état général des terres que durent dresser les maires de chaque commune. Lacombe, maire d’Herlem, parcourut le pays, distribuant des feuilles à tous les fermiers. C’étaient de grands questionnaires : combien cultivez-vous d’hectares en blé, avoine, trèfle, etc. ? Combien avez-vous de chevaux, vaches, moutons ? Combien de voitures, outils, blés en granges, harnais, cuir, huiles et essences ?
Les feuilles remises, on vit le colonel, en calèche, faire le tour du village avec Lacombe. Résultat, de nouvelles circulaires : mettre en état les chemins, les empierrer, curer les mares et les fossés, nettoyer les abords des puits, y étaler des cendres, veiller à la propreté du sol dans un rayon de dix mètres. Ordre à tout malade d’avertir la Kommandantur. Ordre à tous de fournir dix heures de travail par jour à la Kommandantur. Jeter du sable sur les routes en cas de gel, torréfier les fruits pour les conserver, battre le blé et l’ensacher, arracher les betteraves, les mettre en silos, tenir les cuisines plus proprement, manœuvrer une fois par mois la pompe à incendie. Jamais Herlem n’avait été si net.
Entre temps, une équipe de chimistes analysait les terres. Dès janvier, les fermiers reçurent des engrais, se virent imposer les répartitions des semailles. Défense d’abord de cultiver la betterave à sucre : l’Allemagne en produisait assez. Semer ici du blé, ailleurs de la luzerne, finir les labours pour février, les semailles pour mars, herser, rouler, arroser les foins. Ordre à Lacombe de tailler sa haie, à Humfels de curer ses fossés, à Bozin de réparer sa faucheuse. Faucarder l’étang. Tenir une comptabilité du bétail, indiquer à la Kommandantur les naissances et décès des bêtes, les quantités journellement produites de lait, beurre et œufs. Fournir par tête de bétail tant de litres de lait, – trois œufs par poule et par semaine. L’autorité allemande les payait cinq pfennigs, et sept pfennigs le litre de lait, mais retenait dix pfennigs par litre ou œuf manquant. Défense de tuer lapins, poules, cochons. Présenter à la mairie le cadavre de tout animal décédé par accident.
On commença par rire. Amendes, perquisitions, confiscations, lassèrent vite les résistances. On dut s’incliner, plier, avec urne rage qui n’était pas exempte d’une certaine admiration. Décidément, ils étaient forts !
Un après-midi du mois dé février 1915, Pascal Donadieu, le fils du forgeron Simon embarqué à Lille sur une locomotive avec Jean Sennevilliers, se mit en route pour la ferme Lacombe.
Depuis que Donadieu était parti, en octobre 1914, on était sans nouvelles. Pascal, qui avait dix-sept ans, vivait avec sa mère à la forge, et avait dû abandonner les cours de mécanique et d’électricité qu’il suivait à l’Institut de Tourcoing. L’argent s’en allait. Pascal voulait travailler. Il s’était mis à la recherche d’un emploi.
La neige était tombée la veille. Un pâle soleil, invisible presque, blanchissait la brume. Et Pascal allait bon pas, à travers champs. Sous la neige, les fermes s’ensevelissaient. Il ne restait sur une blancheur universelle que les taches noires de quelques murs, et le grêle lacis des arbres échevelés. Immense page vierge et comme lumineuse. Pascal trouvait à ce ciel blanc, à cette terre blanche à peine ponctuée de noir, à cette uniformité pâle et confondue, quelque chose de léger et de pur, qui l’emplissait malgré la tristesse de l’heure d’un vague contentement. Il respirait largement.
L’idée de revoir Judith Lacombe, la fille du fermier, lui causait un léger trouble. Il avait quelque peu conté fleurette, jadis, à la jeune fille. On s’était promenés deux ou trois fois dans les avenues du château des Parges. On avait échangé quelques confidences. Simon Donadieu, avant de s’en aller, en avait touché mot à son fils :
– Tu es jeune, tu n’as pas encore de situation, je te demande d’être sérieux. La fille des Lacombe n’est pas pour toi. Plus tard, on verra…
C’est ainsi que depuis le départ de son père Pascal avait voulu ignorer Judith. Désobéir à l’absent en de telles circonstances l’eût effrayé, comme si cela avait pu porter malheur à son père. À présent, il n’en était plus de même. C’était pour lui une nécessité d’aller chez Lacombe, où il espérait trouver un emploi. Les Allemands exigeaient le travail de tout le monde. Pascal avait dû lui-même travailler pour eux, forger des fers pour leurs chevaux dans la forge paternelle. Il ne s’était vu dispenser de ce travail qu’en se blessant volontairement d’un coup de marteau à la main. Maintenant, guéri, il cherchait à leur échapper. Il avait pensé à Lacombe, le maire, qu’il connaissait bien, et pour qui maintes fois il avait réparé des faucheuses et des charrues.
Lacombe, durant les premiers temps de la guerre, avait gagné beaucoup d’argent. Il venait à Herlem des hordes de réfugiés fuyant l’ennemi, descendant vers la France. Ces gens, des fermiers, des paysans, pour la plupart, emmenaient un bétail énorme, encombrant, affamé, et qui les entravait. Lacombe et quelques gros fermiers achetaient à vil prix ces troupeaux et s’en allaient les revendre trois fois plus cher aux bouchers des villes voisines.
Quand les Allemands revinrent à Herlem, Lacombe, épouvanté, commença par se cacher. Il avait sur la conscience le partage des manteaux des uhlans tués. Il se voyait très bien emprisonné ou fusillé. Il fut malade de frousse, crut faire une jaunisse. Par chance, les Allemands n’eurent pas vent de cette affaire. Maire du village, il fut bientôt appelé à la Kommandantur. Tremblant de peur, il promit tout ce qu’on voulut, se montra d’une exemplaire docilité, indiqua sans se faire prier les ressources du village, fournit la liste des hommes valides. Au point que ce fut la mairie elle-même qui envoya aux hommes l’ordre de travailler pour la Kommandantur. Lacombe donna l’exemple de la soumission, laissa s’installer chez lui un chef de culture allemand avec trois ouvriers pour remplacer ses valets.
À présent, rasséréné, il recommençait à voir les choses par leur bon côté, travaillait ses terres avec le chef de culture bavarois, et volait le plus clair de leur produit, de complicité avec l’Allemand, un grand gaillard qu’on appelait Albrecht.
Pascal le trouva dans sa cuisine, debout devant la fenêtre, tournant le dos à la porte, et fumant sa pipe en regardant les champs. C’était un grand gaillard, solide comme un bœuf. Judith, sa fille cadette, penchée sur un baquet, les bras nus, lavait le beurre dans l’eau fraîche. Il régnait dans la pièce une odeur aigre.
– Tiens ! dit Lacombe, c’est Pascal. Quelle nouvelle ?
Pascal exposa son affaire :
– Voilà, monsieur le Maire : je n’aime pas travailler pour l’ennemi. J’ai un peu d’instruction. Ne pouvez-vous m’occuper à la mairie ?
– Heu, dit Lacombe… c’est-à-dire… Justement je pensais remplacer les employés qui restent par des femmes. La Kommandantur a besoin d’hommes…
– Ah, bien, très bien, fit Donadieu, ébahi. Merci tout de même…
Il faisait une si drôle de mine que le père Lacombe comprit sa sottise, et voulut se rattraper.
– Bien sûr, je ne fais pas leur jeu. Mais ils sont les plus forts, tu vois… Il faut bien « faire avec… »
– Oui, oui, dit Pascal.
Il contenait sa colère. Il se répétait qu’il avait besoin de Lacombe, devait le ménager. Il reprit d’un ton à peu près tranquille :
– Et tout au moins, Monsieur le Maire, ne pourriez-vous pas… m’oublier sur la liste des hommes ? Ne pas m’inscrira tout de suite, au moins ?
Lacombe rit :
– Pas bête, ce Pascal ! Entendu, mon garçon. On fera passer ça… J’indiquerai à ta place le fils des Larmiget… Ils m’ont refusé leur vache. Ça leur apprendra… Salut, mon garçon.
Il se remit à fumer devant la fenêtre.
Dehors, sur le trottoir, Pascal retrouva Judith. Elle avait traîné sa cuvelle sous la pompe, elle pompait sur le beurre jaune un jet d’eau fraîche, pour le rincer. Ses bras nus, à la volée, levaient et abaissaient le long bras de fer grinçant.
Pascal s’arrêta devant elle :
– Bonsoir, Judith.
Judith avait dix-sept ans. Mince et nerveuse, le visage long et pâle, les cheveux noirs, elle frappait par son expression volontaire et tendue, quelque chose de romanesque aussi, qui laissait deviner dans cette fille de gros fermiers vulgaires un tempérament exalté, une nature emportée et chimérique.
– Bonsoir, dit-elle.
Et Pascal crut deviner chez elle la même gêne qu’il éprouvait lui-même.
Elle semblait à la fois contente et confuse de cette rencontre.
– Ça va toujours ?
– Mais oui.
– Il y a longtemps qu’on ne s’était vus, dit Pascal, qui regretta tout de suite cette parole imprudente, évocatrice du passé.
– Oui…
– J’étais venu pour obtenir une place à la mairie, mais c’est impossible.
– Et ton père ?
– Pas de nouvelle.
– C’est vrai que les Allemands abattent les tilleuls de l’avenue du Château ?
– C’est vrai, oui…
Ils se turent. Chaque parole ressuscitait malgré eux le souvenir de cette courte liaison sentimentale et innocente, ces deux ou trois brèves et timides promenades d’amoureux, dans l’avenue du grand château.
À ce moment, dans la cour, entra un grand gaillard de trente à trente-cinq ans, blond, frisé, le teint rose, les yeux clairs, vêtu en ouvrier de ferme. Il vint droit à la pompe. Il dit, avec un fort accent germanique :
– Bonjour, bonjour…
– Bonjour, Albrecht, dit Judith.
Et Pascal devina qu’il s’agissait là du chef de culture allemand qui dirigeait la ferme Lacombe. Il fut surpris, sottement, qu’un Allemand en ouvrier ressemblât à un Français. Cet homme-là n’avait rien d’un ennemi, ainsi vu en vêtements de travail, avec sa bonne tête frisée et son large sourire débonnaire.
– Sale, disait Albrecht. Beaucoup sale ! et faim ! Beaucoup travaillé.
Il montrait ses mains terreuses, les approcha familièrement du visage de Judith. Elle recula vivement.
– Allons, Albrecht ! Restez tranquille !
Elle semblait gênée, devant Pascal.
– Wasser ? demanda Albrecht, montrant le bras de la pompe.
Et il l’empoigna, la manœuvra d’une main, sans effort, avec une vigueur incroyable, fit jaillir sur les mottes jaunes un jet puissant et continu.
– Ça va, ça va, merci.
Judith s’était remise à rincer son beurre. Elle tournait le dos à Pascal, et, très rouge, semblait presque se cacher. Albrecht, lui, regardait Pascal, lui adressait des clins d’œil, et, riant, montrant ses dents carrées et blanches, faisait des gestes et des grimaces, feignait de vouloir pomper sur la tête de Judith.
– Au revoir, dit Pascal.
– Au revoir, répondit Judith, toujours penchée sur sa cuvelle.
Pascal s’en alla. Il revint vers la place d’Herlem par le sentier qui passe derrière le fort et coupe à travers champs. Il faisait toujours le même temps de brume, de lumière pâle et voilée, diffusée du ciel clair sur la terre ensevelie. Pas d’ombres. Une immensité blanche et muette. Un silence qui maintenant serrait le cœur de Pascal. Tout cela était devenu d’une tristesse accablante.
Pascal se hâtait vers la forge. Il se sentait amer et vieilli. Il pensait à son père, découvrait dans ses derniers conseils une sagesse profonde qu’il n’avait pas soupçonnée. Il y avait en lui une douleur confuse, qu’il n’eût pas volontiers sondée.
―――
Le soir, après l’ouvrage, les ouvriers allemands revinrent à la ferme avec Albrecht. Il faisait presque nuit. Judith leur avait chauffé un chaudron d’eau de pluie, pour qu’ils pussent se laver dehors, sur le petit trottoir de briques, malgré le froid.
Ils se dévêtirent, ne gardèrent que leur pantalon serre à la ceinture. Judith leur apporta l’eau chaude. Ils se mirent à s’ébrouer, s’asperger, se frotter. Judith et sa sœur Estelle les regardaient.
– Seife ?
Estelle allait à la cuisine, rapportait le savon noir. C’était une grande fille plate et maigre, qui ressemblait à sa mère, faisait la dévote et gardait un maintien hypocritement effacé. Mais elle aimait les hommes. Et plusieurs fois Judith l’avait trouvée dans la grange avec l’un ou l’autre des Allemands. Une vicieuse qui cachait son jeu, et dont le mari, Louis Babet, maintenant mobilisé, avait sans le savoir été la risée du village.
Elle regardait, appuyée contre la porte, les trois hommes se laver. Il faisait noir. On avait accroché au mur un falot dont la clarté rouge découpait un cercle de lumière, caressait et dorait les torses nus, les chairs roses, grasses et saines de ces trois grands gaillards mamelus.
– Estelle ! cria la mère Lacombe, de la cuisine. Estelle dut rentrer. Judith demeura seule. Elle ne s’en allait pas. Le spectacle l’amusait toujours, la vue de ces trois hommes robustes, insensibles au froid et comme accoutumés à une vie plus large et plus pure que celle des gens de son village. Un tel courage, une propreté si scrupuleuse l’étonnaient un peu. Elle n’avait jamais vu chez les valets de ferme qu’une crasse puante, superficiellement décapée le dimanche.
Les hommes s’essuyaient. Ils rentrèrent dans la cuisine en s’ébrouant et se giflant à grandes claques. Il ne resta qu’Albrecht, qui se savonnait la tête, en faisait une énorme boule mousseuse. On le voyait s’agiter, silhouette claire dans la nuit.
– Wasser…
Il s’était approché de la pompe :
– Pomper, Judith, pomper beaucoup fort…
Il s’était courbé, offrait sa tête, son torse nu au jet d’eau froide qui giclait sur la chair saine.
Il se releva, courut s’abriter du vent à l’entrée de la grange, et il se frottait avec un vieux torchon, à grands coups rapides. De loin, il montra le torchon à Judith :
– Frotter ! Comme cheval ! Fort, fort, comme cheval !
Judith prit le torchon. Elle raclait de toutes ses forces le vaste dos, à le griffer. Albrecht riait : « Plus fort, plus fort ! » Il se retourna vers elle, les bras toujours en croix, offrant sa poitrine. Chaque coup y laissait un trait. Et, sans raison, Judith se sentait troublée devant ce grand torse nu. Elle voulut rire. Son rire sonna faux. Son geste s’alentissait.
Brutalement, les bras d’Albrecht se refermèrent sur elle. Elle tomba dans la couche de foin épaisse, traîtresse. Sur elle, la masse d’Albrecht l’écrasait. Une odeur capiteuse de foin, d’herbe sèche, de savon, de sueur, le contact doux et chaud du grand corps nu l’enivraient. Elle se sentit sans force…
L’espace d’un éclair, le souvenir de Pascal la traversa, Remplit d’horreur soudaine. Elle se raidit dans une défense instinctive, pour s’évader. Elle se sentit ténue. Albrecht la paralysait…
Apaisé, maintenant, il lui parlait, lui murmurait en allemand, à l’oreille, des paroles douces qu’elle ne comprenait pas et qui lui faisaient mal. Elle avait chaud, sous lui. Il fouillait des lèvres dans ses cheveux, lui mordillait le lobe de l’oreille, jouait comme un jeune chien. Elle l’enlaça de nouveau, s’accrocha à lui dans une sorte de désespoir. Il ne s’aperçut pas qu’elle pleurait.
―――
Elle s’attacha à Albrecht avec frénésie. Littéralement, elle en était folle, prise pour cet homme d’une passion qui n’était pas, d’ailleurs, à beaucoup près, exclusivement charnelle, où il entrait un besoin de se dévouer, de se donner. Elle reportait sur lui, sans qu’il eût rien fait pour mériter ce don splendide, par une espèce d’instinct, tout le dévouement, toutes les possibilités inemployées qui dormaient jusque-là en elle. La jeune fille s’ignore. Judith jusque-là s’était crue surtout préoccupée d’elle-même et passablement égoïste. Pour Albrecht, brusquement, elle se sentit capable de tous les sacrifices. Lui, il reçut ce don d’une âme sans même s’en apercevoir. C’était un garçon qui manquait absolument d’idéalisme et ne voyait dans l’amour qu’une occasion d’heureux et fréquents divertissements. Il ne s’estimait pas frustré. Il eut en elle une maîtresse capiteuse et prompte au plaisir. Il la crut assez vicieuse. Il ne comprit jamais que c’était pour lui, non pour elle, et qu’elle se fût contentée, elle, de sa seule présence, du son de sa voix.
Elle eût aimé trouver en lui tout ce qu’elle avait entrevu de l’amour dans sa brève idylle avec Pascal, – de longues rêveries communes, d’ennoblissantes pensées, une tendre et divine compréhension mutuelle des âmes. Mais Albrecht ne cherchait pas si loin. Et tel qu’il était, elle l’acceptait, courageusement. Il avait littéralement forcé son âme comme son corps.
Elle trouvait naturel de se montrer au village avec lui. Inutile de cacher sa liaison, puisqu’elle l’aimait ! Que faisait-elle de mal ?
Tout de suite, Estelle, l’aînée, devina l’histoire. Elle ne dit rien, contente au fond d’avoir barre sur sa cadette.
La mère Lacombe aussi vit le manège. Elle garda elle aussi le silence. Elle avait peur de son mari et du scandale. Elle laissa aller les choses.
Quant à Lacombe, nul ne pouvait savoir s’il voyait clair ou non. Albrecht et lui étaient bons camarades, s’entendaient comme larrons en foire pour piller les produits de la ferme. Il eût été désastreux de provoquer une dispute. Aussi longtemps que nul ne mettrait à Lacombe le nez dans son ordure…
D’ailleurs, rien ne prouvait qu’il eût des soupçons. Toujours préoccupé de lui-même, démesurément tyrannique et égoïste, il allait par l’existence comme si la terre entière avait eu les yeux sur lui. Lui seul comptait. Peut-être aussi la connaissance de la terreur qu’il inspirait aux siens lui faisait-elle écarter la possibilité pour ses filles de commettre la moindre faute.
II
Une nuit de la fin de mars, Judith, qui dormait avec Estelle dans la chambre au-dessus de la cuisine, fut éveillée en sursaut par des gémissements. Une seconde, elle écouta. Les gémissements reprirent. Cela venait du lit d’Estelle.
D’un bond, Judith sauta sur le plancher. Et, pieds nus, en chemise de nuit, elle courut au lit de sa sœur.
– Estelle ! Estelle !
Le visage livide, les yeux clos, baignée de sueur, Estelle râlait. Épouvantée, d’un geste éperdu, Judith rejeta les couvertures. Il y avait dans le milieu du lit une large tache sombre, presque noire. Du sang.
Judith ne comprit pas tout de suite.
– Estelle, Estelle ! Mon Dieu ! Elle criait, affolée.
Estelle rouvrit les yeux. Par un effort immense, elle put parler. Elle souffla tout bas :
– Tais-toi ! Maman… Va chercher maman…
Elle referma les yeux, se laissa aller à nouveau en arrière, articula dans un effort suprême :
– N’éveille pas le père… Ah ! je meurs…
Judith courut à la chambre des parents. Ils dormaient. Elle toucha le bras de la mère, qui s’éveilla :
– Estelle ? Hein ? Ah !… oui. Ah mon Dieu !
Elle se levait, passait ses pantoufles, suppliait :
– Pas de bruit… Le père, n’éveille pas le père…
Elle suivit sa fille dans les ténèbres, n’alluma la bougie que dans le corridor.
On ranima Estelle avec du vinaigre. À la lueur de la bougie, on vit le visage blême, pincé, tiré, esquisser une grimace… Elle rouvrit les yeux, reconnut sa mère et sa sœur. La mère l’avait prise sous les épaules pour l’asseoir. Elle la relevait doucement. Estelle parut se vider. Un flot coula sous elle, dans un clapotis horrible.
– Ah ! la la. Qu’est-ce que t’as fait, Estelle ! gémit la mère Lacombe.
– C’est toi, souffla Estelle. C’est toi qui l’as voulu…
Elle mit dans ce souffle un accent de haine indicible, la haine terrible de celle qui se sent mourir, et qui accuse. Puis elle se laissa retomber en arrière, comme morte.
Tapes, vinaigre, eau fraîche, la tirèrent une seconde fois de sa syncope. Judith redescendit à la cuisine, fit du feu, prépara du café coupé de genièvre. Estelle but, reprit un peu de force. On changea son linge, on la transporta dans le lit de Judith. Elle s’endormit d’un sommeil écrasant.
– Où est Estelle ? demanda Lacombe le lendemain matin.
– Elle a pris médecine, elle reste couchée, dit la mère.
– Bon.
Il n’insista pas. À la campagne, on jeûne et on reste au lit les jours de purge. Lacombe prit sa pipe et son bâton, et s’en fut faire sa tournée quotidienne par les champs.
Judith et la mère restèrent seules dans la cuisine. On sentait que la mère avait quelque chose sur le cœur. Elle tournait autour de Judith. Elle cherchait un préambule, maladroitement. Et la honte l’empêchait de s’expliquer ouvertement. À la fin, elle dit :
– T’as entendu ce qu’elle racontait, la nuit, Estelle ? Faut croire qu’elle avait la fièvre…
Judith ne releva pas.
– Parce que, bien sûr, c’est pas moi qui lui avais dit de faire ça. J’avais seulement dit que je n’« en » voulais pas… Un bâtard ! qu’est-ce qu’il aurait dit, le père ! Et Babet, quand il reviendra de la guerre !
Pour elle, son beau-fils était resté Babet et non Louis. Il ne semblait pas être entré dans la famille. Elle reprit :
– On ne peut tout de même pas accepter des histoires pareilles ! On peut… On peut « fréquenter », je comprends… Mais les hommes n’ont qu’à faire attention, voilà. Dans tons les cas, sûr que le père n’accepterait jamais ça.
Ce mot « ça » dut lui rappeler la chose, de façon précise et brutalement concrète. Elle laissa là le tas de linge qu’elle triait pour la lessive, monta dans la chambre.
Estelle, les yeux ouverts, songeait, le nez tiré. Elle tourna son regard vers sa mère, murmura :
– Tu cherches quelque chose ?
– Le… Le seau…
– Sous mon lit…
La mère se baissa.
– Tu feras un trou dans le fumier, souffla Estelle.
– Dans le fumier ? Ah bien non ! Ça ne se fait pas ! Je vais le clouer dans une petite caisse, et je m’arrangerai avec le fossoyeur. Il l’enterrera au-dessus d’un autre… Faut le mettre en terre bénite, c’est comme ça qu’on doit faire…
Elle disparut dans l’escalier avec le seau. C’était une femme soucieuse des convenances et respectueuse des rites.
III
Le 9 avril 1915, Lacombe, le maire, fut appelé à une réunion de tous les maires de la région, sur la convocation du C. R. B. (Committee for relief in Belgium) qui souhaitait venir au secours de la population. Il avait enfin obtenu des Allemands l’autorisation de faire entrer dans la France envahie des vivres et du charbon.
Chaque commune dut avoir sa commission. À Herlem, elle fut composée du maire, de Humfels, l’adjoint et de Premelle, le secrétaire de mairie, de Marellis le percepteur, du curé Limard, de Serez, l’instituteur et de M. Hérard, un rentier du village, directement nommé par le Committee pour le représenter. Cette commission recevrait les marchandises du Committee, les revendrait aux habitants et verserait le montant des ventes au Committee.
Pour les insolvables, des comptes spéciaux seraient ouverts, que chaque commune liquiderait après la guerre, Il était interdit de faire aucun acte de commerce avec les denrées. Toutes les fonctions devaient être gratuites.
―――
Marellis le percepteur et Serez l’instituteur, désormais, s’occupèrent de la distribution des vivres ; Marellis en tirait une grande fierté. Fonctionnaire, il avait l’orgueil un peu naïf de son titre. Il remplissait son emploi de percepteur avec solennité. Son mot était : « Nous, fonctionnaires… » Scrupuleux, tatillon presque, il représentait cependant, par sa rigide honnêteté, son souci d’équité, son zèle à défendre l’intérêt de l’État, un type précieux pour le bien public. Tout le monde, lors de l’invasion, lui avait conseillé de fuir, comme beaucoup de ses collègues, « Fonctionnaire, avait répondu Marellis, je ne puis partir sans un ordre. » L’ordre n’était pas venu. Marellis était resté.
Bloqué dans le Nord, il avait encore fait ici son devoir, caché sa caisse et ses archives, refusé de collecter, à l’exemple de certains collègues, les impôts pour le compte de l’ennemi. Le spectacle du village l’écœurait. On s’inclinait docilement devant les Allemands. Isolés, les fermiers n’avaient même pas pensé à la résistance, trop âpres au gain, trop attachés à leurs terres et leur bétail pour accepter de les perdre. On s’était soumis, adapté avec une résignation humiliante. Et depuis que Marellis était employé au ravitaillement, son indignation avait encore beaucoup grandi. Lacombe, Premelle, Hérard, abusaient de leurs fonctions. Marellis remarquait des factures de trois cents sacs de charbon, soit quinze tonnes, alors que le village en recevait sept ou huit. On se partageait les restes du ravitaillement. Et pour qu’ils fussent plus copieux, on faisait les parts de la population plus petites. On « oubliait » d’annoncer les produits rares, le lait condensé, le gruyère. Si bien que beaucoup de gens ne pensaient pas à en réclamer, et qu’il en restait pour les distributeurs. Il y avait des tripotages, des reventes de cartes et de tickets. Les indigents ne devaient pas payer leur ravitaillement. Lacombe en profitait pour distribuer des cartes d’indigents à tous ses amis. La plupart des ouvriers qui travaillaient pour les Allemands et à qui la caisse de la commune payait un salaire de sept francs par jour, recevaient leur ravitaillement au même titre d’indigents. Lacombe ne tenait aucun livre des rentrées d’argent. Toutes les recettes du ravitaillement tombaient dans la caisse communale. Et cela servait, non à régler les factures dues au Comity, mais à payer les amendes et les impôts de guerre qu’infligeaient les Allemands. Lacombe évitait ainsi à ses amis les fermiers des impositions d’office. La Kommandantur imposait aux communes l’achat des farines allemandes, dites K. K., pour la confection du pain. Deux boulangers la recevaient, chacun par moitié. Le pain de Baille était mangeable. Celui d’Orchon, infect. Mais Orchon revendait en cachette une partie de la farine, et ne cuisait qu’à peine son pain pour gagner sur le poids. Comme il était ami de Lacombe, on ne pouvait rien dire, et il empoisonnait impunément la moitié de la population. À chaque séance de ravitaillement, c’étaient des batailles à qui serait servi le premier, pour recevoir du pain de Baille.
Pour un homme méticuleux et scrupuleux comme l’était Marellis, épris de balances exactes, de livres bien tenus, de comptabilités ordonnées et claires, un pareil gâchis était un perpétuel sujet de stupeur et d’exaspération.
Ce samedi-là, comme toutes les semaines, avait lien la « réunion du colonel », après laquelle se retrouvaient les membres de la commission du ravitaillement, afin de discuter des mesures nécessaires pour la semaine suivante. Marellis, qui avait passé son après-midi à compter des sacs de charbon et avait, une fois de plus, constaté un manquant scandaleux, arriva en retard à la réunion du colonel.
On y reçut, comme à l’ordinaire, des ordres pour l’administration du village. L’atmosphère était celle d’une réunion de vassaux recevant les volontés de leur suzerain. Le colonel arrivait, posait son épée nue sur la table, commandait :
– Messieurs, silence !
On se taisait. Et il commençait :
– J’ordonne… J’ordonne… J’ordonne…
Cela tombait comme un couperet.
Il questionna d’abord, le maire sur la qualité de la farine allemande K. K., celle qui servait à faire le célèbre pain « caca ». Lacombe affirma naturellement ! qu’elle était excellente.
Le colonel énuméra les sommes que paierait la Kommandantur aux fermiers pour leurs fournitures de beurre, d’œufs et de lait. Il infligea des amendes à la commune pour fournitures insuffisantes de denrées, pour des cabinets malpropres, des puits non abrités. Il donna des ordres pour la culture, pour la récolte des orties. On écoutait docilement. Lacombe devrait tuer un veau. Humfels placerait des tuteurs sous ses pommiers. Bozin entraverait son taureau méchant. Puis vinrent quelques nouveaux commandements, qui plongèrent les assistants dans la stupeur : J’ordonne :
« Étant donnés les cas de contagion qui se sont produits dans l’armée allemande, – dorénavant tous les hommes du village subiront une revue de santé.
« Les femmes indiquées sur la présente liste, et suspectes de mauvaises mœurs, se présenteront désormais chaque semaine à la visite médicale du major. La liste sera affichée à la porte de la Mairie.
« Les Maires de chaque commune seront tenus d’établir dans les huit jours une liste des malades, vieillards, enfants et bouches inutiles en général, en vue de leur évacuation vers la France…
« Messieurs, je lève la séance, et vous convoque ici à huitaine. Bonsoir. »
Il reprit son épée, s’inclina, s’en alla. Même dans cette façon de s’en aller, on sentait le maître.
―――
– Ainsi, disait Marellis une heure après, messieurs les fermiers sont en compte courant avec la Kommandantur ! Ils lui achètent et lui vendent, en reçoivent de l’argent ! Et voilà que la mairie va lui fournir des listes de proscriptions !
La commission du ravitaillement d’Herlem siégeait au sortir de la réunion du colonel. Marellis y représentait l’opposition.
– Nous sommes ici pour parler ravitaillement, dit Premelle, le secrétaire de mairie.
– Hé, parlons-en, cria Marellis. D’abord, j’attends toujours les comptes que nous devons fournir au Committee. Où en sommes-nous ? Y a-t-il un état des dépenses, des recettes ? Rien du tout ! Tout ce qu’on reçoit de la population tombe dans la caisse de la mairie, sert à payer les amendes, les ouvriers qui travaillent pour l’ennemi. Et le Committee là dedans ? Et les comptes séparés qu’il nous réclame ?
– Pour la recette qu’on fait ! dit Lacombe, c’est vraiment bien la peine de parler de tenir des livres !
– Parbleu ! la moitié du village ne paie pas son ravitaillement ! Les ouvriers enrôlés par l’ennemi ne paient pas ! Des commerçants ne paient pas ! Cuégain, le coiffeur, a une carte d’indigent ! Le baron des Parges ne paie pas sous prétexte qu’il ne reçoit plus ses fermages ! Et le peu d’argent qu’apportent les naïfs, vous le mêlez aux fonds communaux, et les Allemands vous le prennent. Le ravitaillement fait le jeu de l’ennemi, voilà !
– On ne peut pas forcer les gens à payer s’ils n’ont pas d’argent, dit Premelle.
– On peut au moins retenir sur le salaire des ouvriers, puisque c’est nous qui les payons. Et puis, il y en a tant qui pourraient payer…
– Est-ce que monsieur Premelle paie son ravitaillement ? Et monsieur Hérard ? coupa Serez, l’instituteur, qui soutenait Marellis.
– Ça ne vous regarde pas ! cria Hérard, qui était un rentier. On travaille, on donne sa peine…
– Et on prend le beurre et le fromage, et les emballages pour faire du feu, acheva Serez.
– Et le charbon ? reprit Marellis. Monsieur la Maire, j’ai compté quatre cent vingt sacs. Je trouve une facture de sept cent quarante. Ou sont passés les trois cent vingt sacs que nous n’avons pas reçus ?
Lacombe était devenu violacé. Il n’avait pas vu Marellis compter les sacs. Il bafouilla :
– Le wagon… en route… Je ne sais pas, moi…
– Et le beurre, et le fromage ? redit Serez.
– C’était du rabiot, je vous l’ai déjà dit, protesta Premelle, on ne peut tout de même pas peser au centigramme près !
– En tout cas, vous avez la main légère. Et les restes, vous pouviez les distribuer aux vieillards, aux enfants. Six kilos de beurre, quatre kilos de gruyère de reste, je trouve que c’est beaucoup…
– Maintenant, reprit Marellis, comment avez-vous osé, Monsieur le Maire, déclarer au colonel que le pain K. K. est bon ?
– Je le trouve bon, dit Lacombe.
– Vous n’en mangez pas ! Vous avez votre blé !
– On pourrait d’ailleurs l’amender, dit le curé. Le pain de Baille est de beaucoup meilleur que celui d’Orchon.
– Rien d’étonnant ! Orchon tripote, cuit à peine, mêle trop d’eau, revend de la farine en cachette…
– Alors, dit Premelle, vous préférez le favoritisme ? Vous aimez mieux qu’on avantage un boulanger au détriment de l’autre ? C’est bon, on donnera tout au même, puisque vous le voulez. Est-ce fini ?
– Non, dit Serez. Il y a plus grave que tout cela. Il y a cette question des évacuables. La mairie a déjà appelé les ouvriers au travail pour le compte de l’ennemi. Va-t-elle maintenant l’aider à expulser nos enfants et nos vieux, et se faire de nouveau l’auxiliaire des Allemands ? Monsieur le Maire, donnerez-vous cette liste d’évacuables ?
– Vous ne voulez tout de même pas que je me laisse flanquer en prison ? Que diable, c’est moi, le maire, ce n’est pas vous qui trinquerez si je n’obéis pas. Débrouillez-vous. Moi, j’obéis.
– À propos, coupa Hérart, il y a cette liste de femmes suspectes de contamination…
– Ah ! oui, fit Lacombe, heureux de la diversion. J’avais oublié.
Il tira la liste de sa poche. Il lut tout haut :
– Seront soumises chaque semaine à la visite médicale : la fille Augustine Godeaux…
– Pas étonnant, dit Serez.
– Les deux sœurs Debraine…
– Les mercières ! Pas possible !
On riait, on trouvait cela très drôle.
– La femme Houez, la fille Lacombe, la fille Norel…
Il avait lu machinalement. Il s’interrompit, au milieu d’un silence consterné. Il reprit le papier, relut, lâcha la feuille, regarda les autres d’un air égaré. Son visage était cramoisi. Il porta la main à son col, aspira l’air comme un homme qui étouffe. On crut qu’il crèverait sur place d’un coup de sang. Tout à coup, il se rua vers la porte et on le vit, par la fenêtre, se précipiter vers la Kommandantur.
―――
Dans la cuisine de la ferme Lacombe, les deux sœurs pétrissaient la pâte pour le pain. Elles levaient et laissaient retomber en lambeaux la lourde masse blanche dans le pétrin. Leurs bras nus enfarinés s’empâtaient jusqu’aux coudes. Une poussière de farine poudrait les dalles bleues du sol. Devant le poêle, la mère tournait le lait battu. On n’entendait que le grattement régulier de la louche raclant le fond de la marmite et le coup sourd de la pâte retombant dans le pétrin. Dehors, il faisait grand vent. Le soir venait, la bise pleurait.
La porte s’ouvrit brusquement. Lacombe entra. Il saisit son chapeau, le lança sur les dalles d’un geste furieux.
– Nom de D…
Les femmes sursautèrent. Il avait bu, bien sûr.
– Nom de D… de nom de D…
Il marcha vers sa femme, approcha de son visage sa face congestionnée et furieuse.
– Alors ! Laquelle de tes deux garces de filles s’est fait faire un gosse par les Boches ?
La mère Lacombe avait blêmi.
– Tu dis, Hector ? T’es fou ? Tu dis…
– Laquelle doit passer la visite ? Laquelle s’est fait avorter ? Hein ? Hein ? J’ai couru à la Kommandantur ! On s’est foutu de ma gueule ! On m’a dit que tous les Boches le savaient par le fossoyeur ! Hein ! Hein !
La mère n’avait rien entendu. Les vociférations de Lacombe ne la touchaient pas. Elle songeait éperdument au moyen de tout sauver, à l’excuse à trouver, tout de suite… Estelle mariée ! Que dirait Babet, le beau-fils, en revenant ? Scandale ! Déshonneur ! L’autre était fille, tout de même, libre…
– Vas-tu répondre ! hurla Lacombe, levant une main formidable.
Elle murmura :
– C’est… C’est…
Elle regardait Estelle, puis Judith. Elles se comprenaient. Elles avaient eu la même pensée, toutes les trois. L’honneur… Cette bizarre et grotesque conception de l’honneur de la famille.
– C’est qui ?
– Judith…
– Judith ?
Il fut frappé. Il avait confiance en sa cadette. Sa fureur s’en accrut.
– Judith ! Ah garce ! Ah femelle !
Il alla sur elle. Elle s’abritait, levait devant son visage ses mains encore engluées de pâte ; elle poussa un cri de terreur.
– Et avec qui, charogne ? Avec qui ? Avec qui ? Réponds, ou je te décarcasse !
– Albrecht… souffla Judith.
À cet instant, pour elle, on eût dit que c’était presque vrai. Elle éprouvait une espèce de joie sombre, de douceur inexplicable, à confesser ce crime qu’elle n’avait pas commis.
– Tu vas foutre le camp d’ici ! dit Lacombe.
Judith regarda tour à tour sa mère et sa sœur. Elles avaient l’air à la fois consternées et stupides, ne disaient pas un mot.
– Allez, ouste, fous le camp ! redit Lacombe.
– Hector ! gémit la mère.
– Toi…
Il s’était retourné vers elle, la main retournée pour une gifle. Elle recula, ne dit plus rien.
Judith, lentement, essuyait ses doigts où collait la pâte. Elle dénoua lentement son tablier, du geste d’une servante, le mit sur le dossier d’une chaise, sortit de la cuisine. On ne sait ce qui retint Lacombe, mais il n’osa pas la frapper.
―――
Elle alla demeurer dans une petite maison qu’elle trouva libre, au Mont d’Herlem, en face de la carrière Sennevilliers, à une centaine de mètres de la maison de Fanny. Albrecht l’aida. Il fit apporter pour elle des meubles volés dans des maisons inhabitées. Presque chaque soir, il venait la voir après l’ouvrage. Car il était demeuré à la ferme Lacombe, très naturellement. Lacombe n’avait rien osé lui dire. Avec ces bougres d’Allemands, savait-on jamais ? Surtout, Albrecht parti, qui le remplacerait ? On connaît ce qu’on perd, non ce qu’on trouve. Albrecht menait la ferme de main de maître, et Lacombe et lui s’entendaient admirablement pour le partage des petits profits. D’ailleurs, l’honneur était sauf. La coupable était chassée, l’outrage lavé aux yeux du village. Lacombe, maire d’Herlem, allait de nouveau le front haut parmi ses administrés.
Au reste, il était en train de dresser la liste des infirmes, malades et indésirables que la Kommandantur voulait refouler vers la France. C’était une épée de Damoclès qu’il tenait suspendue sur tout le village quecette menace d’exode, loin de la famille, de la maison. Lacombe pouvait frapper qui il voulait, et ne s’en faisait pas faute. Aussi lui témoignait-on, dans le village, la plus grande considération.
IV
Avec la prospérité des Lacombe, Humfels et autres gros fermiers, contrastait la détresse des Sennevilliers.
Les Sennevilliers, dans le village, subissaient l’inimitié générale. Le père Sennevilliers n’était qu’un modeste maçon. Il avait eu la hardiesse et commis le crime de deviner et d’exploiter une source de richesses que tout le monde dédaignait.
La carrière à craie existait depuis très longtemps. Elle avait été exploitée par Vauban au XVIIesiècle. Il en avait extrait de la chaux pour les fortifications de Menin. Elle était restée en activité jusque vers la Révolution. Depuis, abandonnée, elle s’était transformée en un profond étang poissonneux et inutile et que les gens fréquentaient peu, parce que de noirs récits couraient à son sujet. Cette eau dormante, encavée au fond d’une espèce de ravin sauvage, faisait impression sur les imaginations.
Sennevilliers le père racheta le trou au baron des Parges, pour en faire un vivier, dit-il. Il en paya le quart comptant, prit hypothèque pour le reste, bâtit de ses mains un four à chaux en briques et une cabane pour y loger. En dix ans, il avait remboursé l’hypothèque, édifié l’auberge et acheté autour de la carrière assez de terres pour s’attirer la solide inimitié de tous les fermiers du pays. Herlem, où la presque totalité du sol appartient au baron des Parges, et le reste à quelques gros fermiers, était demeuré, au milieu de l’essor industriel extraordinaire de la Flandre française, un îlot arriéré, réactionnaire, où l’étranger, le nouveau, l’inconnu, étaient rigoureusement tenus à l’écart. Le baron des Parges, possesseur d’une énorme fortune terrienne lentement accrue par le jeu même des événements, affectait l’orgueil de caste des anciens hobereaux, méprisait l’industrie et l’activité d’un homme tel que Sennevilliers. Les fermiers voyaient avec haine le chaufournier attirer la main-d’œuvre de la ville, payer de gros salaires, réclamer l’électrification, une voie ferrée, installer des machines, des pompes, des treuils et des Decauville. On essaya de l’étrangler, on lui refusa la terre, l’avance dont il avait besoin chaque année pour pousser plus avant l’exploitation du gisement. Mais le père Sennevilliers, sans avoir fréquenté l’école de Droit, ne manquait pas d’une malice retorse, qui l’aida à conquérir par ruse ce qu’on lui refusait de bon gré. Achats sous réserve de déclaration de command, locations avec promesses d’achat, options, manœuvres par tiers interposés, il utilisa tous les stratagèmes, fut bientôt célèbre chez les notaires du pays, prêta sur hypothèques, acheta des parcelles dans tous les coins pour les troquer contre celles qu’il lui fallait, mena toute sa vie durant une espèce de guerre patiente et sourde, de politique féodale d’accroissement et d’acquêts, d’alliances, d’échanges, d’encerclements. Quand il mourut, il laissait à Jean, le plus jeune de ses deux fils, qui reprenait l’affaire, un outil tout forgé, des terres suffisantes pour une exploitation presque illimitée, et la haine solide d’à peu près tous les puissants du village.
Après le départ de Jean, les Sennevilliers avaient été trois ou quatre jours dans l’angoisse. La mère et sa fille Lise habitaient l’auberge. Fannie, la femme de Jean, occupait avec Pierre, son petit garçon, la chaumière familiale, au haut du mont d’Herlem, où les Sennevilliers avaient autrefois vécu. Elles virent de la brûler Lille. Et dans le flot des légions allemandes poursuivant leur ruée vers la mer, Herlem fut submergé. Des hordes de Bavarois et de Saxons arrivèrent un soir, envahirent l’auberge, la mirent à sac, brûlèrent tables et chaises, dévastèrent la cave et les comptoirs, ruèrent les volailles, pillèrent les placards et s’en furent plus loin vers l’Ouest, laissant en ruines la grande maison de la carrière, si propre et si gaie la veille encore.
La vieille Berthe et sa fille Lise achevaient à peine de déblayer les décombres quand déferla une seconde vague. Et le pillage et la destruction recommencèrent. Cette fois, les Allemands ne partirent plus. Herlem était définitivement occupé.