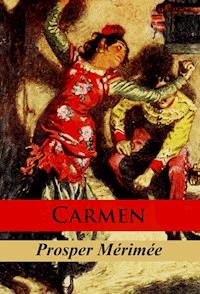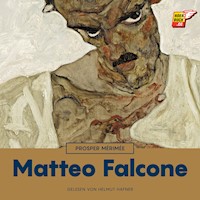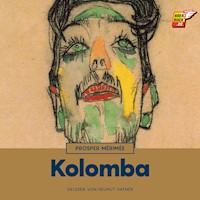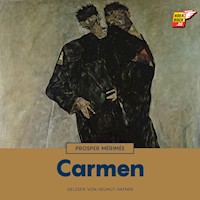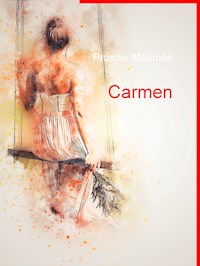
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Lors de son escapade en Espagne, Mérimée, un archéologue de renom, a fait la connaissance d'un voleur appelé José Navarro. En fuite, ce brigand est protégé par le narrateur contre l'arrestation. Quand Mérimée arrive à Cordoue, il rencontre une belle gitane surnommée Carmen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 97
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Carmen
Pages de titrePage de copyrightCarmen
Prosper Mérimée
J’avais toujours soupçonné les géographes de ne savoir ce qu’ils
disent lorsqu’ils placent le champ de bataille de Munda dans le pays
des BastuliPoeni, près de la moderne Monda, à quelque deux lieues
au nord de Marbella. D’après mes propres conjectures sur le texte de
l’anonyme, auteur du Bellum Hispaniense, et quelques
renseignements recueillis dans l’excellente bibliothèque du duc
d’ossuna, je pensais qu’il fallait chercher aux environs de Montilla le
lieu mémorable où, pour la dernière fois, César joua quitte ou double
contre les champions de la république. Me trouvant en Andalousie au
commencement de l’automne de 1830, je fis une assez longue
excursion pour éclaircir les doutes qui me restaient encore. Un
mémoire que je publierai prochainement ne laissera plus, je l’espère,
aucune incertitude dans l’esprit de tous les archéologues de bonne
foi. En attendant que ma dissertation résolve enfin le problème
géographique qui tient toute l’Europe savante en suspens, je veux
vous raconter une petite histoire, elle ne préjuge rien sur
l’intéressante question de l’emplacement de Munda.
J’avais loué à Cordoue un guide et deux chevaux, et m’étais mis
en campagne avec les Commentaires de César et quelques chemises
pour tout bagage. Certain jour errant dans la partie élevée de la plaine
de Cachena, harassé de fatigue, mourant de soif, brûlé par un soleil
de plomb, je donnais au diable de bon cœur César et les fils de
Pompée, lorsque j’aperçus, assez loin du sentier que je suivais, une
petite pelouse verte parsemée de joncs et de roseaux. Cela
m’annonçait le voisinage d’une source.
En effet, en m’approchant, je vis que la prétendue pelouse était un
marécage où se perdait un ruisseau, sortant, comme il semblait, d’une
gorge étroite entre deux hauts contreforts de la sierra de Cabra. Je
conclus qu’en remontant je trouverais de l’eau plus fraîche, moins de
sangsues et de grenouilles, et peutêtre un peu d’ombre au milieu des
rochers. À l’entrée de la gorge, mon cheval hennit, et un autre cheval,
que je ne voyais pas, lui répondit aussitôt. À peine eusje fait une
centaine de pas, que la gorge, s’élargissant tout à coup, me montra
une espèce de cirque naturel parfaitement ombragé par la hauteur des
escarpements qui l’entouraient. Il était impossible de rencontrer un
lieu qui promît au voyageur une halte plus agréable. Au pied de
rochers à pic, la source s’élançait en bouillonnant, et tombait dans un
petit bassin tapissé d’un sable blanc comme la neige. Cinq à six
beaux chênes verts, toujours à l’abri du vent et rafraîchis par la
source, s’élevaient sur ses bords, et la couvraient de leur épais
ombrage ; enfin, autour du bassin, une herbe fine, lustrée, offrait un
lit meilleur qu’on n’en eût trouvé dans aucune auberge à dix lieues à
la ronde.
À moi n’appartenait pas l’honneur d’avoir découvert un si beau
lieu. Un homme s’y reposait déjà, et sans doute dormait, lorsque j’y
pénétrai. Réveillé par les hennissements, il s’était levé, et s’était
rapproché de son cheval, qui avait profité du sommeil de son maître
pour faire un bon repas de l’herbe aux environs. C’était un jeune
gaillard, de taille moyenne, mais d’apparence robuste, au regard
sombre et fier son teint, qui avait pu être beau, était devenu, par
l’action du soleil, plus foncé que ses cheveux.
D’une main il tenait le licol de sa monture, de l’autre une
espingole de cuivre. J’avouerai que d’abord l’espingole et l’air
farouche du porteur me surprirent quelque peu ; mais je ne croyais
plus aux voleurs, à force d’en entendre parler et de n’en rencontrer
jamais. D’ailleurs, j’avais vu tant d’honnêtes fermiers s’armer
jusqu’aux dents pour aller au marché, que la vue d’une arme à jeu ne
m’autorisait pas à mettre en doute la moralité de l’inconnu.
— Et puis, me disaisje, que feraitil de mes chemises et de mes
Commentaires Elzevir ? Je saluai donc l’homme à l’espingole d’un
signe de tête familier et je lui demandai en souriant si j’avais troublé
son sommeil.
Sans me répondre, il me toisa de la tête aux pieds ; puis, comme
satisfait de son examen, il considéra avec la même attention mon
guide, qui s’avançait. Je vis celuici pâlir et s’arrêter en montrant une
terreur évidente. Mauvaise rencontre ! me disje. Mais la prudence
me conseilla aussitôt de ne laisser voir aucune inquiétude. Je mis
pied à terre ; je dis au guide de débrider, et, m’agenouillant au bord
de la source, j’y plongeai ma tête et mes mains ; puis je bus une
bonne gorgée, couché à plat ventre, comme les mauvais soldats de
Gédéon.
J’observais cependant mon guide et l’inconnu. Le premier
s’approchait bien à contrecœur ; l’autre semblait n’avoir pas de
mauvais desseins contre nous, car il avait rendu la liberté à son
cheval, et son espingole, qu’il tenait d’abord horizontale, était
maintenant dirigée vers la terre.
Ne croyant pas devoir me formaliser du peu de cas qu’on avait
paru faire de ma personne, je m’étendis sur l’herbe, et d’un air
dégagé je demandai à l’homme à l’espingole s’il n’avait pas un
briquet sur lui. En même temps je tirais mon étui à cigares.
L’inconnu, toujours sans parler fouilla dans sa poche, prit son
briquet, et s’empressa de me faire du feu.
Évidemment il s’humanisait ; car il s’assit en face de moi,
toutefois sans quitter son arme. Mon cigare allumé, je choisis le
meilleur de ceux qui me restaient, et je lui demandai s’il fumait.
— Oui, monsieur réponditil. C’étaient les premiers mots qu’il
faisait entendre, et je remarquai qu’il ne prononçait pas l’s à la
manière andalouse, d’où je conclus que c’était un voyageur comme
moi, moins archéologue seulement.
— Vous trouverez celuici assez bon, lui disje en lui présentant
un véritable régalia de la Havane.
Il me fit une légère inclination de tête, alluma son cigare au mien,
me remercia d’un signe de tête, puis se mit à fumer avec l’apparence
d’un très vif plaisir.
— Ah ! s’écriatil en laissant échapper lentement sa première
bouffée par la bouche et les narines, comme il y avait longtemps que
je n’avais fumé !
En Espagne, un cigare donné et reçu établit des relations
d’hospitalité, comme en Orient le partage du pain et du sel.
Mon homme se montra plus causant que je ne l’avais espéré.
D’ailleurs, bien qu’il se dît habitant du partido de Montilla, il
paraissait connaître le pays assez mal. Il ne savait pas le nom de la
charmante vallée où nous nous trouvions ; il ne pouvait nommer
aucun village des alentours ; enfin, interrogé par moi s’il n’avait pas
vu
aux environs des murs détruits, de larges tuiles à rebords, des
pierres sculptées, il confessa qu’il n’avait jamais fait attention à
pareilles choses. En revanche, il se montra expert en matière de
chevaux. Il critiqua le mien, ce qui n’était pas difficile ; puis il me fit
la généalogie du sien, qui sortait du fameux haras de Cordoue : noble
animal, en effet, si dur à la fatigue, à ce que prétendait son maître,
qu’il avait fait une fois trente lieues dans un jour, au galop ou au
grand trot. Au milieu de sa tirade, l’inconnu s’arrêta brusquement,
comme surpris et fâché d’en avoir trop dit.
— C’est que j’étais très pressé d’aller à Cordoue, repritil avec
quelque embarras. J’avais à solliciter les juges pour un procès… En
parlant, il regardait mon guide Antonio, qui baissait les yeux.
L’ombre et la source me charmèrent tellement, que je me souvins
de quelques tranches d’excellent jambon que mes amis de Montilla
avaient mis dans la besace de mon guide.
Je les fis apporter, et j’invitai l’étranger à prendre sa part de la
collation impromptue. S’il n’avait pas fumé depuis longtemps, il me
parut vraisemblable qu’il n’avait pas mangé depuis quarantehuit
heures au moins. Il dévorait comme un loup affamé. Je pensai que
ma rencontre avait été providentielle pour le pauvre diable. Mon
guide, cependant, mangeait peu, buvait encore moins, et ne parlait
pas du tout, bien que depuis le commencement de notre voyage il se
fût révélé à moi comme un bavard sans pareil. La présence de notre
hôte semblait le gêner, et une certaine méfiance les éloignait l’un de
l’autre sans que j’en devinasse positivement la cause.
Déjà les dernières miettes du pain et du jambon avaient disparu ;
nous avions fumé chacun un second cigare ; j’ordonnai au guide de
brider nos chevaux, et j’allais prendre congé de mon nouvel ami,
lorsqu’il me demanda où je comptais passer la nuit.
Avant que j’eusse fait attention à un signe de mon guide, j’avais
répondu que j’allais à la venta del Cuervo.
— Mauvais gîte pour une personne comme vous, monsieur… J’y
vais, et, si vous me permettez de vous accompagner, nous ferons
route ensemble.
— Très volontiers, disje en montant à cheval.
Mon guide, qui me tenait l’étrier, me fit un nouveau signe des
yeux. J’y répondis en haussant les épaules, comme pour l’assurer que
j’étais parfaitement tranquille, et nous nous mîmes en chemin.
Les signes mystérieux d’Antonio, son inquiétude, quelques mots
échappés à l’inconnu, surtout sa course de trente lieues et
l’explication peu plausible qu’il en avait donnée, avaient déjà formé
mon opinion sur le compte de mon compagnon de voyage. Je ne
doutai pas que je n’eusse affaire à un contrebandier peutêtre à un
voleur ; que m’importait ?
Je connaissais assez le caractère espagnol pour être très sûr de
n’avoir rien à craindre d’un homme qui avait mangé et fumé avec
moi. Sa présence même était une protection assurée contre toute
mauvaise rencontre. D’ailleurs, j’étais bien aise de savoir ce que c’est
qu’un brigand. On n’en voit pas tous les jours, et il y a un certain
charme à se trouver auprès d’un être dangereux, surtout lorsqu’on le
sent doux et apprivoisé.
J’espérais amener par degrés l’inconnu à me faire des
confidences, et, malgré les clignements d’yeux de mon guide, je mis
la conversation sur les voleurs de grand chemin. Bien entendu que
j’en parlai avec respect. Il y avait alors en Andalousie un fameux
bandit nommé JoséMaria, dont les exploits étaient dans toutes les
bouches.
— Si j’étais à côté de JoséMaria ? me disaisje… Je racontai les
histoires que je savais de ce héros, toutes à sa louange d’ailleurs, et
j’exprimai hautement mon admiration pour sa bravoure et sa
générosité.
— JoséMaria n’est qu’un drôle, dit froidement l’étranger
Se rendil justice, ou bien estce excès dé modestie de sa part ? me
demandaije mentalement ; car à force de considérer mon
compagnon, j’étais parvenu à lui appliquer le signalement de José
Maria, que j’avais lu affiché aux portes de mainte ville d’Andalousie.
Oui, c’est bien lui… Cheveux blonds, yeux bleus, grande bouche,
belles dents, les mains petites ; une chemise fine, une veste de
velours à boutons d’argent, des guêtres de peau blanche, un cheval
bai… Plus de doute ! Mais respectons son incognito.
Nous arrivâmes à la venta. Elle était telle qu’il me l’avait
dépeinte, c’estàdire une des plus misérables que j’eusse encore
rencontrées. Une grande pièce servait de cuisine, de salle à manger et
de chambre à coucher. Sur une pierre plate, le feu se faisait au milieu
de la chambre, et la fumée sortait par un trou pratiqué dans le toit, ou
plutôt s’arrêtait, formant un nuage à quelques pieds audessus du sol.
Le long du mur, on voyait étendues par terre cinq ou six vieilles
couvertures de mulets ; c’étaient les lits des voyageurs.
À vingt pas de la maison, ou plutôt de l’unique pièce que je viens
de décrire, s’élevait une espèce de hangar servant d’écurie. Dans ce
charmant séjour, il n’y avait d’autres êtres humains, du moins pour le
moment, qu’une vieille femme et une petite fille de dix à douze ans,
toutes les deux de couleur de suie et vêtues d’horribles haillons.
Voilà tout ce qui reste, me disje, de la population de l’antique
Munda Boetica ! ô César ! ô Sextus Pompée ! que vous seriez surpris
si vous reveniez au monde !
En apercevant mon compagnon, la vieille laissa échapper une
exclamation de surprise.
— Ah ! seigneur don José ! s’écriatelle.
Don José fronça le sourcil, et leva une main d’un geste d’autorité
qui arrêta la vieille aussitôt. Je me tournai vers mon guide, et, d’un
signe imperceptible, je lui fis comprendre qu’il n’avait rien à
m’apprendre sur le compte de l’homme avec qui j’allais passer la
nuit. Le souper fut meilleur que je ne m’y attendais. On nous servit,
sur une petite table haute d’un pied, un vieux coq fricassé avec du riz
et force piments, puis des piments à l’huile, enfin du gaspacho,
espèce de salade de piments. Trois plats ainsi épicés nous obligèrent
de recourir souvent à une outre de vin de Montilla qui se trouva
délicieux. Après avoir mangé, avisant une mandoline accrochée
contre la muraille, il y a partout des mandolines en Espagne, je
demandai à la petite fille qui nous servait si elle savait en jouer.
— Non, réponditelle ; mais don José en joue si bien !
— Soyez assez bon, lui disje, pour me chanter quelque chose ;
j’aime à la passion votre musique nationale.
— Je ne puis rien refuser à un monsieur si honnête, qui me donne
de si excellents cigares, s’écria don José d’un air de bonne humeur ;
et, s’étant fait donner la mandoline, il chanta en s’accompagnant. Sa
voix était rude, mais pourtant agréable, l’air mélancolique et bizarre ;
quant aux paroles, je n’en compris pas un mot.
— Si je ne me trompe, lui disje, ce n’est pas un air espagnol que
vous venez de chanter. Cela ressemble aux zorzicos que j’ai entendus
dans les Provinces, et les paroles doivent être en langue basque.
— Oui, répondit don José d’un air sombre. Il posa la mandoline à
terre, et, les bras croisés, il se mit à contempler le feu qui s’éteignait,
avec une singulière expression de tristesse. Éclairée par une lampe
posée sur la petite table, sa figure, à la fois noble et farouche, me
rappelait le Satan de Milton. Comme lui peutêtre, mon compagnon
songeait au séjour qu’il avait quitté, à l’exil qu’il avait encouru par
une faute. J’essayai de ranimer la conversation, mais il ne répondit
pas, absorbé qu’il était dans ses tristes pensées.
Déjà la vieille s’était couchée dans un coin de la salle, à l’abri
d’une couverture trouée tendue sur une corde. La petite fille l’avait
suivie dans cette retraite réservée au beau sexe. Mon guide alors, se
levant, m’invita à le suivre à l’écurie ; mais, à ce mot, don José,
comme réveillé en sursaut, lui demanda d’un ton brusque où il allait.
— À l’écurie, répondit le guide.
— Pour quoi faire ? Les chevaux ont à manger. Couche ici,
Monsieur le permettra.
— Je crains que le cheval de Monsieur ne soit malade ; je
voudrais que Monsieur le vît : peutêtre sauratil ce qu’il faut lui
faire.
Il était évident qu’Antonio voulait me parler en particulier ; mais
je ne me souciais pas de donner des soupçons à don José, et, au point
où nous en étions, il me semblait que le meilleur parti à prendre était
de montrer la plus grande confiance. Je répondis donc à Antonio que
je n’entendais rien aux chevaux, et que j’avais envie de dormir Don
José le suivit à l’écurie, d’où bientôt il revint seul. Il me dit que le
cheval n’avait rien, mais que mon guide le trouvait un animal si
précieux, qu’il le frottait avec sa veste pour le faire transpirer et qu’il
comptait passer la nuit dans cette douce occupation. Cependant, je
m’étais étendu sur les couvertures de mulets, soigneusement
enveloppé dans mon manteau, pour ne pas les toucher. Après m’avoir
demandé pardon de la liberté qu’il prenait de se mettre auprès de
moi, don José se coucha devant la porte, non sans avoir renouvelé
l’amorce de son espingole, qu’il eut soin de placer sous la besace qui
lui servait d’oreiller. Cinq minutes après, nous étions l’un et l’autre
profondément endormis.
Je me croyais assez fatigué pour pouvoir dormir dans un pareil
gîte ; mais, au bout d’une heure, de très désagréables démangeaisons
m’arrachèrent à mon premier somme. Dès que j’en eus compris la
nature, je me levai, persuadé qu’il valait mieux passer le reste de la
nuit à la belle étoile que sous ce toit inhospitalier.
Marchant sur la pointe du pied, je gagnai la porte, j’enjambai par
dessus la couche de don José, qui dormait du sommeil du juste, et je
fis si bien que je sortis de la maison sans qu’il s’éveillât. Auprès de la
porte était un large banc de bois ; je m’étendis dessus, et m’arrangeai
de mon mieux pour achever ma nuit. J’allais fermer les yeux pour la
seconde fois, quand il me sembla voir passer devant moi l’ombre
d’un homme et l’ombre d’un cheval, marchant l’un et l’autre sans
faire le moindre bruit. Je me mis sur mon séant, et je crus reconnaître
Antonio. Surpris de le voir hors de l’écurie à pareille heure, je me
levai et marchai à sa rencontre. Il s’était arrêté, m’ayant aperçu
d’abord.
— Où estil ? me demanda Antonio à voix basse.
— Dans la venta ; il dort ; il n’a pas peur des punaises. Pourquoi
donc emmenezvous ce cheval ?
Je remarquai alors que, pour ne pas faire de bruit en sortant du
hangar Antonio avait soigneusement enveloppé les pieds de l’animal
avec les débris d’une vieille couverture.
— Parlez plus bas, me dit Antonio, au nom de Dieu ! Vous ne
savez pas qui est cet hommelà. C’est José Navarro, le plus insigne
bandit de l’Andalousie. Toute la journée je vous ai fait des signes que
vous n’avez pas voulu comprendre.
— Bandit ou non, que m’importe ? répondisje ; il ne nous a pas
volés, et je parierais qu’il n’en a pas envie.
— À la bonne heure ; mais il y a deux cents ducats pour qui le
livrera. Je sais un poste de lanciers à une lieue et demie d’ici, et avant
qu’il soit jour, j’amènerai quelques gaillards solides. J’aurais pris son
cheval, mais il est si méchant que nul que le Navarro ne peut en
approcher.
— Que le diable vous emporte ! lui disje. Quel mal vous a fait ce
pauvre homme pour le dénoncer ? D’ailleurs, êtesvous sûr qu’il soit
le brigand que vous dites ?
— Parfaitement sûr ; tout à l’heure il m’a suivi dans l’écurie et
m’a dit : “Tu as l’air de me connaître ; si tu dis à ce bon monsieur qui
je suis, je te fais sauter la cervelle.” Restez, Monsieur restez auprès
de lui ; vous n’avez rien à craindre. Tant qu’il vous saura là, il ne se
méfiera de rien.
Tout en parlant, nous nous étions déjà assez éloignés de la venta
pour qu’on ne pût entendre les fers du cheval.
Antonio l’avait débarrassé en un clin d’œil des guenilles dont il lui
avait enveloppé les pieds ; il se préparait à enfourcher sa monture.
J’essayai prières et menaces pour le retenir.
— Je suis un pauvre diable, Monsieur me disaitil ; deux cents
ducats ne sont pas à perdre, surtout quand il s’agit de délivrer le pays
de pareille vermine. Mais prenez garde : si le Navarro se réveille, il
sautera sur son espingole, et gare à vous ! Moi, je suis trop avancé
pour reculer ; arrangezvous comme vous pourrez.
Le drôle était en selle ; il piqua des deux, et dans l’obscurité je
l’eus bientôt perdu de vue.
J’étais fort imité contre mon guide et passablement inquiet. Après
un instant de réflexion, je me décidai et rentrai dans la venta. Don
José dormait encore, réparant sans doute en ce moment les fatigues et
les veilles de plusieurs journées aventureuses. Je fus obligé de le
secouer rudement pour l’éveiller.
Jamais je n’oublierai son regard farouche et le mouvement qu’il
fit pour saisir son espingole, que, par mesure de précaution, j’avais
mise à quelque distance de sa couche.
— Monsieur lui disje, je vous demande pardon de vous éveiller ;
mais j’ai une sotte question à vous faire : seriezvous bien aise de
voir arriver ici une demidouzaine de lanciers ?
Il sauta en pieds, et d’une voix terrible :
— Qui vous l’a dit ? me demandatil.
— Peu importe d’où vient l’avis, pourvu qu’il soit bon.
— Votre guide m’a trahi, mais il me le payera ! Où estil ?
— Je ne sais… Dans l’écurie, je pense… mais quelqu’un m’a
dit…
— Qui vous a dit ?… Ce ne peut être la vieille…
— Quelqu’un que je ne connais pas… Sans plus de paroles, avez
vous, oui ou non, des motifs pour ne pas attendre les soldats ? Si
vous en avez, ne perdez pas de temps, sinon bonsoir et je vous
demande pardon d’avoir interrompu votre sommeil.
— Ah ! votre guide ! votre guide ! Je m’en étais méfié d’abord…
mais… son compte est bon !… Adieu, Monsieur. Dieu vous rende le
service que je vous dois. Je ne suis pas tout à fait aussi mauvais que
vous me croyez… oui, il y a encore en moi quelque chose qui mérite
la pitié d’un galant homme… Adieu, Monsieur.. Je n’ai qu’un regret,
c’est de ne pouvoir m’acquitter envers vous.
— Pour prix du service que je vous ai rendu, promettezmoi, don
José, de ne soupçonner personne, de ne pas songer à la vengeance.
Tenez, voilà des cigares pour votre route ; bon voyage ! Et je lui
tendis la main.
Il me la serra sans répondre, prit son espingole et sa besace, et,
après avoir dit quelques mots à la vieille dans un argot que je ne pus
comprendre, il courut au hangar.
Quelques instants après, je l’entendais galoper dans la campagne.
Pour moi, je me recouchai sur mon banc, mais je ne me rendormis
point. Je me demandais si j’avais eu raison de sauver de la potence
un voleur et peutêtre un meurtrier et cela seulement parce que
j’avais mangé du jambon avec lui et du riz à la valencienne. N’avais
je pas trahi mon guide qui soutenait la cause des lois ; ne l’avaisje
pas exposé à la vengeance d’un scélérat ? Mais les devoirs de
l’hospitalité !…
Préjugé de sauvage, me disaisje ; j’aurai à répondre de tous les
crimes que le bandit va commettre… Pourtant estce un préjugé que
cet instinct de conscience qui résiste à tous les raisonnements ? Peut
être, dans la situation délicate où je me trouvais, ne pouvaisje m’en
tirer sans remords. Je flottais encore dans la plus grande incertitude
au sujet de la moralité de mon action, lorsque je vis paraître une demi
douzaine de cavaliers avec Antonio, qui se tenait prudemment à
l’arrièregarde. J’allai audevant d’eux, et les prévins que le bandit
avait pris la fuite depuis plus de deux heures.
La vieille, interrogée par le brigadier répondit qu’elle connaissait
le Navarro, mais que, vivant seule, elle n’aurait jamais osé risquer sa
vie en le dénonçant. Elle ajouta que son habitude, lorsqu’il venait
chez elle, était de partir toujours au milieu de la nuit.
Pour moi, il me fallut aller, à quelques lieues de là, exhiber mon
passeport et signer une déclaration devant un alcade, après quoi on
me permit de reprendre mes recherches archéologiques. Antonio me
gardait rancune, soupçonnant que c’était moi qui l’avais empêché de
gagner les deux cents ducats. Pourtant nous nous séparâmes bons
amis à Cordoue ; là, je lui donnai une gratification aussi forte que
l’état de mes finances pouvait me le permettre.
Je passai quelques jours à Cordoue. On m’avait indiqué certain
manuscrit de la bibliothèque des Dominicains, où je devais trouver
des renseignements intéressants sur l’antique Munda. Fort bien
accueilli par les bons Pères, je passais les journées dans leur couvent,
et le soir je me promenais par la ville. À Cordoue, vers le coucher du
soleil, il y a quantité d’oisifs sur le quai qui borde la rive droite du
Guadalquivir. Là, on respire les émanations d’une tannerie qui
conserve encore l’antique renommée du pays pour la préparation des
cuirs ; mais, en revanche, on y jouit d’un spectacle qui a bien son
mérite. Quelques minutes avant l’angélus, un grand nombre de
femmes se rassemblent sur le bord du fleuve, au bas du quai, lequel
est assez élevé. Pas un homme n’oserait se mêler à cette troupe.
Aussitôt que l’angélus sonne, il est censé qu’il fait nuit. Au dernier
coup de cloche, toutes ces femmes se déshabillent et entrent dans
l’eau. Alors ce sont des cris, des rires, un tapage infernal. Du haut du
quai, les hommes contemplent les baigneuses, écarquillent les yeux,
et ne voient pas grandchose.
Cependant ces formes blanches et incertaines qui se dessinent sur
le sombre azur du fleuve, font travailler les esprits poétiques, et, avec
un peu d’imagination, il n’est pas difficile de se représenter Diane et
ses nymphes au bain, sans avoir à craindre le sort d’Actéon.
On m’a dit que quelques mauvais garnements se cotisèrent certain
jour, pour graisser la patte au sonneur de la cathédrale et lui faire
sonner l’angélus vingt minutes avant l’heure légale. Bien qu’il fît
encore grand jour, les nymphes du Guadalquivir n’hésitèrent pas, et
se fiant plus à l’angélus qu’au soleil, elles firent en sûreté de
conscience leur toilette de bain, qui est toujours des plus simples. Je
n’y étais pas.
De mon temps, le sonneur était incorruptible, le crépuscule peu
clair, et un chat seulement aurait pu distinguer la plus vieille
marchande d’oranges de la plus jolie grisette de Cordoue.
Un soir, à l’heure où l’on ne voit plus rien, je fumais, appuyé sur
le parapet du quai, lorsqu’une femme, remontant l’escalier qui
conduit à la rivière, vint s’asseoir près de moi. Elle avait dans les
cheveux un gros bouquet de jasmin, dont les pétales exhalent le soir
une odeur enivrante. Elle était simplement, peutêtre pauvrement
vêtue, tout en noir comme la plupart des grisettes dans la soirée. Les
femmes comme il faut ne portent le noir que le matin ; le soir, elles
s’habillent a la francesa. En arrivant auprès de moi, ma baigneuse
laissa glisser sur ses épaules la mantille qui lui couvrait la tête, et, à
l’obscure clarté qui tombe des étoiles, je vis qu’elle était petite,
jeune, bien faite, et qu’elle avait de très grands yeux. Je jetai mon
cigare aussitôt. Elle comprit cette attention d’une politesse toute
française, et se hâta de me dire qu’elle aimait beaucoup l’odeur du
tabac, et que même elle fumait, quand elle trouvait des papelitos bien
doux. Par bonheur j’en avais de tels dans mon étui, et je m’empressai
de lui en offrir. Elle daigna en prendre un, et l’alluma à un bout de
corde enflammé qu’un enfant nous apporta moyennant un sou.
Mêlant nos fumées, nous causâmes si longtemps, la belle baigneuse
et moi, que nous nous trouvâmes presque seuls sur le quai. Je crus
n’être point indiscret en lui offrant d’aller prendre des glaces à la
neveria.
Après une hésitation modeste elle accepta ; mais avant de se
décider elle désira savoir quelle heure il était. Je fis sonner ma
montre, et cette sonnerie parut l’étonner beaucoup.
— Quelles inventions on a chez vous, messieurs les étrangers ! De
quel pays êtesvous, monsieur ? Anglais sans doute ?
— Français et votre grand serviteur. Et vous mademoiselle, ou
madame, vous êtes probablement de Cordoue ?
— Non.
— Vous êtes du moins Andalouse. Il me semble le reconnaître à
votre doux parler
— Si vous remarquez si bien l’accent du monde, vous devez bien
deviner qui je suis.
— Je crois que vous êtes du pays de Jésus, à deux pas du paradis.
(J’avais appris cette métaphore, qui désigne l’Andalousie, de mon
ami Francisco Sevilla, picador bien connu.)
— Bah ! le paradis… Les gens d’ici disent qu’il n’est pas fait pour
nous.
— Alors, vous seriez donc Moresque, ou… je m’arrêtai, n’osant
dire juive.
— Allons, allons ! vous voyez bien que je suis bohémienne ;
voulezvous que je vous dise la bajia ? Avezvous entendu parler de
la Carmencita ? C’est moi.
J’étais alors un tel mécréant, il y a de cela quinze ans, que je ne
reculai pas d’horreur en me voyant à côté d’une sorcière.
Bon ! me disje ; la semaine passée, j’ai soupé avec un voleur de
grands chemins, allons aujourd’hui prendre des glaces avec une
servante du diable. En voyage il faut tout voir.
J’avais encore un autre motif pour cultiver sa connaissance.
Sortant du collège, je l’avouerai à ma honte, j’avais perdu quelque
temps à étudier les sciences occultes et même plusieurs fois j’avais
tenté de conjurer l’esprit de ténèbres.
Guéri depuis longtemps de la passion de semblables recherches, je
n’en conservais pas moins un certain attrait de curiosité pour toutes
les superstitions, et me faisais une fête d’apprendre jusqu’où s’était
élevé l’art de la magie parmi les Bohémiens.
Tout en causant, nous étions entrés dans la neveria, et nous étions
assis à une petite table éclairée par une bougie renfermée, dans un
globe de verre.
J’eus alors tout le loisir d’examiner ma gitana pendant que
quelques honnêtes gens s’ébahissaient, en prenant leurs glaces, de me
voir en si bonne compagnie.
Je doute fort que mademoiselle Carmen fût de race pure, du moins
elle était infiniment plus jolie que toutes les femmes de sa nation que
j’aie jamais rencontrées.
Pour qu’une femme soit belle, il faut, disent les Espagnols, qu’elle
réunisse trente si, ou, si l’on veut, qu’on puisse la définir au moyen
de dix adjectifs applicables chacun à trois parties de sa personne. Par
exemple, elle doit avoir trois choses noires : les yeux, les paupières et
les sourcils ; trois fines, les doigts, les lèvres, les cheveux, etc. Voyez
Brantôme pour le reste. Ma bohémienne ne pouvait prétendre à tant
de perfections. Sa peau, d’ailleurs parfaitement unie, approchait fort
de la teinte du cuivre. Ses yeux étaient obliques, mais admirablement
fendus ; ses lèvres un peu fortes, mais bien dessinées et laissant voir
des dents plus blanches que des amandes sans leur peau. Ses
cheveux, peutêtre un peu gros, étaient noirs, à reflets bleus comme
l’aile d’un corbeau, longs et luisants. Pour ne pas vous fatiguer d’une
description trop prolixe, je vous dirai en somme qu’à chaque défaut
elle réunissait une qualité qui ressortait peutêtre plus fortement par
le contraste. C’était une beauté étrange et sauvage, une figure qui
étonnait d’abord, mais qu’on ne pouvait oublier. Ses yeux surtout
avaient une expression à la fois voluptueuse et farouche que je n’ai
trouvée depuis à aucun regard humain.
Œil de bohémien, œil de loup, c’est un dicton espagnol qui dénote
une bonne observation. Si vous n’avez pas le temps d’aller au jardin
des Plantes pour étudier le regard d’un loup, considérez votre chat
quand il guette un moineau.
On sent qu’il eût été ridicule de se faire tirer la bonne aventure
dans un café. Aussi je priai la jolie sorcière de me permettre de
l’accompagner à son domicile ; elle y consentit sans difficulté, mais
elle voulut connaître encore la marche du temps, et me pria de
nouveau de faire sonner ma montre.
— Estelle vraiment d’or ? ditelle en la considérant avec une
excessive attention.
Quand nous nous remîmes en marche, il était nuit close ; la
plupart des boutiques étaient fermées et les rues presque désertes.
Nous passâmes le pont du Guadalquivir, et à l’extrémité du faubourg
nous nous arrêtâmes devant une maison qui n’avait nullement
l’apparence d’un palais. Un enfant nous ouvrit. La bohémienne lui
dit quelques mots dans une langue à moi inconnue, que je sus depuis
être la rommani ou chipe calli, l’idiome des gitanos. Aussitôt l’enfant
disparut, nous laissant dans une chambre assez vaste, meublée d’une
petite table, de deux tabourets et d’un coffre. Je ne dois point oublier
une jarre d’eau, un tas d’oranges et une botte d’oignons.
Dès que nous fûmes seuls, la bohémienne tira de son coffre des
cartes qui paraissaient avoir beaucoup servi, un aimant, un caméléon
desséché, et quelques autres objets nécessaires à son art. Puis elle me
dit de faire la croix dans ma main gauche avec une pièce de monnaie,
et les cérémonies magiques commencèrent. Il est inutile de vous
rapporter ses prédictions, et, quant à sa manière d’opérer, il était
évident qu’elle n’était pas sorcière à demi.
Malheureusement nous fûmes bientôt dérangés. La porte s’ouvrit
tout à coup avec violence, et un homme, enveloppé jusqu’aux yeux
dans un manteau brun entra dans la chambre en apostrophant la
bohémienne d’une façon peu gracieuse. Je n’entendais pas ce qu’il
disait, mais le ton de sa voix indiquait qu’il était de fort mauvaise
humeur.
À sa vue, la gitana ne montra ni surprise ni colère, mais elle
accourut à sa rencontre, et, avec une volubilité extraordinaire, lui
adressa quelques phrases dans la langue mystérieuse dont elle s’était
déjà servie devant moi. Le mot de payllo, souvent répété, était le seul
mot que je comprisse. Je savais que les bohémiens désignent ainsi
tout homme étranger à leur race. Supposant qu’il s’agissait de moi, je
m’attendais à une explication délicate ; déjà j’avais la main sur le
pied d’un des tabourets, et je syllogisais à part moi pour deviner le
moment précis où il conviendrait de le jeter à la tête de l’intrus.
Celuici repoussa rudement la bohémienne, et s’avança vers moi ;
puis, reculant d’un pas :
— Ah ! Monsieur ditil, c’est vous !
Je le regardai à mon tour et reconnus mon ami don José.
En ce moment, je regrettais un peu de ne pas l’avoir laissé pendre.
— Eh ! c’est vous, mon brave ! m’écriaije en riant le moins jaune
que je pus ; vous avez interrompu mademoiselle au moment où elle
m’annonçait des choses bien intéressantes.
— Toujours la même ! Ça finira, ditil entre ses dents, attachant
sur elle un regard farouche.
Cependant la bohémienne continuait à lui parler dans sa langue.
Elle s’animait par degrés. Son œil s’injectait de sang et devenait
terrible, ses traits se contractaient, elle frappait du pied. Il me sembla
qu’elle le pressait vivement de faire quelque chose à quoi il montrait
de l’hésitation. Ce que c’était, je croyais ne le comprendre que trop à
la voir passer et repasser rapidement sa petite main sous son menton.
J’étais tenté de croire qu’il s’agissait d’une gorge à couper et
j’avais quelques soupçons que cette gorge ne fût la mienne.
À tout ce torrent d’éloquence, don José ne répondit que par deux
ou trois mots prononcés d’un ton bref. Alors la bohémienne lui lança
un regard de profond mépris ; puis, s’asseyant à la turque dans un
coin de la chambre, elle choisit une orange, la pela et se mit à la
manger.
Don José me prit le bras, ouvrit la porte et me conduisit dans la
rue. Nous fîmes environ deux cents pas dans le plus profond silence.
Puis, étendant la main :
— Toujours tout droit, ditil, et vous trouverez le pont.
Aussitôt il me tourna le dos et s’éloigna rapidement. Je revins à
mon auberge un peu penaud et d’assez mauvaise humeur. Le pire fut
qu’en me déshabillant, je m’aperçus que ma montre me manquait.
Diverses considérations m’empêchèrent d’aller la réclamer le
lendemain, ou de solliciter M. le corrégidor pour qu’il voulût bien la
faire chercher. Je terminai mon travail sur le manuscrit des
Dominicains et je partis pour Séville.
Après plusieurs mois de courses errantes en Andalousie, je voulus
retourner à Madrid, et il me fallut repasser par Cordoue. Je n’avais
pas l’intention d’y faire un long séjour car j’avais pris en grippe cette
belle ville et les baigneuses du Guadalquivir. Cependant quelques
amis à revoir quelques commissions à faire devaient me retenir au
moins trois ou quatre jours dans l’antique capitale des princes
musulmans.
Dès que je reparus au couvent des Dominicains, un des pères qui
m’avait toujours montré un vif intérêt dans mes recherches sur
l’emplacement de Munda, m’accueillit les bras ouverts, en s’écriant :
— Loué soit le nom de Dieu ! Soyez le bienvenu, mon cher ami.
Nous vous croyions tous mort, et moi, qui vous parle, j’ai récité bien
des pater et des ave, que je ne regrette pas, pour le salut de votre âme.
Ainsi vous n’êtes pas assassiné, car pour volé nous savons que vous
l’êtes ?
— Comment cela ? lui demandaije un peu surpris.
— Oui, vous savez bien, cette belle montre à répétition que vous
faisiez sonner dans la bibliothèque, quand nous vous disions qu’il
était temps d’aller au chœur Eh bien ! elle est retrouvée, on vous la
rendra.
— C’estàdire, interrompisje un peu décontenancé, que je l’avais
égarée…
— Le coquin est sous les verrous, et, comme on savait qu’il était
homme à tirer un coup de fusil à un chrétien pour lui prendre une
piécette, nous mourions de peur qu’il ne vous eût tué. J’irai avec
vous chez le corrégidor, et nous vous ferons rendre votre belle
montre. Et puis, avisezvous de dire làbas que la justice ne sait pas
son métier en Espagne !
— Je vous avoue, lui disje, que j’aimerais mieux perdre ma
montre que de témoigner en justice pour faire pendre un pauvre
diable, surtout parce que… parce que…
— Oh ! n’ayez aucune inquiétude ; il est bien recommandé, et on
ne peut le pendre deux fois. Quand je dis pendre, je me trompe. C’est
un hidalgo que votre voleur ; il sera donc garrotté aprèsdemain sans
rémission. Vous voyez qu’un vol de plus ou de moins ne changera
rien à son affaire. Plût à Dieu qu’il n’eût que volé ! mais il a commis
plusieurs meurtres, tous plus horribles les uns que les autres.
— Comment se nommetil ?
— On le connaît dans le pays sous le nom de José Navarro ; mais
il a encore un autre nom basque, que ni vous ni moi ne prononcerons
jamais. Tenez, c’est un homme à voir, et vous qui aimez à connaître
les singularités du pays, vous ne devez pas négliger d’apprendre
comment en Espagne les coquins sortent de ce monde. Il est en
chapelle, et le père Martinez vous y conduira.
Mon Dominicain insista tellement pour que je visse les apprêts du
“petit pendement pien choli”, que je ne pus m’en défendre. J’allai
voir le prisonnier, muni d’un paquet de cigares qui, je l’espérais,
devaient lui faire excuser mon indiscrétion.
On m’introduisit auprès de don José, au moment où il prenait son
repas. Il me fit un signe de tête assez froid, et me remercia poliment
du cadeau que je lui apportais.
Après avoir compté les cigares du paquet que j’avais mis entre ses
mains, il en choisit un certain nombre et me rendit le reste, observant
qu’il n’avait pas besoin d’en prendre davantage.
Je lui demandai si, avec un peu d’argent, ou par le crédit de mes
amis, je pourrais obtenir quelque adoucissement à son sort. D’abord
il haussa les épaules en souriant avec tristesse ; bientôt, se ravisant, il
me pria de faire dire une messe pour le salut de son âme.
— Voudriezvous, ajoutatil timidement, voudriezvous en faire
dire une autre pour une personne qui vous a offensé ?
— Assurément, mon cher lui disje ; mais personne, que je sache,
ne m’a offensé en ce pays.
Il me prit la main et la serra d’un air grave. Après un moment de
silence, il reprit :
— Oseraije encore vous demander un service ?… Quand vous
reviendrez dans votre pays, peutêtre passerezvous par la Navarre :
au moins vous passerez par Vittoria, qui n’en est pas fort éloignée.
— Oui, lui disje, je passerai certainement par Vittoria ; mais il
n’est pas impossible que je me détourne pour aller à Pampelune, et, à
cause de vous, je crois que je ferais volontiers ce détour.
— Eh bien ! si vous allez à Pampelune, vous y verrez plus d’une
chose qui vous intéressera… C’est une belle ville… Je vous donnerai
cette médaille (il me montrait une petite médaille d’argent qu’il
portait au cou), vous l’envelopperez dans du papier.. il s’arrêta un
instant pour maîtriser son émotion… et vous la remettrez ou vous la
ferez remettre à une bonne femme dont je vous dirai l’adresse.
— Vous direz que je suis mort, vous ne direz pas comment. Je
promis d’exécuter sa commission.
Je le revis le lendemain, et je passai une partie de la journée avec
lui. C’est de sa bouche que j’ai appris les tristes aventures qu’on va
lire.
— Je suis né, ditil, à Elizondo, dans la vallée de Baztan. Je
m’appelle don José Lizarrabengoa, et vous connaissez assez
l’Espagne, Monsieur, pour que mon nom vous dise aussitôt que je
suis Basque et vieux chrétien. Si je prends le don, c’est que j’en ai le
droit, et si j’étais à Elizondo, je vous montrerais ma généalogie sur
parchemin. On voulait que je fusse d’église, et l’on me fit étudier
mais je ne profitais guère. J’aimais trop à jouer à la paume, c’est ce
qui m’a perdu.
Quand nous jouons à la paume, nous autres Navarrais, nous
oublions tout. Un jour que j’avais gagné, un gars de l’Alava me
chercha querelle ; nous prîmes nos maquilas, et j’eus encore
l’avantage ; mais cela m’obligea de quitter le pays. Je rencontrai des
dragons, et je m’engageai dans le régiment d’Almanza, cavalerie. Les
gens de nos montagnes apprennent vite le métier militaire. Je devins
bientôt brigadier et on me promettait de me faire maréchal des logis,
quand, pour mon malheur on me mit de garde à la manufacture de
tabacs à Séville. Si vous êtes allé à Séville, vous aurez vu ce grand
bâtimentlà, hors des remparts, près du Guadalquivir. Il me semble
en voir encore la porte et le corps de garde auprès. Quand ils sont de
service, les Espagnols jouent aux cartes, ou dorment ; moi, comme
un franc Navarrais, je tâchais toujours de m’occuper. Je faisais une
chaîne avec du fil de laiton, pour tenir mon épinglette. Tout d’un
coup, les camarades disent : Voilà la cloche qui sonne ; les filles vont
rentrer à l’ouvrage. Vous saurez, monsieur, qu’il y a bien quatre à
cinq cents femmes occupées dans la manufacture. Ce sont elles qui
roulent les cigares dans une grande salle, où les hommes n’entrent
pas sans une permission du vingtquatre, parce qu’elles se mettent à
leur aise, les jeunes surtout, quand il fait chaud. À l’heure où les
ouvrières rentrent, après leur dîner, bien des jeunes gens vont les voir
passer et leur en content de toutes les couleurs. Il y a peu de ces
demoiselles qui refusent une mantille de taffetas, et les amateurs, à
cette pêchelà, n’ont qu’à se baisser pour prendre le poisson. Pendant
que les autres regardaient, moi, je restais sur mon banc, près de la
porte.
J’étais jeune alors ; je pensais toujours au pays, et je ne croyais
pas qu’il y eût de jolies filles sans jupes bleues et sans nattes tombant
sur les épaules.
D’ailleurs, les Andalouses me faisaient peur ; je n’étais pas encore
fait à leurs manières : toujours à railler jamais un mot de raison.
J’étais donc le nez sur ma chaîne, quand j’entends des bourgeois
qui disaient : Voilà la gitanilla ! Je levai les yeux, et je la vis. C’était
un vendredi, et je ne l’oublierai jamais. Je vis cette Carmen que vous
connaissez, chez qui je vous ai rencontré il y a quelques mois.
Elle avait un jupon rouge fort court qui laissait voir des bas de
soie blancs avec plus d’un trou, et des souliers mignons de maroquin
rouge attachés avec des rubans couleur de feu. Elle écartait sa
mantille afin de montrer ses épaules et un gros bouquet de cassie qui
sortait de sa chemise. Elle avait encore une fleur de cassie dans le
coin de la bouche, et elle s’avançait en se balançant sur ses hanches
comme une pouliche du haras de Cordoue. Dans mon pays, une
femme en ce costume aurait obligé le monde à se signer. À Séville,
chacun lui adressait quelque compliment gaillard sur sa tournure ;
elle répondait à chacun, faisant les yeux en coulisse, le poing sur la
hanche, effrontée comme une vraie bohémienne qu’elle était.
D’abord elle ne me plut pas, et je repris mon ouvrage ; mais elle,
suivant l’usage des femmes et des chats qui ne viennent pas quand on
les appelle et qui viennent quand on ne les appelle pas, s’arrêta
devant moi et m’adressa la parole :
— Compère, me ditelle à la façon andalouse, veuxtu me donner
ta chaîne pour tenir les clefs de mon coffrefort ?
— C’est pour attacher mon épinglette, lui répondisje.
— Ton épinglette ! s’écriatelle en riant. Ah ! monsieur fait de la
dentelle, puisqu’il a besoin d’épingles ! Tout le monde qui était là se
mit à rire, et moi je me sentais rougir, et je ne pouvais trouver rien à
lui répondre.
— Allons, mon cœur, repritelle, faismoi sept aunes de dentelle
noire pour une mantille, épinglier de mon âme !
— Et prenant la fleur de cassie qu’elle avait à la bouche, elle me
la lança, d’un mouvement du pouce, juste entre les deux yeux.
Monsieur cela me fit l’effet d’une balle qui m’arrivait… Je ne savais
où me fourrer, je demeurais immobile comme une planche.
Quand elle fut entrée dans la manufacture, je vis la fleur de cassie
qui était tombée à terre entre mes pieds ; je ne sais ce qui me prit,
mais je la ramassai sans que mes camarades s’en aperçussent et je la
mis précieusement dans ma veste.
Première sottise !
Deux ou trois heures après, j’y pensais encore, quand arrive dans
le corps de garde un portier tout haletant, la figure renversée. Il nous
dit que dans la grande salle des cigares il y avait une femme
assassinée, et qu’il fallait y envoyer la garde. Le maréchal me dit de
prendre deux hommes et d’y aller voir. Je prends mes hommes et je
monte. Figurezvous, monsieur, qu’entré dans la salle je trouve
d’abord trois cents femmes en chemise, ou peu s’en faut, toutes
criant, hurlant, gesticulant, faisant un vacarme à ne pas entendre Dieu
tonner.
D’un côté, il y en avait une, les quatre fers en l’air, couverte de
sang, avec un X sur la figure qu’on venait de lui marquer en deux
coups de couteau. En face de la blessée, que secouraient les
meilleures de la bande, je vois Carmen tenue par cinq ou six
commères. La femme blessée criait : Confession ! confession ! je
suis morte !
Carmen ne disait rien ; elle serrait les dents, et roulait des yeux
comme un caméléon.
— Qu’estce que c’est ? demandaije.
J’eus grandpeine à savoir ce qui s’était passé, car toutes les
ouvrières me parlaient à la fois. Il paraît que la femme blessée s’était
vantée d’avoir assez d’argent en poche pour acheter un âne au
marché de Triana.
— Tiens, dit Carmen qui avait une langue, tu n’as donc pas assez
d’un balai ?
— L’autre, blessée du reproche, peutêtre parce qu’elle se sentait
véreuse sur l’article, lui répond qu’elle ne se connaissait pas en
balais, n’ayant pas l’honneur d’être bohémienne ni filleule de Satan,
mais que mademoiselle Carmencita ferait bientôt connaissance avec
son âne, quand M. le corrégidor la mènerait à la promenade avec
deux laquais parderrière pour l’émoucher.
— Eh bien, moi, dit Carmen, je te ferai des abreuvoirs à mouches
sur la joue, et je veux y peindre un damier
— Làdessus, vlivlan ! elle commence, avec le couteau dont elle
coupait le bout des cigares, à lui dessiner des croix de SaintAndré
sur la figure.
Le cas était clair ; je pris Carmen par le bras :
— Ma sœur lui disje poliment, il faut me suivre.
Elle me lança un regard comme si elle me reconnaissait ; mais elle
dit d’un air résigné :
— Marchons. Où est ma mantille ?
Elle la mit sur sa tête de façon à ne montrer qu’un seul de ses
grands yeux, et suivit mes deux hommes, douce comme un mouton.
Arrivés au corps de garde, le maréchal des logis dit que c’était grave,
et qu’il fallait la mener à la prison.
C’était encore moi qui devais la conduire. Je la mis entre deux
dragons et je marchais derrière comme un brigadier doit faire en
semblable rencontre. Nous nous mîmes en route pour la ville.
D’abord la bohémienne avait gardé le silence ; mais dans la rue du
Serpent,
— Vous la connaissez, elle mérite bien son nom par les détours
qu’elle fait.
Dans la rue du Serpent, elle commence par laisser tomber sa
mantille sur ses épaules, afin de me montrer son minois enjôleur, et,
se tournant vers moi autant qu’elle pouvait, elle me dit :
— Mon officier ou me menezvous ?
— À la prison, ma pauvre enfant, lui répondisje le plus
doucement que je pus, comme un bon soldat doit parler à un
prisonnier, surtout à une femme.
— Hélas ! que deviendraije ? Seigneur officier, ayez pitié de moi.
Vous êtes si jeune, si gentil !… Puis, d’un ton plus bas : Laissezmoi
m’échapper, ditelle, je vous donnerai un morceau de la bar lachi, qui
vous fera aimer de toutes les femmes. La bar lachi, monsieur c’est la
pierre d’aimant, avec laquelle les bohémiens prétendent qu’on fait
quantité de sortilèges quand on sait s’en servir Faitesen boire à une
femme une pincée râpée dans un verre de vin blanc, elle ne résiste
plus.
Moi, je lui répondis le plus sérieusement que je pus :
— Nous ne sommes pas ici pour dire des balivernes ; il faut aller à
la prison, c’est la consigne, et il n’y a pas de remède. Nous autres
gens du pays basque, nous avons un accent qui nous fait reconnaître
facilement des Espagnols ; en revanche, il n’y en a pas un qui puisse
seulement apprendre à dire baï jaona. Carmen donc n’eut pas de
peine à deviner que je venais des provinces. Vous saurez que les
bohémiens, monsieur, comme n’étant d’aucun pays, voyageant
toujours, parlent toutes les langues, et la plupart sont chez eux en
Portugal, en France, dans les provinces, en Catalogne, partout ;
même avec les Maures et les Anglais, ils se font entendre. Carmen
savait assez bien le basque.
— Laguna, ene bihotsarena, camarade de mon cœur, me ditelle
tout à coup, êtesvous du pays ?
Notre langue, monsieur, est si belle, que, lorsque nous
l’entendons. en pays étranger, cela nous fait tressaillir.. “Je voudrais
avoir un confesseur des provinces”, ajouta plus bas le bandit. Il reprit
après un silence :
— Je suis d’Elizondo, lui répondisje en basque, fort ému de
l’entendre parler ma langue.
— Moi, je suis d’Etchalar ditelle.
— C’est un pays à quatre heures de chez nous.
— J’ai été emmenée par des bohémiens à Séville. Je travaillais à
la manufacture pour gagner de quoi retourner en Navarre, près de ma
pauvre mère qui n’a que moi pour soutien, et un petit barratcea avec
vingt pommiers à cidre. Ah ! si j’étais au pays, devant la montagne
blanche ! On m’a insultée parce que je ne suis pas de ce pays de
filous, marchands d’oranges pourries ; et ces gueuses se sont mises
toutes contre moi, parce que je leur ai dit que tous leurs jacques de
Séville, avec leurs couteaux, ne feraient pas peur à un gars de chez
nous avec son béret bleu et son Ynaquila. Camarade, mon ami, ne
ferezvous rien pour une payse ?
Elle mentait, monsieur elle a toujours menti. Je ne sais pas si dans
sa vie cette fillelà a jamais dit un mot de vérité ; mais, quand elle
parlait, je la croyais : c’était plus fort que moi. Elle estropiait le
basque, et je la crus Navarraise ; ses yeux seuls et sa bouche et son
teint la disaient bohémienne.
J’étais fou, je ne faisais plus attention à rien. Je pensais que, si des
Espagnols s’étaient avisés de mal parler du pays, je leur aurais coupé
la figure, tout comme elle venait de faire à sa camarade. Bref, j’étais
comme un homme ivre ; je commençais à dire des bêtises, j’étais tout
près d’en faire.
— Si je vous poussais, et si vous tombiez, mon pays, repritelle en
basque, ce ne seraient pas ces deux conscrits de Castillans qui me
retiendraient…
Ma foi, j’oubliai la consigne et tout, et je lui dis :
— Eh bien, m’amie, ma payse, essayez, et que Notre Dame de la
Montagne vous soit en aide !
En ce moment, nous passions devant une de ces ruelles étroites
comme il y en a tant à Séville. Tout à coup Carmen se retourne et me
lance un coup de poing dans la poitrine.
Je me laissai tomber exprès à la renverse.
D’un bond, elle saute pardessus moi et se met à courir en nous
montrant une paire de jambes !… On dit jambes de Basque : les
siennes en valaient bien d’autres… aussi vites que bien tournées.
Moi, je me relève aussitôt ; mais je mets ma lance en travers, de
façon à barrer la rue, si bien que, de prime abord, les camarades
furent arrêtés au moment de la poursuivre. Puis je me mis moimême
à courir et eux après moi ; mais l’atteindre ! il n’y avait pas de risque,
avec nos éperons, nos sabres et nos lances ! En moins de temps que
je n’en mets à vous le dire, la prisonnière avait disparu.
D’ailleurs, toutes les commères du quartier favorisaient sa fuite, et
se moquaient de nous, et nous indiquaient la fausse voie. Après
plusieurs marches et contremarches, il fallut nous en revenir au
corps de garde sans un reçu du gouverneur de la prison.
Mes hommes, pour n’être pas punis, dirent que Carmen m’avait
parlé basque ; et il ne paraissait pas trop naturel, pour dire la vérité,
qu’un coup de poing d’une tant petite fille eût terrassé si facilement
un gaillard de ma force. Tout cela parut louche, ou plutôt trop clair.
En descendant la garde, je fus dégradé et envoyé pour un mois à la
prison. C’était ma première punition depuis que j’étais au service.
Adieu les galons de maréchal des logis que je croyais déjà tenir !
Mes premiers jours de prison se passèrent fort tristement. En me
faisant soldat, je m’étais figuré que je deviendrais tout au moins
officier. Longa, Mina, mes compatriotes, sont bien capitaines
généraux ; Chapalangarra, qui est un négro comme Mina, et réfugié
comme lui dans votre pays, Chapalangawa était colonel, et j’ai joué à
la paume vingt fois avec son frère, qui était un pauvre diable comme
moi.
Maintenant je me disais : Tout le temps que tu as servi sans
punition, c’est du temps perdu. Te voilà mal noté ; pour te remettre
bien dans l’esprit des chefs, il te faudra travailler dix fois plus que
lorsque tu es venu comme conscrit ! Et pour quoi me suisje fait
punir ? Pour une coquine de bohémienne qui s’est moquée de moi, et
qui, dans ce moment, est à voler dans quelque coin de la ville.
Pourtant je ne pouvais m’empêcher de penser à elle. Le croiriez
vous, monsieur ? ses bas de soie troués qu’elle me faisait voir tout en
plein en s’enfuyant, je les avais toujours devant les yeux. Je regardais
par les barreaux de la prison dans la rue, et, parmi toutes les femmes
qui passaient, je n’en voyais pas une seule qui valût cette diable de