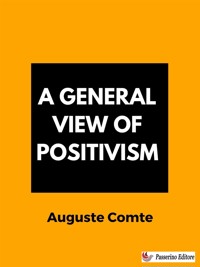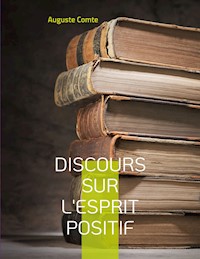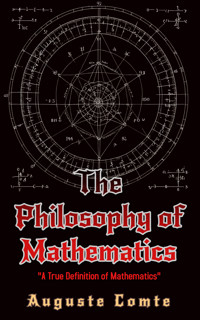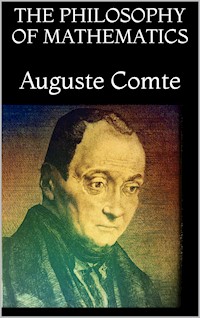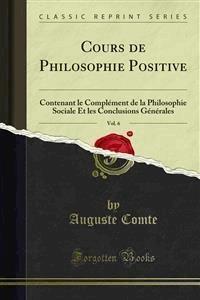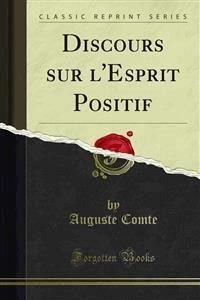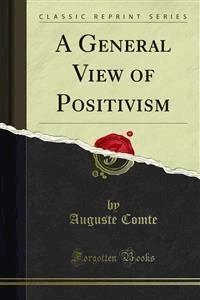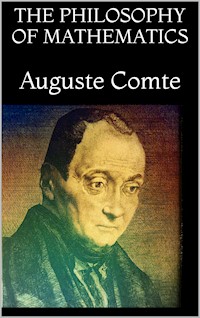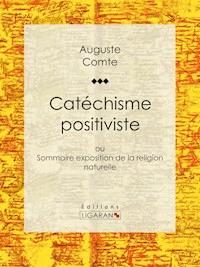
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Extrait : "Je me suis souvent demandé, mon cher père, pourquoi vous persistez à qualifier de religion votre doctrine universelle, quoiqu'elle rejette toute croyance surnaturelle. Mais, en y réfléchissant, j'ai considéré que ce titre s'applique communément à beaucoup de systèmes différents, et même incompatibles, dont chacun se l'approprie exclusivement, sans qu'aucun d'eux ait jamais cessé de compter, chez l'ensemble de notre espèce, plus d'adversaires que d'adhérents."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335034790
©Ligaran 2015
La Femme. Je me suis souvent demandé, mon cher père, pourquoi vous persistez à qualifier de religion votre doctrine universelle, quoiqu’elle rejette toute croyance surnaturelle. Mais, en y réfléchissant, j’ai considéré que ce titre s’applique communément à beaucoup de systèmes différents, et même incompatibles, dont chacun se l’approprie exclusivement, sans qu’aucun d’eux ait jamais cessé de compter, chez l’ensemble de notre espèce, plus d’adversaires que d’adhérents. Cela m’a conduite à penser que ce terme fondamental doit avoir une acception générale, radicalement indépendante de toute foi spéciale. Dès lors, j’ai présumé que, en vous attachant à cette signification essentielle, vous pouviez nommer ainsi le positivisme, malgré son contraste plus profond envers les doctrines antérieures, qui proclament leurs dissidences mutuelles comme non moins graves que leurs concordances. Toutefois, cette explication me semblant encore confuse, je vous prie de commencer votre exposition par un éclaircissement direct et précis sur le sens radical du mot religion.
Le Prêtre. Ce nom, ma chère fille, n’offre en effet, d’après son étymologie, aucune solidarité nécessaire avec les opinions quelconques qu’on peut employer pour atteindre le but qu’il désigne. En lui-même, il indique l’état de complète unité qui distingue notre existence, à la fois personnelle et sociale, quand toutes ses parties, tant morales que physiques, convergent habituellement vers une destination commune. Ainsi, ce terme équivaudrait au mot synthèse, si celui-ci n’était point, non d’après sa propre structure, mais suivant un usage presque universel, limité maintenant au seul domaine de l’esprit, tandis que l’autre comprend l’ensemble des attributs humains. La religion consiste donc à régler chaque nature individuelle et à rallier toutes les individualités ; ce qui constitue seulement deux cas distincts d’un problème unique. Car, tout homme diffère successivement de lui-même autant qu’il diffère simultanément des autres ; en sorte que la fixité et la communauté suivent des lois identiques.
Une telle harmonie, individuelle ou collective, ne pouvant jamais être pleinement réalisée dans une existence aussi compliquée que la nôtre, cette définition de la religion caractérise donc le type immuable vers lequel tend de plus en plus l’ensemble des efforts humains. Notre bonheur et notre mérite consistent surtout à nous rapprocher autant que possible de cette unité, dont l’essor graduel constitue la meilleure mesure du vrai perfectionnement, personnel ou social. Plus se développent les divers attributs humains, plus leur concours habituel acquiert d’importance ; mais il deviendrait aussi plus difficile, si cette évolution ne tendait pas spontanément à nous rendre plus disciplinables, comme je vous l’expliquerai bientôt.
Le prix qu’on attacha toujours à cet état synthétique dut concentrer l’attention sur la manière de l’instituer. On fut ainsi conduit, en prenant le moyen pour le but, à transporter le nom de religion au système quelconque des opinions correspondantes. Mais, quelque inconciliables que semblent d’abord ces nombreuses croyances, le positivisme les combine essentiellement, en rapportant chacune à sa destination temporaire et locale. Il n’existe, au fond, qu’une seule religion, à la fois universelle et définitive, vers laquelle tendirent de plus en plus les synthèses partielles et provisoires, autant que le comportaient les situations correspondantes. À ces divers efforts empiriques succède maintenant le développement systématique de l’unité humaine, dont la constitution directe et complète est enfin devenue possible d’après l’ensemble de nos préparations spontanées. C’est ainsi que le positivisme dissipe naturellement l’antagonisme mutuel des différentes religions antérieures, en formant son propre domaine du fond commun auquel toutes se rapportèrent instinctivement. Sa doctrine ne pourrait pas devenir universelle, si, malgré ses principes antithéologiques, son esprit relatif ne lui procurait nécessairement des affinités essentielles avec chaque croyance capable de diriger passagèrement une portion quelconque de l’Humanité.
La Femme. Votre définition de la religion me satisfera complètement, si vous pouvez, mon père, assez éclaircir la grave difficulté qui me semble résulter de sa trop grande extension. Car, en caractérisant notre unité, vous y comprenez le physique comme le moral. Ils sont, en effet, tellement liés qu’une véritable harmonie ne peut jamais s’établir quand on veut les séparer. Néanmoins, je ne saurais m’habituer à faire rentrer la santé dans la religion, de manière à prolonger jusqu’à la médecine le vrai domaine de la morale.
Le Prêtre. Cependant, ma fille, le schisme arbitraire que vous désirez maintenir serait directement contraire à notre unité. Il n’est dû réellement qu’à l’insuffisance de la dernière religion provisoire, qui ne put discipliner l’âme qu’en abandonnant aux profanes le domaine du corps. Dans les antiques théocraties, qui constituèrent le mode le plus complet et le plus durable du régime surnaturel, cette vaine division n’existait pas ; l’art hygiénique et médical y fut toujours une simple annexe du sacerdoce.
Tel est, en effet, l’ordre naturel, que le positivisme vient rétablir et consolider, en vertu de sa plénitude caractéristique. L’art humain et la science humaine sont respectivement indivisibles, comme les divers aspects propres à leur commune destination, où tout se tient constamment. On ne peut plus traiter sainement ni le corps ni l’âme, par cela même que le médecin et le prêtre étudient exclusivement le physique ou le moral ; sans parler du philosophe qui, pendant l’anarchie moderne, ravit au sacerdoce le domaine de l’esprit en lui laissant celui du cœur.
Les maladies cérébrales, et même beaucoup d’autres, montrent journellement l’impuissance de toute médication bornée aux plus grossiers organes. Il n’est pas moins facile de reconnaître l’insuffisance de tout sacerdoce qui veut diriger l’âme en négligeant sa subordination au corps. Cette séparation doublement anarchique doit donc cesser irrévocablement, d’après une sage réintégration de la médecine au domaine sacerdotal, quand le clergé positif aura suffisamment rempli ses conditions encyclopédiques. Le point de vue moral est, en effet, le seul propre à faire activement prévaloir des prescriptions hygiéniques, tant privées que publiques. On le vérifie aisément d’après les vains efforts des médecins occidentaux pour régler notre alimentation habituelle, depuis qu’elle n’est plus dirigée par les anciens préceptes religieux. Aucune pratique gênante ne saurait être ordinairement admise au seul nom de la santé personnelle, qui laisse chacun juge de lui-même : car, on est souvent plus touché des inconvénients actuels et certains que des avantages lointains et douteux. Il faut invoquer une autorité supérieure à toute individualité, pour imposer, même envers les moindres cas, des règles vraiment efficaces, alors fondées sur une appréciation sociale qui ne comporte jamais d’indécision.
La Femme. Après avoir ainsi reconnu, dans toute sa plénitude, le domaine naturel de la religion, je voudrais savoir, mon père, en quoi consistent ses conditions générales. On me l’a souvent représentée comme ne dépendant que du cœur. Mais j’ai toujours pensé que l’esprit y participe aussi. Pourrais-je y concevoir nettement leurs attributions respectives ?
Le Prêtre. Cette appréciation résulte, ma fille, d’un examen approfondi du mot religion, le mieux composé peut-être de tous les termes humains. Il est construit de manière à caractériser une double liaison, dont la juste notion suffit pour résumer toute la théorie abstraite de notre unité. Afin de constituer une harmonie complète et durable, il faut, en effet, lier le dedans par l’amour et le relier au dehors par la foi. Telles sont, en général, les participations nécessaires du cœur et de l’esprit envers l’état synthétique, individuel ou collectif.
L’unité suppose, avant tout, un sentiment auquel nos divers penchants puissent se subordonner. Car, nos actions et nos pensées étant toujours dirigées par nos affections, l’harmonie humaine deviendrait impossible si celles-ci n’étaient point coordonnées sous un instinct prépondérant.
Mais cette condition intérieure de l’unité ne suffirait pas si l’intelligence ne nous faisait reconnaître, au dehors, une puissance supérieure, à laquelle notre existence doive toujours se soumettre, même en la modifiant. C’est afin de mieux subir ce suprême empire que notre harmonie morale, individuelle ou collective, devient surtout indispensable. Réciproquement, cette prépondérance du dehors tend à régler le dedans, en favorisant l’ascendant de l’instinct le plus conciliable avec une telle nécessité. Ainsi, les deux conditions générales de la religion sont naturellement connexes, surtout quand l’ordre extérieur peut devenir l’objet du sentiment intérieur.
La Femme. Dans cette théorie abstraite de notre unité, je trouve, mon père, une difficulté radicale, envers l’influence morale. En considérant l’harmonie intérieure, vous me semblez oublier que nos instincts personnels sont malheureusement plus énergiques que nos penchants sympathiques. Or, leur prépondérance, qui paraît devoir les ériger en centres naturels de toute l’existence morale, rendrait, d’un autre côté, l’unité personnelle presque inconciliable avec l’unité sociale. Puisqu’on a néanmoins concilié ces deux harmonies, j’ai besoin qu’un nouvel éclaircissement me les représente enfin comme pleinement compatibles.
Le Prêtre. Vous avez ainsi, ma fille, soulevé directement le principal problème humain, qui consiste, en effet, à faire graduellement prévaloir la sociabilité sur la personnalité, quoique celle-ci soit spontanément prépondérante. Pour en mieux comprendre la possibilité, il faut d’abord comparer les deux modes opposés que semble naturellement comporter l’unité morale, suivant que sa base intérieure serait égoïste ou altruiste.
Les expressions multiples que vous venez d’employer envers la personnalité témoignent involontairement son impuissance radicale à constituer aucune harmonie réelle et durable, même chez un être isolé. Car, cette monstrueuse unité n’exigerait pas seulement l’absence de toute impulsion sympathique, mais aussi la prépondérance d’un seul égoïsme. Or, cela n’existe que chez les derniers animaux, où tout se rapporte à l’instinct nutritif, surtout quand les sexes ne sont pas séparés. Mais, partout ailleurs, et principalement dans notre espèce, la satisfaction de ce besoin fondamental laisse successivement prévaloir plusieurs-autres penchants personnels, dont les énergies presque égales annuleraient leurs prétentions opposées à dominer l’ensemble de l’existence morale. Si tous ne se subordonnaient point à des affections extérieures, le cœur serait sans cesse agité d’intimes conflits entre les impulsions sensuelles et les stimulations de l’orgueil ou de la vanité, etc., quand la cupidité proprement dite cesserait de régner avec les besoins purement corporels. L’unité morale reste donc impossible, même dans l’existence solitaire, chez tout être exclusivement dominé par des affections personnelles, qui l’empêchent de vivre pour autrui. Tels sont beaucoup d’animaux féroces que l’on voit, sauf pendant quelques rapprochements passagers, flotter ordinairement entre une activité déréglée et une ignoble torpeur, faute de trouver au dehors les principaux mobiles de leur conduite.
La Femme. Je comprends ainsi, mon père, la coïncidence naturelle entre les vraies conditions morales de l’harmonie individuelle et celles de l’harmonie collective. Mais j’éprouve toujours le même embarras à concevoir l’abnégation habituelle des instincts les plus énergiques.
Le Prêtre. Cette difficulté sera, ma fille, aisément dissipée quand vous remarquerez que l’unité altruiste n’exige point, comme l’unité égoïste, l’entier sacrifice des penchants contraires à son principe, mais seulement leur sage subordination à l’affection prépondérante. En condensant toute la saine morale dans la loi Vivre pour autrui, le positivisme consacre la juste satisfaction permanente des divers instincts personnels, en tant qu’indispensable à notre existence matérielle, sur laquelle reposent toujours nos attributs supérieurs. Dès lors, il blâme, quoique souvent inspirées par des motifs respectables, les pratiques trop austères qui, diminuant nos forces, nous rendent moins propres au service d’autrui. La destination sociale au nom de laquelle il recommande les soins personnels doit à la fois les ennoblir et les régler, en évitant également une préoccupation exagérée et une vicieuse négligence.
La Femme. Mais, mon père, cette consécration même des penchants égoïstes, constamment excités d’ailleurs par nos besoins corporels, me semble encore incompatible avec une prépondérance habituelle de nos faibles affections sympathiques.
Le Prêtre. Aussi, ma fille, ce perfectionnement moral constituera-t-il toujours le principal objet de l’art humain, dont les efforts continus, individuels et collectifs, nous en rapprochent de plus en plus, sans pouvoir jamais le réaliser complètement. Cette solution croissante repose uniquement sur l’existence sociale, d’après la loi naturelle qui développe ou comprime nos fonctions et nos organes suivant leur exercice ou leur désuétude. En effet, les relations domestiques et civiques tendent à contenir les instincts personnels, d’après les conflits qu’ils suscitent entre les divers individus. Au contraire, elles favorisent l’essor des inclinations bienveillantes, seules susceptibles chez tous d’un développement simultané, naturellement continu d’après ces excitations mutuelles, quoique nécessairement limité par l’ensemble de nos conditions matérielles.
Voilà pourquoi la véritable unité morale ne peut assez surgir que dans notre espèce, le progrès social devant exclusivement appartenir à la mieux organisée des races sociables, à moins que d’autres ne s’y joignent comme libres auxiliaires. Mais, sans qu’une telle harmonie puisse ailleurs se développer, son principe est aisément appréciable chez beaucoup d’animaux supérieurs, qui fournirent même les premières preuves scientifiques de l’existence naturelle des affections désintéressées. Si cette grande notion, toujours pressentie par l’empirisme universel, n’avait pas été systématisée aussi tardivement, personne aujourd’hui ne taxerait d’affectation sentimentale une doctrine directement vérifiable parmi tant d’espèces inférieures à la nôtre.
La Femme. Cette suffisante explication ne me laisse, mon père, à désirer qu’un dernier éclaircissement général, envers la condition intellectuelle de la religion. À travers l’incohérence des diverses croyances spéciales, je ne saisis pas nettement en quoi consiste le domaine fondamental de la foi, qui doit pourtant comporter une appréciation commune à tous les systèmes.
Le Prêtre. En effet, ma fille, notre foi n’eut jamais qu’un même objet essentiel : concevoir l’ordre universel qui domine l’existence humaine, pour déterminer notre relation générale envers lui. Soit qu’on assignât ses causes fictives, ou qu’on étudiât ses lois réelles, on voulait toujours apprécier cet ordre indépendant de nous, afin de le mieux subir et de le modifier davantage. Toute doctrine religieuse repose nécessairement sur une explication quelconque du monde et de l’homme, double objet continu de nos pensées théoriques et pratiques.
La foi positive expose directement les lois effectives des divers phénomènes observables, tant intérieurs qu’extérieurs ; c’est-à-dire, leurs relations constantes de succession et de similitude, qui nous permettent de les prévoir les uns d’après les autres. Elle écarte, comme radicalement inaccessible et profondément oiseuse, toute recherche sur les causes proprement dites, premières ou finales, des évènements quelconques. Dans ses conceptions théoriques, elle explique toujours comment et jamais pourquoi. Mais, quand elle indique les moyens de diriger notre activité, elle fait, au contraire, prévaloir constamment la considération du but ; puisque alors l’effet pratique émane certainement d’une volonté intelligente.
Toutefois, la poursuite des causes, quoique directement vaine, fut d’abord indispensable autant qu’inévitable, comme je vous l’expliquerai spécialement, pour remplacer et préparer la connaissance des lois, qui suppose un long préambule. En cherchant le pourquoi qu’on ne pouvait trouver, on finissait alors par découvrir le comment, dont l’étude n’était pas immédiatement instituée. Il ne faut vraiment blâmer que la puérile persistance, si commune encore chez nos lettrés, à pénétrer les causes quand les lois sont connues. Car, notre conduite ne se rapportant jamais qu’à celles – ci, la recherche de celles-là ne devient pas moins inutile que chimérique.
Le dogme fondamental de la religion universelle consiste donc dans l’existence constatée d’un ordre immuable auquel sont soumis les évènements de tous genres. Cet ordre est à la fois objectif et subjectif : en d’autres termes, il concerne également l’objet contemplé et le sujet contemplateur. Des lois physiques supposent, en effet, des lois logiques, et réciproquement. Si notre entendement ne suivait spontanément-aucune règle, il ne pourrait jamais apprécier l’harmonie extérieure. Le monde étant plus simple et plus puissant que l’homme, la régularité de celui-ci serait encore moins conciliable avec le désordre de celui-là. Toute foi positive repose donc sur cette double harmonie entre l’objet et le sujet.
Un tel ordre ne peut être que constaté, jamais expliqué. Il fournit, au contraire, l’unique source possible de toute explication raisonnable, qui consiste toujours à faire rentrer dans les lois générales chaque évènement particulier, dès lors susceptible d’une prévision systématique, seul but caractéristique de la véritable science. Aussi l’ordre universel fut-il longtemps méconnu, tant que prévalurent les volontés arbitraires auxquelles on dut d’abord attribuer les principaux phénomènes de toute sorte. Mais une expérience souvent réitérée et jamais démentie le fit enfin reconnaître, malgré les opinions contraires, envers les plus simples évènements, d’où la même appréciation s’étendit graduellement jusqu’aux plus complexes. C’est seulement de nos jours que cette extension a pénétré dans son dernier domaine, en représentant aussi les plus éminents phénomènes de l’intelligence et de la sociabilité comme toujours assujettis à des lois invariables, que nient encore beaucoup d’esprits cultivés. Le positivisme résulta directement de cette découverte finale, qui, complétant notre longue initiation scientifique, termina nécessairement le régime préliminaire de la raison humaine.
La Femme. Mon père, la foi positive, d’après ce premier aperçu, me semble très satisfaisante pour l’intelligence, mais trop peu favorable à l’activité, qu’elle paraît subordonner à d’inflexibles destinées. Cependant, puisque l’esprit positif, comme vous le dites souvent, surgit partout de l’existence pratique, il ne saurait lui être contraire. Je voudrais concevoir nettement leur accord général.
Le Prêtre. Pour y parvenir, ma fille, il suffit de rectifier l’appréciation spontanée qui vous fait regarder les lois réelles comme immodifiables. Tant que les phénomènes furent attribués à des volontés arbitraires, la conception d’une fatalité absolue devint le correctif nécessaire d’une hypothèse directement incompatible avec tout ordre effectif. La découverte des lois naturelles tendit ensuite à maintenir cette disposition générale, parce qu’elle concerna d’abord les évènements célestes, entièrement soustraits à l’intervention humaine. Mais à mesure que s’est développée la connaissance de l’ordre réel, on l’a regardé comme essentiellement modifiable, même par nous. Il le devient d’autant plus que les phénomènes s’y compliquent davantage, ainsi que je vous l’expliquerai bientôt. Cette notion s’étend aujourd’hui jusqu’à l’ordre céleste, dont la simplicité supérieure nous permet de mieux imaginer l’amélioration, afin de corriger un aveugle respect, quoique nos faibles moyens physiques ne puissent jamais la réaliser.
Envers des évènements quelconques, sans excepter les plus complexes, les conditions fondamentales sont toujours immuables ; mais partout aussi, y compris les plus simples cas, les dispositions secondaires peuvent être modifiées, et le plus souvent par notre intervention. Ces modifications n’altèrent aucunement l’invariabilité des lois réelles, parce qu’elles ne deviennent jamais arbitraires. Leur nature et leur étendue suivent toujours des règles propres, qui complètent notre domaine scientifique. L’immobilité totale serait tellement contraire à la notion même de loi, que celle-ci caractérise partout la constance aperçue au milieu de la variété.
Ainsi l’ordre naturel constitue toujours une fatalité modifiable, qui devient la base nécessaire de l’ordre artificiel. Notre vraie destinée se compose donc de résignation et d’activité. Cette seconde condition, loin d’être incompatible avec la première, repose directement sur elle. Une judicieuse soumission aux lois fondamentales peut seule, en effet, prévenir le vague et l’instabilité de nos desseins quelconques, de manière à nous permettre d’instituer, d’après les règles secondaires, une sage intervention. Voilà comment le dogme positif consacre directement notre activité, qu’aucune synthèse théologique ne pouvait embrasser. Cet essor pratique y devient même le principal régulateur de nos travaux théoriques envers l’ordre universel et ses diverses modifications.
La Femme. Après une telle explication, il me reste, mon père, à concevoir comment la foi positive se concilie pleinement avec le sentiment, auquel sa nature me semble radicalement contraire. Je comprends toutefois que son dogme fondamental fournit doublement une forte base de discipline morale, soit en subordonnant nos penchants personnels à une puissance extérieure, soit en excitant nos instincts sympathiques pour mieux subir ou modifier la fatalité commune. Mais malgré ces précieux attributs, le positivisme ne m’offre pas encore une stimulation assez directe des saintes affections qui paraissent devoir former le principal domaine de la religion.
Le Prêtre. Je reconnais, ma fille, que l’esprit positif présenta jusqu’ici les deux inconvénients moraux propres à la science, enfler et dessécher, en développant l’orgueil et détournant de l’amour. Cette double tendance s’y conservera toujours assez pour exiger habituellement des précautions systématiques dont je vous entretiendrai plus tard. Néanmoins votre principal reproche résulte, à cet égard, d’une insuffisante appréciation du positivisme, que vous considérez uniquement dans l’état incomplet qu’il offre encore chez la plupart de ses adhérents. Ils s’y bornent à la conception philosophique émanée de la préparation scientifique, sans aller jusqu’à la conclusion religieuse qui seule résume l’ensemble de cette philosophie. Mais en complétant l’étude réelle de l’ordre universel, on voit le dogme positif se concentrer finalement autour d’une conception synthétique, aussi favorable au cœur qu’à l’esprit.
Les êtres chimériques qu’employa provisoirement la religion inspirèrent directement de vives affections humaines, qui furent même plus puissantes sous les fictions les moins élaborées. Cette précieuse aptitude dut longtemps sembler étrangère au positivisme, d’après son immense préambule scientifique. Tant que l’initiation philosophique embrassa seulement l’ordre matériel, et même l’ordre vital, elle ne put que dévoiler des lois indispensables à notre activité, sans nous fournir aucun objet direct d’affection permanente et commune. Mais il n’en est plus ainsi depuis que cette préparation graduelle se trouve enfin complétée par l’étude propre de l’ordre humain, individuel et collectif.
Cette appréciation finale condense l’ensemble des conceptions positives dans la seule notion d’un être immense et éternel, l’Humanité, dont les destinées sociologiques se développent toujours sous la prépondérance nécessaire des fatalités biologiques et cosmologiques. Autour de ce vrai Grand-Être, moteur immédiat de chaque existence individuelle ou collective, nos affections se concentrent aussi spontanément que nos pensées et nos actions. Sa seule idée inspire directement la formule sacrée du positivisme : L’Amour pour principe, et l’Ordre pour base ; le Progrès pour but. Toujours fondée sur un libre concours de volontés indépendantes, son existence composée, que toute discorde tend à dissoudre, consacre aussitôt la prépondérance continue du cœur sur l’esprit comme l’unique base de notre véritable unité. C’est ainsi que l’ordre universel se résume désormais dans l’être qui l’étudie et le perfectionne sans cesse. La lutte croissante de l’Humanité contre l’ensemble des fatalités qui la dominent présente, au cœur comme à l’esprit, un meilleur spectacle que la toute-puissance, nécessairement capricieuse, de son précurseur théologique. Mieux accessible à nos sentiments comme à nos conceptions, d’après une identité de nature qui n’empêche point sa supériorité sur tous ses serviteurs, un tel Être-Suprême excite profondément une activité destinée à le conserver et l’améliorer.
La Femme. Toutefois, mon père, le travail matériel imposé sans cesse par nos besoins corporels me semble directement contraire à cette tendance affective de la religion positive. Car une telle activité me paraît devoir toujours conserver un caractère essentiellement égoïste, qui s’étend même jusqu’aux efforts théoriques qu’elle suscite. Or cela suffirait pour empêcher la prépondérance réelle de l’amour universel.
Le Prêtre. J’espère, ma fille, vous faire bientôt reconnaître la possibilité de transformer radicalement cette personnalité primitive des travaux humains. À mesure que l’activité matérielle devient de plus en plus collective, elle tend davantage vers le caractère altruiste, quoique l’impulsion égoïste doive toujours rester indispensable à son premier essor. Car, chacun travaillant habituellement pour autrui, cette existence développe nécessairement les affections sympathiques, quand elle est assez appréciée. Il ne manque donc à ces laborieux serviteurs de l’Humanité qu’un sentiment complet et familier de leur existence réelle. Or cela doit naturellement résulter d’une suffisante extension de l’éducation positive. Vous pourriez déjà constater cette tendance si l’activité pacifique, encore dépourvue de toute discipline systématique, était autant réglée que la vie guerrière, seule organisée jusqu’ici. Mais les grands résultats moraux obtenus jadis envers celle-ci, et qui restent même sensibles sous sa dégradation actuelle, indiquent assez ceux que comporte l’autre. Il faut même attendre de l’instinct constructeur des réactions sympathiques plus directes et plus complètes que celles de l’instinct destructeur.
La Femme. D’après cette dernière indication, je commence, mon père, à saisir l’harmonie générale du positivisme. J’y conçois déjà comment l’activité, naturellement subordonnée à la foi, peut aussi se soumettre à l’amour, qu’elle semble d’abord repousser. Dès lors votre doctrine me paraît enfin remplir toutes les conditions essentielles de la religion, telle que vous l’avez définie, puisqu’elle convient également aux trois grandes parties de notre existence, aimer, penser, agir, qui ne furent jamais autant combinées.
Le Prêtre. Plus vous étudierez la synthèse positive, mieux vous sentirez, ma fille, combien sa réalité la rend plus complète et plus efficace qu’aucune autre. La prépondérance habituelle de l’altruisme sur l’égoïsme, où réside le grand problème humain, y résulte directement d’un concours continu de tous nos travaux, théoriques et pratiques, avec nos meilleures inclinations. Cette vie active que le catholicisme représentait comme opposée à notre intime perfectionnement, en devient, pour le positivisme, la principale garantie. Vous concevez maintenant un tel contraste entre deux systèmes dont l’un admet et l’autre nie l’existence naturelle des affections désintéressées. Les besoins corporels, qui semblaient devoir nous séparer toujours, peuvent désormais tendre davantage à nous unir que si nous en étions dispensés. Car l’amour se développe mieux d’après des actes que par des vœux ; et d’ailleurs, quels souhaits formerait-on envers ceux qui ne manqueraient de rien ? On peut aussi reconnaître que le type d’existence réelle propre aux positivistes surpasse nécessairement, même quant au sentiment, la vie chimérique promise aux théologistes.
La Femme. Afin de compléter cet entretien préliminaire, je vous prie, mon père, de m’expliquer brièvement la division générale de la religion, dont vous m’exposerez ensuite chaque partie essentielle. En vous demandant cet éclaircissement, je sens que l’amour étant le principe de l’unité humaine, la partie qui s’y rapporte doit naturellement prévaloir dans le système religieux, et que vous devez commencer par elle mon initiation positiviste.
Le Prêtre. Cette dernière réflexion, ma fille, prouve, une fois de plus, combien la sympathie est favorable à la synthèse. Vous venez, en effet, de signaler spontanément le trait le plus caractéristique de la religion positive, la préséance qu’elle donne au culte sur le dogme. Pour mieux sentir la nécessité de cet arrangement, vous devez remarquer que la décomposition de la religion et l’ordre de ses différentes parties résultent d’une juste appréciation de l’existence totale qu’elle doit diriger. Le culte, le dogme, et le régime concernent respectivement nos sentiments, nos pensées, et nos actes. Telles sont donc les trois parties fondamentales de la religion, disposées dans l’ordre que leur assigne la théorie générale de la nature humaine, qui place le sentiment avant l’intelligence et l’activité, ses deux ministres nécessaires.
Mais, comme l’adoration positiviste exige la connaissance de l’Humanité, qui est le résumé du dogme, il semble que l’on devrait placer celui-ci avant le culte, ainsi que je fis d’abord par trop de déférence envers mes prédécesseurs catholiques, sans examiner si cette disposition était aussi conforme à la nouvelle synthèse qu’à l’ancienne. Pour résoudre cette difficulté, il suffit de distinguer les deux constitutions, analytique et synthétique, que comporte la doctrine universelle. La première forme le dogme proprement dit. La seconde ne consiste que dans la théorie fondamentale de l’Humanité. Le culte repose nécessairement sur celle-ci, qu’il développe en l’idéalisant. Mais loin d’exiger la constitution analytique du dogme, il devient indispensable à son digne établissement. Il suffira donc que je vous expose d’abord, dans notre prochain entretien, la théorie synthétique du Grand-Être, pour que je puisse commencer immédiatement votre initiation religieuse par le culte, qui, en idéalisant l’Humanité, doit cultiver en nous, avant tout, les sentiments propres à l’existence qu’elle nous prescrit. Nous devons aborder ensuite l’étude du dogme, destiné à nous faire connaître analytiquement l’ordre fondamental et le Grand-Être qui le modifie. Nous passons, enfin, au régime, qui règle directement chaque conduite humaine.
Voilà comment la religion positive embrasse à la fois nos trois grandes constructions continues, la poésie, la philosophie, et la politique. Mais la morale y domine toujours, soit l’essor de nos sentiments, soit le développement de nos connaissances, soit le cours de nos actions, de manière à diriger sans cesse notre triple recherche du beau, du vrai, et du bon.
La Femme. D’après notre entretien préliminaire, je me sens effrayée, mon père, de ma profonde insuffisance envers la haute exposition que vous allez commencer. Puisque la conception de l’Humanité condense le dogme de la religion universelle, lequel consiste dans la philosophie positive, mon intelligence me semble trop faible, ou du moins trop peu préparée, pour en comprendre assez l’explication, quelque simple que vous puissiez la rendre. Je n’apporte ici qu’une pleine confiance, un respect sincère, et une active sympathie envers la doctrine qui paraît, après tant de vaines tentatives, propre à surmonter enfin l’anarchie moderne. Mais je crains que ces dispositions morales ne suffisent pas pour me permettre d’aborder avec succès une étude aussi difficile.
Le Prêtre. Vos inquiétudes exigent, ma fille, quelques réflexions préalables, qui, j’espère, vous rassureront bientôt. Il ne s’agit ici que d’accomplir, envers la religion nouvelle, une exposition générale équivalente à celle qui vous initia jadis au catholicisme. La nature mieux intelligible d’une doctrine toujours démontrable doit même, outre la présente maturité de votre raison, vous rendre cette seconde opération plus facile que la première. Rappelez-vous d’ailleurs l’admirable maxime que notre grand Molière fit proclamer par l’homme de goût de son dernier chef-d’œuvre :
Je consens qu’une femme ait des clartés de tout ;
et notez aussi que le Je consens d’alors deviendrait maintenant Il convient.
Au fond, le domaine intellectuel du sacerdoce fut toujours le même que celui du public, sauf la diversité de culture, systématique d’un côté, purement spontanée de l’autre. Cette identité essentielle, sans laquelle on ne concevrait aucune harmonie religieuse, devient à la fois plus directe et plus complète dans le positivisme qu’elle ne put jamais l’être sous le théologisme. Le véritable esprit philosophique consiste, en effet, comme le simple bon sens, à connaître ce qui est, pour prévoir ce qui sera, afin de l’améliorer autant que possible. Un des meilleurs préceptes positivistes proclame même vicieuse, ou du moins prématurée, toute systématisation qui n’est point précédée et préparée par un suffisant essor spontané. Cette règle résulte aussitôt du vers dogmatique d’après lequel le positivisme caractérise l’ensemble de notre existence :
Agir par affection, et penser pour agir.
Le premier hémistiche correspond à la spontanéité, et le second à la systématisation consécutive. Quelques inconvénients que suscite l’activité irréfléchie, elle seule peut ordinairement fournir les premiers matériaux d’une méditation efficace, qui permettra de mieux agir.
Considérez enfin qu’aucun esprit ne saurait s’abstenir d’une opinion quelconque sur l’ordre universel, soit extérieur, soit humain. Vous savez maintenant que le dogme religieux eut toujours le même objet essentiel, avec cette seule différence générale que la connaissance des lois y remplace désormais la recherche des causes. Or, des hypothèses chimériques envers celles-ci ne sauraient vous sembler plus intelligibles que des notions réelles sur celles-là.
Les femmes et les prolétaires, que cette exposition a principalement en vue, ne peuvent ni ne doivent devenir des docteurs, pas plus qu’ils ne le veulent. Mais tous ont besoin de comprendre assez l’esprit et la marche de la doctrine universelle, pour imposer à leurs chefs spirituels une suffisante préparation scientifique et logique, sur laquelle repose nécessairement l’office systématique du sacerdoce. Or, cette discipline intellectuelle est aujourd’hui tellement contraire aux habitudes émanées de l’anarchie moderne, qu’elle ne saurait jamais prévaloir si le public des deux sexes ne l’impose point à ceux qui prétendent diriger ses opinions. Cette condition sociale rendra toujours précieuse la propagation générale de l’instruction religieuse, outre sa destination propre pour guider chaque existence, individuelle ou collective. Mais un tel service acquiert maintenant une importance capitale, afin de mettre un terme décisif à l’anarchie occidentale, principalement caractérisée par la révolte intellectuelle. Si ce catéchisme pouvait convaincre les femmes et les prolétaires que leurs prétendus guides spirituels sont radicalement incompétents envers les hautes élaborations qu’on leur confie aveuglément, il contribuerait beaucoup à pacifier l’Occident. Or, cette conviction unanime ne peut résulter aujourd’hui que d’une suffisante appréciation du dogme final, propre à rendre incontestables les conditions générales de sa culture systématique.
Quant aux difficultés que vous redoutez maintenant dans cette étude indispensable, vous faites trop peu de cas, pour les surmonter, de vos excellentes dispositions morales. Aucune académie actuelle n’hésiterait à proclamer doctoralement que l’esprit pense toujours comme si le cœur n’existait pas. Mais les femmes et les prolétaires n’ont jamais méconnu l’intime réaction du sentiment sur l’intelligence, expliquée enfin par la philosophie positive. Votre sexe surtout, dont le doux office involontaire nous transmit, autant que possible, les admirables mœurs du Moyen Âge à travers l’anarchie moderne, juge journellement l’hérésie métaphysique qui sépare ces deux grands attributs. Puisque, suivant la belle maxime de Vauvenargues, le cœur est nécessaire aux principales inspirations de l’esprit, il doit aussi servir à comprendre leurs résultats. Cette puissante assistance convient surtout aux conceptions morales et sociales, envers lesquelles l’instinct sympathique peut mieux seconder l’esprit synthétique, dont les plus grands efforts ne sauraient, sans un tel secours, surmonter leurs difficultés. Mais elle peut aussi s’appliquer aux théories inférieures, d’après la connexité nécessaire de toutes nos spéculations réelles.
Des deux conditions fondamentales de la religion, amour et foi, la première doit certainement prévaloir. Car, quoique la foi soit très propre à consolider l’amour, l’action inverse est plus puissante comme plus directe. Non seulement le sentiment préside aux inspirations spontanées qu’exige d’abord toute élaboration systématique : mais il consacre et seconde celle-ci, quand il en a reconnu l’importance. Aucune femme expérimentée n’ignore l’insuffisance trop fréquente des meilleures affections qui ne sont point assistées de convictions inébranlables. Ce mot convaincre suffirait, d’après son origine, pour rappeler l’aptitude des croyances profondes à consolider le dedans en le liant au dehors.
L’insuffisance théorique qui vous effraye ici repose enfin sur la confusion ordinaire entre l’instruction et l’intelligence. Votre admiration familière pour l’incomparable Molière ne vous a point préservée, à cet égard, de l’erreur vulgaire, soigneusement entretenue par nos Trissotins de toutes robes. On devrait pourtant rougir d’être aujourd’hui moins avancé qu’au Moyen Âge, où tous savaient apprécier le profond mérite intellectuel de personnages fort illettrés. N’avez-vous pas quelquefois trouvé, chez de tels esprits, plus de véritable aptitude que chez la plupart des docteurs ? Aujourd’hui plus que jamais, l’instruction n’est vraiment indispensable que pour construire et développer la science, dont l’ensemble doit toujours être institué de manière à devenir directement accessible à toutes les saines intelligences. Sans cela, nos meilleures doctrines dégénéreraient bientôt en mystifications dangereuses : cette déviation propre aux théoriciens quelconques ne peut s’y contenir assez que d’après une digne surveillance du public des deux sexes.
La Femme. Encouragée par votre préambule, je vous prie, mon père, de passer à une explication plus directe et plus complète du principe universel de notre religion, ainsi que vous me l’avez annoncé. J’ai déjà compris que votre conception du vrai Grand-Être résume nécessairement l’ensemble de l’ordre réel, non seulement humain, mais aussi extérieur. C’est pourquoi j’éprouve le besoin d’une détermination plus nette et plus précise envers cette unité fondamentale du positivisme.
Le Prêtre. Pour y parvenir, vous devez, ma fille, définir d’abord l’Humanité comme l’ensemble des êtres humains, passés, futurs, et présents. Ce mot ensemble vous indique assez qu’il n’y faut pas comprendre tous les hommes, mais ceux-là seuls qui sont réellement assimilables, d’après une vraie coopération à l’existence commune. Quoique tous naissent nécessairement enfants de l’Humanité, tous ne deviennent pas ses serviteurs, et beaucoup restent à l’état parasite qui ne fut excusable que pendant leur éducation. Les temps anarchiques font surtout pulluler, et trop souvent fleurir, ces tristes fardeaux du véritable Grand-Être. Plus d’un vous a rappelé l’admirable réprobation de Dante, ébauchée déjà par Horace :
Vous voyez ainsi que, à cet égard comme à tout autre, l’inspiration poétique devança beaucoup la systématisation philosophique. Quoi qu’il en soit, si ces parasites ne font vraiment point partie de l’Humanité, une juste compensation vous prescrit de joindre au nouvel Être-Suprême tous ses dignes auxiliaires animaux. Toute utile coopération habituelle aux destinées humaines, quand elle s’exerce volontairement, érige l’être correspondant en élément réel de cette existence composée, avec un degré d’importance proportionné à la dignité de l’espèce et à l’efficacité de l’individu. Pour apprécier cet indispensable complément, nous n’avons qu’à supposer qu’il nous manque. On n’hésite point alors à regarder tels chevaux, chiens, bœufs, etc., comme plus estimables que certains hommes.
Dans cette première conception du concours humain, l’attention concerne naturellement la solidarité, de préférence à la continuité. Mais, quoique celle-ci soit d’abord moins sentie, parce qu’elle exige un examen plus profond, sa notion doit finalement prévaloir. Car, l’essor social ne tarde guère à dépendre davantage du temps que de l’espace. Ce n’est pas seulement aujourd’hui que chaque homme, en s’efforçant d’apprécier ce qu’il doit aux autres, reconnaît une participation beaucoup plus grande chez l’ensemble de ses prédécesseurs que chez celui de ses contemporains. Une telle supériorité se manifeste, à de moindres degrés, aux époques les plus lointaines ; comme l’indique le culte touchant qu’on y rendit toujours aux morts, suivant la belle remarque de Vico.
Ainsi, la vraie sociabilité consiste davantage dans la continuité successive que dans la solidarité actuelle. Les vivants sont toujours, et de plus en plus, gouvernés nécessairement par les morts ; telle est la loi fondamentale de l’ordre humain.
Pour la mieux concevoir, il faut distinguer, chez chaque vrai serviteur de l’Humanité, deux existences successives : l’une, temporaire mais directe, constitue la vie proprement dite ; l’autre, indirecte mais permanente, ne commence qu’après la mort. La première étant toujours corporelle, elle peut être qualifiée d’objective ; surtout par contraste envers la seconde, qui, ne laissant subsister chacun que dans le cœur et l’esprit d’autrui, mérite le nom de subjective. Telle est la noble immortalité, nécessairement immatérielle, que le positivisme reconnaît à notre âme, en conservant ce terme précieux pour désigner l’ensemble des fonctions intellectuelles et morales, sans aucune allusion à l’entité correspondante.
D’après cette haute notion, la vraie population humaine se compose donc de deux masses toujours indispensables, dont la proportion varie sans cesse, en tendant à faire davantage prévaloir les morts sur les vivants dans chaque opération réelle. Si l’action et le résultat dépendent surtout de l’élément objectif, l’impulsion et la règle émanent principalement de l’élément subjectif. Libéralement dotés par nos prédécesseurs, nous transmettons gratuitement à nos successeurs l’ensemble du domaine humain, avec une extension de plus en plus faible en proportion de ce que nous reçûmes.
Cette gratuité nécessaire trouve sa digne récompense dans l’incorporation subjective qui nous permettra de perpétuer nos services en les transformant.
Quoiqu’une telle théorie semble constituer aujourd’hui le dernier effort systématique de l’esprit humain, les plus lointaines évolutions en offrent toujours le germe spontané, déjà senti chez les plus anciens poètes. La moindre peuplade, et même chaque famille un peu considérable, se regarde bientôt comme la souche essentielle de cette existence composée et progressive qui ne comporte, dans l’espace et dans le temps, d’autres limites nécessaires que celles de l’état normal propre à sa planète. Quoique le Grand-Être ne soit pas encore assez formé, les plus intimes collisions ne cachèrent jamais son évolution graduelle, qui, systématiquement appréciée, fournit aujourd’hui la seule base possible de notre unité finale. Même sous l’égoïsme chrétien, qui dictait au dur saint Pierre la maxime caractéristique : Regardons-nous sur la terre comme des étrangers ou des exilés on voit déjà l’admirable saint Paul devancer, par le sentiment, la conception de l’Humanité, dans cette image touchante mais contradictoire : Nous sommes tous les membres les uns des autres. Le principe positiviste devait seul révéler le tronc unique auquel appartiennent nécessairement tous ces membres spontanément confus.
La Femme. Je ne puis m’empêcher, mon père, d’admettre cette conception fondamentale, quelques difficultés qu’elle m’offre encore. Mais je m’effraye de ma nullité personnelle envers une telle existence, dont l’immensité m’efface davantage que ne le fit jadis la majesté d’un Dieu avec lequel, quoique chétive, je me sentais en relation propre et directe. Après m’avoir dominée par la prépondérance croissante du nouvel Être-Suprême, j’ai donc besoin que vous ranimiez en moi le juste sentiment de mon individualité.
Le Prêtre. Cela va résulter, ma fille, d’une appréciation plus complète du dogme positif. Il suffit de reconnaître que, quoique l’ensemble de l’Humanité constitue toujours le principal moteur de nos opérations quelconques, physiques, intellectuelles, ou morales, le Grand-Être ne peut jamais agir que par des organes individuels. C’est pourquoi la population objective, malgré sa subordination croissante envers la population subjective, reste nécessairement indispensable à toute influence de celle-ci. Mais, en décomposant cette participation collective, on la voit finalement résulter d’un-libre concours entre des efforts purement personnels. Voilà ce qui doit relever chaque digne individualité en présence du nouvel Être-Suprême davantage qu’envers l’ancien. En effet, celui-ci n’avait réellement aucun besoin de nos services quelconques, sinon pour de vains éloges, dont la puérile avidité devait même le dégrader à nos yeux. Rappelez-vous ce vers décisif de l’Imitation :
Peu d’hommes sans doute, sont autorisés à se regarder comme réellement indispensables à l’Humanité : cela ne convient qu’aux vrais promoteurs de nos principaux progrès. Mais toute digne existence humaine peut et doit sentir habituellement l’utilité de sa coopération personnelle à cette immense évolution, qui cesserait nécessairement aussitôt que tous ses minimes éléments objectifs auraient à la fois disparu. Le développement, et même la conservation, du Grand-Être, restent donc subordonnés toujours aux libres services de ses divers enfants, quoique l’inaction de chacun d’eux soit ordinairement susceptible d’une suffisante compensation.
Cette sommaire exposition du dogme fondamental de notre religion me permet, ma fille, de procéder maintenant à l’explication, d’abord générale, puis spéciale, du culte positiviste. Son étude vous fera sentir, j’espère, que l’aptitude poétique du positivisme est vraiment au niveau de sa puissance philosophique, sans avoir pu produire des résultats aussi décisifs.
La Femme. Nos deux précédents entretiens, respectivement consacrés à la théorie générale de la religion et à l’exposition synthétique du dogme de l’Humanité, m’ont dégagée irrévocablement de la situation contradictoire où je flottais entre l’impulsion catholique et la tendance voltairienne. Me considérant déjà comme positiviste, je viens donc vous demander désormais de m’apprendre directement à mieux aimer, pour mieux servir l’incomparable Déesse que vous m’avez révélée, et à laquelle j’espère mériter d’être finalement incorporée. Dès lors, mon attitude change spontanément, et nos conférences prennent davantage le caractère de véritables entretiens. Au lieu de vous soumettre des doutes essentiels, exigeant de longues explications, je ne vous interromprai qu’afin d’éclaircir ou de développer quelques indications insuffisantes. J’espère même, envers le culte, devenir assez active pour vous seconder, en devançant certaines explications, de manière à rendre votre, exposition plus rapide, sans qu’elle soit moins complète. Nous entrons ici dans le domaine du sentiment, où l’inspiration féminine, quoique toujours empirique, peut vraiment assister la construction sacerdotale.
Le Prêtre. Je compte beaucoup, ma fille, sur cette coopération spontanée, pour rendre cette partie de notre catéchisme moins étendue que la suivante. Mais, afin de mieux utiliser votre disposition actuelle, ce nouvel entretien, qui concerne seulement l’ensemble du culte, doit commencer en systématisant le plan général de la religion, quoiqu’il vous soit déjà familier.
Toute combinaison, même physique, et surtout logique, devant être toujours binaire, comme l’indique assez l’étymologie, cette règle s’étend nécessairement aux décompositions quelconques. La division fondamentale de la religion y satisfait naturellement, en répartissant le domaine religieux entre l’amour et la foi. Dans toute évolution normale, individuelle ou collective, l’amour nous conduit d’abord à la foi, tant que l’essor demeure spontané. Mais, quand il devient systématique, on construit la foi pour régler l’amour. Cette division principale équivaut à la vraie distinction générale entre la théorie et la pratique.
Le domaine pratique de la religion se décompose nécessairement aussi en deux, d’après la distinction naturelle entre les sentiments et les actes. La partie théorique-ne correspond qu’à l’intelligence, seule base possible de la foi. Mais sa partie pratique embrasse tout le reste de notre existence, aussi bien nos sentiments que nos actes eux-mêmes. L’usage universel et spontané, qui constitue le meilleur régulateur du langage, consacre directement une telle appréciation, en qualifiant de pratiques