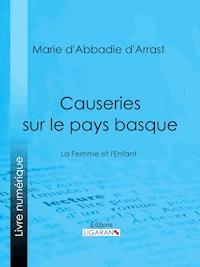
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Lorsque le Basque est étonné par la vue de quelque chose d'inusité et de bizarre, il emploie un proverbe que l'on peut traduire ainsi : « Celui qui veut voir de drôles de choses doit venir dans ce monde. » Nous pourrions parfois placer à propos ce proverbe en écoutant raconter certaines vieilles légendes du pays basque, en constatant le persistance d'usages dont on a de la peine à découvrir la raison d'être et l'origine."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN MEMORIAM AU Dr ET À Mme DIHURSUBÈHÈRE
La plupart de nos renseignements sur le pays basque, sur ses mœurs et ses traditions, nous les devons à une femme dont le souvenir doit rester en grand honneur dans notre région, à la regrettée Mme Dihursubèhère, veuve du Docteur Dihursubèhère qui, pendant de longues années, en collaboration avec son mari, avait consacré à ses compatriotes et, en particulier, aux habitants de la vallée de Saint-Étienne-de-Baïgorry, son grand dévouement, l’affection d’un cœur généreux et compatissant. Certes, si nous voulons attribuer au caractère basque une supériorité remarquable, nous regarderons au souvenir de ces deux amis, le Docteur et Mme Dihursubèhère. Tous deux nous semblent avoir incarné les meilleures vertus de leur noble race et c’est à leur mémoire qu’avec émotion, nous dédions en hommage de gratitude notre opuscule. Puissent-ils tenir pour agréable notre modeste offrande !
M. D’ABBADIE D’ARRAST.
Château d’Echauz, le… décembre 1908.
Nous avons recueilli, il y a une trentaine d’années déjà, les notes que nous publions aujourd’hui sur le Pays basque. Nous parlons en particulier de la basquaise, de l’enfant et enfin des hôtes inférieurs de la maison et de la montagne. Ces notes n’ont aucune prétention scientifique : elles n’ont d’autre intérêt, si tant est que le bienveillant lecteur puisse y satisfaire sa curiosité, que celui de l’ancienneté des souvenirs qu’elles évoquent ; car tandis que les versants des Pyrénées et les vallées où se sont établis les Basques demeurent dans leur superbe immobilité, les mœurs du petit peuple se sont modifiées, l’antique idiome euscarien a perdu sa pureté primitive et la transformation moderniste est si rapide que, peut-être, serait-il malaisé de s’entretenir aujourd’hui, comme nous avons eu le privilège de le faire jadis, avec des témoins qui, nés dans la première moitié du dix-neuvième siècle, avaient reçu les traditions de l’époque où leurs aïeuls furent les jeunes, c’est-à-dire vers la fin du dix-huitième siècle, contemporains de la Révolution Française de 1789.
Nous publions nos notes telles qu’elles se présentent à notre souvenir ; nous ne cherchons pas à y introduire un ordre chronologique quelconque ; c’est à la fois une conversation familière sur le temps passé et des observations personnelles plus récentes sur le mode de vie de chaque jour.
Le Pays basque n’a pas échappé au sort commun des anciennes provinces de France. Les routes, les chemins de fer, les relations avec les grands centres, les journaux, les vêtements qu’envoient les grands magasins de Paris avec les objets et ustensiles d’un usage courant, sont autant de causes d’affaiblissement de l’esprit local et particulariste ; le service militaire lui donne le coup de grâce.
Cependant, en dépit de l’usure du temps, nous retraçons la civilisation primitive par quelques traits de mœurs, par une certaine mentalité des habitants du pays. Cette empreinte antique persiste, grâce à l’attachement du basque à la Maison, à cette maison où sont venues naître et mourir tour à tour les générations successives. Par le moyen du foyer séculaire, la famille et les traditions se continuent ; le Code civil n’est pas parvenu à détruire entièrement tout vestige de l’état premier, tandis qu’au contraire, d’une façon presque universelle, le souvenir du passé s’est effacé au sein des nations civilisées du globe, lorsque la perpétuité de la famille n’a pas été assurée par la permanence héréditaire du domaine.
Bientôt les récits consignés dans notre petit livre seront de l’histoire ancienne, absolument oubliée. Maintenant, quoique tardivement, nous arrivons par l’observation de la façon de vivre et d’agir de nos basques à la conclusion logique, conséquence de la permanence de l’habitation, que la femme occupe parmi eux une place hors pair. Nous nous trouvons en présence des dernières manifestations d’un état social que l’on a retrouvé identique dans un grand nombre de civilisations anciennes et que l’on désigne sous le nom de « Matriarcat » ou gouvernement des Mères. Sans doute, il serait téméraire d’affirmer que chez l’Escualduna, la femme fut en possession de droits juridiques qui élevaient sa condition au-dessus de celle de l’homme ; nous pensons qu’il faut s’en tenir à admettre qu’il existait une certaine égalité entre les sexes, égalité ou confusion de droits dont le texte des fors, c’est-à-dire des codes des provinces basques, établissent la réalité ; cette égalité de droits entre les sexes existait d’une façon plus évidente dans les siècles passés qu’actuellement. Rappelons le témoignage de Plutarque qui écrit expressément que lorsqu’Annibal franchit les Pyrénées, il s’engagea à dédommager les populations montagnardes des dégâts que causeraient ses troupes. Entre lui et la population des vallées, il fut convenu, d’un commun accord, qu’un tribunal de femmes fixerait le chiffre des indemnités ; les femmes étaient donc en possession d’un mandat de juré, d’une magistrature ; c’est-à-dire qu’elles prenaient part au gouvernement et nous lisons dans Eugène Cordier : « Organisation de la famille chez les Basques » que dans le for de Jaca, en Aragon, se trouve une disposition du même ordre « que mon maire », dit le roi, « n’accueille pas de plainte contre un homme de Jaca, si ce n’est à l’arbitrage des femmes de la ville ». Or, les Basques et les Cantabres, s’ils n’ont pas une origine commune, sont assez voisins les uns des autres pour faire admettre comme plausible une ressemblance d’usages s’étendant d’un peuple à l’autre.
On sait que chez les Basques, l’héritage était dévolu à l’aîné des enfants sans distinction de sexe. Encore, aujourd’hui, on observe cette extension à la femme, du droit d’aînesse. Lorsqu’une fille est l’aînée, elle est l’héritière et elle devient la maîtresse de la maison, la maîtresse du domaine familial. On l’appelle l’Etcheko anderia, la dame, la seigneuresse de la maison. Le mari qu’elle prend pour cultiver le bien, occupe un rang intermédiaire entre celui de maître et de valet de ferme : il n’y a, du reste, pas de mot propre en basque qui exprime la relation du mari vis-à-vis de sa femme. Nous rappellerons, dans le courant de ce volume, certaines particularités des fors sur la constitution de la famille.
Mais, avant d’aller plus loin, nous devons dire quelques mots au sujet de l’énigme qui semble insoluble de l’origine de la race Basque. Plusieurs hypothèses ont été émises. On a vu chez les Basques les descendants des « rescapés » de l’immense naufrage où est venu s’effondrer dans les flots de l’Atlantique, un continent tout entier, celui de l’Atlantide. Les Basques seraient de la race des Atlantes. D’autres auteurs, en présence des découvertes dans les tombeaux de la haute Égypte, de squelettes d’une très grande antiquité, avaient rattaché les Basques à des gens que l’on avait désignés sous le nom de « New race ». Cette hypothèse doit, sans aucun doute, disparaître depuis les études de M. de Morgan sur les tombeaux découverts à Négadah, qui semblent établir que la race que l’on regardait comme celle des envahisseurs de l’Égypte, après la sixième dynastie, doit être reportée à l’époque néolithique, à l’homme préhistorique. Les Basques sont-ils de la grande famille humaine qui s’est établie sur le pourtour de la Méditerranée ? Doit-on les considérer comme les frères des Touaregs du désert, comme des cousins germains des Étrusques, des Cantabres, des Carthaginois ? Faut-il, avec le comte de Charencey, retracer leur long exode depuis le pays des Finnois, des Lapons jusqu’aux Pyrénées, à travers les continents asiatiques, s’enrichissant à chaque étape de leur vie pastorale d’usages, de mots qu’ils adoptèrent jusqu’à l’arrivée dans un pays qui leur parut plus beau, plus doux à habiter qu’aucun autre ; le pays enchanteur des riantes vallées des Pyrénées qui fut pour eux la possession convoitée pendant de longs siècles de la « Terre promise » ? M. Julien Vinson, l’éminent linguiste de l’École des Langues orientales, se rattache à une hypothèse différente qu’il a faite sienne pendant son séjour à Bayonne, comme Garde Général des Eaux et Forêts. Pour M. Vinson, qui approfondit le problème à l’aide de sa connaissance extraordinaire de la langue euscarienne, les Basques ne viennent de nulle part autre que de chez eux, c’est-à-dire qu’ils seraient une race autochtone. Dans son livre : Les Basques et le pays basque, voici ce qu’a écrit le savant auteur : Il est infiniment probable que les Basques n’ont jamais été, aux époques les plus reculées, qu’une tribu peu nombreuse, cantonnée dans quelques vallées des Pyrénées occidentales, dont l’état de civilisation était des plus rudimentaire. Du moins leur langage, à en juger par le basque moderne, était très pauvre ; pas d’expressions indiquant des idées abstraites : point de « Dieu », de « roi », de « loi » ; point ou très peu d’ustensiles domestiques ; pour armes une « hache » dont le nom « haïzkora » dérive peut-être du mot « haïtz » « pierre, rocher ».
M. Bladé, Études sur l’origine des Basques, après de nombreuses objections qu’il accumule contre la pureté de la race euscarienne, note que les Basques sont aujourd’hui regardés, par l’immense majorité des savants, comme les héritiers des Vascons qui se rattacheraient eux-mêmes par un lien non moins légitime aux Ibères, dont on fait volontiers la population primitive de l’Espagne. Quand il s’agit, au contraire, de déterminer l’origine de ces Ibères, l’accord fait place à la plus complète division. Ici, plusieurs hypothèses prennent place, dont quelques-unes sont de haute fantaisie :
I. Les Basques descendent du patriarche Tubal ou de son neveu Tarsis (Saint-Jérôme, d’après Josèphe).
II. Les Basques sont les mêmes que les Ibères du Caucase. Identité qui ne repose que sur des textes tirés de Strabon ou de Pline.
III. Les Basques se rattachent aux populations africaines, c’est l’opinion de Chaho et d’Antoine d’Abbadie.
IV. La langue basque est un idiome sémitique.
M. Eichoff affirme, sans en fournir aucune preuve, que les ancêtres des Basques sont venus de la région des langues chaldéennes en suivant le littoral de l’Afrique septentrionale.
V. Les Basques se rattachent à la famille aryenne. Chaho qui compare le basque au sanscrit, ne s’appuie, pour soutenir son opinion, que sur des analogies de glossaires.
VI. Les Basques se rattachent au groupe Touranien, c’est-à-dire qu’ils seraient de la même famille que les Finnois et les Samoyèdes. L’allemand Rasse prétend que les Basques ne sont que des Finnois et c’est l’opinion de Bergmann, professeur à la Faculté des lettres de Strasbourg, que les Basques sont venus des rives de la Baltique.
VII. Les Basques se rattachent aux Américains primitifs.
Carl Vogt serait le premier anthropologiste qui ait accueilli cette hypothèse après les études de crânes basques du cimetière de Zarauz dans le Guipuscoa, études du Dr Paul Broca. C’est l’hypothèse d’une Atlandide qui aurait relié la Floride à notre continent. M. de Humboldt s’est plu à trouver des ressemblances entre l’Euskara et les langues primitives de l’Amérique. Antoine d’Abbadie ne contredit pas ces assertions, mais il se garde de conclure. Le comte de Charencey a également étudié les affinités du basque avec les idiomes canadiens, iroquois, lénapès, algonquins.
Au milieu de toutes ces suppositions auxquelles il conviendrait d’ajouter l’affirmation de certains abbés qu’Adam et Ève parlèrent euscarien dans le paradis, M. Vinson a procédé par voie d’élimination et, constatant l’insuffisance des preuves, il en est arrivé à l’hypothèse d’une race autochtone que nous avons exposée plus haut.
Ainsi la langue que parle la petite nation pyrénéenne, n’apporte pas de solution indiscutable au problème de son origine : la littérature de ce peuple est trop sommaire pour qu’on lui demande des éclaircissements et, tandis que chez d’autres nations, les pierres parlent, les rochers sont couverts de signes épigraphiques, documents historiques indestructibles, ici, les pierres se taisent et les rochers sont muets. Mais qu’importe une question d’origine, question toujours douteuse et obscure dans les familles comme chez les peuples ; ici, une famille se rattache au patriarche Noé et affirme avoir eu ses parchemins préservés dans l’arche et sauvés des eaux ; là, un peuple se dit fils d’un loup ou d’un cheval ou d’un lévrier ou d’hommes géants. Certains savants nous font remonter à l’anthropopithèque, l’homme singe dont ils croient sans cesse retrouver le précieux tibia dans un terrain tertiaire. Contentons-nous, au sujet des Basques, puisque le mot de l’énigme n’est pas trouvé, de dire que leur pays est charmant entre tous, que les habitants sont d’honnêtes gens dont l’accueil est cordial ; que les routes sont bonnes et favorables à l’automobilisme ; que les frontières au Sud, à l’Est à l’Ouest, s’ouvrent sur l’Espagne et qu’aucune excursion ne saurait être plus intéressante qu’une course vers l’Espagne à travers le pays basque. Là est la question pratique et nos souvenirs recueillis sur place fourniront assez de couleur locale au touriste pendant les vacances, pour qu’il pénètre Français dans notre région doucement montagneuse et qu’il en sorte Basque basquisant, le makhila au poignet, le béret sur le chef, les reins serrés dans la ceinture rouge, les pieds chaussés d’espargattes, espadrilles ou alpargattes. Aussi le sage ne s’embarrasse pas de problèmes qui fatiguent l’esprit et tout en regardant voler sous ses yeux le riant paysage, il se chantera à lui-même sur le mode enjoué, le « carpe diem » oraison agréable aux saints protecteurs de l’enivrante vitesse. Nous indiquons ci-après un petit manuel de la conversation à l’usage des chauffeurs et quelques indications d’agréables itinéraires.
Vallée de Baïgorry route des Aldudes. Sources de la Nive ; par les Aldudes. Roncevaux et retour par Saint-Jean-Pied-de-Port. Route du Col de Ispéguy. Ascension du pic de Hausa. Descente sur l’Espagne. Elissonde et Pampelune : retour par Cambo ou Fontarabie. Ascensions de la chaîne de Bustanxelhay, du Mont Baïgoura, du Yarra. Descente sur Ossés :
Vallée de Saint-Jean-Pied-de-Port, course à Esterençuby et sources de la Nive-de Saint-Jean : course à Ahusqui et descente par Tardets et Mauléon ; magnifiques forêts à parcourir ; route de Saint-Jean-Pied-de-Port à Mauléon par le col de Ausquiche ; ascension du pic d’Ory ; route de Mauléon à Oloron : Sauveterre, Saint Palais.
Les quatre vallées de Baïgorry, Saint Jean-Pied-de-Port, Tardets et Mauléon rivalisent de pittoresque et de fraîcheur ; elles sont sillonnées par des Nives ; encadrées de montagnes, elles offrent au touriste le calme et une solitude relative et le bien-être d’un air pur qui réconforte et qui vivifie.
Lorsque le Basque est étonné par la vue de quelque chose d’inusité et de bizarre, il emploie un proverbe que l’on peut traduire ainsi : « Celui qui veut voir de drôles de choses doit venir dans ce monde. »
Nous pourrions parfois placer à propos ce proverbe en écoutant raconter certaines vieilles légendes du pays basque, en constatant la persistance d’usages dont on a de la peine à découvrir la raison d’être et l’origine. Les personnes très âgées parlent avec un respect superstitieux de ces coutumes qui sont restées dans leur souvenir comme des extensions de leur foi religieuse. Il en est ainsi, en France, de Saint-Jean-Pied-de-Port, Mauléon, Saint-Palais, jusqu’aux rives de la Bidassoa, en Basse Navarre. Soule et Labourt et en Espagne, dans les populeuses provinces de la Navarre et du Guipuscoa, sur les deux versants des Pyrénées, là où s’étend en longue bande le territoire qu’occupe le peuple basque.
Chez les Basques, nous venons de le dire, la transmission de la propriété se fait en faveur de l’aîné, garçon ou fille. L’héritier avantagé légalement du quart est, bien entendu, dans l’obligation de désintéresser ses cohéritiers pour pouvoir garder la totalité du bien de famille. Cette obligation est une source intarissable d’embarras d’argent, d’expédients, de gêne, de pauvreté. Pour s’en tirer, l’héritier ou l’héritière cherche à épouser une dot, quelques milliers de francs, qui vont alléger d’autant la dette contractée vis-à-vis des frères et des sœurs. Mais cette petite somme ne suffit pas et souvent il faut que le mari ou les fils s’ingénient pour sauver la situation ; ils s’expatrient, deviennent bergers dans la République Argentine ou en Californie, et ne rentrent chez eux, après plusieurs années d’exil, que lorsqu’ils peuvent, grâce aux bénéfices que leur ont donnés les troupeaux de bœufs et de brebis sur la terre d’Amérique, dégrever le bien et désintéresser leurs créanciers.
C’est le jour de marché, sur la place du village, que jeunes gens et jeunes filles font connaissance ; si de part et d’autre la fortune semble satisfaisante, les parents consentent au mariage et font la demande officielle. L’héritière a recherché chez le jeune homme qu’elle veut épouser, les qualités d’un bon laboureur. Elle a besoin de s’assurer les services d’un brave travailleur, car c’est à son mari qu’elle va confier le soin de cultiver ses champs et de soigner son bétail, et de préférence elle jettera son dévolu sur un homme qui aura, comme valet de ferme chez quelque grand propriétaire du pays, acquis des connaissances pratiques en agriculture.
En retour de l’apprentissage agricole qu’elle exige de son futur mari, elle tient à lui prouver qu’elle a, comme maîtresse de maison, des aptitudes sérieuses. Elle s’est placée elle-même pendant un ou deux ans comme servante dans une maison riche à Bordeaux, à Saint-Jean, à Biarritz, à Bayonne. Tous les samedis son fiancé vient passer la soirée avec elle et elle lui prépare à souper. Châtaignes rôties, lait de brebis caillé, fromage, œufs aux tomates sur une tranche de jambon frit qui s’intitule une chingara, galette de farine de maïs, qu’on nomme des talouas, et pain de maïs ou méture ; elle lui offre un vrai festin. Elle y met de l’amour-propre, elle veut qu’il apprécie ses talents culinaires. Le moment du mariage s’approche, on songe à se procurer les meubles, la corbeille et le trousseau. Le jeune homme commande chez le menuisier l’armoire, le lit, une table, des chaises ; il achète la robe de cachemire noir qui servira de robe de noce : c’est lui qui doit également payer l’anneau de mariage, une broche en or, les boucles d’oreilles, une chaîne de cou à l’extrémité de laquelle est accroché un médaillon.
Depuis longtemps la jeune fille a mis en réserve une pièce de belle toile qu’elle a filée elle-même dans les veillées d’hiver, avec le lin récolté sur sa terre. Dans cette pièce de toile, elle taille une douzaine de chemises pour le trousseau de son fiancé. Ce seront les chemises de travail. Elle fait coudre pour le jour du mariage, une plus belle chemise en toile très fine et très blanche, qu’elle orne d’un bouton en or pour fermer le col. C’est elle qui doit faire les frais des rideaux du lit et fournit les ustensiles de toilette de son futur ménage. C’est à la ville voisine, chez le marchand de nouveautés le plus en renom, que la corbeille et le trousseau sont achetés. Les fiancés s’y sont rendus accompagnés de la mère de la jeune fille et de la couturière. La couturière est le personnage important ; son rôle est de discuter les achats, de conseiller, de juger. On ne décide rien sans sa haute approbation. Elle a droit à tous les égards ; aussi le marchand lui offre-t-il en cadeau une robe de laine noire, et il l’invite au repas qu’il a préparé pour les fiancés et pour leur mère, repas qui est l’heureuse conclusion des brillantes affaires qu’il vient de traiter. On dîne donc ensemble chez le marchand, et, après le dîner, l’on s’en retourne à pied, à cheval ou à dos de mulet.
Pour rentrer à la maison, il faut marcher pendant plusieurs heures et monter la montagne qui est abrupte. On s’étonne des courses que peuvent faire, dans le pays, de vieilles gens et des enfants pour aller à l’église ou pour suivre l’école.
L’habillement de noce du fiancé se compose d’une veste ronde de drap noir, laquelle flotte sur une ceinture de laine rouge et s’ouvre largement pour laisser voir le gilet d’étoffe rouge et la blancheur éblouissante de la chemise ; un béret bleu sur la tête, et aux pieds les chaussures de toile blanche, à semelles de chanvre, sont les compléments du costume. Jadis on portait des culottes courtes de velours, et on voyait s’échapper du béret de longs cheveux bouclés qui tombaient sur les épaules. Les cheveux sont devenus courts et les culottes se sont allongées en pantalons. La fiancée porte la grande mante noire ornée de dentelles dont elle s’enveloppe en entier, et, chose bizarre, pour se marier, elle met plusieurs robes les unes sur les autres, parce que paraît-il, la bénédiction nuptiale a la vertu de préserver, de purifier et de sanctifier les vêtements que l’on porte ce jour-là. La bénédiction du prêtre les met à l’abri des sortilèges. Or la sorcière, en pays basque, joue un rôle important ; on la redoute, on connaît son pouvoir ; elle fait boiter les chevaux, elle jette le mauvais sort sur le bétail ; elle rend ses victimes, hommes, femmes et enfants, malades de consomptions étranges et terrifiantes. Ah ! certes, il fait bon se rendre invulnérable par des vêtements à l’épreuve de la méchanceté diabolique.
Quarante-huit heures avant le jour fixé pour le mariage, il est d’usage que le fiancé envoie chez sa fiancée la corbeille et les objets qui constituent sa dot. Plus il est riche, plus il possède d’objets, plus il emploie de charrettes pour transporter son ménage. Les charrettes sont attelées de vaches sous le joug. Elles s’alignent sur la route au nombre de 2, 3, 4, d’après les richesses de leur propriétaire. L’arrangement des charrettes est une œuvre d’art ; les meubles se présentent en façade sur les côtés ; les matelas sont empilés au milieu pour donner une apparence plus fournie ; quand les charrettes sont chargées, l’on forme le cortège selon certaines règles et l’on se met en marche, montant et descendant, par les chemins de montagne, traversant les villages, sous les yeux des habitants ébahis qui se hâtent d’accourir aux fenêtres et sur le pas de leur porte, pour admirer le défilé.
La première chose qui attire les regards, c’est un superbe mouton blanc. Un jeune homme le tient en laisse et ouvre la marche. Les cornes de l’animal sont dorées ; des rubans et des banderoles de couleur flottent sur sa toison, et au cou il porte une grosse cloche que l’on nomme bouloumba, à cause du grand bruit sonore, bou-lou, bou-lou, par lequel, pendant la marche du cortège, il semble qu’on avertisse les gens de venir regarder. Après le mouton, s’avancent cinq à six jeunes filles ; celles-ci portent avec grâce et assurance, sur la tête, de grandes corbeilles rondes en osier. Le rebord des corbeilles est garni de serviettes à bordure rouge et bleue. Sur les serviettes, on a placé avec soin des pains, des bouteilles de vin, des liqueurs et de hauts gâteaux en forme de clochers tout garnis de fleurs. Ce sont des provisions que les amis de la fiancée apportent pour le repas de la noce ; les charrettes viennent ensuite les unes devant les autres ; sur la plus haute des charrettes on a juché la couturière ; elle trône sur la pile des matelas ; elle va veiller à l’arrangement de la chambre nuptiale et monter les rideaux du lit. Quant au beau mouton blanc, est-il besoin de le dire ? Aussitôt arrivé à destination, il est cruellement égorgé, devant figurer rôti sur la table le surlendemain.
Tous ces préparatifs menés à bien et heureusement terminés, le jour du mariage, les amis vont en troupe chercher le fiancé dans sa maison et le conduisent chez la future, qui, de son côté, est entourée de ses compagnes. L’église est quelquefois à une heure de marche, en bas dans la vallée. Les gens de la noce descendent à dos de mulets. Les mulets sont parés avec coquetterie, les brides ornées de cuivre, sont chamarrées de pompons aux vives couleurs. Sous les selles, on a mis de grandes couvertures aux teintes éclatantes que terminent de longues franges. Rien n’est plus pittoresque que de voir défiler le long des bois, par les contours de la route qui serpente entre les rochers, la longue escorte des futurs jeunes mariés. On sent qu’une noce, chez ces gens, est vraiment une fête pour leur cœur simple ; il semble alors que la nature même ait voulu s’unir à leur joie en se faisant pour eux plus pittoresque et plus belle encore par la fraîche verdure de ses beaux arbres, ses clairs ruisseaux au gai murmure, les couleurs chatoyantes des fougères et des bruyères sur le flanc des montagnes.
Une noce, autrefois, durait trois jours pleins et l’on ne craignait pas de s’y rendre de dix lieues à la ronde ; les repas en sont la principale affaire : ils durent tout l’après-midi. On se met à table au retour de l’église. À la fin de la journée, les mariés se lèvent de table et on forme la farandole. Le garçon d’honneur la conduit ; les invités se tiennent les uns les autres par leurs mouchoirs ; un violon les accompagne et ils s’en vont ainsi, dansant par les rues du village, l’air parfaitement heureux. Le marié doit déjà pâtir : il est relégué sur les côtés de la farandole, il marche tout seul et porte sous chaque bras, avec une résignation touchante, une bouteille de vin. Il tient un verre à la main, et à chaque passant qu’il rencontre, son devoir est d’offrir un verre de vin. Or, on ne se fait pas faute d’user de sa bonne volonté. Pendant que les gens de la noce dansent, il verse à boire de l’air d’un homme bien ennuyé de son rôle ridicule. Après avoir fait plusieurs fois le tour du village, la farandole entre pour se reposer et se rafraîchir à l’auberge ; les cavaliers servent à leurs danseuses des verres d’eau sucrée et des sirops, chose très appréciée dans le pays. Vers dix heures, on revient à la maison toujours chantant et dansant ; le souper est servi. On se remet à table, on soupe, puis, après souper, on achève la nuit dans les danses au son du flageolet et de l’instrument que les Basques appellent le chiroulire, qui est une sorte de petite guitare sur les cordes de laquelle on frappe avec un bâton.
À partir du jour où il habite sa nouvelle maison, le marié perd son nom de famille. On ne le désigne plus que sous l’appellation de la demeure dont il est devenu le maître, de sorte que, par le fait, chez les Basques, c’est la femme, lorsqu’elle est héritière, qui donne son nom à son mari ; ce n’est pas le mari qui donne son nom à sa femme.
D’ailleurs, M. Eugène Cordier qui a beaucoup étudié le droit des provinces basques, remarque qu’une faveur singulière entoure les jeunes ménages, c’est-à-dire ceux des aînés, fils ou filles qui se marient. Dans les trois coutumes basques de France, Basse-Navarre, Soule, Labourt, la dot du conjoint est remise aux parents, et ceux-ci doivent aux nouveaux époux la moitié divise des propres de la famille sur laquelle ils perdent tous leurs droits.
La dot entre les « Rustiques de Soule » était acquittée, jusqu’au XVIIIe siècle, moitié en argent, moitié en bon bétail « bouvin » à dire d’experts. Plus anciennement, l’argent était rare, nous savons par le texte d’anciens contrats de mariage qui remontent au XVe siècle, que les dots étaient presque exclusivement en bétail.
Pour compléter le tableau de ces anciens usages, nous devons ajouter que les cadets n’avaient rien à prétendre des biens de famille ; leur devoir était d’abord de rester dans la famille, d’y travailler, d’y servir, sans quoi ils perdaient leurs droits si faibles déjà ; les cadets étaient donc, en réalité, des domestiques sans gages, dans leur propre maison, tant qu’ils n’étaient pas mariés.
Les obligations des puînés des deux sexes, à Barège, les faisaient désigner sous le nom d’esclaves ; s’ils quittaient leur maison natale sans le consentement de l’héritier, ils devaient ensuite, pour obtenir leur légitime, rapporter les profits qu’ils avaient faits au dehors.
Dans les maisons basquaises, nous retrouvons les traces de toutes ces anciennes coutumes : la famille habite autant que possible sur la terre patrimoniale : les frères, les sœurs, les oncles, les tantes, restent attachés à la propriété et travaillent avec les héritiers ; le même toit les abrite tous ; la nourriture auprès du feu de la cuisine est partagée entre tous. En Soule, s’il n’y avait dans la maison qu’un lit, les héritiers en se mariant prenaient possession de la couche unique ; les vieux parents et autres personnes se logeaient dans la grange comme l’on pouvait, et l’on dormait sur le foin destiné au bétail. On n’en dormait pas moins bien après les durs travaux de la journée.
Si le mariage est bien caractéristique chez le peuple basque, la mort et les cérémonies qui suivent la mort sont non moins intéressantes.
On accepte la mort avec héroïsme. Du reste, chez tous les peuples agricoles qu’un commerce incessant avec la nature habitue à accepter l’inévitable mort comme la loi commune, on meurt facilement.
Les Basques ont conservé cette simplicité. Lorsque la mort survient, elle ne les surprend pas ; ils l’accueillent sans trouble, sans apparat et sans phases. Leur foi enfantine, résignée, leur laisse peu de regrets d’une vie qui leur a été rude et qu’ils vont échanger contre les choses meilleures. Avec soumission à la volonté de Dieu, ils disent en présence de la mort : « Ce que Dieu voudra ». Ils ne se révoltent pas contre la destinée fatale.
Voltaire a défini les Basques : « Un petit peuple qui saute et qui danse au haut des Pyrénées » : sauteurs et danseurs savent, à leur heure, être des stoïques.
Il serait aisé de multiplier par des exemples frappants, les preuves de leur sang-froid au moment du délogement.
Gachina, la veuve de Manech, maîtresse de la maison Curutcheta, est tombée gravement malade. On a attendu pensant qu’elle allait se remettre, mais l’amélioration n’ayant aucunement l’air de se manifester, on s’est décidé à appeler le médecin. La maison, avec son champ, sa prairie et ses bois, est située sur le penchant de la montagne, à une altitude de 500 mètres au moins au-dessus de la vallée. Le chemin qui y conduit est long, rocailleux : un mulet y passe avec peine ; les secours, en conséquence, sont pénibles à se procurer. Le médecin avait d’autres malades ; il n’est venu qu’à la seconde ou troisième invitation. C’était trop tard ; il a dit à la famille qu’il n’y avait plus d’espoir, qu’il était inutile qu’il revînt.
Chez les paysans, on est philosophe. Le médecin parti, la femme du fils aîné s’est approchée du lit de sa belle-mère et d’un ton à peine plus grave qu’à son ordinaire, elle lui fait la lugubre communication :
« Vous êtes bien malade, ma belle-mère, vous avez une très forte fièvre ; dans quelques jours vous n’aurez peut-être plus toute votre lucidité d’esprit ; il vaudrait mieux faire tout de suite ce qu’il vous reste à faire. Vous avez d’autres enfants que Peyo, mon mari, et vous avez promis d’arranger les choses en notre faveur. »
La pauvre Gachina n’a que trop compris. Elle regarde droit dans les yeux de sa belle-fille, mais ni l’une ni l’autre des deux femmes n’éprouvent un instant de défaillance. Il faut bien mourir une fois ; c’est la volonté de Dieu !
On court chez le notaire, on court chez le curé ; bientôt, au contentement de la famille, les affaires temporelles et spirituelles de la mourante sont en règle.
Vers le soir, une voisine qui, de temps à autre, avait veillé Gachina, monte pour lui dire adieu.
« Ah ! voisine ! je vous remercie de vos soins », lui dit Gachina d’un ton affectueux, « mais surtout ne manquez pas de venir à mon enterrement ».
La belle-fille qui assiste aux adieux, ajoute d’un air satisfait ;
« Oui, oui, soyez sans inquiétude, ma mère, nous vous ferons tous les honneurs ».
Alors, Gachina se souvient que le lendemain c’est le jour de marché. Elle retient sa belle-fille et lui recommande de ne pas manquer d’aller au village se fournir des provisions que rend indispensables l’évènement qu’il faut prévoir. Elle n’oublie rien, ni le boucher, ni le boulanger. Pour le repas des funérailles, elle veut que les invités aient du café, elle commande les cierges, la bougie filée et les aunes de ruban noir. Ces rubans serviront à lier ses pieds, ses mains et son visage lorsqu’elle sera morte.
En effet, le lendemain, la bru exécuta les ordres qu’elle avait reçus. Il s’agissait de ne rien épargner, car la maison était ancienne et considérée. À son retour du marché, sa belle-mère respirait encore. Elle monta doucement l’escalier, sur la tête sa corbeille ronde garnie de vivres et d’objets funèbres ; elle s’approcha du lit et présenta ses emplettes. « Voyez, ma mère », dit-elle sans embarras et presque sans émotion, « voyez ceci et encore ceci… je l’ai acheté chez un tel… je l’ai payé tant. Êtes-vous contente ? Maintenant mourez tranquille, vos honneurs seront bien faits. »
Et à mesure que le contenu de la corbeille s’étale sur le lit, on voit comme un éclair de satisfaction errer sur le visage livide. Puis une idée traverse l’esprit de Gachina ; elle fait comprendre qu’elle veut parler. Son fils s’approche, et lorsqu’elle sent l’oreille à portée de sa bouche elle dit :
« Peyo ! promets-moi, le jour de mon enterrement, de me couvrir de ma belle mante de mariage ».
Ce furent ses dernières paroles. Le roi des épouvantements était entré dans la demeure de la veuve de Manech et y avait fait son œuvre. Mais quel calme pour le recevoir, quelle résignation pour l’accueillir ! Puissent les Basques conserver parmi eux la tradition de ce superbe sang-froid qui est à leur plus grand éloge !
Catherine, dite la « noire » ou la « doyenne » était la plus vieille des bohémiennes du pays basque et on la considérait comme la reine des bohémiens. Elle vint à mourir âgée de 82 ans, dans le village de Iholdy ; elle était née en 1817, dans une commune voisine où les bohémiens de la région venaient volontiers s’établir ; cette Catherine avait une physionomie à part ; elle était la terreur des petits enfants par la rudesse de ses traits ; on racontait qu’elle avait subi cinq condamnations pour délits de vols, vagabondage, mendicité. Selon l’habitude de ses compatriotes, elle usait de menaces pour se faire donner les vivres dont elle avait besoin ; lorsqu’elle se présentait à la porte d’une maison, elle demandait qu’on lui donnât du pain, des légumes secs et elle ajoutait : « ou autrement, vous aurez affaire à moi ».





























