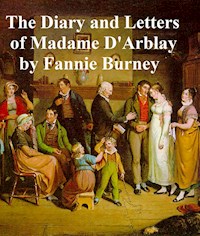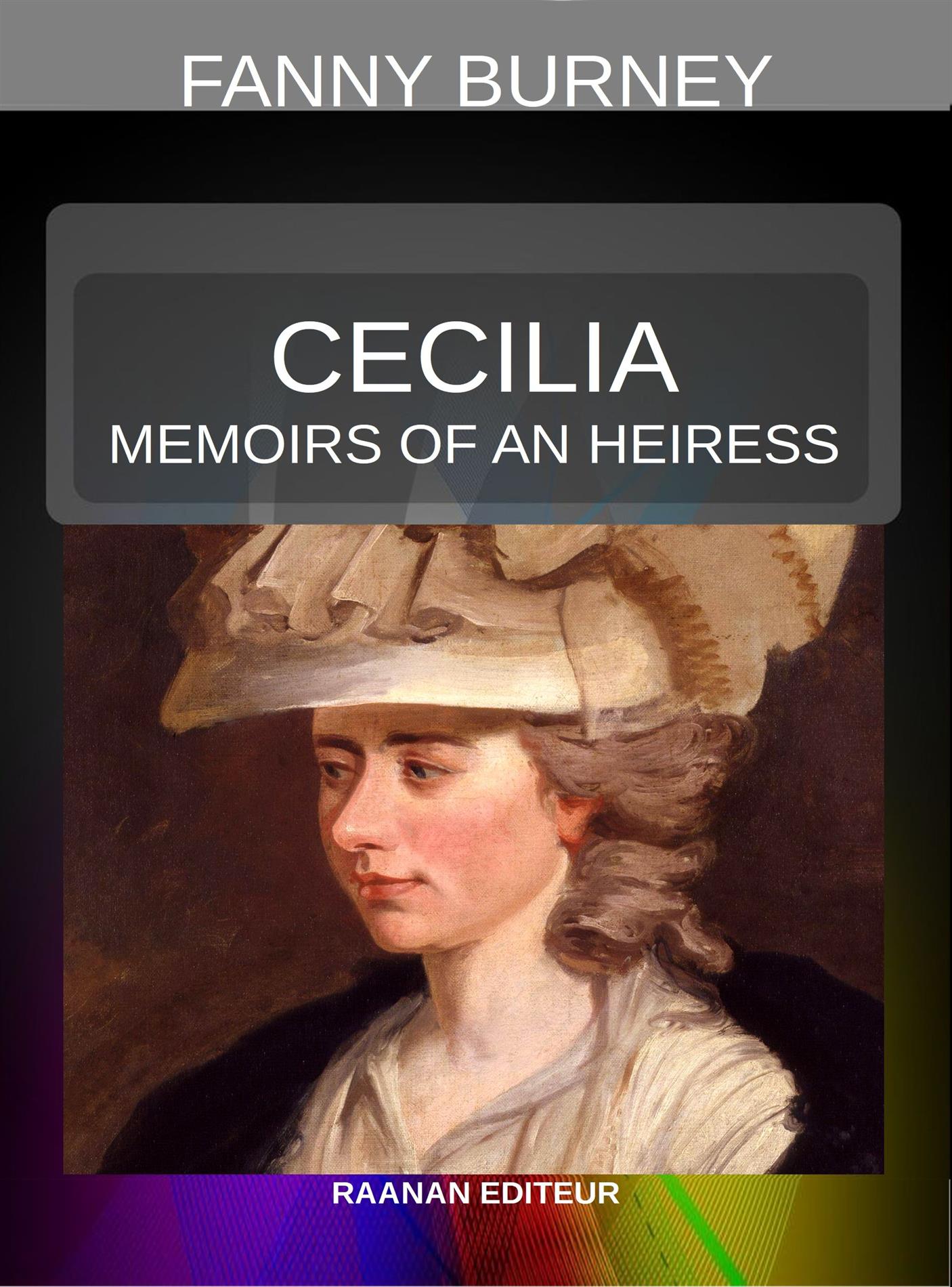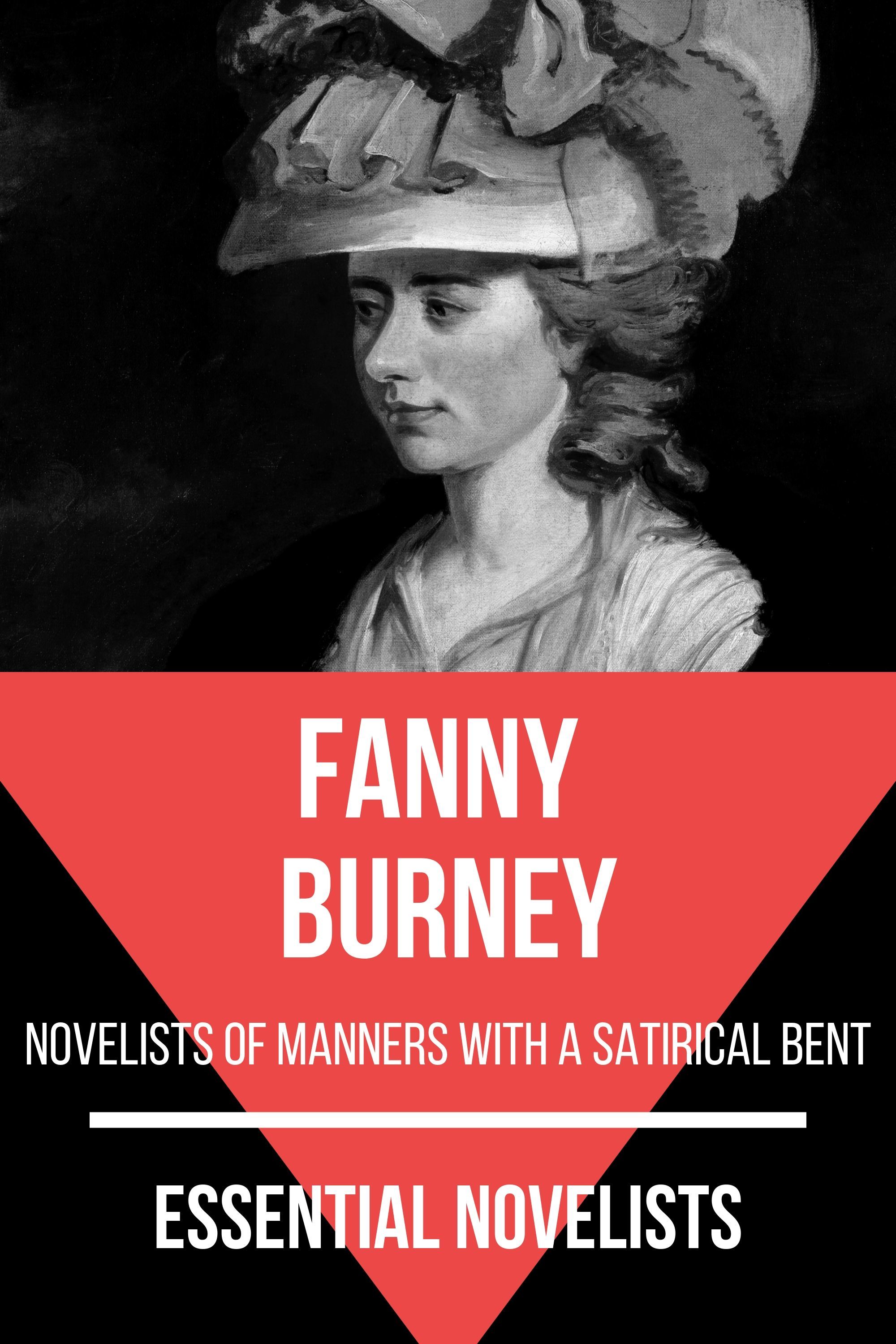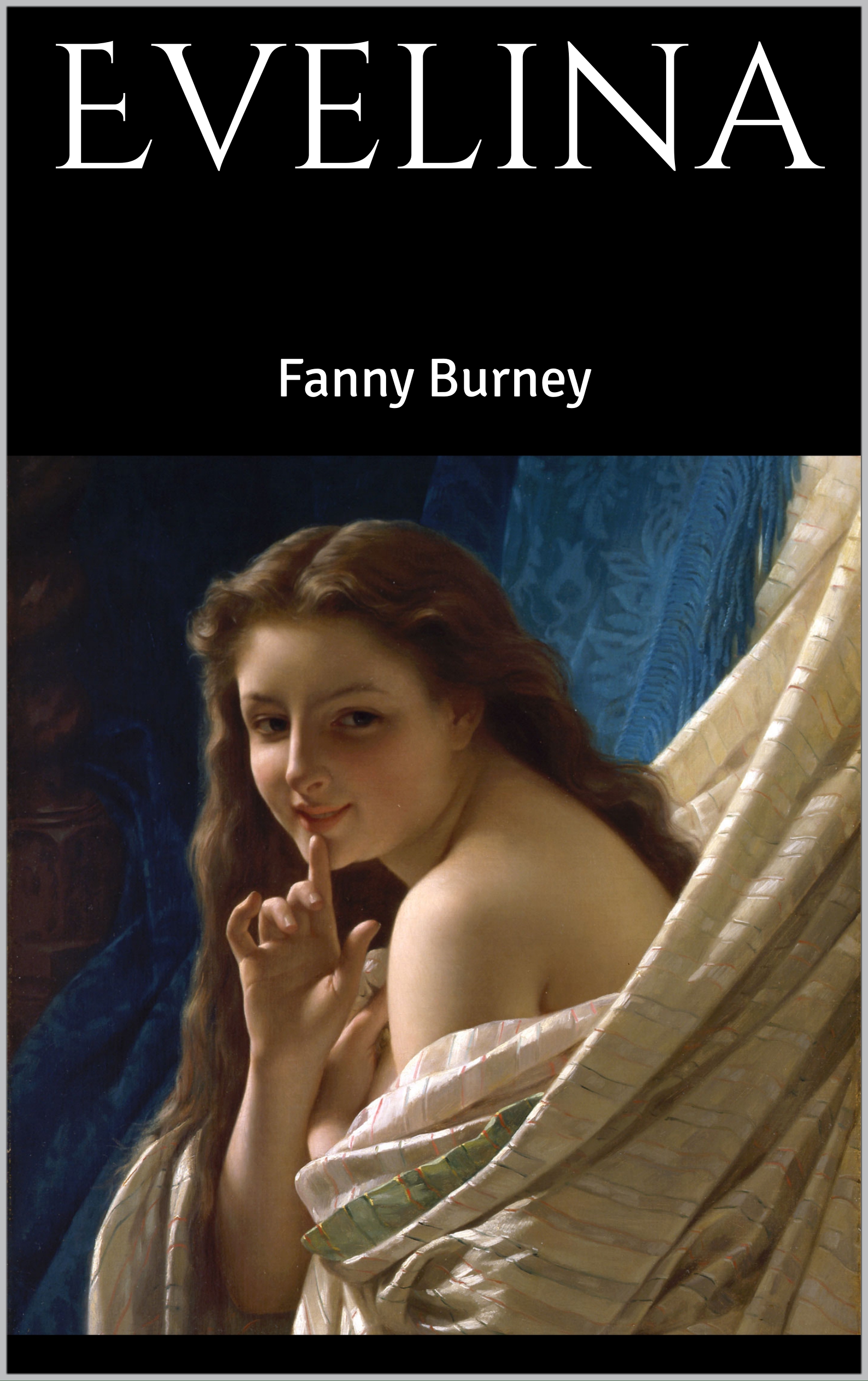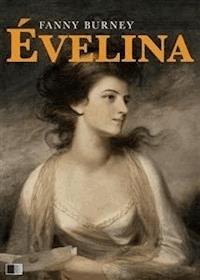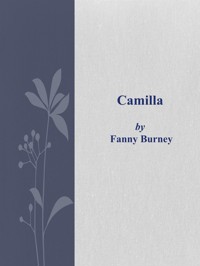2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FV Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le belle Cécilia, qui voudrait tant se marier par amour et non selon les conventions de l'époque, arrivera-t-elle à se défaire de cet héritage si pesant ? Sur fond de critique sociale et de mise en lumière de la condition féminine au XVIIIeme siècle, ce roman constitue un véritable chef d'oeuvre dont l'histoire et les personnages ont inspiré le célèbre « Orgueil et Préjugés » de Jane Austen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Contenu
copyright
CECILIA
AVIS DE L’ÉDITEUR
LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
LIVRE II.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
LIVRE III.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
LIVRE IV.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
LIVRE V.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
LIVRE VI.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
LIVRE VII.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
LIVRE VIII.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
CHAPITRE X.
CHAPITRE XI.
CHAPITRE XII.
CHAPITRE XIII.
LIVRE IX.
CHAPITRE PREMIER.
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
LIVRE X.
CHAPITRE PREMIER
CHAPITRE II.
CHAPITRE III.
CHAPITRE IV.
CHAPITRE V.
CHAPITRE VI.
CHAPITRE VII.
CHAPITRE VIII.
CHAPITRE IX.
Également Disponible
Notes de bas de page
copyright
Copyright © 2017 par FV Éditions
Couverture : George [email protected]
ISBN 979-10-299-0392-2
Tous Droits Réservés
CECILIAou les Mémoires d’une Héritière
par
Fanny Burney
— 1782 —
Nota :
Le texte original fut traduit dans un français dont nombre de formulations et règles grammaticales ne sont plus utilisées de nos jours. Afin de faciliter la lecture, nous avons légèrement modifié et modernisé le texte. Etant donné le nombre conséquent de corrections nécessaires, il est néanmoins possible que certaines d’entre-elles nous aient échappées. Merci de votre compréhension.
AVIS DE L’ÉDITEUR
Si le succès du roman de Cécilia a été des plus heureux à Londres, celui de sa traduction, quoique très-défectueuse à tous égards, ne l’a pas été moins en France : quelqu’informe qu’elle soit, on en a multiplié les éditions, au lieu d’en donner une nouvelle, dans laquelle on aurait évité, du moins en grande partie, tous les défauts qui la déparent. Les traducteurs de Clarisse, de Tom-Jones, de Paméla, et de plusieurs autres romans anglais, ont très-bien senti combien il serait difficile de faire goûter en France un ouvrage anglais sur lequel on se serait traîné péniblement pour en rendre, avec une plate fidélité, les longueurs, et les détails les plus inutiles : aussi se sont-ils permis des changements, des suppressions qui rendent l’action plus vive et le dialogue ou la narration plus animés.
On a toujours reproché aux anglais d’employer souvent des moyens trop faibles, et quelquefois aussi des ressorts trop usés, pour mettre en jeu leurs personnages ; de s’abandonner à des détails trop futiles ou trop bas, et sur-tout de ne cesser de délayer, ou plutôt de tourmenter une idée qui a ri à leur imagination. Le traducteur de Cécilia a cru devoir respecter ces défauts, et ne nous a pas fait grâce d’une virgule. Cependant on conviendra que ce roman, pour être goûté en France, avait certainement besoin, non d’être refondu (car le plan et la marche en sont très-bien conçus) mais corrigé quant aux accessoires. Et voilà précisément ce que n’a point senti la personne qui en a donné une traduction strictement littérale, dans laquelle elle a conservé scrupuleusement tout ce qu’en France on aurait pu reprocher à l’original.
Un homme de goût, piqué de voir ce roman noyé dans des longueurs et des superfluités qui en embarrassent la marche et refroidissent l’intérêt, s’est amusé à les élaguer de cette même traduction. Il a resserré le dialogue, et l’a rendu plus vif, plus rapide ; il a retouché le style ; il a fait un plus heureux choix d’expressions qui ajoutent aux beautés de l’original ; il en a retranché aussi des répétitions qui devenaient insupportables pour nous, et qui n’ajoutaient rien aux divers tableaux que ce roman nous présente. Il ne s’en est pas tenu là : il a senti que certains personnages étaient des hors-d’œuvres absolument inutiles, ou tout au moins déplacés, ou qui ne faisaient qu’embarrasser l’action ; il les a supprimés sans scrupule. En un mot, on peut considérer la traduction que nous allons donner, comme un joli habit à l’anglaise, qu’on a refait sur la taille d’un français, et qui sied tout au mieux à celui-ci.
Comme nous ne sommes nullement persuadés qu’on doive nous en croire sur notre parole dans tout ce que nous avançons au sujet de ce roman et de sa traduction, nous allons rapporter ici ce qu’en disent des journalistes dont les jugements sont de quelque poids dans la balance littéraire. Voici d’abord ce qu’en dit le Mercure de France, n°. 16, page 109, année 1784.
« C’est au succès d’Evelina que nous devons Cécilia, second ouvrage du même auteur (Miss Burney), alors âgée de vingt-un ans. La juste célébrité que ce roman a obtenue en Angleterre, a engagé un anonyme à le traduire en français. Nous ne dirons rien de cette traduction, dans laquelle nous ne pourrions que relever une multitude de défauts que tout lecteur n’apercevra que trop facilement ; mais nous croyons devoir déclarer, parce que nous en sommes sûrs, que si le traducteur anonyme est une femme, ainsi que le bruit s’en est répandu, au moins n’est-ce pas celle que le public a paru désigner ».
L’auteur de cet extrait, en revenant sur ses pas, dans un autre Mercure, dit : « Nous croyons qu’on peut reprocher à Miss Burney de se laisser entraîner trop facilement par des détails, par des scènes entières, qui ne servent ni à l’intérêt de l’action, ni au développement des caractères ; enfin, de ramener trop souvent des personnages peu utiles, qui ne peuvent inspirer qu’un intérêt de curiosité, et que par là même on ne désire plus de revoir du moment qu’ils sont connus. Mais nous devons dire aussi que son ouvrage nous paraît d’une grande conception et d’un vif intérêt ; qu’il possède éminemment le mérite de peindre les mœurs et les usages ; qu’il est rempli d’observations fines et profondes ; qu’en général, les caractères et les sentiments y sont vrais et bien soutenus ; que la morale en est attrayante et pure. Nous pensons enfin que ce roman doit être compris parmi les meilleurs ouvrages de ce genre, Etc. Etc. ».
C’est ainsi que s’exprime l’auteur des Liaisons dangereuses, dans les extraits qu’il a donnés de Cécilia dans trois Mercures, et certainement on peut s’en rapporter à un juge aussi compétent, sur-tout en matière de romans. Nous allons faire connaître ce que pensent de cet ouvrage les auteurs du Journal Encyclopédique, qui jouit, depuis son origine, de l’estime publique, et qu’on cite avec éloge dans quantité de livres savants, tant étrangers que nationaux. Voici ce qu’il en est dit dans ce journal du 15 Juillet de la même année, (page 274).
« Après avoir donné à ce roman les éloges qu’il mérite, nous ne dissimulerons pas qu’il est fâcheux que tant de beaux caractères, des scènes si attendrissantes, des peintures si fraîches et si vives des mœurs, soient, pour ainsi dire, étouffés par des détails minutieux, quelquefois bas, longs, conséquemment très-fatigants pour le lecteur, et qu’on soit obligé d’acheter, par des moments d’ennui, le plaisir qu’on y goûte, Etc, Etc. ».
Dans le Journal du Lycée, qui s’imprime à Londres, on n’attaque pas, à la vérité, le fond du roman : l’auteur, quoique français, juge comme un anglais aurait pu le faire ; il borne sa critique à la traduction, et nous dit : « Tout homme oui sait les deux langues n’a qu’à comparer : il gémira de voir le charmant roman de miss Burney si défiguré…… Lecteurs, ne jugez donc pas Cecilia d’après une très-mauvaise traduction, qui vient d’en paraître ».
Comment a-t-on pu, après de pareils jugements sur cette informe traduction, en faire quantité d’éditions qui se nuiraient mutuellement, quand même celle que nous donnons n’aurait point paru ? On avait semblé d’abord dédaigner Evelina du même auteur ; ce roman avait été traduit par la même personne, et par conséquent avec les mêmes défauts ; le succès de Cécilia a reflué sur Evelina ; les mêmes raisons ont déterminé l’homme de goût dont il s’agit, à faire pour Evelina ce qu’il a fait pour Cécilia, et il n’a rien négligé pour en rendre la lecture infiniment plus agréable et plus intéressante.
LIVRE PREMIER.
CHAPITRE PREMIER.Un Voyage.
Cécile avait atteint depuis peu sa vingt-unième année. Ses ancêtres avaient été d’opulents fermiers de la province de Suffolck. Cette profession peu conforme aux idées ambitieuses de son père, ne lui avait pas paru digne de lui ; l’appât des richesses avait eu moins d’empire sur son esprit, que le désir de vivre d’une manière plus brillante ; sa vie avait été celle d’un gentilhomme de province ; et sans avoir cherché à augmenter sa fortune, il s’était contenté des revenus que les travaux de ses prédécesseurs lui avaient procurés. Cécile était encore au berceau, lorsque son père vint à mourir ; sa mère suivit son mari de très-près. Ils lui avaient laissé dix mille livres sterling, et l’avaient confiée au doyen***, son oncle, qu’ils avaient nommé son tuteur. C’est chez cet ecclésiastique, dont la fortune, augmentée par plusieurs circonstances heureuses, était devenue assez considérable, que Cécile venait de passer quatre années, lorsqu’il vint à décéder. Sa mort, en la privant de son dernier parent, l’avait laissée héritière de tous ses biens, dont le revenu se montait à 3000 livres sterling ; à cette seule condition, que le mari en faveur duquel elle disposerait de sa main et de sa fortune, prendrait son nom en l’épousant. Traitée aussi favorablement du côté des richesses, elle l’avait été encore plus par la nature : sa figure était agréable, son cœur noble et bienfaisant ; son abord prévenait en sa faveur, et annonçait beaucoup d’esprit ; la moindre émotion de son âme se peignait sur son visage ; et ses yeux, interprètes de ses pensées, laissaient voir tour-à-tour son discernement et sa sensibilité.
Le doyen avait confié, pendant le court espace qui devait s’écouler jusqu’à la majorité de son héritière, sa personne et sa fortune à trois tuteurs, s’en rapportant entièrement à son choix, et lui permettant d’habiter chez celui d’entre eux qui lui conviendrait le mieux. Cécile, affligée de la perte de tous ses parents, ne trouvait de véritable consolation que dans la tranquillité de la vie champêtre, et dans les soins maternels d’une amie respectable qui la connaissait depuis son enfance, et que ses années et son expérience lui avaient rendue presque aussi chère que sa propre mère. Madame Charlton, cette amie sincère et respectable, la reçut chez elle. Elle y était établie depuis le moment où elle avait rendu les derniers devoirs au doyen ; et peut-être, si elle n’avait suivi que son inclination, y serait-elle restée jusqu’à celui où elle aurait pu aller habiter sa maison ; mais ses tuteurs désirèrent qu’elle changeât de demeure. Elle obéit à regret, quitta ses premières compagnes, l’amie la plus chérie et la plus respectable, ainsi que le lieu qui renfermait les restes des seules personnes qu’elle eût aimées. Accompagnée d’un de ses tuteurs, et suivie de deux domestiques, elle se rendit de Bury à Londres.
Ce tuteur était M. Harrel. Quoiqu’encore à la fleur de son âge, galant, poli, enjoué, grand et répandu dans le monde, il avait été nommé par son oncle un de ses trois tuteurs, dans la vue de faire plaisir à sa nièce, dont il avait épousé la plus intime amie. Cette unique raison lui fit penser qu’elle préférerait sa maison à toute autre. M. Harrel ne manqua pas de mettre en œuvre, pour dissiper sa mélancolie, tous les moyens que son esprit et sa politesse lui suggérèrent ; et Cécile, chez qui la douceur était assaisonnée de dignité, et la délicatesse de fermeté, se comporta de manière à lui persuader que ses soins n’étaient point inutiles. L’idée de retrouver une jeune amie, de vivre dans le sein de la confiance, venait adoucir les regrets de quitter des personnes auxquelles la reconnaissance l’attachait, et d’abandonner cette tranquillité qu’elle aimait. Elle avait cependant encore une épreuve à soutenir ; il lui restait un ami, duquel elle ne pouvait se dispenser de prendre congé.
À la distance de sept milles de Bury, résidait M. Monckton, le particulier le plus riche et le plus accrédité de tout le voisinage ; il avait invité Cécile et son tuteur à déjeûner chez lui à leur passage. M. Monckton était le cadet d’une famille distinguée, un homme à talents, fort instruit, et qui avait de la finesse. Il joignait à une force d’esprit naturelle, un grand usage du monde, et à l’art de distinguer avec la plus grande facilité le caractère de ceux avec qui il avait à traiter, celui de déguiser parfaitement le sien. Désirant ardemment d’acquérir une fortune, et d’obtenir la considération, suite de l’opulence, il s’était marié de très-bonne heure avec une riche douairiére de condition, dont l’âge avancé, puisqu’elle comptait déjà soixante-sept ans, n’était cependant qu’une de ses qualités les moins désagréables, son humeur étant encore plus repoussante que ses rides. Une si grande disproportion d’âge lui avait fait espérer que les richesses qu’il s’était ainsi procurées seraient bientôt débarrassées de ce qui en rendait la jouissance moins agréable ; mais son attente fut aussi vaine qu’intéressée : sa femme n’était pas plus la dupe de ses protestations, qu’il ne l’était lui-même de ses espérances. Il connaissait trop bien le monde, pour s’exposer à sa critique, en maltraitant la femme à laquelle il devait le rang qu’il y occupait. Il est vrai qu’il ne la voyait que rarement ; mais il savait trop ce qu’il se devait à lui-même, pour manquer aux lois que la décence et la politesse imposent en pareil cas aux honnêtes gens. Ayant ainsi sacrifié à son ambition tout espoir de bonheur dans sa vie privée, il tourna ses vues du côté où il espérait trouver les plaisirs qu’il avait acheté si cher la faculté de se procurer. Cette ressource, pour les personnes opulentes, ne saurait leur être ravie, et il n’y a que la satiété qui puisse les en priver. M. Monckton n’avait point encore éprouvé ce sentiment, et il avait prudemment partagé son temps entre les amusements dispendieux de la capitale, et les plaisirs les plus bruyants de la province.
Le peu de connaissance que Cécile avait acquis des usages du monde et des différents caractères de ceux qui le composent, elle ne le devait qu’aux observations qu’elle avait eu occasion de faire chez ce gentilhomme, avec lequel le doyen son oncle avait été particulièrement lié. Il était très-considéré ; sa conversation était pour elle une source inépuisable d’instructions. L’habitude de la société, et l’étude des individus qui la composent le mettaient à portée de traiter les sujets dont elle avait le moins d’idée ; et son esprit, capable de saisir et de sentir le vrai, y trouvait de nouvelles lumières.
Les idées de Cécile s’étaient étendues, tandis que les réflexions de M. Monckton n’avaient servi qu’à l’affliger. Il voyait devant lui un objet qui, à tous les avantages de cette opulence qu’il avait si fort prisée, joignait encore la beauté, la jeunesse et l’esprit. Quoique beaucoup plus âgé qu’elle, il ne l’était cependant point encore assez pour que son inclination eût rien de ridicule ; et la satisfaction que sa conversation paraissait causer à Cécile, lui donnait lieu de se flatter que l’opinion avantageuse qu’elle avait conçue de son mérite, pourrait insensiblement se changer en affection. Il se reprochait le motif qui l’avait porté à se sacrifier, en épousant une femme qu’il abhorrait ; et les vœux qu’il formait pour en être débarrassé, devenaient tous les jours plus fervents. Il savait que les liaisons de Cécile ne s’étendaient pas au-delà d’un cercle particulier dont il faisait lui-même le principal ornement ; qu’elle avait rejeté tous les partis qui s’étaient présentés jusqu’alors ; et comme il l’avait soigneusement observée depuis ses premières années, il avait sujet de penser que son cœur s’était refusé à toute impression dangereuse. Il s’était accoutumé depuis long-temps à la considérer comme un bien qui ne pouvait lui échapper ; et quoiqu’il n’eût pas apporté une plus grande attention à approfondir sa façon de penser qu’à empêcher qu’elle ne parvînt à découvrir la sienne, il avait disposé d’avance de sa fortune, et avait déjà fait des arrangements en lui-même qui répondaient le mieux à ses goûts.
La mort du doyen, oncle de Cécile, avait réellement alarmé M. Monckton ; il la voyait à regret abandonner la province de Suffolk, où il se regardait comme l’homme le plus considérable, tant par son mérite, que par son crédit ; et il redoutait le séjour de Londres, où il prévoyait que nombre de rivaux, ses égaux par leurs talents et leurs richesses, ne tarderaient pas à se présenter, et à lui prodiguer des soins. Ces rivaux, plus jeunes et aussi confiants que lui, n’étant pas retenus par les mêmes liens, feraient tous leurs efforts pour lui plaire, et pouvaient fort bien réussir. La beauté et l’indépendance, qui se trouvent si rarement ensemble dans une jeune personne, ne manquent presque jamais de lui attirer une foule d’adorateurs ; d’ailleurs, la maison de M. Harrel était renommée pour son élégance et les agréments dont on y jouissait. Malgré toutes ces considérations, bravant le danger, et se confiant à son ascendant, il résolut de ne point renoncer à son projet, convaincu que sa persévérance et son adresse ne pouvaient manquer d’en assurer le succès.
CHAPITRE II.Un Argument.
Monsieur Monckton avait alors chez lui quelques amis qui étaient venus y passer les fêtes de Noël. Il attendait impatiemment Cécile, et courut pour l’aider à descendre de la voiture avant que M. Harrel eût pu mettre pied à terre. Il remarqua son air mélancolique, et fut charmé de voir que le voyage de Londres était si peu de son goût. Il la conduisit à la salle à manger, où milady Marguerite et ses amis l’attendaient. Celle-ci la reçut avec une froideur qu’on eût pu prendre pour impolitesse. Naturellement colère, et jalouse par la connaissance qu’elle avait d’elle-même, l’apparence de la beauté l’alarmait, et celle de l’enjouement lui déplaisait. Elle regardait avec défiance toutes les personnes pour lesquelles son mari avait la moindre attention ; et ayant précédemment remarqué ses fréquentes visites chez le doyen, elle avait conçu une haine toute particulière pour Cécile, qui s’en étant aperçue, et n’en pouvant deviner ni connaître la cause, avait pris soin d’éviter d’avoir avec elle d’autres liaisons que celles que la bienséance et le voisinage exigeaient, se contentant de plaindre en secret le triste sort de son ami.
La compagnie qui se trouvait alors chez M. Monckton était composée d’une femme et de plusieurs hommes. La femme (mademoiselle Bennet) était, dans toute l’étendue du terme, l’humble compagne de milady Marguerite. D’une naissance obscure, mal élevée, l’âme basse, aussi peu sensible au mérite naturel qu’aux talents acquis, elle avait cependant fait de grands progrès dans l’art de flatter, et en connaissait toutes les petites ruses. N’ayant d’autre but que celui de se procurer, sans travail, une sorte d’aisance dans le monde, elle était devenue peu à peu l’esclave de la maîtresse de la maison, recevant des affronts sans se plaindre, et se soumettant au mépris comme à la chose du monde la moins extraordinaire.
Parmi les hommes, le plus remarquable était M. Aresby, capitaine de milice, jeune homme qui croyait qu’un militaire devait nécessairement être galant : en conséquence, sans chercher en aucune façon à se rendre utile à sa patrie, il regardait une cocarde comme une preuve incontestable de mérite, et ne s’en était décoré que pour témoigner son dévouement au beau sexe, qu’il se croyait fait pour conquérir.
Un certain M. Morrice, qui, par les attentions les plus recherchées, tâchait de se faire distinguer, faisait là son pendant. Ce jeune homme suivait depuis quelque temps le barreau, où, quoiqu’il commençât à être connu, il ne devait pourtant ses succès ni à une habileté plus qu’ordinaire, ni à l’expérience qui en tient souvent lieu. Au respect le plus profond pour le rang et la fortune, il joignait une confiance en lui même, qu’aucune supériorité n’était capable d’humilier. Ses prétentions étaient soutenues d’un enjouement que nulle mortification ne pouvait diminuer ; et tandis que la souplesse de son caractère le garantissait d’avoir des ennemis, son empressement à obliger lui acquérait des amis auxquels il trouvait toujours le moyen d’être utile.
Il s’y rencontrait encore quelques autres gentilshommes du voisinage, ainsi qu’un vieillard qui, sans paraître faire la moindre attention au reste de la compagnie, se tenait à l’écart avec un air de mauvaise humeur.
Mais la principale figure de ce tableau était M. Belfield, grand jeune homme, d’une taille fine et déliée, dont tous les traits annonçaient une grande activité ; ses yeux étaient on ne peut pas plus vifs et plus spirituels. Destiné d’abord par son père au commerce, il y renonça bientôt, parce que son inclination l’élevait beaucoup au-dessus de cet état. Du mécontentement, il passa à la résistance, et finit par quitter la demeure de ses parents, et entra au service : mais, passionné pour les beaux arts, et empressé d’acquérir de nouvelles connaissances, il ne tarda pas à s’apercevoir que ce métier n’était guère plus de son goût que celui auquel il s’était refusé. Il s’en dégoûta bientôt, se raccommoda avec son père, et s’adonna à l’étude des lois. Trop léger pour une application sérieuse, et trop dissipé pour une occupation pénible, il fit très-peu de progrès dans cette carrière. Et cette même pénétration, ainsi que cette force d’imagination, qui, si elles avaient été accompagnées de prudence, auraient pu l’élever à la première dignité de sa profession, étant malheureusement associées avec un grand fond d’inconstance et de caprice, ne servirent qu’à retarder sa marche, et à s’opposer à son avancement. Peu occupé, et n’ambitionnant pas de l’être davantage, sa fortune, très-médiocre, diminuant tous les jours, il ne lui resta que la stérile admiration des gens à la mode, laquelle se bornant à de simples politesses, ne lui laissa qu’une existence très-incertaine. Caressé généralement et recherché avec empressement, il négligea ses propres intérêts, ne s’embarrassa guère de l’avenir, consacra tout son temps à la société, ses revenus au plaisir, et son esprit aux muses.
Je vous présente, dit M. Monckton, en conduisant Cécile dans la salle, un objet d’affliction dans cette jeune demoiselle, qui n’a jamais causé d’autre regret à ses amis que celui qu’ils éprouvent de son départ.
Si l’affliction, s’écria M. Belfield, en fixant sur elle un regard pénétrant, se montre sous un aspect pareil dans la partie du monde que vous habitez, qui voudrait jamais l’échanger contre le séjour le plus délicieux ?
Elle est divinement belle, rien de plus certain, ajouta le capitaine, feignant que cette exclamation lui échappait malgré lui.
Cécile, s’étant placée auprès de la maîtresse de la maison, commença tranquillement à déjeuner ; M. Morrice, le jeune jurisconsulte, se mit sans façon à ses côtés, tandis que M. Monckton, occupé ailleurs, plaçait le reste de ses convives de manière à pouvoir s’y placer ensuite lui-même. S’adressant alors à Cécile, il lui dit : Nous allons vous perdre, et vous paraissez fâchée de nous quitter ; cependant je crains qu’avant peu vous n’ayez oublié Bury, ses habitants et ses environs. Si vous le pensez, répondit Cécile, je crois que Bury, ses habitants et ses environs ne tarderont pas à m’oublier. Mais il paraît, dit M. Monckton, qu’on excuse aisément l’oubli de ses anciens amis, et qu’on regarde cette négligence comme une nécessité que différentes circonstances et une nouvelle position dans la société doivent faire pardonner. Quoique cette maxime ne soit pas encore ouvertement admise comme un précepte, elle est cependant si généralement confirmée par l’expérience, que ceux qui agissent différemment s’exposent à la critique du public, et à passer pour singuliers.
Il est donc heureux pour moi, répartit Cécile, que ma personne et mes actions soient assez peu connues de lui, pour ne pas arrêter son attention. — Vous vous proposez donc, Madame, dit M. Belfield, au mépris de ces maximes, de n’avoir d’autre guide de votre conduite que les lumières de votre raison ?
Telle est ordinairement, répliqua M. Monckton, l’intention de tous ceux qui débutent dans le monde. Tout individu raisonnant dans son cabinet, a toujours des sentiments épurés, et la plus grande confiance dans ses propres forces ; mais il n’est pas plutôt livré au tourbillon, que réfléchissant moins, et agissant davantage, il reconnaît la nécessité de se conformer aux usages reçus, et de suivre bonnement le chemin battu. Pardonnez-moi, s’écria M. Belfield ; pour peu qu’il ait de courage, il s’en gardera bien ; le chemin battu sera sûrement le dernier qu’un être raisonnable choisira.
On ne verra jamais que des gens ordinaires,
Dirigés et conduits par les règles vulgaires.
Maxime pernicieuse, très-pernicieuse, s’écria d’un air refrogné le vieillard qui était assis dans un des coins de la salle.
Cette espèce de mépris pour les principes reçus, dit M. Monckton, sans faire la moindre attention aux propos du vieillard, est non-seulement excusable, mais louable ; et vous avez, Belfield, un droit tout particulier à soutenir cette opinion. Cependant, eu égard au peu de gens qui vous ressemblent, on est rarement dans le cas de se prévaloir de cet exemple.
Et pourquoi rarement, ajouta Belfield ? Parce que vos règles générales, vos coutumes reçues, vos formes de convenance, sont autant d’arrangements absurdes pour retarder, non-seulement les progrès du génie, mais l’usage même du discernement. Si l’homme osait agir par lui-même ; si l’intérêt, les préjugés dont on l’a imbu, les préceptes éternels et les exemples n’offusquaient pas sa raison, et n’influaient pas sur sa conduite, qu’il serait excellent et admirable ! Combien,infini par ses facultés ! Combien semblableà Dieu par son esprit1 !
Tout ce que vous dites là, répliqua M. Monckton, n’est que le résultat d’une imagination exaltée, à laquelle les impossibilités ne paraissent que des difficultés, et celles-ci des encouragements à tout entreprendre, tandis que l’expérience nous démontre absolument le contraire. Elle nous enseigne que l’opposition d’un individu à l’opinion générale, est toujours dangereuse dans la pratique, et que l’événement en est rarement heureux ; peut être même ne l’est-il jamais sans un concours singulier de circonstances favorables, secondées par beaucoup d’habileté.
Je voudrais, répliqua Belfield, que tous les hommes, philosophes ou idiots, agissent par eux-mêmes. Alors, chacun se montrerait tel qu’il est ; les tentatives plus fréquentes réussiraient, et la fureur d’imiter diminuerait ; et le génie sentirait sa supériorité, et la sottise sa nullité. Alors, et alors seulement, nous cesserions d’être excédés de cette uniformité éternelle dans les mœurs et dans l’extérieur, qui prévaut actuellement dans tous les états et dans toutes les conditions.
Le déjeûné étant fini, M. Harrel fit avancer sa chaise, et Cécile se leva pour prendre congé. Dans ce moment, M. Monckton eut quelque peine à cacher les craintes que lui causait son départ, et lui prenant affectueusement la main, il dit : J’imagine que vous refuserez à un ancien ami la liberté de vous faire sa cour à Londres, de peur que sa vue ne vous rappèle le souvenir des tristes moments que vous regretterez bientôt d’avoir perdus en province. Pourquoi me dites-vous cela, M. Monckton, s’écria Cécile ? je suis sûre que vous ne sauriez le penser. Ces profonds scrutateurs du cœur humain, dit Belfield, sont de pauvres champions de la confiance ou de l’amitié. Ils sont en guerre ouverte avec tout sentiment qui n’est pas absolument dépravé, et font à peine quartier aux plus pures intentions, dès qu’ils soupçonnent qu’on pourrait avoir la moindre tentation d’y déroger.
Il est facile en théorie, dit M. Monckton, de résister à la tentation ; mais, si vous réfléchissez au grand changement que Miss Beverley éprouvera à la vue du nouveau théâtre où elle va débuter, des nouvelles connaissances qu’elle sera obligée de faire, et des nouvelles liaisons qu’elle formera, vous ne serez plus étonné qu’un ami qui s’intéresse à elle ait quelqu’inquiétude sur son compte. Ne rencontrerait-on pas des fripons, des escrocs, des trompeurs, enfin des malheureux de toute espèce et sous toutes sortes de dénominations qui guettent la jeunesse lorsqu’elle est riche, pour en faire leur dupe ?
Partons, partons, s’écria M. Harrel : il est plus que temps que j’emmène ma belle pupille, puisque c’est là votre manière de lui peindre le lieu qu’elle va habiter.
Est-il possible, dit brusquement le capitaine en s’avançant vers Cécile, que cette demoiselle n’ait point encore essayé de Londres ? Ensuite, adoucissant sa voix et la fixant en souriant, d’un air languissant, il ajouta : se peut-il qu’une personne aussi divinement belle ait été confinée en province ? Ah ! quelle honte ! Comment pourrait-on avoir la cruauté de laisser rouiller dans une campagne un objet si charmant !
Cécile, pensant qu’un pareil compliment ne méritait d’autre réponse de sa part qu’une simple révérence, se tourna du côté de milady Marguerite, et lui dit : comptez-vous, madame, de venir à Londres cet hiver ? et en ce cas, oserais-je vous demander votre adresse, pour avoir l’honneur de vous rendre mes devoirs ? Je ne sais point encore ce que je ferai, répondit la vieille milady, avec sa mauvaise grâce ordinaire.
Cécile serait sortie sur-le-champ, si M. Monckton ne l’avait arrêtée, pour lui réitérer combien il redoutait les conséquences de son voyage. Soyez en garde, s’écria-t-il, contre toutes les nouvelles connaissances ; ne jugez personne sur les apparences ; ne formez aucune liaison à la hâte ; prenez tout le temps nécessaire pour connaître ceux qui vous entourent, et souvenez-vous que vous ne sauriez apporter le moindre changement dans votre manière de vivre, sans courir risque de vous en trouver mal, plutôt que d’en tirer le moindre avantage. En conséquence, restez, autant qu’il se pourra, telle que vous êtes. Alors, plus vous verrez les autres femmes, plus vous serez contente de ne leur pas ressembler, et de ne pas être liée avec elles.
Quoi, M. Monckton ! s’écria Belfield, est-ce vous qui donnez de pareils avis ? Qu’est devenu votre système de conformité ? Il me semble que vous prétendiez que tout le monde devait se conduire de même, et ne s’écarter jamais de la route ordinaire.
Je parlais, répliqua M. Monckton, du monde en général, et point en particulier de cette demoiselle. Y a-t-il quelqu’un qui la connaisse, et qui ait le bonheur de la voir, qui ne désire ardemment qu’elle reste, autant que cela se pourra à tous égards, telle qu’elle est à présent ?
Je m’aperçois, du moins, répondit Cécile, que dans le cas où je serais exposée à la flatterie, vous voulez, en m’y accoutumant d’avance, prévenir les mauvais effets qu’elle pourrait produire.
Eh bien ! Miss Beverley, s’écria M. Harrel, après tout ce que vous venez d’entendre, ne redoutez-vous pas le voyage de Londres ? et M. Monckton est-il parvenu à vous en dégoûter ? Si je n’avais pas plus de chagrin de quitter mes amis, répliqua Cécile, que je n’ai de crainte en me hasardant d’aller à Londres, combien ce voyage ne me serait-il pas facile et agréable !
Bravo ! cria Belfield ; je suis enchanté de voir que les discours de M. Monckton ne vous aient point intimidée, ni convaincue que vous étiez à plaindre d’avoir le malheur d’être en même temps jeune, belle et riche. Hélas, pauvre enfant ! dit douloureusement le vieillard qui était dans un coin, regardant fixement d’un air de pitié Cécile, qui témoigna quelque surprise, et fut la seule qui parut faire attention à lui.
Les civilités ordinaires que l’on a coutume de faire en pareille occasion se répétèrent, et le capitaine s’avança très-respectueusement pour présenter la main à Cécile ; mais tandis que son éloquence muette se manifestait par ses mines gracieuses et ses profondes révérences, M. Morrice, feignant de ne pas s’apercevoir de son intention, se glisse adroitement entre eux deux, et saisit lui-même, sans l’en prévenir, la main de Cécile, tâchant cependant de couvrir sa témérité par un air très-respectueux. Le capitaine haussa les épaules, et se retira. M. Monckton, indigné de l’impudence de Morrice, et résolu de l’en punir, s’avança, et lui dit : de quel droit prétendez-vous vous arroger le privilège que me donne ma qualité de maître de la maison ? Vous avez raison, répondit celui-ci ; j’avais oublié que vous étiez membre du parlement, et qu’en conséquence vous aviez le droit incontestable de vous montrer jaloux de vos privilèges. Après quoi, faisant une profonde révérence à Cécile, il abandonna sa main, tout aussi satisfait de la céder, qu’il l’avait été de la prendre.
M.Monckton, en la conduisant à sa voiture, lui demanda une seconde fois la permission de lui rendre ses devoirs à Londres. M. Harrel profita de cette occasion pour le prier de regarder sa maison comme la sienne ; et Cécile lui témoignant sa reconnaissance de l’intérêt qu’il daignait prendre à elle, ajouta : j’espère, Monsieur, que vous voudrez bien m’honorer de vos conseils et de vos avis relativement à ma conduite, toutes les fois que vous me ferez la grace de venir me voir. C’était là précisément ce qu’il souhaitait. Il la conjura à son tour de l’honorer de sa confiance ; et la saluant respectueusement, on se mit en voyage.
CHAPITRE III.Une Arrivée.
À peine eurent-ils perdu de vue la maison, que Cécile témoigna sa surprise de la conduite du vieillard relégué dans un coin de la salle, dont le silence constant, l’éloignement du reste de la compagnie, et la distraction avaient fort excité sa curiosité. M. Harrel n’était guère en état de la satisfaire : il lui dit qu’il avait rencontré deux ou trois fois cet homme dans des lieux publics, où tout le monde était frappé de la singularité de ses manières et de son extérieur ; mais qu’il n’avait trouvé personne qui parût le connaître, et qu’il était tout aussi surpris qu’elle de voir un personnage de cette espèce chez M. Monckton. La conversation roula ensuite sur la maison qu’ils venaient de quitter. Cécile témoigna avec chaleur la manière avantageuse dont elle pensait sur le compte de M. Monckton, combien elle lui était obligée de l’intérêt que, depuis sa plus tendre enfance, il n’avait cessé de prendre à ses affaires, et l’espoir qu’elle avait de retirer beaucoup de fruit des instructions et de l’amitié d’un homme qui connaissait si bien le monde.
M. Harrel parut très-satisfait du choix qu’elle avait fait d’un pareil conseil ; car quoiqu’il ne le connût que peu, il savait cependant que c’était un homme riche et de bon ton, jouissant de l’estime générale. Ils plaignirent mutuellement sa triste situation, relativement à l’intérieur de sa maison ; et Cécile témoigna bonnement son regret de l’aversion que milady Marguerite paraissait avoir conçue pour elle, aversion que M. Harrel imputa, avec assez de raison, à sa jeunesse et à sa beauté, sans soupçonner cependant qu’elle eût d’autre cause plus particulière que l’envie et le dépit qu’elle avait en général contre des agréments aux-quels elle survivait depuis si long-temps.
Comme leur voyage touchait à sa fin, toutes les sensations tristes et désagréables que Cécile avait éprouvées en le commençant, firent place au bonheur qu’elle se promettait en revoyant bientôt son intime amie.
Dans ses premières années, Madame Harrel avait été la compagne des jeux de son enfance, et pendant sa jeunesse, sa camarade d’école ; une conformité d’inclinations, fondée sur la douceur des caractères, les avait, de bonne heure, rendues chères l’une à l’autre, quoique leur ressemblance à d’autres égards ne fût plus la même. Madame Harrel, avec moins d’esprit et de bon sens que son amie, ne laissait pas d’être aimable et amusante. Sans être belle, elle plaisait par ses bonnes qualités ; et si elle n’inspirait pas cet amour dont le respect doit être la base, elle faisait au moins naître ces goûts vifs qui en tiennent lieu.
Mariée depuis près de trois ans, elle avait, dès cette époque, tout-à-fait quitté la province de Suffolck, et n’avait eu de commerce avec Cécile que par lettres. Leur entrevue fut tendre et affectueuse. La sensibilité du cœur de Cécile se manifesta par ses larmes, et la joie de Madame Harrel parut sur son visage. Après les premières expressions de leur affection, et les questions générales en pareil cas, Madame Harrel la pria de vouloir permettre qu’elle la conduisît dans la salle d’assemblée, où, ajouta-t-elle, vous trouverez quelques-uns de mes amis qui désirent ardemment de vous être présentés. J’aurais souhaité, lui dit Cécile, qu’après une si longue absence, nous eussions passé seules cette première soirée. Ce sont tous des gens de mérite, répondit-elle, très-impatients de vous voir, que j’ai rassemblés pour vous distraire et tâcher de vous faire oublier Bury.
Cécile, sensible à sa politesse, la suivit sans rien dire jusqu’à la porte de la salle, et vit avec surprise un appartement décoré avec magnificence, éclairé avec profusion, rempli de personnes très-parées, occupées les unes au jeu, les autres à la conversation.
Cécile qui, d’après le mot d’amis, s’attendait à voir une compagnie choisie et peu nombreuse, rassemblée uniquement pour jouir des douceurs d’un entretien familier, recula involontairement à la vue de tout ce monde, et eut à peine la force d’entrer. Cependant, Madame Harrel la prenant par la main, la présenta à l’assemblée, dont elle lui nomma tous les individus (formalité qui lui parut inutile, tous ces noms lui étant aussi étrangers que les personnes, et qui ne fit qu’accroître son embarras). Mais son bon sens, et une dignité qui lui était naturelle, lui ayant appris de bonne heure à distinguer la modestie de la fausse honte, elle se remit bientôt ; et après avoir prié Madame Harrel de demander excuse à la compagnie sur son négligé, elle s’assit entre deux jeunes demoiselles.
L’habit de voyage que portait Cécile, quoique fort simple, lui seyait à merveille : son air noble et décent, les grâces de sa figure, ce que l’on savait de son état et de sa fortune, tout prévenait en sa faveur, et lui attira les regards de l’assemblée. Les hommes louèrent tout bas sa beauté naïve, les femmes lui pardonnèrent d’être belle, à cause de sa modestie et de son air un peu provincial.
Quoiqu’elle vît la capitale pour la première fois, notre héroïne n’en ignorait pourtant pas entièrement les usages ; elle avait passé sa vie dans la retraite et non dans la solitude ; et depuis plusieurs années elle était chargée de faire les honneurs de la maison de son oncle, qui recevait les personnes les plus distinguées de la province. On y parlait souvent de Londres, et de ce qui s’y passait d’intéressant ; et c’était dans cette compagnie que Cécile avait acquis des idées sur le monde et la société, et perdu un peu de cette extrême timidité qui est le partage des jeunes personnes élevées à la campagne.
En conséquence, elle regardait tour-à-tour les deux jeunes demoiselles entre lesquelles elle se trouvait placée, avec le désir d’entrer en conversation avec elles. Mais la plus âgée, Mademoiselle Larolles, s’entretenait sérieusement avec son voisin ; et la plus jeune, Mademoiselle Leeson, déconcerta toutes ses avances par l’air froid et sérieux avec lequel elle la fixa chaque fois qu’elle cherchait à lui adresser la parole.
N’étant donc interrompue que par quelques paroles que M. et Madame Harrel lui disaient par politesse, Cécile, qui aimait à observer, réfléchissait en silence, lorsque la personne qui parlait à Mademoiselle Larolles, étant sortie de la salle, celle-ci se tourna tout-à-coup de son côté, et lui dit : Il faut avouer que M. Meadows est on ne peut pas plus singulier ; croiriez-vous qu’il soutient que sa santé ne lui permettra pas de se trouver à l’assemblée de milady Nyland ? Quelle ridiculité !
Cécile, surprise d’une attaque aussi imprévue, se contenta de l’écouter en silence. Vous y viendrez sans doute, ajouta-t-elle ? Non, Mademoiselle ; je n’ai point l’honneur d’être connue de milady. Oh ! cela n’y fait rien, répliqua-t-elle ; Mad. Harrel l’instruira que vous êtes à Londres, et vous pouvez être sûre qu’elle vous enverra un billet : alors rien ne vous empêchera d’y aller. Un billet, répéta Cécile ; n’est-on admis chez milady Nyland que par billet ? Juste ciel ! s’écria Mademoiselle Larolles, en riant de toutes ses forces, ne comprenez-vous pas ce que je veux dire ? Ce qu’on appèle ici un billet, est une carte de visite, avec le nom de la personne, et nous donnons le même nom à toutes celles d’invitation. Cécile la remercia de cette explication : après quoi Mademoiselle Larolles lui demanda combien de milles elle avait faits depuis le matin. Soixante et treize, répondit Cécile ; et j’espère qu’une aussi longue course servira à faire excuser mon habillement. Oh ! vous êtes au mieux, dit l’autre ; pour moi, je ne fais jamais attention à la parure. Vous ne sauriez vous imaginer ce qui m’arriva l’année passée. Savez-vous que je vins à Londres le 20 de Mars ? Cela n’était-il pas désespérant ? Cela peut être, répartit Cécile ; mais ce qu’il y a de certain, c’est que je ne saurais dire pourquoi.
Vous ne sauriez dire pourquoi ? répéta Mademoiselle Larolles. Comment, ne savez-vous pas que ce jour-là fut celui du grand bal masqué de mylord Dariens ? Je n’aurais pas voulu le manquer pour toute chose au monde. Je n’ai jamais eu autant d’impatience que dans ce malheureux voyage. Nous n’arrivâmes à Londres qu’excessivement tard, et vous saurez qu’alors je n’avais ni billet, ni habit. Concevez quel devait être mon embarras. Eh bien, j’envoyai chez toutes mes connaissances pour tâcher de me procurer un billet ; toutes répondirent qu’il était impossible d’en avoir. Je crus que je deviendrais folle. Environ dix à onze heures, une jeune demoiselle, mon intime amie, par le plus grand bonheur du monde, se trouva tout-à-coup assez mal ; de sorte que ne pouvant faire usage du sien, elle me l’envoya. Cela n’était-il pas charmant ? Pour elle, extrêmement ! répartit Cécile en riant. Eh bien ! continua-t-elle, j’étais si joyeuse, que je savais à peine ce que je faisais ; je me tournai de tant de côtés, que je me procurai un des plus jolis habits de bal que vous ayez jamais vus : si vous vous donnez la peine de passer chez moi une matinée, je vous le montrerai. Cécile, peu préparée à une invitation aussi brusque, fit une inclination de tête sans rien dire ; et Mademoiselle Larolles, trop heureuse de parler sans être interrompue, loin de s’offenser de son silence, continua son récit.
Nous en sommes actuellement au plus fâcheux de l’aventure. Pensez donc que tout étant prêt, je ne pus jamais avoir mon coiffeur. Je le fis chercher par toute la ville ; on ne le trouva nulle part ; je crus que je mourrais de chagrin : je vous assure que je pleurai tant, que si je n’avais pas eu un masque, je n’aurais jamais osé me montrer. Enfin, après avoir essuyé cette abominable fatigue, je fus réduite à me laisser coiffer par ma femme-de-chambre, de la manière du monde la plus simple, et de façon à ne point être remarquée. Pouvait-il jamais m’arriver rien de plus mortifiant ? Certainement, répondit Cécile ; il me paraît que cela l’était assez pour vous rappeler avec chagrin la maladie de la jeune demoiselle qui vous avait envoyé son billet. Leur conversation fut interrompue par Mad. Harrel, qui s’avança vers Cécile, suivie d’un jeune homme d’une figure sérieuse et d’un extérieur modeste. Pardon, si je vous dérange, lui dit-elle ; mais mon frère vient de me reprocher d’avoir présenté toute la compagnie à miss Beverley sans avoir pensé à lui.
Je ne saurais me flatter, dit M. Arnott, d’avoir conservé quelque part dans le souvenir de miss Beverley. Pour moi, quoique j’aie quitté depuis long-temps la province de Suffolck, je suis cependant bien convaincu qu’après cet espace de temps, grandie et formée comme elle l’est, je l’aurais tout de suite reconnue. Je me rappèle bien, dit Cécile, que lorsque vous quittâtes la province, je crus avoir perdu l’un de mes meilleurs amis. Cela serait-il possible ? reprit M. Arnott, de l’air du monde le plus satisfait. Pouvez-vous en douter, et n’avais-je pas raison ? N’étiez-vous pas toujours mon défenseur, mon camarade d’amusements, mon appui dans toutes les occasions ?
Madame, s’écria d’un ton railleur un homme entre deux âges, qui les écoutait, si vous l’aimiez parce qu’il était votre défenseur, votre camarade et votre soutien, je vous prie de m’aimer aussi : je vous promets de vous en servir. Vous êtes trop bon, répondit Cécile ; actuellement, je n’ai plus besoin de défenseur. C’est dommage, car M. Arnott me paraît très-disposé à s’acquitter encore de cet emploi : il n’aurait besoin que de rétrograder de quelques années pour revenir à celles de l’enfance. Ah, plût au ciel ! dit M. Arnott : ces jours ont été les plus fortunés de ma vie.
Mademoiselle Larolles, pour qui toute conversation où il n’était pas question d’elle devenait ennuyeuse, se leva ; et M. Gosport ayant pris sa place, continua sur le même ton. J’ai souvent désiré, dit-il, que dans les assemblées nombreuses telles que celle-ci, après la première demi-heure destinée aux compliments, il fût permis de proposer quelque jeu d’exercice auquel chacun prendrait part : cela vaudrait bien les cartes, la médisance, les modes, l’histoire du jour, et toutes les sottises dont nous faisons notre amusement dans la capitale.
Cécile, quoique surprise d’une telle sortie contre la société de ses amis, et de la part d’un homme qui en était, n’eut rien à répondre à sa critique. L’assemblée se sépara un moment après, et le reste de la soirée fut consacré à l’amitié, aux tendres caresses et aux doux souvenirs. Les deux amies s’entretinrent long-temps de leurs premières années, et ne se séparèrent qu’à regret.
CHAPITRE IV.Une Esquisse du bon ton.
Empressée de reprendre une conversation qui lui avait fait tant de plaisir, Cécile, oubliant la fatigue de son voyage et le peu qu’elle avait dormi, se leva avec le jour, et dès qu’elle fut habillée, elle se rendit, sans perdre de temps, à la salle à manger.
Elle n’avait pas eu plus d’impatience d’y entrer, qu’elle n’en eut bientôt d’en sortir ; car, quoique peu surprise d’y avoir précédé son amie, le désir d’y attendre son arrivée fut bientôt ralenti en trouvant que le feu était à peine allumé, et que la chambre, en désordre, n’était point encore échauffée. À dix heures, elle fit une nouvelle tentative : la salle était rangée, mais il n’y avait personne. Elle se retirait pour la seconde fois, lorsque M. Arnott, qui arrivait, l’engagea à rester. Il lui témoigna sa surprise de ce qu’elle s’était levée si matin, de manière à prouver le plaisir qu’il avait de la voir ; ensuite, reprenant la conversation de la veille, il parla assez vivement du bonheur des jours de son enfance, rappela les moindres circonstances des amusements qu’ils avaient partagés, et s’arrêta avec complaisance sur certains petits détails d’un ton à prouver combien ce récit lui était agréable. Ils ne cessèrent de s’en entretenir qu’à l’arrivée de Mad. Harrel ; et alors la conversation devint plus animée et plus générale.
Pendant le déjeûné, l’on annonça à Cécile la visite de Mademoiselle Larolles, qui s’approcha de l’air dont elle aurait abordé une ancienne amie ; elle lui prit la main, et l’assura qu’elle n’avait pu différer plus long-temps de se procurer l’honneur de la voir.
Cécile, étonnée de cet excès de politesse de la part d’une personne qu’elle connaissait à peine, reçut son compliment avec un peu de froideur ; mais, Mademoiselle Larolle, sans s’embarrasser de son air, continua de lui exprimer le désir ardent qu’elle avait depuis long-temps de la connaître, lui dit qu’elle espérait la voir fréquemment ; assurant que rien au monde ne lui ferait plus de plaisir, et la pria de permettre qu’elle lui recommandât sa marchande de modes. Je vous assure, continua-t-elle, qu’elle a tout Paris à sa disposition : vous y verrez les plus charmants bonnets, les plus magnifiques garnitures ; ses rubans sont toujours du meilleur goût. Rien au monde de si dangereux que sa boutique : je n’entre jamais chez elle que je ne sois sûre d’en sortir ruinée. Je vous y mènerai ce matin, si vous voulez.
Je vous remercie, dit Cécile ; si sa connaissance est si redoutable, je ferai mieux de n’y pas aller. Cela est impossible ; on ne saurait vivre sans elle. Il est vrai qu’elle est horriblement chère ; mais doit-on s’en étonner ? Elle fait de si jolies choses, qu’on ne peut trop les payer. Mad. Harrel ayant joint sa recommandation à la sienne, la partie fut arrangée ; et les dames, accompagnées de M. Arnott, se rendirent chez la marchande de modes.
Ce fut là où Mademoiselle Larolles recommença ses louanges et ses extases : elle examina avec un plaisir inexprimable les ajustements qu’on étala, demanda le nom des personnages auxquels ils étaient destinés, les entendit nommer avec envie, et soupira avec toute l’amertume de l’humiliation, de ce qu’elle n’était pas assez riche pour acheter presque tout ce qu’elle voyait.
Leurs emplettes finies, ils visitèrent encore plusieurs manufactures de ce genre, et Mademoiselle Larolles prodigua par-tout les mêmes éloges et les mêmes désirs de tout acquérir. Après l’avoir ramenée chez elle, Madame Harrel et son amie rentrèrent pour le dîner, celle-ci se félicitant de passer la soirée tête-à-tête avec elle. Mais non, dit Madame Harrel, cela ne se peut pas ; car j’attends du monde ce soir. — Encore du monde ce soir ? — Oui : ne vous épouvantez pas ; la compagnie sera peu nombreuse, tout au plus quinze à vingt personnes. Regardez-vous quinze à vingt personnes comme une compagnie peu nombreuse, répartit Cécile en souriant ? Il n’y a pas bien long-temps que vous et moi l’aurions trouvée tout autrement. Oh ! vous parlez du temps où je vivais en province, répartit Madame Harrel ; Quelle idée pouvais-je alors me former de la compagnie ou des sociétés ?
La compagnie était, comme la veille, composée de gens inconnus à Cécile, à l’exception de mademoiselle Leeson, qui se trouva placée à côté d’elle, et dont l’aspect froid l’obligea de nouveau à observer le silence. Elle fut cependant surprise qu’une demoiselle qui paraissait décidée à n’être amusée, et à n’amuser personne, eût quelque envie de se montrer deux fois de suite dans une assemblée où rien ne semblait l’intéresser. M. Arnott vint la dédommager du silence de sa voisine : il l’entretint encore des amusements de leur enfance, dont le souvenir lui était cher ; et quoiqu’elle essayât de changer de sujet, il y revint toujours avec une espèce d’obstination.
Lorsque la compagnie se fut retirée, M. Arnott étant resté seul avec les dames, Cécile, surprise de ne point voir M. Harrel, demanda de ses nouvelles, et observa qu’il n’avait point paru de toute la journée. Oh ! s’écria sa femme, vous en êtes étonnée ? cela arrive continuellement. Il dîne ordinairement au logis ; sans cela, je ne le verrais jamais. Réellement ? Et à quoi emploie-t-il son temps ? C’est ce que je ne saurais vous dire, car il ne me consulte jamais là-dessus ; cependant j’imagine qu’il l’emploie à peu près de même que ses pareils.
Ah ! Priscilla, s’écria Cécile, d’un ton sérieux, je ne m’attendais guère à vous trouver aussi changée, et que vous eussiez adopté en si peu de temps les maximes des femmes du bon ton. Des femmes du bon ton, répéta madame Harrel ! eh bien, ma chère, je suis l’usage établi parmi les personnes de mon état. On ne saurait, je pense, trouver rien à redire à mon genre de vie. Miss Beverley, dit tout bas M. Arnott, vous donnerez, j’espère, l’exemple aux autres, et vous ne le prendrez jamais d’eux. Un moment de silence suivit cette conversation, et bientôt ils se séparèrent.
Le lendemain matin, Cécile ne manqua pas d’employer son temps d’une manière plus utile que la veille ; et sans s’amuser à parcourir la maison pour chercher une compagne qu’elle était sûre de n’y pas trouver, elle se fit un plan d’occupation qui devait remplir ses moments de loisir, et la lecture dans laquelle elle se promettait de trouver de l’instruction et de l’amusement fut pour elle la ressource qui lui parut la plus assurée au milieu de l’ennui et des inutilités de la société.
On était encore à déjeûner, lorsqu’on reçut une nouvelle visite de mademoiselle Larolles. Je suis venue, s’écria-t-elle vivement, pour courir avec vous à l’auction2 de mylord Belgrade ; tout l’univers y sera, et nous entrerons au moyen de nos billets. Vous ne sauriez vous figurer la foule qu’il y aura. Qu’est-ce qu’on y vendra ? demanda Cécile. Oh ! tout ce qu’on peut imaginer ; des maisons, des écuries, de la porcelaine, des dentelles, des chevaux, des bonnets, toutes sortes de choses. Et vous proposez-vous d’y faire quelque emplette ? — Mon Dieu ! non ; mais on est bien aise de voir tout cela. Cécile la pria de vouloir bien l’excuser, si elle se dispensait de l’accompagner. Non, je ne saurais y consentir, s’écria Mademoiselle Larolles, il faut que vous y veniez ; je vous assure qu’il y aura la plus terrible foule que vous ayez jamais vue de votre vie. Je suis certaine que nous y serons à moitié étouffées à force d’être pressées. Cette expectative, dit Cécile, est peu flatteuse, et ne saurait avoir beaucoup d’attrait pour une pauvre provinciale nouvellement débarquée : il faudrait, pour en sentir tout le prix, que j’eusse passé plus de temps dans la capitale. Oh ! venez, car ce sera sûrement l’auction la plus fameuse de cette saison. Je ne saurais imaginer, madame Harrel, le parti que prendra la malheureuse milady Belgrade ; j’apprends que les créanciers ont saisi tout ce qui restait. Ces gens-là sont, à mon gré, la plus cruelle engeance qu’il y ait au monde ; ils lui ont saisi jusqu’à ces belles boucles de souliers que nous lui connaissions. Pauvre femme ! je vous déclare que j’aurai le cœur déchiré en les voyant exposées en vente : sur ma parole rien de plus révoltant. Je n’en ai encore pas vu d’aussi bien travaillées. Mais, allons, il est tard. Si nous ne partons pas sur-le-champ, nous ne pourrons jamais entrer.
Cécile la pria de nouveau de l’excuser, et de la dispenser de l’accompagner, ajoutant qu’elle était décidée à rester au logis. Au logis, ma chère ! repartit madame Harrel ; cela ne se peut pas ; il y a plus d’un mois que nous avons promis à madame Mears, et elle m’a priée de vous engager à être de la partie. J’attends à tout instant qu’elle vienne elle-même, ou qu’elle vous envoie un billet d’invitation. Il est bien malheureux pour moi, dit Cécile, que vous ayez dans ce moment un si grand nombre d’engagements ; je me flatte, du moins, que vous n’en aurez point pour demain. Pardonnez-moi : demain nous serons chez madame Elton. Encore demain ? Et combien cela durera-t-il ? Dieu, le sait ! Je vous montrerai ma liste.
Alors elle tira de sa poche un petit livre qui contenait les noms des différentes personnes auxquelles elle avait promis. Il y en avait au moins pour trois semaines. Je les efface, dit-elle, à mesure que ces promesses sont remplies, et j’y substitue les nouvelles ; cela nous mènera, je crois, jusqu’à l’anniversaire de la naissance du roi.
Cette liste ayant été examinée et commentée par mademoiselle Larolles, et parcourue avec étonnement par Cécile, on la remit à sa place, et les deux dames s’en furent à l’auction, permettant cependant pour cette fois à Cécile de ne pas les suivre.
Elle retourna à son appartement tout aussi peu satisfaite de la conduite de son amie que de sa position. L’éducation qu’elle avait reçue lui ayant inspiré de bonne heure le plus grand respect pour les préceptes salutaires de la religion et les règles fondamentales de la plus exacte probité, lui avait en même temps fait envisager une continuelle dissipation comme un acheminement au vice, et la prodigalité comme un avant-coureur de l’injustice. Accoutumé depuis long-temps à voir madame Harrel dans la solitude qu’elles avaient habitée ensemble, lorsque les livres faisaient leur principal amusement et leur société mutuelle leur plus grand bonheur, le changement qu’elle remarquait dans sa façon de penser et d’agir, la surprenait autant qu’il l’affligeait. Elle la voyait devenue insensible à l’amitié, indifférente pour son mari, et ne s’occupant jamais de soins domestiques ; la parure, la compagnie, les parties de plaisir et les spectacles paraissaient non-seulement prendre tout son temps, mais être encore l’objet de tous ses désirs. Cécile, dont le caractère noble et généreux ne respirait que la bienveillance et le goût sincère de toutes les vertus, fut cruellement mortifiée de cette métamorphose. Elle eut cependant assez de raison pour s’abstenir de lui en faire des reproches, convaincue que l’unique effet qu’ils puissent produire sur un cœur insensible, c’est de changer l’indifférence en aversion.
Dans le fond, celui de madame Harrel était honnête, quoique sa vie fût très-dissipée. Mariée fort jeune, elle avait passé tout d’un coup de la tranquillité d’une petite ville de province au tumulte de la capitale, et s’était trouvée maîtresse d’une des maisons les plus élégantes de la place de Portman, jouissant d’une fortune considérable, et femme d’un homme dont la conduite lui prouva bientôt le peu de cas qu’il faisait du bonheur domestique. Engagée dans un cercle continuel de sociétés et d’amusements, son esprit qui n’était pas des plus solides, se laissa bientôt éblouir par l’éclat de sa situation ; elle adopta facilement les maximes générales des gens du monde, et n’eut bientôt plus d’autre désir que de surpasser ses égales par sa parure et sa dépense.
Le doyen de ***, en choisissant M. Harrel pour l’un des tuteurs de sa nièce, avait simplement cherché à satisfaire le penchant qu’il supposait qu’elle aurait à vivre avec son amie : il le connaissait très-peu. Il l’avait ouï souvent nommer, et avait seulement des liaisons avec sa famille ; ce qui, sans chercher à en savoir davantage, lui parut suffisant pour présumer que ce tuteur conviendrait aussi bien qu’un autre à miss Beverley.
Il avait été plus circonspect dans le choix des deux autres. Le premier, M. Delvile, était un homme de très-grande naissance, et d’une probité reconnue ; le second, M. Briggs, avait passé sa vie dans le commerce, où il avait déjà amassé une fortune immense ; il n’avait pas de plus grand plaisir que celui de l’augmenter. Il se promettait, en conséquence, des sentiments nobles et généreux du premier, que sa nièce serait protégée, et à l’abri de toute imposition ; et vu l’expérience de M. Briggs en matière d’intérêt, et son habileté dans les affaires, il attendait de ses soins que sa fortune, tant qu’elle resterait entre ses mains, ne manquerait pas de prospérer. De cette manière, il se flattait d’avoir également pourvu à ses plaisirs, à sa sûreté, et à la conservation de son bien.
Lorsque Cécile descendit pour dîner, M. Harrel lui présenta le chevalier Robert Floyer comme son plus intime ami. C’était un homme d’environ trente ans, ni beau ni laid ; tout ce qui le distinguait, c’était une assurance à toute épreuve, des manières libres, un air fier, un ton dédaigneux et brusque ; il montrait tous les vices des hommes à la mode, sans en avoir les grâces ni la politesse.