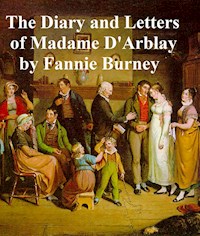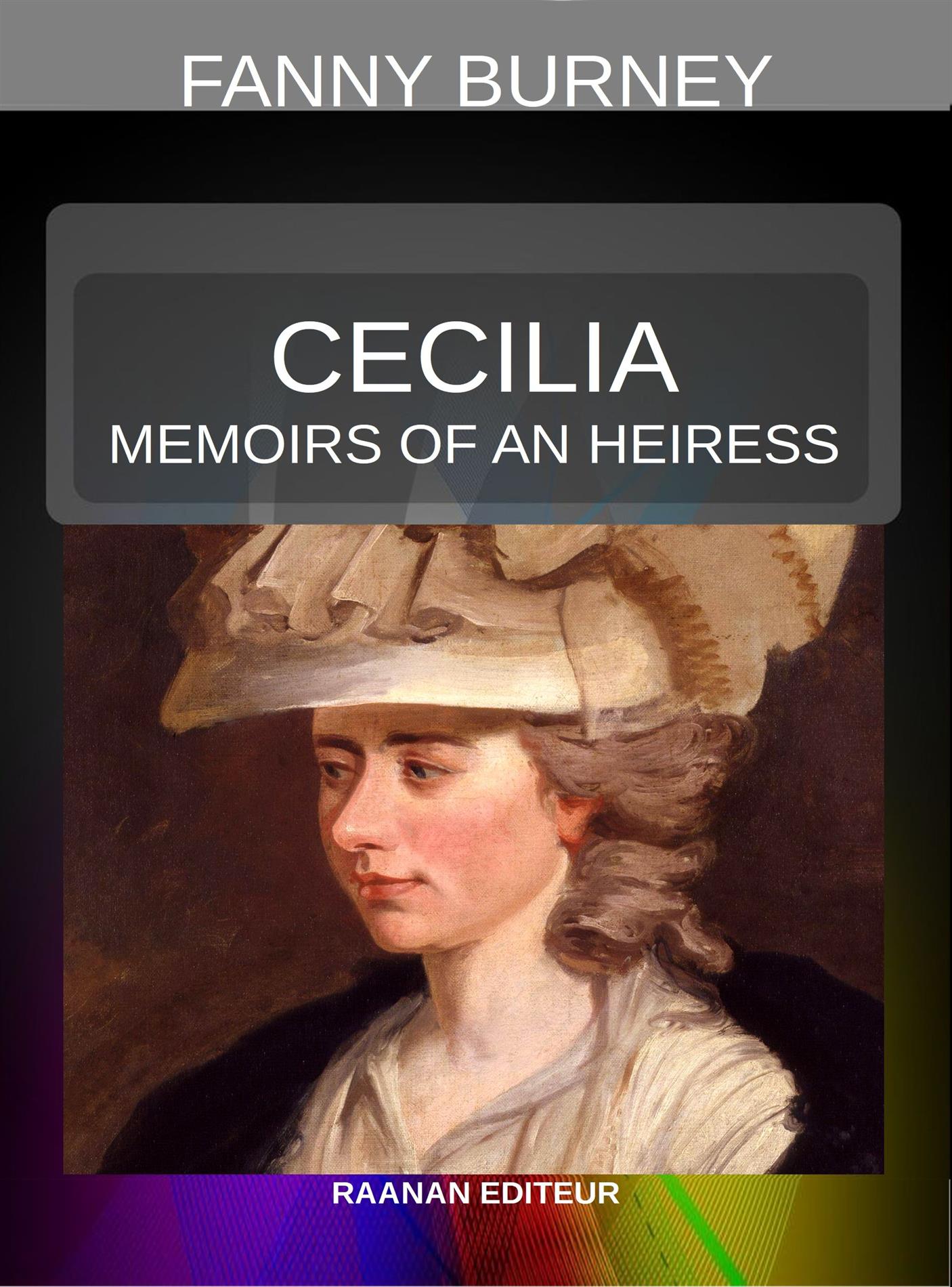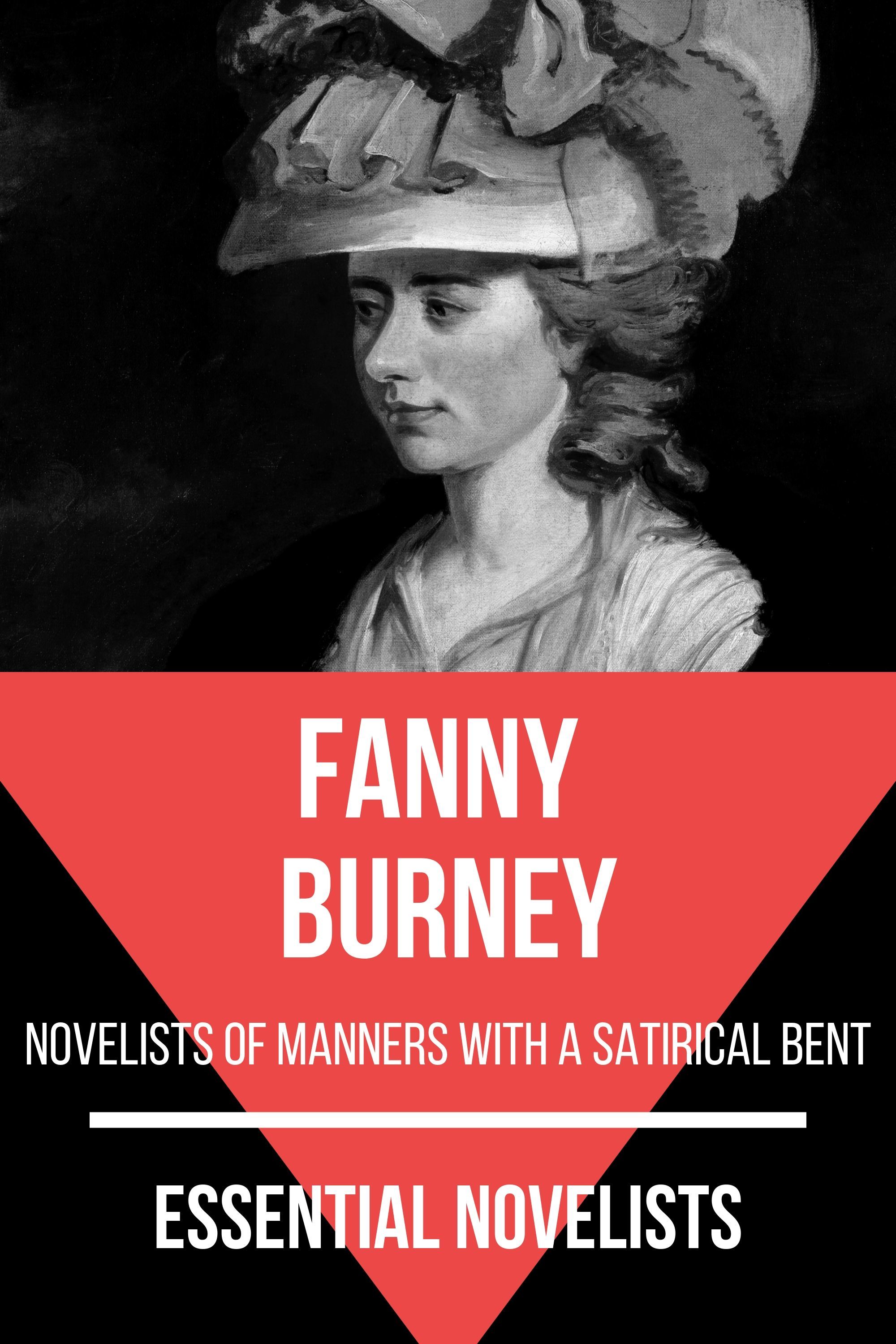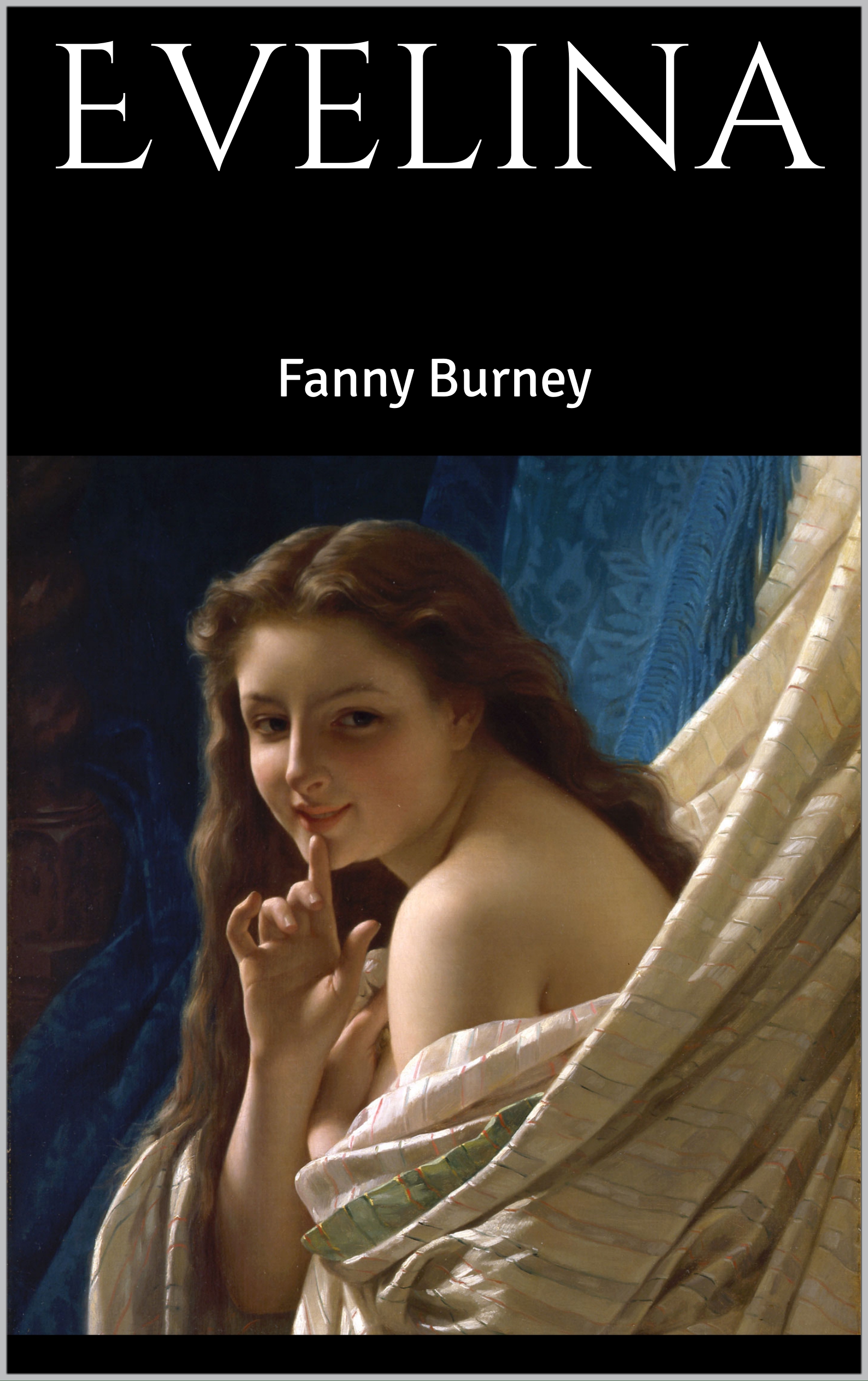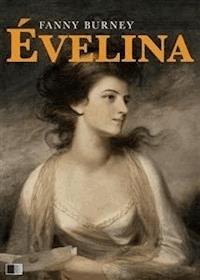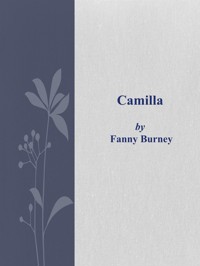1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Evelina – de son nom complet Evelina, or the History of a Young Lady’s Entrance into the World (Evelina, ou l’Histoire de l’entrée d’une jeune dame dans le monde) est un roman de la romancière anglaise Fanny Burney, publié pour la première fois en 1778.
Présentation
| Dans ce roman épistolaire, Evelina, l’héroïne éponyme, est la fille non reconnue d’un aristocrate anglais qui mène une vie dissipée. Elle doit à sa naissance équivoque d’être élevée loin du monde, à la campagne, jusqu’à ses dix-sept ans. À travers toute une série d’évènements humoristiques qui se déroulent à Londres et dans le lieu de villégiature qu’est Hotwells (en), près de Bristol, Evelina apprend à trouver son chemin dans le dédale complexe de la société du XVIIIe siècle et gagne l’amour d’un noble seigneur. Ce roman sentimental comprend des aspects faisant appel à la sensibilité ainsi qu’à un romantisme précoce...|
|Source Wikipédia|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
TOME PREMIER.
AVANT-PROPOS.
LETTRE PREMIÈRE.
LETTRE II.
LETTRE III.
LETTRE IV.
LETTRE V.
LETTRE VI.
LETTRE VII.
LETTRE VIII.
LETTRE IX.
LETTRE X.
LETTRE XI.
LETTRE XII.
LETTRE XIII.
LETTRE XIV.
LETTRE XV.
LETTRE XVI.
LETTRE XVII.
LETTRE XVIII.
LETTRE XIX.
LETTRE XX.
LETTRE XXI.
LETTRE XXII.
LETTRE XXIII.
LETTRE XXIV.
LETTRE XXV.
LETTRE XXVI.
LETTRE XXVII.
LETTRE XXVIII.
LETTRE XXIX.
LETTRE XXX.
LETTRE XXXI.
LETTRE XXXII.
LETTRE XXXIII.
LETTRE XXXIV.
LETTRE XXXV.
LETTRE XXXVI.
LETTRE XXXVII.
LETTRE XXXVIII.
LETTRE XXXIX.
LETTRE XL.
LETTRE XLII.
LETTRE XLIII.
LETTRE XLIV.
LETTRE XLV.
LETTRE XLVI.
LETTRE XLVII.
LETTRE XLVIII.
TOME SECOND.
LETTRE XLIX.
LETTRE L.
LETTRE LI.
LETTRE LII.
LETTRE LIII.
LETTRE LIV.
LETTRE LV.
LETTRE LVI.
LETTRE LVII.
LETTRE LVIII.
LETTRE LIX.
LETTRE LX.
LETTRE LXI.
LETTRE LXII.
LETTRE LXIII.
LETTRE LXIV.
LETTRE LXV.
LETTRE LXVI.
LETTRE LXVII.
LETTRE LXVIII.
LETTRE LXIX.
LETTRE LXX.
LETTRE LXXI.
LETTRE LXXII.
LETTRE LXXIII.
LETTRE LXXIV.
LETTRE LXXV.
LETTRE LXXVI.
LETTRE LXXVII.
LETTRE LXXVIII.
LETTRE LXXIX.
LETTRE LXXX.
LETTRE LXXXI.
LETTRE LXXXII.
LETTRE LXXXIII.
LETTRE LXXXIV.
FANNY BURNEY
ÉVELINA
Ou l’entrée d’une jeune personne dans le monde.
ROMAN
Paris, Maradan | 1797
Raanan Éditeur
Livre numérique 451 | édition 2
TOME PREMIER.
AVANT-PROPOS.
Une jeune demoiselle élevée dans la retraite, paroît à l’âge de dix-sept ans sur le grand théâtre du monde. Avec une ame vertueuse, un esprit cultivé et un cœur sensible, elle a le malheur de tomber dans plusieurs erreurs, que lui font commettre son inexpérience, et le défaut de ce qu’on appelle usage du monde. Les événemens qui en résultent, forment le fond de ces Lettres qu’on offre aujourd’hui au public. Elles peuvent fournir le sujet d’une lecture amusante, et même utile à bien des égards. Les caractères y sont tracés avec vérité, la vertu y est présentée sous un point de vue aimable, et le vice y est peint avec les couleurs odieuses qui lui sont propres.
ÉVELINA
LETTRE PREMIÈRE.
Lady Howard à M. Villars.
Howard-Grove.
Concevez-vous, mon cher ami ; une tâche plus pénible pour un caractère bienfaisant, que la nécessité de donner de mauvaises nouvelles ? Certes, il est difficile quelquefois de décider s’il faut plaindre davantage celui qui les donne, ou celui qui les reçoit.
Madame Duval vient de m’écrire : cette femme est dans le plus grand embarras sur la conduite qu’elle doit tenir ; elle semble desirer de réparer les maux qu’elle a faits, et elle voudroit en même temps passer pour innocente aux yeux du monde. Elle cherche à rejeter sur quelqu’autre, l’odieux de toutes les calamités dont elle est seule responsable. Sa lettre est violente, quelquefois outrageante. C’est vous, monsieur, qu’elle accuse, vous à qui elle a des obligations qui l’emportent même sur ses torts. C’est à vos conseils qu’elle impute méchamment toutes les souffrances de son infortunée fille, feu lady Belmont. Je vais vous communiquer l’essentiel de ce qu’elle m’écrit ; la lettre même n’est pas digne de votre attention.
Elle me dit que, depuis bien des années, elle s’étoit flattée de l’idée d’un voyage en Angleterre ; que c’est ce qui l’a empêchée de nous demander des éclaircissemens sur un sujet fâcheux dont elle espéroit se procurer des nouvelles par ses propres recherches ; des affaires de famille l’ont retenue jusqu’ici en France, et probablement ne lui permettront plus de quitter ce royaume. Elle a donc fait les derniers efforts pour recueillir des lumières sur tout ce qui concerne son imprudente fille. Les nouvelles qu’elle a reçues lui donnent lieu de craindre que lady Belmont n’ait laissé en mourant un orphelin : elle ajoute gracieusement qu’elle est informée que cet enfant est retiré chez vous et, pourvu que vous en prouviez authentiquement la parenté, elle consent que vous l’envoyiez à Paris, où elle en prendra tout le soin convenable.
Cette femme, n’en doutons pas, commence enfin à ouvrir les yeux sur sa conduite dénaturée. Au reste, sa lettre prouve qu’elle est toujours aussi ignorante, aussi peu instruite de l’usage du monde, qu’elle l’étoit lorsque son premier mari, M. Evelyn, eut la foiblesse de l’épouser. Elle ne me fait pas la moindre excuse de ce qu’elle s’adresse à moi, quoique je ne l’aie jamais vue qu’une fois.
Cette lettre excite toute la curiosité de ma fille Mirvan. Elle m’a demandé par quels motifs madame Duval avoit pu être poussée à abandonner l’infortunée lady Belmont, dans un moment où la protection d’une mère lui étoit si nécessaire pour son repos et pour sa réputation. Quoique je connoisse toutes les personnes intéressées dans cette affaire, le sujet m’a toujours paru trop délicat pour leur en parler ; je ne puis donc satisfaire madame Mirvan autrement qu’en m’adressant à vous.
Il est aisé de démêler le motif de l’offre de madame Duval ; elle vise à obliger ceux même à qui elle est redevable. Je ne prétends pas vous conseiller. Vous, monsieur, à la protection généreuse duquel cette orpheline abandonnée doit tout, vous êtes le meilleur et le seul juge de ce qu’il lui reste à faire. Ce qui me tourmente le plus, c’est l’embarras que cette indigne madame Duval va peut-être vous donner.
Ma fille et ma petite-fille se joignent à moi pour vous prier de nous rappeler à cette aimable enfant ; elles me chargent de vous faire souvenir que la visite annuelle que vous promîtes ci-devant à Howard-Grove, a été interrompue depuis plus de quatre années. Je suis, mon cher monsieur, avec la plus haute considération, &c.
M. Howard.
LETTRE II.
M. Villars à Lady Howard.
Berry-Hill, Dorsetshire.
Vous n’avez que trop bien prévu, madame, l’embarras que m’a causé la lettre de madame Duval. Cependant, en considérant le repos dont j’ai joui depuis tant d’années, j’ai lieu de m’applaudir, plutôt que de murmurer, de ma situation présente ; je commence du moins à croire que cette méchante femme ouvre son cœur aux remords.
Quant à la réponse qu’elle attend de ma part, je vous supplie, madame, de lui marquer que je serois fâché de la désobliger en quelque manière que ce soit ; mais j’ai des raisons pressantes, et même incontestables, pour retenir sa petite-fille en Angleterre. Le premier de ces motifs, est la volonté d’une personne à qui elle doit une entière obéissance. Madame Duval peut être persuadée d’ailleurs que mon élève est traitée avec toute l’attention et toute la tendresse imaginables : son éducation, quoiqu’au-dessous de mes desirs, excède presque mes moyens, et j’ose me flatter que, lorsque le temps viendra où elle ira rendre ses devoirs à sa grand’mère, madame Duval n’aura pas sujet d’être mécontente de mes soins.
Je suis sûr, madame, que cette réponse ne vous surprendra point. Madame Duval est, pour une jeune personne, une mauvaise société, et une tout aussi mauvaise surveillante. Sans éducation et sans principes, elle est d’une humeur intraitable, et ses mœurs sont grossières. Je sais que, depuis long-temps, elle m’a pris en aversion. Malheureuse créature ! je ne puis l’envisager que comme un objet de pitié !
Je n’ai rien à refuser à madame Mirvan ; mais en lui accordant sa demande, j’abrégerai le récit des tristes événemens qui ont précédé la naissance de ma pupille ; ils n’ont rien qui puisse intéresser agréablement un cœur aussi sensible que le sien.
Vous n’ignorez pas, sans doute, madame, que je fus choisi pour gouverneur de M. Evelyn, grand-père de ma jeune pupille ; j’eus l’honneur de l’accompagner dans le cours de ses voyages. À peine de retour en Angleterre, il épousa madame Duval, alors servante de cabaret. Ce mariage fatal fut conclu en dépit des conseils et des instances de tous les amis de M. Evelyn ; moi-même je fus un de ceux qui insistoient le plus pour l’en détourner ; il demeura ferme dans son projet, et peu après il quitta sa patrie pour se fixer en France. La honte, et le repentir l’y suivirent : son cœur étoit peu fait à de tels sentimens. Avec un caractère excellent et une conduite jusqu’alors sans tache, ce jeune homme n’avoit à se reprocher que la foiblesse qui l’empêchoit de résister aux attraits de la beauté que la nature avoit répandue à pleines mains sur sa femme, quoiqu’à tout autre égard elle l’eût traitée en marâtre. Il ne survécut à cette malheureuse union que deux ans. Avant que d’expirer, il m’écrivit d’une main tremblante le billet suivant :
« Mon ami, que votre humanité vous fasse oublier un juste ressentiment ! Un père qui craint tout pour sa fille, la lègue à vos soins. — Ô Villars ! écoutez-moi ! prenez pitié de moi ! secourez-moi » !
Si les circonstances me l’avoient permis, j’aurois répondu à ces lignes, en me mettant incessamment en route pour Paris ; mais il me fallut agir par l’entremise d’un ami qui étoit sur les lieux, et qui assista à l’ouverture du testament.
M. Evelyn me laissoit mille livres sterlings et la tutelle de sa fille, jusqu’à ce qu’elle eût atteint l’âge de dix-huit ans. Il me conjuroit, dans les termes les plus pathétiques, de me charger de son éducation, jusqu’à ce qu’elle pût se pourvoir elle-même. À l’égard des biens qu’il lui laissoit, il la rendoit entièrement dépendante de sa mère, à la tendresse de laquelle il la recommandent instamment.
Ainsi, sans vouloir confier l’éducation morale de sa fille à une femme aussi mal élevée que madame Evelyn, il jugea pourtant à propos de lui assurer le respect et les égards qu’elle pouvoit exiger de la part d’un enfant. Malheureusement il ne soupçonna point que la mère fût capable de manquer d’affection et d’équité.
Depuis l’âge de deux ans jusqu’à dix-huit, miss Evelyn fut élevée sous ma direction. Je me dispense, madame, de vous parler des vertus de cette jeune personne. Elle m’aimoit comme son père ; elle fut également attachée à madame Villars : en un mot, elle me devint si chère, que je la quittois avec autant de regret que madame Villars elle-même, qui bientôt après me fut enlevée par la mort.
C’est à cette époque de sa vie que nous nous séparâmes. Sa mère, qui avoit épousé M. Duval, la fit venir à Paris. Que ne l’ai-je accompagnée ! peut-être mon appui lui auroit-il épargné les disgraces qui l’attendoient ! Enfin madame Duval pressée par son mari, s’employa avec vivacité, ou plutôt avec tyrannie, à faire réussir le mariage de miss Evelyn avec l’un des neveux de M. Duval. Lorsqu’elle vit échouer ses efforts, le refus de sa fille l’irrita au point, qu’elle eut recours aux voies de rigueur, jusqu’à la menacer de l’indigence.
Miss Evelyn, pour qui la colère et la violence étoient des sentimens inconnus, se lassa bientôt des procédés de sa mère. Elle eut l’imprudence de donner sa main en cachette à sir John Belmont, jeune débauché qui n’avoit que trop bien réussi à s’insinuer dans ses bonnes graces. Il promit de la conduire en Angleterre : — il tint parole. — Vous savez le reste, madame. — Dès qu’il vit que la fortune qu’il avoit attendue, venoit à manquer par l’impitoyable animosité des Duval, il eut la bassesse de brûler le certificat du mariage, et il nia d’avoir jamais été uni avec miss Evelyn.
Elle vola vers moi pour chercher du secours : avec quels transports, mêlés de joie et de tristesse, ne la revis-je pas ! Elle tâcha, par mes conseils, de rassembler des preuves, de son mariage : mais tout fut inutile ; sa crédulité l’avoit empêchée de prendre des précautions : elle n’eut rien à opposer aux ruses du barbare Belmont.
Sa jeunesse irréprochable, le libertinage connu de son séducteur, plaidoient assez en sa faveur. Tout le monde la jugea innocente. Mais ses souffrances étoient trop violentes pour une constitution aussi délicate que la sienne, et le même instant qui donna le jour à son enfant, termina ses chagrins et sa vie.
La fuite de miss Evelyn avoit rallumé la fureur de madame Duval ; son ressentiment ne se calma point, tant que respira cette victime de sa cruauté. Il est à croire que son intention étoit de lui pardonner dans la suite ; mais elle n’en eut pas le loisir. Informée de la mort de sa fille, elle s’abandonna à tous les excès de la douleur, et tomba dangereusement malade. Mais depuis son rétablissement jusqu’à la date de la lettre qu’elle vous a adressée, madame, elle n’a témoigné, que je sache, nul désir d’être instruite des circonstances de la mort de lady Belmont et de la naissance de son enfant.
Tant qu’il me restera un souffle de vie, cette enfant ne connoîtra point la perte qu’elle a faite. Je l’ai chérie, soutenue, depuis sa plus tendre enfance jusqu’à l’âge de seize ans ; elle a tellement récompensé mes soins et ma tendresse, que je n’ai plus d’autre vœu à faire que de la voir mariée à un honnête homme qui reconnoisse son mérite ; et après avoir eu cette consolation, je ne demande plus qu’à mourir entre ses bras.
Ainsi, par un concours fortuit de circonstances, j’ai été chargé de l’éducation du père, de la fille et de la petite-fille. Combien de chagrins les deux premiers ne m’ont-ils pas causés ! Ah ! si le cher rejeton qui me reste étoit réservé à de pareilles disgraces, quelle triste issue n’auroient pas eue toutes mes peines ! que la fin de mes jours seroit remplie d’amertume !
Quand même madame Duval seroit digne de remplir la tâche qu’elle veut entreprendre, je doute que j’eusse assez de force pour lui céder mon élève ; mais telle que je la connois, non-seulement ma tendresse, mais même les sentimens de l’humanité se révoltent à la seule idée de lui abandonner le dépôt sacré qui m’a été confié. La quitter ! moi, qui consentois à peine quelle rendît une visite par an au château de Howard-Grove ! Pardonnez, madame ; je ne suis pas insensible, à l’honneur que vous nous faites : mais telle est l’impression qu’ont laissée dans mon cœur les calamités de la mère, que je ne perds pas un instant mon élève de vue, sans être agité par des craintes et des frayeurs qui sont plus fortes que moi. Ma tendresse et ma foiblesse vont jusqu’à ce point. Hélas ! madame, elle est le seul lien qui m’attache encore à ce monde ; j’espère de vos bontés que vous ne jugerez pas mes sentimens avec trop de rigueur.
Permettez que je présente mes très-humbles respects à madame et à miss Mirvan. J’ai l’honneur d’être, &c.
Arthur Villars.
LETTRE III.
(écrite plusieurs mois après la dernière.)
Lady Howard à M. Villars.
Howard-Grove, 8 mars.
Monsieur,
Votre dernière lettre m’a fait un plaisir infini : quelle satisfaction pour vous et pour vos amis, de vous voir relevé d’une aussi longue maladie ! Tous les habitans de ce château font mille vœux pour votre prompt et parfait rétablissement.
Ne penserez-vous pas que je vais tirer parti de cet heureux événement, si je vous parle encore de votre pupille et de Howard-Grove dans une même phrase ? Souvenez-vous cependant de la résignation avec laquelle nous avons consenti à vous la laisser pendant toute votre maladie ; ce n’est qu’avec beaucoup de peine que nous nous sommes défendus de vous demander sa société. Ma petite-fille, sur-tout, désire vivement de rejoindre l’amie de son enfance, et moi-même je brûle d’impatience de prouver l’estime que j’avois pour l’infortunée lady Belmont, en rendant service à son enfant ; c’est, je pense, la meilleure façon d’honorer sa mémoire. Permettez donc, monsieur, que je vous communique un plan que j’ai formé de concert avec madame Mirvan, dès que nous avons appris la nouvelle de votre convalescence.
Mon dessein n’est pas de vous effrayer. — Mais croyez-vous pouvoir vous séparer de votre élève pendant deux ou trois mois ? Madame Mirvan se propose de passer le printemps prochain à Londres : ma petite-fille l’y accompagnera pour la première fois. Elles souhaitent, mon cher ami, l’une et l’autre, que votre aimable pupille soit de la partie ; le voyage en sera d’autant plus agréable. Madame Mirvan partagera ses soins et ses attentions entre elle et sa propre fille. Ne soyez point surpris de ce projet ; il est temps que votre élève commence à connoître le monde. Les jeunes gens qui en sont trop sévèrement séquestrés, s’en font une trop haute idée : leur imagination vive et romanesque le peint comme un paradis qu’on leur a caché injustement ; mais lorsqu’ils l’ont vu de près et à temps, ils apprennent à l’envisager tel qu’il est, partagé entre les peines et les plaisirs, l’espérance et les revers.
Ne craignez rien de sir John Belmont. Ce misérable est actuellement en voyage, et n’est point attendu de retour cette année.
Eh bien ! mon cher monsieur, que dites-vous de notre plan ? J’espère qu’il aura votre approbation : sinon, je me soumettrai également à votre décision, comme à celle d’un homme que je respecte et que j’estime. C’est avec ces sentimens que je suis, &c.
M. Howard.
LETTRE IV.
M. Villars à Lady Howard.
Berry-Hill, 12 mars.
Je suis fâché de paroître obstiné, et je rougis de passer pour un homme intéressé. Ce n’est point pour satisfaire ma seule inclination que j’ai retenu ma jeune pupille à la campagne. Destinée, selon toutes les apparences, à ne posséder qu’une fortune très-médiocre, j’ai souhaité d’y proportionner ses vues. L’esprit n’est que trop enclin au plaisir, ne se livre que trop aisément à la dissipation : je me suis appliqué à la mettre en garde contre ces sortes d’illusions ; j’ai tâché de l’accoutumer à s’en passer et à les mépriser. Mais le temps approche où mes instructions doivent cesser ; elle doit juger désormais par sa propre expérience, et par les observations qu’elle aura occasion de faire elle-même. Si je l’ai mise en état de le faire avec discernement et à son avantage, je croirai avoir contribué beaucoup à son bien-être. Elle est actuellement dans l’âge du bonheur : — qu’elle en jouisse donc ! Je la remets à votre protection, madame, et je souhaite que vous la trouviez digne d’une partie des bontés qui l’attendent chez vous.
Jusqu’ici, je souscris volontiers à ce que vous me demandez. Tant que je saurai ma pupille entre les mains de lady Howard, son absence ne me donnera aucune inquiétude ; et si je suis privé de sa société, je serai du moins convaincu qu’elle est en pleine sûreté, autant que si elle étoit restée avec moi. Mais pouvez-vous, après cela, me proposer sérieusement, madame, de l’introduire dans les assemblées tumultueuses de Londres ? Permettez-moi de vous demander à quel propos et dans quel dessein ? Un jeune cœur est rarement sans ambition ; il faut la réprimer de bonne heure, et c’est le premier pas vers le contentement ; car, diminuer notre attente, c’est augmenter nos jouissances. Je ne crains rien plus que d’exalter trop les espérances et les vues de mon élève, ce qui seroit très-aisé avec la vivacité naturelle de son caractère. Les connoissances de madame Mirvan dans la capitale, appartiennent toutes au cercle du grand monde. Cette enfant ingénue, avec trop de beauté pour ne pas être remarquée, a trop de sensibilité pour y être indifférente ; mais sa fortune n’est pas assez considérable pour tenter un homme de façon.
Rappelez-vous, madame, tout ce que sa situation a de cruel : enfant unique d’un riche baronnet, qu’elle n’a jamais vu, dont elle a droit d’avoir le caractère en horreur, elle n’ose pas même prétendre à son nom. Héritière légitime de ses biens, y a-t-il la moindre apparence qu’il la reconnoîtra jamais pour sa fille ? Et, aussi long-temps qu’il persistera à désavouer son mariage avec miss Evelyn, je ne souffrirai point, madame, qu’il lui accorde, par faveur, une partie de ses droits, ce seroit les acheter aux dépens de l’honneur de sa mère.
Quant aux biens de M. Evelyn, madame Duval et sa famille auront grand soin de se les approprier ; je n’en attends rien du tout.
Ainsi, malgré les titres les plus réels, cette enfant délaissée se voit frustrée à la fois de deux riches successions, et ses espérances se trouvent bornées aux faveurs qu’elle attend de l’adoption et de l’amitié. Cependant ses revenus pourront suffire à son bonheur, si elle demeure dans le cercle d’une vie retirée ; mais ils ne lui permettent point de se jeter dans le luxe d’une femme de la capitale.
Souffrez donc, madame, que pendant que miss Mirvan brillera dans le grand monde, ma fille continue à goûter les plaisirs d’une humble retraite, les seuls qui peuvent convenir à son état.
J’espère, madame, que ce raisonnement obtiendra votre approbation ; j’ai d’ailleurs un autre motif de grand poids. Je ne voudrois choquer personne, et si madame Duval venoit à savoir qu’après le refus que je lui ai fait, je permets à sa petite-fille d’aller à Londres pour une partie de plaisir, elle seroit autorisée à m’accuser d’injustice.
En la gardant chez vous, à Howard-Grove, tous ces scrupules disparoissent. Madame Clinton l’y accompagnera la semaine prochaine : c’est une femme de mérite, qui a été ci-devant la nourrice de mon élève, et qui me sert actuellement comme ménagère.
Jusqu’ici, la pupille a porté le nom d’Anville, et j’ai répandu dans notre voisinage que son père, un de mes amis intimes, l’a confiée à ma tutelle. Avant que de vous l’envoyer, j’ai cru qu’il étoit nécessaire de la mettre au fait des circonstances fâcheuses de sa naissance. En lui cachant son nom et sa famille, j’ai cherché à la préserver d’une curiosité indiscrète ; mais je veux épargner à sa délicatesse le chagrin d’apprendre ses malheurs par quelque hasard imprévu.
N’attendez pas trop, madame, de ma pupille : c’est une petite campagnarde qui n’a aucune connoissance du monde ; et, quoique j’aie fait l’impossible pour lui donner une bonne éducation, je n’ai pu cependant suffire à tout dans un endroit isolé, éloigné de sept milles de Dorchester, la ville la plus proche. Vous vous appercevrez d’une quantité de petits défauts qui devoient naturellement m’échapper. Elle doit être bien changée depuis la dernière visite qu’elle a faite à Howard-Grove ; mais je ne veux point vous prévenir ; je l’abandonne à votre jugement, et je vous supplie de me dire sincèrement ce que vous pensez d’elle, Je suis, &c.
Arthur Villars.
LETTRE V.
M. Villars à Lady Howard.
18 mars.
Madame,
Cette lettre vous sera remise par mon enfant, — l’enfant de mon adoption, — de mon affection. Privée des plus doux liens de la nature, elle mérite de trouver des ressources dans le sein de l’amitié. Je vous l’envoie innocente comme les anges, pure comme le jour ; et avec elle je vous envoie le cœur de votre ami, son unique espoir sur la terre, l’objet de ses plus tendres soins. Pour elle seule, madame, j’ai souhaité de vivre encore ; pour elle seule je suis prêt à mourir avec joie. Rendez-la-moi avec toute l’innocence qu’elle vous apporte, et vous aurez rempli mes plus chères espérances.
Arthur Villars.
LETTRE VI.
Lady Howard à M. Villars.
Howard-Grove.
Monsieur,
Le ton solemnel que vous employez en m’envoyant votre fille, a diminué en quelque sorte le plaisir que me faisoit cette marque de votre confiance. Je crains que vous ne souffriez trop de votre complaisance ; et, dans ce cas, je me reprocherois la vivacité avec laquelle je vous ai demandé cette faveur : mais souvenez-vous, monsieur, qu’elle n’est qu’à une très-petite distance de chez vous, et soyez assuré que je ne la retiendrai pas un instant au-delà du terme que vous fixerez à son absence.
Vous voulez savoir ce que je pense d’elle ? C’est un petit ange ! et je ne m’étonne plus que vous vous attribuiez sur elle des droits exclusifs : mais vous devez sentir combien il vous sera difficile de conserver ces droits à la longue.
Sa physionomie et toute sa figure s’accordent pleinement avec l’idée que je me formois d’une beauté parfaite ; et la chose est si frappante, qu’il n’y a pas moyen de la passer sous silence, quoique nous attachions, vous et moi, peu de prix à un aussi frêle avantage. Si j’avois ignoré de qui elle tient son éducation, j’aurois été en peine, au premier coup-d’œil, de son esprit : on a remarqué depuis long-temps, et avec raison, que la sottise va presque toujours de pair avec la beauté.
Elle a la même douceur dans les manières, les mêmes grâces naturelles dans sa démarche, qui distinguoient si favorablement sa mère. Son caractère est l’ingénuité, la naïveté même ; et, quoique douée d’un jugement exquis et d’une grande pénétration d’esprit, elle y joint un certain air d’inexpérience et d’innocence qui la rend on ne peut pas plus intéressante.
Vous auriez tort de regretter la retraite dans laquelle elle a vécu ; un penchant naturel à obliger, et des façons infiniment prévenantes, lui tiennent lieu de cette politesse qu’on acquiert dans le grand monde.
Je remarquai, à ma satisfaction, que cette aimable enfant s’attache de plus en plus à ma petite-fille : celle-ci est aussi éloignée de tout ce qui s’appelle amour-propre ou fantaisie, que votre jeune élève l’est de la ruse. Leurs liaisons leur seront réciproquement utiles : l’émulation qui en résultera, leur fera beaucoup de bien ; car l’envie n’y sera pas mêlée. Je veux qu’elles se tiennent lieu de sœurs l’une à l’autre.
Soyez convaincu, mon cher monsieur, que nous aurons soin de votre fille comme de notre propre enfant. Nous réunissons nos vœux sincères pour votre santé et pour votre prospérité, et nous vous remercions de la faveur que vous nous avez accordée, &c.
M. Howard.
LETTRE VII.
Lady Howard à M. Villars.
Howard-Grove, 26 mars.
Ne vous alarmez pas, mon digne ami, de me voir déjà revenir à la charge. Je n’admets point de cérémonies dans mes correspondances ; et, sans attendre régulièrement des réponses à mes lettres, sans me piquer moi-même de ponctualité, il suffit que je sois dans le cas de réclamer votre indulgence, pour que je mette la main à la plume. Madame Mirvan vient de recevoir une lettre de son époux : après une très-longue absence, il lui marque l’agréable nouvelle, qu’il compte d’être rendu à Londres dans les premiers jours de la semaine prochaine. Ma fille et le capitaine ont été séparés depuis environ sept ans : ainsi je me dispense de vous dire quelle joie, quelle surprise, quelle confusion, le retour de M. Mirvan répand dans Howard-Grove. Ma fille, comme vous pensez bien, ira incessamment en ville à sa rencontre : ma petite-fille est obligée de la suivre ; je suis fâchée de ne pas pouvoir en faire autant.
Maintenant, mon cher monsieur, je n’ai plus le courage de continuer. De grace ! oserai-je demander — permettrez-vous que votre fille les accompagne ? N’allez pas dire que nous sommes indiscrètes. Considérez tous les motifs qui concourent dans ce moment-ci à lui rendre le séjour de Londres infiniment agréable : l’événement heureux qui donne lieu à ce voyage, l’alégresse de tous ceux qui seront de la partie. Opposez à cela la vie ennuyeuse à laquelle elle sera réduite, si elle reste ici avec une vieille femme solitaire pour toute société, tandis qu’elle saura que toute la famille nage dans la joie : voilà des circonstances qui semblent mériter votre attention.
Madame Mirvan me prie de vous assurer qu’une semaine est tout ce qu’elle demande ; car elle est sûre que le capitaine, qui hait Londres, pressera son retour à Howard-Grove. D’ailleurs, Marie désire avec tant d’ardeur d’avoir son amie avec elle, qu’un refus de votre part la priveroit de la moitié du plaisir qu’elle se promet de cette course.
En attendant, monsieur, je ne veux rien vous cacher ; je ne vous garantis point qu’ils mèneront à Londres une vie retirée, et même cela n’est nullement apparent. Mais ne craignez rien de madame Duval : elle n’a aucune correspondance en Angleterre ; ce qu’elle apprend de nous, n’est que par des bruits publics. Le nom que porte votre fille, ne sauroit lui être connu ; et, supposé même qu’elle vînt à savoir que notre jeune amie ait passé une huitaine de jours en ville dans une occasion aussi extraordinaire, il n’est pas possible qu’elle s’en tienne offensée.
Madame Mirvan vous assure que si vous déférez à sa demande, ses deux enfans partageront également son temps et ses attentions. Elle a donné commission à un ami d’arrêter une maison pour elle ; la réponse ne tardera à venir, et j’attendrai dans cet intervalle votre décision. Votre fille vous écrit elle-même ; sa lettre fera plus que toutes nos sollicitations.
Madame Mirvan vous fait ses complimens, dans le cas seulement, à ce qu’elle dit, où vous accorderez votre consentement ; pas autrement.
Adieu, mon cher monsieur, nous espérons tout de votre bonté.
M. Howard.
LETTRE VIII.
Évelina à M. Villars.
Cette maison est le séjour de la joie ; chaque physionomie annonce la gaîté, tout le monde vous aborde avec un souris sur les lèvres. Je ne fais que roder pour m’amuser de la confusion qui y règne. On prépare une chambre sur le jardin pour servir de cabinet d’étude au capitaine. Lady Howard n’est pas un instant à la même place ; miss Mirvan fait des bonnets ; on s’occupe de tout côté ; on court de chambre en chambre ; on donne des ordres ; on les révoque ; on en donne de nouveaux ; tout est en désordre et en agitation.
J’ai une prière à vous faire, mon cher monsieur, et j’espère que vous ne m’accuserez point d’abuser de vos bontés. Lady Howard veut absolument que je vous écrive ; comment m’y prendre ? une prière suppose des besoins ; et m’en avez-vous jamais laissé ?
Je suis confuse d’avoir commencé cette lettre, mais ces chères dames sont si pressantes ! — Je ne puis m’empêcher de l’avouer ; les plaisirs auxquels elles m’invitent de prendre part me tentent beaucoup, pourvu seulement que vous ne les désapprouviez pas.
Elles vont faire un court séjour à Londres. Le capitaine les y joindra dans peu de jours. Madame Mirvan sera accompagnée de sa fille. — Quelle délicieuse partie ! et cependant je ne me sens pas une envie excessive de les suivre ; du moins je crois que je demeurerai avec plaisir si vous le desirez.
Assurée, mon très-cher monsieur, de votre bonté, de votre amitié, de votre indulgence, me seroit-il permis de souhaiter quelque chose sans votre agrément ? Décidez, je vous prie, sans craindre de me gêner ou de m’affliger. Tant que je serai dans l’incertitude, j’espérerai peut-être ; mais dès que vous aurez prononcé, je n’aurai rien à répliquer.
Elles me disent que Londres est actuellement dans tout son brillant. Deux spectacles, — l’Opéra, — le Ranelagh, — le Panthéon ; — vous voyez que je sais déjà tous ces noms par cœur. Néanmoins je n’ai encore rien disposé pour mon départ ; et s’il faut que je reste, je les verrai monter en chaise, sans qu’il m’en coûte un soupir, quoique je sois sûre de ne plus retrouver une occasion comme celle-là. Leur joie sera si complète, qu’il est naturel de desirer de la partager.
Suis-je donc ensorcelée ? Je me proposois en commençant de ne pas insister ; mais ma plume, — ou plutôt mes idées l’emportent. Je l’avoue malgré moi, votre consentement me tient à cœur.
Je me repens déjà d’avoir laissé échapper cet aveu : oubliez, je vous supplie, ce que je viens d’écrire, si ce voyage vous déplaît. Je finis ; car plus je pense à cette affaire, moins elle me devient indifférente.
Adieu, mon très-honoré, mon très-respecté, mon très-aimé père ; car comment puis-je vous appeler autrement ? Je ne connois de bonheur ou de chagrin, d’espérance ou de crainte, que ceux que votre satisfaction ou votre déplaisir peuvent me donner. Si vous me refusez, je suis sûre que ce ne sera pas sans de fortes raisons, et je ne doute pas que je n’y souscrive volontiers. — J’espère encore cependant, — peut-être pourrez-vous me laisser aller. Je suis avec une entière affection,
Évelina.
Je n’ose pas signer Anville une lettre adressée à vous ; et quel autre nom m’est-il permis de prendre ?
LETTRE IX.
M. Villars à Évelina.
Berry-Hill, 28 mars.
Je n’ai pas la force de résister à une sollicitation pressante. Loin d’usurper sur vous, mon enfant, une autorité qui porte atteinte à votre liberté, je ne consulte que la prudence pour m’épargner les angoisses du repentir. Votre impatience de voir Londres, ne me surprend point, puisque la vivacité de votre imagination vous peint cette ville avec des couleurs si avantageuses ; je souhaite seulement que votre attente ne soit pas trompée. Vous refuser, ce seroit exalter vos idées. Je ne demande pas mieux que de contribuer au bonheur de mon Évelina : ainsi je vous accorde mon consentement. Partez, mon enfant ; que le ciel soit votre guide ! qu’il vous conserve et vous fortifie ! Je le prierai nuit et jour pour votre félicité. Qu’il vous prenne sous sa garde, qu’il veille sur vous, qu’il vous préserve de tout danger, de toute adversité ! Qu’il écarte de votre personne le vice, autant qu’il est éloigné de votre cœur ! Qu’il me donne enfin la dernière consolation que je lui demande, celle de fermer les yeux dans les bras d’une fille qui m’est si chère, et qui mérite tant de l’être.
Arthur Villars.
LETTRE X.
Évelina à M. Villars.
Londres, Queen-Street, samedi 2 avril.
J’arrive dans ce moment, et déjà je me prépare d’aller à Drury-Lane. Le célèbre Garrick remplira le rôle de Ranger. Je suis toute en extase. Miss Mirvan ne l’est pas moins. Quel heureux hasard, en effet, de voir Garrick, lui qui joue si rarement ! Nous avons eu bien de la peine à arracher le consentement de madame Mirvan : elle prétend que nous ne sommes pas assez habillées pour paroître en public ; car nous n’avons pas encore eu le temps de nous monter au ton de Londres. À force de la tourmenter, nous avons obtenu cependant une loge écartée, où nous ne serons vues de personne. Quant à moi, toute place m’est égale ; je serai inconnue à la première comme à la dernière.
J’interromps ici ma lettre. À peine ai-je le temps de respirer. — Je remarquerai seulement que la magnificence des maisons et des rues de Londres ne répond pas à l’idée que j’en avois.
Je vous dis adieu, monsieur, pour le présent : je ne pouvois m’empêcher de vous écrire un mot à mon arrivée ; car je suppose que ma lettre de remercîment est encore en chemin.
Samedi au soir.
Me voici de retour du spectacle, ivre de plaisir ! C’est à bien juste titre que M. Garrick mérite sa réputation et une admiration universelle. — Je n’avois point d’idée d’un aussi grand acteur.
Quelle aisance, quelle vivacité dans son jeu ! quelles graces dans tous ses mouvemens ! quel feu et quelle expression dans ses yeux ! Je ne pouvois pas me persuader qu’il débitoit de mémoire ; chaque mot semble partir de l’impulsion du moment.
Son action est à la fois agréable et sans gêne : sa voix distincte et mélodieuse, et en même temps merveilleusement variée dans tous ses tons, pleine de vie ; chaque regard est une parole.
J’aurois donné tout au monde pour voir recommencer la pièce. — Et lorsque je le vis danser, — oh ! que j’enviois Clarinde ! J’étois tentée de sauter sur le théâtre pour me mettre de la partie.
Vous me prendrez pour une folle : ainsi je ferai bien de quitter ici la plume. Mais je vous proteste que vous seriez enchanté vous-même de Garrick, si vous le voyiez. Je vais prier madame Mirvan de nous envoyer au spectacle tous les jours que nous passerons ici. Elle me comble de bontés, et Marie, sa charmante fille, est la plus aimable enfant du monde.
Chaque soir, monsieur, je vous rendrai compte de ma journée, avec autant de vérité que si j’étois sous vos yeux.
Dimanche.
Nous avons été ce matin à la chapelle de Portland, et, après le service, nous nous sommes promenées dans le mail du parc Saint-James, qui n’a nullement rempli mon attente. C’est une longue allée couverte d’un gravier sale, très-incommode pour les piétons : les deux extrémités, au lieu de présenter des vues découvertes, sont bornées par des maisons de briques. Lorsque madame Mirvan me fit remarquer le Palais, je pensai tomber de mon haut.
Quoi qu’il en soit, la promenade nous fit plaisir : tout le monde avoit l’air gai, et sembloit content. Les femmes étoient extrêmement parées : miss Mirvan et moi, nous ne pouvions pas assez les regarder. Madame Mirvan rencontra plusieurs de ses amies : cela n’étoit pas surprenant, car jamais je ne vis une pareille foule. Je cherchois aussi si je ne trouverois personne de ma connoissance ; je n’en vis point, et cela me parut singulier : je croyois que le monde entier étoit réuni ici.
Madame Mirvan dit que nous ne retournerons point au parc dimanche prochain, supposé même que nous soyons encore en ville : on nous conduira aux jardins de Kensington, où l’on dit qu’il y a meilleure société. C’est ce qu’on a de la peine à croire, lorsque l’on sort d’un cercle si brillant.
Lundi.
Nous sommes invitées ce soir à un bal privé qui se donne chez madame Stanley, femme du bon ton, et l’une des connoissances de madame Mirvan.
Nous avons passé notre matinée à courir les boutiques, pour acheter des étoffes, des bonnets, des gazes et autres bagatelles.
Ces boutiques sont assez amusantes, sur-tout celles des merciers : vous voyez dans chacune une demi-douzaine d’hommes, qui, à force de révérences et de souris, cherchent à être remarqués. On nous conduisit de l’un à l’autre, et nous passâmes de salle en salle avec tant de cérémonies, que j’eus d’abord peur de suivre.
Je crus que je ne viendrois jamais à bout de choisir une étoffe ; ils en montrèrent une si prodigieuse quantité, que je ne savois auxquelles m’en tenir : d’ailleurs, ils les vantoient avec tant de complaisance, qu’on eût dit que, pour m’engager à acheter toutes leurs marchandises, il ne s’agissoit que de m’en donner bonne opinion ; et, en vérité, j’aurois voulu pouvoir acheter davantage, à cause des peines qu’ils se donnoient.
Chez les marchands de modes, nous vîmes des dames habillées avec tant d’éclat, qu’on eût dit qu’elles étoient sorties pour rendre des visites, plutôt que pour faire des emplettes. Mais ce qui m’amusa le plus, c’est que, dans ces boutiques, nous étions presque toujours servies par des hommes, et, ce qui est bien pis, par des hommes affectés et précieux. Ils étoient mieux instruits que nous des moindres détails de nos ajustemens, et ils recommandoient leurs bonnets et leurs rubans avec un air d’importance, qui me donna envie de leur demander depuis quand ils avoient cessé d’en porter ?
La vitesse avec laquelle on travaille dans ces grandes boutiques, est surprenante ; ils m’ont promis pour ce soir un assortiment complet.
Je suis actuellement entre les mains du perruquier, et je ne me retrouve plus la même tête. On l’a chargée de poudre, d’épingles noires et d’un grand coussin. Je doute que vous me reconnussiez, car ma physionomie est toute différente de ce qu’elle étoit sans coiffure. Accoutumée à m’arranger moi-même, je crains que je n’y réussisse pas de si-tôt, tant ma chevelure se trouve entortillée, ou tapée, comme on dit en termes de l’art.
Le bal de ce soir me met mal à mon aise ; car vous savez que je n’ai jamais dansé qu’à l’école. Madame Mirvan me dit cependant qu’il n’y a pas là de quoi être embarrassée ; je n’en souhaite pas moins que cette fête soit passée.
Adieu, mon cher monsieur ; excusez, de grace, le fatras dont cette lettre est remplie : peut-être le séjour de la capitale polira-t-il mon style, et que dans la suite je pourrai vous offrir une correspondance plus digne de votre attention. En attendant, je suis, en dépit de mon peu de savoir, &c.
Évelina.
La pauvre miss Mirvan est obligée de refaire tous ses bonnets, qui ne sont pas montés à la hauteur des coiffures de Londres.
LETTRE XI.
Suite de la Lettre d’Évelina.
Mardi matin, 5 avril.
J’ai bien des choses à vous dire, et je passerai la matinée à vous écrire. Je m’étois proposé, à la vérité, d’employer mes soirées à vous rendre compte des aventures du jour ; mais cet arrangement devient impossible : les divertissemens de cette capitale sont poussés si avant dans la nuit, que si je voulois m’occuper encore après le souper, il me faudroit renoncer entièrement au sommeil.
Nous avons passé hier une soirée des plus extraordinaires. Comme nous étions invitées à ce qu’on appelle ici un bal privé, je comptois n’y trouver qu’une douzaine de personnes : au lieu de cela, je suis tombée au milieu d’un demi-monde. Imaginez-vous deux grandes salles, remplies autant qu’elles pouvoient l’être ; dans l’une, on avoit dressé des tables à jeu pour les femmes mariées ; l’autre étoit pour la danse. Ma mère (car madame Mirvan me nomme toujours sa fille) nous dit qu’elle resteroit avec Marie et moi, jusqu’à ce que nous fussions pourvues de danseurs, et qu’ensuite elle iroit faire sa partie.
Les hommes passoient et repassoient devant nous, sembloient se dire qu’ils étoient sûrs de nous, comme si nous n’étions-là que pour attendre l’honneur, de leurs ordres. Ces messieurs se promenoient d’un air distrait et nonchalant, vraisemblablement pour nous tenir en suspens. Miss Mirvan et moi, nous ne fûmes pas les seules qui eûmes à nous plaindre ; aucune des femmes ne fut mieux traitée. J’étois piquée au point que je résolus de me passer de la danse, plutôt que de supporter de telles manières, et d’accepter le bras du premier venu qui daigneroit me l’offrir.
Un jeune homme qui nous avoit déjà fixées depuis quelque temps assez cavalièrement, s’avança vers moi sur la pointe des pieds : un petit souris de commande et un ajustement de fat, indiquoient assez qu’il cherchoit à s’attirer les yeux de l’assemblée, quelque laid qu’il fût d’ailleurs.
Il se prosterna jusqu’à terre, et en me présentant la main avec un geste infiniment étudié, il me dit d’un ton de voix fort niais : « Est-il permis, madame » ? Puis il se tut un moment, et se mit en devoir de prendre mon bras. Je le retirai, et j’eus de la peine à m’empêcher de lui rire au nez. « Vous voudrez bien, madame, continua-t-il en affectant de s’interrompre à tout moment, » m’accorder l’honneur et l’avantage, — si je n’ai pas le malheur d’arriver trop tard, — pour vous demander l’honneur et l’avantage ». — Et il voulut de nouveau s’emparer de ma main. Je baissai la tête, je le priai de m’excuser, et je me tournai vers miss Mirvan, car je riois tout de bon. Il me demanda alors si quelqu’un plus fortuné que lui l’avoit déjà devancé. Je lui répondis que non, et qu’apparemment je ne danserois pas du tout. Il me répliqua qu’il ne s’engageroit pas de son côté, dans l’espérance de me voir changer encore de résolution ; et, après avoir marmotté quelques propos ridicules, dans lesquels il mêla les mots de chagrin et de malheur, il se retira avec son air souriant qui ne l’avoit pas quitté un instant.
Pendant ce petit dialogue, miss Mirvan, comme nous nous le rappelâmes ensuite, s’étoit entretenue avec la dame du logis. Bientôt après un autre jeune homme, âgé d’environ vingt-six ans, mis avec élégance, quoique sans fatuité, et d’une très-belle figure, m’accosta d’un air poli et galant, et me pria de lui faire l’honneur de lui accorder mon bras, si je n’étois pas encore engagée. Je ne vis pas trop quel pouvoit être l’honneur qui lui en viendroit ; mais ces sortes de phrases sont de simples façons de parler, qu’on emploie indifféremment et sans distinction de personne.
Je fis la révérence, et suis sûre que je rougissois ; l’idée de danser en présence de tant de monde, et sur-tout avec un inconnu, me déconcerta : cependant la chose étoit inévitable ; car j’eus beau promener mes regards dans la salle, je n’y rencontrois personne qui ne fût étranger pour moi. Je donnai donc le bras à mon cavalier, et nous allâmes joindre les rangs.
Les menuets étoient finis avant que nous arrivassions ; nos marchands de modes n’avoient été prêts que fort tard.
Mon danseur témoigna une grande envie de lier conversation avec moi ; mais je fus tellement intimidée, que je pouvois à peine proférer une parole ; et si je n’avois pas été honteuse de changer d’avis à chaque instant, je serois retournée à ma chaise pour ne pas danser de toute la soirée.
Il fut surpris de mon embarras, qui n’étoit que trop visible. Je ne sais ce qu’il pensa de moi ; mais il ne me dit plus rien, et je ne pus pas prendre sur moi de lui avouer que mon trouble venoit de ce que je n’étois pas accoutumée à danser en grande société.
Sa conversation étoit pleine de bon sens et d’esprit, son air et son abord noble et aisé, ses manières douces, polies et engageantes, sa figure élégante, et sa physionomie la plus animée et la plus expressive que j’aie jamais vue.
Peu après, miss Mirvan prit sa place à côté de nous ; elle vint me dire à l’oreille que mon cavalier étoit un homme de condition. Cette découverte ne servit qu’à augmenter mon désordre. « Combien il aura de regret, me disois-je, d’avoir fait tomber son choix sur une petite campagnarde, sans usage du monde, qui craint à chaque pas de faire une incongruité » !
L’idée de me voir engagée avec un homme, à tous égards si fort au-dessus de moi, m’avoit déjà jetée dans la plus grande confusion, et vous pensez bien que je ne fus pas trop rassurée en entendant dire à une dame qui passa devant nous : « Voilà une danse des plus difficiles »
« Oh ! dans ce cas, dit Marie à son danseur, je vous demande la permission de ne pas en être, et d’attendre la suivante ».
« J’en ferai autant, ajoutai-je ; car également je ne m’en tirerois pas ».
Marie me répondit qu’il falloit en prévenir mon cavalier, qui s’étoit détourné pour parler à quelqu’un. Je n’eus pas le courage de lui adresser la parole, et nous nous glissâmes tous trois hors des rangs, pour nous asseoir au bout de la salle.
Malheureusement pour moi, miss Mirvan se laissa entraîner de nouveau dans la danse ; et au moment où elle se leva, elle s’écria : « Ma chère, je vois là-bas votre cavalier, le lord Orville, qui court la salle pour vous chercher ».
Je la suppliois de ne pas m’abandonner ; mais elle le devoit. J’étois plus mal à mon aise que jamais ; j’eusse donné tout au monde pour trouver madame Mirvan, et pour la prier de me justifier dans l’esprit du lord ; car que pouvois-je alléguer pour excuser mon impolitesse ? Il devoit me prendre pour une imbecille ou pour une folle. Quelqu’un qui connoît le monde et ses usages, ne peut se faire une idée du trouble dont j’étois agitée.
J’étois dans la plus grande confusion ; j’observois qu’il me cherchoit par-tout d’un air embarrassé : mais quand je vis à la fin qu’il s’avançoit vers l’endroit où j’étois, je pensai tomber à la renverse. Je ne me sentois pas en état de l’attendre ; car je ne savois que lui dire. Je me levai donc, et je me précipitai dans la salle du jeu, bien résolue de passer le reste de la soirée à côté de madame Mirvan, et de ne pas danser du tout. Mais avant que de la découvrir, mylord Orville me joignit.
Il s’informa si j’étois incommodée. Vous vous imaginez sans doute, monsieur, combien je fus déconcertée. Au lieu de répondre, je baissois sottement la tête, et je fixois mon éventail.
Il me demanda d’un ton grave et respectueux, s’il avoit eu le malheur de me déplaire.
« Non certes, répliquai-je ». Et pour changer de conversation et prévenir de nouvelles questions, je le priai de me dire s’il n’avoit pas vu la jeune dame avec laquelle j’avois parlé tantôt.
« Non : mais ordonnez-vous que j’aille la chercher» ?
« Point du tout ».
« Y a-t-il quelqu’autre à qui vous souhaiteriez de parler » ?
Je lui dis que non, avant que de savoir que je répondois.
« Aurai-je l’avantage de vous offrir quelques rafraîchissemens » ?
Je fis une inclination de tête sans le vouloir, et il partit comme un éclair.
Je commençois à me fâcher contre moi-même, et je me remis assez pour m’appercevoir de la ridicule figure que je faisois ; mais j’étois trop hors de moi pour penser ou pour agir convenablement.
Si le lord n’avoit été de retour dans un clin d’œil, je me serois peut-être échappée une seconde fois. Il m’apporta un verre de limonade. Dès que je l’eus pris, il me dit qu’il se flattoit que je lui accorderois l’honneur de ma main pour la danse qu’on venoit de commencer.
Le souvenir de la conduite puérile que j’avois tenue auparavant, fit renaître mes craintes plus que jamais. Je tremblois de danser devant tant de monde, et avec un homme de ce rang. Je crois qu’il remarqua mon embarras, car il me supplia de reprendre ma place, si la danse ne m’amusoit pas : je n’eus garde d’accepter la proposition, car je n’avois déjà fait que trop de sottises ; à peine cependant pouvois-je me soutenir sur mes jambes.
Préparée de la sorte, il est aisé de s’imaginer que je me tirai très-mal d’affaire. Je m’attendois à voir le lord outré de la mauvaise étoile qui l’avoit guidé dans son choix ; mais, à ma grande consolation, il parut assez content ; il m’avoit aidée et encouragée de son mieux. Ces gens du monde ont trop de présence d’esprit pour découvrir jamais leur trouble et leur mauvaise humeur, quand même ils en auroient le cœur navré : eussé-je été la première personne de l’assemblée, il n’auroit pu me traiter avec plus d’égards et de politesse.
Je ne parvins point à me remettre, pas même après la danse ; mon cavalier me présenta un siége, en me disant qu’il ne souffriroit point que je me fatiguasse par complaisance.
Avec un peu plus d’habileté, ou seulement avec un peu plus de courage, j’aurois pu lier une conversation très-intéressante. Je vis alors que la naissance du lord Orville étoit son moindre mérite, et qu’il se distinguoit bien plus par son esprit et ses manières. Rien de plus juste et de plus piquant que ses remarques sur l’ensemble de notre société. Je ne conçois pas comment je pus rester aussi indifférente ; mais je me rappelois toujours le misérable rôle que j’avois joué en présence d’un observateur si délicat ; et ce qui m’empêcha de goûter ses plaisanteries, c’est ce qui excita ma compassion pour d’autres. Cependant, je n’avois pas le courage ni de prendre leur défense, ni de railler à mon tour ; je me bornois à écouter dans un profond silence.
Voyant que cet entretien ne faisoit pas fortune, il se mit à parler des assemblées publiques, des concerts ; mais il ne tarda pas à s’appercevoir que je n’en avois aucune idée.
Enfin, il laissa tomber la conversation, avec une adresse infinie, sur les agrémens et les occupations de la campagne.
Pour le coup, je ne devois plus douter que son intention ne fût de me mettre à l’épreuve, et qu’il vouloit essayer s’il n’y avoit aucun moyen de me faire parler. Cette réflexion mit de nouveau mon esprit à la gène ; j’en demeurai aux monosyllabes, et encore tâchai-je de les éviter tant que je pouvois.
Mylord Orville continuoit à donner cours à sa belle humeur, et moi je tenois toujours la tête sottement baissée. Au moment que j’y pensois le moins, ce même fat qui m’avoit demandée précédemment, s’approcha avec un air d’importance ridicule ; et, après deux ou trois grandes révérences, il dit : « Je vous demande pardon, madame, — et à vous aussi, mylord, — de ce que j’interromps un entretien aussi agréable, — qui sans doute vous amuse davantage — que les offres que j’eus l’honneur de vous faire tantôt ; mais — »
Je partis, à ce mot, d’un grand éclat de rire : je rougis de ma sottise ; mais je ne pus m’en empêcher. Figurez-vous, d’un côté, ce petit-maître avec son air présomptueux ; une tabatière à la main ; de l’autre, la physionomie de mylord Orville, où se peignoit la plus extrême surprise, — et je vous demande s’il y avoit moyen de tenir son sérieux ?
Je riois pour la première fois, depuis que miss Mirvan m’avoit quittée, et pendant tout ce temps j’avois été plus disposée à pleurer qu’à rire. Mylord Orville me regarda avec attention : le petit-maître, dont j’ignore le nom, étoit furieux ; il me dit d’un air de suffisance : « Arrêtez, madame, je vous prie ; seulement un instant, je n’ai qu’un mot à vous dire. — M’est-il permis de savoir par quel accident j’ai été privé de l’honneur de danser avec vous » ?
« Par quel accident » ! repris-je très-étonnée.
« Oui, madame, sans contredit, et je prendrai la liberté de vous faire remarquer qu’il n’y a qu’un accident très-peu ordinaire qui puisse engager une demoiselle de votre âge à commettre une impolitesse ».
Une idée confuse me passa alors par la tête, que je pouvois avoir manqué à quelque usage reçu dans les grandes assemblées. Je me rappelois, en effet, d’avoir entendu autrefois, qu’après avoir refusé un cavalier, il n’en falloit plus accepter. Étourdie que j’étois ! je l’avois oublié. Je demeurois interdite ; et tandis que cette idée me poursuivoit, mylord Orville répondit avec chaleur : « Monsieur, cette dame n’est pas capable de mériter un tel reproche ».
Cet homme insupportable (car, en vérité, je suis très en colère contre lui) fit une profonde révérence ; et avec un souris grimacier des plus choquans, il répondit : « Mylord, loin de faire un reproche à madame, j’ai assez de discernement pour reconnoître le mérite supérieur qui vous a valu la préférence». Il fit une seconde révérence, et s’en alla.
Y eut-il jamais quelque chose d’aussi insolent ? Je mourois de honte. « Le fat » ! s’écria mylord Orville ; et moi, sans savoir ce que je faisois, je me levai de ma chaise fort à la hâte ; et en m’en allant, je disois : « Où donc peut être madame Mirvan ? on ne la voit plus ».
« Permettez, dit mylord, que j’aille » m’en informer ». Je repris ma chaise, n’osant lever les yeux. Que devait-il penser de moi, de toutes mes bévues, de cette préférence supposée ?
Il revint dans un moment, et me rapporta que madame Mirvan étoit au jeu ; mais qu’elle seroit charmée de me voir. J’y allai incessamment. Je pris le seul siége qui étoit vacant, et mylord Orville nous quitta, à ma grande satisfaction. Je racontai mes désastres à madame Mirvan : elle eut la bonté de se faire des reproches de ne m’avoir pas mieux instruite ; mais elle m’avoit crue au fait de ces petits usages. Quoi qu’il en soit, il est à croire que notre homme s’en tiendra à sa belle harangue, sans pousser, son ressentiment plus loin.
Mylord Orville ne fut pas long-temps absent. Il m’invita de retourner à la danse ; J’y consentis de la meilleure grace qu’il me fut possible. J’avois eu le temps de me remettre, et j’avois résolu de faire un effort pour réparer, s’il y avoit moyen, mes premières sottises ; et quoique je fusse déplacée avec un homme du rang et de la figure de mylord Orville, j’aurois desiré de ne pas lui faire honte, puisqu’il avoit eu le malheur de me choisir.
Il parla peu, et la danse fut bientôt finie ; je n’avois donc pas eu l’occasion de remplir mon intention. Je pensois d’abord que les peines inutiles qu’il avoit prises auparavant, pouvoient l’avoir dégoûté ; puis l’idée me vint que peut être il auroit appris qui j’étois. Nouveau trouble de ma part ; et, au lieu de faire parade de mon esprit, comme je me l’étois proposé, je retombai dans mon ancien état de stupidité. Ennuyée, honteuse et mortifiée, je demeurai tranquille, jusqu’à ce que nous nous retirâmes ; ce qui heureusement arriva bientôt. Lord Orville me fit l’honneur de me présenter la main pour me conduire au carrosse ; et, chemin faisant, il me remercia de l’honneur que je lui faisois. Oh, ces gens à la mode !
Que direz-vous, mon cher monsieur, de cette soirée ? n’est-elle pas, en effet, des plus extraordinaires ? Je n’ai pu vous épargner ces détails, qui sont tous fort neufs pour moi. Mais il est temps de finir. Je suis avec un attachement respectueux, &c.
Évelina.
LETTRE XII.
Suite de la précédente.
Mardi, 5 avril.
Cette fâcheuse soirée d’hier continue à m’intriguer encore. Je viens de recueillir de Marie, à force d’instances et de plaisanteries, un dialogue des plus curieux. Vous serez d’abord surpris de ma vanité : mais je vous prie, mon cher monsieur, d’écouter jusqu’au bout, sans vous impatienter.
Cette conversation doit avoir eu lieu pendant que j’étois avec madame Mirvan, dans la chambre à jeu. Marie étant occupée à prendre quelques rafraîchissemens, mylord Orville s’approcha du buffet dans le même dessein ; il ne la reconnut point, quoiqu’elle le remît tout de suite. Peu après, un jeune homme d’une physionomie éveillée, vint le trouver en grande hâte, et lui dit : « Eh bien ! mylord, qu’avez-vous fait de votre belle danseuse » ?
« Rien », répondît Orville en souriant et haussant les épaules.
« C’est, je vous jure, la plus belle créature que j’aie jamais vue ».
Mylord se mit à rire, et avec raison. « Oui, répliqua-t-il, elle est assez jolie, et surtout très-modeste ».
« Oh ! mylord, s’écria cet extravagant, c’est un ange » !
« Un ange qui ne dit mot ».
« Comment cela se peut-il, mylord, avec une physionomie aussi spirituelle et aussi expressive » !
« Une petite idiote », ajouta Orville en secouant la tête.
« Voilà qui va bien, sur ma foi », répliqua l’autre.
Dans le même instant, cet homme odieux qui venoit de me donner tant d’inquiétude, se mêla de la conversation ; et en s’adressant respectueusement à mylord Orville, il lui dit : « Je vous demande pardon, mylord, si, comme j’ai lieu de le craindre, j’ai réprimandé tantôt, avec trop de sévérité, la dame que vous honorez de votre protection. Mais, avec d’aussi mauvaises manières, vous m’avouerez qu’on peut pousser un homme à bout ».
« Mauvaises manières ! s’écria mon champion anonyme ; cela est impossible. Un minois comme celui-là, ne sauroit prendre un aussi vilain masque ».