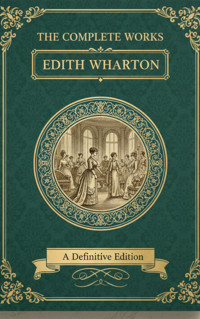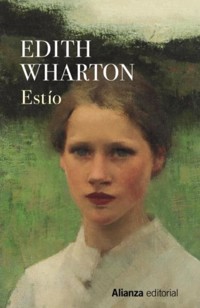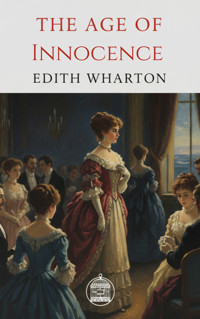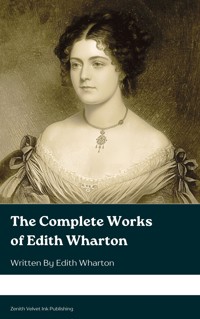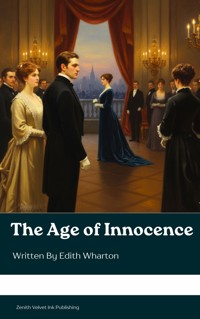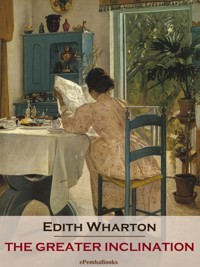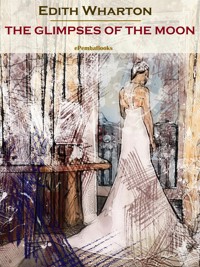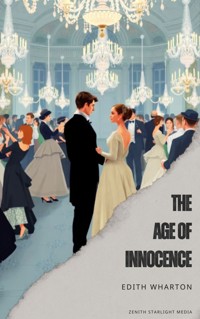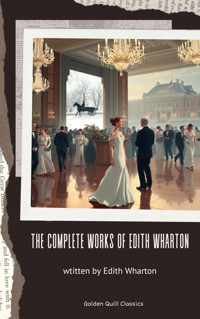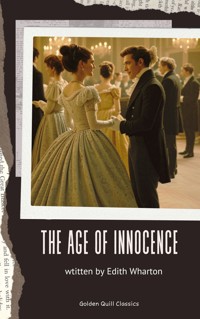1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Chez les heureux du monde (titre original : The House of Mirth) est une œuvre de la romancière américaine Edith Wharton, publiée en 1905. En France, il paraît pour la première fois en 1908
Présentation
Chez les heureux du monde suit les pérégrinations d'une jeune femme, Lili Bart, dans le milieu des nantis de New York au début du XXe siècle. En quête de mari, d'abord adulée, puis accusée par la rumeur, enfin rejetée, la jeune femme finit tragiquement, incapable de vivre hors de cette société et de ses artifices.
Extrait
| I
Selden s’arrêta surpris. Dans la bousculade de l’après-midi, à la Grande Station Centrale, ses yeux venaient de rencontrer le visage reposant de miss Lily Bart.
C’était un lundi, au début de septembre : le jeune avocat retournait à sa besogne après une rapide fugue à la campagne ; mais que pouvait faire miss Bart en ville, à cette époque de l’année ? Si elle avait eu l’air de prendre un train, il aurait pu en déduire qu’il l’avait surprise à son passage entre deux des maisons de campagne qui se disputaient sa présence après la fin de la saison de Newport ; mais son apparence indécise le rendait perplexe. Elle se tenait en dehors de la foule, qu’elle laissait s’écouler vers le quai ou vers la rue, avec une mine irrésolue qui — Selden le soupçonnait — pouvait masquer un projet très défini. Tout de suite il lui vint à l’esprit qu’elle attendait quelqu’un ; pourtant il ne se rendait pas bien compte pourquoi cette idée l’avait saisi. Il n’y avait rien de changé en Lily Bart ; mais quoi ! il ne la revoyait jamais sans un petit sursaut d’intérêt : elle avait le don de toujours susciter la réflexion ; ses actes les plus simples semblaient le résultat d’intentions qui allaient loin.
Un mouvement de curiosité le fit se détourner du chemin qui menait à la sortie ; il dépassa miss Bart en flânant. Il savait que si elle ne désirait pas être vue, elle trouverait moyen de l’éviter ; et la pensée de mettre son habileté à l’épreuve le divertissait.
— Monsieur Selden !… quel heureux hasard !
Elle vint au-devant de lui, souriante, presque empressée, résolue à l’arrêter ...|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
CHEZ LES HEUREUX DU MONDE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
EDITH WHARTON
CHEZ LES HEUREUX
DU MONDE
The House of Mirth
roman
Traduction Charles du Bos
Raanan Editeur
Livre 686 | édition 1
CHEZ LES HEUREUX DU MONDE
I
Selden s’arrêta surpris. Dans la bousculade de l’après-midi, à la Grande Station Centrale, ses yeux venaient de rencontrer le visage reposant de miss Lily Bart.
C’était un lundi, au début de septembre : le jeune avocat retournait à sa besogne après une rapide fugue à la campagne ; mais que pouvait faire miss Bart en ville, à cette époque de l’année ? Si elle avait eu l’air de prendre un train, il aurait pu en déduire qu’il l’avait surprise à son passage entre deux des maisons de campagne qui se disputaient sa présence après la fin de la saison de Newport ; mais son apparence indécise le rendait perplexe. Elle se tenait en dehors de la foule, qu’elle laissait s’écouler vers le quai ou vers la rue, avec une mine irrésolue qui — Selden le soupçonnait — pouvait masquer un projet très défini. Tout de suite il lui vint à l’esprit qu’elle attendait quelqu’un ; pourtant il ne se rendait pas bien compte pourquoi cette idée l’avait saisi. Il n’y avait rien de changé en Lily Bart ; mais quoi ! il ne la revoyait jamais sans un petit sursaut d’intérêt : elle avait le don de toujours susciter la réflexion ; ses actes les plus simples semblaient le résultat d’intentions qui allaient loin.
Un mouvement de curiosité le fit se détourner du chemin qui menait à la sortie ; il dépassa miss Bart en flânant. Il savait que si elle ne désirait pas être vue, elle trouverait moyen de l’éviter ; et la pensée de mettre son habileté à l’épreuve le divertissait.
— Monsieur Selden !… quel heureux hasard !
Elle vint au-devant de lui, souriante, presque empressée, résolue à l’arrêter. Une ou deux personnes, en les frôlant, s’attardèrent à regarder : car la tournure de miss Bart était capable de retenir même le voyageur de banlieue se précipitant vers son dernier train.
Selden ne l’avait jamais vue plus rayonnante. Sa tête animée, se détachant sur les tons obscurs de la foule, était plus en relief que dans une salle de bal : sous le chapeau sombre et le voile, elle retrouvait le teint de jeune fille, pur et lisse, qu’elle commençait à perdre après onze années de veilles et de danse ininterrompue… Y avait-il vraiment onze années, Selden en était à se le demander, et avait-elle vraiment atteint le vingt-neuvième jour de naissance que ses rivales lui prêtaient ?
— Quelle chance ! — reprit-elle. — Comme c’est gentil à vous de venir à mon secours !
Il répondit joyeusement qu’il n’avait pas été mis au monde pour autre chose, et lui demanda quel genre de secours il pouvait lui apporter.
— Oh ! tout ce que vous voudrez… jusqu’à vous asseoir sur un banc et bavarder avec moi… On « cause » bien un cotillon : pourquoi ne pas « causer » l’intervalle de deux trains ? Il ne fait pas plus chaud ici que dans les salons de Mrs. Van Osburgh… et les femmes n’y sont guère plus laides.
Elle s’interrompit en riant, expliqua qu’elle arrivait de Tuxedo, qu’elle allait chez les Gus Trenor, à Bellomont, et qu’elle avait manqué le train de trois heures quinze pour Rhinebeck.
— Et il n’y en a pas d’autre avant cinq heures et demie. (Elle consulta la petite montre en pierreries cachée dans ses dentelles.) Juste deux heures à attendre. Et je ne sais que devenir. Ma femme de chambre est arrivée ce matin pour faire des courses et devait partir à une heure pour Bellomont ; la maison de ma tante est fermée et je ne connais pas une âme en ville. (Elle jeta sur la gare un coup d’œil plaintif.) Après tout, il fait plus chaud que chez Mrs. Van Osburgh. Si vous avez du temps à perdre, emmenez-moi donc quelque part respirer un peu.
Il déclara qu’il était entièrement à sa disposition : l’aventure lui paraissait plaisante. Comme spectateur il avait toujours apprécié Lily Bart. Et son genre de vie le tenait si éloigné du cercle où elle se mouvait que cela l’amusait d’être entraîné pour un instant dans l’intimité subite que sa proposition impliquait.
— Allons-nous chez Sherry prendre une tasse de thé ?
Elle eut un sourire d’assentiment, puis elle fit une légère grimace :
— Tant de gens viennent en ville, le lundi !… on est sûr de rencontrer une quantité de raseurs… Je suis vieille comme les rues, c’est vrai, et cela ne devrait pas tirer à conséquence ; mais si, moi, je suis assez vieille, vous ne l’êtes pas, — objecta-t-elle gaiement. — Je meurs d’envie de prendre du thé… mais n’y a-t-il pas un endroit plus tranquille ?
Il lui rendit son sourire qui se posait sur lui allègrement. Ses réserves l’intéressaient presque autant que ses imprudences : il était si persuadé que les unes et les autres faisaient partie d’un même plan soigneusement élaboré ! En jugeant miss Bart, il avait toujours eu recours à l’argument des causes finales.
— Les ressources de New-York sont assez maigres ! dit-il. Mais je vais d’abord chercher un hansom, puis nous inventerons quelque chose.
Il la conduisit à travers la foule des petites gens de retour de congé ; ils dépassèrent des filles au teint blême, coiffées de chapeaux absurdes, et des femmes à poitrines plates qui se battaient avec des paquets et des éventails en feuille de palmier. Était-il possible qu’elle fût de la même race ? L’apparence terne et mal dégrossie de cette moyenne humanité féminine fit sentir à Selden quel haut échelon elle occupait dans l’échelle des êtres.
Une courte averse avait refroidi l’atmosphère, et la fraîcheur des nuages était encore suspendue sur la rue humide.
— C’est délicieux ! Marchons un peu, — dit-elle en sortant de la gare.
Ils tournèrent dans l’avenue Madison et flânèrent en se dirigeant vers le nord. Comme elle allait à ses côtés, d’un pas léger et allongé, Selden devint conscient du plaisir sensuel que lui donnaient son voisinage, le modelé de sa petite oreille, la sinueuse vague montante de ses cheveux — l’art ajoutait-il tant soit peu à leur éclat ? — et la ligne épaisse des cils noirs et droits. Tout en elle était à la fois vigoureux et exquis, à la fois fort et fin. Il avait l’intuition confuse qu’elle avait dû coûter beaucoup à créer, qu’un grand nombre d’êtres incolores et laids avaient de quelque mystérieuse façon été sacrifiés à la produire. Il n’ignorait pas que les qualités par où elle se distinguait de la masse de son sexe étaient surtout de surface : — comme si un émail rare et délicat avait été appliqué sur une argile commune… Et pourtant l’image ne le satisfaisait pas, car une substance grossière ne supporte pas un haut degré de fini : ne se pouvait-il faire que la matière fût précieuse, mais que les circonstances lui eussent donné une forme futile ?
Quant il en fut arrivé à ce point dans ses réflexions, le soleil reparut, et l’ombrelle ouverte vint contrarier son plaisir. Un moment après, miss Bart s’arrêta en soupirant.
— Ah ! Dieu, que j’ai chaud et que j’ai soif ! Quel endroit hideux que New-York ! (Elle parcourut d’un regard désespéré la chaussée lugubre.) D’autres villes revêtent leurs plus beaux habits en été, mais New-York a l’air assise en manches de chemise. (Ses yeux errèrent au fond d’une rue latérale.) Quelqu’un a eu la charité de planter quelques arbres de ce côté : allons à l’ombre.
— Je suis content que ma rue ait votre approbation ! — dit Selden quand ils eurent tourné le coin.
— Votre rue ?… Vous demeurez ici ?
Elle regarda avec intérêt le devant des maisons neuves, en brique et pierre à chaux, décorées de motifs fantasques pour obéir au goût américain de la nouveauté, mais fraîches et accueillantes avec leurs stores et leurs jardinières fleuries.
— Ah ! oui… c’est cela : le Benedick… Quelle charmante construction ! Je ne crois pas l’avoir encore vue. (Elle examinait la maison de rapport qui, de l’autre côté de la rue, élevait son porche de marbre et sa façade pseudo-xviiie siècle.) Quelles sont vos fenêtres ? Celles avec les stores baissés ?
— Au dernier étage, oui.
— Et ce gentil petit balcon est à vous ? Comme il doit faire frais là-haut !
Il hésita, un instant :
— Venez-y voir ! — suggéra-t-il. — Je puis vous donner une tasse de thé en un rien de temps… et vous ne rencontrerez pas de raseurs.
Son visage se colora, — elle n’avait pas encore perdu l’art de rougir au bon moment, — mais elle accepta la proposition aussi légèrement qu’elle était faite.
— Pourquoi pas ? C’est trop tentant… je cours le risque ! déclara-t-elle.
— Oh ! je ne suis pas dangereux, — fit-il sur le même ton.
À la vérité, elle ne lui avait jamais tant plu qu’en cette minute. Il savait qu’elle avait accepté sans arrière-pensée : il n’avait pas la prétention d’entrer en ligne de compte dans ses calculs ; il y avait pour lui une surprise bienfaisante, ou presque, dans la spontanéité de son consentement.
Sur le seuil, il s’arrêta, un instant, cherchant sa clef.
— Il n’y a personne ici, mais j’ai un domestique qui est censé venir le matin, et il se peut qu’il ait sorti ce qu’il faut pour le thé et qu’il se soit procuré quelque gâteau.
Il l’introduisit dans une antichambre étroite, ornée de vieilles gravures. Elle remarqua les lettres et les cartes entassées sur la table, parmi les gants et les cannes. Puis elle se trouva dans une petite bibliothèque, sombre mais riante, avec ses murs tapissés de livres, une carpette orientale, aux nuances agréablement passées, un bureau encombré, et, comme il l’avait prédit, un plateau à thé sur une table basse, auprès de la fenêtre… Une brise s’était levée, agitant les rideaux de mousseline ; elle apportait de la jardinière posée sur le balcon une fraîche senteur de réséda et de pétunia.
Lily se laissa choir avec un soupir dans un des fauteuils de cuir usé.
— Quel délice d’avoir un endroit comme cela tout à soi ! Quelle lamentable chose que d’être une femme !
Elle s’abandonnait à toutes les voluptés du spleen.
Selden farfouillait dans une armoire, à la recherche du gâteau.
— On trouve cependant des femmes, — dit-il, — qui ont adopté le régime privilégié du petit appartement.
— Oui, des gouvernantes… ou des veuves. Mais pas des jeunes filles… pas de pauvres misérables jeunes filles à marier !
— Moi, je connais même une jeune fille qui a un petit appartement.
Elle sursauta :
— Vrai ?
— Mais oui ! — répliqua-t-il, sortant de l’armoire avec le gâteau en question.
— Oh ! je sais… vous voulez dire Gerty Farish. (Elle eut un sourire peu bienveillant.) Mais j’ai dit : « à marier… » Et puis elle vit dans un horrible petit trou, elle n’a pas de femme de chambre, et elle mange des choses si étranges ! Sa cuisinière lave le linge, et la nourriture a le goût de savon… Je détesterais cela, vous savez.
— Vous ne devriez pas dîner avec elle les jours de blanchissage, — dit Selden, découpant le gâteau.
Et de rire, tous les deux. Il s’agenouilla près de la table et alluma la lampe sous la bouilloire, tandis qu’elle mettait dans la petite théière en faïence verte la dose de thé nécessaire. Il observait sa main, polie comme un morceau de vieil ivoire, avec ses ongles roses et frêles, et le bracelet de saphir qui lui glissait sur le poignet : il sentit combien il était ironique de lui suggérer, à elle, une vie comme celle que sa cousine, à lui, Gertrude Farish, avait choisie. Elle était si évidemment la victime de la civilisation qui l’avait produite que les anneaux de son bracelet avaient l’air de menottes l’enchaînant à son destin.
Elle parut lire sa pensée :
— C’est très vilain à moi d’avoir ainsi parlé de Gerty. — dit-elle avec une componction charmante. — J’ai oublié qu’elle était votre cousine. Mais, vous savez, nous sommes si différentes !… elle aime à être bonne, et moi, j’aime à être heureuse… Et puis, elle est libre et je ne le suis pas… Si je l’étais, je ne dis pas que je ne parviendrais pas à être heureuse même dans son petit appartement. Cela doit être une joie sans mélange que de disposer ses meubles selon son goût, et de donner toutes les horreurs au chiffonnier. Si je pouvais seulement refaire le salon de ma tante, je suis sûre que je serais une meilleure femme.
— Est-il vraiment si mal, ce salon ? — demanda Selden d’un ton compatissant.
Elle lui sourit par-dessus la théière, qu’elle tenait levée, prête à être remplie.
— Cela prouve que vous y venez rarement… Pourquoi ne venez-vous pas plus souvent ?
— Quand je viens, ce n’est pas pour regarder les meubles de Mrs. Peniston.
— Allons donc ! — fit-elle. — Vous ne venez jamais… et pourtant, quand nous nous rencontrons, nous nous entendons si bien !
— Peut-être, — s’empressa-t-il de riposter, — est-ce la raison. Je crains de ne pas avoir de crème… accepterez-vous une tranche de citron, à la place ?
— Je le préfère. (Elle attendit jusqu’à ce qu’il eût coupé le citron et qu’il en eût déposé une mince rondelle dans sa tasse.) Mais ce n’est pas la vraie raison, — insista-t-elle.
— La raison de quoi ?
— De ce que vous ne venez jamais. (Elle se pencha en avant, avec une ombre de perplexité dans ses yeux d’enchanteresse.) Je voudrais tant savoir, je voudrais tant vous comprendre !… Naturellement, je sais qu’il y a des hommes à qui je ne plais pas… cela se voit tout de suite. Et il y en a d’autres qui ont peur de moi : ils s’imaginent que je désire les épouser. (Elle lui sourit franchement.) Mais je ne crois pas vous déplaire… et vous ne pouvez pas vous imaginer que je désire vous épouser.
— Non… cela, je vous en absous !
— Eh bien, alors ?…
Il avait porté sa tasse près de la cheminée ; il se tenait appuyé au manteau, et regardait miss Bart avec un air de nonchalance amusée. La provocation qu’il y avait dans les yeux de la jeune fille accrut son amusement : il n’aurait pas supposé qu’elle gaspillerait sa poudre en l’honneur d’un si mince gibier, mais peut-être n’était-ce pour elle qu’un exercice d’entraînement ; peut-être aussi une personne de son espèce ne pouvait-elle parler d’autre chose que d’elle-même. En tout cas, elle était étonnamment jolie, il l’avait invitée à prendre le thé : il devait se montrer à la hauteur de la situation.
— Eh bien, alors, — hasarda-t-il, — peut-être est-ce là, justement, la raison.
— Quoi ?
— Le fait que vous ne désirez pas m’épouser… Peut-être ne vois-je pas là un si grand encouragement à vous rendre visite.
Il sentit un léger frisson dans le dos après avoir risqué cette phrase ; mais le rire de miss Bart le rassura.
— Cher monsieur Selden, voilà qui n’est pas digne de vous. C’est stupide à vous de me faire la cour, et cela ne vous ressemble pas d’être stupide.
Elle se pencha en arrière, buvant son thé à petites gorgées, d’un air si merveilleusement méditatif que, s’ils s’étaient trouvés dans le salon de sa tante, il aurait presque essayé de donner un démenti à son raisonnement.
— Ne voyez-vous pas, — continua-t-elle, — qu’il y a assez d’hommes pour me dire des choses agréables, et que ce qu’il me faudrait, c’est un ami qui n’aurait pas peur de m’en dire de désagréables quand j’en ai besoin ? J’ai songé parfois que vous pourriez être cet ami… je ne sais pas pourquoi, si ce n’est que vous n’êtes ni un fat ni un goujat, et qu’avec vous il ne me serait nécessaire ni de poser ni d’être sur mes gardes.
Sa voix était devenue sérieuse et, de son fauteuil, elle le dévisageait avec la gravité inquiète d’un enfant.
— Vous ne savez pas combien j’ai besoin d’un pareil ami, — dit-elle. — Ma tante possède bien une collection de maximes exemplaires, mais qui toutes correspondent aux mœurs d’il y a cinquante ans. Je sens toujours que les mettre en pratique supposerait que l’on porte de l’organdi et des manches à gigot. Quant aux autres femmes, mes meilleures amies… eh bien, elles se servent de moi ou elles me débinent ; mais tout ce qui peut m’arriver leur est bien indifférent. On m’a trop vue : les gens se fatiguent de moi ; ils commencent à dire que je devrais me marier.
Il y eut un moment de silence, durant lequel Selden prépara une ou deux répliques susceptibles d’ajouter une saveur momentanée à la situation ; mais il leur préféra cette simple phrase :
— Eh bien, pourquoi ne vous mariez-vous pas ?
Elle rougit et se mit à rire.
— Ah ! je vois qu’en fin de compte vous êtes un véritable ami : voilà précisément une des choses désagréables que je réclamais.
— Cela n’était pas dit avec l’intention d’être désagréable, — répliqua-t-il amicalement. — Le mariage n’est-il pas votre vocation ? n’est-ce pas pour cela qu’on vous élève toutes ?
Elle soupira :
— Je le suppose. Qu’y a-t-il d’autre ?
— En effet !… Et alors, pourquoi ne pas faire le plongeon et en finir ?
Elle haussa les épaules :
— Vous parlez comme si je devais épouser le premier homme qui se présentât.
— Je ne voulais pas dire que vous en fussiez là. Il doit exister quelqu’un avec les qualités requises.
Elle secoua la tête avec lassitude :
— J’ai repoussé une ou deux bonnes occasions, à mes débuts… J’ai idée que c’est le cas de toutes les jeunes filles… Et vous n’ignorez pas que je suis très pauvre, et horriblement dispendieuse. J’ai besoin de beaucoup d’argent.
Selden s’était retourné pour prendre sur la cheminée une boîte de cigarettes.
— Qu’est devenu Dillworth ? — demanda-t-il.
— Oh ! sa mère a pris peur… Elle craignait que je ne fisse remonter tous les bijoux de famille. Elle voulait que je promisse de ne pas toucher au salon.
— Et c’est pour cela même que vous vous mariez !
— En effet !… Aussi elle a expédié son fils aux Indes.
— Pas de chance !… Mais vous pouvez trouver mieux que Dillworth.
Il lui tendit la boîte : elle prit trois ou quatre cigarettes, en mit une entre ses lèvres et glissa les autres dans un petit étui d’or qui était attaché à sa longue chaîne de perles.
— Ai-je le temps ?… Une bouffée, alors.
Elle se pencha en avant et alluma sa cigarette à celle de Selden. Pendant ces quelques secondes, il observa, avec un plaisir tout impersonnel, combien également les cils noirs étaient plantés dans les paupières d’un blanc uni, et comme l’ombre mauve sous les yeux se perdait dans la pâleur mate de la joue.
Elle commença à errer à travers la chambre, examinant entre deux bouffées les rayons de la bibliothèque. Certains volumes avaient les tons mûrs du vieux maroquin et des fers choisis : elle les caressait voluptueusement du regard, non pas avec l’appréciation du connaisseur, mais avec la jouissance que lui procuraient les nuances et les surfaces harmonieuses, — un de ses modes de sensibilité les plus profonds. — Tout à coup son expression se modifia : la satisfaction d’un moment faisait place à des réflexions plus positives. Elle se tourna vers Selden et lui posa une question :
— Vous collectionnez, n’est-ce pas ?… vous vous y connaissez en premières éditions et autres choses ?
— Autant que le peut un homme qui n’a pas d’argent à dépenser. De temps en temps, j’attrape quelque chose en bouquinant, et j’assiste en spectateur aux ventes importantes.
Elle interrogeait de nouveau les rayons, mais ses yeux maintenant les parcouraient sans attention, et il vit qu’une nouvelle idée la préoccupait.
— Et les Americana[2]…, en faites-vous collection ?
Selden ouvrit de grands yeux et se mit à rire.
— Non, cela sort plutôt de mon domaine… Voyez-vous, je ne suis pas vraiment collectionneur : j’aime tout simplement à avoir de bonnes éditions des livres qui me sont chers.
Elle fit une légère grimace :
— Et les Americana sont horriblement ennuyeux, je suppose !
— Je le croirais volontiers… excepté pour les historiens. Mais le collectionneur-né estime un objet pour sa rareté. Je ne suppose pas que les acheteurs d’Americana passent la nuit à les lire… Le vieux Jefferson Gryce ne le faisait certainement pas.
Elle écoutait avec une attention vive.
— Et pourtant ils atteignent des prix fabuleux, n’est-ce pas ? Cela semble si bizarre de payer très cher un vilain livre, mal imprimé, qu’on ne lira jamais !… Et j’imagine que la plupart des possesseurs d’Americana ne sont pas non plus des historiens ?
— Non : très peu d’historiens sont en mesure de les acheter. Ils sont obligés d’avoir recours aux exemplaires des bibliothèques publiques ou des collections privées. Il semble bien que la rareté seule attire la moyenne des collectionneurs.
Il s’était assis sur un bras du fauteuil auprès duquel elle se tenait debout, et elle continuait à le questionner, lui demandant quels étaient les volumes les plus rares, si la collection Jefferson Gryce était réellement considérée comme la plus belle du monde, et quel était le plus gros prix qu’eût jamais atteint un volume isolé.
C’était si agréable d’être là, de la regarder tandis qu’elle prenait un livre, puis un autre, faisait voltiger les pages entre ses doigts, son profil penché se détachant sur le fond riche des vieilles reliures, qu’il continua de parler sans s’étonner de l’intérêt qu’elle manifestait subitement pour un sujet si peu suggestif. Mais il ne pouvait jamais rester longtemps avec elle sans chercher à découvrir un motif de ses actes, et, comme elle replaçait une première édition de La Bruyère et s’éloignait de la bibliothèque, il commença à se demander où elle voulait en venir.
La question qu’elle fit ensuite n’était pas de nature à l’éclairer. Elle s’arrêta devant lui avec un sourire qui semblait à la fois l’admettre en son intimité et lui rappeler les restrictions nécessaires.
— Est-ce que cela ne vous ennuie jamais, — demanda-t-elle soudain, — de ne pas être assez riche pour acheter tous les livres que vous voulez ?
Il suivait son regard qui faisait le tour de la pièce, du mobilier usé, des tentures passées.
— À qui le dites-vous !… Me prenez-vous pour un anachorète ?
— Et d’avoir à travailler… est-ce que cela vous ennuie ?
— Oh ! le travail en soi, n’a rien de fâcheux… J’aime assez le droit.
— Non… mais les attaches, la routine… est-ce que vous ne sentez jamais le désir de vous en aller, de voir des pays nouveaux, des gens nouveaux ?
— Si, terriblement… surtout au printemps quand je vois tous mes amis s’embarquer.
Elle eut un murmure de commisération.
— Mais cela vous ennuie-t-il assez… pour que le mariage vous paraisse une solution ?
Selden éclata de rire.
— À Dieu ne plaise ! — déclara-t-il.
Elle se leva en soupirant et jeta sa cigarette dans le foyer.
— Ah ! voilà la différence… une jeune fille y est forcée, un homme peut, si cela lui convient. (Elle l’examinait d’un œil critique.) Votre jaquette est un peu râpée… mais qui donc y prend garde ? Cela n’empêche pas les gens de vous inviter à dîner. Si, moi, j’avais une robe fanée, personne ne me voudrait : une femme est invitée autant pour sa toilette que pour elle-même. La toilette est le fond du tableau, le cadre, si vous voulez : elle ne détermine pas le succès, mais elle y contribue. Qui voudrait d’une femme pas élégante ? On attend de nous que nous soyons jolies et bien habillées jusqu’à la fin… et si nous ne pouvons y parvenir toute seule, il nous faut monter une association à deux.
Selden l’observait avec amusement : malgré la supplication de ses beaux yeux, il était impossible d’envisager au point de vue sentimental le cas de miss Bart.
— Eh bien, mais… il doit y avoir une masse de capitaux en quête d’un pareil placement. Peut-être votre destin vous attend-il ce soir chez les Trenor.
Elle répondit à son regard par une interrogation :
— Je pensais que vous iriez peut-être… oh ! pas à ce titre ! Mais il y aura un tas de vos amis… Gwen Van Osburgh, les Wetherall, lady Cressida Raith… et les George Dorset.
Elle s’était arrêtée, un instant, avant ce dernier nom ; elle lança entre ses cils un coup d’œil inquisiteur, mais il demeura imperturbable.
— Mrs. Trenor m’avait invité, mais je ne puis m’absenter avant la fin de la semaine, et ces grandes réunions m’assomment.
— Ah ! moi aussi, — s’écria-t-elle.
— Alors, pourquoi y allez-vous ?
— Cela fait partie du métier… l’oubliez-vous ? Et puis, si je n’y allais pas, il me faudrait faire le bésigue de ma tante, à Richfield Springs.
— Presque aussi ennuyeux que d’épouser Dillworth !
Et tous deux se mirent à rire de bon cœur, tout au plaisir de leur intimité soudaine.
Elle regarda la pendule :
— Mon Dieu ! il faut que je parte. Il est cinq heures passées.
Elle s’arrêta devant la cheminée, et s’examina dans la glace tandis qu’elle ajustait son voile. La pose mettait en valeur la ligne allongée de ses hanches fines, qui donnait une sorte de grâce sauvage à sa silhouette, — comme d’une dryade captive apprivoisée à la vie conventionnelle des salons ; et Selden songeait que c’était la même pointe de liberté sylvestre qui prêtait tant de saveur à tout ce qu’elle avait d’artificiel.
Il la suivit jusqu’à l’antichambre ; mais sur le seuil elle lui tendit la main en geste d’adieu.
— J’ai passé une heure charmante ; et maintenant vous serez obligé de me rendre ma visite.
— Mais ne voulez-vous pas que je vous accompagne à la gare ?
— Non, disons-nous au revoir ici, je vous prie.
Elle laissa sa main, un instant, dans celle de Selden et lui adressa un adorable sourire.
— Au revoir, alors… Et bonne chance, à Bellomont ! — dit-il en ouvrant la porte.
Elle s’arrêta, un moment, sur le palier et regarda tout autour d’elle. Il y avait mille à parier contre un qu’elle ne rencontrerait personne, mais on ne savait jamais, et elle expiait toujours ses rares inconséquences par un violent retour de prudence. Il n’y avait personne en vue toutefois, rien qu’une femme de ménage qui récurait l’escalier. Sa forte personne et les ustensiles qui l’environnaient occupaient tant de place que Lily, pour la dépasser, dut rassembler ses jupes et frôler le mur. Cependant la femme interrompit son ouvrage et leva les yeux avec curiosité, appuyant ses poings rougis sur le torchon mouillé qu’elle venait de tirer du seau. Elle avait un visage large et blafard, légèrement marqué de petite vérole et des cheveux clairsemés, couleur de paille, au travers desquels son crâne luisait désagréablement.
— Je vous demande pardon, — dit Lily, avec l’intention de marquer par sa politesse le sans-gêne de l’autre.
La femme, sans répondre, poussa le seau de côté et continua de fixer les yeux sur miss Bart qui passa dans un froufrou de dessous soyeux. Lily se sentit rougir sous ce regard. Que supposait cette créature ? Ne pouvait-on jamais faire la chose la plus simple, la plus innocente, sans s’exposer à quelque odieuse conjecture ? À mi-chemin de l’étage suivant, elle sourit de penser qu’une femme de ménage suffisait pour la démonter à ce point. La pauvre femme était probablement éblouie par une apparition si insolite… Mais de telles apparitions étaient-elles vraiment insolites dans l’escalier de Selden ?… Miss Bart ignorait le code moral qui régit les garçonnières, et de nouveau elle rougit en songeant que peut-être l’insistance de ce regard signifiait un éveil confus d’images antérieures. Mais elle écarta cette idée en souriant de ses propres craintes, et descendit rapidement, se demandant si elle trouverait un fiacre avant la Cinquième Avenue.
Elle s’arrêta de nouveau sous le porche xviiie siècle, explorant la rue : pas un hansom ! Mais, à peine sur le trottoir, elle se heurta à un petit homme reluisant, gardénia à la boutonnière, qui la salua et s’écria avec surprise :
— Miss Bart ? Eh bien… si je m’attendais !… Voilà une chance !
Et elle perçut entre ses paupières mi-closes une lueur de curiosité amusée.
— Oh ! monsieur Rosedale… comment allez-vous ?
Et, dans la familiarité soudaine du sourire qui parut sur la face de cet homme, elle vit le reflet de la contrariété que sa figure, à elle, n’avait pu celer.
M. Rosedale était là qui la dévisageait d’un œil approbateur. C’était un homme rondelet, au teint rose, le type du juif blond, avec d’élégants habits faits à Londres qui semblaient accrochés sur lui par un tapissier et de petits yeux obliques qui lui donnaient l’air d’estimer les gens comme s’il s’agissait de bric-à-brac. Il interrogea du regard le porche du Benedick.
— Venue en ville pour faire quelques courses, j’imagine ? — dit-il, sur un ton qui avait la privauté d’un contact.
Miss Bart recula légèrement, puis se lança dans des explications précipitées :
— Oui… Je suis venue voir ma couturière. Et je cours prendre le train pour aller chez les Trenor.
— Ah !… votre couturière, ah ! oui — fit-il d’une voix mielleuse. — Je ne savais pas qu’il y eût des couturières au Benedick.
— Au Benedick ? (Elle prit un air gentiment intrigué.) Est-ce le nom de ce bâtiment-là ?
— Oui, c’est son nom : je crois que c’est un vieux mot pour dire « célibataire », n’est-ce pas ? Il se trouve que je suis le propriétaire du bâtiment… voilà comment je le sais.
Son sourire se creusa, et il ajouta, de plus en plus à son aise :
— Mais laissez-moi vous conduire à la gare. Les Trenor sont à Bellomont, naturellement ? Vous avez tout juste le temps d’attraper le train de cinq heures quarante… La couturière vous a fait attendre, je suppose.
Lily se raidit sous la plaisanterie.
— Oh ! merci, — balbutia-t-elle.
Et, à ce moment, elle aperçut un hansom qui descendait l’avenue Madison : elle le héla d’un geste désespéré.
— Vous êtes trop aimable, mais je ne voudrais pour rien au monde vous déranger ! — dit-elle, tendant la main à M. Rosedale.
Et, sans prendre garde à ses protestations, elle sauta dans le véhicule sauveur et jeta, toute hors d’haleine, un ordre au cocher.
II
Dans le hansom, elle se renversa en soupirant.
Pourquoi faut-il qu’une jeune fille expie si chèrement la moindre infraction à la routine ? Pourquoi ne peut-on jamais faire une chose naturelle sans avoir à la dissimuler derrière tout un échafaudage d’artifices ? Elle avait cédé à l’impulsion du moment en allant chez Lawrence Selden, et il était si rare qu’elle pût s’offrir le luxe d’une impulsion ! Cette fois, en tout cas, cela pourrait lui coûter un peu plus que ses moyens ne le lui permettaient. Elle était vexée de voir que, malgré tant d’années d’application, elle avait gaffé deux fois en l’espace de cinq minutes. Cette stupide histoire de couturière était déjà assez malheureuse : — il aurait été si simple de dire à Rosedale qu’elle venait de prendre le thé chez Selden ! Il suffisait d’énoncer le fait pour le rendre inoffensif. Mais, après s’être laissé surprendre en flagrant délit de mensonge, il était doublement maladroit de rembarrer le témoin de sa déroute.
Si elle avait eu la présence d’esprit d’autoriser Rosedale à la conduire à la gare, elle eut sans doute par cette concession acheté son silence. Il tenait de sa race l’art d’apprécier exactement les valeurs, et le fait d’être vu arpentant le quai bondé, à cette heure de l’après-midi, en compagnie de miss Lily Bart lui représentait, pour parler sa langue, de l’argent comptant. Il n’ignorait naturellement pas que des invités de marque étaient attendus à Bellomont, et la possibilité de passer pour un des hôtes de Mrs. Trenor faisait sans aucun doute partie de ses calculs. M. Rosedale, dans son ascension mondaine, n’avait pas encore dépassé le point où il importe de produire des effets de ce genre.
Le pire était que Lily savait tout cela. Elle savait combien il aurait été facile de le désarmer sur place, et combien cela pouvait devenir difficile par la suite. M. Simon Rosedale était un homme qui faisait métier de tout connaître sur chacun ; sa manière, à lui, de témoigner qu’il était chez lui dans le monde consistait à étaler une indiscrète familiarité avec les habitudes de ceux qu’il désirait faire passer pour ses intimes. Lily était certaine qu’en moins de vingt-quatre heures l’histoire de sa visite à la couturière du Benedick circulerait parmi les relations de M. Rosedale. Malheureusement, elle l’avait toujours ou remis à sa place ou traité en quantité négligeable. À sa première apparition, — lorsque l’imprévoyant cousin de Lily, Jack Stepney, lui avait obtenu (en retour de services trop aisés à deviner) une carte d’invitation pour une de ces immenses « tueries » où les Van Osburgh conviaient toute leur liste, — Rosedale, avec le mélange de sensibilité artistique et de sagacité professionnelle qui caractérise sa race, avait aussitôt gravité autour de miss Bart. Elle comprenait ses motifs, car sa propre conduite était réglée par des calculs aussi subtils. Le dressage et l’expérience lui avaient enseigné à se montrer hospitalière aux nouveaux venus : ceux qui s’annonçaient le plus mal pouvaient devenir utiles, un jour ; sinon, il y avait toujours assez d’oubliettes où les engloutir. Mais une répugnance instinctive, triomphant de longues années de discipline mondaine, l’avait fait pousser M. Rosedale dans son oubliette sans l’avoir mis à l’épreuve. Il n’avait laissé derrière lui que le remous de gaîté que cette rapide exécution avait soulevé parmi ses amis, à elle ; et bien que, par la suite, il eût reparu en aval, ce n’étaient jamais que des apparitions à la surface, entre des plongeons prolongés.
Jusqu’à présent, Lily n’avait été troublée par aucun scrupule. Dans sa petite coterie, M. Rosedale avait été décrété « impossible », et Jack Stepney vertement tancé pour avoir voulu payer ses dettes en invitations à dîner. Même Mrs. Trenor, que son goût pour la variété avait entraînée à quelques expériences hasardeuses, résista aux efforts de Jack pour lui couler M. Rosedale comme nouveauté : elle déclara qu’il était le même petit juif qu’on leur avait servi une douzaine de fois, à sa connaissance, et que le monde avait toujours rejeté. Tant que Judy Trenor demeurait intraitable, il y avait peu d’espoir pour M. Rosedale de pénétrer au delà de ces limbes extérieurs qu’étaient les « tueries » Van Osburgh. Jack renonça à la lutte et dit en riant : « Vous verrez ! » Il resta bravement sur ses positions, et s’afficha dans les restaurants à la mode avec Rosedale, en compagnie de dames aux dehors brillants, mais de situation obscure, que l’on peut toujours se procurer pour ce genre de démonstrations. Mais la tentative, jusqu’à ce jour, était demeurée vaine, et comme, sans aucun doute, c’était Rosedale qui payait les dîners, ce fut son débiteur qui eut les rieurs avec lui.
M. Rosedale n’était donc pas jusqu’à présent un facteur à redouter, — à moins que l’on ne se mît en son pouvoir. Et c’était précisément ce que miss Bart avait fait. Son mensonge maladroit laissait voir à cet homme qu’elle avait quelque chose à cacher. Elle était certaine qu’il avait un compte à régler avec elle : quelque chose dans son sourire, à lui, disait qu’il n’avait pas oublié. Elle écarta cette image avec un petit frisson, mais elle ne put s’en défaire durant tout le trajet, jusqu’à la gare : l’image la harcelait encore sur le quai, avec une insistance digne de M. Rosedale lui-même.
Elle eut juste le temps de prendre sa place avant le départ du train ; après s’être installée dans un coin avec ce sens instinctif de « l’effet » qui ne l’abandonnait jamais, elle regarda tout autour d’elle, souhaitant d’apercevoir quelque autre invité des Trenor. Elle voulait s’évader d’elle-même, et la conversation était le seul moyen d’évasion qu’elle connût.
Elle fut récompensée de sa recherche par la découverte d’un jeune homme très blond à barbe rougeâtre et légère, qui, à l’autre bout du wagon, semblait se dissimuler derrière un journal déplié. L’œil de Lily brilla et un faible sourire détendit les lignes contractées de sa bouche. Elle n’ignorait pas que monsieur Percy Gryce devait aller à Bellomont, mais elle n’avait pas compté sur cette bonne fortune de l’avoir pour elle toute seule dans le train : du coup, toutes les pensées troublantes qui se rattachaient à M. Rosedale disparurent. Peut-être, après tout, la journée se terminerait-elle plus favorablement qu’elle n’avait commencé.
Lily se mit à couper les pages d’un roman, examinant paisiblement sa proie à travers ses cils baissés, tandis qu’elle organisait son plan d’attaque. Quelque chose dans l’attitude du jeune homme, son air volontairement absorbé lui disait qu’il la savait là : jamais personne n’avait été à ce point accaparé par un journal du soir ! Elle devina qu’il était trop timide pour venir à elle : c’était à elle d’imaginer quelque moyen d’approche qui ne semblât pas une avance de sa part. Cela l’amusait de songer que quelqu’un d’aussi riche que M. Percy Gryce pût être timide ; mais elle possédait des trésors d’indulgence pour des particularités de ce genre, et, d’ailleurs, ses desseins seraient peut-être mieux servis par cette timidité que par trop d’aplomb. Elle avait l’art de donner de l’assurance aux gens embarrassés, mais elle n’était pas aussi sûre de pouvoir embarrasser ceux qui ont de l’assurance.
Elle attendit que le train sortit du tunnel et poursuivît sa course, entre des talus misérables, à travers la banlieue du nord. Puis, quand il ralentit l’allure, près de Yonkers, elle quitta sa place et parcourut lentement le wagon. Comme elle passait à côté de M. Gryce, le train fit une embardée, et le jeune homme eut le sentiment qu’une petite main agrippait le dossier de son fauteuil. Il se leva en sursaut, et laissa voir un visage naïf qui semblait avoir été plongé dans un bain d’incarnat : jusqu’au roux de la barbe qui eut l’air de s’aviver.
Le wagon pencha de nouveau, jetant presque miss Bart dans ses bras. Elle raffermit en riant son équilibre et recula ; mais il était enveloppé dans le parfum que dégageait cette robe, et son épaule avait senti le fugitif contact.
— Oh ! monsieur Gryce, c’est vous ? Je suis désolée… J’étais à la recherche du conducteur pour obtenir du thé.
Elle lui tendit la main, pendant que le train reprenait sa course normale, et, debout dans le passage, ils échangèrent quelques paroles. « Oui… il allait à Bellomont. Il avait entendu dire qu’elle y serait… (À cet aveu, il rougit de nouveau…) — Et il comptait y rester une semaine ?… Oh ! parfait ! »
Mais alors un ou deux voyageurs en retard, montés à la station précédente, firent irruption dans le wagon, et Lily dut regagner sa place.
— La place à côté de moi est libre… venez donc ! — dit-elle par-dessus son épaule.
M. Gryce, on ne peut plus embarrassé, parvint à effectuer un changement qui le transporta, lui et ses sacs, à côté de miss Bart.
— Ah ! voici le conducteur ; peut-être y aura-t-il moyen d’avoir du thé.
Elle fit signe à l’employé, et, en un instant, avec l’aisance qui semblait accompagner l’accomplissement de tous ses vœux, une petite table avait été dressée entre les deux sièges, et elle avait aidé M. Gryce à caser dessous ses bagages encombrants.
Lorsqu’on eut apporté le thé, il contempla, silencieux et fasciné, ses mains qui voltigeaient au-dessus du plateau, si miraculeusement fines et frêles en regard de la porcelaine grossière et du pain de ménage. Il avait peine à concevoir que l’on pût s’acquitter avec cette nonchalante désinvolture de la tâche laborieuse de faire du thé en public, et dans un train qui a ce mouvement de lacet. Il n’aurait jamais osé s’en commander lui-même, crainte d’attirer l’attention de ses compagnons de voyage ; mais, s’abritant à l’ombre d’une pareille maîtrise, il dégusta le breuvage, noir comme de l’encre, avec une délicieuse sensation de griserie.
Lily, dont les lèvres gardaient encore l’arôme du thé de caravane bu chez Selden, n’avait guère envie de le noyer dans la drogue de wagon-restaurant qui semblait un tel nectar à son voisin ; mais, jugeant avec raison qu’un des charmes du thé réside dans le fait de le boire ensemble, elle se disposa à porter à son comble la satisfaction de M. Gryce en lui souriant par-dessus sa tasse levée.
— Est-ce bien comme cela ?… pas trop fort ? — demanda-t-elle avec sollicitude.
Et il répliqua, d’un ton convaincu, qu’il n’avait jamais bu de meilleur thé.
« Ce doit être vrai », — réfléchit-elle.
Et son imagination prit feu à l’idée que M. Gryce, qui aurait pu sonder avec complaisance les abîmes de l’égoïsme le plus raffiné, faisait peut-être son premier voyage en tête à tête avec une jolie femme.
Il lui parut providentiel d’avoir été choisie, elle, comme agent de son initiation. Certaines jeunes filles n’auraient pas su comment le manœuvrer. Elles auraient trop marqué la nouveauté de l’aventure, dans l’espoir qu’il y ressentît le piquant d’une escapade. Mais les méthodes de Lily étaient plus délicates. Elle se rappelait que son cousin Jack Stepney avait un jour défini M. Gryce « le jeune homme qui a promis à sa mère de ne jamais sortir, par la pluie, sans ses galoches » ; et, se conformant à cette indication, elle décida de donner à la scène une allure gentiment familiale, dans l’espoir que son compagnon, au lieu de sentir qu’il faisait quelque chose de téméraire et d’insolite, serait simplement amené à méditer sur l’avantage d’avoir toujours une compagne pour faire le thé en chemin de fer.
Mais, en dépit de ses efforts, la conversation languit après que le plateau eut été enlevé, et Lily fut contrainte de vérifier encore les bornes de M. Gryce. Ce n’était pas, somme toute, l’occasion, mais l’imagination qui lui faisait défaut : il avait, intellectuellement, un palais qui n’apprendrait jamais à faire la distinction entre le nectar et le thé des wagons-restaurants. Il existait toutefois un sujet auquel elle pouvait se fier, un ressort qu’il lui suffirait de presser pour mettre en mouvement son mécanisme rudimentaire. Elle s’était abstenue d’y toucher parce que c’était sa dernière ressource, et elle s’était fiée à d’autres artifices pour exciter d’autres sensations ; mais, comme un air d’ennui bien établi commençait de gagner les traits ingénus du jeune homme, elle vit que les mesures extrêmes étaient nécessaires.
— Et où en êtes-vous, — dit-elle, se penchant en avant, — avec vos Americana ?
L’œil de M. Gryce devint tant soit peu moins opaque, — comme si l’on venait de retirer une taie en voie de formation, et Lily connut tout l’orgueil d’un habile opérateur.
— J’ai quelques petites choses nouvelles, — dit-il, tout pénétré de plaisir, mais en baissant la voix comme s’il redoutait que ses compagnons de voyage n’eussent comploté pour le dépouiller.
Elle l’interrogea de nouveau avec sympathie, et peu à peu il fut conduit à parler de ses dernières acquisitions. C’était l’unique sujet qui lui permît de s’oublier, ou, plutôt, de se souvenir de lui-même sans contrainte : il y était chez lui, et pouvait affirmer une supériorité que peu de gens étaient en état de lui disputer. Presque personne parmi ses accointances ne se souciait des Americana, presque personne ne s’y connaissait le moins du monde ; et le sentiment de cette ignorance faisait agréablement ressortir le savoir de M. Gryce. La seule difficulté était d’introduire le sujet, puis de le maintenir sur le tapis : la plupart ne manifestaient aucun désir d’être instruits, et M. Gryce avait l’air d’un marchand dont les magasins sont bourrés de denrées invendables.
Mais miss Bart, apparemment, voulait être éclairée sur les Americana ; et, qui plus est, elle était déjà assez au courant pour rendre la tâche d’une plus complète éducation aussi aisée qu’elle était agréable. Elle l’interrogeait avec intelligence, et l’écoutait avec soumission ; et lui, guettant l’air de lassitude qui d’ordinaire envahissait le visage de ses auditeurs, devint éloquent sous la réceptivité de ce regard. Les points de repère qu’elle avait eu la présence d’esprit de glaner chez Selden, en prévision même de cette éventualité, servaient si avantageusement ses desseins qu’elle commença à penser que cette visite avait été le plus heureux incident de la journée. Elle avait montré une fois de plus son talent de mettre à profit l’imprévu, et des théories dangereuses sur l’opportunité qu’il peut y avoir à céder à son impulsion germaient sous la surface d’attention souriante qu’elle continuait d’offrir à son compagnon.
Les sensations de M. Gryce, bien que moins définies, étaient également agréables. Il éprouvait la titillation confuse par laquelle les organismes d’espèce inférieure accueillent la satisfaction de leurs besoins ; tous ses sens nageaient dans un vague bien-être, à travers quoi la personne de miss Bart transparaissait un peu floue, mais charmante.
L’intérêt de M. Gryce pour les Americana n’avait point pris naissance avec lui : il était impossible de se le figurer développant un goût qui lui fût propre. Un oncle lui avait légué une collection déjà célèbre parmi les bibliophiles : l’existence de cette collection était le seul fait qui eût jamais répandu quelque gloire sur le nom de Gryce, et le neveu était aussi fier de cet héritage que si la chose était son œuvre à lui. Il en arriva, petit à petit, à réellement la considérer comme telle et à éprouver un sentiment de satisfaction personnelle toutes les fois qu’il tombait sur quelque référence aux Americana de la collection Gryce. Tout désireux qu’il était de ne pas attirer l’attention sur lui-même, il goûtait à voir son nom imprimé un plaisir si exquis et si excessif qu’il semblait compenser son aversion de la publicité.
Pour jouir de cette sensation le plus souvent possible, il souscrivait à toutes les revues de bibliophilie en général, et d’histoire américaine en particulier, et, comme les allusions à sa bibliothèque abondaient dans les pages de ces périodiques, qui constituaient son unique lecture, il en vint à se regarder comme occupant une place éminente aux yeux du public, et à se représenter avec plaisir l’intérêt qui serait éveillé si les gens qu’il rencontrait dans la rue ou en chemin de fer apprenaient soudain qu’il était le possesseur de la collection Gryce.
La plupart des timidités ont de semblables compensations secrètes, et miss Bart était assez perspicace pour savoir que la vanité intime est généralement en proportion de l’humilité extérieure. Avec une personne de mine plus assurée elle n’aurait pas osé s’attarder si longtemps sur un même sujet, ni tant exagérer l’intérêt qu’elle y prenait ; mais elle avait deviné sagement que l’égoïsme de M. Gryce était un sol assoiffé, réclamant sans cesse des aliments du dehors. Miss Bart avait le don de suivre le courant profond de ses pensées, tout en ayant l’air de voguer à la surface de la conversation, et, dans cette circonstance, son excursion mentale fut un coup d’œil jeté sur l’avenir de M. Gryce en tant qu’associé au sien.
Les Gryce étaient d’Albany, et nouveaux venus dans la Métropole ; la mère et le fils s’y étaient rendus après la mort du vieux Jefferson Gryce, pour prendre possession de sa maison de l’avenue Madison : une lugubre demeure, faite de pierre brune au dehors et de sombre noyer au dedans, avec la bibliothèque Gryce dans une annexe à l’épreuve du feu, qui ressemblait à un mausolée. Lily, du reste, savait tout ce qu’il y avait à savoir d’eux : l’arrivée du jeune M. Gryce avait fait tressaillir les seins des mères, à New-York, et, lorsqu’une jeune fille n’a plus de mère pour palpiter, à son sujet, force lui est bien d’être elle-même sur le qui-vive. C’est pourquoi non seulement Lily s’était arrangée pour se trouver sur le chemin du jeune homme, mais elle avait fait la connaissance de madame Gryce, une femme monumentale, avec l’organe d’un prédicateur et un esprit tourmenté par les iniquités de ses domestiques : elle venait quelquefois bavarder avec Mrs. Peniston et apprendre de cette dame comment elle parvenait à empêcher la fille de cuisine de faire sortir des provisions d’épicerie en contrebande. Mrs. Gryce avait une sorte de bienveillance impersonnelle : les cas de besoin individuel, elle les regardait d’un œil soupçonneux, mais elle souscrivait aux Œuvres dont les bulletins annuels proclamaient un majestueux excédent. Ses devoirs de maîtresse de maison étaient multiples et divers, — depuis les visites furtives aux chambres des domestiques jusqu’aux descentes inopinées à la cave ; — mais elle ne s’était jamais permis beaucoup de distractions. Une fois pourtant elle avait fait imprimer en rouge une édition spéciale du Sarum Rule[3] et en avait offert un exemplaire à tous les pasteurs du diocèse ; et l’album doré sur tranche dans lequel étaient collées leurs lettres de remerciements constituait le principal ornement de la table de son salon.
Percy avait été élevé selon les principes qu’une si excellente femme devait infailliblement inculquer. Toutes les variétés de la prudence et du soupçon avaient été greffées sur une nature d’elle-même hésitante et circonspecte, avec ce résultat que Mrs. Gryce n’aurait même pas eu besoin de lui imposer le serment des galoches, tant il était peu vraisemblable que Percy se risquât dehors par la pluie. Après avoir atteint sa majorité, mis en possession de la fortune que feu M. Gryce avait faite grâce à un système breveté pour exclure l’air frais des hôtels, le jeune homme continua de vivre avec sa mère à Albany : mais, à la mort de Jefferson Gryce, lorsque ces nouveaux biens, qui n’étaient pas médiocres, tombèrent dans les mains de son fils. Mrs. Gryce considéra que ce qu’elle appelait les « intérêts » du jeune homme exigeait sa présence à New-York. En conséquence, elle s’installa dans la maison de l’avenue Madison, et Percy, chez qui le sentiment du devoir n’était pas moindre que chez sa mère, passa tous ses jours de semaine dans le magnifique bureau de Broad Street, où une fournée d’hommes pâles et mal rétribués avaient blanchi dans l’administration de l’empire des Gryce, et où Percy fut initié avec tout le respect convenable aux moindres détails de l’art d’accumuler.
Autant que Lily avait pu le savoir, telle avait été jusqu’à présent l’unique occupation de M. Gryce : elle était excusable de ne pas regarder comme une tâche supérieure à ses forces l’entreprise d’intéresser un jeune homme soumis à un régime si débilitant. En tout cas, elle se sentait si complètement maîtresse de la situation qu’elle s’abandonna à une sécurité où toute crainte de M. Rosedale et des difficultés auxquelles se rattachait cette crainte s’évanouit et disparut de sa conscience.
L’arrêt du train à Garrisons ne l’aurait point divertie de ces pensées, si elle n’avait surpris un soudain regard de détresse dans l’œil de son compagnon. La place de M. Gryce était vis-à-vis de la porte, et Lily devina qu’il avait été troublé par l’approche d’une personne de connaissance : intuition corroborée par les têtes qui se retournaient et par la sensation d’émoi général que sa propre entrée dans un wagon était apte à produire.
Elle reconnut aussitôt les symptômes et ne fut pas surprise de s’entendre héler par la voix perçante d’une jolie femme qui montait dans le train, accompagnée d’une femme de chambre, d’un bull-terrier, et d’un valet de pied chancelant sous le poids des sacs et des nécessaires.
— Oh ! Lily… vous allez à Bellomont ? Alors vous ne pouvez pas me céder votre place, j’imagine ? Mais il me faut une place dans ce wagon… Conducteur, il faut que vous m’en trouviez une, tout de suite… Est-ce qu’on ne peut pas déplacer quelqu’un ? Je veux être avec mes amis… Oh ! bonjour, monsieur Gryce ! Je vous en prie, faites-lui comprendre qu’il me faut une place près de Lily et de vous.
Mrs. George Dorset, sans prendre garde aux efforts bénévoles d’un voyageur à valise de tapisserie qui faisait de son mieux pour lui céder la place en descendant du train, se tenait debout au milieu du passage, diffusant autour d’elle ce sentiment d’exaspération générale que crée assez souvent une jolie femme en voyage.
Elle était plus petite et plus mince que Lily Bart, avec une flexibilité agitée, — comme si elle avait pu se contracter et passer à travers une bague, pareille aux draperies sinueuses dont elle aimait à se parer. — Sa petite figure pâle semblait n’être que la monture de deux yeux sombres et agrandis, dont le regard visionnaire contrastait curieusement avec son ton et ses gestes très décidés, — en sorte que, selon la remarque d’un de ses amis, elle avait l’air d’un esprit désincarné qui occuperait beaucoup d’espace.
Ayant finalement découvert que la place à côté de miss Bart était disponible, elle s’en empara en dérangeant encore plusieurs personnes ; elle expliqua, ce faisant, qu’elle était arrivée de Mount Kisco, en auto, le matin même, et qu’elle venait de faire le pied de grue pendant une heure à Garrisons, sans même la consolation d’une cigarette, sa brute de mari ayant oublié de lui remplir son étui avant le départ.
— Et, à cette heure-ci, je ne pense pas qu’il vous en reste une seule, n’est-ce pas, Lily ? — acheva-t-elle d’une voix plaintive.
Miss Bart intercepta le regard étonné de M. Percy Gryce dont le tabac ne souillait jamais les lèvres.
— Quelle question absurde, Bertha ! — s’écria-t-elle, rougissant au souvenir de la provision de cigarettes qu’elle avait faite chez Lawrence Selden.
— Quoi ! vous ne fumez pas ? Depuis quand avez-vous renoncé ?… Quoi ! vous n’avez jamais ?… Et vous non plus, monsieur Gryce ? Ah ! naturellement… que je suis bête !… je comprends.
Et Mrs. Dorset se renversa contre ses coussins de voyage, avec un sourire qui fit regretter à Lily qu’il se fût trouvé un siège vacant auprès du sien.
III
Le bridge, à Bellomont, durait, d’habitude jusqu’à une heure avancée de la nuit, et, quand Lily remonta se coucher, elle avait joué trop longtemps pour son bien.
Ne se sentant aucun appétit pour les réflexions qui l’attendaient dans la solitude de sa chambre, elle s’attarda sur le vaste palier, plongeant les yeux dans le hall, où les derniers joueurs formaient un groupe autour du plateau chargé de longs verres et de carafes au col d’argent que le maître d’hôtel venait de poser sur une table basse, auprès du feu.
Le hall était à arcades, avec une galerie que supportaient des colonnes de marbre jaune pâle. Aux angles des murs, de hauts massifs de plantes en fleur se détachaient sur un fond de feuillage sombre. Sur le tapis cramoisi, un limier et deux ou trois épagneuls sommeillaient voluptueusement devant le foyer ; la lumière qui tombait de la grande lanterne centrale lustrait les chevelures des femmes, et, au moindre mouvement, faisait jaillir des étincelles de leurs bijoux.
Il y avait des moments où des scènes de ce genre ravissaient Lily, où elles satisfaisaient son sens de la beauté, son aspiration vers une vie extérieurement parfaite ; il y en avait d’autres où elles donnaient une arête trop vive à la maigreur des occasions qui s’offraient à elle. À ce moment-là, le sentiment du contraste prédominait, et elle tourna impatiemment la tête à la vue de Mrs. George Dorset qui, scintillante et serpentine en ses paillettes, entraînait Percy Gryce dans son sillage vers un recoin intime, sous la galerie.
Ce n’était pas que miss Bart redoutât de perdre l’ascendant qu’elle venait d’acquérir sur M. Gryce. Mrs. Dorset pouvait bien le troubler ou l’éblouir, mais elle n’avait ni l’habileté ni la patience nécessaires à le capturer. Elle était trop occupée d’elle-même pour pénétrer les arcanes de sa timidité, et, d’ailleurs, pourquoi voudrait-elle s’en donner la peine ? Tout au plus, cela pourrait-il l’amuser, pour un soir, de se jouer de sa simplicité ; — après quoi, il lui serait à charge, et, sachant cela, elle avait bien trop d’expérience pour l’encourager. Mais la seule idée de cette femme qui pouvait à volonté adopter un homme, puis le rejeter, sans avoir à le considérer comme un facteur possible dans ses plans, remplissait Lily Bart d’envie. Percy Gryce l’avait rasée toute l’après-midi, — rien que d’y songer semblait réveiller un écho de sa voix monotone, — et pourtant elle ne pouvait l’ignorer le lendemain, il lui fallait poursuivre son succès, se soumettre à plus d’ennui encore, être prête à de nouvelles complaisances, à de nouvelles souplesses, et tout cela dans l’unique espoir que finalement il se déciderait peut-être à lui faire l’honneur de la raser à vie.
C’était un destin haïssable, — mais comment s’y soustraire ? Quel choix avait-elle ? Il lui fallait être ou elle-même ou une Gerty Farish. Lorsqu’elle entra dans sa chambre, aux lumières délicatement tamisées, son peignoir de dentelles étendu sur le couvre-pied de soie, ses petites mules brodées devant le feu, un vase d’œillets embaumant l’atmosphère, et les derniers romans et magazines, non coupés, déposés sur la table auprès de la lampe, elle eut la vision de l’étroit appartement de miss Farish, avec son confort à bon marché et son hideux papier sur les murs. Non ! elle n’était pas faite pour un décor piètre et mesquin, pour les sordides compromis de la pauvreté. Tout son être se dilatait dans une atmosphère de luxe : c’était le milieu dont elle avait besoin, le seul climat où elle put respirer. Mais le luxe des autres ne lui suffisait pas. Il y a quelques années, elle s’en était contentée : elle avait accepté sa part journalière de plaisir, sans s’inquiéter des pourvoyeurs. Maintenant elle commençait à s’irriter contre les obligations qui lui étaient imposées en retour, à se sentir simplement pensionnée par l’opulence qui avait semblé autrefois lui appartenir. Il y avait même des moments où elle avait conscience de devoir payer son écot.
Longtemps elle avait refusé de jouer au bridge. Elle savait qu’elle n’en avait pas les moyens, et elle redoutait d’acquérir un goût si dispendieux. Elle avait vu la démonstration du