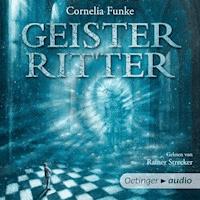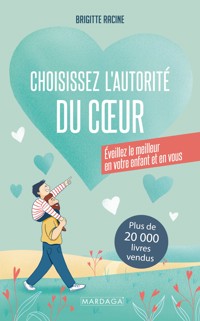
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mardaga
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
L’autorité est un défi au quotidien. Difficile de trouver un bon équilibre entre se faire obéir et maintenir une relation agréable avec son enfant. Ce livre vous apprend comment faire ! L’autrice y partage les outils et les stratégies de la méthode Éducoeur qu’elle développe depuis 20 ans pour les familles qui la consultent.
L’objectif d’Éducœur est simple : instaurer respect et confiance dans les liens parents-enfants et favoriser une relation où chacun se sent bien et grandit. Les enfants deviennent plus responsables et libres tandis que les adultes s’épanouissent pleinement dans leur rôle de parents.
Découvrez une démarche en 5 étapes pour intervenir avec cœur dans toutes les situations du quotidien – repas, devoirs, coucher, hygiène, tâches domestiques.
Brigitte Racine vous offre des techniques faciles à mettre en place pour gérer ces moments qui peuvent facilement tourner au conflit entre vous et vos enfants. Elle vous donne également les clés pour contrôler leurs comportements problématiques tout en préservant une relation d’amour et de respect. À l’aide de nombreux exemples, elle livre des solutions concrètes à des problèmes que chaque parent ou éducateur peut rencontrer.
À PROPOS DE L'AUTRICE
Brigitte Racine est infirmière et psychothérapeute familiale au Québec. Elle travaille auprès de familles depuis plus de 20 ans et a fondé l’organisme Éducœur, spécialisé en gestion relationnelle, pour lequel elle anime des conférences et des ateliers sur l’éducation et la discipline. Elle a écrit "Le respect, une valeur pour la vie". "Éducation en petite enfance" (Éd. CHU Sainte-Justine) et" Éduquer un jeu d'enfant "(Mardaga).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes fils Pierre-Olivier et Jean-Gabriel qui m’ont permis de goûter à une seconde enfance tout en m’enseignant à devenir leur mère.
Avec toute ma tendresse, je vous dis merci d’être dans ma vie, d’être devenus des adultes épanouis qui me donnent autant et dont je suis si fière.
Introduction
Lorsque j’interroge un auditoire de parents à propos de leurs motivations à assister à une conférence sur l’autorité et la discipline, les réponses que je reçois sont multiples. Les uns répondent souhaiter vivre en harmonie avec leur enfant et ressentir du plaisir en sa présence. D’autres cherchent à valider leurs compétences parentales tout en guidant adéquatement leur enfant afin qu’il devienne un adulte accompli. Cesser de répéter, redonner une place de choix au bonheur qui a disparu de la maison, imposer avec doigté des limites à un enfant qui passe le plus clair de son temps à l’ordinateur ou apprendre à exprimer sa colère et son irritation à l’égard de son enfant sans lui causer de tort sont autant de raisons qui sont également évoquées à chaque rencontre.
Avant d’être parent, n’aviez-vous pas un idéal de la vie de famille à l’esprit ? Qui rêvait de répéter sans cesse des consignes à son enfant, de laisser planer des menaces de privation, d’élever régulièrement la voix ou d’interdire une activité à laquelle il tient vraiment ? Quel parent termine sa journée en se félicitant d’avoir puni son enfant une multitude de fois ? Qui se lève le matin avec la ferme intention d’être désagréable avec son enfant et de se mettre en colère contre lui ? Personne, du moins je le crois. Cependant, plusieurs d’entre nous ont tout de même recours à ces moyens pour asseoir leur autorité. S’agirait-il ici d’un manque de moyens plutôt que d’un manque d’amour pour les enfants ? Est-il possible qu’on ne sache pas agir autrement ? Poser la question, c’est pratiquement y répondre.
Chacun fait de son mieux avec les connaissances qu’il a acquises ou alors agit comme ses parents ont agi envers lui, transmettant ainsi un lourd héritage. D’autres sont paralysés par la peur de se tromper ou de traumatiser leur enfant. À force de répéter et d’élever la voix, de nombreuses mères m’ont avoué quitter la maison pour le travail vidées de toute leur énergie. Des pères m’ont aussi confié leur désarroi en se voyant intervenir aussi durement que leur propre père : « Je m’étais promis de ne jamais lui ressembler. Je crains maintenant que mes enfants souffrent de cette discipline rigide comme j’en ai moi-même souffert. »
En chacun de nous, il y a un bon parent qui, parfois, manque de moyens pour assumer son autorité de façon bienveillante. Or, seul un adulte aimant peut éveiller le meilleur d’un enfant et l’amener à réaliser son plein potentiel. Et bien qu’important, l’amour parental s’avère insuffisant. Vous avez beau aimer votre enfant, encore faut-il qu’il se laisse toucher par cet amour, le ressente et le reçoive. Il acceptera alors que vous le guidiez et le dirigiez. Votre enfant se sent-il spécial, important, considéré ? A-t-il une place de choix dans votre vie ou lui accordez-vous le temps qu’il vous reste, lorsqu’il en reste ?
L’approche « Éducœur », telle que présentée dans ce livre, se veut une synthèse de ce que j’ai lu, vu, entendu, expérimenté avec mes propres enfants et proposé à une multitude de parents, d’enseignants et d’éducateurs depuis plus de 10 ans. Les pistes de réflexion et les solutions présentées permettent d’atteindre un niveau inégalé de compétence parentale. Vous y découvrirez des moyens concrets, efficaces et d’une grande simplicité.
Le temps et l’énergie que vous consacrerez à la pratique des exercices proposés vous permettront d’affirmer votre autorité de façon à vous rapprocher de votre enfant et d’accéder à une belle qualité de vie familiale. Cette démarche vous fera vivre l’expérience la plus riche et la plus passionnante qui soit : celle de vous « élever » avec votre enfant.
Première partie
Chapitre 1Élever un enfant
L’autorité, d’hier à aujourd’hui
« Comment agir envers mon fils qui refuse de prendre sa douche ? Interdire à notre fille l’utilisation de l’ordinateur pendant une semaine est-il un moyen efficace pour l’inciter à nous respecter davantage ? Comment m’y prendre pour diminuer les conflits entre mes enfants ? Quelles stratégies employer pour que ma fille de 8 ans accepte d’aller au lit sans rechigner le soir ? À partir de quel âge mes enfants peuvent-ils fréquenter les réseaux sociaux ? Dois-je punir mon enfant qui s’est mal comporté à l’école ? Comment mettre fin aux argumentations ? On nous dit que notre fils de 2 ans est la terreur de sa garderie. On veut l’expulser ! Que faire ? »… Il y a quelques décennies, on ne se posait pas ce genre de questions.
Dans les années 1960, les mères s’en sortaient généralement en menaçant : « Attends que ton père arrive ! » Et les pères distribuaient les punitions en arrivant à la maison, le soir venu. Plus confiants, plus sûrs d’eux, les parents élevaient leurs enfants en copiant fidèlement le modèle de leurs parents, sans outils autres que leur bon jugement. Aucun enfant ne se serait risqué à dire : « Je ne t’aime plus, maman » ou « Tu n’es pas gentil, papa ». Lorsqu’ils se fâchaient ou qu’ils punissaient, ils étaient persuadés d’être dans la bonne voie, ne connaissant rien d’autre, et souhaitaient avant tout avoir des enfants bien élevés en leur inculquant les valeurs qui leur tenaient à cœur. La plupart d’entre eux avaient la conscience tranquille quant à leurs exigences et leurs interventions auprès de leurs enfants. Les punitions étaient formatrices. « Cela va t’apprendre », disaient-ils.
Était-ce plus facile pour eux ? C’était sans doute plus simple, car le monde était plus simple. L’influence de la télévision, des amis et de l’école était beaucoup moins importante. Force est d’admettre que les modèles familiaux se sont transformés. Si, maintenant, les enfants passent avant tout et avant tous, à cette époque, c’était les parents d’abord et les enfants ensuite. Le nombre d’enfants par famille a diminué considérablement, au point qu’aujourd’hui plusieurs d’entre elles se composent d’un enfant unique. De nos jours, une famille de trois enfants est d’ailleurs considérée comme une grande famille par une bonne partie de la population. Étant moins nombreux, les enfants sont devenus plus précieux. Et si, en plus, les parents viennent à se séparer, le lien d’amour et de tendresse avec l’enfant devient le seul lien qui leur semblera durer toute une vie. Affirmer son autorité risque alors de frustrer l’enfant et de compromettre ce lien d’amour, ne serait-ce que pour une courte période. Je raconte parfois que lorsque ma mère punissait trois d’entre nous, par exemple, elle avait encore six enfants qui l’aimaient ! La peur de perdre l’amour de leur enfant en lui imposant des interdictions ou en le limitant empêche un grand nombre de parents d’exercer quotidiennement leur autorité.
De plus, de nombreuses femmes se sentent aujourd’hui noyées dans un océan de responsabilités familiales et professionnelles importantes et parfois difficiles à concilier. La crainte de ne pas pouvoir gérer cette situation, avec tous les tracas qui s’y rattachent, engendre une forte culpabilité chez elles. Comment avoir l’impression d’être une bonne mère dans cet état d’esprit et satisfaire adéquatement ses besoins affectifs tout autant que ceux de son enfant ? Les pères aussi gravissent d’importants échelons dans leur carrière, et ces étapes coïncident le plus souvent avec l’arrivée des enfants. Chacun court sans cesse et tente de gagner du temps. Or, tisser un lien d’attachement de façon à ce que l’enfant se sente aimé et accepte votre autorité requiert du temps et de la disponibilité. De nombreux parents affirment qu’ils voient si peu leurs enfants qu’ils ne leur refusent rien et s’abstiennent de les réprimander. « Le peu de temps passé ensemble doit être amusant », disent-ils. Cependant, sans limites ni règles, il arrive un moment où le plaisir n’est plus au rendez-vous, où votre autorité est en danger.
Il est utopique d’envisager d’assumer votre autorité et transmettre vos valeurs sans, en même temps, préserver et nourrir votre lien d’attachement à votre enfant. L’enfant a un besoin vital de s’attacher à quelqu’un. S’il ne se lie pas à vous, il risque de se tourner vers ses amis, ses pairs, comme le mentionne le médecin et auteur Gabor Maté :
Ce n’est pas un manque d’amour ni un manque de compétences parentales qui nous rendent inefficaces en tant que parents, mais l’érosion du contexte d’attachement lui-même. Parmi ces attachements concurrents, le plus courant et le plus nocif qui affaiblit l’autorité et l’amour des parents est la tendance grandissante de nos enfants à créer des liens avec leurs pairs. Le désordre qui affecte les jeunes enfants et les adolescents d’aujourd’hui a ses origines dans la perte d’orientation vers les adultes significatifs dans leur vie.
Pour la première fois dans l’histoire, les jeunes ne se tournent pas vers leurs parents, leurs enseignants et autres adultes responsables pour leur éducation, leurs modèles et leur encadrement, mais plutôt vers des personnes que la nature n’a jamais envisagées pour assumer le rôle de parent – leurs propres pairs. Les enfants sont difficiles à gérer, ne sont pas coopératifs en salle de classe, ne prennent pas de la maturité, car ils ne nous prennent plus comme modèles. Au lieu, ils sont élevés par des personnes immatures qui ne sont aucunement en mesure de leur montrer le chemin vers la maturité. Ils sont parents les uns des autres1.
Il est urgent, selon lui, de « reconquérir » nos enfants, de retrouver notre juste place de parents si nous souhaitons exercer notre autorité et l’influence que nous confère notre position unique et privilégiée. L’enfant, comme le parent, en sera gagnant.
J’en ai personnellement fait l’expérience lorsque j’ai vu s’éclipser notre fils aîné de la maison au profit de ses amis durant l’été de ses 13 ans. Il n’entrait que pour manger et dormir et en semblait fort heureux. N’est-ce pas ce que l’on souhaite, en tant que parents, de voir nos enfants s’épanouir même si pour cela il nous faut céder du terrain ? Je comprenais son besoin d’indépendance, de liberté et la place privilégiée qu’occupent les amis à cet âge, mais je ressentais, en même temps, un profond malaise et nourrissais une certaine inquiétude. Comment rester des guides et conserver notre influence sur notre enfant sans exercer un contrôle rigide ? Aucun livre ne précise avec exactitude le temps à accorder aux amis et à la famille quand on a 13 ans. Lorsque nous discutions de sa présence rarissime à la maison, il disait : « Mais vous savez que vous pouvez me faire confiance. Vous connaissez mes amis. » J’avais, certes, un deuil à faire. J’étais prête à partager ma place avec ses amis, mais pas à la céder totalement.
Comment pouvais-je aborder le sujet sans créer de résistance et causer un éloignement encore plus grand ? « Dis-moi, ferais-tu confiance à des inconnus, toi ? » l’ai-je questionné. « Bien sûr que non, maman ! », m’a-t-il répondu. « Je te vois si peu depuis le début des vacances que tu es en train de devenir un inconnu pour moi et ça me fait de la peine. Je sais toute l’importance qu’ont tes amis, mais j’ai besoin de connaître le jeune homme que tu deviens, car tu comptes toujours autant pour moi. Tu comprends sûrement que je ne peux pas, dans les circonstances, t’accorder aveuglément ma confiance. » Malgré tous les changements des dernières décennies et le contexte actuel, je demeure persuadée qu’exercer une autorité parentale saine et épanouissante pour le parent comme pour l’enfant est une mission réalisable.
Une question d’équilibre
Quelle ironie de constater que nous n’avons jamais éprouvé autant de difficultés dans nos fonctions parentales tout en étant plus informés que jamais sur le développement de l’enfant ! Depuis plus de 20 ans, différentes ressources (revues, livres, émissions télévisées, cours, etc.) abreuvent en effet les parents de conseils et de recommandations, les incitant à agir différemment de leurs propres parents afin d’éviter de traumatiser leurs enfants. Cependant, ces informations peuvent avoir des conséquences opposées : tantôt positives en servant de balises à certains parents, tantôt négatives en suscitant de l’inquiétude, de la culpabilité et une perte de repères chez d’autres. Par exemple, lorsque le livre Tout se joue avant six ans, de Fitzhugh Dodson, a été publié en 2006, mes enfants avaient 9 et 10 ans. « Il est déjà trop tard ! », avais-je alors pensé, probablement comme bien d’autres parents…
La sensibilité du parent est fort présente par les temps qui courent, mais qu’en est-il de la fermeté ? D’une autorité rigide, nous sommes passés à une carence d’autorité et, parfois même, à une absence d’autorité. Il faut dorénavant expliquer les règles à l’enfant et discuter avec lui de leur importance et de leur raison d’être. Or, cela est nettement insuffisant pour l’amener à les respecter. Il faut se rappeler que « le parent a aussi un rôle d’autorité à assumer et il ne peut y échapper, même s’il le trouve souvent difficile, lourd et négatif. Être en autorité ne signifie nullement faire preuve de méchanceté ou être en colère2 ». Sensibilité et fermeté vont de pair dans une autorité de cœur. Être ferme implique que l’on doive agir chaque fois qu’une règle est enfreinte, que l’une de nos valeurs est touchée. Comme nous le verrons dans les chapitres à venir, cela peut se faire sans colère ni agressivité, de façon tout simplement aimante.
Un juste retour du balancier de l’autorité s’impose. Les caractéristiques d’un enfant qu’on dit « bien élevé » diffèrent évidemment selon chaque parent, chaque époque, chaque culture et chaque continent. Mais peu importe où l’on se trouve, il existe un juste équilibre qui vaut le coup d’être envisagé entre l’imposition d’une discipline de fer où l’enfant n’apprend rien par lui-même et la liberté absolue où l’enfant doit tout apprendre par lui-même.
Éduquer demeure une tâche aussi exigeante que complexe. Le quotidien d’un parent qui refuse de s’appuyer sur les méthodes traditionnelles d’éducation est souvent marqué par le découragement, l’angoisse, le désarroi et la culpabilité. Comment être un bon parent dans ce contexte ? Entre cet enfant dit « mal élevé » et cet autre dit « bien élevé », il y a une merveilleuse place pour s’« élever » avec son enfant.
L’enfant « mal élevé »
Christiane a vu son rêve d’être grand-mère se réaliser il y a quelques années. Elle n’éprouve pourtant aucun plaisir à voir ses petits-enfants. « Ils sont tellement “mal élevés” dit-elle. Comment les aimer alors qu’ils ne sont pas aimables ? Quelle tristesse ! Moi qui rêvais d’aimer, de cajoler mes petits-enfants. Chaque fois qu’ils me rendent visite, ils monopolisent toute l’attention. C’est un défi de discuter calmement entre adultes en leur présence. Toutes les raisons sont bonnes pour nous interrompre. Au moment des repas, ils se disputent sans arrêt et font des commentaires désobligeants sur les mets préparés. Les mettre au lit, le soir, relève de l’exploit. Le pire est que mon fils et ma belle-fille cèdent à tous leurs caprices et n’interviennent d’aucune façon. »
Là où aucune règle n’est en vigueur – que ce soit à la maison, à l’école, dans un jeu ou dans un sport –, il est impossible d’avoir du plaisir. Les limites et les frustrations apprennent à l’enfant qu’il n’est pas seul au monde, qu’il n’est pas le centre du monde. Il y a ses désirs et ceux des autres. Plus tôt s’effectue cet apprentissage, plus facile sera sa vie. Claude Halmos, psychanalyste et écrivaine, a d’ailleurs observé que « les enfants, autrefois, venaient consulter avec des problèmes provenant des relations familiales, de l’histoire parentale. Aujourd’hui, c’est l’absence de repères et de limites qui, le plus souvent, les empêche de se développer normalement3 ». Ne pas vouloir frustrer l’enfant, c’est effectivement lui faire croire à un paradis illusoire et l’empêcher de pouvoir faire face à la vie en société avec ce qu’elle comporte de gratifications et de déceptions. Trop nombreux sont ceux qui croient qu’aimer nos enfants, c’est tout leur donner, répondre à tous leurs désirs. Qu’ils aient une enfance heureuse est important, les préparer à vivre une vie d’adulte la plus heureuse possible compte tout autant.
Louiseenseigne au primaire, en quatrième année. Elle qualifie Julien, un enfant de sa classe, de « très mal élevé ». « En plus d’être impoli et irrespectueux, il intimide bon nombre d’élèves. On lui explique que ses gestes sont inacceptables, qu’il doit s’excuser et on le fait réfléchir à la récréation, debout, face au mur. » Mais cela ne va pas plus loin, car elle avoue que le personnel de l’école a peur de ce jeune garçon. « Vous savez, nous habitons une petite ville en région et il connaît nos adresses. Nous craignons nous-mêmes de subir de l’intimidation de sa part. Il pourrait vandaliser nos maisons, crever les pneus de nos voitures… ou même causer du tort à nos enfants si nous sommes trop sévères à son égard. »
Le personnel en milieu scolaire n’est pas à blâmer, mais cet exemple montre à quel point les adultes se sentent démunis et dépassés devant ce genre de situations. Comment Julien peut-il évaluer la portée de ses gestes et l’ampleur du tort causé à autrui s’il n’assume pas des conséquences adaptées à la gravité de ses actes ? Si personne n’intervient à la mesure des délits commis et n’exige le respect de sa part, alors qu’il est en quatrième année, que va-t-il advenir de cet enfant et de tous les autres qui souffrent de ses agissements ? Comment s’étonner que certaines victimes d’intimidateurs comme Julien ne se présentent plus en classe, fuguent ou pensent à commettre l’irréparable ? Et comment ces jeunes peuvent-ils sentir qu’ils comptent à nos yeux, qu’ils ont de la valeur alors que nous n’assumons pas notre rôle de protection ?
Lorsqu’on se retrouve en présence d’un enfant qu’on dit « mal élevé », on peut penser qu’il y a un ou plusieurs adultes qui n’assument pas leur rôle d’autorité. Un grand nombre d’enseignants et d’intervenants se plaignent du nombre grandissant d’élèves irrespectueux, impolis et insensibles aux autres. Ne voit-on pas dans ce fait la simple conséquence du laxisme des adultes, qui n’exigent ni respect ni politesse de la part des jeunes ? Si la transmission de ces valeurs nous importe, on ne peut pas se contenter de les souhaiter ou de les demander, on doit les exiger. Or, le respect, pourtant la valeur première que tout adulte souhaite transmettre, est justement la valeur qui semble actuellement être la plus délaissée.
Pendant mes conférences, des rires fusent généralement dans l’assistance lorsque je mentionne que ce sont ces mêmes jeunes qui nous gouverneront dans 20 ou 30 ans et que je crains pour notre génération. Pourquoi veilleraient-ils à notre mieux-être et à notre santé au moment de notre retraite s’ils n’ont pas appris le respect des autres ? Si cette valeur n’est pas apprise tôt dans la vie, elle est plus difficile à intégrer lorsque le jeune a atteint l’âge de 15 ou de 25 ans. L’impact d’une bonne éducation et d’un encadrement adéquat pour un enfant n’a pas uniquement des répercussions sur la famille proche ou dans la vie scolaire, mais aussi sur l’ensemble de la société.
L’enfant « bien élevé »
Mon amie Marieme raconte que sa fille Daphné, 14 ans, envie les destinations de voyage de ses amies (Cuba, Madrid ou Paris…) alors qu’elle doit se contenter d’un voyage en voiture chez sa tante aux États-Unis. « Maman, pourquoi ne travailles-tu pas à l’extérieur comme toutes les mères ? Nous pourrions, nous aussi, faire de vrais voyages en avion ailleurs que chez tante Julie ! J’aimerais bien rouler dans une voiture de luxe comme celles des mères de mes amies et porter des vêtements de marque comme mes amies. Je porte toujours les mêmes vêtements ! Maintenant que nous sommes à l’école, il n’est plus nécessaire pour toi de rester à la maison. » Chaque fois que ces récriminations refont surface, Marie répond : « Que vous soyez “bien élevés” demeure ma priorité. Voilà pourquoi je choisis de rester au foyer. Il est plus important pour moi de bien t’élever que de te procurer tout ce que tu désires, Daphné. »
Marie a fait le choix de mettre en veilleuse une carrière prometteuse afin de se consacrer exclusivement à sa famille. Elle n’a pas pris cette décision par esprit de sacrifice, mais plutôt pour accéder aux « rêves de famille » qui l’animaient depuis de nombreuses années. Le salaire de son conjoint Philippe leur permet ce choix de vie, bien qu’ils aient dû renoncer aux produits de luxe comme des vêtements de marque ou des voyages à l’étranger. Marie préfère être présente pour ses enfants au retour de l’école, disponible lorsqu’ils ont besoin de se confier, d’être encouragés, encadrés…
Ce choix de vie n’est évidemment pas accessible à tous. Cependant, la possibilité de tisser un lien d’attachement et d’exercer une autorité sensible et ferme à la fois, dans le respect et la satisfaction des besoins de chacun, est possible peu importe les choix de vie et d’organisation familiale. Il est tout à fait envisageable de prioriser la famille tout en exerçant une profession qui permette de s’épanouir, de se réaliser et, par la même occasion, d’assurer un salaire. Se « sacrifier » pour un enfant n’est souhaitable ni pour le parent ni pour l’enfant.
On a beau avoir souvent remplacé l’expression « élever un enfant » par « éduquer », « guider » ou « accompagner », il reste que le verbe « élever » est plus significatif, plus fort, puisqu’il implique un mouvement vers le haut. Il va de pair avec la signification profonde du mot « autorité » qui, étymologiquement, signifie : « Celui qui augmente, celui qui accroît ». Autrement dit, celui qui fait « grandir ».
S’« élever » avec son enfant
Comment, en tant que parent, retirer un sentiment positif de soi-même lorsqu’on tente de contraindre son enfant, de l’obliger à adopter un comportement par la promesse d’une récompense, la menace d’une punition ou encore en criant ?
S’« élever » avec son enfant, c’est apprendre à s’améliorer jour après jour. Nous devons pouvoir tirer des leçons de chaque situation dans laquelle nous n’avons pas été à la hauteur de nos aspirations parentales et n’avons pas su combler adéquatement les besoins de notre enfant. S’« élever » avec son enfant, c’est également s’assurer d’intervenir avec un réel souci d’aider l’enfant à devenir meilleur, de l’encourager à faire mieux et à se corriger. Cette façon d’assumer son rôle parental avec autorité doit être effectuée avec sensibilité et avec cœur malgré la colère, la frustration ou la déception qui gronde parfois en nous.
Lorsque la colère ou l’exaspération paraît incontrôlable, il est effectivement difficile d’intervenir de façon à être fier de soi ou de parler de ses sentiments à son enfant. C’est un défi de taille ! Dans mon cas, sous le coup de la colère, la maman tendre, aimante, tolérante, à l’écoute, respectueuse, attentive aux besoins de son enfant disparaissait subitement pour être remplacée par cette autre qui était prête à réagir immédiatement pour le corriger.
Les deux mères en moi occupaient deux espaces distincts, qui se chevauchaient parfois. Il y avait l’espace « aimant », du côté du cœur, et l’espace « réactif », tapi du côté de la colère. Dans les moments où mon seul désir était de priver mon enfant de quelque chose qu’il aimait, il me fallait retrouver la voie qui menait au côté du cœur. De cette façon, je pouvais redevenir la mère aimante sans toutefois négliger mes limites et assumer le rôle d’autorité qui m’incombait.
Un moyen efficace d’y parvenir m’a été donné par Sophie, une éducatrice en milieu familial qui avait aménagé dans une pièce de sa maison ce qu’elle nommait un « coin plumes ». Du plafond descendaient de nombreuses plumes multicolores suspendues à un mobile. Juste au-dessous, elle avait placé une chaise. En soufflant sur les plumes, assis sur la chaise, l’enfant désorganisé ou agressif sentait sa colère disparaître, se calmait et revenait à de meilleurs sentiments. Il arrivait même parfois que les enfants suggèrent à Sophie de se rendre elle-même au « coin plumes » afin de retrouver son calme. Certains enfants y allaient d’eux-mêmes quand ils sentaient le besoin d’être plus tranquilles.
Lorsque nous demandons à un enfant colérique ou énervé de se calmer ou de « prendre de grandes respirations », le plus souvent, il ne sait pas comment s’y prendre ou n’a pas envie d’accéder à notre requête. Se calmer alors que la colère gronde n’est pas facile, même pour un adulte. Le fait de souffler doucement pour soulever les plumes stabilise la respiration, la rendant moins saccadée. Le retour au calme s’effectue de façon plus subtile que par la seule force de la volonté.
Nous avons donc, les enfants et moi, installé un coin semblable dans notre maison. Je leur ai expliqué avec des mots simples la pertinence de ce mobile. Que l’on soit parent ou enfant, sous le coup de la colère, il y a parfois des mots, un ton de voix et des gestes qui nous viennent rapidement et qu’il vaut mieux retenir, car ils risquent de blesser ceux qu’on aime. Malgré leur jeune âge (ils avaient environ 4 et 5 ans), ils ont très bien saisi ce qu’étaient les deux espaces en chacun de nous. Je m’étais inspirée des derniers petits conflits survenus entre eux pour illustrer le concept. Nous avons ensuite imaginé un pont quittant le « côté vengeur », qu’ils associaient à un marteau, pour traverser jusqu’au « côté cœur ». J’ai précisé qu’il y avait des colères qui disparaissaient rapidement – le pont était alors vite traversé – alors qu’à d’autres moments, il fallait plus de temps pour ne plus se sentir fâché, pour se sentir de nouveau « aimant ». Les enfants avaient proposé de laisser un petit marteau et un cœur dans le coin plumes pour se rappeler, disaient-ils, leurs deux côtés. Ils avaient aussi demandé qu’on y colle des images illustrant différentes émotions : un visage fâché, un autre triste, un troisième déçu… pour qu’on puisse exprimer ce qu’on ressentait avec les « bons mots ».
Ce « coin plumes » nous a aidés à traverser le pont de nombreuses fois et à préserver l’amour et le respect qui nous liaient. Dès l’âge de 3 ans, un enfant peut comprendre qu’il y a un endroit dans la maison, dans la classe ou à la garderie qui lui évite de se servir de son « côté dur », un espace où l’on peut se retirer pour mieux revenir et discuter, avec son cœur, de la situation conflictuelle.
Pourquoi est-ce si important d’intervenir avec cœur ? Lorsque nous interpellons notre « côté aimant », nous touchons le cœur de l’enfant, nous éveillons cet espace en lui alors que si nous intervenons avec notre « côté vengeur », nous sollicitons l’espace négatif, le « côté marteau » de l’enfant. Chaque personne possède ces deux espaces intérieurs à la fois. Certains en ont développé un plus que l’autre. Lorsque nous prenons le temps de nous calmer et de traverser le pont qui mène du côté du cœur, nous pouvons agir avec sensibilité. Nous touchons ainsi à la sensibilité de notre enfant, à son « côté cœur ». Nous lui permettons de développer cet aspect, d’habiter cet espace en lui alors que lorsque nous le punissons sous le coup de la colère, nous lui apprenons à se venger et à punir à son tour.
Comme l’écrit le pédopsychologue Haim Ginott : « La punition n’a pas sa place dans une relation bienveillante4. » Nous ne devrions jamais intervenir sous le coup d’une émotion forte, alors que nous nous trouvons du « côté vengeur » ou « marteau ». En refusant de céder à cette impulsion de colère, nous pouvons mieux faire saisir à l’enfant comment nous allons intervenir et quelles seront les conséquences de son geste.
Et si l’enfant était ce qu’on en fait ?
En comparant un enfant à son parent, on dit souvent que la pomme ne tombe jamais très loin de l’arbre. Le modèle demeure en effet le principal moyen d’asseoir son autorité et de discipliner par la suite. Ce que vous êtes et ce que vous faites a plus d’impact que ce que vous dites. Les interventions parentales auprès d’un enfant détermineront la façon dont ce dernier agira envers les autres. Si ces interventions sont dictées par l’amour que son parent lui porte, l’enfant sera sensible aux autres et les traitera de la même façon. Il apprendra lui aussi à se tenir du « côté cœur ».
Emma, 3 ans et demi, mord et n’écoute pas les consignes, à la maison tout autant qu’à la garderie. Chaque fois qu’elle adopte un comportement désagréable à la maison, ses parents, en colère, exigent qu’elle aille s’asseoir dans un coin de la cuisine pour réfléchir trois minutes. Ils ont aussi remarqué que, curieusement, elle passe ses journées à disputer ses poupées. Elle mime même des colères en les obligeant à aller « réfléchir ». Cela fait sourire ses parents…
Pourtant, les habitudes de jeu de la fillette montrent bien que les retraits répétitifs qu’elle subit ne sont pas sans conséquences. Lorsque ses parents lui ordonnent d’aller réfléchir dans son coin, tout porte à croire qu’ils ne sont pas, à ce moment, dans leur espace aimant, mais plutôt du « côté vengeur » ou « réactif ». Emma agit de la même façon avec ses poupées.
Les parents devraient d’abord tenter de combler adéquatement les besoins affectifs de leur fille et remplacer les retraits punitifs par des « réparations », c’est-à-dire de petits gestes visant à compenser le tort causé. Pour un enfant de cet âge, et dans ces circonstances particulières d’agressivité, les réparations appropriées peuvent concerner directement les blessures infligées aux autres lors des crises. Après avoir signifié à l’enfant que mordre fait mal, on peut l’inciter à tenir un linge imbibé d’eau froide sur la morsure de la personne qu’il a blessée. On peut également lui demander d’effectuer un petit massage de l’endroit affecté en utilisant une lotion pour le corps. Le but est qu’il apprenne à faire attention aux autres. L’approche « réparation » sera traitée en détail au chapitre 4.
Certains enfants qui font preuve d’agressivité n’ont jamais eu l’occasion d’être doux parce qu’on ne leur a tout simplement pas appris. La réparation favorise l’acquisition de différentes qualités, dont la douceur. En entendant son parent dire : « J’aime vraiment ton massage. Comme c’est bon et doux ! », l’enfant sera incité à la délicatesse et, à la longue, portera plus attention aux autres.
Lorsque ses parents demandent à Emma de réparer le tort qu’elle a causé avec son « côté cœur » plutôt que de lui imposer un retrait dans la cuisine, elle opte pour la sensibilité et prend soin des autres avec douceur. En lui assurant aussi qu’elle peut exécuter de petits massages lorsqu’elle en a envie sans être obligée de mordre auparavant, ils évitent qu’elle associe morsure et massage et qu’elle continue de faire des marques sur le corps.
Chaque fois que les parents de Justin, 8 ans, le privaient de tout plaisir et d’activités en l’envoyant dans sa chambre quand il était en colère (côté « marteau »), il en ressortait en manquant à nouveau de respect et en agressant ses frères. Il ne réagissait pas bien aux retraits négatifs imposés (le côté « dur » répondait au côté « dur ») et se voyait contraint de retourner dans sa chambre… À partir du moment où ses parents lui ont demandé de réparer ses torts (donc d’agir avec cœur) en exécutant une foule de petites tâches et en jouant à de nombreux jeux avec ses frères, Justin est devenu de lui-même, jour après jour, un bon frère. Il y a pris goût. Ses parents ont à coup sûr su toucher son cœur et depuis, il est plus soucieux du bien-être de ses frères, les protège et les amuse sans cesse. Il continue donc d’agir avec cœur.
Que souhaite-t-on apprendre à nos enfants ? À être dur, à punir, à se venger ou à devenir plus humain et plus aimant ? La réponse à cette question influence directement les interventions à privilégier auprès d’eux et, par le fait même, le choix de l’espace – négatif ou positif – à occuper en nous lorsque nous agissons. En tout temps, il faut nous rappeler que nous sommes d’abord et avant tout des modèles imités par nos enfants. Il faut donc apprendre à prioriser le « cœur ».
Un moment de réflexion
•Quel type d’autorité adoptez-vous envers votre enfant ? Êtes-vous rigide, appliquez-vous le « laisser-faire » ou optez-vous pour une discipline de cœur ?
•Votre style d’autorité ressemble-t-il à celui exercé par vos parents ? Si oui, quelles en sont les similitudes ?
•Souhaitez-vous effectuer des changements dans votre style d’autorité ? Si oui, lesquels ?
•Quelles paroles prononcez-vous ou quels gestes faites-vous lorsque vous êtes en colère ou blessé intérieurement ?
•De quelles stratégies pourriez-vous vous munir afin de « traverser le pont », de rester « branché » et de retrouver le calme et la sérénité nécessaires à une intervention efficace auprès de votre enfant ?
Chapitre 2Offrir à l’enfant ce dont il a réellement besoin afin de bâtir un lien solide
L’entourage de l’enfant (les parents, les éducateurs, les enseignants de même que l’ensemble des autres adultes proche de lui) se doit d’œuvrer à satisfaire adéquatement les besoins de celui-ci pour assurer son développement tant affectif que physique. Conséquemment, un lien significatif se tissera. Tel est le premier défi à relever dans l’exercice de l’autorité.
Malheureusement, les termes besoin et désir sont fréquemment confondus, car tous deux impliquent le manque ou l’absence de quelque chose. Comment les distinguer ? Boire découle d’un besoin, boire un jus relève du désir. Disposer de vêtements est un besoin, posséder des vêtements de marque, un désir. Dormir est un besoin ; détenir une chambre à soi, un désir parfois impossible à satisfaire. Vivre sous un toit est un besoin, habiter une maison munie de trois salles de bain, un désir. Être reconnu est sans aucun doute un besoin, mais être complimenté de façon répétitive est un désir. Éprouver du plaisir lors d’un jeu ou d’une activité est un besoin, jouer toute la journée est cependant un désir. Que dire d’un smartphone pour un enfant ? Et d’un téléphone de la plus récente génération pour son parent ? Ce sont des désirs, bien entendu.
Le propre du besoin, physique ou affectif, est d’être satisfait le plus rapidement possible sans quoi l’intégrité physique ou psychologique de la personne s’en trouve menacée. Les besoins sont présents dès la naissance de l’enfant alors que les désirs arrivent plus tard, au gré de son développement. Un désir émane pour être rêvé, entendu et discuté, mais n’a pas à être toujours comblé. Lorsqu’il n’est pas satisfait dans l’immédiat, l’enfant prend conscience qu’il s’agit d’un prix auquel s’associent des efforts. Il peut ainsi se projeter dans le futur et tenter de concrétiser son désir. Celui de marcher, par exemple, est nourri par l’envie de pouvoir se déplacer comme il le veut. Le petit est donc amené à se relever et à recommencer lorsqu’il tombe. Le désir de lire, de déchiffrer la signification des lettres, amène aussi l’enfant à fournir des efforts pour y parvenir alors que le désir d’une nouvelle bicyclette le motive à vouloir effectuer des tâches pour se la procurer ou faire réparer celle qu’il possède.
Tableau 2.1. La distinction entre besoin et désir
Besoin
Désir
Sa satisfaction est essentielle à la croissance de l’enfant.
Sa satisfaction n’est pas essentielle à la croissance de l’enfant.
Il demeure tant qu’il n’est pas satisfait.
Il est éphémère, peut disparaître, être remplacé ou évoluer dans le temps.
Il est assez semblable d’une société à l’autre.
Il est souvent lié au contexte culturel ou à une époque.
Il est limité.
Il peut être infini.
Il engendre la souffrance s’il n’est pas comblé.
Dès qu’il est satisfait, un nouveau désir se manifeste.
À long terme, sa non-satisfaction peut entraîner la mort de la personne.
Sa non-satisfaction ne menace pas la vie de la personne.
Il est essentiel de distinguer les besoins des désirs et doser les réponses à la satisfaction des premiers (besoins) et, surtout, des seconds (désirs) afin d’exercer une autorité efficace et constante. Il semble toutefois que moins le parent s’investit dans la satisfaction des besoins affectifs de son enfant, plus il compense en lui offrant tout ce qu’il désire. Pourtant, le dosage de la réponse aux désirs de l’enfant est un moyen privilégié de l’aider à passer du principe de plaisir à celui de réalité.
Durant mes conférences, lorsque je demande aux parents : « Qui, parmi vous, a tout ce qu’il désire dans la vie, au moment même où il le souhaite ? », aucune main ne se lève. Ne pas obtenir tout ce qu’on désire de façon instantanée est une des caractéristiques de la « vraie vie ». Plus tôt un enfant sera confronté à cette réalité, plus facile sera le déroulement global de sa vie. Je suggère fortement aux parents d’aider leur enfant à bien comprendre les différences entre un besoin et un désir. Ainsi, l’enfant acceptera plus facilement leurs refus de combler certains de ses désirs. Poser des limites et refuser de satisfaire les désirs de votre enfant vous causent des difficultés ? Dressez une liste de ses désirs au fur et à mesure qu’il les exprime et dites-lui : « Je note dans ta liste de désirs ce jeu, cette bande dessinée, etc. » L’enfant aura alors le sentiment que ses désirs sont importants et entendus malgré le fait qu’ils ne soient pas comblés dans l’immédiat.
Les besoins physiques
Je me réfère à la pyramide de Maslow pour démontrer qu’à la base, les besoins physiques d’un jeune doivent être comblés. Dans un deuxième temps, les différents adultes en position d’autorité peuvent passer aux étages supérieurs de cette pyramide et évaluer les moyens de satisfaire ses besoins affectifs.
Partons du principe général que la majorité des enfants des pays développés ne souffrent ni de famine ni de sous-alimentation. On observe par contre le phénomène inverse : la suralimentation. Nos enfants disposent de toute l’énergie nécessaire pour bouger et s’activer, mais le manque d’exercice physique leur cause du tort. Ils ont aussi une chambre, mais bon nombre d’entre eux n’y dorment pas suffisamment. Les habitudes de ces enfants plutôt sédentaires qui mangent et dorment de façon inadéquate se retrouvent au cœur de situations conflictuelles qu’aucun moyen de discipline, aussi « magique » soit-il, ne peut résoudre.
Le sommeil
Le sommeil a des répercussions vitales sur la santé, l’humeur et le rendement scolaire des enfants. Il est donc important d’encourager de bonnes habitudes en ce qui a trait à l’heure du coucher à la maison.
Marlèneraconte que dès que son fils met les pieds hors du lit, il pleure et hurle. Interrogée sur les heures et les habitudes de sommeil de Lucas, Marlène explique que son conjoint et elle rentrent à la maison vers 18 h 30 après avoir récupéré les enfants à la garderie et au service de garde de l’école. S’enchaîne alors une suite d’événements : la préparation du souper, les devoirs de l’aîné, les bains. Il est impossible de coucher les enfants avant 20 h. Le lendemain, ces derniers se font réveiller à 5 h 30 afin que leurs parents soient à l’heure au travail. L’exercice de leurs professions, mentionne Marlène, leur permet une vie de famille enviable et des activités familiales fort agréables les fins de semaine : ski, cinéma, restaurant, etc. Mais chaque matin de la semaine, la crise de Lucas est inévitable.
Marlène est à la recherche de trucs pour illuminer d’un sourire le visage de son Lucas le matin. Or, aucun truc, de quelque ordre qu’il soit, ne peut se substituer au sommeil manquant de cet enfant. En plus d’avoir des effets sur l’humeur, le sommeil est indispensable à notre équilibre et constitue, chez l’enfant, un élément important de son développement. L’hormone de croissance est principalement sécrétée durant cette longue période de repos et c’est en dormant que le jeune mémorise les apprentissages et les expériences qui ont marqué sa journée. Tandis qu’il dort, son système immunitaire se renforce en même temps que son système nerveux s’organise et se perfectionne. Pour cela, les heures de sommeil doivent être suffisantes et de bonne qualité. Informer l’enfant de ces bienfaits facilite généralement l’heure du coucher.
Tableau 2.2. Nombre moyen d’heures de sommeil et de siestes nécessaires par groupe d’âge
Groupe d’âge
Nombre moyen d’heures de sommeil nécessaires par 24 heures
Nombre moyen de siestes nécessaires par 24 heures
Nouveau-né – 0-2 mois
16-20
3-10
Nourrisson – 2-12 mois
9-12 la nuit, 2-4 ½ pour les siestes
1-4
Bébé – 1-3 ans
12-13
1-2
Âge préscolaire – 3-5 ans
11-12
0-1
Âge scolaire – 6-12 ans
10-11
0
Adolescent – 12-18 ans
9-9 ½
0
Adulte – 18 +
7 ½-8 ½
0
Source : Tableau adapté de J.A. Mindell et J.A. Owens, Sommeil et enfants : données scientifiques, Institut universitaire en santé mentale Douglas de Montréal. www.douglas.qc.ca/info/sommeil-et-enfant-donnees-scientifiques
Force est de constater que de nombreux enfants – tel Lucas – ne bénéficient pas d’une période de sommeil adéquate. « Le manque de sommeil et les mauvaises habitudes avant le coucher sont liés à des problèmes de santé comme l’obésité, les maladies cardiovasculaires, le diabète, la dépression, les sautes d’humeur ou l’irritabilité. Ils peuvent aussi avoir un effet négatif sur le fonctionnement de la mémoire et sur le temps de réaction5. »
Karine Spiegel, une chercheuse française, s’est attardée au manque de sommeil et a relevé ses impacts sur l’augmentation des cas d’obésité et de diabète. Une étude québécoise6 effectuée auprès de plus de mille enfants a aussi lié le manque de sommeil chez le très jeune enfant au gain de poids7. En effet, il semble que 26 % des petits âgés de 2 ans et demi qui dorment moins d’une dizaine d’heures par nuit connaissent un surpoids vers l’âge de 6 ans. Selon Jacques Montplaisir, spécialiste du sommeil à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, les enfants qui profitent de 11 heures de sommeil par nuit sont moins à risque de souffrir de cette situation dans une proportion de 16 %. Il précise également que ce risque de surpoids aurait une explication hormonale : « Lorsque nous dormons moins, nous produisons plus de ghréline, une hormone sécrétée par l’estomac et qui stimule l’appétit8. »
Selon cette même étude, le manque de sommeil serait directement en lien avec l’hyperactivité chez l’enfant. Il a effectivement été démontré que 22 % des enfants de 2 ans et demi qui dormaient moins de 10 heures avaient développé un comportement hyperactif quatre ans plus tard. Ce taux est deux fois plus élevé que celui des enfants qui peuvent compter sur 10 ou 11 heures de repos par nuit. Alors que plusieurs parents sont portés à croire que l’hyperactivité provoque l’insomnie ou les problèmes de sommeil, le Dr Montplaisir indique que c’est l’inverse qui se produit. Le manque de sommeil est le facteur qui induit l’hyperactivité. Généralement, une nuit courte provoque chez l’enfant un état d’excitation plus grand que chez l’adulte.
Mais qu’il s’agisse d’un enfant, d’un adolescent ou d’un adulte, il faut admettre que nous dormons de moins en moins parce que nous devons performer de plus en plus. Le rythme effréné de notre quotidien ne valorise pas vraiment le sommeil. Reut Gruber, pédospychologue clinique et chercheuse, précise d’ailleurs qu’un Canadien sur quatre ne dort pas suffisamment9. Les recherches ont montré que les problèmes liés au manque de sommeil n’ont plus rien d’exceptionnel au Canada puisqu’ils touchent entre 20 % et 40 % des jeunes enfants et environ un million d’adolescents. Parmi ces derniers, près de 13 % souffrent même de graves insomnies.
Alors que je travaillais en tant qu’infirmière en milieu scolaire, Josée, une enseignante de sixième année, a sollicité mon aide pour préparer une présentation sur le sommeil aux élèves de sa classe. Elle clamait que plusieurs d’entre eux avaient de la difficulté à garder les yeux ouverts et à rester attentifs pendant les cours. Connaissant son caractère enthousiaste, je doutais fortement qu’il s’agisse des conséquences d’un enseignement ennuyant. Après la présentation, les élèves ont effectué une recherche sur le sommeil afin d’en établir les bienfaits, de déterminer le nombre d’heures de sommeil requis à leur âge et d’identifier les impacts du manque de sommeil. Ils ont été étonnés d’apprendre, entre autres, qu’un enfant grandissait durant son sommeil. À peine quelques jours plus tard, Josée m’a confirmé que l’ensemble des élèves se montrait déjà beaucoup plus alerte et était capable d’une attention plus soutenue et d’une meilleure concentration en classe. Seules Chloé et Sophie continuaient de somnoler. Disposant chacune d’un téléphone et d’une télévision dans leur chambre respective, sans contrôle parental, elles ont finalement avoué dormir entre 7 et 8 heures seulement par nuit.
Il a été prouvé que ce manque criant de repos, qui découle souvent de mauvaises habitudes concernant l’heure du coucher, nuit considérablement à la réussite des élèves. Dans plusieurs familles, il semble en effet que les enfants d’âge scolaire se couchent trop tard. Le manque de sommeil freine leurs efforts de concentration et leurs capacités d’attention. Résultat : 70 % d’entre eux se sentent endormis pendant les cours du matin. Comme le mentionne William Kohler, directeur médical à l’Institut du sommeil en Floride : « Tout facteur qui détériore la qualité ou la quantité de sommeil mène à des difficultés de rendement scolaire et à des problèmes de comportement10. »
L’autorité parentale devrait être clairement assumée lorsque les enfants n’arrivent pas à faire des choix adéquats pour eux-mêmes, comme c’est le cas pour Chloé et Sophie. Vous trouverez au chapitre 6 des moyens visant à favoriser les bonnes habitudes d’endormissement et pallier les difficultés particulières liées au coucher.
L’activité physique
Nous le savons tous, l’activité physique est vitale pour le maintien d’une santé optimale. Et pourtant…
Au retour de l’école, Louis, 11 ans, s’empresse de joindre ses amis sur Facebook. Sa mère, Caroline, doit multiplier les appels, les menaces et les haussements de voix pour le tirer de là et lui faire respecter l’heure, du repas et des devoirs. « Lorsqu’il n’est pas à l’ordinateur, il est devant la télévision, dit-elle. Les fins de semaine, c’est encore pire. Il est de plus en plus pénible de lui faire ranger sa chambre et, depuis peu, les activités en famille le répugnent. De la randonnée pédestre ? C’est beaucoup trop ennuyeux à son goût et bien trop épuisant ! »
L’exemple de Louis n’a rien d’étonnant. Le Bulletin de l’activité physique chez les jeunes, publié par Jeunes en forme Canada, révèle que 73 % des parents remarquent que leurs enfants passent la majorité de leur temps devant l’ordinateur ou la télévision en revenant de l’école. Le Dr Mark Tremblay, conseiller scientifique en chef de Jeunes en forme Canada et directeur du Groupe de vie active saine et obésité (HALO) précise que « le temps consacré à des activités extérieures après l’école réduit les niveaux d’anxiété, de colère, de fatigue et de tristesse11. » Certaines références, dont le Guide d’activité physique canadien pour les enfants,
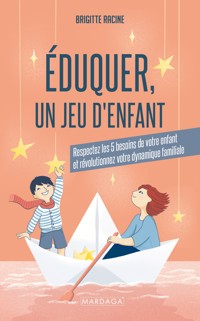














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)