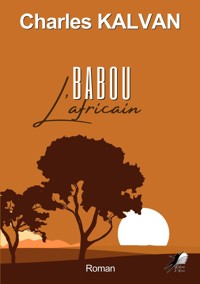Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Un homme bien installé dans la vie possède tout ce qu’il désire. Pourtant, une rencontre, de prime abord anodine, chamboulera son quotidien bien réglé.
Comment j'ai tout perdu est un récit qui emmène le lecteur imperceptiblement vers l’abîme…
À PROPOS DE L'AUTEUR
À la suite d’études supérieures en informatique et ingénierie en formation,
Charles Kalvan consacre sa vie à l’écriture. À l’instar des écrivains tels que Robert Merle ou Alexandre Dumas, il inscrit ses récits dans la lignée des œuvres d’aventures et d’actions.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Charles Kalvan
Comment j’ai tout perdu
Roman
© Lys Bleu Éditions – Charles Kalvan
ISBN : 979-10-377-6336-5
Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122-4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Avant-propos
Cette histoire n’est pas un roman, mais un récit prémonitoire. Je ne savais pas, en effet, qu’en écrivant les lignes qui vont suivre j’allais vivre tout ce que j’étais en train d’écrire.
C’est plusieurs mois après l’achèvement de ce texte que je me suis aperçu que ma vie se déroulait comme je l’avais écrite. Les personnages que j’ai décrits ont bien existé. Je les ai fait apparaître avec un rôle plus ou moins neutre. Mais s’ils apparaissent, c’est qu’une raison inconnue, et de manière inconsciente, je les mis dans ce récit. Pour le lecteur, ils n’auront aucune influence dans le déroulement de l’histoire, mais pour moi, bien après les évènements décrits, j’ai compris leur rôle profond et pour quoi je les ai cités.
À travers les rideaux soulevés, je remarquai un ciel pur et sans nuages qui enveloppait les monts enneigés scintillant au soleil. Deux teintes immaculées se côtoyaient en un jour parfait. Ce n’était pas la beauté pure de ces deux couleurs vierges que la perspective m’offrait ce jour-là et que j’admirais. L’esprit rationnel, pratique de mon tempérament excluait toute forme poétique ou romantique. La pureté, la perfection du paysage, la rareté des couleurs offertes de ce panorama qu’un poète aurait la joie de contempler et de louer m’étaient hors d’atteinte. De ce paysage qui proposait les couleurs parfaites à celui qui voulait bien le voir, je n’en observais que le temps clair. Un temps annonciateur d’une bonne journée. J’abaissai rapidement les rideaux et me retournai :
— Super temps, annonçai-je à mes amis, la neige sera bonne cette fois.
— Oui, dit José, on pourra faire une ou deux noires.
— Trop dur pour moi, répliqua Éric, je préfère les rouges.
— On va se régaler, ajouta Bertrand qui se leva en direction de la fenêtre pour vérifier mes dires.
Je me servis un petit noir avant de m’asseoir. Dehors, la station s’animait. Les premiers skieurs commençaient à faire la queue aux remontées. Les commerçants préparaient leurs boutiques et l’odeur du café envahissait les salles déjà bondées.
Bertrand ouvrit le réfrigérateur :
— Dis donc, on n’a pas fait de courses pour aujourd’hui.
— Pas grave, on mangera au restaurant d’altitude. Avec ce temps, ce sera l’idéal pour s’installer en terrasse.
— Bonne idée, répondirent en chœur les trois amis.
— Et ce soir, continuai-je, je propose une fondue au « Cheval blanc ».
En réalité, notre petite troupe ne se préoccupait guère des courses. Le « Cheval blanc » nous tenait lieu de cantine. Le soir, nous y jouions aux fléchettes, au Yam’s ou à la belote. Le patron organisait parfois des concours de cartes destinés aux habitués et nous aimions y participer.
Faire les commissions et la vaisselle ne nous procurait aucun enthousiasme. Nous préférions savourer notre amitié autour d’une table de restaurant.
Tous les quatre avions réussi notre parcours professionnel. José, en tant directeur d’une importante concession automobile, Bertrand comme chef cuisinier de renom et moi comme directeur marketing d’un groupe international. Quant à Éric, photographe de métier, il s’installa à son compte. Aboutir dans la vie était pour moi un besoin impérieux qui m’animait constamment : être à l’aise financièrement, pouvoir se faire plaisir à tout moment, sans contrainte. Je détestais l’échec quel que soit le domaine et je faisais toujours face aux difficultés.
Bien que l’envie de skier stimulait notre empressement, nous déjeunâmes tranquillement. Cet instant faisait partie du rituel de notre communauté, nous donnant l’occasion du partage de notre amitié. Puis, une fois habillés et l’appartement rangé et nettoyé, nous prîmes notre équipement et nous nous élançâmes à l’assaut des pistes.
Nous quatre venions régulièrement ensemble dans cette station. Chaque année, nous abandonnions femmes et enfants pour nous offrir une tournée en célibataires. Depuis notre adolescence, nous savourions alors des moments de plaisir. Le mariage, il en était convenu ainsi depuis toujours, ne devait pas être un obstacle à nos habitudes. Aussi, nous sortions souvent au restaurant ou au bowling, comme au temps de notre jeunesse, pour ritualiser une amitié qui nous semblait éternelle.
Mon objectif était donc atteint : je jouissais d’une existence confortable. Je maîtrisais ma vie et voulais la guider à l’encontre du poisson qui se laisse porter au gré du courant. Pour profiter pleinement de cette vie, je pouvais offrir à mes amis tous les plaisirs qui me passaient par la tête. Avoir de l’argent ne suffisait pas et pour savourer ces moments, mes amis devenaient indispensables. Une nécessaire amitié profonde devait compenser une existence aussi superficielle que matérielle. Nous nous connaissions depuis l’adolescence et avions vécu ensemble toutes les étapes de la vie qu’un homme pouvait connaître. L’argent entre nous ne devait pas être un tabou, ni un devoir et encore moins une règle. Il ne servait de support qu’au plaisir d’être réunis. Aussi nous passions parfois de très longues minutes à la terrasse d’un café sans parler. Être rassemblés dans notre amitié, sans un mot inutile, formant, alors, l’entité unique de l’entente parfaite.
Le patron du restaurant d’altitude nous connaissait bien pour être de bons clients et nous proposait, maintenant, des plats non-inscrits sur la carte pour notre plus grande joie. Ce jour-là, le serveur nous trouva une place dans une terrasse bondée que favorisait ce jour idéal. Nous nous installâmes et prîmes notre temps pour manger. Quand nous fûmes au dessert, la terrasse s’était vidée de la plupart des skieurs, pressés de retourner sur les pistes. Le patron nous offrit le café et nous parla un moment. Le restaurant se désemplissait rapidement. Presque plus personne ne s’attardait. Un homme pourtant, non loin, semblait apprécier l’instant convivial et nous regardait avec intérêt certain. José reposa sa tasse ayant avalé la dernière gorgée et ordonna :
— Bon, les gars ! On y va ?
— C’est parti ! répliqua Bertrand.
Sur ce, il se leva, suivi de nous tous.
— À demain et bonnes descentes, nous lança le propriétaire tout en débarrassant la table.
Le patron rassembla quelques tasses et leva la tête. De sa terrasse, il aperçut toute la vallée que le temps clair et pur lui permettait de voir. Rarement, une telle vue s’offrait à lui de son restaurant. Il distinguait la route sinueuse, qui en lacets désordonnés, se laissait guider par le torrent qu’elle suivait et qui se perdait dans la vallée. Au pied de celle-ci, il observait nettement les toits d’ardoise du petit village niché dans un creux et, plus près, en contrebas, la station bouillonnante de vie. Il se permit quelques secondes pour contempler ce panorama d’une journée exceptionnelle, comme l’ultime moment avant l’inéluctable dégradation, comme la fleur montrant ses plus beaux atours avant de faner lentement dans son vase. Il se rendit bien compte alors du privilège que la nature lui offrait et qui dure le temps d’un présent, celui que l’on découvre avant de le poser pour l’oublier. Devant lui, il vit un homme qui, dos tourné au paysage, ne se souciait pas du spectacle et buvait son café, en observant notre petit groupe partir. Le patron fulminait en silence, pensant que ce particulier ferait mieux de regarder le paysage plutôt que braquer des yeux les gens ou les filles. Mais, pressé par le travail, il retourna à sa tâche et détourna le regard de ce bouquet de couleurs pures et fraîches qu’un Dieu a bien voulu offrir au plus commun des mortels.
Non loin de là, José, Éric, Bertrand et moi nous en donnions à cœur joie. Et comme le commun des mortels, nous ne nous préoccupions pas non plus du cadeau divin. Grisés par la vitesse et la compétition, nous nous lancions des défis. Vaincre, être le meilleur, prouver que l’on a réussi en tout point, en toute occasion. Le ski en était une parmi d’autres. Et entre nous, par jeux, nous nous testions et nous nous éprouvions. Nous y prenions plaisir. Chaque fin de piste se terminait en franche rigolade et en nouveaux défis. Chaque descente annulait la précédente. Et les parcours changeaient ou revenaient si on les délaissait trop souvent. Sous la forme de jeux, les courses étaient fréquemment chronométrées. Et chaque danger frôlé, chaque prise de risque redoublaient nos émotions et notre joie de se prouver notre courage ou notre capacité à être un homme. Sans animosité entre nous, mais dans l’amitié, nous nous livrions à notre prosaïque virilité. Nous n’avions rien à gagner à part nous démontrer notre aptitude. Et pour le final, perdants et gagnants montaient ensemble sur le même podium de l’amitié, autour d’un verre pour célébrer notre victoire, comme si nous avions vaincu ensemble, hydres et cerbères.
Après cinq heures, comme chaque jour, en un rituel bien établi, nous rentrions pour jouer aux cartes. Puis un peu avant le dîner, nous descendions au « Cheval blanc » pour faire une partie de fléchettes et prendre l’apéritif avant de nous mettre à table.
Ce soir-là, nous descendîmes dans la rue en direction de notre lieu de rendez-vous habituel. La chaussée encore recouverte des récentes chutes de neige ne permettait pas une marche aisée. En zigzaguant entre les plaques compactes qui luisaient sous l’éclat jaune des réverbères, notre petite troupe remontait la rue vers le restaurant. Dans la nuit, l’atmosphère des rues sombres et vides contrastait avec la vie grouillante de la journée. Pas un bruit, pas un rire ne venaient égayer la nuit noire. Personne ne disait mot. Et tous les quatre, avancions silencieusement avec la hâte de rejoindre le « Cheval blanc ». Nous parcourions en silence la rue, quand non loin, devant nous, adossé à un réverbère, nous vîmes un homme qui s’y accrochait. Dans cet endroit désert et silencieux, nous le remarquâmes aussitôt. L’homme lâcha le poteau avec hésitation et tenta de s’y éloigner. Il titubait et chaque pas se négociait avec un long temps de réflexion. Bertrand s’arrêta. Il désigna du doigt l’homme de l’autre côté de la rue qui, en voulant faire un pas, perdit l’équilibre et tomba sur le trottoir. Notre groupe suspendit sa marche un moment pour observer ce phénomène. Non pas pour rire de lui, mais surpris par un spectacle singulier. José voulut intervenir pour l’aider à se relever. Mais l’homme, se redéployant lentement, avec moult difficultés pour tenir l’équilibre, se redressa sans aide. Au bout de ses efforts, il s’appuya alors contre un mur.
— Il y a du vent dans les voiles, gloussa José.
— Je ne sais pas où il va, mais il n’est pas près d’arriver, répliqua Bertrand.
À cet instant, en face, l’homme, surpris de nous voir, comme si nous venions de surgir brusquement, nous regarda un moment. La tête instable sur ses épaules gîtait lentement de gauche à droite, se redressait puis retombait un peu avant de revenir en arrière. Et d’un pas incertain, il traversa la rue en évitant la chute à chaque enjambée. Puis, au milieu de la chaussée, il s’arrêta, mit un moment avant de se stabiliser et regarda le groupe près de lui. Alors, il me considéra et leva lentement le doigt vers moi :
— F... F... Faut… Faut pas…
N’arrivant pas à s’exprimer, il fit un geste de négation avec tout son bras, exagérément. Il me fixait intensément de ses yeux brouillés par l’alcool. Mais soudain, il se pencha et vomit au milieu de la rue.
Éric poussa un cri de dégoût.
— Bon, ça suffit, on en a assez vu, partons !
— Tu as raison, laissons-le, on ne peut rien pour lui.
Je regardais l’ivrogne un moment, puis nous continuâmes notre route sans nous préoccuper davantage de l’alcoolique. Je me demandai comment on pouvait en arriver là. Boire d’accord, mais au point de ne plus se contrôler, voilà qui me choquait profondément. Et en observant ce qui pour moi n’était plus qu’une loque, j’exprimai une grimace de dégoût. Je ne pouvais pas avoir de la pitié pour lui. Il ne la méritait pas. Un homme qui n’est plus maître de lui-même n’était digne d’aucune compassion. Pour moi, le plaisir de l’alcool prenait fin là où l’ivresse commençait. La maîtrise de soi, être maître de ses émotions faisait la différence avec l’animal. Je méprisais tous les gens qui perdaient le contrôle de soi aussi bref soit cette perte.
Après ce triste spectacle, nous arrivâmes soulagés de pénétrer dans l’atmosphère chaleureuse et animée du restaurant.
— Salut les gars ! dit le patron en nous voyant passer la porte.
Nous répondîmes en nous installant au bar sur de hauts tabourets.
— Qu’est-ce que je vous sers, comme d’habitude ?
José nous regarda tour à tour d’un air interrogateur, puis se retourna vers le patron.
— Allez ! Comme d’habitude, Olivier.
— Ça marche, répliqua Olivier.
Pendant, qu’occupé au bar, il nous préparait l’apéritif, je lui demandais :
— Dans la rue, on a vu un gars complètement ivre, il vient de chez toi ?
— Quel gars ? demanda le patron.
— Je ne sais pas, il est là, sur le trottoir, à deux pas et il est dans un sale état. Je désignais du bras l’entrée du restaurant.
Olivier fit le tour de son comptoir et se dirigea vers la porte. Il l’entrouvrit et scruta la pénombre de la rue. Puis il revint au bar en annonçant :
— Non, il ne vient pas d’ici, mais je le connais, c’est un ancien client. Je ne veux plus qu’il vienne, il boit trop.
— Je ne l’ai jamais vu, dis-je.
— Non, je l’ai chassé avant votre arrivée. C’était un bon client même que je connaissais bien. Cela fait plusieurs années qu’il fréquente mon bar. Il ne buvait pas autant, juste un verre ou deux. C’est depuis un mois ou deux qu’il s’est mis à boire.
— Comme ça ? demandai-je.
— Comme ça, tout d’un coup, répondit le patron. Je crois qu’il a eu de graves ennuis et il s’est mis à boire comme si ça pouvait l’aider à surmonter ses problèmes. Mais ça n’a rien arrangé, bien au contraire.
— Qu’a-t-il eu comme ennui ? demandai-je.
— Je crois qu’il en a eu pas mal. Des affaires avec sa femme et son boulot, je crois. À moins que ses soucis de travail aient entraîné des problèmes avec sa femme. Mais quand je l’ai connu, il était bien. Maintenant, c’est une vraie larve. Son épouse est partie avec amant et enfants.
— Il a essayé de nous parler, dis-je, mais il n’a même pas réussi à prononcer un mot.
— Oui, dit José, mais il a tenté de te parler, comme s’il te connaissait.
Je haussai les épaules et bus un peu de Martini avant de répliquer :
— Quoi qu’il advienne, la beuverie n’est pas une solution et c’est la faiblesse qui l’a amené à boire. C’est peut-être à cause de sa faiblesse qu’il a perdu son travail et pas su retenir sa femme.
— Tu parles comme si c’était de sa faute, dit Bertrand.
Je ne répondis pas, mais oui, pour moi, on a que ce qu’on mérite. Éric, discret en ses opinions, préféra écouter les autres plutôt que d’imposer une idée qui pourrait froisser les mentalités.
— Bon, il ne faut pas que ça nous empêche de faire une partie de fléchettes, coupa José qui ne voulait pas que le moral redescende.
— Ah oui, tu as raison, répondit Bertrand, allons-y.
Olivier distribua les fléchettes et je commençai le premier. Pendant que je jouais, quelques personnes qui venaient d’entrer nous regardaient faire.
Nous oubliâmes rapidement l’alcoolique et les causes possibles de sa déchéance pour nous concentrer sur notre partie et notre plaisir d’être ensemble. La soirée se passa tranquillement et quand nous retournâmes à notre appartement, nous ne pensâmes même plus à cet homme que nous croisâmes dans cette rue vide.
Le lendemain matin, j’ouvris les rideaux avec hâte pour savoir si le temps de la veille s’était maintenu. Quelques cirrus voilaient quelque peu le ciel pourtant si purs la veille. Cependant, les conditions pour skier n’en souffriraient pas. Je remarquai également que la ligne dentelée des cimes qui découpait l’horizon n’était pas aussi nette que la veille. Mais peu importe pour moi, seules les conditions pour le ski importaient. Le programme, élaboré pour la journée, ressemblait donc à celui de la veille. Cependant, en milieu de matinée, le vent se leva et à midi, nous ne mangeâmes pas à la terrasse du restaurant d’altitude, mais à l’intérieur. Nous prîmes notre temps pour déjeuner et discuter avec le patron, et c’est vers deux heures, une fois la salle bien vidée, que nous nous décidâmes à skier.
— Bien ! Rouge ou bleu ? demanda Éric en chaussant ses skis.
— Rouges, décidai-je, les bleus m’ennuient maintenant.
Nous filâmes tous, me suivant vers la piste rouge la plus proche. La neige était bonne et nous slalomions à travers les bosses avec aisance. Tout à coup, je me sentis emporté sur le côté et tombai dans la neige. Aussi, je levai les yeux pour comprendre ce qu’il s’était passé et j’aperçus un skieur à côté de moi, allongé, prêt à se relever. Celui-ci enleva ses lunettes et son bonnet. Je vis alors non pas ce que j’avais cru être un homme, mais une fille aux cheveux d’or qui me considérait l’air consterné.
— Oh ! excusez-moi, dit-elle, j’ai loupé la bosse au moment où vous arriviez. Vous n’avez rien, j’espère.
Je fus saisi par la beauté de la jeune femme. Elle me regardait avec des yeux vert clair et perçants dont l’expression reflétait une sincère empathie.
Je mis un temps avant de répondre :
— Non, mademoiselle, je n’ai rien. Mais vous-même ?
— Vraiment, non, je n’ai rien.
Sur ce, elle se mit debout et frotta son anorak afin d’enlever la neige qui s’y collait. Je la regardais faire, subjugué. Je ne me souvenais pas d’avoir déjà rencontré une femme aussi belle. Je devinais à travers ses vêtements de longues jambes bien faites. J’observais aux mains des articulations fines et délicates. Son visage m’inspirait intelligence et sympathie.
— Hé bien, si tout est OK, je continue alors. Bonne descente.
Et sur ce, elle se lança avec rapidité dans la pente neigeuse. Elle me laissa pantois un moment. Je la regardai s’éloigner. Un sentiment ineffable me troublait l’esprit et j’attendis un peu confus avant de m’engager sur la piste à mon tour, rejoindre Éric, Bertrand et José. Quand j’arrivais en bas, mes amis m’attendaient avec une pointe d’impatience.
— Tu as eu des soucis ? demanda José.
— Oui, répondis-je, une fille m’est rentrée dedans.
— Mouais, que n’inventerais-tu pas pour cacher ta maladresse au ski ? répliqua José en riant.
— Et elle était comment, cette maladroite ? demanda Éric d’un air malicieux.
— Blonde, répondis-je, et jolie avec ça.
— Et tu lui as donné rendez-vous pour lui offrir à boire ce soir au bar, pour te faire pardonner, dit José avec un sourire en coin.
— Hé bien non, je n’ai guère eu le temps. Elle est partie comme elle est venue. En coup de vent.
— Tu vieillis, mon gars, dit Bertrand en rigolant, maintenant, continuons !
— Pfft ! fit Éric en souriant, pour me faire comprendre qu’il ne croyait pas à mon histoire de chute.
— Continuons ! répétai-je, ignorant Éric.
Et sur ce, nous poussâmes sur nos bâtons et nous laissâmes emporter par la pente raide.
Nous n’eûmes plus aucun incident et la journée se termina comme d’habitude, au « Cheval blanc ».
— Salut les gars ! dit Olivier en nous voyant entrer. Installez-vous, je vous sers vos apéros.
Nous prîmes place au comptoir.
— Il est clair que le temps est au beau fixe, vous êtes tout bronzés, dit Olivier en nous servant.
— Formidable, le temps est bien meilleur que la semaine dernière, espérons que ça va continuer, dis-je.
— Je ne crois pas, répondit Olivier, ils ne présagent rien de bon à la météo.
Je haussai les épaules en me disant que la météo était souvent bien aussi incertaine que le temps.
— En tout cas, annonça Bertrand, la neige a fondu dans la rue et l’on a pu venir sans slalomer sur les trottoirs pour éviter les plaques de glace.
— Au fait, dit le patron, vous souvenez-vous de l’ivrogne que vous aviez vu hier soir ?
— En effet, dit José.
— Eh bien, il est venu au bar cet après-midi.
— Te réclamer un verre ? demanda Bertrand.