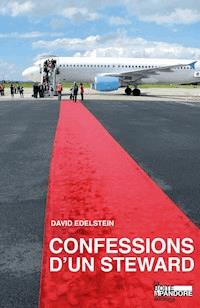
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
La face cachée du « low cost ».
Tout le monde ne rêve pas d’être hôtesse de l’air. Mais lui, il y a toujours pensé. Un avion est une salle de spectacle : lubies des passagers, délires des commandants de bord qui se prennent parfois pour les rois du monde, équipages qui tentent de gérer au mieux les rotations de vol, les passagers incontrôlables, sans oublier… le nettoyage de l’avion. Oui,
David Edelstein est steward sur une compagnie low cost. D’une plume trempée dans le vitriol, il raconte avec humour son quotidien ainsi que la réalité de ce système de gestion de l’aérien qui s’étendra bientôt à Air France et à toutes les compagnies aériennes aux prises avec une conjoncture économique en crise. Mesdames et Messieurs, veuillez attacher votre ceinture de sécurité et découvrez la face cachée du « low cost ». Et bien évidemment, toute ressemblance avec des compagnies aériennes n’est pas... fortuite.
Plongez dans le témoignage d'un steward, et découvrez un portrait du monde aérien dressé avec humour.
EXTRAIT
-Ah les demoiselles ont de la chance ! s’écrie le pilote.
-Je ne pense pas. Je suis basée à Londres Gatwick. Alors que je me rendais à l’aéroport pour un simple aller-retour vers La Rochelle, ils m’ont informée que je serais sur le vol vers Lyon. Lorsque je suis arrivée dans la salle des équipages, nous étions cinq au lieu de quatre sur le vol. Nous étions tous étonnés. Ils nous ont ensuite appelé pour demander à l’un d’entre nous de se porter volontaire pour une « mise en place » vers Lyon. Comme j’étais la seule à avoir des habits de rechange, l’équipage m’a désignés, se plaint une collègue.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© La Boîte à Pandore
Bruxelles – Paris
http ://www.laboiteapandore.fr
La Boîte à Pandore est sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-168-4 – EAN : 9782390091684
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
David Edelstein
Confessions d’un steward
Bienvenue à bord
Je poursuis ma carrière dans le transport aérien. Je l’ai débutée chez CarrottAir, je suis ensuite parti quelques années chez Air Mirage au Moyen-Orient, à bord du plus gros avion des airs, pour finalement revenir chez CarrottAir, en France. J’aime CarrottAir et j’aime mon métier: steward, hôtesse de l’air, PNC, désormais chef de cabine. J’aime toujours autant prendre l’avion tous les matins. J’aime cette ambiance, cette odeur, ces passagers.
« Mesdames et Messieurs, nous avons retrouvé un cerveau dans la salle d’embarquement, celui ou celle qui l’a oublié, merci de quitter l’appareil sur le champ ! ». Les passagers applaudissent et rient aux éclats.
« Mesdames et Messieurs, tous les appareils électroniques, y compris les téléphones portables doivent être éteints pour le décollage ; même s’ils sont en mode avion, ils doivent être complètement éteints ».
Je dois négocier avec une bonne dizaine de clients pour qu’enfin ils daignent éteindre leurs précieux outils de communication. D’autres cachent leur joujou dans leur poche, et le ressortent aussitôt, dès que je m’éloigne. Or, je me rends vers le fond de la cabine, alors que je dois m’asseoir à l’avant. Les passagers ne remarquent pas que je rebrousse chemin et je les surprends tous. Un jour, je perdrai patience et j’écraserai un iPhone sur la tête d’un passager. Il sera alors temps que je prenne ma retraite. J’aurai de beaux souvenirs à raconter.
J’aime mon métier. J’aime cette ambiance particulière au transport aérien, cette solidarité qui existe entre les employés de toutes les compagnies aériennes. J’aime mes collègues aussi : ces débats à l’arrière de la cabine autour de savoir si Britney Spears est trop grosse ou non, cette formidable liberté de parler de sexe. J’aime voir les hétérosexuels se transformer peu à peu en homosexuels, les commandants de bord continuer de croire qu’ils sont les rois du monde parce qu’ils règlent la note de tout l’équipage au bar de l’hôtel. J’aime également cette énorme facilité que nous avons pour voyager : mes parents se préparent des semaines avant leur départ, je peux préparer ma valise pour un trekking de trois semaines au Népal deux heures avant de me rendre à l’aéroport. J’aurai d’ailleurs pris la décision de partir au Népal trois heures avant de décoller pour Katmandou.
Je profite de la vie, je ne travaille qu’un jour sur trois. Je profite d’un excellent salaire, trois fois le revenu minimum. La retraite se touche après trente ans de travail seulement. J’ai du temps. Du temps pour entreprendre, pour apprendre, pour écrire, pour rire.
J’ai intégré CarrottAir et je poursuis gentiment ma carrière dans l’aérien. J’aime l’ambiance de travail détendue. J’ai réussi à gravir les échelons très rapidement : je suis devenu chef de cabine. Désormais, je dois gérer la bonne coordination entre les hôtesses, les pilotes, les agents d’escales, les passagers, les femmes de ménage et les réceptionnistes des hôtels. Un défi ? Non ! De bonnes occasions de rire ! Tellement qu’un producteur m’a proposé de monter un « one-man-show ». J’imagine le spectacle : « Jean-Pierre, l’hôtesse de l’air ». Un spectacle haut en couleurs, avec des chorégraphies, des danses, des costumes, des effets de lumières, des vidéos rigolotes et surtout un escalier posé sur la scène d’où descendrait Jean-Pierre, une bouteille de champagne à la main, le regard hautain, un nœud rouge autour de la taille, entonnant : « Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air, toute ma vie j’ai rêvé de voir le bas d’en haut. Toute ma vie, j’ai rêvé d’être une hôtesse de l’air, toute ma vie j’ai rêvé d’avoir les fesses en l’air ! ».
Un avion, c’est aussi une salle de spectacle. En attendant, voici mon témoignage, mon métier, mon quotidien comme vous ne les avez jamais vus. Voici mes souvenirs!
Joyeux Halloween !
Il y a des travaux de voirie en face de chez moi. Les employés de la direction départementale de l’Equipement (la DDE), habillés en orange vif comme les prisonniers de Guantanamo, ont lancé leurs marteaux-piqueurs dès sept heures du matin, ce qui a le chic d’énerver tout le voisinage. Je gare ma voiture et comme je suis sur les rotules après avoir fait mes quatre vols du matin, j’oublie d’enlever mon uniforme avant de me rendre à la boulangerie voisine pour acheter une baguette. Garder son uniforme lorsque l’on doit affronter la foule est une faute de « bleu ». Dans l’avion, je représente l’autorité, j’ai une légitimité toute faite. Hors du tube métallique, je suis un guignol mal fagoté, à la merci des frustrations de passagers qui m’imputent tous les maux du transport aérien : le vol était en retard, un bagage a été cassé, il y a eu des turbulences pendant le trajet, le café n’est pas bon dans les avions. Qu’ils aient voyagé dans un avion de ma compagnie ou non, ils s’en fichent. Je suis steward, je travaille dans les avions, c’est-à-dire dans le transport aérien, donc je suis responsable de la grève des contrôleurs aériens, de la pluie et du beau temps. J’entre dans la boulangerie. Il y a un monde fou. On me remarque grâce à ma grande parka de couleur orange vif. Le nom de ma compagnie est écrit en grand sur les manches, le dos et l’avant de cette veste en plastique. Les clients me dévisagent, hébétés par l’immondice que je porte sur mes épaules. Heureusement, ils ne peuvent apercevoir le jean baggy et la chemise gris-orange que je porte. Alors que j’étais le dernier arrivé dans la boulangerie, tous les clients reculent, me libérant le passage dans le but ultime de me dévisager encore plus. J’entends leurs chuchotements. Quelle spécialité française de critiquer les tenues vestimentaires de leurs concitoyens ! Je garde mon calme, j’ai perdu toutes mes forces : je suis exténué. J’attends derrière une vieille dame. Elle a du mal à trouver une pièce de deux euros qu’elle confond, étonnamment, avec les centimes. Elle prend son temps car à son âge, du temps, on en a plus qu’il n’en faut. Elle profite également de ce moment où elle reçoit, enfin, toute l’attention qu’elle demande. Elle papote et se plaint bruyamment des travaux de voirie. Je semble être le seul à trépigner, les dizaines de clients qui attendent ont l’esprit occupé par mon parka très moche. Quand la vielle se retourne enfin, elle reste figée, me dévisageant de la tête aux pieds :
« C’est donc vous qui faites tant de bruit avec vos travaux ? »
« Désolé, Madame. Non ce n’est pas moi. »
« Comment ça, ce n’est pas vous ! Vous êtes habillé en orange. Vous travaillez pour la DDE, non ? »
« Non Madame. Je travaille pour une compagnie aérienne, je suis steward. »
« Vous, steward ? Avec ça, sur le dos ? Les stewards sont élégants et certainement pas habillés en clowns comme vous. J’espère que vous aurez bientôt fini avec vos travaux car le bruit me tape sérieusement sur les nerfs ! » Et la vieille sort du magasin, fière d’avoir mis les points sur les « I » à l’impertinent que je dois être à ses yeux.
Je reste bouche bée, le public rit aux éclats. Je m’engonce dans ma parka surdimensionnée et je prends la poudre d’escampette.
Welcome !
Ce matin, ma chef de cabine semble froide. Elle ne décoche pas un sourire et garde un visage fermé. Je soupçonne une sciatique. Elle est de mauvaise humeur alors que je suis de très bonne humeur. Nous voyageons à destination de Palma de Majorque. L’avion est plein à craquer de touristes allemands. Ils sont également d’humeur festive. Je dois détendre ma chef de cabine à tout prix, la faire rire. Ça tombe bien, ce matin je n’avais comme sous-vêtement propre que mon caleçon zèbre. Elle saisit l’interphone pour saluer nos passagers en trois langues : français, anglais et allemand. Je saisis une boite métallique où nous rangeons nos ustensiles, et je me tiens dessous, à l’arrière de la cabine. La chef de cabine me dévisage, se demandant quelle bêtise je m’apprête à faire. J’ai une réputation à tenir : celle de guignol de service. Alors que le ton de sa voix ferait s’endormir un mort, les passagers ont les yeux rivés sur leur magazine ou scrutent l’horizon. J’en profite pour baisser mon pantalon et danser comme un canard. La chef de cabine réagit, enfin presque. Elle écarquille les yeux. Je ne prête plus attention à ce qu’elle dit ; elle entame sa présentation en dialecte suisse. Elle annonce aux passagers :
« Mesdames et Messieurs, vous pouvez à présent profiter d’une chorégraphie effectuée par mon collègue à l’arrière de la cabine. Je précise qu’il vient de baisser son pantalon et qu’il porte un caleçon zèbre. »
A cet instant très précis, cent cinquante-six paires d’yeux se tournent vers moi. Je pivote sur moi-même. Je réalise, après un long moment de solitude, que je suis en train de me ridiculiser devant cent cinquante-six personnes. De grands éclats de rires fusent en cabine. Ma chef de cabine me rejoint à l’arrière et m’annonce :
« Tu feras le service tout seul. Bon courage ! »
A l’atterrissage, les bars sont vides. Les touristes allemands ont tout acheté. Pour vendre, il faut savoir donner de sa personne, et je remercie Dieu car il fait en sorte que le ridicule ne tue pas.
Chippendale
Nous retournons vers Bâle depuis Barcelone. C’est mon dernier vol car je quitte CarrottAir pour m’exiler à Dubaï. Suis-je en train de faire une erreur ? Suis-je en train de me laisser bercer par des illusions ? Suis-je en train de sacrifier une carrière prometteuse au sein de CarrottAir pour pouvoir voler à bord de l’A380 ? Autant de doutes qui m’habitent mais ne me désarment pas. S’il s’agit de mon dernier vol en tant que cabin crew pour CarrottAir, je veux conclure par une note exceptionnelle et faire de ce dernier vol un vol inoubliable. Ce fut un vol inoubliable pour moi, car sur ce vol, un homme d’une beauté exceptionnelle a pris place aux sorties de secours, où je me tiens. J’ai remarqué cet homme aux allures de statue grecque dès son embarquement. La chef de cabine croise mon regard et elle semble tout autant aux anges que moi. Il a la peau mate, une barbe très bien taillée. Il est grand. Sa chemise ouverte laisse apparaitre la ligne verticale qui sépare deux pectoraux ultradéveloppés. Son sourire d’ivoire est impeccable. Je devine de l’ambre dans ses yeux. Son parfum est enivrant. Sa voix, rauque, m’hypnotise. Ses mains sont larges, comme celles d’un travailleur manuel. Je pense qu’il doit beaucoup courir car ses fesses sont rebondies et bien hautes. Je remarque qu’il n’a pas de bague à son annulaire gauche. Je rêve. J’engage une conversation avec lui, j’essaie de déceler des indices qu’il pourrait me donner sur son orientation sexuelle. Une voix qui s’élève dans les aigus, un regard charmeur sur mon postérieur, une allusion à ma cravate car la cravate, droite et longue est l’allégorie de ce que l’on aime chez les hommes. L’indice que j’attendais vient d’embarquer par la porte avant gauche. Je croise à nouveau le regard de ma chef de cabine qui semble être désolée…pour moi.
Une bimbo aux seins aussi faux qu’ils sont hauts, aux fesses aussi larges que mon bras et aux lèvres, supérieures, de la taille d’un pouce chacune, secoue ses hanches pour rejoindre son amoureux qu’elle embrasse ostensiblement devant mes yeux écœurés. Je retourne à l’arrière de la cabine, déçu par tant de faux espoirs. A ce moment-là, je ne soupçonne pas encore que mes mains glisseront bientôt le long de son corps.
Nous débutons le service. Il ne s’agit plus d’un service mais d’une course entre la chef de cabine et moi, une course à celui ou celle qui, le premier, servira ce bellâtre et sa péripatéticienne. Je gagne la course bien évidemment, et sans tricher. Au moment où je m’apprête à lui proposer quelque chose à boire, l’être mi-homme mi-dieu se lève et me demande de lui dégager l’espace pour qu’il aille aux toilettes. Il a l’air livide. Je suis empêtré avec mon chariot et je prends de longues secondes avant de pouvoir le déplacer. Je me tiens en face du bel-ami qui tombe raide sur ses genoux. Sa tête arrive au niveau de ma taille ; son visage, au niveau de ma ceinture. Je sue, une bouffée de chaleur me réchauffe jusqu'à la pointe des oreilles. J’ai un beau garçon à mes pieds, dans une position pour le moins très érotique. Ma transe est presque interrompue par les rires et les sifflements coquins des passagers qui assistent à cette scène pour le moins croustillante. Le passager évanoui tombe ensuite sur son dos épais. Mon réflexe, très juste, est de lui relever les jambes. Je pose la jambe droite sur l’accoudoir du siège droit ; la gauche sur l’accoudoir de gauche. Je rampe jusqu'à son visage, je lui tapote les joues pour vérifier ses réflexes. Etrangement, cette position me force à poser mon bassin sur le sien, et à écarter un peu plus ses jambes. Je dois vérifier sa respiration. Ma main s’achemine sur son torse, je déboutonne sa chemise lentement, chaque bouton ouvert me fait frémir de plaisir. Je découvre un torse parfait, aux muscles saillants. Sa respiration est quasi inexistante. Je souris à l’idée de devoir lui faire du bouche à bouche. Je prends une bouffée d’oxygène et entrouvre ma bouche. L’auditoire en reste muet : ils s’apprêtent tous à devenir témoin d’une scène de viol. Les secondes deviennent de longues minutes. L’exaltation est à son comble. Mon pantalon devient de plus en plus serré au niveau de l’entre-jambes. Je prends appui sur mes deux bras, mon bassin colle au sien, je ne suis qu’à quelques centimètres de son visage.
Il reprend soudainement conscience après qu’un verre d’eau ait été jeté depuis un siège. Le visage trempé, je me retourne. Sa petite amie a mis fin à la scène. Je le savais : celles qui ont un petit ami aussi beau ne peuvent qu’être femmes, égoïstes et jalouses.
DIRIGAF, Do I really give a fuck ?
Le métier de personnel navigant commercial (PNC) est un métier de « service à la clientèle ». Nous devons être là pour nos clients, répondre à leurs besoins, leur apporter du confort et nous assurer de leur sécurité. Nous devons surtout leur parler, communiquer avec eux, échanger des informations et répondre à leurs questions à la con. Apres plusieurs années d’expérience dans le transport aérien, j’ai appris à abréger les dialogues et à répondre de la façon la plus concise et rapide qui soit. Dans le pays de Descartes, où l’éloquence est plus importante que le sens, mieux vaut être succinct plutôt que de s’attarder et s’empêtrer dans des dialectiques infécondes. De toute façon, nous n’avons pas le temps : il serait intenable d’accorder plus de cinq minutes à chacun des cent quatre-vingt passagers voyageant entre Paris et Nice, c’est-a-dire soixante minutes de vol. Alors on fait court.
« Pourquoi sommes-nous en retard ? »
« C’est la tour de contrôle qui nous a impose une restriction DIRIGAF, retardant ainsi notre départ ».
« Pourquoi n’a-t-on pas le droit d’emporter une bouteille d’eau à bord ? »
« C’est l’agence DIRIGAF qui a imposé cette mesure à tous les passagers de toutes les compagnies aériennes ».
« Votre uniforme est bien moins joli que celui d’Air FanFan ! »
« C’est pourtant le designer DIRIGAF qui les a dessiné ! »
« C’est quoi le bruit qu’on vient d’entendre ? »
« C’est le DIRIGAF »
« Comment est le pilote ? »
« Il a été formé chez DIRIGAF »
« Pourquoi l’avion bouge autant ? »
« Nous traversons une couche de DIRIGAF »
« Puis-je vous régler en pesos ? »
« Désolé, Monsieur, mais la procédure DIRIGAF ne me l’autorise pas »
« Est-ce difficile de devenir hôtesse de l’air ? »
« Il faut obtenir le master en DIRIGAF »
« Comment s’appelle ce petit village-là que l’on voit sur le versant sud de cette montagne ? »
« DIRIGAF, Monsieur, il y a un très bon restaurant là-bas qui s’appelle le DIRIRIGAF avec comme spécialité le SOAP (shit on a plate, merde sur assiette) »
« La rivière qu’on voit, elle s’appelle comment ? »
« DIRIGAF, elle se jette dans la Garonne »
« On vient de croiser un avion juste à l’instant, c’est quelle compagnie ? »
« DIRIGAF, bien plus cher que la nôtre »
La réponse à toutes les questions, c’est DIRIGAF :
« Pour quoi faut-il attacher nos ceintures ? »
« Pourquoi ça pue ? »
« Quel est le nom de la rue ? »
« Quel est le nom de la station de métro ? »
« Où puis-je me plaindre ? »
« Comment me fais-je rembourser ? »
« Pourquoi vous ne volez pas vers Trucmuche-les-bains ? »
« J’ai voyagé avec votre collègue très sympathique, comment s’appelle-t-elle ? »
Le tout n’est pas de répondre DIRIGAF, encore faut-il savoir le dire avec la bonne intonation et la bonne gestuelle. Il faut prononcer DIRIGAF avec beaucoup d’aplomb, comme s’il s’agissait d’une certitude. Il faut ajouter un brin d’arrogance et surtout de condescendance envers celui qui semble ne pas connaitre une chose aussi simple que le DIRIGAF. Dans le pays de Descartes, très peu avoueront ne pas connaitre le DIRIGAF. En France, personne n’avoue son ignorance mais préfère mentir plutôt que de creuser le fond tant que la forme parait brillante. Par contre, les imbéciles existent et vous risquez de rencontrer deux ou trois passagers qui demanderont plus d’informations sur le DIRIGAF. Vous leur répondrez :
« Mais, Monsieur, vous ne connaissez pas le DIRIGAF ? C’est un organisme très connu pourtant, je vous laisse aller sur leur site internet. »
L’imbécile se connectera sur Google et trouvera cette définition :
DIRIGAF: acronyme pour Do I really give a fuck ? Ou Qu’est-ce que j’en ai à cirer très souvent utilisé par les hôtesses de l’air ou steward en guise de réponses à des questions stupides ou pour couper court à tout ce qui semblerait être une perte de temps.
Free seating, placement libre
En Italie, il est strictement interdit d’embarquer des passagers lorsque nous sommes en train de faire le plein de kérosène. Il s’agit d’une mesure de sécurité propre à ce pays du Sud, alors qu’en France, les passagers s’installent dans l’avion et peuvent admirer à travers leur hublot le camion citerne. Je travaille dans le transport aérien depuis plusieurs années et je ne comprends toujours pas pourquoi certaines mesures de sécurité s’appliquent dans un pays et non pas dans l’autre. Je me tiens sur le pas de la porte avant gauche de l’appareil. Nous attendons la fin du refuelling (plein de carburant) pour embarquer la centaine de passagers entassés dans le bus. Cela fait déjà dix minutes qu’ils patientent, coincés dans un bus sans climatisation. Nous sommes quatre cabin crew à bord, le plein est bientôt fini. Les passagers vont pouvoir partir dans une course folle : la course à la meilleure place.
C’est le top départ ! Les portes du bus s’ouvrent. Les dizaines de passagers se lancent à l’assaut de l’avion. Monsieur B a profité des dix minutes d’attente dans le bus pour élaborer sa stratégie et atteindre l’avion le premier : bien qu’il soit installé à l’avant du bus, en face de la porte avant gauche de l’avion, il se dirigera vers la porte arrière gauche, pour pouvoir choisir lequel des cent quatre-vingts sièges accueillera son derrière. Il laisse Madame B, sa femme, un peu désorganisée, ma foi c’est une femme, entrer par la porte avant, pour améliorer leurs chances d’avoir une bonne place. Et voilà Monsieur B qui court à grandes enjambées pour grimper quatre à quatre les marches de la passerelle d’embarquement. Il bouscule une petite fille qui tombe sur le tarmac. Monsieur B se retourne et s’excuse brièvement. Il remarque qu’un autre passager lui a grillé la politesse : en effet, monsieur C est désormais en tête et a déjà posé un pied sur la passerelle. Madame C s’attarde autour de la petite fille bousculée qui pleure : elle s’est écorché le genou. Monsieur C lance un cri vers sa femme pour la rappeler à l’ordre : Cours ! Cours ! Réserve-nous des places !
Il perd ainsi de nombreuses secondes et monsieur B a maintenant les deux pieds sur la passerelle d’embarquement. Les deux bonhommes jouent du coude. Un jeune garçon passe entre leurs jambes. Il s’agit du fils de monsieur D, un habitué des vols de CarrottAir.
Monsieur D a laissé sa femme à la porte d’embarquement, elle le rejoindra plus tard, le goût pour la course lui faisant défaut. Tant mieux, s’était dit monsieur D. Son fils sous le bras, monsieur D est sûr de son coup. La passerelle d’embarquement se divise en 37 marches plus une petite plate-forme pouvant accueillir trois personnes. Le trio de tête à la porte arrière gauche est donc : le fils de monsieur D, mademoiselle F et monsieur E, car messieurs C et B se disputent sur le tarmac.
A l’avant, les familles se partagent la priorité à l’embarquement. Je vois arriver pas moins de cinq familles avec bébés. Je les entends hurler en italien. Je soupire. Les familles italiennes considèrent leurs enfants comme des rois, en aucun cas, je n’ai envie de me transformer en bouffon des rois en les laissant s’asseoir à l’avant. Comme sauvé par un coup du sort, on me demande d’ouvrir la porte avant droite car une personne à mobilité réduite est acheminée par ambulift (sorte de camion de chargement sur roues télescopiques). Les procédures de sécurité exigent que l’embarquement par la porte avant gauche ne puisse se poursuivre si la porte opposée est ouverte. Pour une fois, j’applique une procédure de sécurité avec bonheur ! Je fais signe au chef-avion de diriger les passagers vers la porte arrière uniquement. Fâchés, certains se disputent avec lui, d’autres enchaînent les pas le plus rapidement possible, pour laisser croire qu’ils marchent au lieu de courir. C’est si peu chic de courir ! Je vois mademoiselle F atteindre le haut de la passerelle arrière sans grande difficulté. La manière dont elle se meut est un spectacle ahurissant : elle ne donne pas l’impression de courir, ni même de marcher, mais de rouler sur le bitume. Mademoiselle F est sans aucun doute l’individu le plus gras que j’aie jamais vu. Tous les passagers dévisagent la jeune adolescente sans cou ni jambes. Monsieur C et monsieur B signent une trêve de courte durée, stupéfaits par cet être informe. Nous installons une vieille dame très charmante au premier rang. Nous rangeons sa canne et son sac dans les compartiments à bagages. Nous défions la mauvaise réputation de CarrottAir dans sa gestion des handicapés.
Je remarque qu’aucun passager n’est encore installé : ça bouchonne à l’arrière. Je saisis l’interphone et appelle mon collègue à l’arrière.
« Ils parlent tous italien et me baragouinent que ce sont leurs femmes qui ont les cartes d’embarquement ! Et bien évidemment, leurs femmes sont ailleurs ! Mademoiselle, Mademoiselle ! Attendez ! Tu l’as vue, la grosse ? Elle m’a balancé sa carte à la figure et a bousculé tout le monde ! Je vais me la faire ! Je vais me la faire ! »
« Attends, je m’en occupe ! »
Je regarde ma montre : l’heure tourne. Nous serons en retard dans deux minutes. Je dois prendre les choses en main. Je demande à ma collègue de rester à l’avant et de vérifier les cartes d’embarquement. Je lui donne l’instruction de ne laisser passer aucun passager sans carte d’embarquement. Je fais signe au chef-avion, qui se dispute encore avec deux familles, que la voie est libre à l’avant ! Il y a deux passagères à bord, une vieille et une obèse, tandis que cent soixante-dix-huit personnes, plus six bébés, attendent sur le tarmac. Un raz-de-marée humain s’élance vers la porte avant. Un avion de la compagnie irlandaise concurrente est en attente car il ne peut se garer à côté de nous, car des enfants gambadent partout. C’est le bordel, à l’italienne. Je prends le contrôle de la situation. Je m’avance vers le milieu de la cabine pour gérer au mieux le flux de passagers.
Je demande la carte d’embarquement à la demoiselle obèse. Elle a le malheur de me manquer de politesse en me répondant que la carte est restée avec mon collègue. Je me vengerai le moment venu. Messieurs C et B, essoufflés, arrivent enfin dans l’avion et s’assoient aux sorties de secours. Il faut dire que les sièges aux sorties de secours offrent plus de place pour les jambes, ils sont donc très convoités. Bien qu’ils ont été sur le point d’en venir aux mains, ils deviennent complices et savourent leur victoire commune : tous les deux seront bien installés. Je vois monsieur D hurler à la figure de ma collègue car elle refuse de le laisser entrer sans carte d’embarquement. Il s’impatiente car ils voient les sièges des premières rangées se remplir. Celui qui est installé à l’avant sera le premier à sortir de l’avion à Paris. Mais tous devront attendre ensemble la livraison de leurs bagages, qu’ils soient installés à l’avant ou à l’arrière. Il hurle de plus belle. Je me vengerai. En cabine, c’est le chaos. Ça se bouscule, ça hurle, ça pullule, ça pue même. Ceux qui entrent par l’arrière veulent s’asseoir à l’avant et inversement. Je me tiens en milieu de cabine et je bloque ces contre-courants. Je perds patience et me transforme en commandant militaire.
« Vous, ici ! Vous êtes deux ? Venez vous asseoir là ! Monsieur, poussez-vous, laissez passer ! Madame, vous chercherez votre magazine plus tard ! Non, tu ne peux pas aller aux toilettes ! Ne fermez pas le coffre à bagages ! Comment ça, vous ne voulez pas que d’autres y mettent quelque chose ? Madame, Monsieur V, inutile de garder une place libre entre vous, l’avion est plein (je me vengerai) ! Madame, ne changez pas votre bébé sur le siège ! A qui est cette veste ? Elle prend trop de place, tenez, reprenez la sur les genoux ! Les petits sacs iront sous les sièges devant vous ! Monsieur, restez à l’arrière ! Oui, Monsieur, même l’arrière de l’avion va à Paris ! Il n’y a plus de places pour deux personnes ! Oui, Monsieur, madame survivra de ne pas être à vos côtés pendant une heure, elle en profitera même ! Monsieur, vous ne voyez pas que ce jeune homme veut s’asseoir ? Laissez-le passer ! Mais levez-vous enfin ! Assis ! Assis ! Assis ! Et on se tait ! »
Madame D rejoint enfin son mari et son garçon. Je m’avance vers eux. J’installe madame et son fils à la rangée numéro deux. Monsieur sera assis à la trentième rangée : il profitera des odeurs des deux toilettes et des conversations grivoises des membres de l’équipage. Je me suis vengé.
Mademoiselle F me regarde d’un œil inquiet. Je lui demande si elle peut boucler sa ceinture de sécurité. Elle me dit que oui. Je lui demande de le faire. Elle attrape ses bouées de graisse, les passe presque par-dessus l’épaule et boucle sa ceinture. Elle devient bleue : elle ne peut plus respirer. Je la regarde fixement. Elle est en apnée. Soudain, elle saisit sa ceinture et se détache. Elle a besoin d’une extension de ceinture pour pouvoir s’attacher confortablement, or les extensions ne sont pas acceptées au niveau des sorties de secours. Les issues de secours sont petites et les gros ne passent pas. Je lui signifie qu’elle ne pourra pas rester assise aux sorties de sécurité. Je reste ferme et lui ordonne de s’installer ailleurs (je me suis vengé). Je lui propose de me suivre car j’ai trouvé une place disponible. Je l’installe entre monsieur et madame V (je me suis vengé). Tous les passagers sont installés. Beaucoup ont laissé leurs bagages dans l’allée centrale. Je leur demande de les ranger dans les compartiments à bagages. On me répond qu’il n’y a plus de place et que c’est à moi de leur en trouver. Je pourrais le faire mais préfère me venger. Je saisis une à une les valises et les mets sur la passerelle d’embarquement pour que le chef-avion puisse les mettre en soute. Mon sourire semble rassurer les passagers vindicatifs mais résignés à devoir attendre la livraison de leurs bagages à Paris. Je confie les valises des passagers H, G, T, O, R, W, A, et Q au chef-avion.
Ce dernier me signifie que la tour nous ordonne de décoller dans moins de cinq minutes. Je comprends que les valises n’arriveront pas à Paris au même moment que leurs propriétaires.
Je souris (je me suis vengé).
Hématomes
Le vol vers Alicante s’annonce agréable. Depuis la salle de briefing, nous ne nous sommes pas arrêtés de rire, de tout et surtout de rien, malgré l’heure très matinale. La chef d’escale nous annonce en plus qu’il n’y aura pas d’enfants à bord. Alors, nous devenons les enfants de l’avion et nous jouons. Nous rions beaucoup. Ce vol sera donc un vol agréable, facile, rempli de touristes surexcités à l’idée de bronzer sur les plages espagnoles.
Ma collègue m’attrape le col et y glisse des glaçons. Je me tortille dans tous les sens pour faire sortir ces petits soldats qui me narguent le dos. Dans ma trousse de toilette, j’ai du dentifrice. Je décide d’en badigeonner l’interphone de ma chef de cabine qui a étalé de l’eau mélangée à du sucre sur mon strapontin. Nous mélangeons très peu d’eau à beaucoup de poudre de café. Nous étalons le mélange sur des serviettes en papier que nous déposons sur les sièges des pilotes. Croiront-ils que quelqu’un vient de déféquer sur leurs sièges ? Peu probable. Mais l’idée nous gargarise de plaisir. Je réussis à accrocher une longue bande de papier toilettes sur le dos de mon collègue qui ne remarque rien. Nous gardons notre calme pour qu’il ne se doute de rien avant l’embarquement. Les passagers riront bien. D’ailleurs, nous sommes motivés par l’idée d’inclure les passagers dans notre délire. Et je délire. La folle idée de me cacher dans un coffre à bagages me vient à l’esprit. Tout mon équipage applaudit.
Je grimpe sur les sièges situés au niveau des issues de secours et me glisse sur les longueurs de deux coffres à bagages, capables de soutenir 38 kilogrammes chacun. Il n’y a aucun risque qu’ils se décrochent de la carlingue sous mon poids. Le feu vert est donné au chef d’escale pour qu’il lance l’embarquement. J’entends la meute de passagers courir vers l’avion. Je pouffe de rire.
J’aperçois vaguement la foule s’avancer dans l’avion. Je garde le ventre bien à plat pour ne pas attirer l’attention. J’oublie que le vol est plein, donc que tout l’espace dédié aux bagages sera utilisé. J’oublie aussi que je suis au niveau des sorties de secours qui offrent plus d’espace pour les jambes. Ces places sont chères aux passagers d’un certain âge qui doivent étendre leurs jambes pour éviter une phlébite.
Un vieux monsieur tente de déposer sa valise dans le compartiment où je suis. Je la repousse. Il tente à nouveau, usant de toutes ses forces. Je suis plus fort. Et, tout homme qu’il soit, il n’insiste pas, ne cherche ni la raison qui empêche sa valise d’entrer, ni à avoir le dernier mot. Il range son bagage dans le coffre opposé. Un autre couple arrive. L’homme essaie de ranger son sac que je repousse. Il essaie à nouveau. Je le repousse avec la même vigueur. Alors qu’il est sur le point d’abandonner, sa femme, menue, décide de prendre les choses en main. Elle enlève ses chaussures et grimpe sur son siège. D’un claquement de doigt, elle ordonne à son mari de lui donner le sac. Elle l’attrape et le pousse violemment contre mon bas-ventre. Le choc me laisse bouche bée. Après quelques secondes d’inconscience, je repousse finalement le sac. La femme, qui avait jeté un regard plein d’arrogance à son mari, s’étonne. Elle empoigne le sac qu’elle pousse de toutes ses forces dans ma direction. Je ne refais pas la même erreur, mes bras protègent mon bas ventre et je repousse tout aussi vite le sac. La femme s’énerve. Elle grimpe sur l’accoudoir pour s’élever et obtenir un meilleur angle de vue sur le coffre à bagages. Je me retrouve nez-a-nez avec une petite dame aux cheveux gris, au chignon impeccable, et aux yeux vert émeraude. Elle est déjà très bronzée, sans doute grâce à de multiples séances d’UV. Elle est surprise. Muette, puis effrayée. Enivré par la situation très cocace, je ne trouve rien d’autre que de vouloir l’effrayer encore plus en m’avançant vers elle et en criant :
« Bouh ! »
Là, je perds l’équilibre et je tombe du compartiment à bagages. Mes côtes caressent violemment le dossier d’un siège. Elles n’apprécient pas. Je tombe de tout mon poids sur le sol. La cabine reste silencieuse. Je me relève. Personne ne paraît comprendre la situation et la grande majorité des passagers semble se demander si je suis à ce point imbécile pour m’être caché dans un coffre à bagages et en tomber lourdement. Je fuis la cabine et me réfugie à l’arrière de l’avion.
Je passerai le restant du vol sur mon strapontin à chercher une position qui me soulagerait de ma douleur aiguë.
Le vol s’est terminé sur une belle chute.
Le pilote Dieu-Roi
Quelle est la différence entre un pilote de ligne et Dieu ? Ma foi, Dieu ne se prend pas pour un pilote !
Cette blague résume à elle seule les relations que nous entretenons avec les commandants de bord. Certes, elles sont remplies de respect et le plus souvent, je dirais même quasiment tout le temps, nous partageons de bons moments avec nos pilotes. La très grande majorité d’entre eux comprennent qu’ils font partie d’une seule et même équipe et que nos deux métiers sont complémentaires. J’éprouve un respect certain envers nos commandants de bord. D’abord, parce que je connais leur parcours : ils se sont endettés jusqu’au cou pour pouvoir réaliser leur rêve de piloter un avion. Chaque année, ils mettent leur licence de vol en jeu lors d’un examen en simulateur. S’ils loupent leur essai, ils ne pourront jamais plus piloter. Ensuite, ils ont une approche bien plus pragmatique des choses que nous autres, personnel navigant, pouvons avoir. Nous mélangeons souvent les sentiments, les ressentis dans l’analyse de situation. Ce qui est normal puisque nous avons affaire à des êtres humains. Les pilotes eux, ont affaire à des instruments, à des machines. Pousser le manche à gauche et l’avion tournera à gauche. Pousser un passager à gauche et il vous filera une droite avant de vous écraser au sol. Ainsi, les pilotes restent de bon conseil car ils apportent une approche plus pragmatique dans l’analyse de situations. Puis, dans leur cockpit, ils s’ennuient ferme. Alors, ils restent toujours très disponibles pour entendre nos petites histoires d’hôtesses et de stewards insatisfaits. Enfin, les commandants de bord sont pénalement responsables de ce qui se passe à bord. Ils représentent la loi et peuvent prendre des décisions allant à l’encontre des ordres des autorités (un commandant de bord peut refuser l’embarquement de clandestins rapatriés). C’est pour tout cela que je respecte profondément les pilotes de CarrottAir, et aussi car je les admire de pouvoir poser un engin lancé à 300 km/h alors que je sais à peine garer ma voiture sur une place de parking.
Et puis, il y en a d’autres. Ceux qui ne retiennent que leurs galons et leur autorité sur tout. Ceux-là, je les emmerde.
Roger est une figure emblématique du pilote schizophrène. Il apprécie avant tout et surtout les jolies filles. Il part allègrement vers Nice où nous restons dormir. A chaque fois, il est enjoué. Tellement qu’il dépasse les limites de vitesse au sol, 60km/h pour décoller le plus rapidement possible au lieu des 30. En cabine, nous nous accrochons pour ne pas tomber et tenter vaille que vaille d’effectuer les démonstrations de sécurité. A l’atterrissage, il freinera brusquement. Les passagers seront projetés vers l’avant, retenus par leur ceinture de sécurité. Roger veut se garer le plus rapidement possible. Les moteurs arrêtés, il ouvrira les hublots du poste pour hurler contre le manipulateur de passerelle et l’enjoindre de se dépêcher. Il sortira ensuite du poste pour ouvrir lui-même la porte de l’avion et pousser les passagers à sortir le plus rapidement possible. Si certains traînent, il n’hésitera pas à les houspiller. Je l’ai vu saisir notre mégaphone et hurler dans la cabine « Foutez le camp ! Sortez ! On vous a assez vus ! Le dernier qui sort nettoiera l’avion ! ». Fort heureusement, les passagers ont cru à une blague. Nous sommes les seuls à le prendre au sérieux. Car il ne faut que Roger soit en retard auprès de Jacques et Daniel, ses deux amis comme il les appelle en faisant allusion à une marque d’alcool. Il s’hydrate d’alcool. Je lui ai fait une fois l’affront de lui apporter une bouteille d’eau dans le cockpit, il me l’a jetée à la figure et j’ai pris mes jambes à mon cou. Après avoir descendu des litres de Jacques et Daniel, il prend souvent rendez-vous avec Jackie et Danièle qu’il trouve sur les trottoirs. Je plains les prostituées du littoral niçois. Pour quelques euros, elles acceptent de passer une nuit avec Roger, pourtant repoussant. Il ressemble à un garde-forestier tyrolien, la moustache enroulée sur les côtés. Suite à une maladie obscure, il a perdu toute souplesse au niveau de la nuque et ne semble pas nettoyer son dentier bien souvent. Le lendemain matin, nous le récupérons dans sa chambre, endormi et engourdi. Il titube jusqu’à l’avion, demande un café et laisse le copilote se charger de tout. Lorsque le copilote sort tout juste de son école et semble atteindre péniblement la vingtaine d’années, nous faisons nos prières. Roger a le réveil difficile. Dès qu’arrive sa première commande de café, nous désignons celui ou celle qui devra s’occuper de lui. Et nous l’entendons pester, hurler, vociférer à travers la porte blindée qui le sépare de la cabine. Les passagers semblent inquiets. Nos boyaux se tordent. Nous atterrissons. Roger sort. Il existe trois possibilités : soit il rentre chez lui, soit il vire l’un d’entre nous, soit le copilote s’enfuit. Beaucoup de copilotes s’enfuient. Manque de chance, il décide de me débarquer. Pour aucune raison. Je crois que ma tête ne lui revient pas, tout simplement. Je lui tiens tête. Je le menace de prévenir les autorités s’il le fait. Je serre les dents. Il me toise. Il me prend au sérieux. Il vire le copilote. Nous redécollons vingt minutes plus tard. Un nouveau copilote arrive. Je ferme la porte du poste de pilotage. Les yeux du copilote semblent implorer « Au secours ! ».
Patrice est un crapaud. La nature ne l’a pas gâté, ni en centimètres, ni en traits élégants. Pourtant, il aime se montrer aux jolies et jeunes passagères. A chaque embarquement, il laisse le copilote, son vassal, s’occuper de tous les papiers, et se tient près de la porte pour accueillir celle qu’il jugera à sa « hauteur ». Une belle blonde arrive, elle rejoint Nice. La peau bronzée, les lèvres gonflées, elle dandine et me tend du bout des doigts sa carte d’embarquement. Le radar de Patrice fonctionne à merveille. Il m’arrache la carte des mains et propose de porter le sac de mademoiselle. Elle le dévisage avec un air de dégoût mais se résigne finalement. Je vois dans ses yeux qu’elle a l’habitude de susciter l’intérêt des hommes et de manipuler les plus moches. Patrice ne le sait pas encore mais il ne deviendra pour elle qu’un simple bagagiste. Il l’accompagne donc vers un siège, elle lui demande un verre de vin. Il s’exécute. Elle lui demande de reprendre son bagage du compartiment. Il s’exécute. Elle retire une petite trousse. Il redépose le bagage dans le compartiment. Le manège dure pendant tout le processus d’embarquement. J’appelle enfin Patrice car certains documents doivent impérativement être signés par le commandant de bord lui-même. Il se traîne jusqu’au poste avant de revenir à l’avant et saisir l’interphone. L’annonce retentit dans toute la cabine :
« Mesdames et Messieurs, bonjour. Je m’appelle Patrice, je suis votre pilote. Aujourd’hui, je suis très heureux. Mesdames et Messieurs, aujourd’hui, j’ai rencontré une femme qui sera, je l’espère, très importante dans ma vie. Elle est belle, elle est douce, elle est assise en 6C. Chérie, tu m’as tapé dans l’œil ! ». A ce moment précis, elle secoue légèrement son verre de vin vide d’un délicat geste de la main. Patrice repose l’interphone et court lui en apporter un nouveau. La scène choque nombre de passagers, d’autres pouffent de rire. Je ferme la porte de l’avion. J’annonce notre départ imminent pour l’aéroport de Nice. Patrice reste planté dans la cuisine, scrute le moindre geste de sa dulcinée. Je me tiens devant lui, de longues secondes passent avant qu’il ne me remarque enfin.
« Il faudrait que tu y retournes quand même ! ». D’un signe de tête, je lui montre le poste de pilotage. Il se résigne et part s’enfermer dans le cockpit après avoir envoyé des baisers à la demoiselle, sérieusement gênée. Pendant toute la durée du vol, il multipliera les annonces, soulignant son grand « émoi », sa profonde « joie », son bonheur « ineffable ». La jeune demoiselle perd patience et me demande de calmer les ardeurs du commandant de bord qu’elle compare à du harcèlement. Je transmets le message à Patrice. Il saisit l’interphone et annonce sa « rupture douloureuse » d’avec celle dont il ne connaît même pas le nom. Les passagers restent interdits. Je rougis de honte. Une fois de plus, j’entends le commandant de bord hurler contre son copilote qu’il accuse de tous les maux. L’avion se pose très durement. L’avion freine brusquement. Les passagers hurlent, crient. Patrice les entend et s’excuse d’avoir à ses côtés « un imbécile qui n’a pas appris à poser un avion ! ». J’ouvre la porte, je n’ose même pas dire « à bientôt » aux passagers. On me promet plaintes, rapports et promesses de ne plus jamais voler avec CarrottAir. La coordinatrice de vol s’approche et me demande d’ouvrir la porte du poste. J’hésite. Elle est blonde à la peau bronzée.
Philippe est un pilote narcissique. Il se trouve beau, il se trouve grand, il se trouve merveilleux. Il aime se regarder, ajuster sa mèche blanche. Il aime qu’on l’admire et le félicite pour ses exploits. Philippe a décidé de devenir écrivain. Il aime disserter sur l’emploi des mots, cherchant celui qui conviendra le mieux dans une phrase entre « case », « demeure, « logis » pour finalement écrire « maison ». Nous arrivons avec 40 minutes d’avance sur l’horaire à Casablanca, notre décollage est prévu dans 75 minutes. Nous profitons donc d’une grande pause durant laquelle, Philippe nous lira des chapitres entiers de son roman à paraître, un jour, peut-être, éventuellement sans doute.
L’histoire semble un peu décousue entre un meurtrier agissant pour le compte du KGB aidée dans sa lutte contre la mafia philippine par deux chats capables de parler, et de tirer au pistolet ; et un crocodile chanteur de rap qui se révélera être le digne héritier d’une puissante famille de magiciens habitant sur Mars. Nous restons cois. Nous ne comprenons pas trop l’histoire et avec précautions, nous demandons des clarifications. Philippe lui-même se perd dans ses explications. Il demande notre avis sur le style de son écriture. Je le trouve pompeux, mélangeant maladroitement la justesse de Maupassant avec du rap de banlieue. « Justinien, le cœur haletant par tant de passions dévorantes, l’humeur d’un jeune matelot affrontant les vagues de la vie tumultueuse, décida de casser la croûte au fast-food du coin car il avait une grosse envie de gras ». Nous pouffons de rire. Même le copilote anglais, qui s’essaie à la langue de Molière, comprend que le style ne convient pas. La moutarde monte au nez de Philippe. Il serre les poings et nous passe un sacré savon.
« Mais vous n’êtes que des merdes, des salopes d’hôtesses pas capables de faire autre chose que de nettoyer des chiottes. Vous devriez avoir honte, honte de ne servir à rien. Vous êtes des parasites, des sangsues, des sous-merdes. Toi là, va me faire un café ! Et tu devrais faire un régime aussi, grosse vache ! Tu te fais sauter de temps en temps au moins ? Et toi, va me laver les chiottes, je dois poser une pêche, démerde-toi ! Tu lis quoi, toi, un journal ? Tu sais lire ? Si tu savais lire, t’aurais fait autre chose de ta vie que vendre des chips ! Je gagne 10000 euros, vous savez pourquoi, parce que je suis important, je fais de grandes choses ! Sans moi, personne ne décolle ! D’ailleurs, je vous emmerde tous ! Je me casse ! ». Philippe quitte l’avion et se dirige tout droit vers l’aérogare. Il arrivera trente minutes après l’heure de décollage prévue et ne manquera pas de signaler aux passagers :
« Heureusement que je suis là, hein ? Sans moi, vous seriez encore en train d’attendre comme des cons ! ». Le vol se passe plus ou moins bien. Philippe nous a donné l’ordre de ne pas le déranger. Arrivés dans la salle de débriefing, il nous passe un ultime savon, d’une voix posée cependant. Il nous enseigne la nécessité de construire quelque chose, de devenir important, que nous ne pouvons pas rester des parasites. Je coupe court à la conversation :
« Tu peux prétendre être ce que tu veux. Mais ne prétends pas être meilleur que nous. Moi, j’ai déjà trois livres publiés. Trois. Et je n’ai pas cinquante ans. Et je ne raconte pas des histoires de crocodiles magiciens ». Nous éclatons tous de rire. Philippe s’en va. Il a averti la compagnie que jamais plus, il ne souhaitait voler avec moi. Tant mieux.
Une grande majorité des pilotes de CarrottAir sont des rescapés d’Air Belgique, défunte compagnie aérienne. Ce qui alimente l’entreprise en main-d’œuvre belge. Non des belges francophones, wallons, mais des belges néerlandophones, des flamands, réputés pour être…francophobes. Martin fait partie de cette catégorie-là, francophobe à souhait. Il n’adresse la parole à personne. S’il le fait, c’est pour demander « Are you french ? ». Une réponse positive et Martin se mure dans un silence profond. Il ne serre pas les mains, ne salue pas, ne partage pas avec les Français. Pourtant, il vit à Paris. Il profite d’un contrat de travail de droit français et s’enorgueillit d’arnaquer le système social français (il cumule les arrêts maladie, touche la prime pour l’emploi, ne paie aucun impôt, fraude les transports en commun). Martin me croit allemand. Il est vrai que je maîtrise suffisamment la langue de Goethe pour lui plaire. Martin est né à Bruxelles, je suis originaire de Strasbourg : un lien nous unit, semble-t-il. Il considère que l’Alsace subit l’hégémonie française et que nous autres, Alsaciens, nous sommes empêchés de vivre notre « germanité » à notre guise. Une situation comparable à la Belgique. Je suis donc le seul Français à qui Martin daigne adresser la parole. Grâce à ce privilège, j’ai le droit de lui faire son café. Je lui prépare ses repas en vol. Je peux même lui serrer la main. Il me tient compagnie pendant les escales, c’est-à-dire qu’il me regarde « faire mes rangées » (nettoyer la cabine), tout en me racontant les pires horreurs sur le peuple français. J’ai eu droit à toutes les anecdotes sur les pratiques d’hygiène au 17ème siècle. Je connais aussi les manigances politiques qui ont ruiné l’Empire au 18ème siècle. Surtout, il me rappelle à chaque fois que certaines traditions françaises ne viennent pas de l’Hexagone, mais ont été dérobées par ces vicieux Français à d’autres peuples. Il conclut ses thèses par des blagues.
« Qu’obtient-on si l’on jette un Français à la mer ? De la pollution. Et tous les Français à la mer ? La solution. » Je n’ai jamais perdu patience avec lui, j’ai le sens de la dérision. Martin est aussi très mignon, et même s’il est marié et a des jumeaux, il n’hésite pas à inviter des garçons à passer quelques jours chez lui. Je réussis une fois à le convaincre de nous rejoindre au centre-ville lorsque nous étions en escale à Toulouse. L’alcool aidant, il devint très agréable et presque sympathique. Il était ivre comme un coin. Nous l’étions aussi. Arrivés à l’hôtel, nous lui jouons un tour : enfoui dans les bras de Morphée, il ne remarque pas le maquillage et le déguisement dont on l’accoutre. Ma collègue lui peint le drapeau tricolore sur les joues. Un « J’adore Paris » illustre son front. Sur son torse, décevant, elle marque « Je suis Français et fier de l’être ! ». On le drape ensuite dans le drapeau tricolore, dérobé à la mairie du village. L’alcool dissipé, Martin reprend connaissance et pique une colère noire en se voyant dans le miroir. Ma collègue a eu le malheur de rire et d’avouer que tout était de son forfait. Martin lève haut son bras droit avant de frapper violemment la joue de la jeune femme qui tombe à terre. D’un commun accord avec l’entreprise, Martin travaille désormais à Berlin.
Les Allemands ont envahi la France pendant quelques années. Pas assez au goût de Helmut, convaincu que la France, et les Français, auraient beaucoup gagné à être « dressés » par les Allemands. Nous surnommons Helmut « Herr General » car ce commandant de bord doit sans doute être l’un des derniers nostalgiques du régime nazi. Helmut représente l’autorité à bord, il commande donc tous ceux qui s’approchent de son Airbus. Un avant-goût du commandement qui régnait dans les camps de concentration. Nous sommes tenus de marcher derrière lui dans l’aérogare, sur notre chemin vers l’avion. Toutes les décisions doivent être prises par lui et lui uniquement, ce qui inclut bien naturellement les pauses de l’équipage. Si une hôtesse se déplace en cabine alors qu’il était prévu qu’elle soit en pause, Helmut le remarquera à travers le judas de la porte du cockpit. L’hôtesse sera débarquée dès son arrivée car elle n’a pas obéi aux règles édictées par le commandant de bord. Les pilotes sont tenus de ne pas manger le même plat, afin d’éviter une double intoxication alimentaire. Une chef de cabine a eu le malheur de lui rappeler la procédure : elle a été débarquée sur le champ. Un passager éructait contre une hôtesse, la traitant de tous les noms, tripotant ses fesses. Helmut considéra que l’hôtesse exagérait et autorisa le transport du passager en question. L’hôtesse eut le courage de se débarquer mais reçut un avertissement écrit car « selon le rapport du pilote, la situation était maitrisée ». Lorsque nous faisons nos « rangées », Helmut se place derrière et hurle « plus vite, plus vite, plus vite ». Bien évidemment, il peut tout entendre de nos conversations dans l’interphone. Il a, un jour, entendu un steward affirmer : « Je dois tenir la porte à ce couillon, quelqu’un ne veut pas me remplacer, je ne le supporte plus ». Mal lui en a pris. Helmut l’humilia devant tous les passagers, si bien que certains clients durent intervenir pour mettre fin à cette sentence cruelle. Les hôtesses savent se venger. A chaque fois qu’il commandait un café, nous ajoutions notre petit plus : une crotte de nez, une rognure d’ongle, des laxatifs…Jusqu’au jour où un chef de cabine en eut marre. Les briefings des pilotes et des PNC se font sur deux tables différentes, aux coins opposés de notre salle. Il est convenu que les pilotes nous rejoignent dès qu’ils ont fini. Helmut attend qu’on le rejoigne. Il est d’ailleurs le seul. Ce jour-là, le chef de cabine décida de ne pas céder à ses exigences ubuesques. Mal lui en prit. Helmut ne céda pas. Le ton monta, les insultes fusèrent. Helmut prit la décision de « débarquer » le chef de cabine (ne pas l’autoriser à effectuer sa journée de travail). Le chef de cabine prit les devants et notifia les opérations de la compagnie de sa volonté de ne pas travailler avec un pilote qui le maltraitait. Au même moment, Helmut se plaignit des agissements du chef de cabine. Les opérations, confrontées à ces deux versions, prirent la décision de renvoyer et le pilote et le chef de cabine chez eux. Ce fut le début d’une longue bataille. Les pilotes formés sont rares et difficiles à garder, CarrottAir tend plus à donner raison à ses commandants de bord. Or, les hôtesses et stewards sont solidaires. Quand le chef de cabine reçut un avertissement pour « mauvaise gestion de rapports humains », nous décidâmes de mener une action d’ampleur. Chaque chef de cabine refusa de voler avec Helmut et appela les opérations pour leur signifier le refus. A terme, la compagnie dut reconnaître que le problème, c’était Helmut. Au-delà de l’action des chefs de cabine, les hôtesses et stewards se permirent de faire des remarques à Helmut. Bien vite, le commandant de bord comprit qu’il était l’homme le plus détesté de la compagnie. Il est encore, à ce jour, en congé de maladie.
Je suis installé à l’avant de l’appareil pour le décollage, à côté de ma chef de cabine. Nous sommes attachés sur nos strapontins et nous nous tenons prêts pour un décollage imminent. Je sens une odeur inhabituelle. J’en fais part à ma chef de cabine. Elle hume profondément. Elle confirme mes soupçons. L’avion n’est pas encore sur la piste. Nous informons le commandant de bord par interphone. Le commandant de bord, que j’appellerai Hadock, entend nos inquiétudes. Néanmoins, il nous assure que tout va bien. Les passagers de la première rangée s’inquiètent de cette mauvaise odeur qui se propage de plus en plus intensément dans la cabine. Les moteurs montent en puissance et l’avion décolle. A l’odeur s’ajoute une légère fumée. Une fumée noire. Un liquide toxique brûle, cela ne fait aucun doute. La chef de cabine rappelle le commandant. Il nous ordonne de ne pas nous inquiéter et de ne plus le déranger. Je tousse de plus en plus fort. Ma chef de cabine est prise de vertiges. Nous appelons les collègues assis à l’arrière. Ils vont bien. Je saisis l’interphone : le commandant de bord répond, irrité.
« Arrêtez de nous faire chier, bon sang ! Vous êtes de petites natures ! Il n’y a aucun souci avec l’avion. On va à Paris. Vous n’allez pas me foutre en retard ! »
Déjà ce matin, le commandant nous avait ordonné d’être le plus rapide possible car il devait aller chercher son fils à l’école, la nourrice étant malade.
La fumée devient de plus en plus épaisse. Ma chef de cabine vient de tomber dans les pommes. Les passagers toussent gravement. Je commence à perdre mes repères et je tombe à terre. Nos collègues accourent. Ils enfilent les masques antifumée. Ils décrivent la situation au commandant de bord qui fait semblant de ne rien comprendre. L’un d’eux réussira à ouvrir la porte du poste de pilotage. La fumée s’y engouffre. Le commandant Hadock ne peut plus nier le problème. C’est après avoir copieusement insulté les membres de l’équipage qu’il prend enfin la décision de dérouter l’appareil et d’atterrir au plus vite.
Après l’atterrissage, les portes de l’avion sont ouvertes. Les techniciens suisses envahissent la cabine et mènent leur enquête. Lorsque l’appareil était branché au groupe auxiliaire d’électricité (ce sont les réacteurs qui fournissent l’électricité en vol ; au sol, c’est une batterie externe qui prend le relais), une fuite d’huile est entrée en contact avec l’électricité, ce qui a crée de la fumée. Cette même fumée est entrée dans les conduits d’aération de l’avant de l’appareil et a enfumé toute la cabine. Les techniciens insistent pour que nous allions à l’hôpital le plus proche car cette fumée est considérée comme très toxique.
Le commandant Hadock refuse. Le vol accuse déjà deux heures de retard et il n’a toujours pas trouvé de remplaçant pour aller chercher son fils à l’école. Les passagers sont débarqués. Le vol est annulé. En manipulant certaines procédures, et en limitant les informations qu’il partage avec le centre des opérations de la compagnie, Hadock réussit à négocier un retour à Paris, en « ferry », c’est-à-dire sans passagers.
Ma chef de cabine, très remontée, décide d’écrire son rapport, sa version des faits. Le commandant Hadock est convoqué au quartier général. Il reçoit un blâme et est muté dans une autre base, au Royaume-Uni, pour suivre des formations complémentaires et surtout, pour que les chefs-pilotes de la compagnie puissent évaluer ses compétences.
Il rate plusieurs examens. Il s’emporte contre un formateur. Il sera licencié le lendemain.
Les pilotes de ma base ont décidé d’organiser une grève en soutien à ce commandant, car ils craignent qu’en cas « d’erreur », eux aussi soient mutés au Royaume-Uni où il est beaucoup plus simple de licencier qu’en France.
Ils oublient trop vite que le commandant Hadock garde les séquelles d’un crash dont il a été reconnu responsable. Ils oublient trop vite que tous les membres d’équipage évitent tout contact avec le poste de pilotage car le commandant Hadock est un personnage odieux. Ils oublient trop vite qu’à vouloir toujours donner de la voix, ils perdront toute crédibilité, notamment aux yeux des hôtesses et des stewards.
Ils oublient trop vite que leur job est de transporter des vies humaines en toute sécurité.
Tous les membres d’équipage se sont joints pour envoyer un petit mot au commandant Hadock :
« Nous espérons très sincèrement que tu en tireras une bonne leçon et que jamais plus, plus jamais, une compagnie aérienne ne laissera un bouffon derrière le guidon. »





























