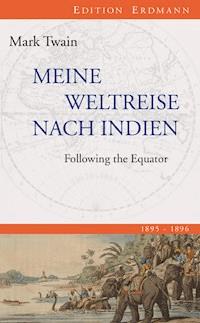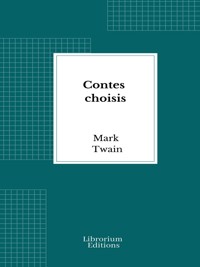
1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Il y a longtemps que le nom de Mark Twain est célèbre en France, et que ce nom représente ce que nous connaissons le mieux de l’humour américain. D’autres écrivains du même genre, Arthemus Ward, par exemple, ont eu grand succès chez leurs concitoyens et en Angleterre, mais leur plaisanterie est trop spéciale pour nous toucher. Ou bien elle consiste en jeux de mots véritablement intraduisibles dans notre langue, et dont toute la saveur nous échapperait. Ou bien leur verve s’exerce sur des sujets usuels, familiers aux Américains, qui saisissent immédiatement l’allusion, laquelle demeure une lettre morte pour nous. L’humour de Mark Twain est plus accessible. Ses plaisanteries sont d’un intérêt plus général. Leur sel touche notre langue. Comme tous les grands écrivains, il a su devenir universel tout en demeurant national. Par les sources où il a puisé son humour, par la peinture qu’il nous présente d’une société, d’une époque, et de mœurs déterminées, par la tournure d’esprit et par l’interprétation, il est en effet profondément et intimement américain.
Ses ouvrages ne sont, d’ailleurs, que le reflet de son existence mouvementée, aventureuse, marquée au coin de la plus étrange énergie, et tellement représentative de celle de ses contemporains. Samuel Langhorne Clemens, qui prit plus tard le pseudonyme de Mark Twain, naquit à Florida, petit hameau perdu du Missouri, le 30 novembre 1835. La grande ville la plus proche était Saint-Louis, qui ne comptait pas, d’ailleurs, à cette époque, plus de dix mille habitants. Ses parents s’étaient aventurés dans ces solitudes avec l’espoir de faire fortune dans un pays neuf. Mais leur espoir fut déçu. Et après la mort de son père le jeune Clemens dut se préoccuper de gagner promptement sa vie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Contes Choisis
Par Mark TwainTraduits de l’anglais par Gabriel de Lautrec et précédés d’une étude sur l’humour
© 2023 Librorium Editions
ISBN : 9782385744144
Mark Twain et l’humour
Ma montre
Le grand contrat pour la fourniture du bœuf conservé
Une interview
Rogers
L’infortuné fiancé d’Aurélia
Madame Mac Williams et le tonnerre
Notes sur Paris
L’article de M. Bloque
Un roman du moyen âge
Un rêve bizarre
Sur la décadence dans l’art de mentir
Le marchand d’échos
Histoire du méchant petit garçon
Histoire du bon petit garçon
Sur les femmes de chambre
La grande révolution de Pitcairn
Comment je devins directeur d’un journal d’agriculture
Le meurtre de Jules César en fait divers
La célèbre grenouille sauteuse du comté de Calaveras
Réponses à des correspondants
L’histoire se répète
Pour guérir un rhume
Feu Benjamin Franklin
L’éléphant blanc volé
Madame Mac Williams et le croup
Histoire de l’invalide
Nuit sans sommeil
Les faits concernant ma récente démission
Économie politique
INTRODUCTION MARK TWAIN ET L’HUMOUR
Il y a longtemps que le nom de Mark Twain est célèbre en France, et que ce nom représente ce que nous connaissons le mieux de l’humour américain. D’autres écrivains du même genre, Arthemus Ward, par exemple, ont eu grand succès chez leurs concitoyens et en Angleterre, mais leur plaisanterie est trop spéciale pour nous toucher. Ou bien elle consiste en jeux de mots véritablement intraduisibles dans notre langue, et dont toute la saveur nous échapperait. Ou bien leur verve s’exerce sur des sujets usuels, familiers aux Américains, qui saisissent immédiatement l’allusion, laquelle demeure une lettre morte pour nous. L’humour de Mark Twain est plus accessible. Ses plaisanteries sont d’un intérêt plus général. Leur sel touche notre langue. Comme tous les grands écrivains, il a su devenir universel tout en demeurant national. Par les sources où il a puisé son humour, par la peinture qu’il nous présente d’une société, d’une époque, et de mœurs déterminées, par la tournure d’esprit et par l’interprétation, il est en effet profondément et intimement américain.
Ses ouvrages ne sont, d’ailleurs, que le reflet de son existence mouvementée, aventureuse, marquée au coin de la plus étrange énergie, et tellement représentative de celle de ses contemporains. Samuel Langhorne Clemens, qui prit plus tard le pseudonyme de Mark Twain, naquit à Florida, petit hameau perdu du Missouri, le 30 novembre 1835. La grande ville la plus proche était Saint-Louis, qui ne comptait pas, d’ailleurs, à cette époque, plus de dix mille habitants. Ses parents s’étaient aventurés dans ces solitudes avec l’espoir de faire fortune dans un pays neuf. Mais leur espoir fut déçu. Et après la mort de son père le jeune Clemens dut se préoccuper de gagner promptement sa vie.
Il entra dans une petite imprimerie de village dirigée par son frère aîné, mais son tempérament aventureux se dessinait déjà, et vers dix-huit ans il partit, voyagea à travers tous les États de l’Est, travaillant quelque temps dans des imprimeries de diverses villes, puis soudain se décida à faire les études nécessaires pour être pilote sur le Mississipi. La navigation fluviale était alors très importante, presque tout le trafic commercial se faisant par eau, et la situation de pilote, qui demandait des aptitudes et des études sérieuses, était des plus avantageuses et des plus recherchées. Mais juste au moment où le jeune homme venait de recevoir son brevet, la guerre civile éclata entre les États du Nord et les Esclavagistes du Sud. La navigation commerciale cessa du coup complètement. Le frère aîné de notre héros, chargé d’une mission officielle dans le Nevada, lui offrit de l’emmener avec lui. Pendant toute une année Mark Twain parcourut les territoires de chasse, menant une vie aventureuse et charmante. En même temps il faisait ses débuts d’écrivain, en envoyant des articles à l’Entreprise territoriale, journal de Virginia-City. Ses articles furent remarqués. Ce fut alors qu’il adopta son pseudonyme, souvenir de sa carrière de pilote si prématurément interrompue, mais dont il avait cependant conservé de vivantes impressions qu’il utilisa dans ses livres. Les pilotes du Mississipi, pour annoncer la profondeur des eaux, dans les passages difficiles, criaient: «Mark three! Mark twain! Troisième marque! Deuxième marque!» Ce cri pittoresque plut au jeune Clemens et devint sa signature désormais.
Un article, dans lequel il attaquait violemment les abus de certains organisateurs, lui attira un duel. L’incident n’eut pas de suites fâcheuses, en lui-même, car au dernier moment l’adversaire de Mark Twain lui fit des excuses. Mais le duel était rigoureusement poursuivi sur le territoire de Nevada, et Twain dut se réfugier en Californie. Il eut un moment la pensée de tenter la fortune aux mines d’or. Heureusement, pouvons-nous dire, il ne réussit pas à trouver le moindre filon. Son succès dans ce sens nous eût peut-être privés des trésors qu’il a trouvés en exploitant une veine plus heureuse...
La vie aventureuse continue, Mark Twain part à Hawaï pour le compte d’un journal de Sacramento. Puis il revient en Californie et donne des conférences sur son voyage. Il accompagne un pèlerinage en Terre Sainte, comme correspondant d’un journal. De ce voyage il rapporte un livre, Les Ingénus en voyage (The Innocents Abroad), qui assure sa célébrité. Puis, de nouveau, des conférences. A ce moment, la situation de l’écrivain commence à prospérer. Il se marie et fait un mariage d’amour, attristé, plus tard, par la mort tragique ou prématurée de ses enfants. Il publie: L’âge d’or, Tom Sawyer, Le Prince et le Pauvre. Le produit de ses livres lui a permis de renoncer au travail de journaliste et aux conférences. Sa situation est prospère. Mais les spéculations malheureuses d’une maison d’éditions qu’il avait commanditée lui font perdre tout le fruit de ses labeurs. Il se retrouve, déjà âgé, avec cent mille dollars de dettes. Alors il part, en 1895, pour faire le tour du monde, simplement, et le livre qu’il publie comme impressions de voyage: En suivant l’Équateur, suffit à payer toutes ses dettes. Les années suivantes, il voyage en Europe, retourne en Amérique, puis repart pour l’Angleterre, où il est reçu avec grand honneur. Cependant il est vieux et souffre d’une affection cardiaque qu’il ne fait rien pour ménager. Ceux qui lui ont rendu visite nous le représentent confiné dans son lit, mais l’esprit toujours jeune, alerte, et fumant le cigare du matin au soir, malgré les observations de ses médecins. En 1900, il perd sa fille qui avait toujours vécu avec lui, et qui meurt tragiquement dans son bain. Dès lors l’état du vieillard empire. Et le 20 avril 1910, âgé de soixante-quinze ans, cet humoriste meurt d’une maladie de cœur.
C’est que, La Bruyère l’a dit, il faut plus que de l’esprit pour être auteur. Et surtout pour être un bon humoriste. Tous ceux que j’ai connus, ayant du talent, avaient des âmes délicieuses. Ce don de l’observation qui permet de découvrir soudain le côté vivant des hommes et des choses, et de l’exprimer par le trait pittoresque et juste, ne va pas sans une grande sensibilité. Et que l’on se garde de prendre ce mot dans son acception vulgaire, banale. Sensibilité n’est pas synonyme de sensiblerie. Je dirais volontiers que ces deux termes sont exclusifs l’un de l’autre. Les gens qui larmoient sans cesse, et sans raison, n’ont pas l’âme très sensible. Ce sont des sots égoïstes qui s’apitoient sur leur propre faiblesse. Ce sont ceux qui versent des torrents de larmes, comme les personnages de Chateaubriand, dans les premiers moments de leur affliction, mais qui sont vite consolés. Un torrent, par définition, s’épuise soudain.
Chez le véritable humoriste, la sensibilité s’enveloppe d’un voile exquis de pudeur. Il a peur de paraître exagéré et vulgaire. Il redoute même le suffrage des sots, et s’emploierait volontiers à les mystifier pour les dégoûter de le lire. Ayant le sens délicat de la mesure, comme le poète a le sens du rythme, il déteste tout ce qui est exagéré et par suite faux, et devient féroce, d’une férocité de brave homme et de justicier, en face des outrances de la sottise humaine. Mais, en revanche, quelle joie, quand le bon humoriste se trouve en présence d’un autre humoriste, aussi ingénu, aussi sincère que lui, aussi disposé à s’amuser de la vie, avec une sorte de pitié émue! Il ne doit pas y avoir de plaisir plus délicat que celui de deux hommes charmants et naïfs, en même temps qu’avertis, qui se rencontrent pour échanger des impressions fugitives, auxquelles ni l’un ni l’autre n’attachent la moindre importance, parce qu’ils savent que c’est la vie, et qu’il convient, avant tout, d’être jovial. Je m’imagine la joie profonde de l’admirable Alphonse Allais, en retrouvant dans l’autre monde l’âme du délicieux Sam Weller de Dickens. Quelles plaisanteries terribles a-t-il dû lui faire! Et ils ont causé pendant des heures (dans l’éternité le temps est pour rien), débitant gravement, chacun à son tour, les choses les plus insensées, jusqu’au moment où ils n’y ont plus tenu, et où ils sont partis en éclats du plus joli rire, du plus cordial, à l’idée de ce que penserait le père de Sam Weller, le «gouverneur», s’il descendait, juste à ce moment-là, du siège de sa diligence pour venir boire un verre avec eux.
Ce serait évidemment un verre de whisky. L’humour, sous sa forme la plus précise, est en effet une des caractéristiques de l’esprit anglais. Et Dickens est le prophète de l’humour. Mais il y en a quelques-uns qui, avant lui, en sont les dieux, comme Allah a précédé, de toute éternité, Mahomet. Si l’on voulait remonter aux origines classiques, on trouverait l’humour dans Shakespeare, comme tout le reste. La formule moderne de l’humour, plus exacte mais plus étroite, se retrouve chez Addison. Il ne lui manque, c’est peu de chose, que le génie. Swift en avait assez pour deux. Tout le monde connaît, en France, les Voyages de Gulliver, où l’on trouve l’application des meilleurs et des plus puissants procédés humoristiques, mis au service d’une conviction âpre et profonde, à laquelle le style direct ne suffit pas. Swift ne fait pas d’esprit pour l’esprit. On l’eût peut-être étonné en lui disant qu’il en avait. Ce n’est pas l’humour moderne, un peu diminué et dilettante, et se complaisant et s’amusant à des trouvailles heureuses dans le détail. C’est un homme aux passions violentes, aux sentiments exaspérés par la conviction, trouvant, à force de fureur, le mot juste et qui porte, et qui sait aussi, pour accentuer la valeur de son ironie, la présenter sous une forme froide, avec une logique déconcertante qui rend mieux la passion cachée et ardente que toutes les clameurs et tous les gestes. Son génie puissant n’est pas joyeux. L’humour est fait d’observation profonde. Quand on sait distinguer, avec clairvoyance, les côtés amusants des choses, c’est que l’on sait voir, et l’on voit tous les aspects, les tristes comme les gais. Il est même fort possible que le sens de l’humour ne s’éveille qu’aux froissements de la vie. Voici le paradoxe usuel sur la tristesse des auteurs gais. Il est si vieux qu’on lui doit quelque respect. Cependant Swift et Dickens, si toute la vie de celui-là et la jeunesse de celui-ci n’avaient été laborieuses et humiliées, auraient-ils écrit le Tonneau ou les aventures de Copperfield? Les médiocres maudissent la vie, quand elle est dure pour eux. Les gens d’esprit la racontent et nous font rire ou pleurer, parfois les deux successivement. Ils se réjouissent des sources fécondes que le pic du malheur fait soudain jaillir à leurs pieds. Ils trouvent dans l’opposition des jours le prétexte à mille imaginations fantasques, dont ils s’amusent délicieusement. Il y a cent manières dans l’humour. Mais c’est toujours un contraste, ou presque toujours.
L’antithèse est, en effet, le plus puissant des procédés littéraires, comme de tous les procédés. Une couleur ressort par l’opposition avec la couleur opposée. Et cela est vrai de l’écriture comme des tableaux. C’est à l’antithèse que Victor Hugo, poète indiscutable et admirable, mais le contraire d’un humoriste, a dû les meilleurs de ses effets. Le ver de terre est amoureux d’une étoile, et Quasimodo de Esméralda. Il serait curieux d’examiner quelles déformations subit le procédé en question pour passer de la poésie à l’humour. Au fond, le mécanisme de l’âme est probablement des plus simples, et peu de chose fait la différence entre les manifestations les plus diverses de l’esprit humain. Il en est de même en chimie, car les lois sont les mêmes partout.
Que cette antithèse, d’ailleurs, et ce contraste, soient dans la forme ou dans l’idée, Fielding, l’humoriste anglais, exposera posément, avec un luxe de détails, la vie de Jonathan Wild, le Grand. Il se trouve que Jonathan Wild est un voleur de grands chemins. La situation élevée où il parvient à la fin de sa carrière consiste à être pendu. Dickens donne une valeur étrange aux détails les plus insignifiants. Ces détails ne sont d’ailleurs insignifiants qu’en apparence, et seulement pour ceux qui ne savent pas voir la vie intime des choses. Écoutez la conversation entre la bouilloire et le grillon, dans les Contes de Noël. Pour l’humoriste, comme pour le poète, et comme pour le messager de Jupiter dans la fable de La Fontaine, tout ce qui vit, fût-ce de la vie la plus obscure, est également intéressant. Les choses n’ont de valeur que celle que nous leur donnons. Mais il faut savoir la donner. Certains détails de la vie usuelle, qui n’existent pas par eux-mêmes, prennent un relief soudain quand celui qui sait voir et décrire nous les fait voir. Le bon humoriste est un visionnaire. C’est que sa faculté d’émotion, comme celle du poète, reste toujours jeune et fraîche. La grande vertu de tous deux c’est, tout en acquérant l’expérience, la maîtrise des choses et des formes, de garder jusqu’à la fin, par un paradoxe heureux, la naïveté, la nouveauté des impressions de l’enfant. Tout les frappe, tout les émeut, comme si c’était la première fois. Quand Horace parle de «la race irritable des poètes» il ne fait que confirmer cette vérité. Les poètes s’irritent aisément, parce que le spectacle des sottises et des méchancetés humaines, auxquelles les gens ordinaires s’habituent, au point de les trouver naturelles, leur paraît toujours nouveau. Les humoristes sont de même, dans le sens de leur tournure d’esprit. Le ridicule, même habituel, les excite, d’autant plus qu’ils ont un sens spécial pour le percevoir, et le don de le mettre en lumière. Leur mode d’expression varie, d’ailleurs, suivant l’impression reçue, et surtout suivant leur tempérament et leur faculté réceptive.
Certains sont amers et irrités. Le spectacle des folies et des injustices humaines les indigne. Ils flagellent impitoyablement les mœurs de leur temps, sans se douter qu’ils font le procès, dérisoire et inutile, de l’éternelle humanité. D’autres ne voient, au contraire, dans le tableau varié qui se déroule sous leurs yeux avertis, qu’un prétexte à s’égayer et à égayer les autres en le leur présentant sous des couleurs vives. Imaginant des combinaisons, des intrigues et des types nouveaux, en partant des éléments fournis par l’observation, ils se soucieront surtout d’exciter le rire, un rire sans méchanceté, bon enfant. Ce sont les optimistes qui se plaisent à leur propre jeu, sans autre prétention que de s’amuser et d’amuser. Il en est enfin qui, n’empruntant au réel que les mots du dictionnaire, inventent de toutes pièces des fantaisies folles et chimériques, nous emportent sur les ailes de leur imagination dans le domaine inquiétant et délicieux de l’absurde, et sont les poètes de l’humour pour le simple humour. Ce genre de littérature ne peut éclore qu’au sein de civilisations déjà vieilles, et sous les rayons nostalgiques des soleils de décadence. Les peuples neufs s’amusent à des jeux plus réels. La littérature américaine, même dans l’humour, est toujours représentative. Cet humour emprunte, en effet, ses éléments les meilleurs aux sentiments, aux pensées, aux habitudes, aux gestes usuels des hommes et du milieu. Que trouvons-nous dans Mark Twain, sinon le fidèle reflet, sous une forme si fantaisiste soit-elle, des préoccupations familières aux Américains de son temps? Une nation jeune et vigoureuse s’intéresse au commerce, aux voyages, à l’organisation. Elle a créé de toutes pièces une société nouvelle, composée des éléments les plus disparates, sur un territoire immense où, par places, errent encore des Indiens libres. Les histoires de Mark Twain se passeront dans les petites villes nées d’hier, mais qui possèdent déjà un journal, Le Tonnerre Quotidien, ou tel autre, et les trappeurs des environs viendront demander des rectifications à coups de revolver. Lisez comment l’auteur devint rédacteur en chef (il était tout seul) d’un journal d’agriculture, et quel article magistral il écrit sur les mœurs du guano, ce bel oiseau. Fine satire de certains journalistes qui se croient universels. D’autres scènes se passent sur les railways, ou dans les commissions du gouvernement. On n’a rien écrit de plus spirituel, en France, sur la manie de la paperasserie, et sur la nonchalance des bureaux, que certaines pages de Mark Twain. Cela est définitif. L’auteur a également utilisé, et d’une façon très heureuse, les souvenirs du temps où il était élève-pilote, pour nous conter avec pittoresque la vie sur le Mississipi. Toute la matière de cette fantaisie est empruntée à la vie réelle. Dans nos histoires anciennes, on dévalise les diligences, et l’on emporte les voyageurs au fond d’une caverne obscure, dans la forêt. Chez Mark Twain, étant donnés les Indiens, l’aventure sera le scalp.
Mais il faut voir le parti que l’auteur a su tirer de ces éléments, et tout ce que sa fantaisie a su y ajouter de plaisant. C’est lui qu’il faut interviewer, si nous voulons obtenir des réponses aussi effarantes que celles qu’il fait au malheureux rédacteur venu dans cette intention. Nous y apprendrons la triste aventure dont le souvenir jette un voile de deuil sur toute sa vie. Il était jumeau, et un jour, comme il était dans le bain avec son frère, un des deux a été noyé. Et on ne sait pas si c’est lui ou si c’est son frère. Quelle plus terrible incertitude pour un homme que de ne pas savoir si c’est lui ou si c’est son frère qui a survécu! Mais, attendez, Mark Twain se rappelle. «Un des deux enfants avait une marque, un grain de beauté sur la cuisse gauche. C’était moi. Cet enfant est celui qui a été noyé.»
D’autres exemples nous montreront d’une façon convaincante ce don de la logique dans l’absurde, ce contraste effarant entre la folie de l’idée et le sérieux imperturbable de la forme, qui est une des caractéristiques de l’humour.
Une définition de l’humour serait chose fort difficile. Elle a été ébauchée ailleurs. Il est plus aisé de faire comprendre par des exemples que par des règles, ce qui, par définition, échappe à toutes les règles. Nous sommes dans le domaine charmant de la fantaisie, et il y aurait un insupportable pédantisme à étudier lourdement les causes de notre plaisir. Mais comme l’humour naît presque toujours d’une antithèse, d’une opposition, c’est par contraste qu’il serait peut-être le plus facile d’indiquer ce qu’il est en réalité. C’est ainsi que l’humour se distingue des autres formes du comique, si l’on veut prendre le terme le plus général. C’est ainsi qu’il diffère de la blague, cette forme d’esprit puissante parfois, mais d’une bouffonnerie plus légère et moins convaincue. L’humour n’est pas non plus l’ironie. Il est plus sincère, et presque ingénu. C’est beaucoup moins un procédé littéraire qu’une disposition et une tournure d’esprit, et qui peut se retrouver, comme il convient, non seulement dans les paroles, mais dans les actes. Robin Hood, avec son épée, fait la rencontre d’un chaudronnier, qui n’a d’autre arme que ses deux bras. Le chaudronnier, attaqué, rosse copieusement Robin Hood, qui, charmé, lui donne cent livres. C’est un trait déconcertant, et d’une logique bizarre. C’est de l’humour en action.
Ceux qui ont cette tournure d’esprit savent toujours prendre les choses par le bon côté, et il y en a toujours un. Sam Weller se frotte les mains de plaisir, toutes les fois qu’il lui arrive quelque chose de fâcheux. Voilà enfin une occasion où il y aura du mérite à être jovial.
Mais le mérite n’est pas médiocre de développer ces antithèses et d’en tirer un amusement. C’est en cela que l’œuvre des humoristes est morale. Ils nous apprennent à sourire des petites misères de la vie, quand nous ne pouvons rien contre, au lieu de nous indigner inutilement. Suivant la parole du philosophe, le ris excessif ne convient guère à l’homme qui est mortel. Mais le sourire appartient à l’homme, et nous devons être reconnaissants à ceux qui nous font sourire, ou même rire sans grossièreté. Souhaitons, pour notre santé morale, et aussi pour notre joie, qu’il y ait des humoristes, jusqu’aux temps les plus reculés, sur notre pauvre machine ronde, ou plutôt tétraédrique, c’est-à-dire en forme de toupie, puisque, d’après les dernières découvertes, il paraît que c’est la forme qu’elle présente en réalité.
Gabriel de Lautrec.
MA MONTREPETITE HISTOIRE INSTRUCTIVE
Ma belle montre neuve avait marché dix-huit mois, sans avance ni retard, sans aucune perturbation dans quelque partie que ce fût de son mécanisme, sans arrêt. J’avais fini par la regarder comme infaillible dans ses jugements sur le temps, et par considérer sa constitution et son anatomie comme impérissables. Mais un jour, une nuit plutôt, je la laissai tomber. Je m’affligeai de cet accident, où je vis le présage d’un malheur. Toutefois, peu à peu je me rassurai et chassai mes pressentiments superstitieux. Pour plus de sûreté, néanmoins, je la portai chez le principal horloger de la ville, afin de la faire régler. Le chef de l’établissement la prit de mes mains et l’examina avec attention. Alors il dit: «Elle est de quatre minutes en retard. Le régulateur doit être poussé en avant.» J’essayai de l’arrêter, de lui faire comprendre que ma montre marchait à la perfection. Mais non.
Tous les efforts humains ne pouvaient empêcher ma montre d’être en retard de quatre minutes, et le régulateur dut être poussé en avant. Et ainsi, tandis que je trépignais autour de lui, dans l’angoisse, et le suppliais de laisser ma pauvre montre en repos, lui, froidement et tranquillement, accomplissait l’acte infâme. Ma montre, naturellement, commença à avancer. Elle avança tous les jours davantage. Dans l’espace d’une semaine, elle fut atteinte d’une fièvre furieuse, et son pouls monta au chiffre de cent cinquante battements à la minute. Au bout de deux mois elle avait laissé loin derrière elle les meilleurs chronomètres de la ville et était en avance sur l’almanach d’un peu plus de treize jours. Elle était déjà au milieu de novembre, jouissant des charmes de la neige, qu’octobre n’avait pas encore fait ses adieux. J’étais en avance sur mon loyer, sur mes paiements, sur toutes les choses semblables, de telle façon que la situation devenait insupportable. Je dus la porter chez un horloger pour la faire régler de nouveau.
Celui-ci me demanda si ma montre avait été déjà réparée. Je dis que non, qu’elle n’en avait jamais eu besoin. Il me lança un regard de joie mauvaise, et immédiatement ouvrit la montre. Puis, s’étant logé dans l’œil un diabolique instrument en bois, il regarda l’intérieur du mécanisme. «La montre demande impérieusement à être nettoyée et huilée, dit-il. Ensuite nous la réglerons. Vous pouvez revenir dans huit jours.» Une fois nettoyée et huilée, puis bien réglée, ma montre se mit à marcher, lentement, comme une cloche qui sonne à intervalles longs et réguliers. Je commençai à manquer les trains, je fus en retard pour mes paiements. Je laissai passer l’heure de mes rendez-vous. Ma montre m’accordait gracieusement deux ou trois jours de délai pour mes échéances et ensuite me laissait protester. J’en arrivai graduellement à vivre la veille, puis l’avant-veille et ainsi de suite, et peu à peu je m’aperçus que j’étais abandonné solitaire le long de la semaine passée, tandis que le monde vivant disparaissait à ma vue. Il me sembla ressentir au fond de mon être une sympathie naissante pour la momie du Muséum et un vif désir d’aller m’entretenir avec elle sur les dernières nouvelles. Je dus retourner chez un horloger.
Cet individu mit la montre en morceaux sous mes yeux et m’annonça solennellement que le cylindre était «enflé». Il se fit fort de le réduire en trois jours à ses dimensions normales. Après cette réparation, la montre se mit à marquer l’heure «moyenne», mais se refusa obstinément à toute autre indication. Pendant la moitié du jour, elle ne cessait pas de ronfler, d’aboyer, de crier; elle éternuait, soufflait avec énergie, à tel point qu’elle troublait absolument mes pensées et qu’il n’y avait pas dans le pays une montre qui pût lui tenir tête. Mais le reste du temps elle s’endormait et s’attardait, s’amusant en route jusqu’à ce que toutes les autres montres laissées en arrière l’eussent rattrapée. Aussi, en définitive, au bout des vingt-quatre heures, aux yeux d’un juge impartial, elle paraissait arriver exactement dans les limites fixées. Mais une moyenne exacte n’est qu’une demi-vertu chez une montre, et je me décidai à la porter chez un nouvel horloger.
J’appris de lui que le pivot de l’échappement était cassé. J’exprimai ma joie que ce ne fût rien de plus sérieux. A dire le vrai, je n’avais aucune idée de ce que pouvait être le «pivot de l’échappement», mais je ne voulus pas laisser voir mon ignorance à un étranger. Il répara la montre, mais l’infortunée perdit d’un côté ce qu’elle gagnait d’un autre. Elle partait tout à coup, puis s’arrêtait net, puis repartait, puis s’arrêtait encore sans aucun souci de la régularité de ses mouvements. Et chaque fois elle donnait des secousses comme un fusil qui recule. Pendant quelque temps, je matelassai ma poitrine avec du coton, mais enfin je fus obligé de recourir à un nouvel horloger. Ce dernier la démonta, comme les autres avaient fait, et en mania un moment les débris sous sa loupe. Après cet examen: «Nous allons avoir, me dit-il, des difficultés avec le régulateur.» Il remit le régulateur en place et fit un nettoyage complet. La montre, dès lors, marcha très bien, avec ce léger détail que, toutes les dix minutes, les aiguilles se croisaient comme une paire de ciseaux et manifestaient dès lors l’intention bien arrêtée de voyager de compagnie. Le plus grand philosophe du monde eût été incapable de savoir l’heure avec une montre pareille, et de nouveau je dus m’occuper de remédier à cet état désastreux.
Cette fois, c’était le verre de la montre qui se trouvait en défaut et qui gênait le passage des aiguilles. De plus, une grande partie des rouages avaient besoin d’être réparés. L’horloger fit tout cela pour le mieux, et dès lors ma montre fonctionna exceptionnellement bien. Notez seulement qu’après avoir marqué l’heure bien exactement pendant une demi-journée, tout à coup, les diverses parties du mécanisme se mettaient à partir ensemble en ronflant comme un essaim d’abeilles. Les aiguilles aussitôt s’empressaient de tourner sur le cadran si vite que leur individualité devenait impossible à discerner; à peine si l’on distinguait quelque chose de semblable à une délicate toile d’araignée. La montre abattait ses vingt-quatre heures en six ou sept minutes, puis s’arrêtait avec un coup.
J’allai, le cœur navré, chez un dernier horloger et je l’examinai attentivement tandis qu’il la démontait. Je me préparais à l’interroger sévèrement, car la chose devenait sérieuse. La montre m’avait coûté à l’origine deux cents dollars; elle me revenait maintenant à deux ou trois mille dollars avec les réparations. Mais tout à coup, tandis que je l’examinais, je reconnus dans cet horloger une vieille connaissance, un de ces misérables à qui j’avais eu affaire déjà, plus capable de reclouer une machine à vapeur hors d’usage que de réparer une montre. Le scélérat examina toutes les parties de la montre avec grand soin, comme les autres avaient fait, et prononça son verdict avec la même assurance. «Elle fait trop de vapeur, vous devriez laisser ouverte la soupape de sûreté.» Pour toute réponse, je lui assénai sur la tête un coup formidable. Il en mourut, et je dus le faire enterrer à mes frais.
Feu mon oncle William (Dieu ait son âme) avait coutume de dire qu’un cheval est un bon cheval jusqu’au jour où il s’est une fois emporté, et qu’une bonne montre est une bonne montre jusqu’au moment où les horlogers, en y touchant, l’ont ensorcelée. Il se demandait aussi, avec une curiosité, vers quel métier se tournent tous les étameurs, armuriers, savetiers, mécaniciens, forgerons qui n’ont pas réussi. Mais personne n’a jamais pu le renseigner sur ce point.
LE GRAND CONTRAT POUR LA FOURNITURE DU BŒUF CONSERVÉ
Aussi brièvement que possible, je désire exposer à la nation la part, si petite soit-elle, que j’ai eue dans cette affaire qui a préoccupé si grandement l’opinion publique, engendré tant de querelles et rempli les journaux des deux continents de renseignements erronés et de commentaires extravagants.
Voici quelle fut l’origine de cet événement fâcheux. Je n’avance, dans le résumé suivant, aucun fait qui ne soit confirmé par les documents officiels du gouvernement.
John Wilson Mackensie, de Rotterdam, comté de Chemung, New-Jersey, actuellement décédé, fit un contrat avec le gouvernement général, le 10 octobre 1861, ou à peu près à cette date, pour fournir au général Sherman la somme totale de trente barils de bœuf conservé.
Très bien.
Il partit à la recherche de Sherman, avec son bœuf. Mais quand il fut à Washington, Sherman venait de quitter cette ville pour Manassas. Mackensie prit donc son bœuf, et l’y suivit, mais il arriva trop tard. Il le suivit à Nashville, et de Nashville à Chattanooga, et de Chattanooga à Atlanta, mais sans pouvoir le rejoindre. A Atlanta, il reprit sa course et poursuivit Sherman dans sa marche vers la mer. Il arriva quelques jours trop tard. Mais apprenant que Sherman s’était embarqué pour la Terre Sainte, en excursion, à bord de la Cité des Quakers, il fit voile pour Beyrouth, calculant qu’il dépasserait l’autre navire. Une fois à Jérusalem, avec son bœuf, il sut que Sherman ne s’était pas embarqué sur la Cité des Quakers, mais qu’il était retourné dans les plaines pour combattre les Indiens. Il revint en Amérique et partit pour les montagnes Rocheuses. Après soixante-huit jours de pénible voyage à travers les plaines, et comme il se trouvait à moins de quatre milles du quartier général de Sherman, il fut tomahawqué et scalpé, et les Indiens prirent le bœuf. Ils ne lui laissèrent qu’un baril. L’armée de Sherman s’en empara, et ainsi, même dans la mort, le hardi navigateur put exécuter une partie de son contrat. Dans son testament, écrit au jour le jour, il léguait le contrat à son fils Barthelemy Wilson. Barthelemy rédigea la note suivante, et mourut:
Doit le Gouvernement des États-Unis.
Pour son compte avec John Wilson Mackensie, de New-Jersey, décédé:
Dollars
Trente barils de bœuf au général Sherman, à 100 dollars
3.000
Frais de voyage et de transport
14.000
Total
17.000
Pour acquit...
Il mourut donc, mais légua son contrat à W. J. Martin, qui tenta de se faire payer, mais mourut avant d’avoir réussi. Lui, le légua à Barker J. Allen, qui fit les mêmes démarches, et mourut. Barker J. Allen le légua à Anson G. Rogers, qui fit les démarches pour être payé, et parvint jusqu’au bureau du neuvième auditeur à la Cour des comptes. Mais la mort, le grand régulateur, survint sans être appelée, et lui régla son compte à lui. Il laissa la note à un de ses parents du Connecticut, Vengeance Hopkins on le nommait, qui dura quatre semaines et deux jours, et battit le record du temps; il manqua de vingt-quatre heures d’être reçu par le douzième auditeur. Dans son testament il légua le contrat à son oncle, un nommé O Gai-Gai Johnson. Ce legs fut funeste à O Gai-Gai. Ses dernières paroles furent: «Ne me pleurez pas. Je meurs volontiers.» Il ne mentait pas, le pauvre diable. Sept autres personnes, successivement, héritèrent du contrat. Toutes moururent. Il est enfin venu entre mes mains. Je l’héritai d’un parent nommé Hubbard, Bethléhem Hubbard, d’Indiana. Il avait eu de l’inimitié pour moi pendant longtemps. Mais à ses derniers moments, il me fit appeler, se réconcilia avec moi complètement, et en pleurant me donna le contrat de bœuf.
Ici finit l’histoire du contrat jusqu’au jour où il vint en ma possession. Je vais essayer maintenant d’exposer impartialement, aux yeux de la nation, tout ce qui concerne ma part en cette matière. Je pris le contrat et la note pour frais de route et transport, et j’allai voir le président des États-Unis.
—«Monsieur, me dit-il, que désirez-vous?»
Je répondis:—«Sire, à la date, ou à peu près, du 10 octobre 1861, John Wilson Mackensie, de Rotterdam, comté de Chemung, New-Jersey, décédé, fit un contrat avec le gouvernement pour fournir au général Sherman la somme totale de trente barils de bœuf...»
Il m’arrêta là, et me congédia, avec douceur, mais fermeté. Le lendemain j’allais voir le secrétaire d’État.
Il me dit:—«Eh bien, Monsieur?»
Je répondis:—«Altesse Royale, à la date ou à peu près du 10 octobre 1861, John Wilson Mackensie, de Rotterdam, comté de Chemung, New-Jersey, décédé, fit un contrat avec le gouvernement pour fournir au général Sherman la somme totale de trente barils de bœuf...»
—«Cela suffit, Monsieur, cela suffit; ce bureau n’a rien à faire avec les fournitures de bœuf.»
Je fus salué et congédié. Je réfléchis mûrement là-dessus et me décidai, le lendemain, à voir le ministre de la marine, qui dit:—«Soyez bref, Monsieur, et expliquez-vous.»
Je répondis:—«Altesse Royale, à la date, ou à peu près, du 10 octobre 1861, John Wilson Mackensie, de Rotterdam, comté de Chemung, New-Jersey, décédé, fit un contrat avec le gouvernement pour fournir au général Sherman la somme totale de trente barils de bœuf.»
Bon. Ce fut tout ce qu’on me laissa dire. Le ministre de la marine n’avait rien à faire avec les contrats pour quel général Sherman que ce fût. Je commençai à trouver qu’un gouvernement était une chose curieuse. J’eus comme une vision vague qu’on faisait des difficultés pour me payer. Le jour suivant, j’allai voir le ministre de l’intérieur.
Je dis:—«Altesse Royale, à la date, ou à peu près, du 10 octobre...»
—«C’est assez, Monsieur. J’ai entendu parler de vous déjà. Allez, emportez votre infâme contrat de bœuf hors de cet établissement. Le ministère de l’intérieur n’a absolument rien à faire avec l’approvisionnement de l’armée.»
Je sortis, mais j’étais furieux. Je dis que je les hanterais, que je poursuivrais tous les départements de ce gouvernement inique, jusqu’à ce que mon compte fût approuvé. Je serais payé, ou je mourrais, comme mes prédécesseurs, à la peine. J’attaquai le directeur général des postes. J’assiégeai le ministère de l’agriculture. Je dressai des pièges au président de la Chambre des représentants. Ils n’avaient rien à faire avec les contrats pour fourniture de bœuf à l’armée. Je fus chez le commissaire du bureau des brevets.
Je dis:—«Votre auguste Excellence, à la date ou à peu près...»
—«Mort et damnation! Vous voilà enfin venu ici avec votre infernal contrat de bœuf! Nous n’avons rien à faire avec les contrats de bœuf à l’armée, mon cher seigneur.»
—«C’est très bien. Mais quelqu’un a affaire de payer pour ce bœuf. Il faut qu’il soit payé, maintenant, ou je fais mettre les scellés sur ce vieux bureau des brevets et tout ce qu’il contient.»
—«Mais, cher Monsieur...»
—«Il n’y a pas à discuter, Monsieur. Le bureau des brevets est comptable de ce bœuf. Je l’entends ainsi. Et, comptable ou non, le bureau des brevets doit payer.»