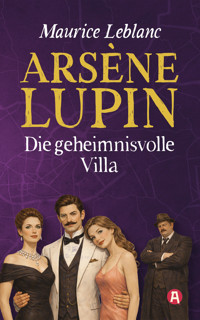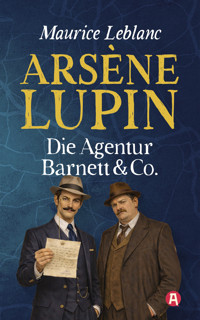0,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Librorium Editions
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le Soldat blessé
La Lettre à Catherine
Le Gilet de laine
Le Portefeuille
Sainte Blandine
Morituri…
Nonoche
Vins, Liqueurs et Spiritueux
Le Rendez-vous
Ici reposent…
Grand premier rôle
Le Coup de fusil
Le Fils du capitaine
La lettre d’adieu
Les Deux fils
La Mère
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
CONTES HÉROÏQUES
Regroupement de
contes publiés par
Maurice LEBLANC
Paris
(Contes parus entre le 5 mars 1915 et le 3 mars 1916)
© 2021 Librorium Editions
ISBN : 9782383830375
Le Soldat blessé
La Lettre à Catherine
Le Gilet de laine
Le Portefeuille
Sainte Blandine
Morituri…
Nonoche
Vins, Liqueurs et Spiritueux
Le Rendez-vous
Ici reposent…
Grand premier rôle
Le Coup de fusil
Le Fils du capitaine
La lettre d’adieu
Les Deux fils
La Mère
Le Soldat blessé
Vers minuit, on vint frapper à la porte de la petite cellule qu’Yvonne Dalbrecq occupait au troisième étage de l’hôpital.
— Vite ! vite ! madame Yvonne, un convoi de blessés qui arrive !
Elle ne dormait pas. Bien qu’à bout de forces au soir de ses longues journées d’infirmière, si laborieuses et si émouvantes, elle avait encore des insomnies où l’assiégeaient tous les mauvais souvenirs de sa vie brisée, les trahisons de son mari, les pardons inutiles, les humiliations, et puis, après vingt ans de martyre, la fuite de l’infidèle, de l’infidèle aux cheveux gris qui s’éprenait bêtement d’une fille quelconque.
Depuis six mois c’était fini. Au cœur d’Yvonne il n’y a plus d’amour pour celui qu’elle méprise. Elle ne souffre même plus. Mais parfois, durant les heures où l’on s’oublie à remuer le passé, quel goût d’amertume lui montait aux lèvres !
— Allons, dit-elle en s’habillant, un peu de fatigue encore. Tant mieux !
Sous sa blouse d’infirmière, coiffée du bonnet qui encadrait si joliment son doux visage à peine touché par la souffrance, elle descendit dans les anciens parloirs du rez-de-chaussée que l’on avait transformés en lavabos. L’un d’eux lui était réservé. Une demi-douzaine de soldats s’y trouvaient déjà, étendus sur des matelas, et les deux infirmiers de service commençaient à les dévêtir et à les laver, avant qu’ils ne fussent conduits dans les salles de visite.
Yvonne se mit à l’œuvre. L’eau chaude coula sur les jambes épuisées, sur les épaules et les bras meurtris. Avec une adresse infinie elle évitait tout geste qui eût pu déranger les pansements. Et puis ce fut le linge bien frais, si blanc, et qui fleurait si bon la lavande.
Cinq blessés partirent ainsi, accompagnés ou portés par les aides. Il n’en restait plus qu’un, qui ne bougeait pas du divan de cuir où on l’avait couché. Les infirmiers avaient prévenu Yvonne :
— Celui-là, madame Yvonne, il paraît qu’il s’est battu comme un lion. Il était enragé. Résultat : deux citations, la médaille… et quatre blessures. Réveillez-le, madame Yvonne, nous revenons tout de suite.
Une fois seule, Yvonne se pencha sur le blessé. Il dormait, le visage sous une serviette.
Elle le toucha légèrement à l’épaule.
— Vous est-il possible de vous lever, mon ami ?
Au bout de quelques secondés il fit un effort qui lui arracha une plainte, et elle dit aussitôt :
— Non, ce n’est pas la peine. Attendez…
Mais l’homme eut un sursaut. Il écarta la serviette et se dressa brusquement.
Yvonne reconnut son mari.
Comment put-elle le reconnaître ?… Hâve, livide, si maigre qu’il lui parut démesurément grandi, la figure semée de poils blancs, les yeux brûlés de fièvre, le front bandé, un pansement de ouate autour du cou, un bras en écharpe, le pied gauche enveloppé de linge… Il était atroce et magnifique. Quant à l’uniforme, des haillons, qui semblaient ne tenir entre eux que par les plaques de boue séchée dont ils étaient recouverts.
Vision formidable et sublime ! Beauté surhumaine de tout ce qui est l’audace guerrière, l’abnégation, le mépris du danger et de la mort…
Elle murmura d’une voix tremblante :
— Tu t’es engagé ?
— Oui, dit-il. Pas tout de suite, mais quand ils ont approché de Paris, j’ai senti que je ne pourrais plus vivre…
— Il parait que tu t’es bien battu.
— Pas mieux qu’un autre. Seulement j’ai eu de la chance.
De quelle chance parlait-il ? La chance d’avoir reçu quatre blessures ?
Ils demeurèrent silencieux, bouleversés par cette rencontre qui les montrait l’un à l’autre sous un aspect si imprévu, tous deux habillés de leurs vêtements de guerre.
Il prononça :
— Je te demande pardon, Yvonne.
— Oh ! non, non, s’écria-t-elle, révoltée, tu n’as pas à me demander pardon ! ! Est-ce que j’ai quelque chose à te pardonner ?
Ah ! ses petites déceptions de femme, ses jalousies, ses larmes, comme tout cela lui semblait mesquin en face de cet homme ravagé de blessures ! Il avait menti ? Il avait trahi ? Mon Dieu, qu’est-ce que tout cela signifiait ? Ce qui importe c’est qu’aux grandes heures tragiques on sache faire son devoir. Et de quelle façon splendide il avait fait le sien !
Elle le regardait indéfiniment, non pas comme une amoureuse, mais avec admiration, avec fierté, et avec une reconnaissance éperdue. Elle sentait ses genoux fléchir et tout son être s’incliner. Il était le symbole déchirant de ces héros qui se sacrifient pour notre salut. Il était le soldat blessé, le martyr dont tous les membres saignent. Ont-ils des comptes à rendre, ceux-là ? Ne sont-ils pas purs entre les plus purs ?
— Assieds-loi, repose-toi, lui dit-elle très doucement, C’est moi seule qui te soignerai…
Et quand il fut couché, il s’aperçut qu’elle était à genoux, et qu’elle lui baisait les mains, ses pauvres mains sales et douloureuses, ses pauvres mains de crucifié…
La Lettre à Catherine
— Dis donc, Bertol, t’es ben professseur, de métier ?
— Pour te servir, mon bon Duroseau.
Bertol, chargé de cours à la Sorbonne, jouissait d’une grande considération parmi ses camarades. Attentif, complaisant, plein d’affection pour ces braves gens dont il aimait à découvrir l’âme ingénue, il écoutait leurs petites histoires et leur donnait des conseils.
Ce jour-là, ils se trouvaient tous les deux dans une tranchée de seconde ligne, avec quelques autres, qui fumaient et qui jouaient aux cartes. Au-dessus de leur tête, la bataille faisait rage.
— Alors, Duroseau ?
— Eh ben ! voilà, fit Duroseau, l’air embarrassé, voilà… il s’agirait d’une chose… d’une lettre à écrire…
— Tu ne sais donc pas écrire, Duroseau ?
— Si, mais voilà l’affaire…
— Quelle affaire ?
— Voilà, Bertol, voilà… Ce matin, tu sais que ce matin on nous a donné un paquet de journaux…
— Oui, des journaux d’une semaine ou deux.
— Eh ben, pour ma part, j’en ai eu un qu’était déchiré… Mais, n’importe, on n’a pas grand’chose à lire… et j’ai lu… des nouvelles de la guerre… et puis encore des nouvelles. Et puis, voilà-t-il pas que je tombe sur une lettre… Ah ! non, ça m’a donné un coup… Ils appellent ça des lettres de soldats… et la signature était… sais-tu de qui, Bertol ? De moi !… Amédée Duroseau… une lettre que j’ai écrite à ma femme. Tiens, regarde…
Il avait déplié la feuille et la tendait à Bertol.
— C’est tout de même curieux comme hasard, fit Bertol. Tu permets ?
Et il se mit à lire à demi-voix :
« Ma bonne Catherine,
» Cette lettre est pour te dire que ça va toujours bien, sauf qu’on a un peu froid. Mais te fais pas de bile, j’ai touché à la distribution un paquet contenant trois caleçons et cinq bonnets de laine. Avec ça, je m’arrange. Et y avait aussi un savon neuf, que je te rapporterai.
» Hier, le fils Armandel, tu sais, le petit de la bouchère… il a été proposé pour la médaille. Ah ! c’est un bougre qui n’a pas froid aux yeux ! Le colonel demande deux hommes d’attaque pour porter un pli au général. Voilà qu’il se présente avec moi, ce gosse ! On part tous les deux. Des balles, et puis des balles, et de la mitraille. Ça tapait comme de la grêle. Mais le petit Armandel ne bronchait pas. Hein ! quel bougre ! Et puis, v’lan ! un coup de tonnerre, une marmite qui éclate. Armandel écope à la jambe. Moi, à l’épaule, une égratignure Il se met à rigoler. « Pas de veine, qu’il me dit, faut que tu y ailles seul. Tu me retrouveras au retour. »
» Alors, je vais de l’avant. Non, ce que ça ronflait ! Bref, au bout d’une heure, je vois le général, un brave homme, qui me remercie et me serre la main. Et puis, je rapplique… toujours sous les balles. « Qu’est-ce qu’il a pu devenir, le camarade ? » que je me disais. Eh bien ! il était toujours là, le bougre, derrière un arbre. Moi, je l’aurais très bien rapporté sur mon dos, malgré ma blessure qui commençait à me taquiner, mais pour sûr qu’il ne serait pas arrivé, à moins d’une chance de tous les diables. Pense donc, la mitraille !… « Il faut que tu repartes, Duroseau, qu’il me dit… la réponse au colonel… » C’était vrai… Ah ! le bougre, il ne perdait pas le nord ! Alors, j’ai piqué une tête dans la grêle. Et je me disais : « Si je tombe, le pauvre type est foutu. » Mais j’ai eu de la veine. Pas un pruneau. Le colonel m’a aussi serré la main. Deux heures. après, le soir, j’ai ramené notre Armandel, évanoui, perdant tout son sang. Il aura la médaille, et, vrai, il ne l’a pas volée, le bougre !
» Ah ! on en voit de riches gars, à cette guerre, mais je t’en raconterais comme ça jusqu’à demain. Au revoir, ma bonne Catherine, je t’embrasse de tout cœur. »
Bertol prit le journal et garda le silence, envahi d’une émotion qui lui étreignait la gorge.
À la fin, il balbutia :
— Alors, Duroseau ?
— Alors, pourquoi qu’on s’est fichu de moi en publiant cette lettre ?
Bertol bondit :
— Hein ? Qu’est-ce que tu me chantes ? On s’est fichu de toi !… Où as-tu vu qu’on s’est fichu de toi ?
— Mais, dame ! Pourquoi qu’ils la publient, c’te lettre ? C’est-il pas rapport à des choses de la grammaire, de l’orthographe ?… Oui, oui… Il y a des types qui trouvent ça rigolo. Je te dis qu’on se fiche de moi, Bertol. Alors, tu vas prendre la plume à ma place. Tu connais ça, toi, les machines d’orthographes… tu es professeur. Alors, n’est-ce pas, on ne pourra pas rigoler.