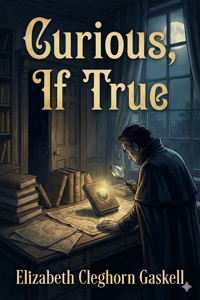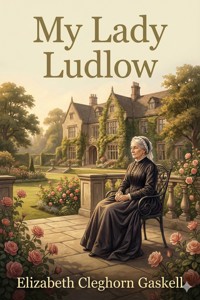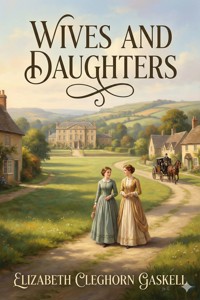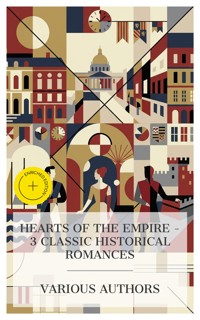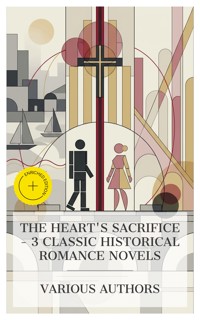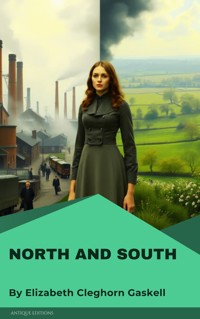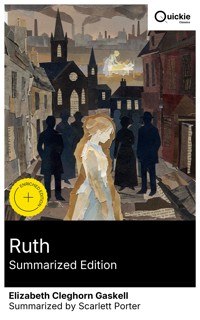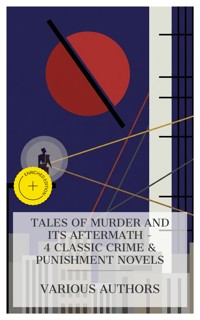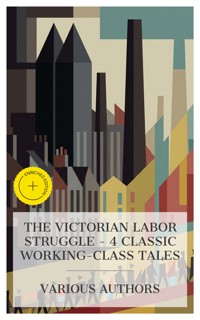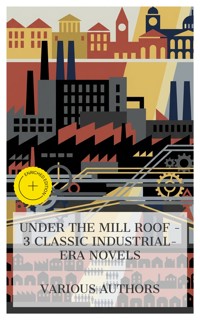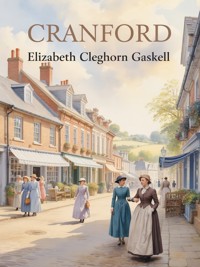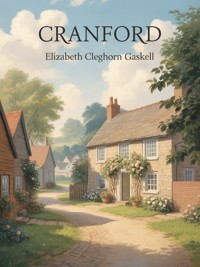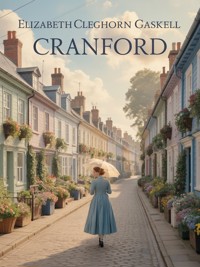
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: anna ruggieri
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
« Cranford » d'Elizabeth Cleghorn Gaskell est un roman écrit au milieu du XIXe siècle. L'histoire se déroule dans un petit village anglais dominé par les femmes, où les hommes sont manifestement absents de la vie sociale. Le récit est riche en observations sur les rituels, les coutumes et la dynamique particuliers de cette communauté très soudée, et se concentre principalement sur la vie de ses habitantes, notamment la charmante et bienveillante Mlle Matty et le fougueux capitaine Brown, qui vient perturber leur existence tranquille. Au début de « Cranford », nous découvrons la structure sociale unique du village, caractérisée par une population majoritairement féminine qui gère ses affaires sans la présence d'hommes, à l'exception de visiteurs occasionnels. Le premier chapitre décrit avec humour les normes sociales et les règles tacites qui régissent les interactions, telles que les règles de visite et la préférence pour l'économie plutôt que l'ostentation. Des personnages clés tels que la douce Mlle Matty et le charismatique capitaine Brown sont présentés, laissant entrevoir une exploration plus approfondie des relations humaines et du développement des personnages au fur et à mesure que l'histoire progresse. À travers les yeux du narrateur, le lecteur découvre les excentricités attachantes et la camaraderie de la communauté de Cranford, préparant le terrain pour les récits d'amitié, d'amour et de commentaires sociaux qui définissent ce charmant roman.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Table des matières
CHAPITRE I. NOTRE SOCIÉTÉ
CHAPITRE II. LE CAPITAINE
CHAPITRE III. UNE HISTOIRE D'AMOUR D'IL Y A LONGTEMPS
CHAPITRE IV. UNE VISITE À UN VIEIL CÉLIBATAIRE
CHAPITRE V. VIENNES LETTRES
CHAPITRE VI. PAUVRE PETER
CHAPITRE VII. EN VISITE
CHAPITRE VIII. « VOTRE SEIGNEURIE »
CHAPITRE IX. SIGNOR BRUNONI
CHAPITRE X. LA PANIQUE
CHAPITRE XI. SAMUEL BROWN
CHAPITRE XII. FIANCÉS
CHAPITRE XIII. PAIEMENT SUSPENDU
CHAPITRE XIV. DES AMIS DANS LE BESOIN
CHAPITRE XV. UN RETOUR HEUREUX
CHAPITRE XVI. LA PAIX À CRANFORD
Cranford
Elizabeth Cleghorn Gaskell
CHAPITRE I. NOTRE SOCIÉTÉ
Tout d'abord, Cranford est aux mains des Amazones ; tous les propriétaires de maisons dont le loyer dépasse un certain montant sont des femmes. Si un couple marié vient s'installer dans la ville, le monsieur disparaît d'une manière ou d'une autre ; soit il est terrifié à l'idée d'être le seul homme dans les soirées de Cranford, soit il est considéré comme étant avec son régiment, son navire, ou occupé par ses affaires toute la semaine dans la grande ville commerciale voisine de Drumble, distante de seulement vingt miles par le chemin de fer. En bref, quoi qu'il advienne des messieurs, ils ne sont pas à Cranford. Que pourraient-ils faire s'ils étaient là ? Le chirurgien fait sa tournée de trente miles et dort à Cranford, mais tout le monde ne peut pas être chirurgien. Pour entretenir les jardins bien entretenus, remplis de fleurs de choix sans aucune mauvaise herbe, pour effrayer les petits garçons qui regardent avec envie lesdites fleurs à travers les grilles, pour chasser les oies qui s'aventurent parfois dans les jardins si les portes sont laissées ouvertes, pour trancher toutes les questions de littérature et de politique sans se soucier de raisons ou d'arguments inutiles ; pour obtenir une connaissance claire et exacte des affaires de chacun dans la paroisse ; pour maintenir leurs servantes soignées dans un ordre admirable ; pour leur gentillesse (quelque peu dictatoriale) envers les pauvres et leurs services réels et tendres les uns envers les autres chaque fois qu'ils sont dans la détresse, les dames de Cranford suffisent amplement. « Un homme, m'a fait remarquer l'une d'elles un jour, est tellement gênant à la maison ! » Bien que les dames de Cranford connaissent toutes les activités des autres, elles sont extrêmement indifférentes à leurs opinions respectives. En effet, comme chacune a sa propre personnalité, pour ne pas dire son excentricité, assez fortement développée, rien n'est plus facile que la riposte verbale ; mais, d'une manière ou d'une autre, la bonne volonté règne parmi elles dans une large mesure.
Les dames de Cranford n'ont que de petites querelles occasionnelles, exprimées par quelques mots piquants et des hochements de tête furieux, juste assez pour empêcher leur vie monotone de devenir trop ennuyeuse. Leur façon de s'habiller est très indépendante de la mode ; comme elles le font remarquer : « Quelle importance a la façon dont nous nous habillons ici à Cranford, où tout le monde nous connaît ? » Et si elles quittent leur domicile, leur raison est tout aussi convaincante : « Quelle importance a la façon dont nous nous habillons ici, où personne ne nous connaît ? » Les tissus de leurs vêtements sont, en général, de bonne qualité et sobres, et la plupart d'entre elles sont presque aussi scrupuleuses que Mlle Tyler, de mémoire irréprochable ; mais je peux vous assurer que le dernier gigot, le dernier jupon serré et court porté en Angleterre, a été vu à Cranford — et vu sans sourire.
U n magnifique parapluie familial en soie rouge
Je peux témoigner de l'existence d'un magnifique parapluie familial en soie rouge, sous lequel une gentille petite vieille fille, seule survivante d'une fratrie nombreuse, se rendait à l'église les jours de pluie. Avez-vous des parapluies en soie rouge à Londres ? Nous avions une tradition du premier qui ait jamais été vu à Cranford ; et les petits garçons l'ont pris d'assaut et l'ont appelé « un bâton en jupons ». Il s'agissait peut-être du parapluie en soie rouge que j'ai décrit, tenu par un père costaud au-dessus d'une troupe de petits ; la pauvre petite dame, la seule survivante, pouvait à peine le porter.
Il y avait aussi des règles et des règlements pour les visites et les appels, qui étaient annoncés à tous les jeunes gens qui séjournaient dans la ville, avec toute la solennité avec laquelle les anciennes lois mannoises étaient lues une fois par an sur le mont Tinwald.
« Nos amis ont envoyé quelqu'un pour prendre de vos nouvelles après votre voyage de ce soir, ma chère » (vingt-cinq kilomètres dans la voiture d'un gentleman) ; « ils vous laisseront vous reposer demain, mais le surlendemain, je n'en doute pas, ils vous rendront visite ; soyez donc libre après midi — de midi à trois heures, ce sont nos heures de visite. »
Puis, après leur visite...
« C'est le troisième jour ; j'ose dire que votre maman vous a dit, ma chère, de ne jamais laisser passer plus de trois jours entre une visite et une visite en retour ; et aussi, que vous ne devez jamais rester plus d'un quart d'heure. »
« Mais dois-je regarder ma montre ? Comment savoir quand un quart d'heure s'est écoulé ? »
« Tu dois penser à l'heure, ma chérie, et ne pas te permettre de l'oublier pendant la conversation. »
Comme tout le monde avait cette règle à l'esprit, qu'il s'agisse de recevoir ou de rendre une visite, il n'était bien sûr jamais question d'aborder des sujets passionnants. Nous nous en tenions à de courtes phrases de conversation mondaine et étions ponctuels.
J'imagine que quelques-uns des gentilshommes de Cranford étaient pauvres et avaient du mal à joindre les deux bouts, mais ils étaient comme les Spartiates et cachaient leur détresse sous un visage souriant. Aucun d'entre nous ne parlait d'argent, car ce sujet avait un goût de commerce et de commerce, et même si certains étaient pauvres, nous étions tous aristocratiques. Les habitants de Cranford avaient cet esprit de corps bienveillant qui leur faisait oublier tous les échecs lorsque certains d'entre eux essayaient de cacher leur pauvreté. Lorsque Mme Forrester, par exemple, organisait une réception dans sa petite maison, et que la petite servante dérangeait les dames assises sur le canapé en leur demandant de lui passer le plateau à thé, tout le monde considérait cette démarche inhabituelle comme la chose la plus naturelle au monde et discutait des usages et des cérémonies domestiques, comme si nous croyions tous que notre hôtesse disposait d'une salle de service, d'une table d'appoint, d'une gouvernante et d'un intendant, au lieu de la seule petite fille issue d'une école de charité, dont les petits bras rougis n'auraient jamais pu être assez forts pour porter le plateau à l'étage si elle n'avait pas été aidée en privé par sa maîtresse, qui était maintenant assise dignement, feignant de ne pas savoir quels gâteaux avaient été envoyés, alors qu'elle le savait, et que nous le savions, et qu'elle savait que nous le savions, et que nous savions qu'elle savait que nous le savions, car elle avait passé toute la matinée à préparer des petits pains et des gâteaux éponge.
Il y avait une ou deux conséquences découlant de cette pauvreté générale mais non reconnue, et de cette gentillesse très reconnue, qui n'étaient pas mauvaises et qui pourraient être introduites dans de nombreux cercles de la société pour leur grand bénéfice. Par exemple, les habitants de Cranford se couchaient tôt et rentraient chez eux en claquant des sabots, guidés par un porteur de lanterne, vers neuf heures du soir ; et toute la ville était couchée et endormie à dix heures et demie. De plus, il était considéré comme « vulgaire » (un mot terrible à Cranford) d'offrir quoi que ce soit de coûteux, à manger ou à boire, lors des réceptions organisées à l' . L'honorable Mme Jamieson ne servait que des gaufrettes au beurre et des biscuits à la cuillère, et pourtant elle était la belle-sœur du défunt comte de Glenmire, bien qu'elle pratiquât une « économie élégante ».
« Une économie élégante ! » Comme il est naturel de retomber dans la phraséologie de Cranford ! Là-bas, l'économie était toujours « élégante », et dépenser de l'argent toujours « vulgaire et ostentatoire » ; une sorte d'attitude aigrie qui nous rendait très paisibles et satisfaits. Je n'oublierai jamais la consternation ressentie lorsqu'un certain capitaine Brown vint s'installer à Cranford et parla ouvertement de sa pauvreté, non pas à voix basse à un ami intime, les portes et les fenêtres étant préalablement fermées, mais dans la rue, d'une voix forte et militaire, invoquant sa pauvreté comme raison pour ne pas prendre une maison en particulier. Les dames de Cranford se plaignaient déjà de l'invasion de leur territoire par un homme et un gentleman. Il était capitaine à demi-solde et avait obtenu un poste dans un chemin de fer voisin, ce qui avait suscité une vive opposition de la part de la petite ville ; et si, en plus de son sexe masculin et de son lien avec le chemin de fer odieux, il avait l'audace de parler de sa pauvreté, alors il fallait vraiment le mettre au ban de la société. La mort était aussi réelle et courante que la pauvreté, mais personne n'en parlait ouvertement dans la rue. C'était un mot à ne pas prononcer devant des oreilles polies. Nous avions tacitement convenu d'ignorer que ceux avec qui nous nous associions sur un pied d'égalité pouvaient être empêchés par la pauvreté de faire tout ce qu'ils souhaitaient. Si nous allions ou revenions d'une fête à pied, c'était parce que la nuit était belle ou l'air si rafraîchissant, et non parce que les chaises à porteurs étaient chères. Si nous portions des imprimés plutôt que des soies d'été, c'était parce que nous préférions les tissus lavables, et ainsi de suite, jusqu'à nous aveugler sur le fait vulgaire que nous étions tous des gens aux moyens très modestes. Bien sûr, à l'époque, nous ne savions pas quoi penser d'un homme qui pouvait parler de la pauvreté comme si ce n'était pas une honte. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le capitaine Brown s'était imposé à Cranford et était sollicité, malgré toutes les résolutions prises pour l'éviter. J'ai été surprise d'entendre ses opinions citées comme une autorité lors d'une visite que j'ai effectuée à Cranford environ un an après son installation dans la ville. Mes propres amis avaient été parmi les plus farouches opposants à toute proposition de rendre visite au capitaine et à ses filles, douze mois auparavant seulement ; et maintenant, il était même admis pendant les heures taboues avant midi. Certes, c'était pour découvrir la cause d'une cheminée fumante avant que le feu ne soit allumé, mais le capitaine Brown monta les escaliers sans se laisser intimider, parla d'une voix trop forte pour la pièce et plaisanta comme un homme familier dans la maison. Il avait ignoré tous les petits affronts et les omissions de cérémonies insignifiantes avec lesquels il avait été reçu. Il s'était montré amical, même si les dames de Cranford étaient restées froides ; il avait répondu de bonne foi aux petits compliments sarcastiques et, avec sa franchise virile, il avait surmonté toute la timidité qui l'accueillait en tant qu'homme qui n'avait pas honte d'être pauvre. Et finalement, son excellent bon sens masculin et sa facilité à trouver des expédients pour surmonter les dilemmes domestiques lui avaient valu une place extraordinaire d'autorité parmi les dames de Cranford. Lui-même poursuivait son chemin, aussi inconscient de sa popularité qu'il l'avait été de son impopularité ; et je suis sûr qu'il fut surpris un jour lorsqu'il constata que ses conseils étaient si appréciés que certains conseils qu'il avait donnés en plaisantant étaient pris au sérieux.
Il s'agissait de ceci : une vieille dame avait une vache Alderney, qu'elle considérait comme sa fille. On ne pouvait pas lui rendre une visite d'un petit quart d'heure sans qu'elle nous parle du lait merveilleux ou de l'intelligence extraordinaire de cet animal. Toute la ville connaissait et aimait l'Alderney de Mlle Betsy Barker ; c'est pourquoi la sympathie et le regret furent grands lorsque, dans un moment d'inattention, la pauvre vache tomba dans une fosse à chaux. Elle gémissait si fort qu'elle fut rapidement entendue et secourue ; mais entre-temps, la pauvre bête avait perdu la plupart de ses poils et en ressortit nue, frigorifiée et misérable, la peau à vif. Tout le monde avait pitié de l'animal, même si certains ne pouvaient s'empêcher de sourire devant son apparence comique. Mlle Betsy Barker pleurait de chagrin et de désarroi ; on dit qu'elle envisagea de lui faire prendre un bain d'huile. Ce remède lui avait peut-être été recommandé par l'une des personnes à qui elle avait demandé conseil, mais la proposition, si elle a jamais été faite, a été rejetée par le capitaine Brown qui a déclaré : « Procurez-lui un gilet et des culottes en flanelle, madame, si vous voulez la garder en vie. Mais mon conseil est de tuer cette pauvre créature immédiatement. »
Mlle Betsy Barker sécha ses yeux et remercia chaleureusement le capitaine ; elle se mit au travail, et peu à peu, toute la ville se rassembla pour voir l'Alderney se rendre docilement à son pâturage, vêtue de flanelle gris foncé. Je l'ai moi-même observée à maintes reprises. Avez-vous déjà vu des vaches vêtues de flanelle grise à Londres ?
Se rendant docilement à son pâturage
Le capitaine Brown avait pris une petite maison à la périphérie de la ville, où il vivait avec ses deux filles. Il devait avoir plus de soixante ans lorsque je me rendis pour la première fois à Cranford après l'avoir quitté. Mais il avait une silhouette nerveuse, bien entraînée et élastique, une tête militaire raide et un pas bondissant, qui le faisaient paraître beaucoup plus jeune qu'il ne l'était. Sa fille aînée semblait presque aussi âgée que lui et trahissait le fait qu'il était plus vieux qu'il n'y paraissait. Mlle Brown devait avoir quarante ans ; elle avait le visage maladif, douloureux et marqué par les soucis, et semblait avoir depuis longtemps perdu toute la gaieté de la jeunesse. Même dans sa jeunesse, elle devait être sans beauté et avoir les traits durs. Mlle Jessie Brown avait dix ans de moins que sa sœur et était vingt fois plus jolie. Son visage était rond et parsemé de fossettes. Mlle Jenkyns avait dit un jour, dans un accès de colère contre le capitaine Brown (dont je vous raconterai la cause dans un instant), « qu'elle pensait qu'il était temps pour Mlle Jessie d'abandonner ses fossettes et de ne pas toujours essayer de ressembler à une enfant ». Il est vrai qu'il y avait quelque chose d'enfantin dans son visage, et je pense que cela restera ainsi jusqu'à sa mort, même si elle vit jusqu'à cent ans. Elle avait de grands yeux bleus émerveillés qui vous regardaient droit dans les yeux ; son nez était mal formé et retroussé, et ses lèvres étaient rouges et humides ; elle portait également ses cheveux en petites boucles, ce qui accentuait cette apparence. Je ne sais pas si elle était jolie ou non, mais j'aimais son visage, comme tout le monde d'ailleurs, et je ne pense pas qu'elle pouvait s'empêcher d'avoir des fossettes. Elle avait quelque chose de la démarche et des manières enjouées de son père ; et toute observatrice attentive pouvait détecter une légère différence dans la tenue vestimentaire des deux sœurs, celle de Mlle Jessie étant environ deux livres par an plus coûteuse que celle de Mlle Brown. Deux livres représentaient une somme importante dans les dépenses annuelles du capitaine Brown.
Telle fut l'impression que me fit la famille Brown lorsque je les vis tous ensemble pour la première fois à l'église de Cranford. J'avais déjà rencontré le capitaine auparavant, à l'occasion du problème de cheminée enfumée, qu'il avait résolu par une simple modification du conduit. À l'église, il avait tenu ses lunettes à double loupe devant ses yeux pendant l'hymne du matin, puis avait redressé la tête et chanté à voix haute et joyeusement. Il répondait plus fort que le sacristain, un vieil homme à la voix faible et aiguë qui, je pense, se sentait offensé par la voix de basse sonore du capitaine et tremblait de plus en plus fort en conséquence.
En sortant de l'église, le capitaine, plein d'entrain, accorda la plus grande attention à ses deux filles. Il salua ses connaissances d'un signe de tête et d'un sourire, mais ne serra la main à personne avant d'avoir aidé Mlle Brown à ouvrir son parapluie, de lui avoir pris son livre de prières et d'avoir attendu patiemment qu'elle soulève sa robe de ses mains tremblantes pour marcher sur les routes mouillées.
Je me demande ce que les dames de Cranford faisaient du capitaine Brown lors de leurs soirées. Nous nous réjouissions souvent, autrefois, de ne pas avoir à nous occuper d'un gentleman ni à trouver des sujets de conversation lors des soirées cartes. Nous nous félicitions du confort de nos soirées et, dans notre amour de la distinction et notre dégoût pour l'humanité, nous nous étions presque persuadées qu'être un homme, c'était être « vulgaire » ; si bien que lorsque j'ai appris que mon amie et hôtesse, Mlle Jenkyns, allait organiser une soirée en mon honneur et que le capitaine et les demoiselles Brown étaient invités, je me suis demandé comment allait se dérouler la soirée. Les tables de jeu, recouvertes de feutrine verte, furent dressées à la lumière du jour, comme d'habitude ; c'était la troisième semaine de novembre, et la nuit tombait vers quatre heures. Des bougies et des jeux de cartes neufs furent disposés sur chaque table. Le feu était allumé, la servante soignée avait reçu ses dernières instructions, et nous étions là, vêtues de nos plus beaux atours, chacune avec un allume-bougie à la main, prêtes à allumer les bougies dès que l'on frapperait à la porte. Les soirées à Cranford étaient des fêtes solennelles, qui rendaient les dames gravement exaltées alors qu'elles étaient assises ensemble dans leurs plus belles robes. Dès que trois d'entre elles furent arrivées, nous nous sommes assises pour jouer au « Preference », moi étant la quatrième malchanceuse. Les quatre suivantes furent immédiatement installées à une autre table ; et bientôt, les plateaux à thé, que j'avais vus disposés dans le cellier en passant le matin, furent placés au milieu d'une table à cartes. La porcelaine était délicate comme de la coquille d'œuf ; l'argenterie à l'ancienne brillait d'éclat ; mais les mets étaient des plus modestes. Alors que les plateaux étaient encore sur les tables, le capitaine et les demoiselles Brown entrèrent ; et je pus constater que, d'une manière ou d'une autre, le capitaine était le favori de toutes les dames présentes. Les sourcils froncés se détendirent, les voix aiguës s'abaissèrent à son approche. Mlle Brown avait l'air malade et déprimée, presque morose. Mlle Jessie souriait comme d'habitude et semblait presque aussi populaire que son père. Il prit immédiatement et discrètement la place de l'homme dans la pièce ; il s'occupa des besoins de chacun, allégea la tâche de la jolie servante en servant les tasses vides et les dames sans pain ni beurre ; et pourtant, il fit tout cela d'une manière si facile et si digne, et comme s'il était tout à fait naturel que les forts s'occupent des faibles, qu'il était un vrai homme dans toute sa personne. Il jouait pour trois pence avec autant d'intérêt que s'il s'agissait de livres ; et pourtant, tout en s'occupant des étrangers, il gardait un œil sur sa fille souffrante - car j'étais sûr qu'elle souffrait, même si pour beaucoup, elle semblait seulement irritable. Mlle Jessie ne savait pas jouer aux cartes, mais elle parlait aux personnes qui ne jouaient pas et qui, avant son arrivée, avaient tendance à être de mauvaise humeur. Elle chantait aussi, accompagnée d'un vieux piano désaccordé, qui, je pense, avait été une épinette dans sa jeunesse. Mlle Jessie chantait « Jock of Hazeldean » un peu faux, mais aucun d'entre nous n'était musicien, même si Mlle Jenkyns battait la mesure, hors du tempo, pour donner l'impression de l'être.
C'était très gentil de la part de Mlle Jenkyns d'agir ainsi, car j'avais remarqué peu avant qu'elle avait été très agacée par la confession imprudente de Mlle Jessie Brown (à propos de la laine des Shetland) selon laquelle elle avait un oncle, le frère de sa mère, qui tenait un magasin à Édimbourg. Mlle Jenkyns tenta de noyer cette confession sous une terrible quinte de toux, car l'honorable Mme Jamieson était assise à une table de jeu près de Mlle Jessie, et que dirait-elle ou penserait-elle, , si elle découvrait qu'elle se trouvait dans la même pièce que la nièce d'un commerçant ! Mais Mlle Jessie Brown (qui n'avait aucun tact, comme nous en avons tous convenu le lendemain matin) répéta l'information et assura à Mlle Pole qu'elle pouvait facilement lui procurer la laine des Shetland requise, « grâce à mon oncle, qui possède le meilleur assortiment de produits des Shetland de tout Édimbourg ». C'est pour nous faire oublier cette conversation et nous enlever ce son des oreilles que Mlle Jenkyns proposa de faire de la musique ; je répète donc que c'était très gentil de sa part de battre la mesure de la chanson.
Lorsque les plateaux réapparurent avec des biscuits et du vin, ponctuellement à neuf heures moins le quart, il y eut des conversations, des comparaisons de cartes et des discussions sur les tours, mais peu à peu, le capitaine Brown se mit à parler de littérature.
« Avez-vous lu des numéros des Pickwick Papers ? » demanda-t-il. (Ils étaient alors publiés en feuilletons.) « C'est excellent ! »
Or, Mlle Jenkyns était la fille d'un ancien recteur de Cranford décédé ; forte d'un certain nombre de sermons manuscrits et d'une assez bonne bibliothèque théologique, elle se considérait comme une femme de lettres et voyait toute conversation sur les livres comme un défi à relever. Elle répondit donc : « Oui, elle les avait vus ; en fait, elle pouvait dire qu'elle les avait lus. »
« Et qu'en pensez-vous ? s'exclama le capitaine Brown. Ne sont-ils pas remarquablement bons ? »
Ainsi pressée, Mlle Jenkyns ne put s'empêcher de répondre.
« Je dois dire que je ne les trouve pas du tout à la hauteur du Dr Johnson. Mais peut-être l'auteur est-il jeune. Qu'il persévère, et qui sait ce qu'il deviendra s'il prend le grand docteur pour modèle ? » C'en était manifestement trop pour le capitaine Brown, qui ne put s'empêcher de réagir. Je vis les mots lui venir à la bouche avant même que Mlle Jenkyns ait fini sa phrase.
« C'est tout à fait différent, ma chère madame », commença-t-il.
« J'en suis tout à fait consciente, répondit-elle. Et je fais preuve d'indulgence, capitaine Brown. »
« Permettez-moi simplement de vous lire un passage du numéro de ce mois-ci », supplia-t-il. « Je l'ai reçu ce matin seulement, et je ne pense pas que la compagnie ait déjà pu le lire. »
« Comme vous voudrez », dit-elle en s'installant avec un air résigné. Il lut le récit de la « bagarre » que Sam Weller avait racontée à Bath. Certains d'entre nous rirent de bon cœur. Je n'osai pas, car je restais dans la maison. Mlle Jenkyns resta assise, patiente et grave. Quand il eut terminé, elle se tourna vers moi et me dit avec une douce dignité :
« Apportez-moi « Rasselas », ma chère, dans la bibliothèque. »
Quand je le lui eus apporté, elle se tourna vers le capitaine Brown :
« Permettez-moi maintenant de vous lire un passage, puis les personnes présentes pourront juger entre votre favori, M. Boz, et le Dr Johnson. »
Elle lut l'une des conversations entre Rasselas et Imlac d'une voix aiguë et majestueuse, puis, lorsqu'elle eut terminé, elle dit : « Je pense que ma préférence pour le Dr Johnson en tant qu'auteur de fiction est désormais justifiée. » Le capitaine pinça les lèvres et tambourina sur la table, mais il ne dit rien. Elle pensa qu'elle allait lui asséner un ou deux coups de grâce.
S'efforçant de l'entraîner dans la conversation
« Je considère qu'il est vulgaire et indigne de la littérature de publier en plusieurs numéros. »
« Comment le Rambler était-il publié, madame ? » demanda le capitaine Brown à voix basse, de sorte que Mlle Jenkyns ne put l'entendre, je pense.
« Le style du Dr Johnson est un modèle pour les jeunes débutants. Mon père me l'a recommandé lorsque j'ai commencé à écrire des lettres. J'ai façonné mon propre style en m'inspirant de lui. Je l'ai recommandé à votre favori. »
« Je serais très désolé qu'il échange son style contre une écriture aussi pompeuse », dit le capitaine Brown.
Mlle Jenkyns prit cela comme une offense personnelle, d'une manière que le capitaine n'aurait jamais imaginée. Elle et ses amis considéraient l'écriture épistolaire comme son point fort. J'ai vu de nombreuses copies de nombreuses lettres écrites et corrigées sur l'ardoise, avant qu'elle ne « profite de la demi-heure précédant l'heure du courrier pour assurer » ses amis de ceci ou de cela ; et le Dr Johnson était, comme elle le disait, son modèle dans ces compositions. Elle se redressa avec dignité et répondit à la dernière remarque du capitaine Brown en disant, en insistant sur chaque syllabe : « Je préfère le Dr Johnson à M. Boz. »
On raconte – je ne garantis pas la véracité de cette anecdote – que le capitaine Brown aurait murmuré : « Maudit Dr Johnson ! » S'il l'a fait, il s'est repenti par la suite, comme il l'a montré en allant se placer près du fauteuil de Mlle Jenkyns et en essayant de l'entraîner dans une conversation sur un sujet plus agréable. Mais elle était inexorable. Le lendemain, elle fit la remarque que j'ai mentionnée au sujet des fossettes de Mlle Jessie.
CHAPITRE II. LE CAPITAINE
Il était impossible de vivre un mois à Cranford sans connaître les habitudes quotidiennes de chaque résident ; et bien avant la fin de ma visite, j'en savais beaucoup sur le trio Brown. Il n'y avait rien de nouveau à découvrir concernant leur pauvreté, car ils en avaient parlé simplement et ouvertement dès le début. Ils ne faisaient aucun mystère de la nécessité d'être économes. Il ne restait plus qu'à découvrir l'infinie bonté de cœur du capitaine et les différentes façons dont il la manifestait, sans s'en rendre compte. Quelques petites anecdotes firent l'objet de conversations pendant un certain temps après qu'elles se furent produites. Comme nous ne lisions pas beaucoup et que toutes les dames étaient assez bien pourvues de domestiques, les sujets de conversation se faisaient rares. Nous avons donc discuté du fait que le capitaine avait pris des mains d'une pauvre vieille femme son dîner un dimanche où le sol était très glissant. Il l'avait rencontrée alors qu'elle revenait de la boulangerie et qu'il sortait de l'église, et il avait remarqué qu'elle avait du mal à marcher. Avec la dignité grave qui le caractérisait, il l'avait soulagée de son fardeau et l'avait accompagnée dans la rue, portant son mouton rôti et ses pommes de terre jusqu'à chez elle. Cela fut jugé très excentrique et on s'attendait plutôt à ce qu'il fasse une tournée de visites le lundi matin pour s'expliquer et présenter ses excuses à la sensibilité de Cranford, mais il n'en fit rien. On décida alors qu'il avait honte et qu'il se cachait. Par compassion pour lui, nous avons commencé à dire : « Après tout, ce qui s'est passé dimanche matin montre qu'il a bon cœur », et il fut décidé qu'il serait réconforté lors de sa prochaine apparition parmi nous ; mais, ô surprise ! il se présenta devant nous, sans aucun sentiment de honte, parlant d'une voix forte et grave comme toujours, la tête rejetée en arrière, sa perruque aussi élégante et bien bouclée que d'habitude, et nous fûmes obligés de conclure qu'il avait tout oublié de dimanche.
Mlle Pole et Mlle Jessie Brown avaient noué une sorte d'intimité grâce à la laine des Shetland et aux nouveaux points de tricot ; ainsi, lorsque je rendais visite à Mlle Pole, je voyais davantage les Brown que lorsque je séjournais chez Mlle Jenkyns, qui ne s'était jamais remise de ce qu'elle appelait les remarques désobligeantes du capitaine Brown à l'égard du Dr Johnson, qu'il qualifiait d'auteur de romans légers et agréables. Je découvris que Mlle Brown était gravement atteinte d'une maladie incurable et persistante, dont la douleur donnait à son visage cette expression inquiète que j'avais prise pour de la mauvaise humeur pure et simple. Elle était parfois de mauvaise humeur, lorsque l'irritabilité nerveuse causée par sa maladie devenait insupportable. Mlle Jessie la supportait dans ces moments-là, avec encore plus de patience qu'elle n'en avait pour les reproches amers qu'elle s'adressait invariablement à elle-même après coup. Mlle Brown s'accusait non seulement d'avoir un caractère impulsif et irritable, mais aussi d'être la cause pour laquelle son père et sa sœur étaient obligés de se serrer la ceinture afin de lui offrir les petits luxes qui étaient nécessaires à son état. Elle aurait tant voulu faire des sacrifices pour eux et alléger leurs soucis que la générosité originelle de son caractère ajoutait de l'acrimonie à son tempérament. Tout cela était supporté avec plus que de la placidité, avec une tendresse absolue, d , Mlle Jessie et son père. Je pardonnais à Mlle Jessie de chanter faux et de s'habiller de façon juvénile lorsque je la voyais à la maison. Je finis par comprendre que la perruque sombre à la Brutus et le manteau rembourré (hélas trop souvent usé) du capitaine Brown étaient des vestiges de l'élégance militaire de sa jeunesse, qu'il portait désormais inconsciemment. C'était un homme aux ressources infinies, acquises grâce à son expérience dans les casernes. Comme il l'avouait lui-même, personne ne savait cirer ses bottes à son goût, sauf lui-même ; mais, en réalité, il n'hésitait pas à épargner la petite servante de toutes les manières possibles, sachant sans doute que la maladie de sa fille rendait la tâche difficile.
Il s'efforça de faire la paix avec Mlle Jenkyns peu après la dispute mémorable que j'ai mentionnée, en lui offrant une pelle à feu en bois (de sa propre fabrication), après l'avoir entendue dire à quel point le grincement d'une pelle en fer l'agaçait. Elle reçut le cadeau avec une gratitude froide et le remercia formellement. Une fois qu'il fut parti, elle me demanda de la ranger dans le débarras, estimant probablement qu'aucun cadeau d'un homme qui préférait M. Boz au Dr Johnson ne pouvait être plus discordant qu'une pelle à feu en fer.
Telle était la situation lorsque je quittai Cranford pour me rendre à Drumble. J'avais cependant plusieurs correspondants qui me tenaient au courant des événements de cette chère petite ville. Il y avait Mlle Pole, qui se passionnait autant pour le crochet qu'elle s'était autrefois passionnée pour le tricot, et dont les lettres se résumaient à peu près ainsi : « Mais n'oubliez pas la laine blanche chez Flint » de la vieille chanson ; car à la fin de chaque phrase contenant des nouvelles venait une nouvelle instruction concernant une commande de crochet que je devais exécuter pour elle. Mlle Matilda Jenkyns (qui ne voyait pas d'inconvénient à être appelée Mlle Matty lorsque Mlle Jenkyns n'était pas là) écrivait des lettres agréables, aimables et décousues, se risquant de temps en temps à donner son opinion ; mais elle se reprenait soudainement et me suppliait de ne pas répéter ce qu'elle avait dit, car Deborah pensait différemment, et elle le savait, ou bien elle ajoutait un post-scriptum indiquant que, depuis qu'elle avait écrit ce qui précède, elle avait discuté du sujet avec Deborah et était tout à fait convaincue que, etc. (suivait probablement une rétractation de toutes les opinions qu'elle avait exprimées dans la lettre). Puis vint Mlle Jenkyns — Deborah, comme elle aimait que Mlle Matty l'appelle, son père ayant dit un jour que le nom hébreu devait être prononcé ainsi. Je pense secrètement qu'elle prenait la prophétesse hébraïque comme modèle de caractère ; et, en effet, elle ne était pas sans rappeler la prophétesse sévère à certains égards, en tenant compte, bien sûr, des coutumes modernes et des différences vestimentaires. Mlle Jenkyns portait une cravate et un petit bonnet semblable à une casquette de jockey, et avait dans l'ensemble l'apparence d'une femme à l'esprit fort, même si elle aurait méprisé l'idée moderne selon laquelle les femmes sont égales aux hommes. Égales, vraiment ! Elle savait qu'elles étaient supérieures. Mais revenons à ses lettres. Tout en elles était majestueux et grandiose, à l'image d'elle-même. Je les ai relues (chère Mlle Jenkyns, comme je l'honorais !) et j'en donnerai un extrait, d'autant plus qu'il concerne notre ami le capitaine Brown :
« L'honorable Mme Jamieson vient de me quitter ; au cours de notre conversation, elle m'a appris qu'elle avait reçu hier la visite de l'ancien ami de son vénéré mari, Lord Mauleverer. Vous ne devinerez pas facilement ce qui a amené Sa Seigneurie dans notre petite ville. C'était pour voir le capitaine Brown, avec lequel, semble-t-il, Sa Seigneurie s'était liée d'amitié pendant les « guerres à plumes » et qui avait eu le privilège de lui éviter la mort alors qu'un grand danger le menaçait, au large du cap mal nommé de Bonne-Espérance. Vous connaissez le manque de curiosité innocente de notre amie, l'honorable Mme Jamieson, et vous ne serez donc pas surpris, , lorsque je vous dirai qu'elle n'a pas été en mesure de me révéler la nature exacte du danger en question. J'avoue que j'étais impatient de savoir comment le capitaine Brown, avec ses moyens limités, pouvait recevoir un invité aussi distingué ; j'ai découvert que Sa Seigneurie s'était retirée pour se reposer, et, espérons-le, pour un sommeil réparateur, à l'hôtel Angel, mais qu'elle avait partagé les repas brunoniens pendant les deux jours où elle avait honoré Cranford de sa présence auguste. Mme Johnson, la femme de notre aimable boucher, m'informe que Mlle Jessie a acheté un gigot d'agneau ; mais, à part cela, je n'ai entendu parler d'aucune préparation pour accueillir comme il se doit un visiteur aussi distingué. Peut-être l'ont-ils diverti avec « le festin de la raison et le flux de l'âme » ; et pour nous, qui connaissons le triste manque d'enthousiasme du capitaine Brown pour « les puits purs de l'anglais immaculé », il y a peut-être lieu de se réjouir qu'il ait eu l'occasion d'améliorer son goût en conversant avec un membre élégant et raffiné de l'aristocratie britannique. Mais qui est totalement exempt de défauts mondains ? »
Mlle Pole et Mlle Matty m'ont écrit par le même courrier. Une nouvelle telle que la visite de Lord Mauleverer ne pouvait échapper aux correspondantes de Cranford : elles en ont tiré le meilleur parti. Mlle Matty s'est humblement excusée d'écrire en même temps que sa sœur, qui était bien plus douée qu'elle pour décrire l'honneur fait à Cranford ; mais malgré quelques fautes d'orthographe, le récit de Mlle Matty m'a donné la meilleure idée de l'agitation provoquée par la visite de Sa Seigneurie, après qu'elle eut eu lieu ; car, à l'exception des clients de l'Angel, des Brown, de Mme Jamieson et d'un petit garçon que Sa Seigneurie avait injurié pour avoir fait rouler un cerceau sale contre ses jambes aristocratiques, je n'ai entendu parler de personne avec qui Sa Seigneurie ait eu une conversation.
Ma visite suivante à Cranford eut lieu pendant l'été. Il n'y avait eu ni naissance, ni décès, ni mariage depuis ma dernière visite. Tout le monde vivait dans la même maison et portait à peu près les mêmes vêtements bien conservés et démodés. Le plus grand événement fut que Mlle Jenkyns avait acheté un nouveau tapis pour le salon. Oh, quelle tâche nous avons eue, Mlle Matty et moi, à courir après les rayons du soleil qui, l'après-midi, tombaient à travers la fenêtre sans rideaux directement sur ce tapis ! Nous avons étendu des journaux à cet endroit et nous nous sommes assises pour lire ou travailler ; mais en un quart d'heure, le soleil avait bougé et brillait à un autre endroit ; nous nous sommes donc remises à genoux pour changer la position des journaux. Nous avons également été très occupées, toute une matinée, avant que Mlle Jenkyns ne donne sa réception, à suivre ses instructions et à découper et assembler des morceaux de papier journal afin de former de petits chemins menant à chaque chaise destinée aux invités attendus, de peur que leurs chaussures ne salissent ou ne souillent la pureté du tapis. Faites-vous des chemins en papier pour que chaque invité puisse marcher dessus à Londres ?
Le capitaine Brown et Mlle Jenkyns n'étaient pas très cordiaux l'un envers l'autre. La dispute littéraire, dont j'avais vu le début, était une « plaie ouverte » qui les faisait grimacer au moindre contact. C'était la seule divergence d'opinion qu'ils aient jamais eue, mais cette divergence suffisait. Mlle Jenkyns ne pouvait s'empêcher de parler au capitaine Brown ; et, bien qu'il ne répondît pas, il tambourinait des doigts, ce qu'elle ressentait et considérait comme très désobligeant envers le Dr Johnson. Il affichait de manière assez ostentatoire sa préférence pour les écrits de M. Boz ; il marchait dans les rues tellement absorbé par sa lecture qu'il faillit heurter Mlle Jenkyns ; et bien que ses excuses fussent sincères et qu'il ne fût en fait pas allé plus loin que de l'effrayer et de s'effrayer lui-même, elle m'avoua qu'elle aurait préféré qu'il la renverse, s'il avait seulement lu un ouvrage littéraire de plus haut niveau. Le pauvre et courageux capitaine ! il semblait plus âgé, plus usé, et ses vêtements étaient très élimés. Mais il semblait aussi vif et joyeux que jamais, sauf lorsqu'on lui posait des questions sur la santé de sa fille.
« Elle souffre beaucoup, et elle doit souffrir encore plus : nous faisons tout ce que nous pouvons pour soulager sa douleur ; que la volonté de Dieu soit faite ! » Il ôta son chapeau en prononçant ces derniers mots. J'ai appris par Mlle Matty que tout avait été fait, en fait. Un médecin très réputé dans cette région rurale avait été appelé, et toutes ses prescriptions avaient été suivies, sans égard au coût. Mlle Matty était certaine qu'ils se privaient de beaucoup de choses pour assurer le confort de l'invalide, mais ils n'en parlaient jamais ; et quant à Mlle Jessie ! « Je pense vraiment que c'est un ange », disait la pauvre Mlle Matty, toute émue. « La voir supporter la mauvaise humeur de Mlle Brown et afficher un visage radieux après avoir veillé toute la nuit et s'être fait gronder pendant plus de la moitié de celle-ci est tout simplement magnifique. Pourtant, elle est aussi pimpante et prête à accueillir le capitaine à l'heure du petit-déjeuner que si elle avait dormi toute la nuit dans le lit de la reine. Ma chère ! Vous ne pourriez plus jamais vous moquer de ses petites boucles guindées ou de ses nœuds roses si vous la voyiez comme je l'ai vue. » Je ne pouvais que me sentir très repentante et saluer Mlle Jessie avec un double respect lorsque je la rencontrai la fois suivante. Elle avait l'air pâle et tirée, et ses lèvres se mirent à trembler, comme si elle était très faible, lorsqu'elle parla de sa sœur. Mais elle s'égaya et refoula les larmes qui brillaient dans ses jolis yeux en disant :
« Mais, bien sûr, quelle ville pleine de gentillesse que Cranford ! Je ne pense pas que quiconque ait un meilleur dîner que d'habitude, mais le meilleur vient dans un petit plat couvert pour ma sœur. Les pauvres gens laissent leurs premiers légumes à notre porte pour elle. Ils parlent de manière brève et bourrue, comme s'ils en avaient honte, mais je suis sûre que leur attention me touche souvent profondément. » Les larmes revinrent et débordèrent, mais après une minute ou deux, elle se mit à se gronder elle-même et finit par partir, toujours aussi joyeuse que d'habitude.
« Mais pourquoi ce Lord Mauleverer ne fait-il rien pour l'homme qui lui a sauvé la vie ? » dis-je.
« Vous voyez, à moins d'avoir une bonne raison, le capitaine Brown ne parle jamais de sa pauvreté ; et il marchait aux côtés de Sa Seigneurie, l'air aussi heureux et joyeux qu'un prince ; et comme ils n'ont jamais attiré l'attention sur leur dîner en s'excusant, et que Mlle Brown allait mieux ce jour-là, et que tout semblait aller pour le mieux, j'ose dire que Sa Seigneurie n'a jamais su à quel point la situation était préoccupante en coulisses. Il envoyait assez souvent du gibier en hiver, mais maintenant il est parti à l'étranger. »
J'ai souvent eu l'occasion de remarquer l'usage qui était fait des fragments et des petites occasions à Cranford ; les pétales de rose qui étaient cueillis avant de tomber pour faire un pot-pourri pour quelqu'un qui n'avait pas de jardin ; les petits bouquets de fleurs de lavande envoyés pour parfumer les tiroirs d'un citadin ou pour brûler dans la chambre d'un invalide. Des choses que beaucoup méprisaient, et des actions qui semblaient à peine valoir la peine d'être accomplies, étaient toutes prises en compte à Cranford. Mlle Jenkyns piquait une pomme de clous de girofle, afin qu'elle soit chauffée et embaume agréablement la chambre de Mlle Brown ; et tandis qu'elle enfonçait chaque clou de girofle, elle prononçait une phrase de Johnson. En effet, elle ne pouvait jamais penser aux Brown sans parler de Johnson ; et comme ils occupaient rarement ses pensées à ce moment-là, j'entendais souvent des phrases alambiquées à trois niveaux.