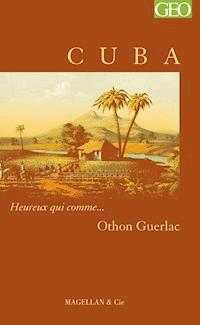
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Partager les émotions des premiers écrivains-voyageurs et retrouver les racines d’un monde intemporel.
Vivant aux États-Unis depuis longtemps, Othon Guerlac est un agent actif du rayonnement français à l’étranger. Quand il débarque à Cuba, il arrive à un moment crucial de l’histoire de la plus grande île des Caraïbes. C’est l’heure inouïe de la proclamation de l’indépendance, depuis l’arrivée de Christophe Colomb en 1492 et une domination espagnole longue de quatre cents ans.
Récit publié dans Le Tour du monde en 1903.
Othon Guerlac livre un portrait de l'île de Cuba au début du XIXe siècle, lorsqu’elle entre dans ce qui est appelé le concert des nations.
EXTRAIT
Le 20 mai 1902, l’île de Cuba a pris sa place dans ce qu’il est convenu d’appeler le « concert des nations ». Cette entrée dans le monde s’est accomplie avec le cérémonial qu’on pouvait attendre d’un peuple qui, par hérédité, aime les belles manières, et au milieu de manifestations de joie et d’enthousiasme dont la violence ne saurait pas non plus surprendre chez des hommes qui vivent sous le vingtième degré de latitude…
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.
Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Né en 1870 à Saint-Louis, ville alors allemande, Othon Guerlac grandira en France. En 1897, fort d’un diplôme en Arts et d’un autre en Droit, il rejoint rapidement l’Université de Cornell, aux États-Unis. Il gravira peu à peu les échelons pour devenir, en 1919, titulaire d’un poste de professeur de littérature.
Il servit la France durant la Première Guerre mondiale, ce qui lui valut le titre de World War Memorial Professor à Cornell, mais aussi, en France, la médaille de la Légion d’Honneur. Correspondant très actif aux États-Unis pour le journal français Le Temps, membre du Bureau d’Études de la Maison de la Presse, il publia plusieurs œuvres théoriques, notamment un manuel scolaire concernant les citations françaises ; ouvrage qui lui valut un succès d’estime auprès des milieux spécialisés.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNE VIE AGITÉE AVANT FIDEL
Présenté par Marc Wiltz
L’histoire de l’île de Cuba est tumultueuse, conçue par tous les étrangers qui l’ont successivement envahie pour en faire leur « chose » et la ployer avec la force de leurs désirs. Elle n’a pas rompue, réinventant son identité aux rythmes entraînant de la musique métisse qu’elle a su installer pour elle-même dans les cœurs de ses habitants. Ce grand mélange des influences venues d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du puissant voisin américain s’est solidement constitué sur les ruines autochtones, balayées par les violences de l’Histoire. Ce melting pot débarqué de l’extérieur s’est mué en une culture à part entière, aisément repérable, avec ses codes et ses douleurs, son charme et ses plaisirs. Elle aurait pu ne jamais advenir. Qu’on en juge !
Le 28 octobre 1492, l’amiral Christophe Colomb croit parvenir en Chine du Sud, l’objet de ses désirs les plus fous depuis sa lecture du Devisement du monde (1298) de Marco Polo. Il fait savoir à tous qu’il est enfin arrivé sur la « terre ferme du commencement de la route des Indes ». Les délires cubains faits de mensonges, de meurtres de masse et de domination implacable ont trouvé avec lui leur premier géniteur, un genou posé sur le sable pour remercier les dieux. Le mythe peut se déployer. Mais Colomb s’est trompé. C’est bien à Cuba qu’il a jeté l’ancre. Il retourne en Espagne pour rendre compte de ses « progrès » sur la route de l’or, mais il revient à chaque fois dans sa « Chine ». Là, il trouve peu d’épices, presque pas d’or et, s’il laisse quelques prêtres sur la plage, c’est pour évangéliser les sauvages à moitié nus qui lui ont pourtant réservé le meilleur accueil. C’est toujours ça, pour complaire à leurs majestés de la lointaine Castille, ses commanditaires. La suite est cruelle.
Les successeurs de Colomb savent maintenant qu’ils ne sont pas en Chine. Cuba sert de camp de base pour lancer la conquête espagnole sur l’Amérique du Sud qui fera des ravages, à commencer sur l’île elle-même où les populations autochtones, Taïnos et Karibs, sont rapidement réduites à néant. Hernan Cortès s’y installe et prépare son expédition au Mexique et la destruction de l’Empire aztèque. Bartolomé de Las Casas (1484-1566), le défenseur des indigènes, indique désabusé que « les Indiens venaient à nous avec victuailles et sourires. Hommes, femmes, enfants : trois mille êtres passés au fil de l’épée, en ma présence, sans raison aucune… »
Il faut bien remplacer alors la main d’œuvre disparue. C’est ainsi que les esclaves venus d’Afrique échouent sur l’île, à flots continus, pour exploiter les nouvelles plantations de canne à sucre. De quarante mille esclaves en 1774, le nombre estimé en 1840 est de quatre cent soixante-dix mille, soit la moitié de la population cubaine…
Pendant ce temps, autour de ces mers agitées, les pirates, les corsaires et tous les flibustiers s’en donnent à cœur joie. Le trafic maritime est tel qu’il laisse l’imagination et la cupidité des plus téméraires se débrider. Les cales des bateaux sont pleines, dans les deux sens. Un coup de chance peut rapporter gros. Le Jolly Roger, le pavillon noir orné d’une tête de mort, et L’Île au trésor (1883) de Robert Louis Stevenson sont nés dans ces parages, donnant encore d’autres couleurs au mythe cubain qui se constitue.
Le café et le tabac viennent s’ajouter au sucre dans l’économie de l’île et poussent à toujours plus de rendement pour les maîtres espagnols. Les premières révoltes pour sortir de cette soumission généralisée éclatent. Vite réprimées d’abord, celles de 1812, de 1841, de 1862. Puis l’insurrection contre l’Espagne gagne. La Guerre des Dix-Ans (1878-1878) et la Guerre d’indépendance (1895-1898) voient naître les premières figures des pères de la nation : Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), mort au combat ; les frères Bacardi – les rois du rhum –, en exil ; José Marti (1853-1895), mort au combat, après avoir écrit le Manifeste de Monte-Cristo, appel à l’insurrection pour construire un pays libre et démocratique ; Antonio Maceo (1845-1896), le général noir qui a participé à près de neuf cents batailles, mort au combat…
José Marti avait pourtant prévenu : « Pour l’indépendance de Cuba, il est de mon devoir d’empêcher la mainmise des États-Unis sur les Antilles et leur invasion… Je connais le Monstre, car j’ai vécu dans son antre. » Mais la presse américaine menée par William Randolph Hearst et par Joseph Pulitzer a chauffé à blanc l’opinion publique. Les événements de Cuba passionnent les foules, et les deux compères et concurrents s’y entendent pour maintenir l’attention sur l’île voisine. À coups de bluff et de racontars, entremêlés de reportages où le réel conserve sa place, leurs journaux respectifs se répandent sur les méfaits de ces horribles Espagnols qui n’ont rien à faire si près des côtes américaines. À longueur de colonnes, les « faits » rapportés font leurs plus gros tirages, et leur fortune ! En février 1898, quand le cuirassé américain Maine explose en rade de La Havane, faisant deux cent soixante morts parmi les marines, c’est l’indignation. L’Espagne est forcément coupable. La guerre est votée par le Congrès le 19 avril, et le 3 juillet, l’affaire est réglée. La guerre éclair a eu raison du colonisateur honni qui rentre chez lui la tête basse après quatre siècles de présence à Cuba. Théodore Roosevelt, engagé volontaire, s’illustre à la tête de son régiment de cavalerie, les Rough Riders, avant de devenir le vingt-sixième président des États-Unis (1901-1909). Sous le couvert de coopération mutuelle, la tutelle américaine peut s’installer durablement sur l’île. Ici s’expérimente à moindre frais un impérialisme qui peu à peu va se répandre autour du monde au nom de la liberté. En 1902, la République de Cuba est officiellement créée. En un demi-siècle, l’île se transforme en un gigantesque tripot flottant, aux mains de la mafia. L’argent, l’alcool, la drogue, le sexe et tous les trafics de la pègre fleurissent à ciel ouvert, nourrissant un nouvel avatar de sa mythologie. La révolution de Fidel Castro y mettra fin le 1er janvier 1959, mais ceci est autre histoire.
En 1903, Othon Guerlac débarque à Cuba à un tournant capital de son histoire. Il découvre les bienfaits de cette nouvelle administration qui vient de remplacer celle des Espagnols, et il compare…
Récit publié dans la revue Le Tour du Monde, 1903.
CUBA
Le 20 mai 1902, l’île de Cuba a pris sa place dans ce qu’il est convenu d’appeler le « concert des nations ». Cette entrée dans le monde s’est accomplie avec le cérémonial qu’on pouvait attendre d’un peuple qui, par hérédité, aime les belles manières, et au milieu de manifestations de joie et d’enthousiasme dont la violence ne saurait pas non plus surprendre chez des hommes qui vivent sous le vingtième degré de latitude.
À midi précis, dans le somptueux palais de La Havane qui abrita plusieurs générations de capitaines généraux, et qui vit, il y a quatre ans, le départ du dernier représentant de la couronne d’Espagne, eut lieu la cérémonie de la transmission des pouvoirs. Au milieu d’une salle bondée de monde, le général Wood, représentant du président des États-Unis, remit à M. Estrada Palma, le président de la nouvelle République, les pouvoirs qu’il avait exercés pendant environ trois années.
Le petit discours officiel qu’il lut, la réponse de M. Estrada Palma, furent presque couverts par les voix qui s’élevaient de la rue et qui, déjà, acclamaient Cuba libre. Puis le drapeau américain, qui flottait sur le palais du Gouvernement, fut abaissé en grande pompe par des soldats des États-Unis, et, à sa place, apparut le pavillon de la nouvelle nation. Et pendant que partout, sur les édifices publics de la ville et, là-bas, sur la vieille forteresse du château Morro, s’opérait également cette petite transformation, symbole du changement de souveraineté, les canons du fort de Cabanas lançaient leurs salves, les fanfares éclataient à tous les coins de la ville, les navires du port sifflaient ou mugissaient à tout rompre, et la foule répandue dans les rues, dans les parcs et sur les quais, grisée de soleil, de bruit et de patriotisme, hurlait à tue-tête : Viva Cuba libre, Viva Estrada Palma, Viva los Estados Unido !





























