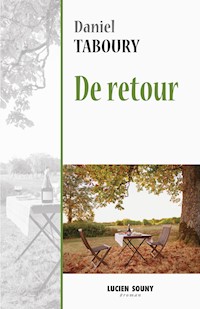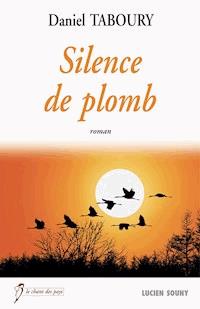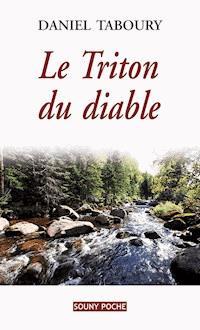« La vue de Jeanne Gontaud sautant et descendant d’un camion, ravi muet, restant sur place à la regarder, incapable d’un mot. Malheureux enfant et si émotif, il se survit en moi toute ma vie. »
Paul Léautaud
Juillet, aéroport international de Carrasco. Déambulation d’un couple anonyme dans la zone commerciale duty free. Cette femme et cet homme n’ont rien à acheter. Sinon du temps, denrée qu’ils épuisent dans des allers-retours comptés. L’avion en direction de Paris-Charles-de-Gaulle ne décollera pas avant quinze heures. La procédure d’embarquement leur laisse environ une heure devant eux. Intervalle impossible à meubler quand il peut s’agir d’une séparation dont le terme est peut-être définitif. Ni l’un ni l’autre ne le sait.
L’explication de leur dernière nuit dans un hôtel de Ciudad de la Costa réside bien dans ce doute qu’ils n’ont pas levé. Pour des raisons différentes, en partie. Lui – Paul – vient d’en terminer avec ses engagements professionnels qui l’auront retenu à l’étranger. Elle – Sepha –, plus jeune, vit et travaille ici, en Uruguay. Leur liaison se compte plutôt en mois qu’en années. Lui est sur le départ et il n’a pas demandé qu’elle le suive. Elle ne l’aurait pas fait, d’ailleurs. Avec sa fin de carrière, il aurait pu rester là. Ils en ont parlé. Très peu. Voilà déjà des semaines en arrière. Un échange condamné à la stérilité puisque envisager d’autres solutions n’était pas d’actualité. Trop tôt. L’un ou l’autre l’a fait remarquer et ils étaient tombés d’accord.
Alors, cette dernière nuit fut souvent silencieuse. Ils s’étaient allongés afin que le contact de leur peau ne s’altère pas. Dans une sorte de frôlement permanent qui avait banni tout corps à corps dont ils redoutaient l’extrême vacuité qui s’ensuivrait. Simplement, plusieurs fois, ils s’étaient pris dans les bras en évitant de trop se serrer. Ils se relâchaient, se reprenaient en un mode de douceur fragile. Et ils ne dormirent pas.
Dans les galeries marchandes, ils se tiennent par la main désormais. Lui s’est senti assez vite mal à l’aise dans cette étreinte juvénile. Il s’en est excusé et la température lui a permis de se justifier sans peine. Elle a pris son bras. Les
horloges les lorgnent partout dans ce lieu où les affichages multiples tiennent sur le qui-vive. Ils vont finir par s’intéresser à ces gens en partance ou à ces autres qui ont atterri, qui s’enlacent encore ou qui portent des enfants au cou. Certains leur arrachent des
sourires spontanés et, ainsi, le temps se trompe. Ils ne devraient plus échanger jusqu’au moment de s’écarter l’un de l’autre. Ils s’en sont fait la promesse en un bref baiser. Elle a obtenu d’un ami l’autorisation d’accéder au tarmac. Ils en approchent maintenant. Le bagage est en soute.
À l’air libre, ils éprouvent une peur étrange, inexorable, et sont incapables de l’expulser. Il leur faut fuir chacun de leur côté, sinon le moment redoutable les ensevelira…
Un point lumineux s’efface dans le ciel. Elle a tourné le dos.
***
En fait, je n’ai plus d’idée précise de l’automne. À bientôt soixante ans, ma mémoire vive avait dû pourtant enregistrer la chute de feuillages rouillés, fripés puis craquants; d’indéracinables brouillards, leur mainmise tenace sur des passants pressés. Un cocktail de clichés. Ne surnagent que de rares images de rentrées scolaires, d’éclairages publics falots… Émergent parfois des traques de gibier en forêt, de brochets dans les grands lacs. Images brouillées: les automnes sont tellement différents sous les très nombreuses latitudes où je me suis retrouvé. Images de bout du monde, images de citadin. Images d’enfance. Je suis passé en aveugle sur cette succession d’automnes. Je n’étais pas un contemplatif; un homme d’affaires pressé, un coureur de sous-bois et de rives, plutôt. Efficacité oblige, au travail comme dans le loisir. Aujourd’hui, je ne suis ni en reconstruction ni en fuite. Je tourne la page. J’entame sur un coup de tête ou par lassitude – la motivation exacte m’échappe – une autre tranche de vie et je sais qu’elle sera la moins longue. C’est la seule évidence que je cerne sans inquiétude. Mon désir devra se limiter à l’instant. J’aurais dû m’interroger sur ma capacité à vivre au jour le jour.
Je roule sur une route inconnue. Je viens d’acheter une petite voiture: une occasion, deux portes et quatre places. Si peu de bagages sur la banquette
arrière. Un fatras dans le coffre. Pêle-mêle: un ordinateur, un fusil dans sa housse, des étuis de cannes à pêche, des bouquins en vrac. Entre autres… Comme si je partais pour un long week-end.
J’ai tout mon temps pour arriver à destination. La hâte n’habite que ceux qui connaissent le terme de leur parcours. Celui qui se sait
attendu accélère; les derniers kilomètres, surtout. À moins qu’il ne flâne volontairement pour jouir par anticipation de retrouvailles. Ni femme ni
enfants ne consultent une montre, n’échangent des regards et ne présument de l’heure de mon arrivée. Je peux m’attarder. Appréhender peut-être cette singularité d’automne que de maigres clichés épars ont nourrie. Le ciel est bleu. Règne une douceur étonnante. Ma vitre est abaissée sur des paysages changeants.
J’ai abandonné sans regret la quatre voies pour traverser le chef-lieu, une ville vite
engloutie en un tournis de ronds-points. La route grimpe ensuite dans une forêt, dessert des villages balisés par des circuits touristiques. Un bocage leur succède. Des troupeaux de bovins le peuplent. L’impression de vie au ralenti me gagne. Il est quinze heures. L’autoradio me parle d’été indien. Il distille en sourdine sur cette départementale où je circule maintenant.
Alternance: pans de résineux, verticalité hérissée des collines; landes et lacs accouplés. Je ne vois qu’un décor que la route impose et je m’en satisfais. La faculté d’étonnement pénalise l’action. Je regarde. Je suis vide de tout commentaire. Je ne suis pas homme à trop bavarder avec lui-même. Du moins, je le crois.
Je constate. L’automne ne rime pas avec tourbillons de feuilles, blizzard et brumes. L’automne se dessine en azur, en vert glacial des sapinières, en incrustations d’or, de cuivre, de grenat. Je ne parviens pas à vaincre les poncifs. L’imagination s’appauvrit-elle avec l’âge? Elle paresse aussi, sans doute… Une sérénité béate, sinon sotte, me guide. Je connais le terme du parcours. Plus exactement, le
nom du village: Arfeuille. Je vais y remettre les pieds après tant d’années d’éloignement. Une histoire assez rocambolesque d’héritage a tout déclenché.
Plus je me rapproche de ma destination, plus j’éprouve le sentiment encore confus du choc prévisible qui m’attend. Je me suis concentré sur les paysages avec une espèce d’indifférence feinte, une carapace plus dérisoire que je l’aurais souhaité. Tout sera difficile. Je me suis menti sans doute. Depuis mon retour en France – je le ressens –, mes incertitudes ont repris le dessus. À l’étranger, dans le feu de l’action, saoulé parfois par le travail, je ne tergiversais pas. Mes fragilités anciennes s’insinuent et je dois réapprendre à les apprivoiser.
L’habitacle est propice à mes questionnements. La voiture, à petite vitesse, ronronne… Que de confusions! Tourner la page, toutes les pages, ne peut s’envisager avec détachement. À moins d’être un imbécile. Je sais bien que le passé proche est accroché à moi-même. J’emporte avec moi tout ce qui a construit comme défait mon existence. Je refoule. Je veux croire possible de biffer un si long
chemin. Vanité encore, illusoire et stupide. On verra à l’usage.
Ma démarche est en elle-même contradictoire. Fait-on table rase sur les lieux mêmes de son enfance? Certes, je ne suis venu ici que gamin, adolescent, et jamais depuis ces séjours de vacances je n’ai eu le désir d’y remettre les pieds. Osé le faire, non plus. Le destin. À défaut d’autres mots. Je finirai par y croire! Le destin sous la forme de la lettre d’un notaire m’avisant que je devenais propriétaire d’une bâtisse du bord de l’eau, du moulin de cet oncle que je n’avais jamais revu depuis la fin de mes étés à la campagne.
Pourquoi moi? N’était-il donc pas parvenu – cet homme dont je me souviens, la quarantaine solide et solitaire – à trouver l’âme sœur, un bâton de vieillesse? Cet oncle dont ma mère ne parlait pas ou plus et que j’avais zappé de ma vie… Cet oncle dont la réalité me rattrape au moment de sa disparition et fait de moi son légataire. Ce tonton – je l’ai appelé ainsi durant tout ce temps – qui, en réalité, m’avait fait héritier sans aucun lien de sang. Je ne l’ai su que bien plus tard.
Sa disparition aura précipité ma décision. Elle m’offrait une porte de sortie inattendue à cet instant où je cherchais une issue possible. J’hésitais à franchir le pas de mon plein gré. Sinon, tôt ou tard, je serai sur la touche, exclu, recraché par un système qui ne supporte pas ses futurs vieux.
J’ai arrêté la voiture un peu avant Arfeuille. J’ai posé mon cul sur le promontoire du fossé et j’ai fumé une cigarette. Si je ne parviens pas à saisir l’intensité de l’instant, je suis bon pour faire demi-tour. Il faut que j’avance pas à pas, que je devienne ce maçon patient de sa propre reconstruction. Au jour le jour. Moi qui n’ai vécu que dans la prospective, les plans, les projets à long terme!
Sur ce dôme miniature entre fougères cramoisies et bruyères, j’aperçois au lointain le village. Je suis installé au sommet d’une bosse franchie naguère combien de fois sur mon vélo! La perspective ne me semble pas considérablement modifiée. Je ne cherche pourtant pas à retrouver des lieux à l’identique. Je ne suis pas naïf au point d’imaginer que je débarquerai à Arfeuille tel que je l’ai laissé voilà un demi-siècle! J’évite un flux d’images; je ne veux pas m’embarquer dans un périple rétro que la nostalgie condescendante jugerait. Pas à pas. Je ne sais rien de ce qui m’attend ici. Je suis au terme d’un parcours où j’arrive sur mes traces anciennes que je ne pensais plus croiser. Le trousseau de
clefs du moulin attend dans la boîte à gants de l’auto.
***
On parvient à la bâtisse sans avoir à traverser le village si on arrive par cette route et j’avais toujours débarqué ici par ce même chemin. J’ai soudain éprouvé le besoin d’arrêter le véhicule sur cet axe principal, d’en descendre et de marcher ensuite sur cette allée conduisant au moulin distant d’une centaine de mètres. D’abord, je n’ai pas pu vraiment avancer. Sur le coup de l’émotion. Elle m’a envahi alors même que je la pensais à l’écart de mon déplacement.
Depuis mon retour en France, j’avais tenté de contrôler toutes les palpitations sensibles qui auraient dû se manifester chez un individu normal. J’avais mis à l’écart de pensées trop invasives ma vie professionnelle achevée, Sepha. Peut-on vraiment revenir blindé dans son pays, là où on est né? Déambuler indifférent dans le quartier d’une ville qui vous a élevé jusqu’à plus de vingt ans? J’y étais parvenu et, en me promenant pas à pas dans les rues, j’avais senti que je cheminais comme l’aurait fait un touriste ordinaire. Ou un curieux qu’un vague intérêt guide dans un lieu où il sait qu’il ne s’attardera pas.
Cette ville avait été biffée de ma mémoire. La disparition de ma maigre famille – déjà disloquée par des affectations extérieures – avait provoqué cet effacement. Pourtant, j’avais fréquenté les parcours qui auraient dû me mettre à vif: le chemin de la communale ou celui, plus long, du lycée. À pied, bien entendu, sinon l’observation est trop fugace, aléatoire. Rien n’avait surgi pourtant. Je m’attendais – sans l’anticiper clairement – à être cueilli par des rafales de souvenirs, à claudiquer sous le télescopage de mes courses anciennes, de mes enjambées joyeuses et de ces retrouvailles. Rien de tout cela. Sans aigreur ni désabusement, je n’identifiais plus la ville de mon enfance, pas plus que celle où j’avais eu vingt ans. Et pourtant, les voies de circulation n’avaient pas réellement changé et je les avais empruntées les yeux un peu fermés. Ces pistes connues m’étaient devenues désormais étrangères. Je l’ai pensé…
Chez le notaire, à aucun moment je n’avais éprouvé une quelconque émotion. La lecture de l’acte de propriété ne procède pas de ce registre sensible, et le jargon, les paraphes, les signatures y
contribuent. Au moment de la remise des clefs, peut-être bien, j’ai ressenti une brève faiblesse. La passation sans doute.
Et me voilà à cent pas de cette transmission, à l’arrêt sur le gravillon du bas-côté, incapable d’avancer tant la vue du moulin m’a assailli. Me serais-je inconsciemment protégé auparavant dans cette pérégrination en apparence désinvolte ou froide? Je comprends assez vite pourquoi ici je ressens ce qui là-bas ne pouvait m’atteindre. Ici, c’est brutal et évident. Rien n’a changé. À cent pas, cela crève les yeux. Je vois la retenue d’eau figée sous un soleil impassible. À cette distance, le barrage alimentant le moulin affirme sa pérennité aveuglante. En aval, les toits gris des bâtiments, les façades sombres; le soleil a franchi le faîte et donne sur l’arrière, s’étale sur des prés où le gros ruisseau serpente, se perd à la limite d’un bosquet au terme de cet horizon.
Rien n’a changé. J’ai tout revu…
Les mots de Verlaine surgissent. De ce poste d’observation où je peux guider mon regard, la permanence du lieu est flagrante, plutôt bouleversante d’autant que mon corps s’est figé à l’entrée du chemin. En réalité – je l’éprouve assez vite –, mon émotion est moins liée à ce paysage semblable à celui de mon souvenir qu’à cet espace sous mes yeux d’où toute vie semble avoir disparu. Pas de canards sur l’étang; pas plus de basse-cour, de volées de moineaux, de jappements d’un chien tirant sur sa chaîne; pas de vaches, pointillés roux disséminés sur l’herbage… Pas d’oncle sur le seuil du moulin, bien calé et droit contre l’arête de l’ouverture et qui, vigie, toujours semblait attendre. « L’avenir est toujours au bout du chemin… » Je n’ai pas oublié ses mots qui n’avaient pourtant aucun sens pour moi et faisaient hausser les épaules de sa mère lorsqu’elle l’entendait les murmurer.
En vrac, tout surgit, se bouscule, s’entrechoque. Je perçois dans mes jambes un tremblement diffus. Un signal. J’ai fait un pas et je m’esquive. Avec lenteur d’abord, un peu comme un blessé retrouvant la coordination du marcheur, hésitant sur les premiers mètres, se rassurant au-delà en comprenant qu’il n’aura pas à fournir un gros effort dans cette première sortie secouant sa torpeur où le temps s’est égaré.
Ainsi, le contact avec le réel se renoue. Le sol à la lisière du goudron de la route est encore craquelé par l’été sec. Solide, l’accotement balise le cheminement. L’éclat lumineux du barrage s’est terni: de longues langues de sable et des vases à fleur d’eau dévorent la retenue. Elle n’est plus qu’une vaste flaque que les atterrissements gangrènent. Une idée d’abandon, d’ensevelissement progressif. Cette impression gagne à mesure que l’on s’approche. Le verger en surplomb aligne des troncs vérolés et, dans l’inextricable des branches que la mousse vert-de-gris parasite, une pauvre
guirlande de quelques maigres pommes. Partout, des herbes folles, des orties géantes, des digitales calcinées par un trop-plein de chaleur. Des volets clos. Du silence et du vide que seul
le chant du ruisseau cherche à évacuer, mais son étiage d’automne l’orchestre en sourdine. Est-ce là que je vais poser mon bagage?
J’ai ouvert la porte. La clef n’a rencontré aucune résistance. Un signe? Volets ouverts sur la clarté du sud-ouest, la lumière afflue au rez-de-chaussée. Une étonnante propreté me frappe. Seul un fin nappage de poussière confirme que les lieux n’ont pas été occupés depuis des mois, plus peut-être. Sinon, tout est en ordre. Dans un ordonnancement qui me redevient familier: la longue table de ferme, les chaises paillées, la cuisinière en fonte, le fauteuil près de la cheminée, l’horloge… Où que mes yeux se portent, ils retrouvent les objets connus il y a un demi-siècle. Troublant musée que le vieux célibataire dont je suis l’unique héritier a préservé. N’a disparu que le portillon en bois servant d’obstacle à l’intrusion de la volaille lorsque la porte restait ouverte.
Le temps est à ce point figé, comme si le rez-de-chaussée du moulin avait été embaumé. Des confusions s’y glissent. Je cherche le gros chat de mon enfance sur la tablette au-dessus de
l’âtre. Le perchoir est vide; le fauteuil aussi. La mère de mon oncle s’y reposait chaque soir et travaillait avec de longues aiguilles à des ouvrages dont je ne voyais jamais la fin.
Aucun vertige ne m’a saisi cependant. Un malaise possible s’est esquivé. La netteté finit par rassurer; les pièces à l’étage sont à l’unisson. On a quitté la place dans un ordre préservé qui contraste avec les abords de la bâtisse à l’abandon. Toute vie s’était-elle repliée dans l’enceinte? Un questionnement sans intérêt, que je chasse. Fenêtres ouvertes, je livre à la lumière d’automne mon possible point d’ancrage.
***
La cheminée alimentée, je me suis assis dans son angle et j’ai pioché dans la pile de bouquins descendus de la chambre de l’oncle. Huit jours que je suis au moulin.
Cet homme dont je ne sais que si peu m’héberge désormais, se dévoile chaque jour. Mon souvenir de lui est trop ancien. La mémoire des personnes côtoyées durant notre enfance, perdues de vue ensuite, est trop perforée. Ne surnagent que des moments idéalisés. Ni recul ni profondeur. Une approche plus minutieuse m’est devenue nécessaire. Il y aurait de l’indécence à prendre possession des lieux sans chercher à mieux connaître cet homme auquel je dois d’être là. Je ne veux rien brusquer. Ni mener une enquête de voisinage. Je découvrirai au hasard. J’ai tout mon temps et je suis convaincu qu’il y a une sorte de devoir moral à réintégrer les lieux sans hâte. Toute frénésie m’a abandonné. Une patience que je dois aux bouquins sans doute.
Les livres de mon oncle sont annotés. Presque tous sont consacrés à l’arboriculture, à l’élevage – poissons, volaille –, et, d’une écriture penchée, appliquée, il a rédigé, en marge ou en bas de page, ses commentaires. Je feuillette; je m’attarde. Religieusement. Je lis et relis. Je l’approche.
À l’extérieur, j’ai entrepris une besogne nécessaire et peu coutumière et je progresse autant que mes reins, mes bras l’autorisent. En faisant le tour des dépendances, remises, atelier, j’ai mis la main sur des outils bien utiles à la tâche à laquelle je m’astreins: défricher, nettoyer d’abord au plus près du moulin. Le manche de la faux suggère l’usage. Certes. Mais la lame couche les herbes molles et elle ne parvient à sectionner que des tiges raides et fortes. Faudrait-il affûter? J’ai revu l’oncle battre le métal sur une sorte d’enclume fichée dans le sol, marteler à coups précis et secs le fil de son dard. Où était logée cette image pour qu’elle ne fût pas oubliée à jamais et qu’elle resurgît à l’instant du besoin? Les ressources insoupçonnables du cerveau ne permettent pas pour autant d’imiter le geste juste. Je m’y suis pourtant employé en cherchant à copier cette partition claire dont renaissait naguère la lame émincée que la pierre avait aiguisée en rasoir. Tant bien que mal, je suis parvenu à éliminer la majeure partie de la végétation encerclant l’aplomb des bâtiments. Une bonne partie est déjà sèche. Je pourrai faire brûler.
Je suis allé au bout du chemin; je voulais embrasser du regard mon ouvrage. Je suis satisfait: cette impression d’abandon qu’inspiraient les lieux s’amenuise. Si je me tiens à ma tâche, je devrais avoir achevé le gros œuvre avant fin octobre. Mains dans le dos, le pas lent, j’aime faire ce tour de propriétaire en mesurant mon avancée, en me projetant sur d’autres labeurs qui, chaque jour, m’éloignent du cœur du moulin. Mon maniement de la faux s’améliore ainsi que mon savoir-faire de cantonnier!
Ainsi, mon repos dans le fauteuil et les livres sont-ils devenus récompense. J’avais commencé surtout par feuilleter; je lis maintenant. Étonné de prendre en considération les différents traitements à appliquer aux fruitiers ou bien à l’élevage de truitelles avant résorption de la vésicule. Le droit juridique dans les échanges économiques et les stratégies commerciales, l’exploitation forestière à grande échelle, bases et références de ma formation et de ma carrière professionnelle, ne pèsent plus lourd. Soigner un arbre, assurer le baby-sitting d’un poisson, voilà des objectifs d’une autre envergure. L’oncle y revit et m’accompagne; ses annotations me parlent: 17 avril, ai lâché des petites truites dans l’Arfeuillette…
Pour l’heure, hormis des images vagues, trop embuées, voilà ce que je connais le mieux de cet homme: ces traces manuscrites. Pas une photo, pas de courrier, de cartes postales
dans cet univers qui se livre peu à peu et que je ne bouscule pas. À croire qu’on aurait fait place nette. Qui? Pourquoi? Ces interrogations ont-elles un sens, d’ailleurs? Avais-je moi-même pris le temps d’adresser un petit mot à mon oncle? Jamais ou si peu. Je cherche à éluder cette part d’indifférence qui me chagrine.
La ligne téléphonique est coupée. J’ai retrouvé le combiné dans un placard, enroulé dans son fil. En revanche, le compteur électrique avait été simplement disjoncté. Il m’a suffi d’appuyer sur le commutateur. Il faudra que j’accomplisse les formalités d’usage d’un nouvel occupant. Mon ordi, mon portable sont fonctionnels dans ce no man’s land que les réseaux desservent…
J’ai tout le temps. Rien ne presse. Je récapitule. Je cherche à établir un tout premier état des lieux. N’ai-je pas toujours été un homme de bilan? Au terme de cette première semaine au moulin, aucune idée de fuite ne m’a effleuré. Je suis ici sans objectif précis, habité peu à peu par le sentiment étrange d’approcher une forme de retraite qui ressemble à une solitude apaisée. Perception encore floue, indistincte.
Sans aucun mal, j’ai repoussé cette curiosité naturelle qui aurait dû m’inciter à parcourir le village sur les pas de l’enfant que j’avais été ici. J’en retarde le moment, et mon relatif éloignement – à peine deux kilomètres – me tient aussi à l’écart. Je cerne là mon appréhension à faire le tour du bourg. Pourtant, j’ai toujours aimé me promener au hasard, considérer d’un regard parfois attendri un coin de province ou du bout du monde. J’ai siroté ces heures contemplatives depuis la terrasse d’un bistro ou dans d’autres lieux improbables d’Afrique, d’Amérique, et je pouvais demeurer de très longs moments à observer le va-et-vient sous mes yeux. Mais ici, je sais qu’en traversant le village, l’émotion va me saisir. Je la redoute. Du moulin, je n’aperçois qu’un lointain clocher, des toits d’ardoise. Une vision partielle et trompeuse… Des fleuves de souvenirs pourraient me submerger. Il me faudra avancer avec la
plus extrême prudence. Je ne suis pas encore capable de me balader les mains dans les
poches, en sifflotant, dans ce bourg que je traverserai un jour prochain…
Le moulin est oasis. Il me protège et m’isole. On y accède et on le quitte incognito. J’ai pu me ravitailler à la ville voisine. Une agglomération à ma convenance – moins de cinq mille habitants, je l’ai lu sur le calendrier de la poste suspendu sur la porte du placard mural de la
cuisine. L’oncle avait choisi des images d’enfants souriants sur une balançoire. Je me rappelle celle qu’il avait conçue pour moi et accrochée à la branche d’un marronnier. L’arbre s’épanouit toujours dans la cour du moulin. Le même. Engoncé dans son embonpoint et sur lequel le temps n’a pas de prise. C’est le seul repère immuable que j’observe ici. Le ruisseau coule moins vivement; le bief se resserre. Les planches de la vanne, noircies, crevassées, se racornissent. Les façades s’effritent; la vigne a disparu, la clématite végète. Des tuiles sur les toits des dépendances ont la gueule de travers. Et pourtant, je me sens à l’abri.
Le temps s’est suspendu cette première semaine. L’Uruguay, Sepha sont-ils encore beaucoup plus loin que la distance qui nous sépare? L’automne se prélasse et se gorge de soleil. J’habite un îlot, un refuge. Momentané peut-être.
***
— Qui es-tu?
J’avais vu l’homme arriver. Il se déplaçait à pas comptés, prudents. Dans cette marche lente, la silhouette, encore lointaine, s’attardait aux détails de son cheminement dans cette allée mal empierrée. L’âge – je le compris assez vite – freinait aussi l’intrusion.
Assis sur le seuil de la porte, je lézardais. Jusque-là, je n’avais aperçu que le déplacement erratique d’un chasseur et de son chien sur le dôme boisé derrière le moulin. Vision fugitive. Le vieil homme, lui, s’approchait. J’ai attendu. Attendu qu’il s’arrête devant moi, me dévisage et m’interpelle:
— Qui es-tu?
Sa question n’était ni agressive ni soupçonneuse. Ce tutoiement en rien brutal. Il m’interrogeait, car ma présence ici devait justifier une explication. Je m’étais étonné que personne ne se soit manifesté depuis mon arrivée. Impossible de passer inaperçu; la cheminée avait fumé et ma voiture stationnait dans la cour, visible aisément de la route. L’homme me parut plus âgé encore que son cheminement l’avait indiqué. Un peu voûté, le visage creusé de rides sous un mauvais rasage. Des yeux bleus, intenses.
Je me suis levé et lui ai tendu la main. Aucune hésitation pour me la serrer. L’immobilité pourtant: il guettait ma réponse. J’ai souri:
— Et vous, qui êtes-vous?
Aucun souvenir d’enfance auquel rattacher ce vieillard n’avait bien sûr surgi. Mon idée du temps qui passe est souvent trop primaire. Près d’un demi-siècle! La permanence d’une physionomie, d’un regard, d’une voix est illusoire. Ce hiatus me trouble plus qu’il m’agace. Si cet homme habite ici, j’ai dû le connaître autrefois. À l’instant, je suis démuni, incapable d’identifier, d’émettre des hypothèses. Qu’il me réponde, donc.
— J’étais cultivateur.
Il allonge le bras. Une colline se dessine dans cette direction. Son fils a
repris la ferme, précise-t-il, et il a fait construire à côté.
Il a répondu à ma question et la sienne demeure en suspens. La manière dont il m’a abordé peut laisser entendre que je ne suis pas pour lui un inconnu. Je me fie à son tutoiement. Hâtive conclusion…
— Vous me connaissez?
— Fichtre non, c’est bien pour cela que je t’ai demandé qui tu es!
Esquisse ironique d’un dialogue. J’ai proposé de poser nos fesses sur le perron. Il se tient les reins; je me ravise et récupère deux chaises dans la cuisine.
— Ah bon, tu ne veux pas que je rentre?
Remarque aigre-douce. Il ajoute:
— Tu as l’air d’avoir peur! D’un ancien comme moi…
— Pas du tout! Je pensais tout bonnement que nous serions mieux dehors, voilà tout.
Aucune tension dans le ton de l’échange. Le vieil homme jauge mes maladresses; du moins, je le pense. Il insiste:
— Alors, tu me réponds. Tu es qui?
J’ai pensé à mentir. Affabuler, non. Travestir simplement. Un refus habituel chez moi de me
livrer illico. J’ai toujours plus ou moins agi ainsi. Une forme de prudence qui ne fournit aux
autres que des fragments d’identité. Un peu comme si je cherchais à me dérober face à un interrogatoire de police. À l’école, je détestais remplir la fiche de renseignements. Cette indiscrétion m’insupportait.
— Le minotier était mon oncle, en quelque sorte, ai-je lâché.
— C’est bien ce que je pensais. Ce pauvre Henri.
Le qualificatif évoque-t-il la récente disparition du meunier ou bien, plus largement, l’existence de mon oncle?
— Ce pauvre Henri, répète le visiteur.
Des hochements de tête prolongent le jugement. J’attends. Je me fais la réflexion que je n’ai rien à offrir à ce voisin, à part de l’eau. On trinquait beaucoup autrefois. Au bistro comme chez les particuliers. L’idée me vient de descendre à la cave. Je ne l’ai pas visitée depuis mon arrivée. L’interdit était clair lorsque j’étais gamin: l’escalier est dangereux, la trappe trop lourde.
Des tubercules de pomme de terre finissent de s’avachir sur la terre battue; des cagettes empilées et vides dans un angle. Des bouteilles, ce que j’espérais, sous la voûte. Je ne vois pas assez clair pour choisir dans un lot de plusieurs dizaines de
ces flacons de vin bouché. Certains sans étiquette; d’autres d’authentification difficile, tant le papier s’est effrité.
Je reviens vers mon visiteur avec deux bouteilles; il me sourit:
— Il en avait une belle réserve, Henri. Il refusait souvent qu’on le dédommage pour un service rendu. Alors, on lui offrait des bons crus. Il avait
toujours aimé la vigne et regrettait de vivre dans une terre où elle ne pousserait pas. Il n’ouvrait pas souvent une bouteille: « faut savoir apprécier », disait-il…
— On va boire en pensant à lui.
J’ai trouvé un tire-bouchon et me suis décidé pour un bourgogne blanc. Année, propriétaire-récoltant inconnus. Ces indications ont disparu ou sont trop fragmentaires. Nous
sommes rentrés pour déguster confortablement. La fraîcheur du vin, ses arômes nous laissent silencieux. La langue du vieil homme apprécie; il consomme par petites gorgées et ses yeux parlent de son plaisir.