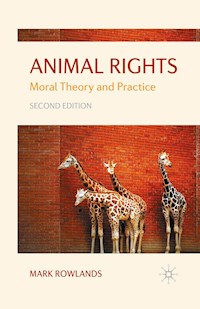Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Decrescenzo
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Ils partagent nos vies, nous aident, nous aiment, pourtant nous ne leur rendons pas toujours : ce sont les animaux. Alors que l’on file sans hésiter chez le vétérinaire pour soigner son meilleur compagnon, d’autres individus finissent chaque année dans nos assiettes, font les frais de l’industrie cosmétique, de l’élevage intensif ou encore de la chasse.
Mark Rowlands démontre dans son livre que les animaux sont bien plus proches de nous que nous le pensons, et invite à repenser notre rapport à l’être-animal. Soutenant l’idée que les animaux ont des droits moraux, l’auteur examine les implications d’une telle reconnaissance à l’aune d’une société où se développe le végétarisme, une société de plus en plus sensible aux questions de l’exploitation animale et de l’atteinte à l’environnement. Avec cet essai, le philosophe signe un véritable plaidoyer pour la cause animale et milite pour un universalisme qui ne se limite pas à l’espèce humaine.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Mark Rowlands est un écrivain et philosophe gallois. Il est né en 1962 à Newport, au Pays de Galles et a commencé son diplôme de premier cycle en ingénierie à l’Université de Manchester avant de passer à la philosophie. Il a obtenu son doctorat en philosophie de l’Université d’Oxford, et a occupé divers postes universitaires en philosophie en Grande-Bretagne, en Irlande et aux États-Unis. Spécialiste reconnu de la question de l’éthique animale, son œuvre la plus célèbre est
Le philosophe et le loup (Belfond puis Pocket), traduite en plus de vingt langues, où l’auteur revient sur les dix années passées avec son loup.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MARK Rowlands
Des animaux comme nous
Essai
Traduit de l’anglais par Sophie Taam
DECRESCENZO
Ouvrage publié sous la direction de
Julien PAOLUCCI
Animal like us by Mark RowlandsCopyright © 2002 by Verso Books
All rights reserved
Original English edition published by Verso Books
French translation rights arranged with Verso Books
© Decrescenzo éditeurs, 2021
pour la traduction française
Tous droits réservés
ISBN : 978-2-36727-111-8
La couverture de
Des animaux comme nous
a été réalisée par Thomas GILLANT
À Emma, un animal comme moi
Préface
Les choses peuvent avoir une valeur de deux manières : intrinsèque ou instrumentale. La vie, la liberté et la quête du bonheur possèdent une valeur intrinsèque : une valeur en soi, pour ce qu’elles sont. Par conséquent, nous encourageons ces valeurs, et nous érigeons des lois, des règles, qui les respectent et les protègent. L’argent, les voitures et le shampoing possèdent une valeur instrumentale : une valeur en tant que moyen d’obtenir d’autres choses, des choses qui, à la fin du processus, possèdent une valeur intrinsèque. Ainsi, l’argent permet d’acheter des biens et des services qui assurent la survie et accroissent le bonheur. Nous divisons généralement le monde entre les choses qui possèdent une valeur intrinsèque et celles qui possèdent une valeur instrumentale, ces dernières étant au service des premières. Il n’y a rien de mal dans cette façon de penser… sauf si l’on confond les détenteurs d’une valeur intrinsèque avec les détenteurs d’une valeur seulement instrumentale. Par conséquent, comme le fait remarquer Kant, il est inacceptable, sur le plan moral, de traiter les êtres humains comme des moyens, et non comme des fins en soi : il est immoral de ne leur accorder qu’une valeur instrumentale.
Pourtant, c’est précisément ce que semble faire l’institution de l’esclavage : la valeur d’un esclave n’est pas mesurée à l’aune de son bonheur, de sa liberté ou de sa vie personnelle, mais de ce qu’il peut faire pour les personnes possédant une valeur intrinsèque. L’esclave est rabaissé au rang de voiture : un simple instrument au service d’autrui. L’esclavage commet l’erreur cruciale de traiter une chose possédant une valeur intrinsèque comme si elle n’avait qu’une valeur instrumentale – d’où le déni des droits humains élémentairesà l’encontre de l’esclave. Une avancée morale consiste à voir la situation telle qu’elle est et à se débarrasser de la perception selon laquelle l’esclave n’est qu’un instrument. Dès lors, une gamme complète de nouvelles attitudes se met en place : le respect, la sollicitude, la protection. Des discours de dignité et de liberté s’appliquent à ce qui était auparavant un simple instrument. La valeur intrinsèque remplace la valeur instrumentale.
La conception instrumentale des animaux est profondément ancrée dans l’esprit humain. Tout au long de l’histoire, il a été accordé une valeur aux animaux uniquement en fonction de leur contribution au bien-être des hommes. La question qui se pose est toujours ce qu’ils peuvent faire pour nous : nous nourrir, nous vêtir, nous distraire, nous protéger, nous réconforter. Et, au même titre que les esclaves, ils sont incontestablement utiles : ils constituent des instruments efficaces à bien des égards. Notre perception de leur nature est profondément imprégnée de cette vision instrumentale ; il nous est difficile de les envisager sous un autre angle. C’est toute la force de la tradition et des habitudes, entretenues par souci de nos propres intérêts. Cette conception se révèle, par exemple, dans l’idée selon laquelle les animaux ont été créés pour être nos instruments : soit par Dieu, soit par une nature serviable. Le but des animaux – ce pour quoi ils ont été conçus – est de servir les désirs de l’homme : ils n’ont nulle autre raison d’être. Par conséquent, leur valeur potentielle dépend entièrement de ce qu’ils peuvent faire pour nous. Même lorsque nous les observons dans leur habitat naturel, hors de la domesticité humaine, nous les considérons comme un spectacle ou, éventuellement, un objet de curiosité scientifique.
Cette vision des animaux en tant qu’instruments au service des humains nécessite une justification morale et philosophique. Dans la mesure où nous les traitons comme des instruments, ils doivent mériter un tel traitement : ils doivent faire partie des choses qui peuvent être traitées de la sorte. Évidemment, nous ne pouvons guère leur accorder de droits, que nous bafouerions nécessairement en utilisant les animaux comme des instruments – de la même façon que nous n’en accordions pas davantage aux esclaves. De plus, ils ne peuvent pas posséder le type de nature excluant de les traiter de manière instrumentale ; en particulier, ils ne peuvent pas posséder de conscience, ou d’âme, ou de personnalité, ou de sentiments. Car si c’était le cas, leur statut de simple moyen serait remis en question. Par conséquent, il est couramment accepté que les animaux ne possèdent ni conscience, ni âme, ni sentiments – soit pas du tout, soit pas « comme les hommes ». Ainsi, même la mort d’un animal ne marque pas la fin d’une chose possédant une valeur intrinsèque – bien que cela puisse représenter un préjudice instrumental pour le « propriétaire » de l’animal (ou un profit si le fait de tuer l’animal produit une valeur instrumentale). Il y a là-dedans une combinaison d’idées étroitement liées : l’animal comme instrument ; l’animal effacé de la cartographie morale ; l’animal comme machine dépourvue d’esprit.
Certes, cette conception, dans sa globalité, n’a pas manqué d’être critiquée, depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, mais il a fallu attendre ces trente dernières années pour qu’elle subisse des attaques nourries et virulentes, l’argument principal étant que les animaux ne possèdent pas uniquement une valeur instrumentale pour les hommes, mais importent plutôt comme une fin en soi : leurvie, leur liberté et leur bonheur possèdent une valeur intrinsèque. Ce changement de perspective nous oblige à repenser notre conception habituelle de l’animal : non pas comme un instrument, mais comme une chose ayant une valeur en soi. Il en découle que peu à peu nous ne percevons plus les animaux comme des machines sans esprit, mais comme des êtres dotés de sensibilité. Nous apprivoisons l’idée que cela leur confère certains droits et certaines protections, et qu’ils importent moralement. Nous nous débarrassons de l’idée – du préjugé – qu’un animal n’est qu’un instrument susceptible d’être utilisé ou écarté à volonté, sans égard pour ses propres intérêts. On devrait pourtant accorder à ses intérêts la même considération qu’à ceux d’autrui :à niveau égal, la souffrance d’un animal n’est absolument pas moins grave que celle d’un homme. Les différences anatomiques ne rendent pas la douleur moralement moins dommageable ou plus négligeable.
Imaginez que vous soyez dans la situation singulière d’ignorer à quelle espèce vous appartenez : vous êtes en quelque sorte atteint d’une étrange amnésie liée à l’espèce. Par ailleurs, votre pied vous fait atrocement mal. Vous diriez-vous : « Eh bien ! Si je suis un homme, c’est une affaire très sérieuse, et quelqu’un a le devoir de m’aider ; mais si je suis un gorille, ce n’est rien de méchant, et personne n’a la moindre responsabilité à mon égard » ? Ce serait absurde, et la même absurdité s’applique à des réflexions similaires quant au fait d’être mangé, chassé ou disséqué. L’espèce à laquelle vous appartenez ne peut pas justifier une telle différence. Maintenant, comparez cela au fait d’ignorer votre couleur de peau et de réfléchir à l’éthique de l’esclavage. Vous diriez-vous : « Eh bien ! Si je suis blanc, l’esclavage est un mal terrible ; mais si je suis noir, il n’y a rien à y redire » ? Bien sûr que non : les maux inhérents à l’esclavage seraient tout aussi réels, indépendamment de votre couleur de peau.
Cela est simplement un moyen d’introduire une règle de morale bien connue :demandez-vous ce que vous ressentiriez si vous étiez à la place de la personne en face de vous. Si vous n’avez pas envie que l’on vous fasse quelque chose, comment pouvez-vous justifier de le faire à autrui ? C’est une maxime qui prône la reconnaissance de l’égalité : ne pas appliquer de discrimination en fonction de caractéristiques moralement non pertinentes. La seule façon équitable ou juste de traiter des êtres dotés d’une valeur intrinsèque est l’égalité : c’est-à-dire en fonction de caractéristiques moralement pertinentes,et non en fonction de caractéristiquesnon pertinentes telles que la couleur de peau, le sexe ou l’espèce. Cela ne signifie évidemment pas que ces caractéristiques ne peuvent jamais être utilisées pour procéder à une sélection : si j’organise une audition pour le rôle d’un homme noir d’âge moyen, il n’existe aucune objection morale m’empêchant de choisir uniquement des individus masculins et noirs. Mais lorsqu’il est question de retenir une candidature pour un poste d’avocat ou d’enseignant, ou de sélectionner un joueur de foot, une telle discrimination n’est pas pertinente. Dans le cas des animaux, la question sous-jacente est de savoir si l’espèce peut être invoquée pour justifier le traitement radicalement différent que nous leur réservons. Par exemple, peut-on y faire appel pour défendre l’élevage industriel des animaux tout en reconnaissant que ce serait un traitement absolument immoral dans le cas des humains ?
Ce genre de questions a été largement débattu ces dernières années. Certains philosophes ont avancé que les causes instrumentales ne suffisent pas à justifier notre façon de traiter les animaux : le plaisir que nous obtenons en les utilisant comme des instruments ne l’emporte pas sur la souffrance que nous leur infligeons ce faisant. D’autres ont présenté l’argument selon lequel les animaux ont des droits par nature, que nous violons systématiquement, tels que le droit de ne pas être enfermé sans motif valable. Dans ce livre, Mark Rowlands enrichit ces arguments en approchant la question sous l’angle de la justice sociale. En se basant sur l’œuvre incontournable de John Rawls, il nous interroge sur l’ordre du monde tel que nous souhaiterions le voir si nous nous trouvions derrière le « voile de l’ignorance », c’est-à-dire sans savoir à quelle espèce nous sommes censés appartenir (globalement la même idée que j’ai utilisée précédemment). Rawls se penchait sur la question de cette ignorance en rapport avec la répartition des biens et des opportunités dans la société humaine ; Rowlands pose la question de notre choix d’une manière encore plus radicale, en supposant que nous ne sachions pas à quelle espèce nous sommes destinés. Et il adopte l’idée selon laquelle il serait irrationnel de plébisciter l’organisation actuelle, puisque cela pourrait bien faire de nous des animaux exploités parmi d’autres – et par conséquent, de simples instruments aux mains de l’homme. Cela peut sembler une façon extravagante de défendre sa position, mais c’est en fait une manière très imagée d’introduire la sagesse populaire consistant à se demander systématiquement ce que l’on ressentirait à la place d’une créature moins privilégiée ou plus malchanceuse que soi. La justice exige que nous ne privilégiions pas le groupe auquel il se trouve que nous appartenons.
Rowlands déroule son argumentation avec beaucoup de patience et d’habileté, n’esquivant aucune des objections potentielles et guidant systématiquement le lecteur à travers les problématiques morales. Tout d’abord, il clarifie les considérations générales en philosophie morale liées à la question des droits des animaux, puis il les applique aux différentes utilisations (ou exploitations) des animaux. Les deux phases de l’argumentation sont essentielles, et il leur confère le même poids : nous devons clarifier nos principes et nous devons également examiner comment ils fonctionnent dans le monde actuel. Il en résulte une présentation extraordinairement lucide de la problématique, au long de laquelle Rowlands ne nous demande jamais de le croire sur parole ; à chaque étape, il s’efforce de développer son raisonnement avec rigueur pour emporter notre adhésion. Ce qui désavantage sans doute le plus sérieusement les animaux, c’est leur incapacité à se défendre eux-mêmes par la parole : ils ne peuvent pas protester contre les traitements qu’ils subissent… en tout cas, pas de manière articulée. Dans cet ouvrage, leur cause est plaidée par Mark Rowlands, l’avocat le plus éloquent qu’ils puissent appeler de leurs vœux.
Colin McGinn
INTRODUCTION
Nous ne traitons pas bien les animaux. Dans le monde entier. Mais dans certains endroits, c’est pire que dans d’autres. Au fil des pages qui suivent, je décris ce que nous faisons aux animaux, de manière parfois très crue. Afin de ne pas m’embourber dans lesproblématiques de qui fait quoi, et où, aux animaux, j’ai écarté la question des décalages entre les lois de protection et, par conséquent, celle des différences de traitement entre pays. Le fait que les élevages de poules pondeuses en batterie soient interdits en Union européenne, par exemple, ne change rien au fait qu’ils ne sont pas abolis ailleurs. Le fait qu’une série d’expérimentations psychologiques violentes ait été menée sur des chiens aux États-Unis n’est absolument pas compensé par le fait qu’une autre n’ait pas été conduite en Grande-Bretagne. Cet ouvrage parle du traitement des animaux par les humains et de l’immense décalage qui existe entre ce qui est et ce qui devrait être. Cet ouvrage parle du traitement des animaux par les humains en général, et pas dans une zone du monde en particulier. Si cela nous fait quelque peu perdre en précision, c’est dommage, mais nécessaire pour notre sujet.
Mon intérêt pour les droits des animaux est né lors d’un voyage plutôt mouvementé que j’ai effectué il y a environ sept ans. J’avais pris le ferry pour la traversée entre Rosslare et Pembroke afin de rendre visite à mes parents pour Noël. Dix minutes avant de débarquer à Pembroke, j’ai levé les yeux de mon livre et j’ai aperçu mon chien-loup Brenin en train de trottiner, tout guilleret, dans la salle des passagers du pont supérieur, en direction du restaurant… avec quelques employés des ferrys irlandais dans son sillage. Il avait forcé la vitre de la voiture, par laquelle il avait bondi, puis était sorti de la cale des véhicules (censée être verrouillée) et s’était faufilé à travers cinq étages jusqu’au pont supérieur réservé aux passagers. Au retour, pour tenter d’éviter le même scénario, j’avais donc remonté la vitre un peu plus haut que d’ordinaire. Brenin a saccagé la voiture. Littéralement. Apparemment, en vieillissant, ses problèmes liés à la séparation devenaient plus aigus. Lorsque l’on a fini par me demander de descendre dans la cale des véhicules pour gérer la situation, l’habitacle de la voiture s’était volatilisé. Les sièges avaient disparu, ainsi que les ceintures de sécurité et tout le reste. Le plafond était en lambeaux. Pour y voir quelque chose et pouvoir sortir la voiture du ferry, puis la conduire jusqu’à chez moi, je devais couper les lambeaux de plafond qui pendouillaient. Ayant remarqué que l’employé de la cale des véhicules avait un couteau, je lui ai demandé de me le prêter. Bizarrement, il a semblé quelque peu réticent à s’en séparer, et j’ai compris qu’il croyait que j’allais m’en servir pour tuer Brenin. Je lui ai expliqué que même si j’étais assez contrarié par la situation, je ne pouvais pas tenir Brenin pour responsable de ce qu’il avait fait. Et au cours du très inconfortable trajet de retour, assis sur les vestiges du siège conducteur, m’efforçant d’apercevoir la route, j’ai eu amplement le temps de réfléchir à l’idée de responsabilité et à sa place dans la conception morale. Il en a d’abord résulté un ouvrage sur le droit des animaux, intitulé (ingénument) Les Droits des animaux, publié quelques années plus tard. Néanmoins, le rôle joué plus généralement par l’idée que nous ne pouvons pas être tenus pour responsables de ce qui se situe en dehors de notre contrôle – ce que j’ai appelé ici le « principe du mérite » – puise sa source dans cette fameuse après-midi. Aujourd’hui, Brenin n’est plus là, mais il perdure à travers ce principe. Je lui en sais gré.
1. LES ANIMAUX ONT-ILS UN ESPRIT ?
Si vous étiez un animal au xviie ou au xviiie siècle, il valait mieux pour vous ne pas croiser le chemin de scientifiques cartésitens. Sinon, il fallait vous attendre à finir cloué sur une table de vivisection et découpé à petit feu. Vous auriez été conscient pendant toute l’opération. En effet, les scientifiques cartésiens ne jugeaient pas nécessaire d’empêcher votre souffrance, pour la bonne et simple raison qu’ils ne croyaient pas que vous étiez capable de ressentir de la souffrance. Pour être exact, ils se moquaient de ceux qui pensaient le contraire. La philosophie n’est pas sans danger : elle peut vous conduire à croire tout un tas de trucs ridicules. Et le scientifique cartésien ordinaire fournit un exemple typique de quelqu’un sous l’emprise, si je puis dire, d’une théorie philosophique.
Cette théorie – c’est pour cela que l’on nomme ces scientifiques des « cartésiens » – vient du philosophe du xviie siècle René Descartes1. Selon lui, les êtres humains représentent quelque chose de très spécial, puisque ce sont les seuls, dans tout l’univers, à posséder un esprit. Or, pour Descartes, l’esprit est la partie en nous qui pense. Aussi, quelque chose qui ne possède pas d’esprit ne peut pas penser. Ni, affirment les disciples de Descartes (mais peut-être pas Descartes lui-même, la preuve dans le texte étant controversée), ressentir quoi que ce soit. Dès lors, il n’y a qu’un minuscule pas à franchir pour arriver jusqu’à nos scientifiques cartésiens clouant des animaux sur une table.
Cette idée que les animaux sont incapables de penser ou de ressentir quoi que ce soit ne tient pas, confrontée au bon sens. Tout d’abord, lorsque vous clouez des animaux sur une table, ils se plaignent et arrivent à imiter ou à simuler brillamment l’action de souffrir. Pourquoi couineraient-ils, pourquoi se débattraient-ils s’ils n’avaient pas mal ? Voici la réponse que donnent Descartes et ses disciples : c’est purement mécanique ! Imaginez : vous êtes un fabricant de jouets de l’époque de Descartes. Vous êtes spécialisé en jouets représentant des animaux. À l’intérieur, chacun de vos animaux est conçu avec minutie et subtilité, dans une organisation complexe de rouages, leviers, circuits, roues, écrous, manivelles, etc. En particulier, si les animaux de votre fabrication reçoivent un coup ou tout autre dommage externe, cela actionne à l’intérieur divers éléments qui enclenchent divers rouages, et ainsi de suite ; en bout de chaîne, deux écrous sont frottés l’un contre l’autre, provoquant un son strident ressemblant en tous points à un cri de douleur. Bien entendu, le jouet n’a pas vraiment mal : ce n’est qu’un jouet. Mais comme les écrous sont frottés l’un contre l’autre uniquement lorsque le jouet est frappé, et comme le son strident qui en sort ressemble à s’y méprendre à un cri de douleur, on a l’impression que le jouet a mal.
Si vous arrivez à imaginer cela, vous vous rapprochez de la vision que nourrit Descartes des animaux. En fait, Descartes lui-même a décrit une analogie similaire. Les jardins du château de Versailles étaient un genre de Disneyland du xviie siècle. Entre autres, ils contenaient un petit groupe d’automates conçus de telle sorte que lorsqu’ils étaient activés par un circuit hydraulique invisible (déclenché par le pas des visiteurs sur les pavés), ils se mouvaient, émettaient des sons et pouvaient même jouer d’un instrument de musique. De plus, leurs mouvements étaient censés exprimer des états d’âme. À l’arrivée de visiteurs inconnus, une Diane en train de se baigner allait se cacher dans des rosiers (simulant ainsi la pudeur) tandis qu’un Neptune s’approchait d’eux en brandissant un trident (simulant ainsi la colère). Ainsi, les automates semblaient avoir des émotions, sans en avoir réellement.
Les animaux, selon Descartes, sont comparables aux automates des jardins du château de Versailles. Le circuit hydraulique qui actionne ces derniers est remplacé par ce qu’il nomme « les esprits animaux », et les tubes dans lesquels circule l’eau sont remplacés par des fibres nerveuses. Mais l’idée est la même. Lorsque vous donnez un coup de pied à un chien, ce stimulus externe provoque la stimulation des fibres nerveuses, ce qui entraîne à son tour la rétraction de tissus dans la moelle nerveuse. Cela déclenche l’ouverture d’un orifice au niveau du cerveau, puis l’émission d’esprits animaux gazeux qui circulent dans les nerfs, les muscles et les tendons. La gueule du chien s’ouvre, et il aboie. Mais il n’y a aucune activité mentale. Le chien ne ressent pas davantage la douleur que l’automate à l’effigie de Diane ne ressent la gêne. Dans le cas des animaux comme dans celui des automates, il y a de la lumière, mais personne dans la maison.
Les activités des scientifiques cartésiens sont un exemple typique des dégâts susceptibles d’être provoqués par la philosophie. Le problème, c’est que nous sommes tous des philosophes. Vous êtes un philosophe, que vous le sachiez ou non, même si vous n’avez jamais ouvert un livre de philosophie de votre vie. Nous, tous autant que nous sommes, évoluons sous l’emprise de diverses suppositions, hypothèses, présomptions, voire théories sur la façon dont le monde fonctionne et sur ce qui est important dans la vie. Chacun d’entre nous, sans exception.
Aussi, avant de prendre nos prédécesseurs de haut, nous devrions sans doute nous rappeler que le traitement actuel que nous infligeons à la plupart des animaux n’est pas meilleur que celui des scientifiques cartésiens (si vous en doutez, poursuivez votre lecture). Nous sommes même, à certains égards, pires qu’eux. Eux pensaient que les animaux étaient incapables de souffrir. Nous, en général, nous ne doutons pas de la capacité des animaux à souffrir. C’est simplement que la plupart d’entre nous pensent que cela n’a aucune importance.
1. Les animaux sont-ils capables d’avoir mal ?
Mais comment savoir si Descartes n’avait pas raison ? Quels motifs nous incitent à penser que les animaux peuvent avoir mal ? Après tout, nous ne pouvons pas être dans la tête d’un animal ; par conséquent, comment savoir ce qui s’y passe ? La réponse est la suivante : de la même façon que nous savons qu’un être humain a mal. Comment savez-vous que j’ai mal ? Il existe des êtres humains qui, à cause d’une anomalie du système nerveux, ne ressentent pas la douleur. Pour eux, la vie est extrêmement dangereuse, puisqu’ils peuvent se blesser, parfois gravement, sans s’en rendre compte. Comment savez-vous que je ne fais pas partie de ce genre d’individus ? Car évidemment, je pourrais vous affirmer que j’ai mal. Mais cela, en soi, ne constitue pas une preuve : je pourrais mentir. À vrai dire, il n’existe aucun test vraiment concluant susceptible d’établir que je ressens de la douleur. Toutefois, il existe une série de considérations qui, cumulées, suggèrent vivement que c’est le cas. Ce sont ces mêmes considérations qui suggèrent vivement que les animaux, eux aussi, ressentent de la douleur.
Tout d’abord, qu’est-ce que la douleur ? Globalement, la douleur est une expérience sensorielle désagréable, typiquement (mais pas systématiquement) associée à des dommages physiques et qui pousse typiquement (mais pas systématiquement) l’individu qui la ressent à l’éviter – cette définition n’est sans doute pas excellente, mais elle suffira à nos besoins actuels. Or, quelles raisons existe-t-il de penser que les animaux (et les êtres humains) sont capables de ressentir la douleur en ces termes ? Elles sont principalement de trois sortes : comportementales, physiologiques et évolutionnistes.
On peut déceler que j’ai mal notamment en observant mon comportement. Premièrement,je vais systématiquement éviter – ou tenter de fuir – les choses qui provoquent habituellement de la douleur. Vous n’avez aucune chance de me surprendre la main dans le feu, ou bien en train de m’appuyer nonchalamment sur l’anneau rouge brûlant de ma cuisinière, ou encore en train de changer le pneu d’une voiture surélevée par un cric branlant. Deuxièmement,si je ne parviens pas à échapper aux choses qui provoquent habituellement de la douleur, je vais sans doute appeler à l’aide et, d’une manière générale, adopter un comportement que nous considérons d’ordinaire comme l’expression d’un inconfort intense. Je vais probablement pleurer, hurler, et sans doute lâcher une bordée d’injures. Troisièmement,à la suite de ma rencontre fortuite avec une chose qui provoque habituellement de la douleur, je m’efforcerai sans doute d’éviter d’utiliser la partie meurtrie de mon corps afin de favoriser sa guérison et je vais éventuellement réitérer le comportement du point numéro deux (à savoir, clopiner chez moi pendant des semaines et marmonner des gros mots à intervalles réguliers).
Il est évident que les animaux adoptent grosso modo le même type de comportement. Premièrement,ils vont éviter, autant que possible, les choses susceptibles de leur infliger de la douleur (le terme technique pour ces choses est « stimuli nuisibles »). Deuxièmement,si leur comportement d’évitement ou de fuite se révèle infructueux, ils vont crier ou adopter une attitude que nous considérons d’ordinaire comme l’expression d’un inconfort intense. Troisièmement,suite à une exposition à des stimuli nuisibles, ils limiteront l’usage de la partie physique meurtrie – ils immobiliseront, par exemple, un muscle abîmé en privilégiant un autre membre – afin qu’elle puisse se reposer ou guérir.
Il existe donc énormément de preuves témoignant que l’idée de Descartes était erronée et que les animaux sont bien capables de ressentir la douleur. Bien entendu, ces preuves ne sont pas absolument infaillibles, pas plus qu’elles ne le sont dans le cas des êtres humains. Je pourrais être, par exemple, un excellent simulateur, très doué pour esquiver les stimuli nuisibles et faire semblant de ressentir la douleur alors qu’il n’en est rien. Cependant, si la preuve comportementale n’est pas infaillible, elle nous fournit autant de raisons de penser que les animaux autres qu’humains sont capables de souffrir qu’elle nous en fournit pour les êtres humains. Et cela constitue un motif tout à fait valable.
Mais il y a bien plus que la preuve comportementale. Les preuves anatomiques et physiologiques représentent un autre faisceau de raisons importantes nous permettant de penser que les animaux peuvent ressentir la douleur. Les mécanismes neuraux responsables de mon comportement après que j’ai fait tomber un objet sur mon pied ressemblent énormément aux mécanismes responsables du comportement du chat après que je lui ai marché sur la patte. En effet, chez les humains, nous savons que le comportement de douleur suite à l’exposition à un stimulus nuisible est régulé, ou amené, par certains types de mécanismes neuraux. Nous savons également qu’il existe des mécanismes neuraux similaires chez tous les mammifères et les oiseaux, et probablement chez tous les vertébrés. Nous savons que le déclenchement de ces mécanismes neuraux chez les humains est conjoint à la douleur. Et cela nous procure une bonne raison de supposer que leur déclenchement est également conjoint à la douleur chez d’autres créatures.
Et, point potentiellement plus significatif encore, on a découvert l’existence d’opioïdes endogènes (ou opiacés) chez les mammifères, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, les poissons et chez certains invertébrés tels que les vers de terre et les insectes. Les opioïdes endogènes – les plus connus du grand public étant les endorphines – sont les opiacés naturels du corps, et leur fonction consiste à soulager la douleur résultant de blessures sérieuses. On pense que ces opiacés font partie d’un processus de survie qui permet à l’animal blessé – humain ou autre – de continuer à fonctionner normalement jusqu’à ce qu’il ait fui un danger immédiat. Par conséquent, la question est la suivante : pourquoi un animal sécréterait-il une substance dont la fonction est de soulager la douleur s’il était incapable de la ressentir ? Certes, on pourrait toujours avancer que ces opioïdes endogènes ont une fonction différente chez les autres animaux. Peut-être, en effet. Mais c’est un peu tiré par les cheveux. L’explication la plus plausible à la présence d’endorphines et autres opiacés chez les animaux autres que les humains demeure qu’ils sont capables d’avoir mal et que les endorphines sont là pour les aider à contrôler la douleur le cas échéant.
De plus, tous les vertébrés, et certains invertébrés, répondent de manière similaire à d’autres substances antidouleur non naturelles telles que les anesthésiants ou les analgésiques. Comment des substances dont la fonction consiste à réduire ou à contrôler la douleur auraient-elles un effet sur les animaux si ces derniers étaient incapables de ressentir la douleur ? Là encore, l’explication la plus plausible à la modification comportementale des animaux autres qu’humains par les analgésiques et les anesthésiants reste qu’ils sont capables de ressentir la douleur.
Enfin, la dernière raison de penser que les animaux sont capables de ressentir la douleur s’appuie sur des considérations évolutionnistes. À l’époque de Descartes, on croyait que les êtres humains étaient très différents des animaux. Pour être exact, les humains n’étaient pas du tout considérés comme des animaux. Selon Descartes, l’esprit, la partie qui réfléchit en nous, était une chose non physique, qui n’appartenait pas vraiment au monde physique. C’était une âme ou une entité spirituelle qui survivait à la mort du corps. Seuls les humains en étaient pourvus, les animaux n’étant que des machines physiques. Aujourd’hui, nous possédons énormément de preuves démontrant à quel point nous sommes semblables aux autres animaux. En particulier, nous savons que notre évolution a une très longue histoire commune avec les animaux, qui a commencé par les chaînes de molécules flottant dans la « soupe primitive ». En effet, plus de 98 % de notre ADN est semblable à celui des chimpanzés : du point de vue génétique, il existe donc une plus grande différence entre les chimpanzés et les autres singes qu’entre les chimpanzés et nous. Nous et les autres grands singes possédons un ancêtre commun, et nous nous sommes scindés en espèces différentes seulement – sur l’échelle du temps de l’évolution – très récemment. Imaginez que vous vous trouviez sur la côte est de l’Afrique. Vous donnez la main à quelqu’un d’autre, qui la donne à quelqu’un d’autre, etc. Vous formez ainsi une chaîne à travers le continent africain, jusqu’à la côte ouest. La personne se trouvant au bord de l’eau sur la côte ouest représente une chaîne peptidique moléculaire, le premier proto-organisme primitif. Vous, qui vous trouvez au bord de l’eau sur la côte est, représentez l’espèce Homo sapiens.Eh bien, nous et les grands singes, nous nous départageons de notre ancêtre commun à environ trente mètres de là où vous vous situez. Voilà notre degré de proximité sur l’échelle du temps de l’évolution.
Cela étant désormais connu de tous, n’est-il pas quelque peu invraisemblable de supposer que la douleur est une caractéristique ressentie par l’humain, et uniquement par l’humain, à l’exclusion des autres espèces ? La douleur, semble-t-il, puise son explication dans l’évolution. Les animaux la ressentent afin d’esquiver les stimuli nuisibles et tentent de leur échapper s’ils recroisent leur route ultérieurement. Et il est évident que tout animal qui ne fuit pas ou qui n’esquive pas les stimuli nuisibles ne va pas survivre bien longtemps. Pourrait-il en être autrement ? Peut-être avons-nous été conçus à l’origine pour éviter ce genre de stimuli, si bien que nous les esquivons automatiquement, dans une sorte de réflexe inconscient. Mais la méthode que l’évolution semble avoir adoptée, dans le cas des êtres humains, est de nous pousser à éviter les stimuli nuisibles en nous dotant de la capacité à ressentir la douleur. Et étant donné la longue continuité évolutionniste entre nous et les autres animaux, il serait très surprenant que l’évolution ait utilisé une méthode radicalement différente chez ces derniers.
Lorsque nous mettons bout à bout ces trois types de preuves, lorsque nous ajoutons les arguments comportementaux, physiologiques et évolutionnistes, nous aboutissons à une démonstration très convaincante de l’hypothèse selon laquelle beaucoup d’animaux autres qu’humains peuvent ressentir la douleur. Nous avons autant de raisons de penser qu’un chien, par exemple, ressent de la douleur lorsqu’on lui donne un coup de pied que de penser qu’un homme ou une femme ressent de la douleur lorsqu’on lui donne un coup de pied. La seule différence, évidemment, réside dans le fait qu’un chien ne peut pas nous dire qu’il ressent de la douleur – du moins pas dans des termes considérés par les humains comme conventionnels. C’est le cas de tous les animaux autres que les humains, à l’exception de quelques primates supérieurs soumis à un entraînement intensif. Mais cela s’applique également aux bébés humains et aux enfants au stade prélinguistique. Pourtant, nous ne doutons nullement qu’ils ressentent de la douleur. Par conséquent, mon argument est que, en nous basant sur les trois types de preuves décrits ci-dessus, nous avons autant de motifs de penser que les animaux autres qu’humains ressentent de la douleur que de penser que les êtres humains qui ne sont pas en mesure de verbaliser leurs sensations ressentent de la douleur. Et cela, à mes yeux, suffit.
2. Autres états psychologiques désagréables
La douleur est l’exemple typique d’un état psychologique désagréable, c’est-à-dire que la douleur est un état tel que quiconque l’éprouve préférerait, normalement, en être soulagé. Normalement, mais pas systématiquement. Une légère douleur peut en effet être assez agréable si vous l’associez (dans votre perception) à une attitude noble ou à un accomplissement : pensez à la légère douleur éprouvée après avoir terminé votre premier marathon, par exemple. Mais, d’une manière générale, ceux qui ressentent une douleur préféreraient en être libérés. Il en est de même pour toute une catégorie d’autres états psychologiques, les exemples les plus flagrants étant la peur et l’anxiété.
La peur est une réaction émotionnelle face à une situation considérée comme dangereuse. Cette réaction implique un degré de conscience et d’attention accru à l’environnement, et elle est habituellement désagréable. Elle est généralement suscitée par un objet connu dans l’environnement immédiat de l’individu et a pour fonction de faciliter la fuite ou toute autre action de protection. L’anxiété, en revanche, est un peu plus vague. Comme la peur, l’anxiété est une réaction émotionnelle désagréable, qui implique, elle aussi, un degré de conscience et d’attention accru à l’environnement. Néanmoins, tandis que la peur est généralement suscitée par un objet ou une situation connus ou reconnus, l’anxiété est suscitée par une situation inédite, inhabituelle. Cette différence que j’établis entre peur et anxiété peut sembler quelque peu artificielle, mais elle est néanmoins utile. Lors de sa première visite dans le cabinet d’un vétérinaire, un chien peut trembler, et cela sera motivé par l’anxiété face à un contexte inhabituel et, par conséquent, potentiellement dangereux. Lors de sa deuxième visite (se souvenant, peut-être, d’un incident ignoble impliquant un thermomètre), le chien gémira ou tentera de fuir par peur d’un événement dont il se souvient (je vous assure que je serais également terrorisé).
De même que pour la douleur, il existe un vaste panel de données comportementales, physiologiques et évolutionnistes prouvant que beaucoup d’animaux sont sujets à la peur et à l’anxiété. Les preuves comportementales incluent : la tension de l’organisme, exprimée par des tremblements et des palpitations ; l’hyperattention, exprimée par la vigilance et le fait de parcourir du regard son environnement ; l’inhibition du répertoire comportemental (l’un des symptômes classiques de l’anxiété). S’y ajoutent des altérations évidentes dans l’activité autonome, qui sont considérées, elles aussi, comme des symptômes classiques de la peur et de l’anxiété : transpiration, cœur qui bat vite, pouls et respiration accélérés, urination fréquente, diarrhée.
Beaucoup d’études neurophysiologiques se concentrent sur la présence de récepteurs des benzodiazépinesdans le système nerveux central des mammifères. Toutes les substances ayant pour objectif de réduire l’anxiété chez les êtres humains – alcool, barbituriques, etc. – fonctionnent en agissant sur ces récepteurs. Les recherches effectuées sur les animaux ont confirmé que ces substances agissent sur leurs récepteurs des benzodiazépines exactement de la même façon que chez les humains, c’est-à-dire par les liaisons chimiques éthanol, les canaux ioniques de chlorure et la liaison chimique des neurotransmetteurs. Pour résumer, les drogues et les médicaments contre l’anxiété ont des effets presque identiques sur les êtres humains et sur les animaux, et, point crucial, doivent leur efficacité à des altérations neurophysiologiques et neurochimiques très similaires. L’explication la plus plausible à ces découvertes est que beaucoup d’autres animaux sont capables de ressentir la peur et l’anxiété.
Enfin, comme pour la douleur, il existe une justification évolutionniste simple à cela. L’anxiété et la peur présentent les mêmes avantages évolutionnistes que la douleur : elles servent toutes deux à accroître la vigilance et l’attention de l’animal dans son environnement, le préparant ainsi physiologiquement à une fuite (ou à une défense) rapide, ce qui, en fin de compte, facilite sa capacité à éviter ou à surmonter le danger.
Aussi, je ne pense pas me tromper en concluant que, en sus de la douleur, beaucoup d’animaux sont capables de ressentir la peur et l’anxiété. En tout cas, nous détenons autant de preuves nous permettant de le penser que nous en avons de supputer que les êtres humains au stade prélinguistique en sont capables.
Cela signifie donc que beaucoup d’animaux autres qu’humains sont capables de souffrir – « souffrir »étant le terme général englobant le fait de ressentir la douleur, la peur ou l’anxiété. On dit que l’on souffre de douleur, de peur et d’anxiété. Être dans de tels états équivaut, généralement, à en souffrir. Cela n’est toutefois pas toujours vrai : comme nous l’avons vu précédemment, une douleur relativement légère peut même être agréable pour des êtres affectés de certaines tendances (les sadomasochistes ou les coureurs de marathon, en supposant qu’il existe une différence entre les deux). On peut dire la même chose au sujet d’un degré relativement léger de peur ou d’anxiété. La montée de peur que je ressens avant de me lancer avec ma planche de surf sur une énorme vague de l’océan déchaîné par une tempête peut être agréable et exutoire.
Par ailleurs, la durée de la douleur, de la peur ou de l’anxiété doit également être prise en compte. Il n’est pas certain que l’élan court, aigu, de douleur que je ressens dans mon dos après un faux mouvement s’apparente à de la souffrance. Il faut également prendre en considération le degré de contrôle que vous avez sur la situation qui a induit cet état psychologique négatif. Il n’est pas évident que la terreur intense que vous ressentez en marchant vers le ring de boxe constitue de la souffrance, puisque le choix de lutter, en fin de compte, est le vôtre. Cependant, dès que l’intensité et la durée de votre douleur, de votre peur ou de votre anxiété ont atteint un certain palier, et dès que les circonstances qui ont suscité ces états psychologiques sont suffisamment hors de votre contrôle, on peut dire, à juste titre, que vous souffrez de ces choses. Si les animaux sont capables de ressentir la douleur, la peur et l’anxiété, ils sont donc également capables d’en souffrir.
3. États psychologiques agréables
Un état psychologique désagréable est caractérisé par le fait que quiconque le ressent, typiquement, aimerait en être soulagé, et quiconque l’a ressenti aimerait ne plus jamais le ressentir. Inversement, un état psychologique agréable est caractérisé par le fait que quiconque le ressent, typiquement, aimerait le prolonger, et quiconque l’a ressenti aimerait le ressentir de nouveau. Voici des exemples typiques d’états psychologiques agréables :le plaisir, le contentement et le bonheur. Nous avons des raisons substantielles de supposer que les animaux sont capables de connaître des états psychologiques désagréables. Peuvent-ils connaître également des états psychologiques agréables ?
Le plaisir peut être, grosso modo, défini ainsi : un sentiment tel que tout individu qui le ressent, typiquement, le considère comme désirable et/ou en voudrait davantage. Les recherches fournissent beaucoup moins de données pertinentes susceptibles de nous apprendre si les animaux sont capables de ressentir du plaisir. En effet, les laboratoires, comme nous allons le constater, ont une prédilection pour générer chez les animaux des états psychologiques désagréables plutôt qu’agréables. Cependant, a priori, il serait très étonnant que les animaux soient capables de connaître des états psychologiques désagréables, mais pas des états psychologiques agréables. Si les animaux – la plupart des vertébrés et probablement certains invertébrés – sont capables de ressentir la douleur, c’est qu’ils sont, par définition, conscients. La douleur est un état psychologique dissuasif qui provoque donc une motivation : celle d’éviter ou de fuir des stimuli nuisibles. Il en est de même pour la peur et l’anxiété. L’état de plaisir provoque également une motivation, mais dont la fonction, pour faire simple, est opposée à celle de la douleur. Il serait à mes yeux extrêmement surprenant que l’évolution ait doté les animaux de conscience, c’est-à-dire de la capacité à utiliser des états motivationnels négatifs (douleur, peur ou anxiété), mais pas de la capacité à se servir d’états motivationnels positifs tels que le plaisir. Nous sommes donc en droit de présumer que, sur la base des motifs évolutionnistes généraux, si un animal est capable de ressentir la douleur, il est également capable de ressentir du plaisir.
Par ailleurs, la preuve comportementale atteste de manière irréfutable qu’au moins les mammifères supérieurs ressentent du plaisir, ce dont n’importe quel maître de chien ou de chat peut témoigner (je doute qu’un quelconque laboratoire parvienne à fournir une preuve plus convaincante). Enfin, on a identifié des centres neuraux de plaisir semblables à ceux des hommes dans les cerveaux de mammifères, d’oiseaux et de poissons.
Si les animaux sont capables de ressentir du plaisir – les preuves, du moins en ce qui concerne les mammifères supérieurs, en sont aussi convaincantes que pour la sensation de douleur –, ils sont également, peu ou prou, par définition, capables de contentement : on dit bien « souffrir de son sort » et, à l’inverse, « être content de son sort ». Qu’en est-il du bonheur ? Les animaux peuvent-ils être heureux ? C’est plus délicat, puisque l’idée de bonheur est ambiguë à plusieurs égards. D’un côté, nous employons souvent le mot bonheur pour nous référer à un certain type de sentiment ou état émotionnel. Dans ce sens, le bonheur correspond assez étroitement au plaisir ou au contentement. Par exemple, nous pourrions décrire un individu qui vient de courir un marathon sous une chaleur estivale torride et qui savoure maintenant une bière bien fraîche, affalé dans un fauteuil confortable, comme « heureux ». Dans cette tournure, l’idée de « bonheur » coïncide avec le plaisir ou le contentement ; par conséquent, les animaux, s’ils sont capables d’éprouver du plaisir, sont également capables d’éprouver du bonheur. D’un autre côté, nous employons souvent ce mot pour décrire une disposition générale temporaire chez quelqu’un. Par exemple, on peut dire d’une personne heureuse qu’elle n’est pas heureuse dans son nouveau travail. Ce n’est pas contradictoire : cela signifie simplement que sa personnalité ou son tempérament, normalement rayonnants, ont été temporairement assombris par des sentiments ou des émotions provoqués par sa nouvelle fonction. Aucune objection majeure ne semble empêcher les animaux d’être heureux dans ce sens-là non plus. Les gens qui ont eu plusieurs chiens, par exemple, sont tout à fait capables de distinguer divers tempéraments et personnalités, même parmi des chiens de race identique. Ainsi, Nina, l’un de mes bergers allemands, est toujours, comme on dit, « partante pour s’amuser ». Cela veut dire que, quelles que soient les circonstances, elle est toujours prête à jouer. Elle vient de courir trente-cinq kilomètres derrière ma bicyclette et s’est écroulée de fatigue à l’arrivée ? Pas de problème. Si vous la réveillez, elle sera prête à repartir. En revanche, tentez la même chose avec Mabon et vous risquez d’y laisser votre main. Il est aisé de reconnaître certains types de dispositions chez les chiens ; il n’est pas non plus difficile de déceler de bonnes dispositions chez ceux qui ne sont pas d’habitude de bonnes pâtes (le nombre de doigts que vous avez encore sur la main indique votre perspicacité en la matière). Par conséquent, on peut dire que les animaux sont probablement capables d’être heureux dans cette deuxième acception du bonheur également.
Il existe néanmoins une troisième signification du bonheur auquel les animaux ne peuvent sans doute pas prétendre. Nous utilisons souvent le mot heureux en lien avec une sorte de projet de vie, et la question : « Êtes-vous heureux ? » signifie plus ou moins : « Vos activités actuelles sont-elles alignées ou compatibles avec vos objectifs généraux de vie ? » Les animaux, évidemment, ne peuvent être heureux en ces termes, sauf s’ils sont capables d’émettre des jugements sur leur vie en général. Et il est peu probable que ce soit le cas.
4. Les animaux ressentent-ils « de la même façon que nous » ?
De nos jours, seuls les gens complètement sous l’emprise d’une théorie, qu’elle soit philosophique, psychologique, religieuse ou plus largement idéologique, remettent en question le fait que les animaux soient capables de connaître des états psychologiques désagréables ou agréables. Cependant, beaucoup de gens pensent qu’en réalité cela importe peu, moralement, puisque les animaux ne souffrent pas de douleur, de peur ou d’anxiété « de la même façon que nous ». Leur souffrance, par conséquent, est moins importante que celle des êtres humains. Que signifie au juste cette expression « de la même façon que nous » ?
Eh bien, cela peut vouloir dire que les animaux n’ont pas la capacité de s’inquiéter des choses de la même façon que nous. Imaginez que vous et votre chien ayez fait une chute dans un ravin et que vous vous soyez brisé tous deux les os de la partie inférieure du corps. Vous souffrez tous les deux. Cependant, on peut avancer l’argument que votre souffrance est plus grande parce que non seulement vous ressentez la douleur pure de votre jambe cassée, mais qu’en plus vous vous inquiétez du moyen de vous tirer de là, vous vous demandez si quelqu’un va finir par vous localiser ou comment vous allez payer les dépenses médicales, etc. Il est évident que votre chien n’est pas capable de s’inquiéter des conséquences financières d’une telle situation ni de se torturer sur la mauvaise idée de ne pas avoir souscrit une assurance santé complémentaire. Par conséquent, même si la douleur que vous infligent les os brisés de la partie inférieure de vos corps est identique pour vous deux, vous semblez souffrir davantage. C’est à cause de vos connaissances et de votre pouvoir de projection supérieurs – votre capacité à réfléchir au futur, etc. – que vous souffrez davantage. Aussi, on pourrait avancer que les hommes, à cause de leurs pouvoirs cognitif, imaginatif et spéculatif supérieurs, souffrent généralement plus que les animaux dans les mêmes situations.
Cette conclusion, cependant, serait prématurée. La raison pour laquelle vous souffrez davantage que votre chien, dans l’exemple ci-dessus, tient plus de l’exemple choisi que d’autres considérations. Nous pourrions aisément imaginer un autre exemple dans lequel votre chien, précisément à cause de ses pouvoirs cognitif, imaginatif et spéculatif moindres, souffrirait davantage. Imaginez que vous et votre chien soyez emmenés dans une pièce où vous subissez tous deux une piqûre douloureuse. Mais la situation vous est expliquée : l’injection est indispensable pour vous sauver la vie, la douleur ne dure pas, il n’y aura aucune complication et vous pourrez vous en aller (je vous laisse compléter par les détails que vous jugerez utiles ou nécessaires). Votre chien, lui, ignore entièrement ces choses et donc, en sus de la douleur de l’injection, il éprouve une anxiété liée à un environnement inhabituel, à des gens étranges qui l’attachent, etc. Dans ce cas-là, c’est votre chien qui semble souffrir plus que vous.
En effet, des travaux récents suggèrent fortement une donnée perturbante : les animaux, précisément à cause de leurs moindres pouvoirs cognitif, imaginatif et spéculatif, ressentent en fait la douleur d’une manière plus aiguë que nous. C’est-à-dire que non seulement votre chien doit supporter l’anxiété, aggravée par un environnement et un entourage inhabituels, mais la douleur causée par l’injection est en réalité plus forte pour lui que pour vous. Selon l’un des grands physiologistes de la douleur, Ralph L. Kitchell, la réaction à la douleur est décomposée en un élément sensoriel discriminatif et un élément motivationnel affectif2. La première composante a pour fonction de localiser et de comprendre la source de la douleur et le danger corrélé. La seconde composante a pour fonction de fuir le stimulus douloureux. Kitchell avance que puisque la première composante est plus limitée chez les animaux, à cause de leurs moindres pouvoirs cognitif, imaginatif et spéculatif, la seconde composante doit, par un mécanisme de compensation, être proportionnellement plus prononcée. Autrement dit, les animaux ne pouvant aborder comme nous la blessure et le danger sur un plan intellectuel, leur motivation à s’enfuir doit être proportionnellement plus grande. Et qu’est-ce qui peut fournir une motivation plus grande pour la fuite ? Élémentaire : une douleur plus importante.
Lorsque les gens prétendent que les animaux ne souffrent pas « de la même façon que nous », ils disent probablement vrai. Mais malheureusement, ils dérapent souvent vers l’affirmation que les animaux « souffrent moins que nous ». Et cela, en revanche, est sans doute faux. En effet, non seulement nous ne possédons pas de preuves que les animaux, à cause de leurs moindres pouvoirs cognitif, imaginatif et spéculatif, souffrent généralement moins que nous, mais les preuves que nous possédons démontrent plutôt l’inverse : les animaux souffrent davantage.
5. Désirs et préférences
Nous avons donc d’excellentes raisons de penser que beaucoup d’animaux autres qu’humains sont conscients et capables de souffrir d’états psychologiques tels que la douleur, la peur et l’anxiété, et de ressentir des états tels que le plaisir et le bonheur (deux formes sur trois). Nous n’avons également pas de raisons de penser que leur degré de souffrance ou de plaisir soit inférieur au nôtre. À première vue, cela semble suffisant pour démontrer que les animaux sont également capables d’avoir des désirs. Il est difficile de concevoir que l’on puisse éprouver, de façon possiblement intense, un état psychologique désagréable tel que la douleur sans le détester et désirer en sortir. Là encore, la définition est explicite : un état psychologique désagréable, comme la douleur, est caractérisé par le fait que quiconque l’éprouve voudrait typiquement en être soulagé, et quiconque l’a éprouvé voudrait ne pas le subir de nouveau. Et parler de ce que quiconque voudrait ou ne voudrait pas revient à parler de ses désirs.
L’une des conséquences est que beaucoup d’animaux ont des préférences, une préférence étant simplement une forme particulière de désir. En bref, une préférence est un désir pour une situation plutôt qu’une autre. Un animal qui a mal et qui désire que la douleur cesse a une préférence pour une situation dans laquelle il n’a pas mal plutôt que pour une situation dans laquelle il a mal.
Certaines personnes, les philosophes en particulier, n’accepteront pas cela aussi facilement. La raison étant qu’ils ont une conception du désir (et par conséquent de la préférence) beaucoup plus limitée. Selon certains philosophes, la notion de désir est étroitement liée à celle de raisonnement. Supposons qu’un chien pourchasse un lapin. On dira naturellement que le chien désire attraper le lapin, car après tout, pourquoi sinon le pourchasserait-il ? Cependant, selon certains philosophes, si le chien désire réellement attraper le lapin, il doit être capable d’avoir ce que l’on nomme un raisonnement pratique sur la meilleure façon d’attraper le lapin, qui consiste en un raisonnement centré plus ou moins sur la relation entre fin et moyens. Exemple : « Si je fais X, j’obtiendrai Y » est une forme (simple) de raisonnement pratique. Aussi, pourchasser simplement le lapin ne suffit pas ; le chien doit également être capable de raisonner de la façon suivante : « Si je chasse le lapin, je l’attraperai (peut-être). »
Lorsque l’on y pense, c’est assez logique. Le simple fait de « viser » un lapin n’est pas suffisant pour constituer un désir. Une balle peut également « viser » un lapin si elle est tirée avec assez de précision. Mais il est impossible que la balle désire attraper le lapin. Aussi, afin d’acquérir la conviction que le chien désire effectivement attraper le lapin, nous devons d’abord être convaincus qu’il est capable d’avoir ce genre de raisonnement pratique. Pareillement, pour acquérir la conviction que le chien du laboratoire désire que la douleur induite par les électrochocs cesse, nous devons d’abord avoir la conviction qu’il est capable d’avoir un raisonnement pratique sur les moyens de la faire cesser (par exemple : « Si je bondis par-dessus ce muret, cela fera cesser la douleur. »). Par conséquent, la question que nous devons nous poser est celle-ci : les animaux sont-ils capables d’avoir un raisonnement pratique ?
Il existe en fait beaucoup de preuves que la plupart des vertébrés sont capables d’avoir un tel raisonnement. À vrai dire, la plupart des travaux conduits sur l’apprentissage des animaux au cours de ce siècle présupposent, au moins implicitement, qu’ils peuvent le faire. Considérons, par exemple, les études menées par Martin Bitterman dans les années ١٩603. On peut entraîner les poissons à pousser des objets en plastique spécifiques avec leur tête. Lorsqu’ils choisissent le bon levier, ils reçoivent en récompense un ver de terre à manger. Donc, le poisson apprend à pousser uniquement les objets d’une forme particulière et à ignorer les autres. On pourrait penser que ce genre d’apprentissage constitue la preuve que le poisson peut raisonner au moins jusqu’à un certain stade : « Si je pousse X (plutôt que Y), j’obtiendrai Z. » Cependant, pour le chercheur sous l’emprise d’une idéologie comportementaliste, il n’en est rien. Ce dernier explique le comportement du poisson en termes de conditionnement : la force de l’habitude créée par la manière dont le poisson a été récompensé jusqu’à présent.
Supposons maintenant que vous changiez la « réponse ». Alors qu’auparavant, le poisson était récompensé lorsqu’il poussait des objets carrés, il est dorénavant récompensé lorsqu’il pousse des objets ronds. Le poisson finira par apprendre la nouvelle « réponse » et réagira en conséquence. Si vous changez de nouveau la réponse et revenez à celle initiale, le poisson finira, là aussi, par l’assimiler. Et ainsi de suite. Bitterman a découvert que si ce genre d’expérimentations est mené sur les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, on constate un phénomène important : progressivement, ils apprennent la réponse correcte de plus en plus vite. Lorsque l’on revient à la réponse initiale pour la deuxième fois, les amphibiens, les reptiles, les oiseaux et les mammifères apprennent tous la réponse correcte plus vite qu’ils ne l’avaient fait la première fois. Et ils le font encore plus rapidement la troisième fois, et ainsi de suite. Les poissons, eux, ne font pas preuve de ce genre de progrès.
Cela indique qu’il s’agit d’un processus d’apprentissage complètement différent pour les reptiles et les amphibiens. Puisque cela prend à chaque fois au poisson le même temps pour apprendre la nouvelle réponse, son comportement peut être expliqué en termes de conditionnement antérieur. On peut avancer que le poisson est mû vers un objet ou un autre en grande partie par la force de l’habitude. C’est-à-dire que la force de l’habitude créée par la forme précédemment récompensée doit être détrônée par la force de l’habitude créée par la nouvelle forme. C’est du moins l’interprétation de Bitterman.
Cependant, le comportement des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères ne peut être expliqué de la sorte. Quand, par exemple, le comportement d’un mammifère évolue rapidement en réaction à une récompense liée à une nouvelle forme, cela suggère qu’il a surmonté un conditionnement créé par un schéma de récompense antérieur. Aussi, il est clair que son nouveau comportement ne peut être expliqué par le conditionnement. En revanche, son comportement suggère vivement qu’un genre de raisonnement pratique a eu lieu, en particulier une sorte de formation et de validation d’hypothèses. Par conséquent, un raisonnement pratique semble apparaître, à tout le moins au niveau de l’herpétofaune (c’est-à-dire les reptiles et les amphibiens). Cela s’applique aussi au désir.