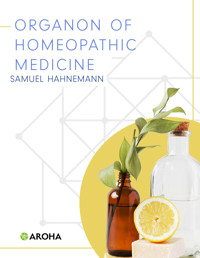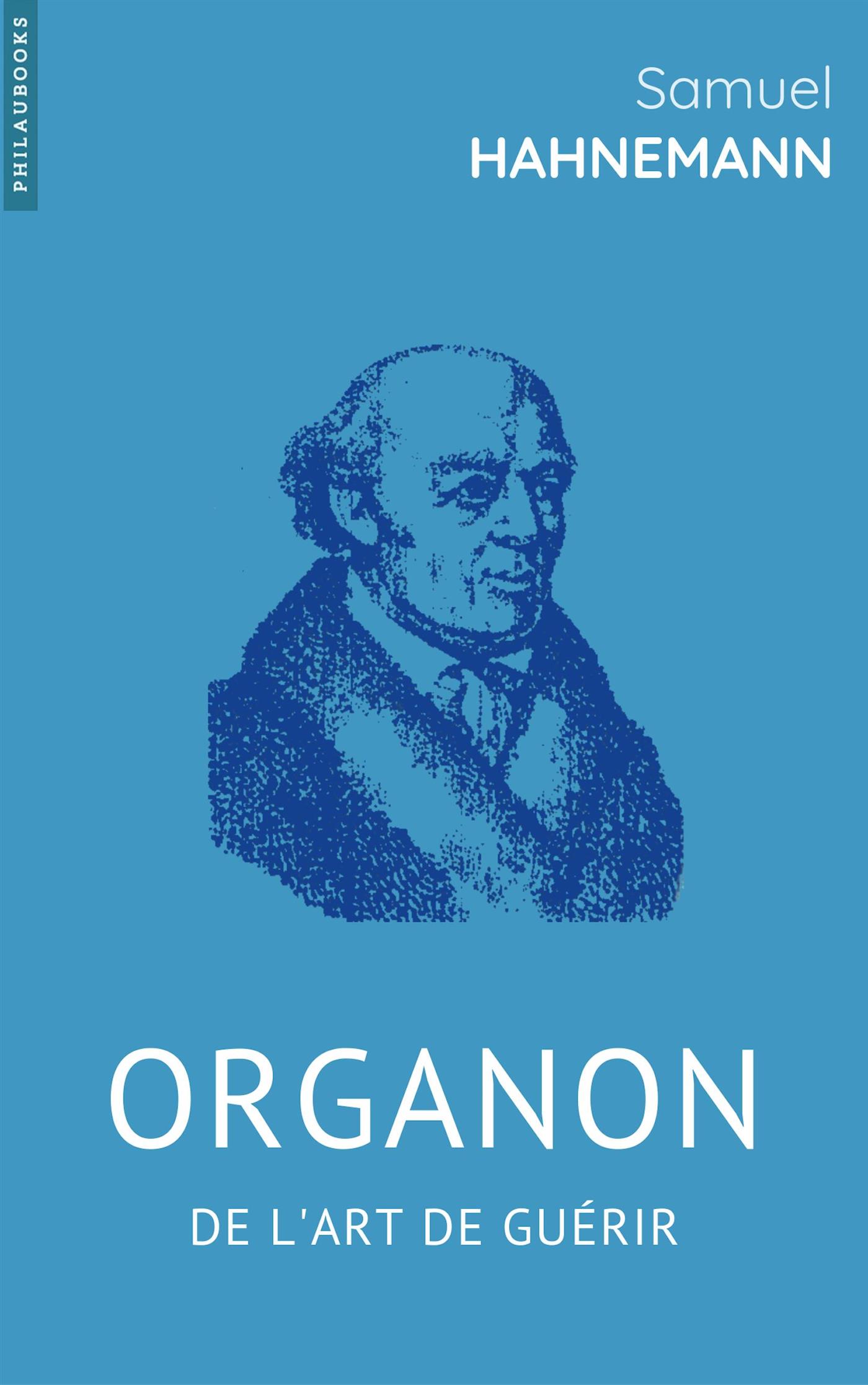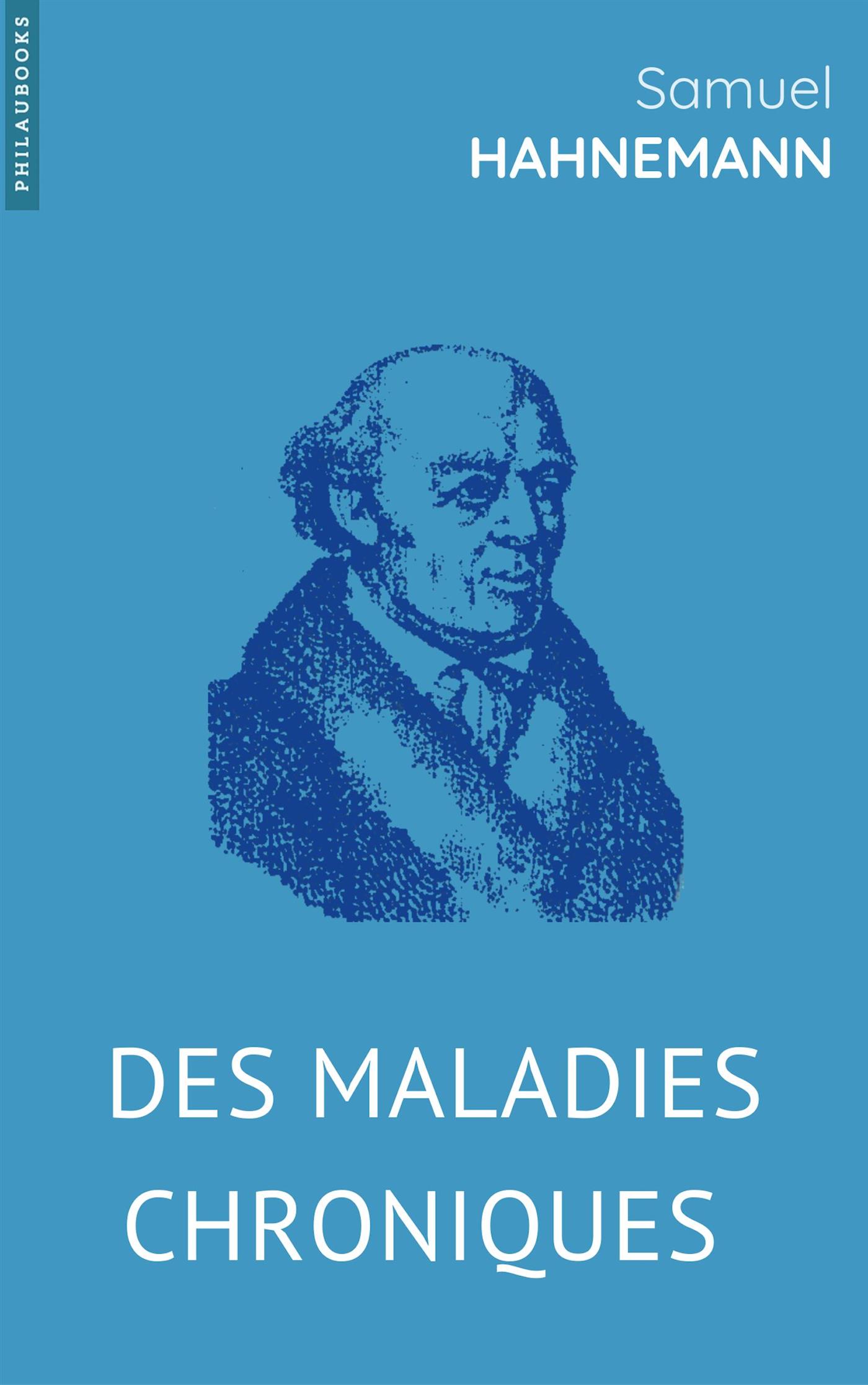
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Philaubooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Französisch
- Texte révisé suivi de repères chronologiques.
(Pour mieux comprendre le vocabulaire particulier de Hahnemann, il peut être utile de lire au préalable L’homéopathie, de Simon V. Léon)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Des maladies chroniques
Samuel Hahnemann
Traduction parDr Bigel
Copyright © 2020 Philaubooks, pour ce livre numérique, à l’exclusion du contenu appartenant au domaine public ou placé sous licence libre.
ISBN : 979-10-372-0180-5
Table des matières
Avertissement de l’éditeur (pour l’édition 1832)
Préface du traducteur
Préface de l’auteur
Maladies chroniques.
1. De la nature des maladies chroniques
2. Cure des maladies chroniques.
3. De la diète homéopathique
Préparation des remèdes anti-psoriques
1. Pétrole
2. Phosphore
3. Sépia
4. Silice
5. Ammoniac
6. Baryte.
7. Calcarea
8. Graphit
9. Iode
10. Lycopode
11. Magnésie
12. Muriate de magnésie
13. Acide nitrique
14. Soude
15. Charbon végétal
16. Charbon animal
17. Caustique
18. Cigüe
19. Potasse
20. Sel commun
21. Soufre
22. Zinc
Observations pratiques du traducteur
Fève de st-ignace
Instruction aussi nécessaire au malade pour consulter le médecin, qu’utile a celui-ci pour diriger le traitement
Sommaire du régime homéopathique
Repères chronologiques
Avertissement de l’éditeur (pour l’édition 1832)
La grande révolution médicale, attendue de siècle en siècle depuis Hippocrate jusqu’à nos jours, venait enfin de s’accomplir. Hahnemann avait fondé l’homéopathie, et déjà malgré l’inévitable opposition des intérêts, de l’insouciance ou de l’orgueil, l’homéopathie gagnait sans cesse de nouveaux appuis parmi les praticiens du premier ordre en Allemagne, en Russie, en Pologne, en Italie, en Amérique ; d’un pas lent, mais assuré, elle s’avançait au milieu des nations en accablant tous ses détracteurs par la supériorité de ses résultats et la solidité de ses conquêtes.
Les homéopathes néanmoins, au sein de leur triomphe, n’avaient pas tardé à rencontrer dans leur pratique médicale des difficultés inattendues, des anomalies rebelles, dont ils ne pouvaient se rendre compte. Etonnés de trouver ainsi plus d’une exception à des principes qui semblaient n’en devoir admettre aucune, ils s’accordaient à reconnaître que leur doctrine, déjà si supérieure à toutes les autres, avait encore besoin de se surpasser elle-même, et qu’un grand pas lui restait à faire.
Ce second pas de géant, c’est encore à l’illustre, à l’immortel Hahnemann que la Providence en avait réservé la gloire. Après 11 nouvelles années de méditations, de recueillement et d’expériences, Hahnemann publia tout-à-coup son Traite des Maladies chroniques. Ce livre admirable, en portant très haut la doctrine et le traitement de ces affections, versa des torrents de lumière sur la thérapeutique des maladies aiguës elles-mêmes, aplanit toutes les difficultés, bannit toutes les anomalies, et fut pour la science comme une seconde création.
Notre compatriote le docteur Bigel, un des plus habiles médecins de la nouvelle école, s’était, dès 1827, empressé de consacrer à la France un grand et important ouvrage sur l’homéopathie 1, ouvrage au-dessus de nos éloges dès le jour où le vénérable Huffeland a dit de son auteur, qu’il avait bien mérité de ses concitoyens en le leur dédiant. Le même zèle lui fait un devoir aujourd’hui de nous associer également aux dernières découvertes de Hahnemann, en nous offrant une traduction de son Traité des Maladies chroniques.
Une traduction du même ouvrage vient d’être publiée, il y a peu de jours, à Paris, par M. le docteur Jourdan, savant estimable, qui comptait déjà parmi ses titres nombreux à la reconnaissance publique, une traduction de l’Organon de Hahnemann, autre écrit fondamental pour la science.
Loin de contester à M. Jourdan le mérite de sa publication, nous sommes assurés qu’elle rendra de très grands services, et nous faisons des vœux pour son rapide écoulement, car nous lui reconnaissons toute la supériorité qu’était susceptible de lui donner un homme de talent, complètement étranger à l’homéopathie. Mais il n’y a rien là qui puisse nous dispenser de mettre au jour la traduction du docteur Bigel.
Outre une préface, des notes et des additions intéressantes dont cette traduction est enrichie, et que Hahnemann lui-même ne désavouerait pas, il est aisé de voir que le docteur Bigel, homéopathe consommé, et vrai représentant de Hahnemann dans une moitié du nord, doit avoir, mieux que personne, saisi la pensée de son modèle, jusque dans les nuances les plus délicates. A ce rare avantage d’une fidélité parfaite, ajoutons l’intérêt d’une rédaction pleine de liberté, de mouvement et de vie, telle qu’on devait l’attendre de l’auteur habile, du praticien exercé qui est maître, à tous égards, de son style comme de son sujet, et telle qu’on la chercherait en vain dans l’œuvre laborieuse et méritante, mais inévitablement servile et morte d’un écrivain qui déclare lui-même n’avoir jamais vérifié un seul des faits innombrables dont sa plume s’est occupée, et dont la science nouvelle se compose.
Il n’est pas inutile de rappeler également ici, que ce nouvel hommage du docteur Bigel à la France, étant comme la suite et le complément indispensable de son Examen de l’homéopathie, il sera nécessairement bien accueilli de tous les lecteurs de ce dernier ouvrage, qui, négligé quelque temps parmi nous, est avidement recherché de toute part aujourd’hui.
Les symptômes de la fève de St-Ignace, omis dans le premier ouvrage, ont été placés à la fin du Traité des Maladies chroniques, et les médecins tiendront compte au docteur Bigel de cette attention.
Enfin, quand l’homéopathie, encore peu connue en France, y inspire un intérêt qui croît de jour en jour dans une progression étonnante ; quand la jeunesse médicale surtout, demande avec ardeur des renseignements détaillés qui éclairent ses premiers pas, nous avons cru pouvoir nous-mêmes seconder ce généreux élan, et donner une utilité de plus à l’écrit que nous publions, en y joignant un sommaire du régime homéopathique, et une courte instruction où les médecins trouveront de quoi s’aider dans le choix des médicaments, et les malades, un moyen de consulter plus fructueusement par écrit.
Ainsi l’élégance et la pureté de notre édition, son prix fixé à 9 fr. et calculé uniquement dans l’intérêt général et non dans le nôtre, sont le moindre des titres qui la recommandent à nos concitoyens ; nous la leur offrons avec le plus juste espoir d’un bon accueil.
COMTE S. DES GULDI, D.-M.
1Examen de la Méthode curative nommée Homéopathie, suivie de la Matière médicale pure du docteur Hahnemann. Varsovie, 1827 ; 3 vol. gr. in-8°. A LYON : LOUIS BABEUF. BARON. — A Genève : CHERBULIEZ. BARBEZAT. — A Paris : CROCHARD. JUST-ROUVIER. Prix : 21 fr.
Préface du traducteur
J’avais promis, dans mon Examen de l’homéopathie, de ne pas reparaître sur la scène médicale, et j’eusse tenu parole, si Hahnemann n’eût à ses ouvrages ajouté un dernier travail destiné à combler une lacune qui rend sa méthode curative imparfaite.
« J’ai, dit-il dans ce traité, enseigné que la loi des semblables est le véritable instrument de guérison des maladies, tant aiguës que chroniques. Une expérience de cinquante ans m’a prouvé la vérité de cette découverte, qui m’est propre ; mais elle m’a fait aussi reconnaître que beaucoup d’affections chroniques, bien que traitées conformément aux principes de l’homéopathie, ou ne se guérissaient point, ou se reproduisaient tôt ou tard après leur guérison.
« J’ai dû rechercher la cause de cette exception à une loi qui ne doit souffrir aucune exception, et je l’ai trouvée dans la présomption que ces maladies chroniques étaient elles-mêmes exceptionnelles, c’est-à-dire qu’elles devaient relever d’une cause toute spéciale, présomption que le temps et l’expérience ont convertie en une certitude.
« Toutes et quantes fois qu’une maladie résiste au traitement homéopathique le plus régulier de la part du médecin et du malade, c’est qu’elle est entretenue par un miasme dont le malade ou son médecin ignorent l’existence. (Je ne parle ici que des miasmes chroniques, les miasmes aigus étant toujours signalés de manière à être connus.)
« Le nombre des miasmes chroniques se réduit à trois, qui sont : la syphilis, la sycosis et la psore. Ces trois miasmes se partagent toutes les maladies chroniques, mais dans des proportions différentes. En faisant huit parts de ces maladies, j’en attribue les sept huitièmes à la psore. Les deux autres sont les causes productrices du dernier huitième.
« J’ai dit que le temps et l’expérience m’avaient conduit à cette opinion. En effet, j’ai vu dans l’histoire des maladies chroniques, faite tant par les anciens que par les modernes, les affections chroniques les plus variées, résulter de la psore répercutée, et je n’ai eu, dans le traitement de la plupart d’entre elles, de succès, que par l’emploi des remèdes anti-psoriques. En faut-il davantage pour avoir le droit de tirer celle conséquence, que j’ai convertie en principe ?
« Longtemps je fus condamné à la stérile contemplation de cette grande vérité médicale, par l’insuffisance de la matière médicale éprouvée. Je dus soumettre aux épreuves d’autres substances médicinales. Elles répondirent par la manifestation des symptômes analogues aux symptômes que j’avais trouvés rebelles, et les moyens de guérison amenèrent les succès dont j’avais entrevu la possibilité. »
Telle est la substance du dernier ouvrage de Hahnemann sur les maladies chroniques.
Ce langage a le droit d’étonner plus encore que tout ce que Hahnemann a écrit jusqu’ici sur son nouvel art de guérir les maladies, Il m’a paru étrange, je l’avoue, et je puis à peine me familiariser avec l’idée que la presque totalité des affections chroniques soit de nature psorique. Néanmoins, malgré cette répugnance, je me sens comme entraîné à partager l’opinion de cet homme singulier, mais étonnant.
Le moyen de lui résister, en effet, lorsqu’il assure que les maladies les plus graves et les plus rebelles, quand elles procèdent évidemment de la psore, cèdent toujours à l’application de sa matière médicale anti-psorique, et lorsque des faits incontestables viennent de toutes parts à l’appui de cette assertion ?
Comment refuser de reconnaître que les symptômes de la psore ont une parfaite similitude avec les symptômes connus de toutes nos affections chroniques, quels que soient les noms dont la pathologie les ait revêtus ? On ne peut contester non plus la ressemblance que présentent les symptômes médicinaux de la matière médicale anti-psorique avec ceux qui accompagnent les affections chroniques naturelles. Il semble donc rigoureux d’en conclure qu’une seule et même cause préside à leur formation, à leur entretien, à leur aggravation.
À cette logique serrée et pressante, on oppose qu’il n’est pas démontré que des causes d’une autre nature que la psore ne puissent désaccorder l’organisme de la même manière que le fait le vice psorique.
« Mais, dit Hahnemann, la puissance de ces causes pathogénétiques, étrangères au miasme psorique, pour la formation des maladies chroniques, ne doit point vous en imposer.
« Sans doute, ces causes produiront des effets semblables à ceux de la psore ; mais ces effets ne résisteront point aux traitements spécifiques que vous leur opposerez, tandis que, lorsque le miasme en sera la cause productrice, vous verrez échouer ce traitement, et la maladie ne céder qu’à la cure anti-psorique.
« C’est ce qui m’a fait établir l’axiome que j’ai posé plus haut : que toute maladie, rebelle au traitement le plus régulier, ne lui résiste que parce que cette maladie étant produite et entretenue par un miasme, elle ne peut être guérie que par le spécifique de ce miasme. Ce raisonnement devient péremptoire, lorsque celui qui le fait, ajoute : j’ai réussi dans le traitement de ces maladies, en les attaquant comme des affections descendantes de la psore. »
Sans exprimer, comme Hahnemann, une opinion aussi large sur l’universalité de la psore, je ne suis pas loin de croire que ce vice est plus répandu qu’on ne le pense généralement. Cette croyance s’appuie chez moi de mes souvenirs et des recherches auxquelles je me suis livré, depuis la publication de l’ouvrage de Hahnemann sur les maladies chroniques.
Dès cette époque, j’ai peu rencontré de personnes atteintes de maladies chroniques, qui n’aient précédemment plus ou moins payé un tribut à la psore, traitée d’après les idées reçues et les méthodes curatives en honneur depuis des siècles nombreux ; on verra ce que l’on doit penser de ces cures, quand on aura lu la doctrine de Hahnemann sur le mode d’infection de la psore et, en général, de tous les miasmes chroniques.
Si donc, comme le prouve cet homme immortel, le miasme de la psore ne peut être détruit que par les méthodes curatives, aujourd’hui encore universellement en usage, il y a quelque raison d’en induire que le miasme psorique, s’il n’est la source unique des affections chroniques, est tout au moins compliqué avec elles, de manière à les rendre incurables autrement que par un traitement anti-psorique.
Je ne puis ne pas adopter sa doctrine sur le mode d’infection de l’organisme par les trois miasmes, exposé avec autant d’évidence que de vérité dans cet intéressant ouvrage. N’y eût-il de remarquable et d’utile que ce tableau de la nature en contact avec ces trois contagions, il faudrait rendre à son auteur d’immortelles actions de grâces !
Puissent ces vérités importantes descendre des chaires académiques jusques dans les classes inférieures de la société ! Il est bien temps que le peuple apprenne à connaître les allures de ces trois fléaux, et tout ce qu’il a à en redouter ! Plus d’un médecin peut-être y apprendra aussi que ces miasmes ne vicient la surface de l’homme, qu’après avoir infecté les centres de l’organisme ; alors on cessera d’avoir à gémir sur ces fausses cures superficielles, qui sont de véritables empoisonnements. Et si ces docteurs profanes, encore trop nombreux, ne veulent embrasser les principes de Hahnemann, qui sont ceux de la nature, ils rencontreront du moins, dès que ces principes seront devenus des connaissances vulgaires et traditionnelles, dans leurs malades, les lumières qui leur manquent, et dans ces lumières, des obstacles à l’exercice de leur thérapeutique involontairement homicide.
Maintenant, si je passe de la pathologie de l’auteur à son mode de traitement, je sens, en face de la diminution de ses doses médicinales, augmenter la surprise que j’éprouvai à la première lecture de l’Organon, sur la nécessité des doses infiniment atténuées prescrites par l’homéopathie. Ici, c’est encore l’expérience qu’il faut consulter et lui faire le sacrifice et de nos croyances et de nos habitudes, si les unes et les autres sont erronées et vicieuses.
Bien que je n’aie pas trop le droit de faire parler la mienne, je dirai cependant ce que j’ai observé depuis que j’ai appliqué la matière médicale anti-psorique aux affections du genre chronique.
La plupart des personnes grevées de maladies chroniques ont, à force de souffrir, contracté une telle exaltation des systèmes sensible et irritable, qu’elles sont devenues susceptibles d’impressions qu’elles n’auraient point perçues dans leur état de santé antécédent. Est-il donc étonnant que les atomes les plus déliés de la matière médicale aient de l’action sur elles ?
Je prie le lecteur peu disposé à croire, de vouloir bien se rappeler ce que j’ai dit de l’idiosyncrasie et de ses phénomènes, dans mon examen de l’homéopathie. Qui n’a pas vu des femmes tomber en défaillance, d’autres éprouver de la suffocation, des convulsions même, pour être entrées dans un appartement où se trouvaient des personnes parfumées de musc ou d’essence de roses ? Quelle fraction de ces substances odorantes pense-t-on que leur système nerveux ait pu percevoir ? qui se chargera de la saisir, de la peser ? croit-on qu’elle ne soit pas inférieure à celle que Hahnemann conseille d’administrer aux personnes atteintes de maladies chroniques ? Le secret de son activité est dans l’impressionnabilité infinie des nerfs qui doivent la percevoir ; de là l’atténuation infinie des substances médicinales. Je ne fortifierai ce raisonnement que d’un seul exemple, que je prendrai parmi les faits familiers à la médecine allopathique.
À quelle dose excessive n’emploie-t-on pas hellébore blanc, pour obtenir des évacuations chez les personnes atteintes de démence ? On l’administre spécialement à celles dont le chagrin a troublé l’esprit. C’est le foie, c’est la veine porte qui sont accusés d’être les fauteurs de tout le mal. Ces organes sont supposés frappés d’une telle atonie, qu’ils ne peuvent être ébranlés que par les remèdes les plus vifs. Il n’est même pas certain qu’ils obéissent au stimulus puissant que l’on dirige contre eux.
Comment se fait-il que la fraction quadrillionième d’un grain de cette substance ait plus d’efficacité que les doses massives de ce remède ? Cet atome d’ellébore n’est envoyé à aucun des organes, dont on suppose l’affection plus souvent qu’on ne la prouve. Il est adressé à la partie souffrante de l’organisme. Cette partie souffrante, quelle qu’elle soit, en sera touchée, parce que le remède est spécifique, et que, produisant en cette qualité des symptômes semblables à ceux de la maladie, il ne les produit que par son affinité avec l’organe malade.
On sait que cet organe, précisément parce qu’il est malade, est irritable et sensible au suprême degré. Cet atome le touche et produit sur lui une impression que l’on est tout étonné de ne pas opérer avec des masses du même remède. Le ventre s’ouvre, la tête s’éclaircit, la raison reprend son empire, sous l’influence de cet atome, tandis que l’orage produit par les doses exagérées de ce médicament, s’est borné, dans les régions de la santé, à quelques coups de tonnerre, dont l’ébranlement retentit trop vivement dans l’organe de l’intelligence, qui s’en trouve un peu plus désaccordé.
Au reste, au milieu de ces fluctuations que doivent produire, d’un côté, l’affirmation, de l’autre, la négation, il est pourtant une règle invariable, qui a servi de gui de aux médecins dans tous les temps, c’est de mesurer la dose d’un remède sur le degré d’impressionnabilité du malade. Elle est immense, comme je l’ai observé, dans l’organe siège du mal. Elle est réduite au minimum dans ceux qui sont étrangers à la maladie. La raison en est que la vie est comme accumulée dans la partie qui souffre, à laquelle le reste de l’organisme a prêté un contingent de forces dont il se prive pour secourir le point malade. L’homéopathie est donc conséquente à ses principes, en atténuant à l’infini ses doses médicinales, comme les partisans de la médecine antagonistique sont conséquents aux leurs, en grossissant jusqu’à la monstruosité leurs remèdes allopathiques.
J’ai observé encore que l’on n’accélère point la cure des maladies chroniques, en dosant trop vivement le remède, ou en le répétant trop fréquemment. Ces cures sont toutes dans le temps, et si quelques médecins déjà se sont plaint qu’ils n’obtenaient point de résultat en se conformant strictement aux règles prescrites par Hahnemann, c’est que sans doute ils ont rencontré des obstacles, ou dans les infractions du malade à son régime, ou dans la difficulté du choix relatif aux médicaments à administrer.
Croit-on facile, en effet, de renoncer aux jouissances dont l’homéopathie commande la privation ? le croit-on davantage de mettre une main assurée sur un remède spécifique ? Je laissé ces deux questions à résoudre au lecteur.
La Matière médicale anti-psorique termine l’ouvrage de Hahnemann sur les maladies chroniques ; elle est volumineuse. Je me conduirai à l’égard de cette traduction, comme je l’ai fait envers la grande Matière médicale de l’homéopathie, c’est-à-dire, que je la bornerai à l’exposition des symptômes caractéristiques des médicaments qui la composent.
J’ai dit que cet ouvrage était de ma part, obligé ; ou je ne devais rien dire de Hahnemann à mes compatriotes, ou je devais leur parler de tout ce qu’il a fait. Il a trouvé dans l’homéopathie une lacune qu’il a remplie. J’en eusse laissé une autre dans mes communications, si je n’eusse pas fait connaître son dernier ouvrage.
Ce nouveau tribut offert à la patrie par un de ses enfants, sera-t-il mieux accueilli que ne le fut, en 1827, mon Examen de l’Homéopathie ? J’ose en nourrir la douce espérance ; car, dès l’apparition de ce dernier ouvrage, les circonstances ont bien changé. L’homéopathie, alors entièrement inconnue de mes compatriotes, est maintenant chez eux l’objet d’un grand intérêt pour plusieurs, d’une vive curiosité pour tous. Ils ont déjà plus ou moins entendu parler de la clinique homéopathique, fondée dans plusieurs capitales de l’Europe, sous la protection des différents souverains, et confiée par eux à des médecins homéopathes.
Quel que soit le voile que l’esprit de parti ait pu jeter sur ces graves et importantes épreuves, la France les connaît, et s’en occupe sérieusement ; elle est à la veille d’admettre enfin l’homéopathie comme une grande et admirable puissance, et de prendre avec éclat le rang qui lui appartient dans cette nouvelle route ouverte par le génie à l’humanité.
Les travaux et les succès de mon honorable ami le docteur Des Guidi, de Lyon, sa pratique aussi heureuse qu’étendue, ses utiles publications, son active correspondance avec les médecins, ses nombreux imitateurs, joints à sa conviction profonde et à la loyauté de son caractère, ont puissamment contribué à cet essor de l’opinion. Les cures si remarquables que l’homéopathie lui doit depuis quelques années, à Lyon, à Paris, dans toute la France, dans toute la Suisse, ont éveillé partout l’attention du public et d’un grand nombre de médecins ; elles ont contribué à susciter à Genève la fondation de cette bibliothèquehoméopathique dont les abonnés se multiplient sans cesse, et que les expériences du docteur Dufrêne ont, dès le premier jour, rendue si intéressante.
D’un autre côté, la traduction de la 4e édition de l’Organon, par un membre distingué de l’Académie royale de médecine ; la traduction meilleure encore du même ouvrage, par le baron de Brunou ; la pratique du docteur Queen, et son excellent Mémoire, publié à Paris, sur le traitement du choléra, tous ces généreux efforts ont déjà profondément remué la France, et l’ont préparée à s’occuper de l’examen impartial, et, par conséquent, à la prochaine adoption de l’homéopathie. Déjà de toute part les essais se multiplient dans les départements où leurs résultats ne sauraient se faire long-temps attendre chez un peuple riche des plus heureux dons de l’intelligence. Les vraies sommités médicales trouveront encore ici des palmes à cueillir, et l’ardente jeunesse aimera bientôt à s y frayer une route nouvelle d’expériences, de bienfaits et de gloire.
Il y aura bien quelques résultats d’épreuves qui paraîtront défavorables, et dont ne manqueront pas de se saisir les hommes qui se sont mis en hostilité ouverte contre la réforme médicale. Mais je proteste d’avance contre des jugements qui ne seraient point rendus par la probité, réunie à une connaissance profonde de la matière en litige.
Il n’est que les amants passionnés du vrai, les hommes capables de lui tout immoler, qui soient propres à instituer des expériences dont le résultat est le renversement de longues erreurs, sur lesquelles on a fondé beaucoup de renommées et beaucoup de fortunes. Telles sont les conditions que doivent remplir les juges chargés de prononcer sur la vérité de l’homéopathie.
Ces titres fournissent la mesure du degré de confiance que mérite un grand nombre d’écrits publiés contre la réforme médicale.
Aux auteurs de quelques-uns on peut reprocher d’avoir jugé sans examen pratique, une découverte faite au lit des malades, et qui ne peut être jugée que sur le théâtre de la douleur D’autres sont justement accusés d’être sortis, dans leurs expériences, de la route tracée par le fondateur de l’homéopathie. Ses préceptes sont rigoureux ; il n’y a point à composer avec leur sévérité. Comment espérer que les médecins familiers avec les doses massives de l’allopathie, observent strictement ces préceptes ? Et cependant la plus légère déviation de ces règles, en fausse les résultats, et défigure entièrement l’homéopathie. Ces erreurs sont d’autant plus faciles, que l’on ne croit pas, en les commettant, manquer à la probité. Si l’on y joint celles qui résultent d’un mauvais choix du remède, on a de suite l’intelligence de cette double assertion : que les remèdes homéopathiques sont nuls, ou dangereux dans leurs effets.
On a écrit longuement déjà pour soutenir ces deux jugements prononcés par l’ignorance ou la mauvaise foi. Mais les auteurs de semblables arrêts (qui sont loin d’être irrévocables) avaient-ils mission pour juger l’homéopathie ? Depuis quand la science peut-elle s’infuser ? Quoi ! on trouve raisonnable de ne croire à l’expérience d’un médecin élevé dans les principes de l’école ancienne, qu’après le laps de la moitié de sa vie, et l’on pourrait devenir homéopathe en quelques semaines ! Mais oublie-t-on que les tableaux des maladies médicinales ne sont pas moins nombreux que ceux de nos maladies qu’ils représentent, et dont nous mettons des années à nous charger la mémoire ? oublie-t-on que le rassemblement des symptômes de la maladie doit être aussi complet que possible, pour en former une image fidèle, dont on doit chercher la copie non moins exacte dans la collection des symptômes médicinaux ? Conçoit-on bien tout ce que ces opérations doivent coûter de peine et de patience ? Si je ne me trompe, il est quelques frais d’étude à faire avant que d’arriver à la maîtrise, dont le diplôme de docteur ne donne que le nom ; et nonobstant ces efforts, il est et il y aura toujours de bons, de médiocres et de mauvais médecins homéopathes. La faute n’en sera pas toujours à l’homéopathie, mais bien :
Aux Dieux, qui quelquefois refusent les talents.
Préface de l’auteur
Si je n’avais eu la conscience de ma destination sur la terre, destination qui consiste à aimer le bien et à le répandre, autant qu’il est en moi, j’eusse montré bien peu de connaissance du monde, et beaucoup de maladresse, en communiquant de mon vivant, et pour le bonheur de tous, un art dont je suis seul en possession, et dont le secret eût pu m’apporter d’immenses avantages.
En publiant cette précieuse découverte, je n’ose espérer que mes contemporains, frappés de la justesse et de la conséquence de ma doctrine, l’admettent, et que, marchant fidèlement sur mes traces, ils fassent jouir l’humanité des biens infinis dont elle doit être la source intarissable. Ou plutôt n’ai-je pas lieu de craindre que ce que mes préceptes renferment d’étrange et d’inouï, en les rebutant, en les effrayant même, ne les porte à leur refuser les épreuves et l’imitation qui doit les féconder.
Non, je ne saurais me livrer à l’espoir que ces communications nouvelles soient plus heureuses que la publication des principes généraux de l’homéopathie. L’incrédulité n’a-t-elle pas trouvé un appui dans l’exiguïté des doses médicamenteuses qu’elle prescrit, exiguïté fondée sur le caractère dynamique de leur sphère d’action, et démontrée nécessaire par des milliers d’expériences ? Accueillera-t-on mieux la proposition de renchérir encore sur cette exiguïté ? Non, je ne puis le croire. On continuera long-temps encore à doser fortement les remèdes, comme je l’ai fait moi-même avant d’arriver à ces nouvelles connaissances, et à créer ainsi à beaucoup de maladies, des dangers qu’il serait si facile d’éviter, en accordant à mes paroles quelque confiance, à ma doctrine quelques épreuves.
Pouvait-il y avoir quelque témérité dans l’usage des médicaments, aux petites doses que j’ai conseillées ? La nullité des effets était la seule conséquence à redouter, car ils ne pouvaient nuire. Mais on a mieux aimé élever ces doses, en les employant homéopathiquement, et l’on a rouvert à l’erreur le chemin que j’avais fermé. Le danger recréé pour le malade, la perte de ses forces, celle du temps, ont ramené dans les routes que j’ai ouvertes, et l’on a reconnu avec moi qu’elles seules conduisent au but d’une manière sûre, prompte, douce et durable.
Encore une fois, je le demande, fera-t-on de cette nouvelle et précieuse découverte, un meilleur usage ? Mes contemporains laisseront-ils à la postérité le soin et l’honneur de délivrer l’humanité souffrante du poids des maladies chroniques qui pèsent sur elle, en refusant le présent que je leur offre, de ce complément à la doctrine homéopathique.
Maladies chroniques.
Leur nature spéciale et de leur traitement homéopathique
De la nature des maladies chroniques
Jusqu’ici l’homéopathie, pratiquée conformément à l’enseignement contenu dans mes ouvrages et ceux de mes disciples, a montré une prééminence marquée sur la méthode allopathique, tant dans le traitement des maladies aiguës qui attaquent subitement, que dans la cure des fléaux épidémiques et des fièvres sporadiques.
C’est avec la même supériorité que l’homéopathie combat les maladies syphilitiques, que l’on voit disparaître d’autant plus sûrement, plus doucement « que cette méthode ne touche point aux symptômes locaux, se contentant d’attaquer leur cause interne et spécifique par un remède également intérieur et spécifique, d’où suit la disparition des symptômes et du vice qu’ils représentaient, sans laisser après elle aucune suite fâcheuse.
Cependant, nonobstant ces brillants avantages, il restait à l’homéopathie à faire plus encore, il lui appartenait de faire cesser cette foule de maladies chroniques avec ou sans nom, qui font le désespoir de la médecine et le malheur de l’humanité.
Ce n’est pas sans préjudice pour les malades, que les médecins allopathes leur ont opposé jusqu’ici leurs traitements. On sait qu’ils se composent des substances médicinales les plus vives, comme les plus nauséabondes, mêlées ensemble et administrées à de grandes doses, dont les propriétés véritables leur sont inconnues, portant tous les noms imposants de sudorifiques, altérants, diurétiques et calmants. Viennent ensuite les bains de toute espèce, aidés des clystères, des frictions sèches ou humides, secondés par les fomentations, fumigations, emplâtres de tout genre, exutoires et fontanelles ; dans leur insuffisance, on appelle à leur secours la saignée, les sangsues, et d’éternels purgatifs dont on accroît l’action débilitante par une inanition méthodique. On ne peut disconvenir que cet empirisme, tout raisonné qu’il soit, n’empire l’état du malade qui lui est soumis, en dépit des remèdes fortifiants dont on les croise. Il arrive bien quelquefois un phénomène qui a droit de surprendre, et souvent semble consoler le médecin, c’est l’apparition d’un mal nouveau, dont il espère de triompher, comme il a triomphé du premier. On ne veut pas voir que, du côté du mal, il n’y a que les formes qui ont changé. On recommence l’attaque sur de nouveaux frais ; le mal s’aggrave, la plainte est plus bruyante et ne perd de son éclat que lorsque le malade, épuisé, a perdu la force de l’exprimer. La mort enfin met un terme à ses souffrances, et l’on n’entend plus que la voix de l’homme de l’art, répondant aux gémissements des parents, des amis éplorés, par ces mots : rien n’a été négligé pour sauver l’infortuné.
Autre est le procédé de l’homéopathie, ce présent inestimable de la Divinité ! Avec le choix d’un remède éprouvé sur l’homme sain, et dont les symptômes ont de la similitude avec les symptômes du mal chronique à quérir ; les disciples de l’homéopathie ont souvent, sans diminution des forces, ni perte des sucs, opéré des guérisons aussi promptes qu’efficaces, lorsque la maladie n’avait poussé encore des racines très profondes, ni atteint son plus haut degré de gravité. L’allopathie pourrait-elle en dire autant, elle, dont l’allure est rendue incertaine par le choix fortuit d’un médicament dont elle ignore les vertus positives ?
Il est arrivé fréquemment que le malade guéri par un procédé si simple et si efficace, après avoir joui plus ou moins de temps de sa santé, est retombé dans les mêmes accidents, et quelquefois dans de nouveaux plus graves et plus opiniâtres encore. Ils étaient le produit, ou de fautes de régime grossières, ou d’un refroidissement causé par les vicissitudes de l’air, le passage d’une saison à une autre, comme aussi ils pouvaient avoir été déterminés par une violente fatigue du corps, de fortes contentions d’esprit, et, ce qui est plus nuisible encore, par un ébranlement total de la santé, effet de graves lésions corporelles, surtout de chagrins vifs, profonds et durables.
Mais soit que les accidents fussent les mêmes, soit qu’ils eussent changé de caractère, le médecin homéopathe, dans ce dernier cas, trouvant dans la matière médicale pure, un remède en analogie de symptômes avec les symptômes du mal, replaçait promptement le malade dans un état meilleur, tandis que dans le premier cas, où rien n’était changé dans la nature des symptômes, les moyens médicinaux, si efficaces au premier traitement, n’offraient plus qu’une efficacité imparfaite contre la récidive, laquelle imperfection allait toujours croissant dans les récidives subséquentes. Il n’était pas rare, nonobstant la parfaite spécificité des médicaments, et l’observation sévère du régime, que des symptômes morbifiques nouveaux vinssent se joindre aux anciens, sans qu’il fût possible de les enlever d’une manière complète avec les remèdes les plus analogues à leur nature, en raison de l’influence des causes externes ci-dessus mentionnées, dont la constante opposition contrariait la cure.
C’est en vain que le malade éprouvait quelque relâche à son mal, n’observant pas qu’il était redevable à toute autre puissance qu’à celle des remèdes, tel qu’un événement heureux, un changement fortuné de situation sociale, un voyage agréable, une sérénité constante de l’atmosphère, illusion flatteuse, partagée par le médecin comme par son malade ; illusion qui ne tardait pas à s’évanouir, les récidives successives du mal montrant les spécifiques les mieux choisis, les plus sagement administrés, de plus en plus inefficaces et convertis à la fin en moyens palliatifs. Communément même, ces remèdes laissaient inattaqués quelques symptômes, en dépit de leur similitude avec les symptômes médicaux, et que le médecin avait la douleur de voir s’aggraver chaque jour davantage, lors même que le malade et l’homme de l’art restaient irréprochables, l’un dans son régime, l’autre dans son procédé curatif. L’état chronique, résistant à l’une et à l’autre influence, s’empirait d’année en année.
Telle fut, marquée par plus ou moins de rapidité, la terminaison du traitement de presque toutes les maladies chroniques qui ne relevaient pas du vice vénérien, malgré la conformité de ces traitements avec les principes de la médecine homéopathique. Commencés sous les auspices de la joie, la défaveur en signalait la continuation, et le désespoir la terminaison.
Et cependant la doctrine qui dirigeait ces cures, est appuyée sur des fondements inébranlables. Elle est la vérité elle-même, et le sera de toute éternité. Des actes nombreux, des faits patents ont instruit le monde de son excellence, j’oserais presque dire, de son infaillibilité.
N’est-ce pas l’homéopathie qui, la première et toute seule, a enseigné à guérir les maladies déterminées les plus graves, telles que la fièvre scarlatine de Sydenham, la fièvre pourprée nouvelle, la coqueluche, le vice verruqueux, les dysenteries automnales, avec des remèdes spécifiques ? et n’a-t-on pas vu les fléaux putrides les plus contagieux, conjurés et domptés à l’aide des doses les plus faibles de médicaments choisis dans la corrélation de leurs symptômes avec les symptômes de ces maladies épouvantables ?
Quelle peut donc être la source du peu ou point de succès de l’homéopathie dans le traitement des maladies chroniques de toute autre nature que celle syphilitique ? Pourquoi tant et de si longs efforts ne peuvent-ils amener une guérison durable ? Faut-il s’en prendre à la pauvreté de sa matière médicale ? mais cette partie de la science ne s’est-elle pas prodigieusement enrichie par un travail de quarante ans, que mes disciples ont partagé avec moi, et malgré son enrichissement, l’homéopathie n’en restait pas moins impuissante contre la plus grande partie des maladies chroniques.
Ce problème ne pouvait trouver sa solution que dans une investigation plus attentive et plus profonde de la nature propre et vraie des sujets demeurés incurables. Car la loi homéopathique est vraie de toute éternité. Cette recherche fut depuis 1816, jour et nuit, le constant objet de mes occupations, dont la patience infatigable fut récompensée par la découverte du mot de cette désespérante énigme. J’en rends grâces au Ciel, au nom de l’humanité entière.
C’est dans le plus profond secret que j’ai travaillé à ce grand œuvre. Mes disciples l’ont ignoré. Le monde entier n’en devait rien savoir. Non que je voulusse conserver sur eux une prééminence magistrale, ni punir l’ingratitude et les persécutions dont les hommes ont payé les services que je leur ai rendus. J’en ai trouvé la récompense dans le bonheur d’avoir atteint le grand but auquel tendaient mes efforts. À ce silence je n’ai fait d’exceptions qu’en faveur de mes deux premiers disciples. Toutefois, sans aucune prédilection spéciale, considérant mes confidences comme un dépôt dont l’humanité eût été privée, si la mort, qui me guette à soixante-treize ans, m’eût, comme il arrive si souvent, enlevé sans m’avertir.
Un fait général fixa mon attention : j’ai vu constamment les maladies chroniques, non syphilitiques, après un traitement sévèrement homéopathique, et un succès de guérison aussi parfait qu’on pouvait le désirer, non seulement se renouveler, mais s’accompagner, à chaque récidive, d’une forme nouvelle et de symptômes nouveaux, et ce phénomène reparaître plus ou moins promptement après chaque nouvelle guérison. J’en ai tiré cette première conclusion : que le médecin homéopathe, dans le traitement de ces maladies, ne peut se borner à saisir l’ensemble des formes extérieures du mal ; que ces formes qui suffisent partout ailleurs, comme le démontrent l’expérience et le succès des cures, ne composent point ici un tout parfait et indépendant, mais bien seulement une fraction du mal détachée d’un mal plus profond et fondamental, ayant une sphère d’action et de position plus étendue, dont on peut reconnaître la vérité d’existence par les symptômes nouveaux qu’on lui voit développer successivement : par conséquent, que c’est à rechercher et à connaître la totalité de cette sphère d’action, dans la diversité des symptômes qui en caractérisant le vice fondamental, le montrent, à chacun des cas particuliers, différent de lui-même, que peut s’attacher l’espoir de le détruire, espoir que peut seul réaliser la découverte d’un ou plusieurs médicaments, dont les symptômes puissent répondre à la multiplicité de ceux propres à ce vice fondamental, de manière à embrasser la totalité de sa sphère, par conséquent aussi toutes ses fractions particulières multiples, c’est-à-dire, toutes les fausses individualités qu’il engendre, fausseté si clairement démontrée par le défaut de solidité et de durée des guérisons qui en ont été opérées.
Ces prémisses une fois admises, je me demandai quelle pouvait être la nature de ce vice, source de tant de maladies. L’homéopathie s’est interdit la recherche de la nature des causes internes de nos maux ; mais elle est d’autant plus curieuse d’en connaître la cause occasionnelle : je ne peux leur en supposer d’autres qu’un miasme que j’appellerai chronique. Il est, en effet, de l’essence du miasme chronique de ne pouvoir être dompté par les forces de la constitution la plus robuste ; il ne cède pas davantage au régime de vie le plus sévère. Enfin il ne s’éteint jamais de lui-même ; loin de là, on le voit s’accroître par les années, passer d’une forme grave à une autre forme plus grave encore, et empirer jusqu’à la mort, à la manière de toutes les maladies chroniques produites par un miasme ; soit prise pour exemple, la maladie du chancre. Ne l’a-ton pas toujours vu, lorsqu’il n’est point attaqué par le mercure, son spécifique, s’éterniser à la place qu’il occupe, ou disparaître pour engendrer les symptômes qui caractérisent une syphilis confirmée, qui résiste à toutes les forces de l’organisme, à toute la rigueur du régime de vie le plus sage, s’entoure, d’année en année, de symptômes nouveaux plus dangereux, et n’accorde au malheureux qu’elle dévore, le bienfait de la mort, qu’après lui en avoir imposé l’horreur des détails ? C’est ainsi qu’on voit la phtisie pulmonaire se changer en phrénésie 1 ; l’ulcère desséché produire l’hydropisie ou l’apoplexie ; la fièvre intermittente devenir un asthme ; les incommodités du bas-ventre transformées en maladies des articulations, ou paralysies, sans qu’il soit difficile d’apercevoir que ces maladies nouvelles n’étaient que des fractions isolées d’un vice général.
J’en étais arrivé à ce point, lorsque, en observant et scrutant toujours plus profondément les maladies chroniques, étrangères au vice syphilitique, je commençai à croire que l’obstacle à leur guérison venait de l’opinion fausse de cette individualité dont je viens de parler, tandis que presque toujours elles n’étaient qu’une des mille et une faces du miasme psorique, qui, de l’aveu des malades, leur avait préexisté, et dont ils dataient l’origine de leurs maux ; et, lorsque cet aveu ne pouvait être obtenu, soit que le malade n’eût point fait de remarques, ou qu’il les eût oubliées, il finissait néanmoins par ressortir, ou de mes propres recherches, ou des observations du malade lui-même, qui se rappelait avoir éprouvé de légères éruptions psoriques ou dartreuses, signe indicatif et dénonciateur d’une infection précédente de cette nature.
Si l’on rapproche ce que je viens de dire, des observations faites par les médecins de tous les temps, auxquelles je pourrais joindre les miennes propres, que la rétrocession du vice psorique a jeté des hommes de la plus belle santé, dans des accidents semblables à ceux qui accompagnent les maladies chroniques, on conviendra qu’il ne devait plus me rester de doute sur l’espèce d’ennemi caché que j’avais à combattre dans leur traitement.
Il ne s’agissait plus que de trouver des médicaments plus efficaces contre un mal père de tant d’autres maux, mal que je nommerai d’un terme générique la psore, vice galeux interne avec ou sans société éruptive. Mes épreuves ne furent point infructueuses. L’emploi que j’en fis dans le traitement de maladies chroniques semblables, que le malade ne pouvait attribuer à aucune contagion de cette nature, ayant été suivi du succès, il me fut démontré que ces affections reconnaissaient pour principe le vice psorique, contracté peut-être encore au berceau, ou plus tard, mais sans en avoir conservé aucun souvenir : ce que je parvenais assez souvent à vérifier, en consultant les père et mère ou autres membres de la famille.
Dans le cours de onze années consacrées à ces recherches pénibles, une inquisition rigoureuse de la vertu curative des moyens anti-psoriques découverts et éprouvés, m’apprit combien nombreuses sont les maladies, tant légères que graves, et très graves, qui relèvent de la psore.
Ainsi j’accuse la psore, non seulement de toutes ces éruptions cutanées dont Villau s’est donné la peine de distinguer tant d’espèces différentes, en assignant à chacune d’elles un nom particulier, mais encore de toutes ces végétations dont se couvre la peau, depuis la simple verrue jusqu’au tophus sébacée le plus volumineux, depuis le plus léger panaris jusqu’au gonflement des os, sans excepter les déviations de la colonne épinière et le ramollissement du système osseux, quelque soit l’âge où ces monstruosités paraissent : je lui impute de même les hémorragies nasales, celles de l’anus, ainsi que les engorgements hémorroïdaux, l’hémoptysie, le vomissement et pissement de sang, comme aussi la suppression, l’irrégularité, la surabondance du flux menstruel, les sueurs nocturnes, l’aridité de la peau, le dévoiement chronique, la constipation permanente, les douleurs et convulsions périodiques ; en un mot, cette innombrable cohorte de souffrances chroniques, que la pathologie a revêtues de dénominations diverses, je la regarde comme la progéniture légitime du protée de la psore.
Il en est de l’épidémie chronique de la psore, comme de l’épidémie d’un typhus aigu, qui ravage toute une contrée. Je prendrai pour exemple celui qui régna à Leipzig en 1813, auquel j’ai assisté.
Les symptômes formant l’image parfaite de la maladie étaient nombreux. Cependant chacun des malades n’en offrait qu’un petit nombre, réunis dans son individualité pathologique. Ils variaient chez chacun d’eux, sans doute en raison des diversités constitutionnelles. Et néanmoins, malgré cet isolement des symptômes, l’expérience prouva que chaque fraction du mal, traitée comme le tout complexe de la maladie, cédait à l’influence des deux remèdes qui renfermaient son image complète. La Bryone et le Rhus toxicodendron se montrèrent spécifiques contre toutes les formes du fléau.
Pourquoi n’en serait-il pas de même dans les affections chroniques du corps et de l’âme, qui sont étrangères aux vices de la syphilis et de la sycosis ? La psore, comme le typhus, engendre une foule de symptômes dont la réunion forme un tout, un corps complet, qu’il ne sera jamais donné d’apercevoir tout entier sur un seul et même sujet ; mais les fractions dans lesquelles il se divise, sont le résultat nécessaire de la diversité des constitutions. L’homme de l’art, pour composer le portrait ressemblant de la maladie, est obligé, comme il l’a été dans l’épidémie typhoïde, d’envisager un grand nombre de malades, chacun d’eux ne présentant que quelques traits isolés de ce portrait. Mais ces traits, tout isolés qu’ils sont, ne sont pas moins les traits du vice original général, qui, participant de sa nature, doivent, dans leur isolement du tout, être attaqués comme le tout lui-même, par un ou plusieurs médicaments dont les symptômes renferment la totalité des symptômes qu’il est susceptible de développer.
J’ai dit, il n’y a qu’un instant, que les maladies chroniques abandonnées à elles-mêmes, et qu’un mauvais traitement n’a point empirées, montraient une telle persévérance et une telle durée, que, lorsqu’elles étaient développées, et non radicalement guéries, on les voyait d’année en année s’aggraver, et résister opiniâtrement à toutes les forces de l’organisme, secondées par le régime de vie le plus sévère ; la nature étant sans puissance pour opérer leur destruption, elles croissent, grandissent et se terminent par la mort. Il faut donc qu’elles aient pour principe un miasme chronique immuable, qui alimente sans cesse leur existence parasite dans l’organisme.
On ne connaît guère en Europe que trois miasmes chroniques, dont les maladies qui en procèdent se montrent accompagnées d’un symptôme local, et qui soient la source de la plus grande partie des maux chroniques qui affligent l’humanité. C’est la syphilis que je nomme maladie du chancre, la sycosis, ou miasme des excroissances ou fics ; enfin, le miasme qui produit les éruptions galeuses, la psore, la plus importante des trois, qui, pour cette raison, va nous occuper avant toutes choses 2.
Le plus ancien, le plus généralement répandu, le plus dangereux et tout à la fois le moins connu des miasmes chroniques, c’est la psore. Elle tourmente et défigure les peuples depuis la plus haute antiquité ; mais surtout depuis les derniers siècles, elle est devenue la mère d’une foule de maladies, tant aiguës que chroniques, à la multiplication desquelles la civilisation de l’espèce humaine a beaucoup contribué, comme la syphilis et la sycosis, lorsqu’elle n’est point radicalement guérie ; elle traverse toute la carrière de la vie de l’homme, bravant les forces de la constitution la plus robuste, ne s’épuisant jamais d’elle-même, mais plus féconde que ces deux premiers miasmes, en douleurs et en infirmités ; c’est à son antiquité que ce miasme doit ce funeste privilège ; c’est pour avoir traversé des millions d’organismes, qu’il a acquis cette sphère d’action immense, qui permet à peine de nombrer les formes qui appartiennent à ces maladies, dont quelques-unes ont reçu des noms, et d’autres sont restées non dénommées, les unes et les autres prenant leur véritable et unique source dans la psore rentrée et dégénérée.
Les plus anciens monuments historiques parlent déjà de la psore, comme d’une maladie complètement formée. Moïse 3 il y a 3 400 ans, dépeint plusieurs dégénérations de ce miasme. Cependant, de son temps, et toujours depuis lui, la psore semble avoir eu son principal siège sur les parties extérieures du corps, phénomène également particulier à la Grèce encore sauvage et grossière, et qui se fit remarquer plus tard chez les Arabes ; enfin, dans l’Europe non cultivée du moyen-âge. Qu’importent les noms divers que les divers peuples donnèrent aux symptômes extérieurs et cutanés de la psore, lorsque l’essence de ce miasme producteur des démangeaisons, est demeurée invariable !
La psore, après avoir, dans le moyen-âge, où elle se montrait en Europe sous la forme d’un érysipèle malin, développé pendant plusieurs siècles les accidents les plus graves, reprit, en se combinant avec le miasme lépreux que les croisés rapportèrent, la figure de la lèpre.
Néanmoins, quoique cette circonstance contribua à sa propagation (car, en l’an 1226, la France comptait deux mille hôpitaux de galeux,) la psore perdit peu à peu de sa difformité extérieure, ce que l’on doit attribuer à l’usage du lin et du fil que ces mêmes croisés rapportèrent des contrées de l’Orient en Europe. On adopta les chemises faites de ces matières nouvelles, on introduisit l’usage des bains chauds, et ces deux moyens, aidés par les progrès de la civilisation qui amena une propreté plus grande, une nourriture plus saine, dépouillant le miasme de son hideux aspect, le réduisirent à n’être plus au 15e siècle, que l’éruption pustuleuse que nous voyons tous les jours.
Mais pendant que l’humanité s’affranchissait de ce fléau, un autre fléau non moins redoutable franchissait les portes de sa prison, et rompant ses chaînes, fondit de l’Amérique sur l’Europe : l’ancien monde reçut la syphilis.
Ainsi ramenée à la forme extérieure de l’éruption galeuse que nous connaissons, la psore, communiquée, fut plus facile à faire disparaître de la peau, aussitôt après l’infection. L’empirisme, l’art lui-même, ont conseillé des traitements extérieurs, propres à débarrasser promptement la peau de ce vice, tels que les bains, lotions, frictions, dont le soufre, le plomb, le cuivre, le zinc et le mercure formaient plus ou moins les bases. Souvent l’extinction en survenait avec tant de facilité, qu’elle jetait dans le doute, si l’enfant ou la personne adulte avaient véritablement été atteints du vice psorique, L’humanité, sous beaucoup de rapports, perdit plus qu’elle ne gagna à cet état de choses.
Il est bien vrai que, avant la découverte des remèdes que je viens de nommer, la psore, conservant encore son caractère lépreux, tourmentait davantage ceux qui en étaient infectés, de ses élancements douloureux, ainsi que de sa démangeaison brûlante ; mais une compensation leur était réservée, dans le maintien de la santé générale du corps à la surface duquel le vice était opiniâtrément attaché ; car on ne peut se dispenser de considérer le symptôme extérieur de ce vice, non seulement comme le signe de la saturation psorique de tout l’organisme, mais encore comme un grand exutoire qui veille à la garde de l’harmonie organique, et, en quelque sorte, comme le modérateur des désordres cachés du miasme : de plus, la vue des lépreux, si propre à inspirer la crainte ainsi que le dégoût, fit penser à se séparer soigneusement de leur société, mesure dont l’effet fut d’arrêter, ou tout au moins de ralentir la propagation du mal.
Quel fut au contraire, le résultat de ces cures extérieures, inventées dans les 14me et 15me siècles ? À la vérité les formes extérieures de la psore se sont adoucies. L’infection ne produit plus que des boutons peu remarquables, et très faciles à voiler ; mais l’insupportable démangeaison qui porte à les gratter, en fait sortir une humidité qui s’attache à tout, et communique invisiblement la contagion, ce qui explique cette propagation infinie, que l’on ne voyait point dans les temps antérieurs, où le miasme était revêtu de ses difformités primitives. C’est donc avec raison que je considère la psore comme le miasme chronique le plus contagieux et le plus généralement répandu. Ajoutez à cela que la classe inférieure du peuple, moins soucieuse de propreté, moins soigneuse de sa santé, ne pense que fort tard à se défaire de ce vice, ce qui lui donne le temps de répandre d’autant plus la contagion.
Je crois avoir démontré suffisamment que les modifications que la psore a éprouvées, en passant des formes de la lèpre au caractère connu de la gale, se sont opérées au préjudice de l’humanité. Si l’on considère maintenant que ce vice, en perdant ses premières formes, n’a point changé de nature, et que la facilité avec laquelle on fait disparaître son symptôme extérieur, ne contribue qu’un peu plus encore à le répandre dans l’intérieur de l’organisme, on cessera de s’étonner que cette disparition du symptôme local ait donné lieu au développement de cette foule de symptômes secondaires, qui constituent les maladies chroniques. La médecine n’en pouvait soupçonner ni deviner la source, et par conséquent les laissait sans guérison. Et comment l’aurait-elle opérée, lorsque la psore encore accompagnée de son symptôme local, non seulement échappait à leurs traitements, mais s’aggravait et empirait sous l’influence des fautes nombreuses qui les accompagnaient ?
Malheureusement le symptôme extérieur de la gale est susceptible de disparaître de lui-même, sans avoir besoin, pour quitter la peau, des traitements vicieux de l’empirisme, et de l’art lui-même, comme on peut s’en convaincre ci-après, enlisant les observations des médecins anciens. Voyez les nos 9, 18, 26, 35, 50, 58, 61, 64 et 65 dans la relation qui va suivre. La syphilis et la sycosis ont toutes deux sur le miasme psorique un grand avantage ; c’est que, dans la première, le chancre ou le bubon, dans la seconde, l’excroissance verruqueuse ne quittent leur siège extérieur, que lorsque l’un et l’autre en ont été déplacés par la violence externe, ou par l’extinction du vice qui leur a donné naissance. Dans ce dernier cas, les symptômes consécutifs de ces maladies ne peuvent pas exister, car il n’y a point d’effets sans cause. On sera étonné peut-être aussi de m’entendre dire qu’ils n’apparaîtront pas davantage, tant que les symptômes locaux n’auront point disparu. J’ai avancé plus haut que les symptômes locaux sont tout à la fois, et la physionomie de toutes les maladies, et l’exutoire qui porte au-dehors tous les produits du vice intérieur. Tant qu’ils ne sont point contrariés par des vices de traitement, ou effacés par d’autres causes, le chancre et la verrue restent permanents, et préviennent le développement des symptômes secondaires, jusqu’à ce que, attaqué par des remèdes spécifiques, le miasme souterrain qui les a produits et les entretient, soit expulsé de l’organisme, qu’il quitte, emportant avec lui l’enseigne de son existence.
La psore, descendue de la forme lépreuse à la simple éruption connue, est loin d’avoir, depuis les trois derniers siècles que s’est opérée cette modification, ce côté avantageux. Combien plus mobile que le chancre et la verrue, n’est pas l’éruption psorique ! non seulement elle obéit avec facilité aux méthodes curatives, tant internes qu’externes, qui la déplacent ; mais encore une foule d’accidents de la vie en déterminent la déviation, tels qu’un événement funeste, physique ou moral, une vive épouvante, un chagrin constant, un refroidissement, comme l’indique l’observation 67, les bains chauds, tièdes ou froids, une fièvre éventuelle ou toute autre maladie, la variole, observation 39. Un dévoiement de quelque durée, peut-être un certain état d’inertie de la peau, ne sont pas moins propres à opérer ce déplacement qui, pour reconnaître une autre cause qu’un mauvais traitement, n’en opèrent pas moins tôt ou tard le développement des symptômes secondaires de la psore, c’est-à-dire la foule des maux chroniques qui affligent l’humanité.
C’est à tort que l’on croit que la psore, réduite à une simple éruption, diffère, par cette modification, essentiellement de la lèpre. L’identité de leur nature se démontre par l’identité des maladies aiguës ou chroniques auxquelles la rétrocession de cette dernière donnait lieu. (Voyez l’observation 35.) Mais alors, comme aujourd’hui, les médecins ne songeaient point à voir dans ces maladies les conséquences de traitements qu’ils croyaient être suffisamment efficaces. Ces cas, néanmoins, étaient plus rares dans l’antiquité, la lèpre étant, lorsqu’elle avait vieilli, moins mobile, plus opiniâtrément attachée à la peau.
Sans doute, l’antiquité a connu les maux de nerfs, les douleurs erratiques, les crampes, les ulcères malins et cancéreux, l’atonie, la paralysie, la consomption ; les difformités de l’esprit et du corps ne lui étaient pas plus inconnues qu’à nous-mêmes, bien qu’alors la psore tînt plus opiniâtrement son symptôme adhérent à l’organe cutané. Mais combien davantage l’humanité n’est-elle pas grevée de tous ces maux, depuis que les siècles derniers ont appris à refouler au-dedans l’humeur psorique, par des traitements qui suppriment le courant extérieur du vice interne, ainsi forcé de développer ses symptômes secondaires 4.
C’est ainsi que la psore est devenue la mère de presque toutes les maladies chroniques ; je lui en attribue les sept huitièmes, assignant pour cause au dernier huitième, la syphilis et la sycosis. De plus la combinaison de deux de ces trois miasmes, et quelquefois leur triple complication. Si la syphilis, que guérit si facilement une petite dose de mercure, si la sycosis, qui ne résiste pas davantage à deux petites doses de thuya occidental, alternées avec un peu d’acide nitrique, offrent quelquefois des obstacles à leur guérison, c’est que, sans que l’homme de l’art le soupçonne, ces deux miasmes sont compliqués avec la psore, de toutes les maladies la plus méconnue, par conséquent traitée de la manière la plus préjudiciable.
Telle fut jusqu’à ce jour la doctrine de l’école : professeurs, praticiens, écrivains, tous, sans aucune exception, ont enseigné que toute éruption psorique n’est qu’une maladie locale à laquelle le reste de l’organisme ne prend aucune part ; qu’il est, en conséquence, innocent de l’effacer de la peau, opération à laquelle ils emploient et conseillent d’employer le soufre, le plomb, le zinc, et même le mercure, afin de s’en débarrasser au plus vite ; qu’à la vérité un trop long séjour de ce vice sur l’organe cutané peut lui fournir l’occasion de s’introduire dans l’organisme par l’absorption, et que, dans ce cas même, à l’aide des moyens dépurants et purgatifs, il est facile d’en purifier le sang, et de faire disparaître les accidents auxquels cette résorption peut avoir donné lieu ; mais qu’ils peuvent être facilement évités, en détruisant encore à temps le vice local, seul moyen de prévenir les dégénérations de ce miasme.
Ces erreurs funestes à l’humanité, règnent encore aujourd’hui despotiquement, dans les chaires académiques, ainsi que dans les hospices de la clinique ; la célébrité médicale leur rend le même hommage que la médiocrité elle-même. Personne ne doute que, prise à temps, attaquée dès, son apparition, la psore n’ait pu encore vicier le sang, désaccorder l’organisme. Que n’en est-il ainsi ? nous verrons plus bas, que le premier bouton psorique, accompagné de sa démangeaison désagréablement voluptueuse, et suivi du sentiment d’une douleur brûlante, si l’on y touche, est la déclaration même de la saturation de l’organisme par le miasme.
Ainsi donc, il est aussi peu raisonnable de refouler le symptôme local vers les profondeurs, qu’il le serait à de prétendre soulager la variole, en fermant à la nature la voie qu’elle a ouverte au vice variolique. On sait trop quels accidents épouvantables succèdent à la rétrocession de ce dernier miasme. Pour n’avoir point la même acuité, les symptômes secondaires de la psore n’en ont peut-être que plus d’opiniâtreté. Il n’est pas rare même que la mort suive incontinent et punisse l’imprudence qui a dicté de semblables traitements ; j’en appelle à l’expérience de tous.
Cependant on croit être dans le chemin de la vérité, et si, tôt ou tard, mais inévitablement, ces guérisons trompeuses sont suivies d’accidents qu’on n’avait point encore connus, tels que les maladies d’enflure, de douleurs rebelles, des affections hypocondriaques ou hystériques, et arthritiques, l’amaigrissement, la pulmonie, l’asthme constant ou périodique, la cécité, la surdité, la paralysie, la carrie osseuse, le cancer, les convulsions, l’hémorragie et les troubles de l’esprit, loin d’en accuser un traitement réputé sage et prudent, on soupçonne toute autre chose. On rêve une cause à ces affections nouvelles, et le fantôme morbifique qu’on a mis à la place d’une vérité que l’on désespère de connaître, est combattu sans relâche par toutes les ressources connues d’une thérapeutique qui ne repose que sur l’hypothèse, jusqu’à ce que le malade, dont les maux ne peuvent que s’accroître, en trouve la délivrance dans la mort, échappant ainsi à la maladie et à l’homme de l’art qui l’empirait.
Fortuitement, il a pu arriver qu’un mal inconnu, rebelle à toutes les épreuves de curation, ait trouvé de l’amendement dans l’usage des bains sulfureux ; plus souvent encore, que la maladie, changeant de formes sous l’influence de ces bains, en revêt de nouvelles plus douces, ce qui décide à en répéter l’usage, sans qu’on ait vu se répéter le même succès, ce dont on cessera de s’étonner, dès que l’on saura que le soufre, si spécifique à l’origine de la psore, est insuffisant contre les symptômes secondaires de ce miasme répercuté et dégénéré.
Les anciens procédaient avec plus de conscience, observaient avec plus d’impartialité. De nombreuses expériences leur avaient appris que l’extinction du symptôme cutané était suivie de maux sans nombre. Ils en conclurent qu’ils avaient affaire avec une maladie intérieure, et cherchaient à la détruire avec tous les remèdes internes que pouvait leur offrir leur matière médicale. Si leurs efforts furent inutiles, la faute en est à l’ignorance d’une véritable méthode curative, qu’il était réservé à l’homéopathie de découvrir.
Toutefois il faut les louer de cette vue diagnostique : la psore n’était point pour eux une affection purement locale, comme le prouvent les nombreuses observations qu’ils nous ont laissées. J’en citerai quelques-unes, auxquelles je pourrais joindre les miennes propres, si déjà les leurs ne suffisaient pour démontrer avec quelle violence la psore interne se développe, lorsqu’elle est privée de son symptôme local, et combien il importe de ne voir en elle qu’une affection intérieure de l’organisme, dont le signe extérieur disparaît aussitôt que le miasme, auquel il doit son existence, a cédé à un traitement régulier. On y verra combien nombreuses et variées sont les maladies tant aiguës que chroniques, résultats des traitements dirigés par la manière de voir, opposée au point de vue dont je pars pour envisager cette affection. On y verra la fausseté de l’opinion qui rejette tous ces maux sur la rétrocession de ce miasme, tandis qu’on ne doit y voir qu’une suraddition du vice externe au vice intérieur déjà préexistant, et surchargé, par cette fausse guérison, de la fraction miasmatique qui lui servait de déchargeoir, au grand avantage de tout l’organisme.
Avant d’exposer l’opinion des anciens sur cet important objet, je citerai Louis-Chrétien Juncker, et sa Dissertation De damno ex scabie repulsâ