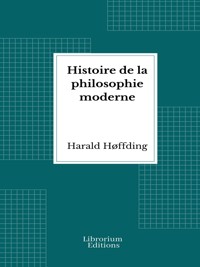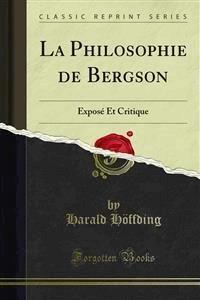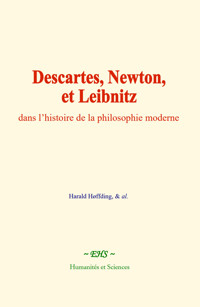
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Trois philosophes partageaient en Europe l’honneur d’y avoir rappelé les lumières, Descartes, Newton et Leibnitz ; et ceux qui n’avaient point approfondi les sciences plaçaient Malebranche presque sur la même ligne.
Descartes fut un très grand géomètre. L’idée, si heureuse et si vaste, d’appliquer aux questions géométriques l’analyse générale des quantités, changea la face des mathématiques ; et cette gloire, il ne la partagea avec aucun des géomètres de son temps, qui cependant fut très fécond en hommes doués d’un grand génie pour les mathématiques…
Newton a l’honneur, unique jusqu’ici, d’avoir découvert une des lois générales de la nature ; et, quoique les recherches de Galilée sur le mouvement uniformément accéléré, celles de Huygens sur les forces centrales dans le cercle, et surtout la théorie des développées, qui permettait de considérer les éléments des courbes comme des arcs de cercle, lui eussent ouvert le chemin, cette découverte doit mettre sa gloire au-dessus de celle des philosophes ou des géomètres qui même auraient eu un génie égal au sien. Kepler n’avait trouvé que les lois du mouvement et des corps célestes ; et Newton trouva la loi générale de la nature dont ces règles dépendent. La découverte du calcul différentiel le place au premier rang des géomètres de son siècle ; et ses découvertes sur la lumière, à la tête de ceux qui ont cherché dans l’expérience le moyen de connaître les lois des phénomènes.
Leibnitz a disputé à Newton la gloire d’avoir trouvé le calcul différentiel ; et, en examinant les pièces de ce grand procès, on ne peut sans injustice refuser à Leibnitz au moins une égalité tout entière. Observons que ces deux grands hommes se contenteront de l’égalité, se rendirent justice, et que la dispute qui s’éleva entre eux fut l’ouvrage du zèle de leurs disciples…
À PROPOS DE L'AUTEUR
Harald Høffding, né le 11 mars 1843 à Copenhague et décédé le 2 juin 1931 dans cette même ville, est un philosophe danois. Il développe tout au long de son œuvre une doctrine à la fois positiviste et critique, dans la continuation du criticisme kantien et en rupture avec le matérialisme réductionniste. Il est associé à la théorie du parallélisme psychophysique dont il a contribué à la diffusion dans l'Europe de la fin du XIXe siècle.
Harald Høffding est diplômé de théologie en 1865, date à laquelle il séjourne à Paris pour suivre les cours d'Hippolyte Taine et y étudier la philosophie. Il est reçu docteur en philosophie en 1870, maître de conférences à l'université de Copenhague en 1880 avant d'y être nommé professeur extraordinaire en 1883, où il enseigne jusqu'en 1915. Il est président de cette même université entre 1902 et 1903. Il est membre de l'Académie royale des Sciences et des Lettres à partir de 1884. Premier habitant d'honneur de la Fondation Carlsberg en 1914, il assume de 1917 à 1921 la présidence de la Croix-Rouge danoise.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 189
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Descartes, Newton, et Leibnitz
Descartes, Newton, et Leibnitz
dans l’histoire de la philosophie moderne
Introduction{1}
Trois philosophes partageaient en Europe l’honneur d’y avoir rappelé les lumières, Descartes, Newton et Leibnitz; et ceux qui n’avaient point approfondi les sciences plaçaient Malebranche presque sur la même ligne.
Descartes fut un très grand géomètre. L’idée, si heureuse et si vaste, d’appliquer aux questions géométriques l’analyse générale des quantités, changea la face des mathématiques ; et cette gloire, il ne la partagea avec aucun des géomètres de son temps, qui cependant fut très fécond en hommes doués d’un grand génie pour les mathématiques, tels que Cavalleri, Pascal, Fermat, et Wallis.
Quand même Descartes devrait à Snellius la connaissance de la loi fondamentale de la dioptrique, ce qui n’est rien moins que prouvé, cette découverte était restée absolument stérile entre les mains de Snellius ; et Descartes en tira la théorie des lunettes : on lui doit celle des miroirs et des verres, dont les surfaces seraient formées par des arcs de sections coniques. Il découvrit, indépendamment de Galilée, les lois générales du mouvement, et les développa mieux que lui ; il se trompa sur celles du choc des corps, mais il a imaginé le premier de les chercher, et il a montré quels principes on devait employer dans cette recherche. On lui doit surtout d’avoir banni de la physique tout ce qui ne pouvait se ramener à des causes mécaniques ou calculables, et de la philosophie l’usage de l’autorité.
Newton a l’honneur, unique jusqu’ici, d’avoir découvert une des lois générales de la nature ; et, quoique les recherches de Galilée sur le mouvement uniformément accéléré, celles de Huygens sur les forces centrales dans le cercle, et surtout la théorie des développées, qui permettait de considérer les éléments des courbes comme des arcs de cercle, lui eussent ouvert le chemin, cette découverte doit mettre sa gloire au-dessus de celle des philosophes ou des géomètres qui même auraient eu un génie égal au sien. Kepler n’avait trouvé que les lois du mouvement et des corps célestes ; et Newton trouva la loi générale de la nature dont ces règles dépendent. La découverte du calcul différentiel le place au premier rang des géomètres de son siècle ; et ses découvertes sur la lumière, à la tête de ceux qui ont cherché dans l’expérience le moyen de connaître les lois des phénomènes.
Leibnitz a disputé à Newton la gloire d’avoir trouvé le calcul différentiel ; et, en examinant les pièces de ce grand procès, on ne peut sans injustice refuser à Leibnitz au moins une égalité tout entière. Observons que ces deux grands hommes se contenteront de l’égalité, se rendirent justice, et que la dispute qui s’éleva entre eux fut l’ouvrage du zèle de leurs disciples. Le calcul des quantités exponentielles, la méthode de différencier sous le signe, plusieurs autres découvertes trouvées dans les lettres de Leibnitz, et auxquelles il semblait attacher peu d’importance, prouvent que, comme géomètre, il ne cédait pas en génie à Newton lui-même. Les idées sur la géométrie des situations, ses essais sur le jeu du solitaire, sont les premiers traits d’une science nouvelle qui peut être très-utile, mais qui n’a fait encore que peu de progrès, quoique de savants géomètres s’en soient occupés. Il fit peu en physique, quoiqu’il sût tous les faits connus de son temps, et même toutes les opinions des physiciens, parce qu’il ne songea point à faire des expériences nouvelles. Il est le premier qui ait imaginé une théorie générale de la terre, formée d’après les faits observés, et non d’après des dogmes de théologie ; et cet essai est fort supérieur à tout ce que l’on a fait depuis en ce genre.
Les grands systèmes dans l’histoire de la philosophie moderne{2}
À l’ère des idées nouvelles et des découvertes succède l’époque des tentatives pour ordonner et pour systématiser, pour ramener la foule des pensées et des faits à des pensées fondamentales, simples et solides. Ces tentatives furent faites dans la ferme confiance que la vraie base était trouvée. L’analyse fut remplacée par la construction. Cela eut cette grande importance pour la pensée qu’elle put maintenant mettre en plein jour le contenu des conceptions établies par la Renaissance et par la nouvelle science de la nature. Celles-ci furent fixées avec une sûreté dogmatique inconnue aux esprits de l’époque précédente, qui ne se rendaient pas un compte exact des divers principes et de leur portée. On formulait maintenant en toute connaissance de cause ce qui auparavant n’avait été qu’une vision plus ou moins confuse. Et à l’aide de ces hypothèses ainsi formulées, on construisit des systèmes qui tous avaient la prétention de remplacer le vieux système scolastique, auquel le coup de grâce fut seulement donné alors. Cependant, la tendance à obtenir une conclusion absolue de la connaissance, à tranquilliser la pensée par un principe ne renfermant plus lui-même de problème, était un héritage de la scolastique ; on voulait élever l’édifice nouveau à la hauteur de l’édifice abattu. L’impulsion naturelle, toujours plus ou moins active dans l’esprit humain, qui pousse à enchaîner toutes les idées supposées valables, se manifesta alors avec une vivacité, une énergie et une puissance géniales que l’on chercherait en vain dans les autres périodes de l’histoire de la philosophie moderne. Cela tient à ce que l’on se posait des problèmes qui, avant ou après, ne présentèrent pas la même nouveauté, ni la même acuité. On voulait fondre le nouveau système du monde et la science nouvelle avec le reste du contenu de l’esprit déjà établi pour la conscience. Voilà pourquoi le problème de l’existence devait figurer en première ligne. Bruno l’avait traité sur la base de la nouvelle conception du monde. Mais la nouvelle explication mécanique de la nature était venue s’y ajouter, et du même coup se posait à la pensée le grand problème des rapports de la matière et de l’esprit. Les hypothèses les plus importantes que l’on peut émettre sur ces rapports furent établies par les systèmes du XVIIe siècle avec une clarté et une force qui prêtent à ces tentatives intellectuelles une valeur durable. Toutefois d’autres problèmes furent combinés avec celui-ci. Le problème des rapports de Dieu avec le monde passe même pendant un certain temps au premier plan. À celui-ci se rattache encore le problème de l’unité ou de la multiplicité de l’existence. Et enfin la question de savoir dans quelle mesure l’explication mécanique de la nature permet d’attribuer à la notion de fin une signification positive devient un problème important.
Le problème de la connaissance et le problème de l’estimation des valeurs s’effacent devant le problème de l’existence, tout en exerçant une influence de tous les instants ; ils jouent le rôle de ressorts plus ou moins conscients et de forces d’impulsion. Chez Descartes, le premier dans la série des grands systématiques, se montre encore, même dans le style, la tendance évidente à trouver par analyse la voie pour la pensée constructive. Chez Hobbes et chez Spinoza, l’analyse est obscurcie par la construction. Avec Leibniz, la tendance analytique recommence à prendre le dessus — transition à l’importance prépondérante que le problème de la connaissance et le problème de l’estimation des valeurs devaient avoir au xviiie siècle.
L’histoire de la civilisation offre au xviie siècle une certaine analogie avec la tendance à conclure systématiquement qui fut pendant cette période la direction principale de la philosophie. Une même disposition dominante pénètre les différents domaines de la politique, de l’Église et de la pensée. C’est le siècle de la souveraineté absolue de l’État. L’État s’est émancipé de la tutelle de l’Église et réclame maintenant une soumission complète de l’individu et des petits groupements.
Le principe de la souveraineté est même développé sous ses formes extrêmes par les deux penseurs précisément qui marquent l’apogée de la construction. L’individu recherche alors le calme et la sécurité après les tourmentes de la Renaissance et de la Réforme. Beaucoup sont attirés par la contemplation et le mysticisme. Un penchant au quiétisme se fait sentir. Mais ces inclinations se satisfont dans les systèmes philosophiques par l’élaboration réfléchie des nouvelles idées et des découvertes. Elles prenaient ainsi l’importance d’expériences de nature à éprouver la portée de courants d’idées considérables.
1. René Descartes
a) Biographie et caractéristique.
Le fondateur de la philosophie moderne naquit le 31 mars 1596 dans une famille noble de la Touraine. Maladif, il trahissait déjà enfant des dispositions exceptionnelles, et son père avait l’habitude de l’appeler le philosophe à cause du grand nombre de questions qu’il posait. Pour recevoir une éducation soignée il entra au collège de jésuites de la Flèche, fondé depuis peu par Henri IV. Par la suite il se souvint toujours avec reconnaissance de ses anciens maîtres, et lorsque les jésuites prirent parti contre sa philosophie, il en conçut un grand chagrin. Il apprit à la Flèche la physique et la philosophie selon le système scolastique, mais il se livra surtout aux mathématiques. Il semble s’être préoccupé de fort bonne heure des idées qui le menèrent à sa grande découverte mathématique, la fondation de la géométrie analytique, c’est-à-dire à l’application de l’algèbre à la géométrie. Il a décrit lui-même, dans le Discours de la méthode, l’histoire de sa jeunesse, qui est en même temps la genèse de sa philosophie. Au sortir de l’école, il se sentit peu satisfait de tout ce qu’il avait appris. Il connaissait beaucoup de faits ; beaucoup de belles pensées lui avaient été transmises ; il admirait surtout la méthode rigoureuse des mathématiques. Mais ces faits et ces pensées ne lui semblaient que des fragments incohérents et les mathématiques n’étaient à ses yeux qu’une inutile chimère. Il pendit donc au croc les études et se jeta dans le tourbillon de la vie de Paris. Il ne put cependant renier entièrement son goût pour la spéculation ; parmi ses papiers se trouvait un traité sur l’escrime datant de cette époque. Il eut vite fait de se dégoûter de cette existence vide et brusquement il délaissa ses amis. Il s’était retiré dans un quartier solitaire de la ville pour étudier en paix. Dès lors son idéal fut de plus en plus de mener une vie solitaire, consacrée à la réflexion et à l’étude. Il prit pour devise : « Heureux qui a vécu caché ! » (Bene vixit, qui bene latuit !). Au bout de deux ans, ses amis le retrouvèrent et l’arrachèrent à la solitude. Il résolut alors d’étudier le « grand livre du monde ». Peut-être la vie pratique, qui met à l’épreuve toutes les pensées, apprendrait-elle aux hommes les vérités que de savantes spéculations ne peuvent faire découvrir. Du reste il voulait s’éprouver lui-même sous les coups du sort. Il entra comme volontaire à ses frais au service de Maurice d’Orange, tout en consacrant ses heures de loisir aux études, surtout aux mathématiques. De Hollande il passa en Allemagne, où la guerre de Trente ans était sur le point d’éclater. Il se joignit à l’armée rassemblée par le prince électeur de Bavière contre la Bohême révoltée. Pendant qu’il prenait ses quartiers d’hiver (1619-1620) à Neuburg sur le Danube, une crise scientifique se produisit en lui ; il trouva alors la méthode générale qui le guida par la suite dans ses études philosophiques et mathématiques. Dans une note posthume provenant de cette époque il a même indiqué la date précise du jour où naquit cette pensée décisive : « le 10 novembre 1619, lorsque rempli d’enthousiasme je trouvai le fondement d’une science admirable ». Il s’enferma dans son « poèle » et se livra à des pensées qui le menèrent à sa théorie générale de la méthode. Il lui vint à l’esprit que de même que l’œuvre commune à plusieurs hommes est généralement plus imparfaite que celle exécutée par un seul homme, de même l’imperfection de notre savoir vient du grand nombre de nos professeurs, dont chacun nous inculque ses propres opinions, de l’influence des diverses tendances, des divers jugements contradictoires que nous entendons porter par les savants et par les gens de métier. Pour remédier à cette imperfection, il faudrait recommencer par le commencement, faire abstraction de la tradition et élever notre édifice lentement et sur un fondement unique. La vraie méthode consiste à n’admettre que ce qui est clairement et distinctement pensé, à décomposer chaque difficulté en ses diverses parties et à partir du plus simple et du plus facilement intelligible pour entrer ensuite pas à pas dans les questions plus complexes. Telle est la méthode analytique telle qu’elle apparut dans ses grands traits à son regard intérieur. Dans le domaine des mathématiques cette méthode le mena à l’idée d’une science plus générale que les sciences mathématiques particulières : elle devait examiner les rapports, les proportions en général, que ce soit entre des figures ou des nombres ou d’autres choses. C’était une théorie générale des grandeurs ou des fonctions dont la géométrie analytique était l’application spéciale. — Ses pensées travaillaient avec une telle ardeur à ces idées qu’il tomba dans un état d’exaltation. Il eut des rêves bizarres et le lendemain il promit à la mère de Dieu de faire un pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, afin qu’elle activât ses pensées. (Il n’accomplit toutefois ce vœu que lorsqu’une occasion favorable se présenta.) Un vœu de pèlerinage, voilà une singulière introduction à la philosophie moderne — et un pendant à la voix surnaturelle où Herbert de Cherbury entendit peu d’années après la sanction de sa « religion naturelle ! » — Mais il était encore trop tôt, croyait-il, pour procéder à l’élaboration de sa philosophie. Après avoir participé à la prise de Prague et à une campagne en Hongrie, il revint en France et prit possession de quelques domaines qui lui étaient échus en héritage. Sa famille désirait le voir se marier et occuper un poste de fonctionnaire ; mais il n’avait pas l’esprit disposé à cela. Il prit la résolution de consacrer sa vie à la science et pour pouvoir s’y livrer en paix, il passa en Hollande (1629). Il avait déjà eu à différentes reprises l’occasion de développer ses idées philosophiques, notamment sur la méthode, dans des cercles littéraires de Paris. Deux remarquables traités inachevés qui ne parurent que longtemps après sa mort : Règles pour la direction de l’esprit et Recherches de la vérité par les lumières naturelles datent certainement de cette époque. Ils présentent un exposé considérable de la méthode analytique. Durant la première période de son séjour en Hollande, il s’occupa (comme on le voit au Discours de la méthode, 3e et 4e parties) des idées spéculatives qu’il développe tout au long dans les Méditations. Il fonda là sa théologie et sa psychologie et trouva un chemin qui du doute même le mena au point de départ de toute connaissance philosophique cohérente.
Si Descartes se fixa en Hollande, ce ne fut pas seulement parce qu’il cherchait le calme et que — comme il disait — il pouvait mieux philosopher dans un climat plus froid. L’espérance d’y trouver une plus grande liberté pour ses recherches y fut aussi pour quelque chose. Le mouvement réactionnaire qui fit monter Bruno sur le bûcher et soumit l’âme de Galilée à la torture, avait gagné la France. Quelques jeunes savants ayant voulu en 1624 dans une conférence publique soutenir la théorie des atomes contre la physique d’Aristote, la faculté de théologie déclara hérétique la doctrine qui fait tout consister en atomes, car elle est contraire au dogme catholique de la Cène. La conférence fut interdite au dernier moment, alors qu’il y avait déjà un millier de spectateurs environ venus pour y assister. Les auteurs furent arrêtés et expulsés de la ville. Et le 6 septembre 1624 le Parlement défendit — sous peine de mort ! — de poser des principes contraires au témoignage des auteurs anciens, et de faire des conférences non autorisées par la faculté de théologie ! — Cela était bien fait pour rendre l’air de Paris peu supportable pour un philosophe. En Hollande, il pouvait espérer trouver une atmosphère plus libre. Outre les spéculations purement philosophiques, Descartes, se livrait dans sa nouvelle résidence à l’étude des sciences de la nature et il rédigea un ouvrage qui devait s’appeler Le monde, où il se proposait d’exposer comment le monde s’est développé et édifié, conformément à des lois purement mécaniques. Il se figurait que Dieu a créé la matière sous forme de chaos et qu’il l’a ensuite organisée d’après les lois qu’il respecte maintenant encore dans la conservation du monde. De cette façon il conciliait la foi au dogme de la création avec l’idée d’un développement accompli selon des lois naturelles, que l’on peut encore démontrer maintenant. L’application de ces lois à la formation de notre système du monde fait de lui le devancier de Kant et de Laplace. Mais alors vint la nouvelle que Galilée était condamné et que le collège inquisitorial avait réprouvé la théorie de Copernic, supposée par Descartes dans son hypothèse — et l’ouvrage fut abandonné. Il ne veut rien enseigner, écrit-il à son ami, le P. Mersenne, qui soit contraire à la foi de l’Église, et au surplus, sa devise est : heureux qui vit caché (bene vixit, qui bene latuit) ; il désire avant tout avoir la paix et éviter la crainte et les désagréments ; aussi, étant donné l’état de choses présent, veut-il se borner à étudier pour lui seul. — La belle devise de Descartes eut ainsi une vilaine application et l’on a dit avec raison que cette affaire était une tache pour son caractère. On voit à ses lettres qu’il était absolument d’accord avec les résultats de Galilée. Et bien qu’on ait tout lieu de croire que Descartes ait été un catholique sincère, on ne peut guère mettre en doute que la crainte, et encore plus peut-être le besoin de repos, lui aient surtout dicté sa retenue. Il exposa plus tard (dans les Principia philosophiæ) sa théorie de la genèse du monde — sous une forme déguisée, il est vrai. Comme dit son premier biographe, il jeta de la poudre aux yeux de l’Inquisition.
Descartes n’avait encore rien confié à la presse. Ses idées sur la philosophie et la science de la nature étaient cependant connues dans des cercles assez étendus, soit à Paris, soit en Hollande. La philosophie cartésienne — ainsi qu’on a dit avec raison — a été enseignée avant d’être étudiée dans les livres. Plusieurs de ses disciples l’exposèrent dans les Universités de Hollande. Elle provoqua des luttes violentes qui attirèrent à son auteur bien des querelles. Ce n’est qu’en 1637 que, sur les instances énergiques de ses amis, il laissa publier quatre traités. (Essays philosophiques, Leyde 1637) qui devaient donner des exemples caractéristiques de son investigation et de ses résultats. Dans le premier traité (Discours de la méthode), le seul qui ait une signification purement philosophique, il donne l’histoire de ses idées et les traits fondamentaux d’une théorie de la connaissance et d’une métaphysique nouvelles. Dans le deuxième et le troisième traités (Dioptrique, Météores) il donne l’exemple d’une explication rigoureusement mécanique de la nature, et dans le quatrième (Géométrie) il fonde la géométrie analytique. Il donna l’exposé complet de sa philosophie quelques années plus tard dans les Méditations (1640) et dans les Principia philosophiæ (1644). Il avait envoyé les Méditations en copies à plusieurs penseurs contemporains, par exemple à Antoine Arnauld, le célèbre Janséniste, à Gassendi, à Hobbes, et leurs objections furent imprimées en supplément dans l’ouvrage proprement dit avec les réponses de Descartes, ce qui lui confère un caractère de dialogue intéressant. La discussion avec Gassendi se continua assez longtemps et prit un ton passablement aigre. L’opposition de Gassendi et de Hobbes était purement philosophique et pour cette raison toujours instructive ; mais la nouvelle philosophie se heurta pour de tout autres raisons à une résistance de la part des Jésuites et du protestantisme orthodoxe. À Utrecht, à Groningue et à Leyde se livrèrent de violents combats, car les théologiens tenaient à la philosophie scolastique comme à un rempart de la foi. Enfin une interdiction des idées nouvelles fut rendue. Les Hollandais, dit Descartes dans une lettre, font plus de cas de la barbe, de la voix et de la mine des théologiens que de leur honnêteté. Il croyait les théologiens protestants pires que les catholiques. Il se trouvait entre deux feux. Les théologiens protestants l’accusaient de scepticisme, d’athéisme ; ils disaient qu’il dissolvait les Universités, l’Église et l’État, ils condamnaient en outre sa philosophie comme papiste ; et les théologiens catholiques l’accusaient non seulement d’opinions hérétiques, par exemple de croire au mouvement de la terre (ce qu’il avait essayé de cacher), mais encore de pencher vers le protestantisme et de prendre part au culte protestant.
Le dernier ouvrage de Descartes qui parut de son vivant, est l’intéressant traité des émotions (Les passions de l’âme, 1649). La naissance de ce traité est due à la princesse palatine Elisabeth (fille de Frédéric du Palatinat, le malheureux roi de Bohème), avec laquelle il entretenait une active correspondance. Il développait ses idées éthiques dans les lettres qu’il lui adressait. Il entama aussi une correspondance avec une autre princesse de talent, la reine Christine de Suède. Sur l’invitation de Christine il alla à Stockholm pour l’initier personnellement à sa philosophie. Ce séjour « au pays des ours, des glaces et des rochers » (comme il dit dans une lettre) ainsi que la vie de cour fut préjudiciable à sa santé. Un an après son arrivée il contracta une maladie qui entraîna sa mort (1650).