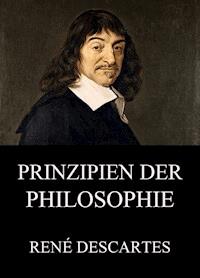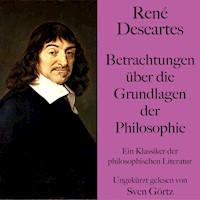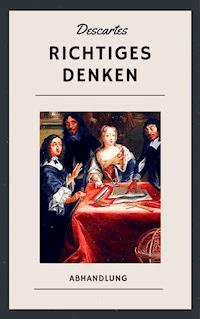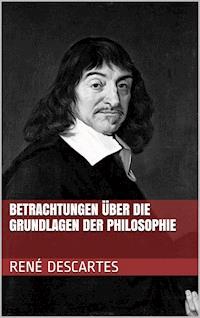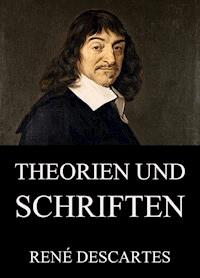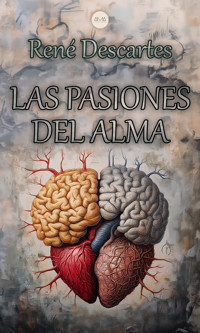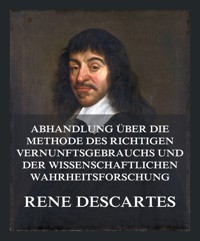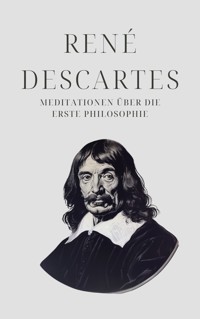Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le Discours de la Méthode, sous titré :"Pour bien conduire sa raison, et chercher la vérité dans les sciences" est un texte philosophique publié anonymement par René Descartes en juin 1637. Il devait à l'origine servir d'introduction générale aux traités scientifiques écrits par l'auteur, à savoir, la Dioptrique, les Météores et la Géométrie. Il s'agissait pour Descartes "d'en dire assez pour faire juger que les nouvelles opinions, qui se verraient dans dans la Dioptrique et les Météores, n'étaient point conçues à la légère". Toutefois, la célébrité du texte est devenue telle, qu'il est maintenant souvent publié seul, comme un essai indépendant. Il est reconnu comme l'une des oeuvres de la philosophie occidentale. Dans ce discours, Descartes expose son parcours intellectuel de façon rétrospective, depuis son regard critique porté sur les enseignements qu'il a reçus, jusqu'à sa création d'une philosophie nouvelle quelques années plus tard. Il y propose aussi une méthode, basée sur quatre règles pour éviter l'erreur et y développe une philosophie du doute, visant à reconstruire le savoir sur des fondements certains, en s'inspirant de la certitude exemplaire des mathématiques. La célèbre phrase "je pense dons je suis" (cogito, ergo sum), permet à Descartes de sortir du doute et lui servira à ce titre de premier principe. Les mathématiques suivent donc cette méthode et sont le modèle idéal qui doit être appliqué à toutes les sciences. Dans ce livre, le Discours de la Méthode est suivi de la Dioptrique, les Météores, et le Traité de Mécanique. Vous retrouverez également les 94 dessins qui accompagnent les démonstrations de Descartes. Bonne lecture.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
René DESCARTES
DISCOURS DE LA METHODE
Pour bien conduire la raison et chercher
la vérité dans les sciences.
Suivi de
LA DIOPTRIQUE
LES METEORES
Qui sont des essais de cette METHODE
Et LA MECANIQUE.
ebouquin
ÉLOGEdeRENÉ DESCARTES,
par THOMAS,
Discours qui a remporté le prix de l’académie française en 1765.
Nous réimprimons ici les notes de l’Éloge de Descartes, supprimant celles que remplit une philosophie commune et déclamatoire, et, dans presque toutes, les traits de mauvais goût qui s’y rencontrent fréquemment. Nous avons scrupuleusement conservé toute la partie biographique, propre à bien faire connaître le caractère, les habitudes et toute la carrière de Descartes.
ELOGE DE DESCARTES
Lorsque les cendres de Descartes, né en France et mort en Suède, furent rapportées, seize ans après sa mort, de Stockholm à Paris ; lorsque tous les savants, rassemblés dans un temple, rendaient à sa dépouille des honneurs qu’il n’obtint jamais pendant sa vie, et qu’un orateur se préparait à louer devant cette assemblée le grand homme qu’elle regrettait, tout-à-coup il vint un ordre qui défendit de prononcer cet éloge funèbre. Sans doute on pensait alors que les grands seuls ont droit aux éloges publics ; et l’on craignit de donner à la nation l’exemple dangereux d’honorer un homme qui n’avait eu que le mérite et la distinction du génie. Je viens, après cent ans, prononcer cet éloge. Puisse-t-il être digne et de celui à qui il est offert, et des sages qui vont l’entendre ! Peut-être au siècle de Descartes on était encore trop près de lui pour le bien louer. Le temps seul juge les philosophes comme les rois, et les met à leur place.
Le temps a détruit les opinions de Descartes, mais sa gloire subsiste. Il est semblable à ces rois détrônés qui, sur les ruines même de leur empire, paraissent nés pour commander aux hommes. Tant que la philosophie et la vérité seront quelque chose sur la terre, on honorera celui qui a jeté les fondements de nos connaissances, et recréé, pour ainsi dire, l’entendement humain. On louera Descartes par admiration, par reconnaissance, par intérêt même ; car si la vérité est un bien, il faut encourager ceux qui la cherchent.
Ce serait aux pieds de la statue de Newton qu’il faudrait prononcer l’éloge de Descartes ; ou plutôt ce serait à Newton à louer Descartes. Qui mieux que lui serait capable de mesurer la carrière parcourue avant lui ? Aussi simple qu’il était grand, Newton nous découvrirait toutes les pensées que les pensées de Descartes lui ont fait naître. Il y a des vérités stériles, et pour ainsi dire mortes, qui n’avancent de rien dans l’étude de la nature : il y a des erreurs de grands hommes qui deviennent fécondes en vérités. Après Descartes, on a été plus loin que lui ; mais Descartes a frayé la route. Louons Magellan d’avoir fait le tour du globe ; mais rendons justice à Colomb, qui le premier a soupçonné, a cherché, a trouvé un nouveau monde.
Tout dans cet ouvrage sera consacré à la philosophie et à la vertu. Peut-être y a-t-il des hommes dans ma nation qui ne me pardonneraient point l’éloge d’un philosophe vivant ; mais Descartes est mort, et depuis cent quinze ans il n’est plus ; je ne crains ni de blesser l’orgueil ni d’irriter l’envie.
Pour juger Descartes, pour voir ce que l’esprit d’un seul homme a ajouté à l’esprit humain, il faut voir le point d’où il est parti. Je peindrai donc l’état de la philosophie et des sciences au moment où naquit ce grand homme ; je ferai voir comment la nature le forma, et comment elle prépara cette révolution qui a eu tant d’influence. Ensuite je ferai l’histoire de ses pensées. Ses erreurs mêmes auront je ne sais quoi de grand. On verra l’esprit humain, frappé d’une lumière nouvelle, se réveiller, s’agiter, et marcher sur ses pas. Le mouvement philosophique se communiquera d’un bout de l’Europe à l’autre. Cependant, au milieu de ce mouvement général, nous reviendrons sur Descartes ; nous contemplerons l’homme en lui ; nous chercherons si le génie donne des droits au bonheur ; et nous finirons peut-être par répandre des larmes sur ceux qui, pour le bien de l’humanité et leur propre malheur, sont condamnés à être de grands hommes.
La philosophie, née dans l’Égypte, dans l’Inde et dans la Perse, avait été en naissant presque aussi barbare que les hommes. Dans la Grèce, aussi féconde que hardie, elle avait créé tous ces systèmes qui expliquaient l’univers, ou par le principe des éléments, ou par l’harmonie des nombres, ou par les idées éternelles, ou par des combinaisons de masses, de figures et de mouvements, ou par l’activité de la forme qui vient s’unir à la matière. Dans Alexandrie, et à la cour des rois, elle avait perdu ce caractère original et ce principe de fécondité que lui avait donné un pays libre. À Rome, parmi des maîtres et des esclaves, elle avait été également stérile ; elle s’y était occupée, ou à flatter la curiosité des princes, ou à lire dans les astres la chute des tyrans. Dans les premiers siècles de l’église, vouée aux enchantements et aux mystères, elle avait cherché à lier commerce avec les puissances célestes ou infernales. Dans Constantinople, elle avait tourné autour des idées des anciens Grecs, comme autour des bornes du monde. Chez les Arabes, chez ce peuple doublement esclave et par sa religion et par son gouvernement, elle avait eu ce même caractère d’esclavage, bornée à commenter un homme, au lieu d’étudier la nature. Dans les siècles barbares de l’Occident, elle n’avait été qu’un jargon absurde et insensé que consacrait le fanatisme et qu’adorait la superstition. Enfin, à la renaissance des lettres, elle n’avait profité de quelques lumières que pour se remettre par choix dans les chaînes d’Aristote. Ce philosophe, depuis plus de cinq siècles, combattu, proscrit, adoré, excommunié, et toujours vainqueur, dictait aux nations ce qu’elles devaient croire ; ses ouvrages étant plus connus, ses erreurs étaient plus respectées. On négligeait pour lui l’univers ; et les hommes, accoutumés depuis longtemps à se passer de l’évidence, croyaient tenir dans leurs mains les premiers principes des choses, parce que leur ignorance hardie prononçait des mots obscurs et vagues qu’ils croyaient entendre.
Voilà les progrès que l’esprit humain avait faits pendant trente siècles. On remarque, pendant cette longue révolution de temps, cinq ou six hommes qui ont pensé, et créé des idées ; et le reste du monde a travaillé sur ces pensées, comme l’artisan, dans sa forge, travaille sur les métaux que lui fournit la mine. Il y a eu plusieurs siècles de suite où l’on n’a point avancé d’un pas vers la vérité ; il y a eu des nations qui n’ont pas contribué d’une idée à la masse des idées générales. Du siècle d’Aristote à celui de Descartes, j’aperçois un vide de deux mille ans. Là, la pensée originale se perd, comme un fleuve qui meurt dans les sables, ou qui s’ensevelit sous terre, et qui ne reparaît qu’à mille lieues de là, sous de nouveaux cieux et sur une terre nouvelle. Quoi donc ! y a-t-il pour l’esprit humain des temps de sommeil et de mort, comme il y en a de vie et d’activité ? ou le don de penser par soi-même est-il réservé à un si petit nombre d’hommes ? ou les grandes combinaisons d’idées sont-elles bornées par la nature, et s’épuisent-elles avec rapidité ? Dans cet état de l’esprit humain, dans cet engourdissement général, il fallait un homme qui remontât l’espèce humaine, qui ajoutât de nouveaux ressorts à l’entendement, qui se ressaisît du don de penser, qui vît ce qui était fait, ce qui restait à faire, et pourquoi les progrès avoient été suspendus tant de siècles ; un homme qui eût assez d’audace pour renverser, assez de génie pour reconstruire, assez de sagesse pour poser des fondements sûrs, assez d’éclat pour éblouir son siècle et rompre l’enchantement des siècles passés ; un homme qui étonnât par la grandeur de ses vues ; un homme en état de rassembler tout ce que les sciences avoient imaginé ou découvert dans tous les siècles, et de réunir toutes ces forces dispersées pour en composer une seule force avec laquelle il remuât pour ainsi dire l’univers ; un homme d’un génie actif, entreprenant, qui sût voir où personne ne voyait, qui désignât le but et qui traçât la route, qui, seul et sans guide, franchît par-dessus les précipices un intervalle immense, et entraînât après lui le genre humain. Cet homme devait être Descartes. Ce serait sans doute un beau spectacle de voir comment la nature le prépara de loin et le forma ; mais qui peut suivre la nature dans sa marche ? il y a sans doute une chaîne des pensées des hommes depuis l’origine du monde jusqu’à nous ; chaîne qui n’est ni moins mystérieuse ni moins grande que celle des êtres physiques. Les siècles ont influé sur les siècles, les nations sur les nations, les vérités sur les erreurs, les erreurs sur les vérités. Tout se tient dans l’univers ; mais qui pourrait tracer la ligne ? On peut du moins entrevoir ce rapport général ; on peut dire que, sans cette foule d’erreurs qui ont inondé le monde, Descartes peut-être n’eût point trouvé la route de la vérité. Ainsi chaque philosophe en s’égarant avançait le terme. Mais, laissant là les temps trop reculés, je veux chercher dans le siècle même de Descartes, ou dans ceux qui ont immédiatement précédé sa naissance, tout ce qui a pu servir à le former en influant sur son génie.
Et d’abord j’aperçois dans l’univers une espèce de fermentation générale. La nature semble être dans un de ces moments où elle fait les plus grands efforts : tout s’agite ; on veut partout remuer les anciennes bornes, on veut étendre la sphère humaine. Vasco de Gama découvre les Indes, Colomb découvre l’Amérique, Cortès et Pizarre subjuguent des contrées immenses et nouvelles, Magellan cherche les terres australes, Drake fait le tour du monde. L’esprit des découvertes anime toutes les nations. De grands changements dans la politique et les religions ébranlent l’Europe, l’Asie et l’Afrique. Cette secousse se communique aux sciences. L’astronomie renaît dès le quinzième siècle. Copernic rétablit le système de Pythagore et le mouvement de la terre ; pas immense fait dans la nature ! Tycho-Brahé ajoute aux observations de tous les siècles ; il corrige et perfectionne la théorie des planètes, détermine le lieu d’un grand nombre d’étoiles fixes, démontre la région que les comètes occupent dans l’espace. Le nombre des phénomènes connus s’augmente. Le législateur des cieux paraît ; Képler confirme ce qui a été trouvé avant lui, et ouvre la route à des vérités nouvelles. Mais il fallait de plus grands secours. Les verres concaves et convexes, inventés par hasard au treizième siècle, sont réunis trois cents ans après, et forment le premier télescope. L’homme touche aux extrémités de la création. Galilée fait dans les cieux ce que les grands navigateurs faisaient sur les mers ; il aborde à de nouveaux mondes. Les satellites de Jupiter sont connus. Le mouvement de la terre est confirmé par les phases de Vénus. La géométrie est appliquée à la doctrine du mouvement. La force accélératrice dans la chute des corps est mesurée ; on découvre la pesanteur de l’air, on entrevoit son élasticité. Bacon fait le dénombrement des connaissances humaines et les juge : il annonce le besoin de refaire des idées nouvelles, et prédit quelque chose de grand pour les siècles à venir. Voilà ce que la nature avait fait pour Descartes avant sa naissance ; et comme par la boussole elle avait réuni les parties les plus éloignées du globe, par le télescope rapproché de la terre les dernières limites des cieux, par l’imprimerie elle avait établi la communication rapide du mouvement entre les esprits d’un bout du monde à l’autre.
Tout était disposé pour une révolution. Déjà est né celui qui doit faire ce grand changement 1 ; il ne reste à la nature que d’achever son ouvrage, et de mûrir Descartes pour le genre humain, comme elle a mûri le genre humain pour lui. Je ne m’arrête point sur son éducation2 ; dès qu’il s’agit des âmes extraordinaires, il n’en faut point parler. Il y a une éducation pour l’homme vulgaire ; il n’y en a point d’autre pour l’homme de génie que celle qu’il se donne à lui-même : elle consiste presque toujours à détruire la première. Descartes, par celle qu’il reçut, jugea son siècle. Déjà il voit au-delà ; déjà il imagine et pressent un nouvel ordre des sciences : tel, de Madrid ou de Gênes, Colomb pressentait l’Amérique.
La nature, qui travaillait sur cette âme et la disposait insensiblement aux grandes choses, y avait mis d’abord une forte passion pour la vérité. Ce fut là peut-être son premier ressort. Elle y ajoute ce désir d’être utile aux hommes, qui s’étend à tous les siècles et à toutes les nations ; désir qu’on ne s’était point encore avisé de calomnier. Elle lui donne ensuite, pour tout le temps de sa jeunesse, une activité inquiète3, ces tourments du génie, ce vide d’une âme que rien ne remplit encore, et qui se fatigue à chercher autour d’elle ce qui doit la fixer. Alors elle le promène dans l’Europe entière, et fait passer rapidement sous ses yeux les plus grands spectacles. Elle lui présente, en Hollande, un peuple qui brise ses chaînes et devient libre, le fanatisme germant au sein de la liberté, les querelles de la religion changées en factions d’état ; en Allemagne, le choc de la ligue protestante et de la ligue catholique, le commencement d’un carnage de trente années ; aux extrémités de la Pologne, dans le Brandebourg, la Poméranie et le Holstein, les contre-coups de cette guerre affreuse ; en Flandre, le contraste de dix provinces opulentes restées soumises à l’Espagne, tandis que sept provinces pauvres combattaient depuis cinquante ans pour leur liberté ; dans la Valteline, les mouvements de l’ambition espagnole, les précautions inquiètes de la cour de Savoie ; en Suisse, des lois et des mœurs, une pauvreté fière, une liberté sans orages ; à Gênes, toutes les factions des républiques, tout l’orgueil des monarchies ; à Venise, le pouvoir des nobles, l’esclavage du peuple, une liberté tyrannique ; à Florence, les Médicis, les arts, et Galilée ; à Rome, toutes les nations rassemblées par la religion, spectacle qui vaut peut-être bien celui des statues et des tableaux ; en Angleterre, les droits des peuples luttant contre ceux des rois, Charles Ier sur le trône, et Cromwel encore dans la foule4. L’âme de Descartes, à travers tous ces objets, s’élève et s’agrandit. La religion, la politique, la liberté, la nature, la morale, tout contribue à étendre ses idées ; car l’on se trompe si l’on croit que l’âme du philosophe doit se concentrer dans l’objet particulier qui l’occupe. Il doit tout embrasser, tout voir. Il y a des points de réunion où toutes les vérités se touchent ; et la vérité universelle n’est elle-même que la chaîne de tous les rapports. Pour voir de plus près le genre humain sous toutes les faces, Descartes se mêle dans ces jeux sanglants des rois, où le génie s’épuise à détruire, et où des milliers d’hommes, assemblés contre des milliers d’hommes, exercent le meurtre par art et par principes5. Ainsi Socrate porta les armes dans sa jeunesse. Partout il étudie l’homme et le monde. Il analyse l’esprit humain ; il observe les opinions, suit leur progrès, examine leur influence, remonte à leur source. De ces opinions, les unes naissent du gouvernement, d’autres du climat, d’autres de la religion, d’autres de la forme des langues, quelques unes des mœurs, d’autres des lois, plusieurs de toutes ces causes réunies : il y en a qui sortent du fond même de l’esprit humain et de la constitution de l’homme, et celles-là sont à peu près les mêmes chez tous les peuples ; il y en a d’autres qui sont bornées par les montagnes et par les fleuves, car chaque pays a ses opinions comme ses plantes : toutes ensemble forment la raison du peuple. Quel spectacle pour un philosophe ! Descartes en fut épouvanté. Voilà donc, dit-il, la raison humaine ! Dès ce moment il sentit s’ébranler tout l’édifice de ses connaissances : il voulut y porter la main pour achever de le renverser ; mais il n’avait point encore assez de force, et il s’arrêta. Il poursuit ses observations ; il étudie la nature physique : tantôt il la considère dans toute son étendue, comme ne formant qu’un seul et immense ouvrage ; tantôt il la suit dans ses détails. La nature vivante et la nature morte, l’être brut et l’être organisé, les différentes classes de grandeurs et de formes, les destructions et les renouvellements, les variétés et les rapports, rien ne lui échappe, comme rien ne l’étonne. J’aime à le voir debout sur la cime des Alpes, élevé, par sa situation, au-dessus de l’Europe entière, suivant de l’œil la course du Pô, du Rhin, du Rhône et du Danube, et de là s’élevant par la pensée vers les cieux, qu’il paraît toucher, pénétrant dans les réservoirs destinés à fournir à l’Europe ces amas d’eaux immenses ; quelquefois observant à ses pieds les espèces innombrables de végétaux semés par la nature sur le penchant des précipices, ou, entre les pointes des rochers ; quelquefois mesurant la hauteur de ces montagnes de glace, qui semblent jetées dans les vallons des Alpes pour les combler, ou méditant profondément à la lueur des orages6. Ah ! c’est dans ces moments que l’âme du philosophe s’étend, devient immense et profonde comme la nature ; c’est alors que ses idées s’élèvent et parcourent l’univers. Insatiable de voir et de connaître, partout où il passe, Descartes interroge la vérité ; il la demande à tous les lieux qu’il parcourt, il la poursuit de pays en pays. Dans les villes prises d’assaut, ce sont les savants qu’il cherche. Maximilien de Bavière voit dans Prague, dont il s’est rendu maître, la capitale d’un royaume conquis ; Descartes n’y voit que l’ancien séjour de Tycho-Brahé. Sa mémoire y était encore récente ; il interroge tous ceux qui l’ont connu, il suit les traces de ses pensées ; il rassemble dans les conversations le génie d’un grand homme. Ainsi voyageaient autrefois les Pythagore et les Platon, lorsqu’ils allaient dans l’Orient étudier ces colonnes, archives des nations et monuments des découvertes antiques. Descartes, à leur exemple, ramasse tout ce qui peut l’instruire. Mais tant d’idées acquises dans ses voyages ne lui auraient encore servi de rien, s’il n’avait eu l’art de se les approprier par des méditations profondes ; art si nécessaire au philosophe, si inconnu au vulgaire, et peut-être si étranger à l’homme. En effet, qu’est-ce que méditer ? C’est ramener au dedans de nous notre existence répandue tout entière au dehors ; c’est nous retirer de l’univers pour habiter dans notre âme ; c’est anéantir toute l’activité des sens pour augmenter celle de la pensée ; c’est rassembler en un point toutes les forces de l’esprit ; c’est mesurer le temps, non plus par le mouvement et par l’espace, mais par la succession lente ou rapide des idées. Ces méditations, dans Descartes, avoient tourné en habitude7 ; elles le suivaient partout : dans les voyages, dans les camps, dans les occupations les plus tumultueuses, il avait toujours un asile prêt où son âme se retirait au besoin. C’était là qu’il appelait ses idées ; elles accouraient en foule : la méditation les faisait naître, l’esprit géométrique venait les enchaîner. Dès sa jeunesse il s’était avidement attaché aux mathématiques, comme au seul objet qui lui présentait l’évidence8. C’était là que son âme se reposait de l’inquiétude qui la tourmentait partout ailleurs. Mais, dégoûté bientôt de spéculations abstraites, le désir de se rapprocher des hommes le rentraînait à l’étude de la nature. Il se livrait à toutes les sciences : il n’y trouvoit pas la certitude de la géométrie, qu’elle ne doit qu’à la simplicité de son objet ; mais il y transportait du moins la méthode des géomètres. C’est d’elle qu’il apprenait à fixer toujours le sens des termes, et à n’en abuser jamais ; à décomposer l’objet de son étude, à lier les conséquences aux principes ; à remonter par l’analyse, à descendre par la synthèse. Ainsi l’esprit géométrique affermissait sa marche ; mais le courage et l’esprit d’indépendance brisaient devant lui les barrières pour lui frayer des routes. Il était né avec l’audace qui caractérise le génie ; et sans doute les événements dont il avait été témoin, les grands spectacles de liberté qu’il avait vus en Allemagne, en Hollande, dans la Hongrie et dans la Bohême, avoient contribué à développer encore en lui cette fierté d’esprit naturelle. Il osa donc concevoir l’idée de s’élever contre les tyrans de la raison. Mais, avant de détruire tous les préjugés qui étaient sur la terre, il fallait commencer par les détruire en lui-même. Comment y parvenir ? comment anéantir des formes qui ne sont point notre ouvrage, et qui sont le résultat nécessaire de mille combinaisons faites sans nous ? Il fallait, pour ainsi dire, détruire son âme et la refaire. Tant de difficultés n’effrayèrent point Descartes. Je le vois, pendant près de dix ans, luttant contre lui-même pour secouer toutes ses opinions. Il demande compte à ses sens de toutes les idées qu’ils ont portées dans son âme ; il examine tous les tableaux de son imagination, et les compare avec les objets réels ; il descend dans l’intérieur de ses perceptions, qu’il analyse ; il parcourt le dépôt de sa mémoire, et juge tout ce qui y est rassemblé. Partout il poursuit le préjugé, il le chasse de retraite en retraite ; son entendement, peuplé auparavant d’opinions et d’idées, devient un désert immense, mais où désormais la vérité peut entrer9.
Voilà donc la révolution faite dans l’âme de Descartes : voilà ses idées anciennes détruites. Il ne s’agit plus que d’en créer d’autres. Car, pour changer les nations, il ne suffit point d’abattre ; il faut reconstruire. Dès ce moment, Descartes ne pense plus qu’à élever une philosophie nouvelle. Tout l’y invite ; les exhortations de ses amis, le désir de combler le vide qu’il avait fait dans ses idées, je ne sais quel instinct qui domine le grand homme, et, plus que tout cela, l’ambition de faire des découvertes dans la nature, pour rendre les hommes moins misérables ou plus heureux. Mais, pour exécuter un pareil dessein, il sentit qu’il fallait se cacher. Hommes du monde, si fiers de votre politesse et de vos avantages, souffrez que je vous dise la vérité ; ce n’est jamais parmi vous que l’on fera ni que l’on pensera de grandes choses. Vous polissez l’esprit, mais vous énervez le génie. Qu’a-t-il besoin de vos vains ornements ? Sa grandeur fait sa beauté. C’est dans la solitude que l’homme de génie est ce qu’il doit être ; c’est là qu’il rassemble toutes les forces de son âme. Aurait-il besoin des hommes ? N’a-t-il pas avec lui la nature ? et il ne la voit point à travers les petites formes de la société, mais dans sa grandeur primitive, dans sa beauté originale et pure. C’est dans la solitude que toutes les heures laissent une trace, que tous les instants sont représentés par une pensée, que le temps est au sage, et le sage à lui-même. C’est dans la solitude surtout que l’âme a toute la vigueur de l’indépendance. Là elle n’entend point le bruit des chaînes que le despotisme et la superstition secouent sur leurs esclaves : elle est libre comme la pensée de l’homme qui existerait seul. Cette indépendance, après la vérité, était la plus grande passion de Descartes. Ne vous en étonnez point ; ces deux passions tiennent l’une à l’autre. La vérité est l’aliment d’une âme fière et libre, tandis que l’esclave n’ose même lever les yeux jusqu’à elle. C’est cet amour de la liberté qui engage Descartes à fuir tous les engagements, à rompre tous les petits liens de société, à renoncer à ces emplois qui ne sont trop souvent que les chaînes de l’orgueil. Il fallait qu’un homme comme lui ne fût qu’à la nature et au genre humain. Descartes ne fut donc ni magistrat, ni militaire, ni homme de cour10. Il consentit à n’être qu’un philosophe, qu’un homme de génie, c’est-à-dire rien aux yeux du peuple. Il renonce même à son pays ; il choisit une retraite dans la Hollande. C’est dans le séjour de la liberté qu’il va fonder une philosophie libre. Il dit adieu à ses parents, à ses amis, à sa patrie; il part11. L’amour de la vérité n’est plus dans son cœur un sentiment ordinaire; c’est un sentiment religieux qui élève et remplit son âme. Dieu, la nature, les hommes, voilà quels vont être, le reste de sa vie, les objets de ses pensées. Il se consacre à cette occupation aux pieds des autels. Ô jour, ô moment remarquable dans l’histoire de l’esprit humain ! Je crois voir Descartes, avec le respect dont il était pénétré pour la Divinité, entrer dans le temple, et s’y prosterner. Je crois l’entendre dire à Dieu : Ô Dieu, puisque tu m’as créé, je ne veux point mourir sans avoir médité sur tes ouvrages. Je vais chercher la vérité, si tu l’as mise sur la terre. Je vais me rendre utile à l’homme, puisque je suis homme. Soutiens ma faiblesse, agrandis mon esprit, rends-le digne de la nature et de toi. Si tu permets que j’ajoute à la perfection des hommes, je te rendrai grâce en mourant, et ne me repentirai point d’être né.
Je m’arrête un moment : l’ouvrage de la nature est achevé. Elle a préparé avant la naissance de Descartes tout ce qui devait influer sur lui ; elle lui a donné les prédécesseurs dont il avait besoin ; elle a jeté dans son sein les semences qui devaient y germer ; elle a établi entre son esprit et son âme les rapports nécessaires ; elle a fait passer sous ses yeux tous les grands spectacles et du monde physique et du monde moral ; elle a rassemblé autour de lui, ou dans lui, tous les ressorts ; elle a mis dans sa main tous les instruments : son travail est fini. Ici commence celui de Descartes. Je vais faire l’histoire de ses pensées : on verra une espèce de création ; elle embrassera tout ce qui est ; elle présentera une machine immense, mue avec peu de ressorts : on y trouvera le grand caractère de la simplicité, l’enchaînement de toutes les parties, et souvent, comme dans la nature physique, un ordre réel caché sous un désordre apparent.
Je commence par où il a commencé lui-même. Avant de mettre la main à l’édifice, il faut jeter les fondements ; il faut creuser jusqu’à la source de la vérité ; il faut établir l’évidence, et distinguer son caractère. Nous avons vu Descartes renverser toutes les fausses opinions qui étaient dans son âme ; il fait plus, il s’élève à un doute universel12. Celui qui s’est trompé une fois peut se tromper toujours. Aussitôt les cieux, la terre, les figures, les sons, les couleurs, son corps même, et les sens avec lesquels il voyage dans l’univers, tout s’anéantit à ses yeux. Rien n’est assuré, rien n’existe. Dans ce doute général, où trouver un point d’appui ? Quelle première vérité servira de base à toutes les vérités ? Pour Dieu, cette première vérité est partout. Descartes la trouve dans son doute même. Puisque je doute, je pense ; puisque je pense, j’existe. Mais à quelle marque la reconnaît-il ? À l’empreinte de l’évidence. Il établit donc pour principe de ne regarder comme vrai que ce qui est évident, c’est-à-dire ce qui est clairement contenu dans l’idée de l’objet qu’il contemple. Tel est ce fameux doute philosophique de Descartes. Tel est le premier pas qu’il fait pour en sortir, et la première règle qu’il établit. C’est cette règle qui a fait la révolution de l’esprit humain. Pour diriger l’entendement, il joint l’analyse au doute. Décomposer les questions et les diviser en plusieurs branches ; avancer par degrés des objets les plus simples aux plus composés, et des plus connus aux plus cachés ; combler l’intervalle qui est entre les idées éloignées et le remplir par toutes les idées intermédiaires ; mettre dans ces idées un tel enchaînement que toutes se déduisent aisément les unes des autres, et que les énoncer, ce soit pour ainsi dire les démontrer : voilà les autres règles qu’il a établies, et dont il a donné l’exemple13. On entrevoit déjà toute la marche de sa philosophie. Puisqu’il faut commencer par ce qui est évident et simple, il établira des principes qui réunissent ce double caractère. Pour raisonner sur la nature, il s’appuiera sur des axiomes, et déduira des causes générales tous les effets particuliers. Ne craignons pas de l’avouer, Descartes a tracé un plan trop élevé pour l’homme; ce génie hardi a eu l’ambition de connaître comme Dieu même connaît, c’est-à-dire par les principes : mais sa méthode n’en est pas moins la créatrice de la philosophie. Avant lui, il n’y avait qu’une logique de mots. Celle d’Aristote apprenait plus à définir et à diviser qu’à connaître ; à tirer les conséquences, qu’à découvrir les principes. Celle des scolastiques, absurdement subtile, laissait les réalités pour s’égarer dans des abstractions barbares. Celle de Raimond Lulle n’était qu’un assemblage de caractères magiques pour interroger sans entendre, et répondre sans être entendu. C’est Descartes qui créa cette logique intérieure de l’âme, par laquelle l’entendement se rend compte à lui-même de toutes ses idées, calcule sa marche, ne perd jamais de vue le point d’où il part et le terme où il veut arriver ; esprit de raison plutôt que de raisonnement, et qui s’applique à tous les arts comme à toutes les sciences.
Sa méthode est créée : il a fait comme ces grands architectes qui, concevant des ouvrages nouveaux, commencent par se faire de nouveaux instruments et des machines nouvelles, Aidé de ce secours, il entre dans la métaphysique. Il y jette d’abord un regard. Qu’aperçoit-il ? une audace puérile de l’esprit humain, des êtres imaginaires, des rêveries profondes, des mots barbares ; car, dans tous les temps, l’homme, quand il n’a pu connaître, a créé des signes pour représenter des idées qu’il n’avait pas, et il a pris ces signes pour des connaissances. Descartes vit d’un coup d’œil ce que devait être la métaphysique. Dieu, l’âme, et les principes généraux des sciences, voilà ses objets14. Je m’élève avec lui jusqu’à la première cause. Newton la chercha dans les mondes ; Descartes la cherche dans lui-même. Il s’était convaincu de l’existence de son âme ; il avait senti en lui l’être qui pense, c’est-à-dire l’être qui doute, qui nie, qui affirme, qui conçoit, qui veut, qui a des erreurs, qui les combat. Cet être intelligent est donc sujet à des imperfections. Mais toute idée d’imperfection suppose l’idée d’un être plus parfait. De l’idée du parfait naît l’idée de l’infini. D’où lui naît cette idée ? Comment l’homme, dont les facultés sont si bornées, l’homme qui passe sa vie à tourner dans l’intérieur d’un cercle étroit, comment cet être si faible a-t-il pu embrasser et concevoir l’infini ? Cette idée ne lui est-elle pas étrangère ? ne suppose-t-elle pas hors de lui un être qui en soit le modèle et le principe ? Cet être n’est-il pas Dieu ? Toutes les autres idées claires et distinctes que l’homme trouve en lui ne renferment que l’existence possible de leur objet : l’idée seule de l’être parfait renferme une existence nécessaire. Cette idée est pour Descartes le commencement de la grande chaîne. Si tous les êtres créés sont une émanation du premier être, si toutes les lois qui font l’ordre physique et l’ordre moral sont, ou des rapports nécessaires que Dieu a vus, ou des rapports qu’il a établis librement, en connaissant ce qui est le plus conforme à ses attributs, on connaîtra les lois primitives de la nature. Ainsi la connaissance de tous les êtres se trouve enchaînée à celle du premier. C’est elle aussi qui affermit la marche de l’esprit humain, et sert de base à l’évidence ; c’est elle qui, en m’apprenant que la vérité éternelle ne peut me tromper, m’ordonne de regarder comme vrai tout ce que ma raison me présentera comme évident.
Appuyé de ce principe, et sûr de sa marche, Descartes passe à l’analyse de son âme. Il a remarqué que, dans son doute, l’étendue, la figure et le mouvement s’anéantissaient pour lui. Sa pensée seule demeurait ; seule elle restait immuablement attachée à son être, sans qu’il lui fût possible de l’en séparer. Il peut donc concevoir distinctement que sa pensée existe, sans que rien n’existe autour de lui. L’âme se conçoit donc sans le corps. De là naît la distinction de l’être pensant et de l’être matériel. Pour juger de la nature des deux substances, Descartes cherche une propriété générale dont toutes les autres dépendent : c’est l’étendue dans la matière ; dans l’âme, c’est la pensée. De l’étendue naissent la figure et le mouvement ; de la pensée naît la faculté de sentir, de vouloir, d’imaginer. L’étendue est divisible de sa nature ; la pensée, simple et indivisible. Comment ce qui est simple appartiendrait-il à un être composé de parties ? comment des milliers d’éléments, qui forment un corps, pourraient-ils former une perception ou un jugement unique ? Cependant il existe une chaîne secrète entre l’âme et le corps. L’âme n’est-elle que semblable au pilote qui dirige le vaisseau ? Non; elle fait un tout avec le vaisseau qu’elle gouverne. C’est donc de l’étroite correspondance qui est entre les mouvements de l’un et les sensations ou pensées de l’autre, que dépend la liaison de ces deux principes si divisés et si unis15. C’est ainsi que Descartes tourne autour de son être, et examine tout ce qui le compose. Nourri d’idées intellectuelles, et détaché de ses sens, c’est son âme qui le frappe le plus. Voici une pensée faite pour étonner le peuple, mais que le philosophe concevra sans peine. Descartes est plus sûr de l’existence de son âme que de celle de son corps. En effet, que sont toutes les sensations, sinon un avertissement éternel pour l’âme qu’elle existe ? Peut-elle sortir hors d’elle-même sans y rentrer à chaque instant par la pensée ? Quand je parcours tous les objets de l’univers, ce n’est jamais que ma pensée que j’aperçois. Mais comment cette âme franchit-elle l’intervalle immense qui est entre elle et la matière ? Ici Descartes reprend son analyse et le fil de sa méthode. Pour juger s’il existe des corps, il consulte d’abord ses idées. Il trouve dans son âme les idées générales d’étendue, de grandeur, de figure, de situation, de mouvement, et une foule de perceptions particulières. Ces idées lui apprennent bien l’existence de la matière, comme objet mathématique, mais ne lui disent rien de son existence physique et réelle. Il interroge ensuite son imagination. Elle lui offre une suite de tableaux où des corps sont représentés : sans doute l’original de ces tableaux existe, mais ce n’est encore qu’une probabilité. Il remonte jusqu’à ses sens. Ce sont eux qui font la communication de l’âme et de l’univers ; ou plutôt ce sont eux qui créent l’univers pour l’âme. Ils lui portent chaque portion du monde en détail ; par une métamorphose rapide, la sensation devient idée, et l’âme voit dans cette idée, comme dans un miroir, le monde qui est hors d’elle. Les sens sont donc les messagers de l’âme. Mais quelle foi peut-elle ajouter à leur rapport ? Souvent ce rapport la trompe. Descartes remonte alors jusqu’à Dieu. D’un côté, la véracité de l’Être suprême ; de l’autre, le penchant irrésistible de l’homme à rapporter ses sensations à des objets réels qui existent hors de lui : voilà les motifs qui le déterminent, et il se ressaisit de l’univers physique qui lui échappait.
Ferai-je voir ce grand homme, malgré la circonspection de sa marche, s’égarant dans la métaphysique, et créant son système des idées innées ? Mais cette erreur même tenoit à son génie. Accoutumé à des méditations profondes, habitué à vivre loin des sens, à chercher dans son âme ou dans l’essence de Dieu, l’origine, l’ordre et le fil de ses connaissances, pouvait-il soupçonner que l’âme fût entièrement dépendante des sens pour les idées ? N’était-il pas trop avilissant pour elle qu’elle ne fût occupée qu’à parcourir le monde physique pour y ramasser les matériaux de ses connaissances, comme le botaniste qui cueille ses végétaux, ou à extraire des principes de ses sensations, comme le chimiste qui analyse les corps ? Il était réservé à Locke de nous donner sur les idées le vrai système de la nature, en développant un principe connu par Aristote et saisi par Bacon, mais dont Locke n’est pas moins le créateur, car un principe n’est créé que lorsqu’il est démontré aux hommes. Qui nous démontrera de même ce que c’est que l’âme des bêtes ? quels sont ces êtres singuliers, si supérieurs aux végétaux par leurs organes, si inférieurs à l’homme par leurs facultés ? quel est ce principe qui, sans leur donner la raison, produit en eux des sensations, du mouvement et de la vie ? Quelque parti que l’on embrasse, la raison se trouble, la dignité de l’homme s’offense, ou la religion s’épouvante. Chaque système est voisin d’une erreur ; chaque route est sur le bord d’un précipice. Ici Descartes est entraîné, par la force des conséquences et l’enchaînement de ses idées, vers un système aussi singulier que hardi, et qui est digne au moins de la grandeur de Dieu. En effet, quelle idée plus sublime que de concevoir une multitude innombrable de machines à qui l’organisation tient lieu de principe intelligent ; dont tous les ressorts sont différents, selon les différentes espèces et les différents buts de la création ; où tout est prévu, tout combiné pour la conservation et la reproduction des êtres ; où toutes les opérations sont le résultat toujours sûr des lois du mouvement ; où toutes les causes qui doivent produire des millions d’effets sont arrangées jusqu’à la fin des siècles, et ne dépendent que de la correspondance et de l’harmonie de quelque partie de matière ? Avouons-le, ce système donne la plus grande idée de l’art de l’éternel géomètre, comme l’appelait Platon. C’est ce même caractère de grandeur que l’on a retrouvé depuis dans l’harmonie préétablie de Leibnitz, caractère plus propre que tout autre à séduire les hommes de génie, qui aiment mieux voir tout en un instant dans une grande idée, que de se traîner sur des détails d’observations et sur quelques vérités éparses et isolées.
Descartes s’est élevé à Dieu, est descendu dans son âme, a saisi sa pensée, l’a séparée de la matière, s’est assuré qu’il existait des corps hors de lui. Sûr de tous les principes de ses connaissances, il va maintenant s’élancer dans l’univers physique ; il va le parcourir, l’embrasser, le connaître : mais auparavant il perfectionne l’instrument de la géométrie, dont il a besoin. C’est ici une des parties les plus solides de la gloire de Descartes ; c’est ici qu’il a tracé une route qui sera éternellement marquée dans l’histoire de l’esprit humain. L’algèbre était créée depuis longtemps. Cette géométrie métaphysique, qui exprime tous les rapports par des signes universels, qui facilite le calcul en le généralisant, opère sur les quantités inconnues comme si elles étaient connues, accélère la marche et augmente l’étendue de l’esprit en substituant un signe abrégé à des combinaisons nombreuses ; cette science, inventée par les Arabes, ou du moins transportée par eux en Espagne, cultivée par les Italiens, avait été agrandie et perfectionnée par un Français : mais, malgré les découvertes importantes de l’illustre Viète, malgré un pas ou deux qu’on avait faits après lui en Angleterre, il restait encore beaucoup à découvrir. Tel était le sort de Descartes, qu’il ne pouvait approcher d’une science sans qu’aussitôt elle ne prît une face nouvelle. D’abord il travaille sur les méthodes de l’analyse pure : pour soulager l’imagination, il diminue le nombre des signes ; il représente par des chiffres les puissances des quantités, et simplifie, pour ainsi dire, le mécanisme algébrique. Il s’élève ensuite plus haut : il trouve sa fameuse méthode des indéterminées, artifice plein d’adresse, où l’art, conduit par le génie, surprend la vérité en paraissant s’éloigner d’elle ; il apprend à connaître le nombre et la nature des racines dans chaque équation par la combinaison successive des signes ; règle aussi utile que simple, que la jalousie et l’ignorance ont attaquée, que la rivalité nationale a disputée à Descartes, et qui n’a été démontrée que depuis quelques années. C’est ainsi que les grands hommes découvrent, comme par inspiration, des vérités que les hommes ordinaires n’entendent quelquefois qu’au bout de cent ans de pratique et d’étude ; et celui qui démontre ces vérités après eux acquiert encore une gloire immortelle. L’algèbre ainsi perfectionnée, il restait un pas plus difficile à faire. La méthode d’Apollonius et d’Archimède, qui fut celle de tous les anciens géomètres, exacte et rigoureuse pour les démonstrations, était peu utile pour les découvertes. Semblable à ces machines qui dépensent une quantité prodigieuse de forces pour peu de mouvement, elle consumait l’esprit dans un détail d’opérations trop compliquées, et le traînait lentement d’une vérité à l’autre. Il fallait une méthode plus rapide ; il fallait un instrument qui élevât le géomètre à une hauteur d’où il pût dominer sur toutes ses opérations, et, sans fatiguer sa vue, voir d’un coup d’œil des espaces immenses se resserrer comme en un point : cet instrument, c’est Descartes qui l’a créé ; c’est l’application de l’algèbre à la géométrie. Il commença donc par traduire les lignes, les surfaces et les solides en caractères algébriques ; mais ce qui était l’effort du génie, c’était, après la résolution du problème, de traduire de nouveau les caractères algébriques en figures. Je n’entreprendrai point de détailler les admirables découvertes sur lesquelles est fondée cette analyse créée par Descartes. Ces vérités abstraites et pures, faites pour être mesurées par le compas, échappent au pinceau de l’éloquence ; et j’affaiblirais l’éloge d’un grand homme en cherchant à peindre ce qui ne doit être que calculé. Contentons-nous de remarquer ici que, par son analyse, Descartes fit faire plus de progrès à la géométrie qu’elle n’en avait fait depuis la création du monde. Il abrégea les travaux, il multiplia les forces, il donna une nouvelle marche à l’esprit humain. C’est l’analyse qui a été l’instrument de toutes les grandes découvertes des modernes ; c’est l’analyse qui, dans les mains des Leibnitz, des Newton et des Bernoulli, a produit cette géométrie nouvelle et sublime qui soumet l’infini au calcul : voilà l’ouvrage de Descartes. Quel est donc cet homme extraordinaire qui a laissé si loin de lui tous les siècles passés, qui a ouvert de nouvelles routes aux siècles à venir, et qui dans le sien avait à peine trois hommes qui fussent en état de l’entendre ? Il est vrai qu’il avait répandu sur toute sa géométrie une certaine obscurité : soit qu’accoutumé à franchir d’un saut des intervalles immenses, il ne s’aperçût pas seulement de toutes les idées intermédiaires qu’il supprimait, et qui sont des points d’appui nécessaires à la faiblesse ; soit que son dessein fût de secouer l’esprit humain, et de l’accoutumer aux grands efforts ; soit enfin que, tourmenté par des rivaux jaloux et faibles, il voulût une fois les accabler de son génie, et les épouvanter de toute la distance qui était entre eux et lui16. ait conçu la grande idée de réunir toutes les sciences, et de les faire servir à la perfection l’une de l’autre. On a vu qu’il avait transporté dans sa logique la méthode des géomètres ; il se servit de l’analyse logique pour perfectionner l’algèbre ; il appliqua ensuite l’algèbre à la géométrie, la géométrie et l’algèbre à la mécanique, et ces trois sciences combinées ensemble à l’astronomie. C’est donc à lui qu’on doit les premiers essais de l’application de la géométrie à la physique ; application qui a créé encore une science toute nouvelle. Armé de tant de forces réunies, Descartes marche à la nature ; il entreprend de déchirer ses voiles, et d’expliquer le système du monde. Voici un nouvel ordre de choses : voici des tableaux plus grands peut-être que ceux que présente l’histoire de toutes les nations et de tous les empires17.
Qu’on me donne de la matière et du mouvement, dit Descartes, et je vais créer un monde. D’abord il s’élève par la pensée vers les cieux, et de là il embrasse l’univers d’un coup d’œil ; il voit le monde entier comme une seule et immense machine, dont les roues et les ressorts ont été disposés au commencement, de la manière la plus simple, par une main éternelle. Parmi cette quantité effroyable de corps et de mouvements, il cherche la disposition des centres. Chaque corps a son centre particulier, chaque système a son centre général. Sans doute aussi il y a un centre universel, autour duquel sont rangés tous les systèmes de la nature. Mais où est-il, et dans quel point de l’espace ? Descartes place dans le soleil le centre du système auquel nous sommes attachés. Ce système est une des roues de la machine ; le soleil est le point d’appui. Cette grande roue embrasse dix-huit cent millions de lieues dans sa circonférence, à ne compter que jusqu’à l’orbe de Saturne. Que serait-ce si on pouvait suivre la marche excentrique des comètes ! Cette roue de l’univers doit communiquer à une roue voisine, dont la circonférence est peut-être plus grande encore ; celle-ci communique à une troisième, cette troisième à une autre, et ainsi de suite dans une progression infinie, jusqu’à celles qui sont bornées par les dernières limites de l’espace. Toutes, par la communication du mouvement, se balancent et se contrebalancent, agissent et réagissent l’une sur l’autre, se servent mutuellement de poids et de contre-poids, d’où résulte l’équilibre de chaque système, et, de chaque équilibre particulier, l’équilibre du monde. Telle est l’idée de cette grande machine, qui s’étend à plus de centaines de millions de lieues que l’imagination n’en peut concevoir, et dont toutes les roues sont des mondes combinés les uns avec les autres.
C’est cette machine que Descartes conçoit, et qu’il entreprend de créer avec trois lois de mécanique. Mais auparavant il établit les propriétés générales de l’espace, de la matière et du mouvement. D’abord, comme toutes les parties sont enchaînées, que nulle part le mécanisme n’est interrompu, et que la matière seule peut agir sur la matière, il faut que tout soit plein. Il admet donc un fluide immense et continu, qui circule entre les parties solides de l’univers ; ainsi le vide est proscrit de la nature. L’idée de l’espace est nécessairement liée à celle de l’étendue, et Descartes confond l’idée de l’étendue avec celle de la matière : car on peut dépouiller successivement les corps de toutes leurs qualités ; mais l’étendue y restera, sans qu’on puisse jamais l’en détacher. C’est donc l’étendue qui constitue la matière, et c’est la matière qui constitue l’espace. Mais où sont les bornes de l’espace ? Descartes ne les conçoit nulle part, parce que l’imagination peut toujours s’étendre au-delà. L’univers est donc illimité : il semble que l’âme de ce grand homme eût été trop resserrée par les bornes du monde ; il n’ose point les fixer. Il examine ensuite les lois du mouvement : mais qu’est-ce que le mouvement ? c’est le plus grand phénomène de la nature, et le plus inconnu. Jamais l’homme ne saura comment le mouvement d’un corps peut passer dans un autre. Il faut donc se borner à connaitre par quelles lois générales il se distribue, se conserve ou se détruit ; et c’est ce que personne n’avait cherché avant Descartes. C’est lui qui le premier a généralisé tous les phénomènes, a comparé tous les résultats et tous les effets, pour en extraire ces lois primitives : et puisque dans les mers, sur la terre et dans les cieux, tout s’opère par le mouvement, n’était-ce pas remettre aux hommes la clef de la nature ? Il se trompa, je le sais ; mais, malgré son erreur, il n’en est pas moins l’auteur des lois du mouvement : car, pendant trente siècles, les philosophes n’y avoient pas même pensé ; et dès qu’il en eut donné de fausses, on s’appliqua à chercher les véritables. Trois mathématiciens célèbres18 les trouvèrent en même temps : c’était l’effet de ses recherches et de la secousse qu’il avait donnée aux esprits. Du mouvement il passe à la matière, chose aussi incompréhensible pour l’homme. Il admet une matière primitive, unique, élémentaire, source et principe de tous les êtres, divisée et divisible à l’infini ; qui se modifie par le mouvement ; qui se compose et se décompose ; qui végète ou s’organise ; qui, par l’activité rapide de ses parties, devient fluide ; qui, par leur repos, demeure inactive et lente ; qui circule sans cesse dans des moules et des filières innombrables, et, par l’assemblage des formes, constitue l’univers : c’est avec cette matière qu’il entreprend de créer un monde.
Je n’entrerai point dans le détail de cette création. Je ne peindrai point ces trois éléments si connus, formés par des millions de particules entassées, qui se heurtent, se froissent et se brisent ; ces éléments emportés d’un mouvement rapide autour de divers centres, et marchant par tourbillons ; la force centrifuge qui naît du mouvement circulaire ; chaque élément qui se place à différentes distances, à raison de sa pesanteur ; la matière la plus déliée qui se précipite vers les centres et y va former des soleils ; la plus massive rejetée vers les circonférences ; les grands tourbillons qui engloutissent les tourbillons voisins trop faibles pour leur résister, et les emportent dans leurs cours ; tous ces tourbillons roulant dans l’espace immense, et chacun en équilibre, à raison de leur masse et de leur vitesse. C’est au physicien plutôt qu’à l’orateur à donner l’idée de ce système, que l’Europe adopta avec transport, qui a présidé si long-temps au mouvement des cieux, et qui est aujourd’hui tout-à-fait renversé. En vain les hommes les plus savants du siècle passé et du nôtre, en vain les Huygens, les Bulfinger, les Malebranche, les Leibnitz, les Kircher et les Bernoulli ont travaillé à réparer ce grand édifice ; il menaçait ruine de toutes parts, et il a fallu l’abandonner. Gardons-nous cependant de croire que ce système, tel qu’il est, ne soit pas l’ouvrage d’un génie extraordinaire. Personne encore n’avait conçu une machine aussi grande ni aussi vaste ; personne n’avait eu l’idée de rassembler toutes les observations faites dans tous les siècles, et d’en bâtir un système général du monde ; personne n’avait fait un usage aussi beau des lois de l’équilibre et du mouvement ; personne, d’un petit nombre de principes simples, n’avait tiré une foule de conséquences si bien enchaînées. Dans un temps où les lois du mécanisme étaient si peu connues, où les observations astronomiques étaient si imparfaites, il est beau d’avoir même ébauché l’univers. D’ailleurs tout semblait inviter l’homme à croire que c’était là le système de la nature ; du moins le mouvement rapide de toutes les sphères, leur rotation sur leur propre centre, leurs orbes plus ou moins réguliers autour d’un centre commun, les lois de l’impulsion établies et connues dans tous les corps qui nous environnent, l’analogie de la terre avec les cieux, l’enchaînement de tous les corps de l’univers, enchaînement qui doit être formé par des liens physiques et réels, tout semble nous dire que les sphères célestes communiquent ensemble, et sont entraînées par un fluide invisible et immense qui circule autour d’elles. Mais quel est ce fluide? quelle est cette impulsion ? quelles sont les causes qui la modifient, qui l’altèrent et qui la changent ? comment toutes ces causes se combinent ou se divisent-elles pour produire les plus étonnants effets ? C’est ce que Descartes ne nous apprend pas, c’est ce que l’homme ne saura peut-être jamais bien ; car la géométrie, qui est le plus grand instrument dont on se serve aujourd’hui dans la physique, n’a de prise que sur les objets simples. Aussi Newton, tout grand qu’il était, a été obligé de simplifier l’univers pour le calculer. Il a fait mouvoir tous les astres dans des espaces libres : dès lors plus de fluide, plus de résistances, plus de frottements ; les liens qui unissent ensemble toutes les parties du monde ne sont plus que des rapports de gravitation, des êtres purement mathématiques. Il faut en convenir, un tel univers est bien plus aisé à calculer que celui de Descartes, où toute action est fondée sur un mécanisme. Le newtonien, tranquille dans son cabinet, calcule la marche des sphères d’après un seul principe qui agit toujours d’une manière uniforme. Que la main du génie qui préside à l’univers saisisse le géomètre et le transporte tout-à-coup dans le monde de Descartes : Viens, monte, franchis l’intervalle qui te sépare des cieux, approche de Mercure, passe l’orbe de Vénus, laisse Mars derrière toi, viens te placer entre Jupiter et Saturne ; te voilà à quatre-vingt mille diamètres de ton globe. Regarde maintenant : vois-tu ces grands corps qui de loin te paraissent mus d’une manière uniforme ? Vois leurs agitations et leurs balancements, semblables à ceux d’un vaisseau tourmenté par la tempête, dans un fluide qui presse et qui bouillonne ; vois et calcule, si tu peux, ces mouvements. Ainsi, quand le système de Descartes n’eût point été aussi défectueux, ni celui de Newton aussi admirable, les géomètres devaient, par préférence, embrasser le dernier ; et ils font fait. Quelle main plus hardie, profitant des nouveaux phénomènes connus et des découvertes nouvelles, osera reconstruire avec plus d’audace et de solidité ces tourbillons que Descartes lui-même n’éleva que d’une main faible ? ou, rapprochant deux empires divisés, entreprendra de réunir l’attraction avec l’impulsion, en découvrant la chaîne qui les joint ? ou peut-être nous apportera une nouvelle loi de la nature, inconnue jusqu’à ce jour, qui nous rende compte également et des phénomènes des cieux et de ceux de la terre ? Mais l’exécution de ce projet est encore reculée. Au siècle de Descartes, il n’était pas temps d’expliquer le système du monde ; ce temps n’est pas venu pour nous. Peut-être l’esprit humain n’est-il qu’à son enfance. Combien de siècles faudra-t-il encore pour que cette grande entreprise vienne à sa maturité ! Combien de fois faudra-t-il que les comètes les plus éloignées se rapprochent de nous, et descendent dans la partie inférieure de leurs orbites ! Combien faudra-t-il découvrir, dans le monde planétaire, ou de satellites nouveaux, ou de nouveaux phénomènes des satellites déjà connus ! combien de mouvements irréguliers assigner à leurs véritables causes ! combien perfectionner les moyens d’étendre notre vue aux plus grandes distances, ou par la réfraction ou par la réflexion de la lumière ! combien attendre de hasards qui serviront mieux la philosophie que des siècles d’observations ! combien découvrir de chaînes et de fils imperceptibles, d’abord entre tous les êtres qui nous environnent, ensuite entre les êtres éloignés ! Et peut-être après ces collections immenses de faits, fruits de deux ou trois cents siècles, combien de bouleversements et de révolutions ou physiques ou morales sur le globe suspendront encore pendant des milliers d’années les progrès de l’esprit humain dans cette étude de la nature ! Heureux si, après ces longues interruptions, le genre humain renoue le fil de ses connaissances au point où il avait été rompu ! C’est alors peut-être qu’il sera permis à l’homme de penser à faire un système du monde ; et que ce qui a été commencé dans l’Égypte et dans l’Inde, poursuivi dans la Grèce, repris et développé en Italie, en France, en Allemagne et en Angleterre, s’achèvera peut-être, ou dans les pays intérieurs de l’Afrique, ou dans quelque endroit sauvage de l’Amérique septentrionale ou des Terres australes ; tandis que notre Europe savante ne sera plus qu’une solitude barbare, ou sera peut-être engloutie sous les flots de l’océan rejoint à la Méditerranée. Alors on se souviendra de Descartes, et son nom sera prononcé peut-être dans des lieux où aucun son ne s’est fait entendre depuis la naissance du monde.
Il poursuit sa création : des cieux il descend sur la terre. Les mêmes mains qui ont arrangé et construit les corps célestes travaillent à la composition du globe de la terre. Toutes les parties tendent vers le centre. La pesanteur est l’effet de la force centrifuge du tourbillon. Ce fluide, qui tend à s’éloigner, pousse vers le centre tous les corps qui ont moins de force que lui pour s’échapper : ainsi la matière n’a par elle-même aucun poids. Bientôt tout devait changer : la pesanteur est devenue une qualité primitive et inhérente, qui s’étend à toutes les distances et à tous les mondes, qui fait graviter toutes les parties les unes vers les autres, retient la lune dans son orbite, et fait tomber les corps sur la terre. On devait faire plus, on devait peser les astres; monument singulier de l’audace de l’homme ! Mais toutes ces grandes découvertes ne sont que des calculs sur les effets. Descartes, plus hardi a osé chercher la cause. Il continue sa marche : l’air, fluide léger, élastique et transparent, se détache des parties terrestres plus épaisses, et se balance dans l’atmosphère ; le feu naît d’une agitation plus vive, et acquiert son activité brûlante ; l’eau devient fluide, et ses gouttes s’arrondissent ; les montagnes s’élèvent, et les abîmes des mers se creusent ; un balancement périodique soulève et abaisse tour à tour les flots et remue la masse de l’océan, depuis la surface jusqu’aux plus grandes profondeurs ; c’est le passage de la lune au-dessus du méridien qui presse et resserre les torrents de fluide contenus entre la lune et l’océan. L’intérieur du globe s’organise, une chaleur féconde part du centre de la terre, et se distribue dans toutes ses parties ; les sels, les bitumes et les soufres se composent ; les minéraux naissent de plusieurs mélanges ; les veines métalliques s’étendent ; les volcans s’allument ; l’air, dilaté dans les cavernes souterraines, éclate, et donne des secousses au globe. De plus grands prodiges s’opèrent : la vertu magnétique se déploie, l’aimant attire et repousse, il communique sa force, et se dirige vers les pôles du monde ; le fluide électrique circule dans les corps, et le frottement le rend actif. Tels sont les principaux phénomènes du globe que nous habitons, et que Descartes entreprend d’expliquer. Il soulève une partie du voile qui les couvre. Mais ce globe est enveloppé d’une masse invisible et flottante, qui est entraînée du même mouvement que la terre, presse sur sa surface, et y attache tous les corps : c’est l’atmosphère ; océan élastique, et qui, comme le nôtre, est sujet à des altérations et à des tempêtes ; région détachée de l’homme, et qui, par son poids, a sur l’homme la plus grande influence ; lieu où se rendent sans cesse les particules échappées de tous les êtres ; assemblage des ruines de la nature, ou volatilisée par le feu, ou dissoute par l’action de l’air, ou pompée par le soleil; laboratoire immense, où toutes ces parties isolées et extraites d’un million de corps différents se réunissent de nouveau, fermentent, se composent, produisent de nouvelles formes, et offrent aux yeux ces météores variés qui étonnent le peuple, et que recherche le philosophe. Descartes, après avoir parcouru la terre, s’élève dans cette région19. Déjà on commençait dans toute l’Europe à étudier la nature de l’air. Galilée le premier avait découvert sa pesanteur. Torricelli avait mesuré la pression de l’atmosphère. On l’avait trouvée égale à un cylindre d’eau de même base et de trente-deux pieds de hauteur, ou à une colonne de vif-argent de vingt-neuf pouces. Ces expériences n’étonnent point Descartes : elles étaient conformes à ses principes. Il avait deviné la nature avant qu’on l’eût mesurée. C’est lui qui donne à Pascal l’idée de sa fameuse expérience sur une haute montagne20; expérience qui confirma toutes les autres, parce qu’on vit que la colonne de mercure baissait à proportion que la colonne d’air diminuait en hauteur. Pourquoi Pascal n’a-t-il point avoué qu’il devait cette idée à Descartes ? N’étaient-ils pas tous deux assez grands pour que cet aveu pût l’honorer ?
Les propriétés de l’air, sa fluidité, sa pesanteur et son ressort le rendent un des agents les plus universels de la nature. De son élasticité naissent les vents. Descartes les examine dans leur marche. Il les voit naître sous l’impression du soleil, qui raréfie les vapeurs de l’atmosphère ; suivre entre les tropiques le cours de cet astre, d’orient en occident ; changer de direction à trente degrés de l’équateur ; se charger de particules glacées, en traversant des montagnes couvertes de neiges ; devenir secs et brûlants en parcourant la zone torride ; obéir, sur les rivages de l’océan, au mouvement du flux et du reflux ; se combiner par mille causes différentes des lieux, des météores et des saisons ; former partout des courants, ou lents ou rapides, plus réguliers sur l’espace immense et libre des mers, plus inégaux sur la terre, où leur direction est continuellement changée par le choc des forêts, des villes et des montagnes, qui les brisent et qui les réfléchissent. Il pénètre ensuite dans les ateliers secrets de la nature ; il voit la vapeur en équilibre se condenser en nuage ; il analyse l’organisation des neiges et des grêles ; il décompose le tonnerre, et assigne l’origine des tempêtes qui bouleversent les mers, ou ensevelissent quelquefois l’Africain et l’Arabe sous des monceaux de sable.