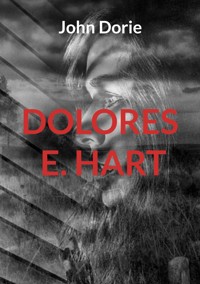
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
Le soir du réveillon, alors qu'une tempête fait rage dans le Connecticut, Dolores cède à la pression de son compagnon, John, et prend le volant. La route est glissante, la visibilité quasi nulle... puis c'est l'accident. Elle en sort indemne. Lui, non. John est gravement blessé, condamné à boiter toute sa vie. Mais son grand plaisir devient bientôt de lui faire payer le prix de son malheur. Humiliations, manipulations... chaque jour, Dolores s'enfonce un peu plus dans une prison invisible dont elle ne sait comment s'échapper. Jusqu'au jour où un doute s'immisce dans son esprit : et si elle n'avait jamais été au volant ce soir-là? Si la vérité était tout autre? Et surtout... si John ne devais plus jamais se réveiller?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 212
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Avant-propos
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Chapitre 26
Chapitre 27
Chapitre 28
Chapitre 29
Chapitre 30
Chapitre 31
Chapitre 32
Épilogue
Remerciements
Avant-propos
Après La Chose dans la maison, un roman dont le personnage principal était une femme, j’ai récidivé avec cette nouvelle fiction intitulée Dolores E. Hart. D’ordinaire, tous mes héros ou anti-héros sont des personnages masculins, mais avec le temps, j’ai pris conscience de l’intérêt de mettre en avant un personnage féminin, quelle que soit sa situation professionnelle ou sociale.
Pour cette nouvelle histoire, j’ai situé l’action à une époque qui m’a marqué quand j’étais enfant, celle où Elvis Presley nous a quittés.
Où étiez-vous quand Elvis est mort ? Que faisiez-vous ? Nous nous en souvenons tous de manière individuelle, comme nos parents se souviennent de l’assassinat de JFK. Mais pour Elvis, c’est différent : il a laissé chacun de nous aussi seul qu’il l’était lui-même…
Oui, je me rappelle où j’étais le 16 août 1977. Je me souviens encore du moment où j’ai appris sa mort. Nous traversions la ville de Perpignan, l’ancienne capitale continentale du Royaume de Majorque. Il y avait un bouchon dans le centre-ville. Mes deux frères et moi étions assis côte à côte sur la banquette arrière de la Renault 12 de mon père. En fin d’après-midi, Europe 1 a interrompu ses programmes pour annoncer la terrible nouvelle : « Elvis est mort ! » La radio a diffusé ses chansons pendant vingt-quatre heures. C’est à partir de ce moment que j’ai commencé à m’intéresser à lui.
Le 16 août 1977, à 14 h 56, une ambulance, toute sirène hurlante, est arrivée en trombe au service des urgences du Baptist Memorial Hospital de Memphis, Tennessee. L’équipe de réanimation s’est pressée, mais il était déjà trop tard. À 15 h 30, toutes les radios et télévisions américaines ont interrompu leurs programmes. Une dépêche urgente était tombée : Elvis Presley a été retrouvé mort, victime d’un arrêt cardiaque, dans sa résidence de Graceland. Il avait quarante-deux ans.
À l’époque de sa disparition, l’image d’Elvis était la plus couramment reproduite après celle de Mickey Mouse. Très vite, il fut déifié, mais presque aussi vite, il devint un sujet de dérision, car les dieux sont toujours un peu drôles et les héros toujours un peu ridicules et apprêtés. Avec Elvis, un dieu a presque été créé, un héros a presque été inventé. Mais on a voulu aller trop vite et sommes restés à la forme immolée de la divinité. On a forcé Elvis à s’altérer physiquement et nerveusement, et c’est pour cela que la mutation du monde qu’il symbolisait est restée inachevée.
Quand je vivais à Paris, j’avais acheté une affiche de concert au marché aux Puces, Porte de Saint-Ouen. Depuis, je l’ai toujours conservée. Sur cette affiche, il est inscrit en caractères gras : ELVIS IN CONCERT – SUN., AUG. 21 – 1977. CIVIC CENTER, HARTFORD, CONNECTICUT. Son tout dernier concert a eu lieu le dimanche 26 juin 1977 devant quelque dix-huit mille spectateurs au Market Square Arena d’Indianapolis. C’était la dernière date d’une tournée amorcée le 17 juin à Springfield, dans le Missouri. La tournée devait reprendre le 17 août à Portland, dans le Maine, et le 21 août 1977, Elvis Presley devait se produire sur scène à Hartford, Connecticut. Mais le destin en a décidé autrement.
Elvis donnait l’impression d’avoir un destin ; cette impression est toujours le luxe des spectateurs. Dans le corps d’un homme, cela se passe différemment. En conséquence, nous nous sommes sentis coupables de son déclin et ne l’avons pas laissé mourir. Au lieu de le laisser disparaître dans le néant, on a capturé son image et on l’a fixée, non seulement sur des films, des posters, des figurines, des mugs, mais encore sur d’autres corps : ces corps d’imitateurs qui le rendent, par substitution, éternellement présent sur la Terre et ces apparitions qui rythment notre quotidien et que l’on répertorie sur le web comme des rencontres du troisième type. Au XXIe siècle, l’Amérique célèbre toujours Elvis Presley et le pleure encore. Le roi est mort et quelque chose s’est définitivement perdu avec lui.
À chaque livre, un nouveau défi…
Quand j’écris, je suis déconnecté de la réalité. Pourtant, je me retrouve toujours au même endroit : une grande pièce, une table de salon, mon ordinateur portable, des cahiers de brouillon où j’ai griffonné pas mal de choses, des bouquins, des magazines, des revues et puis Internet.
Dolores E. Hart est une fiction de deux cent trente pages (environ 42 000 mots). C’est un roman qui, à l’origine, était une nouvelle d’une cinquantaine de pages. En le développant, je ne cherchais pas à atteindre la perfection. Mais comme l’a dit Stephen King : « Écrire est humain, corriger est divin. »
C’est mon troisième roman… l’histoire se déroule à Hartford, Connecticut, et commence le 16 août 1977, le jour de la mort du roi Elvis. Dolores Hart est une femme ordinaire et complexe à la fois. Elle vit un calvaire depuis qu’elle est tombée amoureuse de John Ireland, un comédien raté et alcoolique. Un accident de voiture va rendre ce calvaire encore plus insupportable.
1
Dolores dormait dans une chambre d’hôpital et rêvait du passé. Cela ne la menait pas bien loin, car on lui avait confié une mission. Mais comme le disait son amie Lisa, une femme très active : « Ce n’est pas catastrophique, on a tous une mission. » Et quand Lisa parlait, Dolores l’écoutait, car elle la considérait vraiment comme intelligente. Elle se demanda alors : « Pourquoi m’en faire ? » Après tout, tout ce qu’on y gagne, ce sont des cheveux blancs, et elle n’en avait pas besoin. Elle était belle, encore jeune malgré ses quarante ans, débrouillarde, et, en plus de cela, c’était une femme bien.
Soudain tirée de son sommeil, elle scruta le rayon de soleil qui venait frapper la fenêtre de sa chambre. L’automne battait son plein, et les odeurs terreuses dominaient, issues des plantes et des feuilles tombées qui commençaient à se décomposer, libérant la senteur musquée de leurs sucres et composés organiques. Pendant ce qui lui parut une éternité, ces effluves furent sa seule réalité extérieure. Qui elle était et où elle se trouvait, elle n’en avait aucune idée.
Avec le temps, elle prit conscience de cycles récurrents. Et pour la première fois depuis qu’elle avait émergé des ténèbres qui précédaient cette brume, une pensée surgit, indépendante de sa situation actuelle, quelle qu’elle soit : l’image d’un arbre et d’un pick-up abîmé par un choc.
Ses rêves la ramenaient souvent à cet endroit, et elle ne pouvait l’oublier. Ce souvenir tourbillonnait comme une mouche paresseuse, la rendant folle. Elle hésitait, cherchant à comprendre la signification de cette image, quand un coup frappé à la porte l’interrompit. Une de ses mains se posa instinctivement sur sa poitrine dans un geste protecteur, tandis que l’autre réajustait sa coiffure.
— Entrez, dit-elle.
Un homme de grande taille entra. Dolores sentit une vague de frayeur l’envahir.
Ce visage... je l’ai déjà vu, songea-t-elle.
— Comment vous sentez-vous, Dolores ?
Elle ne savait pas. Son estomac se tordit, un nœud d’angoisse se formant dans ses entrailles.
L’homme sembla le remarquer.
— Si vous ne vous sentez pas bien, il faut me le dire.
Elle ouvrit la bouche. Hésita.
— Je ne sais pas, docteur.
Le docteur mesurait un mètre quatre-vingt-cinq, une carrure d’athlète. Rassurant, d’une certaine façon. Mais aussi intimidant. Ce genre d’homme qui sait plus de choses sur vous que vous-même.
— Vous avez écrit hier soir ?
Une pointe de remords lui serra le cœur. Non. Elle n’avait pas écrit. Elle n’avait respecté aucune des instructions.
— Un peu, mentit-elle.
Il voulait qu’elle écrive. Il voulait qu’elle plonge, qu’elle fouille dans les recoins sombres de sa mémoire. Parfois, elle avait envie de le supplier d’arrêter, de lui demander un peu de répit. Mais au fond… au fond, elle voulait qu’il la pousse encore plus loin.
— Qu’éprouvez-vous maintenant ?
Elle ne répondit pas.
— Toujours la même sensation ?
— Je vous l’ai dit. Je ne sais pas.
À moins d’admettre qu’elle se sentait coupable. À moins de passer pour une meurtrière.
— Il n’y a pas besoin de le vaincre, parce que ce n’est pas un ennemi, déclara le docteur.
— Je crois que je ne pourrai jamais m’en débarrasser.
— Il n’y a pas besoin de s’en débarrasser, parce que ce n’est pas une maladie.
Elle baissa la tête.
— Je pensais peut-être… naïvement…
— Quoi donc ?
Elle hésita. Les mots lui paraissaient vains.
— Je crois que…
Le silence pesa entre eux.
Elle ferma les yeux.
— Mon couple… notre couple… était assez fort pour pouvoir survivre à ça.
La voix de Dolores se brisa. Quelque chose en elle céda, et, pendant une fraction de seconde, elle se sentit presque tomber.
Le docteur l’observa en silence. Un élan de compassion l’envahit, une émotion qu’il n’aurait peut-être pas dû laisser transparaître.
— C’est de l’histoire ancienne, maintenant.
Dolores secoua la tête, un sourire sans joie flottant sur ses lèvres.
— Tout est ma faute.
— Vous ne pouvez pas dire ça, Dolores.
— Vous ne comprenez pas !
Son souffle s’accéléra. Ses ongles s’enfoncèrent dans le tissu de son peignoir.
— Je ne suis pas comme il faut !
Ces mots s’échappèrent d’elle comme un cri étranglé, et pendant une seconde, elle eut l’impression qu’ils avaient été prononcés par quelqu’un d’autre.
Le docteur s’approcha, pencha légèrement la tête.
— Croyez-moi. Avec tout ce qui vous est arrivé, vous êtes vraiment comme il faut.
Le silence s’étira. Il jeta un coup d’œil à sa montre.
— Il est déjà seize heures. On va vous apporter du thé et des biscuits. Ensuite, nous irons faire une promenade dans le parc.
Elle le fixa un instant, puis hocha lentement la tête. Le docteur pivota sur ses talons. Ses pas s’éloignèrent, et la porte se referma derrière lui.
2
Hartford, Connecticut, le 16 août 1977.
La venue d'Elvis Presley pour un concert prévu le 21 août au Civic Center, dans la « Capitale mondiale des compagnies d’assurances », avait suscité l'intérêt de la presse locale, à un moment où le King n’était plus que l’ombre de lui-même. Selon ceux qui l’avaient vu lors d’une tournée en juin, ses concerts ne duraient pas plus d’une heure, il oubliait les paroles de certaines chansons, et son poids avait considérablement augmenté. Heureusement, sa voix, toujours pleine de ferveur et d’émotion, était restée intacte.
La salle du World of Beer, un bar situé sur Isham Road près de l’I-84, n’était pas pleine, mais l’air y était imprégné de la fumée froide des cigares. Une douzaine de clients, le regard rivé sur le téléviseur, venaient d’apprendre que l’icône du rock and roll était décédée d’une crise cardiaque.
La mort d’Elvis plongea l’Amérique dans un profond désarroi. Jimmy Carter, alors président, prononça un hommage poignant : « La disparition d'Elvis Presley prive notre pays d'une part de lui-même. Il était unique et irremplaçable. Il est apparu sur scène il y a vingt ans avec un impact sans précédent qui ne sera probablement jamais égalé. Sa musique et sa personnalité, mélange de folklore blanc et de rythmes noirs, ont radicalement changé la culture populaire américaine. Son influence était immense, et pour le monde entier, il incarnait la vitalité, l’esprit de rébellion et la joie de vivre de notre pays. »
— C’est fichu pour le concert du 21, grogna un grand gaillard grisonnant en reniflant de dépit.
Ed Grady, le gérant, retira la cigarette de sa bouche, l’examina un instant, puis la remit entre ses lèvres avant de se tourner vers la serveuse.
— Il a trop bu, Betty. Prépare-lui une grande tasse de café. Il va en avoir besoin s’il veut rentrer chez lui.
— Tu plaisantes ? répondit-elle en le fixant. Ce type me fiche la trouille.
Le grand gaillard se pencha vers elle et lança :
— Tenez, mademoiselle, je vais vous en raconter une bonne.
Betty recula instinctivement, évitant son regard. Surpris, il fronça les sourcils avant de poursuivre :
— Une dame de la haute société répétait sans cesse à sa fille : pour réussir avec les hommes, il faut avoir de l’adresse. La fille a bien retenu la leçon. Elle est devenue call-girl et des adresses, elle en a plein son carnet de rendez-vous ! Plus de dix mille !
Il éclata de rire. Hormis deux clients en état d’ébriété, personne ne réagit.
John Ireland, quarante-deux ans, incarnait le stéréotype du citoyen désabusé, indifférent au monde qui l’entourait. Du haut de son mètre quatre-vingt-douze, tout dans son allure respirait l’antipathie : sa casquette étriquée, à laquelle il prêtait mille précautions, et sa chemise à carreaux rouge et noire, déboutonnée pour laisser entrevoir sa poitrine velue. Il boitait légèrement, préférant s’asseoir au comptoir pour éviter de plier sa jambe droite.
En lui servant un café, Betty ne put s’empêcher de froncer les sourcils. Ses yeux verts, semblables à des raisins sans peau, scrutaient chaque détail de son visage. Une angoisse visible l’agitait, une nervosité qu’elle ne pouvait dissimuler. À la façon dont elle reculait chaque fois qu’il se penchait vers elle, John comprit que quelqu’un avait dû la mettre en garde, probablement Mia, sa collègue qu'il avait taquinée la veille.
Il passa la tête au-dessus du comptoir pour lui offrir un large sourire. Betty, surprise, lâcha la Thermos pleine de café qui s'écrasa sur son pied. Elle poussa un cri et s’éloigna, la main tremblante.
— Je vais vous aider, dit-il en levant son bras marqué de cicatrices et de tatouages.
— Ce n’est pas la peine ! répondit-elle, effrayée, en cherchant des yeux Ed, occupé à trier des factures derrière le comptoir.
John, toujours souriant, lui montra sa paume en signe de bonne volonté, mais tout ce qu'elle voyait, c'était une main rugueuse et blanchâtre.
— N’approchez pas ! cria-t-elle.
Sa main se tendit brusquement, comme un trait. Betty ferma les yeux, s’attendant à recevoir un coup, mais quand elle les rouvrit, la Thermos était posée sur le comptoir.
— Je voulais seulement ramasser ce que vous aviez fait tomber, murmura John, penaud.
Betty soupira profondément et récupéra l’objet.
Le téléphone sonna. Elle décrocha.
— Ne quittez pas, je vous prie.
Elle fit signe à Ed. Ce dernier s’approcha avec lenteur, la démarche nonchalante.
— Ed à l’appareil… Oui… Très bien.
Il raccrocha, lançant un regard noir à John.
— Tu viens avec moi, dit-il à Betty. On va le raccompagner chez lui.
La serveuse soupira de nouveau, comprenant que c’était probablement la femme de John qui venait d’appeler.
Quel crétin, pensa-t-elle.
Dix minutes plus tard, Ed était au volant d'un pick-up Chevrolet, John à ses côtés. Ils roulaient doucement, suivis à une cinquantaine de mètres par Betty dans une Mercedes. Bien que la distance entre le bar et la maison ne fût que de trois kilomètres, le trajet sembla une éternité à John. Il se sentait mal, en manque d’alcool, même s’il était déjà bien ivre.
Encore un verre, juste un dernier, et tout ira mieux, pensa-t-il.
Mais un verre en appelle toujours un autre.
— On est encore loin ? demanda-t-il.
— Non, à peine deux kilomètres, répondit Ed, concentré sur la route.
John tourna légèrement la tête vers lui.
— Comment tu vas faire pour rentrer ?
Ed le fixa un instant, ses yeux gris sans éclat.
— Ne t'inquiète pas pour ça, répondit-il calmement avant d’allumer une cigarette. T’en veux une ?
John acquiesça.
Ils poursuivirent leur route en silence, Ed conservant toujours la même allure. Aucun autre véhicule ne se trouvait sur la route. John continuait à fumer, jetant parfois des coups d’œil à Ed, qui, de temps en temps, regardait Betty dans son rétroviseur.
— Tu es sûr de pouvoir rentrer ? insista John.
— Je te l’ai dit, ne t’inquiète pas, répondit Ed, son ton inchangé.
Au-dessus d’eux, un avion fendait le ciel noir. John jeta son mégot par la fenêtre et se tortilla un peu sur son siège. Il aperçut des phares derrière eux.
— On dirait qu’on est suivis, s’inquiéta-t-il.
Il se retourna pour suivre du regard la Mercedes qui les suivait de près, disparaissant momentanément dans un virage, avant de réapparaître.
— C’est sûrement un flic.
Autour d'eux, tout était silencieux ; même le bruit du moteur semblait assourdi. Ed ralentit légèrement, et Betty fit de même pour maintenir la distance.
Ils roulèrent encore une centaine de mètres avant de s’arrêter. Ed sortit du pick-up et aida John à marcher jusqu’à la porte de sa maison. Betty attendait dans la voiture, ses yeux verts fixés sur Ed.
— Alors ? demanda-t-elle.
Il hocha la tête avant de la rejoindre.
Elle poussa un soupir de soulagement, s’installa sur le siège passager et, alors qu’Ed restait figé près de la portière ouverte, elle lui lança :
— Ce type me fiche vraiment la trouille.
Ed ne répondit pas.
— Qu’est-ce qui t’arrive ? demanda-t-elle en remarquant sa pâleur. Pourquoi fais-tu cette tête ?
Il s’assit finalement à côté d'elle et répondit, après un long silence :
— Si tu l’avais connu vingt ans plus tôt…
— Allez, démarre, le coupa-t-elle, pressée de partir.
3
Dolores, la compagne de John depuis cinq ans, l’attendait comme à son habitude. À la lueur jaune de l’ampoule nocturne, elle scrutait le mur et le plafond, réfléchissant à ce que le destin réservait aux justes et aux maudits. D’un côté, ceux qui graviraient l’escalier doré menant aux portes du paradis, et de l’autre, ceux qui dévaleraient sans fin la route sinueuse de l’enfer : les bannis, les faussaires, les désillusionnés, tous ceux qui avaient choisi la facilité, sans le courage d’affronter la vie.
— Tu es encore saoul !
Dolores en voulait à tous ceux qui payaient un verre à John, ces vauriens qui encourageaient ses fanfaronnades. Elle ne se souvenait pas avoir autant souffert, même lorsqu’à douze ans, elle avait perdu sa mère.
— Bonsoir, ma mignonne ! marmonna-t-il.
Elle peinait à respirer, comme si l’air s’était raréfié dans la pièce. Mais l’angoisse était trop forte pour qu’elle s’inquiète de choses aussi triviales que l’air. Le tourment l’envahissait, tel un ouragan ravageant une église.
— Aide-moi à me déshabiller, tu veux ?
Dolores observait son compagnon dont l’ombre déformée, longue et spectrale, se balançait sur le mur du salon. Elle le regardait d’un œil perçant, à travers ses cils clairs et fins. Un regard qui disait : Je suis folle de l’aimer.
Elle ferma les yeux, espérant que cela suffirait à effacer sa présence. Quand elle les rouvrit, il était affalé sur le canapé du salon. Résignée, elle lui retira ses bottes, sa chemise, son pantalon. Elle acceptait cet état de fait parce qu’elle aimait la lueur dans ses yeux, celle qui la faisait se sentir belle et désirable.
— Oh non… murmura-t-elle, horrifiée.
John s’était tellement enivré qu’il s’était uriné dessus sans s’en rendre compte. Soudain, il se leva et s’approcha d’elle. Son regard était empli de peur et de terreur. Un instant, elle fut convaincue qu’il allait la tuer. Il y avait quelque chose d’inhumain dans sa démarche maladroite, les yeux écarquillés, les bras ballants, comme un géant épuisé.
— On ne peut plus vivre comme ça, John, dit-elle.
— Ouais, je sais… marmonna-t-il en s’accroupissant pour passer ses bras autour d’elle.
— J’ai envie de toi, ma mignonne, ajouta-t-il.
Dolores ne prononça pas les mots qui lui venaient à l’esprit : Je te déteste…
Le lendemain soir, John n’était toujours pas rentré. Eleonora, la fille de Dolores, était venue passer la nuit chez eux et avait préparé un poulet grillé au beurre d’ail avec des pommes de terre sautées. Un repas simple mais délicieux.
Eleonora ressemblait trait pour trait à sa mère, avec vingt ans de moins. Mais elle avait hérité du caractère de son père, qui répétait sans cesse que « le monde appartient aux forts et que les forts se renforcent en dévorant les faibles. »
Après le dîner, mère et fille allèrent se promener jusqu’à l’orée du bois au bout de la rue. Le vent du soir faisait bruisser les feuilles des arbres. Dolores posa doucement un baiser sur le front d’Eleonora, ressentant un profond sentiment de sécurité à ses côtés.
— Je me demande où il peut bien être, murmura Dolores.
— Moi, je le sais, répondit Eleonora sèchement.
— Je ne peux pas vraiment lui en vouloir, tu sais…
— Il te tient en son pouvoir, ce salaud.
Tout en marchant sous la chaleur oppressante de la nuit, Dolores songea à John. Depuis son échec à percer en tant qu’acteur, il s’était enfoncé dans des affaires louches, incapables de lui assurer une vie stable. Elle rêvait de pouvoir monter un petit commerce avec lui, mais depuis l’accident, leur situation n’avait fait qu’empirer. Peut-être qu’un jour, ils partiraient en Floride, mais ce jour n’était pas encore venu.
De retour à la maison, sans un mot, Dolores et Eleonora allèrent se coucher.
Allongée dans son lit, Dolores scrutait la grande pièce baignée de la lumière de la lune. Les murs vert d’eau, les rideaux vénitiens, le tableau au style vaguement abstrait, tout cela composait un cadre charmant, mais pour une vie ordinaire.
Eleonora, quant à elle, n’arrivait pas à dormir. Ses pensées tourbillonnaient autour de John et de l’étrange relation qu’il entretenait avec sa mère. Que faisait-elle encore avec cet homme ?
Sortie fumer une cigarette, elle aperçut les phares du pick-up de John. Ivre comme à son habitude, il titubait en descendant du véhicule.
— Bonsoir, ma mignonne, lança-t-il. Tu m’attendais ?
Eleonora le dévisagea froidement. John s’était toujours montré ambigu avec elle, jouant de regards appuyés et de gestes déplacés. Il la touchait furtivement, la fixant avec cet air lubrique qui la mettait hors d’elle. Mais elle n’en parlait jamais à sa mère, par peur de la blesser.
— Tu veux bien m’aider ? demanda-t-il en s’agrippant au pick-up.
À contrecœur, elle s’avança pour l’aider à entrer.
— Tu pues l’alcool, comme d’habitude !
— Ça va, aide-moi juste à enlever mes bottes, grogna-t-il.
Elle s’exécuta. Mais lorsqu’il lui demanda d’enlever aussi ses chaussettes, elle soupira d’agacement.
Soudain, John l’agrippa par le bras.
— Tu es belle à croquer, dit-il en la tirant vers lui pour l’embrasser de force.
Eleonora se dégagea brutalement. Mais John, obstiné, continua à la harceler, ses mains devenant de plus en plus intrusives. Elle le repoussa avec violence, son genou cognant son menton et son pied frappant ses parties génitales. John s’effondra en arrière, grimaçant de douleur.
Le souffle court, Eleonora le regarda. C’était le moment ou jamais.
4
Je veux dormir, se plaignit dans la tête de Dolores la petite voix d’enfant qui, visiblement effrayée et sous le choc, ne se souciait plus de la logique, ne supportait plus les « je l’attends » ou « je ne l’attends pas ».
Elle était presque endormie quand le vilain John pénétra dans la chambre, et maintenant, la seule chose qu’elle voulait, c’était dormir. Elle ferma les yeux dix minutes après s’être couchée. Elle rêva du passé et de Gary, l’homme qu’elle avait épousé vingt ans plus tôt…
Gary Lockwood, natif de Sarasota en Floride, était trop petit pour le football à l’université. Il s’imposa comme chef des supporters et pratiqua la gymnastique. C’était un élève exemplaire, bien noté par ses professeurs. À l’époque, les élèves n’osaient rien faire de ce qui était interdit. C’était un meneur, mais il obéissait et se pliait aux règlements, en vrai militaire qu’il était déjà. Il demeura fidèle à cette attitude toute sa vie.
En 1956, il valida brillamment son diplôme de l’US Naval Academy. Il fut affecté à la base navale de New London, à Groton, Connecticut, la principale base sousmarine de l'United States Navy et l'une des plus anciennes. Pendant trois ans, il dirigea les écoles et les centres de formation navale.
Le 31 décembre 1956, le soir de la Saint-Sylvestre, à l’occasion d’un bal, Gary tomba sous le charme d’une jeune femme de dix-neuf ans : Dolores Hart. Ce fut un coup de foudre réciproque.
À bien des égards, Dolores était le contraire de Gary. Elle était aussi blonde qu’il était brun et était la fille d’un petit fonctionnaire de la Navy. C’était une jeune femme agréable, avec une grande force de caractère. Ils se marièrent trois mois plus tard. De leur union naquit Eleonora, le 8 janvier 1958, prénom choisi en hommage à la mère de Dolores, décédée prématurément.
Le couple vivait à Groton, dans une maison dont le jardin donnait directement sur les rives du haut fleuve Connecticut. Quand Gary était présent, ils menaient une vie typique d’une famille américaine. Lorsqu’il était mobilisé à la base, Dolores et sa fille vivaient chez les parents de Gary, Charles et Caroline, qui tenaient une petite quincaillerie en ville. Malgré l’environnement rassurant et amical de leur demeure, ce fut une période d’austérité pour Dolores. Les parents de Gary étaient pratiquants et ne buvaient jamais d’alcool.
Mariée à ce soldat de dix ans son aîné, Dolores fut un jour blessée dans tout ce qu’elle avait de plus sacré en découvrant qu’il menait une double vie avec une femme avec qui il était encore marié. Sa vie s’était arrêtée, son cœur avait cessé de battre, son univers s’était effondré.





























