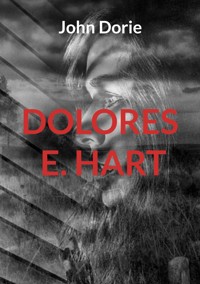Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
John Milner est-il une victime ou un bourreau? Marqué à jamais par la perte de son frère jumeau, hanté par des voix qui ne sont que des fragments de lui-même, John Milner vit avec un trouble dissociatif de l'identité. Derrière ses multiples facettes se cache un homme brisé, capable de transformations troublantes qui affectent autant son esprit que son corps. Pourtant, un détail ne change jamais : le foulard qu'il porte en permanence, dissimulant une vieille cicatrice. Mais sous ce nom se tapit une autre identité, bien plus sombre. Randy. Un pseudonyme murmuré avec effroi, un fantôme des bas-côtés, une légende urbaine qui s'avère bien réelle. Car John Milner est toujours vivant. Un thriller psychologique haletant où la frontière entre la folie et la vérité s'efface, entrainant le lecteur dans les méandres d'un esprit fracturé. Oserez-vous suivre la route jusqu'au bout?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sommaire
Avant -propos
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Chapitre 25
Épilogue
Avant -propos
« Derrière lui, le meurtre laisse un vomissement qu'un jour il faudra boire. » – Victor Hugo, L'Année terrible, Oh ! Qui que vous soyez (1871).
Au début des années 1950, Jack Kerouac, écrivain et vagabond, a arpenté les États-Unis d'est en ouest avec pour seuls bagages la liberté et l'envie de vivre chaque instant. En 2002, j’ai traversé ce pays d’est en ouest, à la recherche de rêves perdus et de bons moments aussi. J’ai suivi la route avec « la joie comme moteur, l'inconnu pour destination, l'instant pour apothéose et l'Amérique pour carburant », comme le disait Kerouac.
En compagnie de deux amis, nous avons roulé vers l'ouest sans idée particulière en tête. Bien sûr, je n’ai pas manqué de m’arrêter à Nashville, le temple de la musique country, et à Memphis pour visiter Graceland, la demeure d’Elvis Presley, devenue « musée ».
Au bout d’une semaine, nous avions dépensé les deux tiers de notre budget. Nous dormions dans des motels bon marché et parfois dans la voiture. Il nous arrivait de faire notre toilette dans des stations-service réservées aux chauffeurs routiers.
Tout défilait très vite, avec autant de faux départs que de retours précipités. Les haltes et les rencontres se faisaient nombreuses. On a même croisé des filles que l'on a séduites puis abandonnées. Comment oublier cette cohorte de musiciens, de poètes, de paumés, faciles d’accès ? La plupart prônaient la contreculture américaine.
Une fois la côte ouest atteinte, mes deux amis étaient fauchés. Je les ai aidés, mais ils sont partis. J’ai bourlingué en solitaire quelques jours puis j’ai décidé de rentrer en France…
Ce voyage demeure une expérience unique, cérébrale et mystique.
Les États-Unis détiennent le record mondial du nombre d’armes par habitant et expriment une propension à la violence sans égale dans le monde occidental. Il existe tant de fous en liberté, prêts à sacrifier leur vie pour accéder à l’immortalité. L’Amérique, elle aussi, possède sa propre variété de kamikazes.
Dans la culture nord-américaine et anglo-saxonne, le criminel est souvent perçu comme un monstre inhumain qui menace la société, tel un miroir fatal. Les tueurs en série américains s’inscrivent dans une normalité affirmée comme unique. Prenons l’exemple d’un tireur isolé : un homme devient fou et braque une foule. En général, avant d’être abattu, il a le temps de tuer une, dix ou cinquante personnes. La tendance anglo-saxonne est de pousser à la série, à l’excès, et de créer une productivité sociale du criminel en miroir de la productivité économique « normale » de la société.
On dit que la fiction incite à la violence. C’est plutôt le contraire qui s’observe lorsque l’auteur de fiction s’inspire du criminel et en déploie tout le potentiel d’activation culturelle. Moi-même, j’ai tendance à confirmer une symétrie entre le criminel et la société répressive : d’un côté, la violence individuelle ; de l’autre, la réponse sociale.
Mon penchant pour la mise en scène d’une violence excessive, par le biais d’un personnage capable de tuer à la dizaine, résulte de l’idée que chaque société possède sa propre forme de criminalité, aussi bien en nombre qu’en style, alimentant le commentaire effaré ou parfois l’apologie déguisée sous la répulsion.
Quand j’ai commencé à travailler sur Miroir d’asphalte, mon obsession était de revisiter le mythe de l’autostoppeur psychopathe. En explorant le thème de la folie meurtrière, je prenais le risque de tomber dans une hésitation permanente entre suggestion et démonstration directe, volontairement choquante et donc un peu vaine. Les différentes personnalités de mon héros vont contredire ses pulsions monstrueuses. Il est à la fois innocent et totalement coupable.
Quoi qu’il en soit, je voulais faire de ce livre une histoire déroutante, à la manière d’un auteur ou d’un cinéaste du genre.
1
Fort Worth, Texas, le 20 février 1996.
Dans la pièce obscure flottait une senteur envoûtante, un parfum capiteux aux nuances de vanille, à la fois sensuel et troublant. L’air semblait dense, presque tangible, chargé de mystères.
— J’ai encore fait le même rêve, docteur. Je dresse une table dans la salle à manger. Je l’embellis d’une jolie nappe immaculée et de serviettes élégamment pliées, murmura la patiente, ses doigts crispés sur l’accoudoir du fauteuil.
Le docteur Graves la scruta, d’un regard indéchiffrable derrière ses lunettes. Une hésitation, à peine perceptible, traversa son visage.
— Au fait, avez-vous appelé mon frère ? demanda-t-elle brusquement, comme si elle cherchait à fuir son propre récit.
Le docteur haussa légèrement un sourcil, mais ne se laissa pas distraire.
— Si vous le permettez, revenons à votre rêve, Anita. Parlez-moi davantage de cette table.
Le pouls de la jeune femme s’accéléra. Une douleur lancinante martelait l’arrière de son crâne, pulsant au rythme de ses battements de cœur. Elle détourna le regard, cherchant refuge dans la fenêtre. Au-dehors, les nuages, lourds et menaçants, présageaient un orage d’une rare violence.
— Il n’y a rien d’autre à dire, docteur, lâcha-t-elle d’une voix tremblante. Et puis… vous allez sûrement m’annoncer qu’on n’a plus le temps.
— Il nous reste quelques minutes. Vous étiez simplement en retard.
Elle fronça légèrement les sourcils, le fixant comme pour sonder ses pensées.
— C’est vrai. Ça m’arrive souvent, ces derniers temps.
Ses doigts effleurèrent machinalement le collier de perles autour de son cou, un geste révélateur de son anxiété.
Le docteur lui prit délicatement le poignet, évaluant son pouls avec une précision clinique.
— Y a-t-il une raison particulière à ces retards répétés ?
La jeune femme sembla chercher une réponse dans le labyrinthe de ses souvenirs. Elle finit par secouer la tête, mais la douleur à son crâne l’arracha à sa réflexion.
— Chaque fois que je quitte la maison, j’ai un pressentiment… étrange. Comme si j’avais oublié quelque chose. Éteindre la lumière, fermer le robinet… Une fois que j’ai vérifié, je reviens encore, pour la cafetière cette fois. Ce matin, je crois bien l’avoir fait deux fois. Je suis arrivée en retard au travail.
Le docteur hocha la tête avec compréhension.
— Et qu’en a dit votre patron ?
Elle marqua une pause, puis lui adressa un sourire énigmatique.
— Rien. Absolument rien. J’ai l’impression qu’il m’épargne. Peut-être… qu’il est amoureux de moi.
Graves demeura stoïque, se contentant de prendre des notes d’une main précise.
— Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous tentée ?
Elle détourna la tête, un sourire mutin jouant sur ses lèvres.
— Par vous ? Non… enfin… par lui, je veux dire. Je ne sais pas trop.
Le docteur esquissa un léger sourire avant de reprendre.
— Peut-être cherchez-vous à attirer son attention… ou à le contrarier.
La jeune femme éclata d’un petit rire nerveux avant de revenir soudainement à son sérieux.
— Mason… pardon, docteur Graves… vous devez vraiment appeler mon frère. Il sait des choses. Des choses sur mes parents qui pourraient vous éclairer.
Intrigué, le docteur releva les yeux de son carnet, redoublant d’intérêt.
— Nous pourrions explorer ce sujet lors d’une prochaine séance, Anita.
Elle le fixa longuement, son regard chargé d’une intensité presque inconfortable. Un frisson parcourut son échine, et elle se redressa brusquement, submergée par une vague de panique. Le docteur posa une main rassurante sur son épaule, l’immobilisant en douceur.
— Je me demande souvent ce que mon père a ressenti, avoua-t-elle, sa voix marquée par une tristesse profonde. Pendant ses dernières heures… Est-ce qu’il savait ? Est-ce qu’il a vu venir la tragédie ? Ou bien… est-ce que ce sont des choses qui arrivent sans prévenir ?
Ses yeux se perdirent dans le vide.
— Je ne pourrai jamais oublier mon père, reprit-elle. Mon moment préféré avec lui, c’est ce gros câlin qu’il me donnait après l’école. Ces bras forts, protecteurs… J’avais l’impression que rien ne pouvait m’arriver.
Le docteur hocha la tête, l’encourageant à poursuivre. Il nota le tremblement imperceptible de ses doigts sur l’accoudoir du fauteuil. Un geste infime, mais révélateur.
Anita inspira profondément. L’air semblait plus lourd d’un coup, chargé d’une moiteur invisible.
— Quand mes parents sortaient le vendredi soir, je verrouillais la porte à double tour. Deux fois. J’entendais le clic du pêne et je testais la poignée, juste pour être sûre. Nous vivions à Las Vegas Trail, dans un quartier où les sirènes de police étaient aussi régulières que le chant des grillons dans une banlieue tranquille. Des ombres traînaient entre les réverbères cassés, des voix murmuraient derrière les buissons. Je savais que je devais veiller. Je me sentais responsable de tout, même de Roberto…
Sa voix s’effilocha, comme un fil trop tiré. D’une main tremblante, elle effleura son cou, et un frisson la parcourut, fugace mais violent.
— Roberto… Il rentrait tard, reprit-elle après un silence. Toujours épuisé par le travail. On se parlait peu. Il avait cette façon de passer devant moi, comme un fantôme en costume bleu marine. L’odeur de son après-rasage flottait un instant, et puis il n’y avait plus que le vide. Mais je l’aimais. Je l’ai toujours aimé.
Elle baissa les yeux. Ses paupières battirent une ou deux fois, hésitantes, avant qu’une ombre ne vienne ternir son regard. Une lueur étrange, indéfinissable, comme une bougie qui s’éteint d’un coup sous un souffle invisible.
— Vous savez, docteur, j’aimerais pouvoir dire que dans ses derniers instants, mon père a senti le danger. Qu’il a eu cette montée d’adrénaline, ce sixième sens des flics qui leur fait flairer une embuscade. Qu’il s’est battu. Après tout, c’était un vrai flic, un de ceux qui ne lâchent rien. Mais dans mes rêves… il apparaît, si beau, si jeune…
Sa voix se fit plus faible.
— Et puis il y a cette tache de sang sur sa poitrine. Pas énorme, pas spectaculaire, juste un rond sombre qui s’étale lentement sur sa chemise blanche, comme un œillet qu’on aurait trempé dans l’encre.
Elle marqua une pause. Le silence, oppressant, palpitait entre eux.
— Je veux crier, docteur. Mais je ne peux pas. Mes lèvres sont scellées, mes cordes vocales engluées dans quelque chose de froid et poisseux. Tout ce que je peux faire, c’est…
Ses yeux, embués de larmes, se fixèrent sur un point invisible, au-delà du bureau du médecin, au-delà même des murs du cabinet. Un ailleurs que lui seul ne pouvait pas voir.
— Fermer les yeux.
Sa voix n’était plus qu’un murmure.
— Ce n’est qu’un rêve. Juste un mauvais rêve.
Elle s’arrêta de parler.
Le docteur nota la manière dont ses épaules s’étaient affaissées, comme si un poids invisible s’était abattu sur elles. Une lassitude ancrée dans les os, dans la chair. Mais ce qui le troubla le plus, ce fut l’ombre d’un sourire qui effleura un instant les lèvres d’Anita. Une esquisse fugace, presque irréelle, comme si elle goûtait à un secret dont lui seul ignorait l’existence.
Puis, elle releva les yeux, et son regard se fixa sur lui avec une intensité soudaine, une étincelle qu’il n’avait pas encore vue chez elle.
— Parlez à mon frère, docteur, dit-elle.
Une phrase simple, anodine en apparence. Mais il y avait dans sa voix quelque chose de tranchant, une inflexion qu’il ne parvint pas à définir tout de suite.
— À côté de lui, je me sens comme une chenille misérable.
Le docteur esquissa un sourire compatissant.
— Les chenilles deviennent des papillons, Anita.
Elle haussa les épaules, un sourire triste flottant sur ses lèvres. Mais ce n’était pas un sourire de résignation, ni même de mélancolie. Il y avait quelque chose d’autre, un courant plus sombre sous la surface, comme une rivière souterraine qui charrie des choses qu’on préférerait ne jamais voir remonter à la surface.
— Peut-être… murmura-t-elle.
Elle se redressa légèrement, et ses doigts glissèrent sur l’accoudoir du fauteuil, caressant distraitement le cuir usé.
Puis, elle tourna lentement la tête vers le docteur.
— Mais c’est Roberto, le papillon.
Le docteur sentit un frisson lui courir le long de la nuque, et il n’aurait su dire pourquoi. Peut-être à cause de la façon dont Anita avait prononcé le nom de son frère. Comme si elle récitait un psaume, ou un verset tiré d’un livre ancien.
2
Arlington, Texas, un an plus tard.
Le matin du 2 janvier 1997, dans la lumière blafarde d’un restaurant à la périphérie de la ville, deux routiers buvaient leur café noir, les épaules affaissées sous le poids des kilomètres à venir. Roberto Moreno et Harry Miles, compagnons de route et d’usure, observaient le jour naissant à travers la vitre ternie par le givre.
— Je vais encore me taper quatre mille bornes cette semaine, grogna Harry en frottant son front ridé.
— Moi, ça va être plus tranquille, répondit Roberto en haussant les épaules.
Harry renifla, un éclat de rancœur dans ses yeux verts perçants.
— J’en ai marre de ce boulot, lâcha-t-il, tout en réajustant maladroitement sa moumoute qui lui donnait un air vaguement comique.
Harry était tout en angles et en nerfs, un homme émacié dont les avant-bras velus semblaient disproportionnés par rapport à son torse maigre. Sa chemise marron, son jean rapiécé et ses bottes usées complétaient son allure d’ouvrier qui n’avait jamais connu le confort. Roberto, de son côté, présentait une figure plus avenante. Proche de la trentaine, il avait une carrure solide et un visage aux traits harmonieux, accentués par sa peau mate et ses cheveux bruns.
Un flash d’information à la télévision suspendue dans un coin du restaurant interrompit leur conversation. Une journaliste annonçait la mort de Townes Van Zandt, un chanteur originaire de Fort Worth.
— C’est triste de mourir un 1er janvier, dit Maria Vargas, la serveuse, en essuyant ses mains sur son tablier avant de disparaître dans la cuisine.
— Ce gars-là, c’était le fils d’une grande famille texane, révéla Roberto.
Harry releva la tête, surpris.
— Sérieusement ? Il avait plutôt l’air d’un hippie complètement alcoolo.
Maria, qui faisait mine de ne pas écouter, hocha la tête sans se retourner.
— Peut-être, admit Roberto. Mais son arrière-arrière-grand-père était comte, si je ne m’abuse.
Il y eut un silence. Puis Roberto ajouta, presque distraitement :
— Ça fait un bail qu’on n’a pas vu Mason.
Harry se raidit. Ses doigts se crispèrent sur sa tasse.
— Tu veux dire ce soi-disant docteur qui se prend pour un détective ?
Roberto le fixa, retenant sa respiration.
— C’est le petit ami de ma sœur, Harry. Et je lui dois beaucoup pour ce qu’il a fait pour elle.
Harry ricana, un sourire mauvais étirant ses lèvres.
— Ce qu’il a fait ? Tu veux dire qu’il a fini par se la taper.
Le silence qui suivit fut chargé de tension, et Roberto détourna les yeux. L’horloge à quartz fixée au mur marqua six heures trente-cinq. Les deux hommes en étaient à leur troisième café.
— J’ai commencé par faire de la ville, lança soudain Harry, brisant le silence.
— On la connaît par cœur, ton histoire ! répliqua Maria en passant près de leur table.
Harry rougit légèrement, mais continua, comme pour affirmer son importance.
— Cent cinquante kilomètres autour de Dallas, payé à l’heure pendant trois mois pour m’habituer aux gabarits des camions. Après ça, des trajets courts dans le Texas, l’Arizona et le Nouveau-Mexique. Je transportais des matériaux pour la construction.
Roberto l’interrompit, le secouant légèrement par le bras.
— Regarde ! Le tueur a encore frappé, cette fois du côté de Lubbock.
Harry fronça les sourcils.
— Lubbock ? Je dois y livrer un chargement.
— C’est là que je me rends moi aussi, fit une voix derrière eux.
Mason Graves venait de s’installer à leur table. Son élégance tranchait avec l’environnement fruste du restaurant. Vêtu d’un manteau impeccablement coupé, ses cheveux longs lui donnaient un air singulier. Il semblait hors de place dans ce décor.
— Justement, on parlait de toi, lança Roberto avec un sourire.
— En bien, j’espère.
Harry le fixait avec insistance, ses yeux verts transperçant presque le docteur.
— Je pars avec toi, Harry, dit Graves.
Maria leur servit du café et proclama :
— Le monstre de la route s’est invité chez nous, les gars !
Les mots flottèrent dans l’air comme un mauvais présage. Harry se tourna vers Graves, soudain nerveux.
— Que vas-tu faire à Lubbock ?
Graves se leva puis dit :
— On y va ?
— Donne-moi deux minutes pour finir mon café.
Durant le trajet, le silence s’installa dans la cabine du camion. L’intérieur exhalait des odeurs d’huile, de cuir et de fatigue. Harry, les mains crispées sur le volant, peinait à rester concentré. Après une demi-heure de route, il brisa le silence.
— Hier et avant-hier, j’ai très peu dormi.
— Ah ? fit Graves d’un ton laconique.
Harry toussa, cherchant ses mots.
— Mon médecin dit que je souffre d’insomnie.
— Et pourquoi ?
Harry poussa un soupir, son ton empreint de désespoir.
— Je crois que je couve une dépression.
Ces mots, chargés d’une douleur sourde, firent frissonner Graves. Il l’observa un moment avant de répondre :
— La fatigue peut être un symptôme ou une cause. Mais il est essentiel de creuser davantage pour comprendre.
Harry tourna brusquement la tête vers Graves, les mâchoires serrées. Son regard, méfiant et agacé, semblait chercher une faille chez son passager.
— J’comprends rien à ton charabia !
Graves le fixa calmement, sans ciller, son visage impassible comme sculpté dans la pierre.
— En termes simples, même si tu te reposes, la fatigue peut persister. Ce n’est pas seulement physique. C’est plus profond.
Harry serra le volant, ses jointures blanchissant sous la pression, avant de desserrer les mains, comme s’il voulait évacuer une tension intérieure.
— Ton problème, c’est que t’en as ras-le-bol de ce boulot, conclut Graves.
Harry secoua la tête, un rictus crispé étirant ses lèvres. Il semblait lutter contre une vérité qu’il n’était pas prêt à accepter.
Cherchant à détourner la conversation, Graves poursuivit d’un ton presque détaché :
— Depuis que j’ai commencé à exercer comme psychiatre, je m’intéresse au comportement criminel.
Harry plissa les yeux, intrigué malgré lui. Il ôta sa casquette et lissa d’une main nerveuse sa perruque clairsemée, un geste révélateur de son malaise.
— Qu’est-ce que tu veux dire ? lâcha-t-il enfin.
Graves esquissa un sourire énigmatique, le genre qui ne rassurait jamais complètement.
— J’essaie d’en devenir un.
Harry sursauta, son corps tout entier tendu comme un ressort. Il s’affaissa légèrement en avant, comme si le poids de cette révélation venait de l’écraser.
— Quoi ? Un criminel ?
Graves, bien qu’amusé intérieurement par cette réaction, resta de marbre. Il était conscient que, dans l’habitacle exigu, chaque mot devait être pesé. Harry était au volant, et le moindre faux pas risquait de les envoyer dans le décor.
— Du calme, Harry, répondit-il en levant une main apaisante. Laisse-moi t’expliquer.
Le routier fronça de nouveau les sourcils, une ride profonde creusant son front. Il semblait suspendu aux lèvres de Graves, à la fois fasciné et horrifié.
— La police croit qu’on empêche un crime en attrapant le tueur et en le mettant derrière les barreaux. Mais ça ne résout rien.
Harry secoua la tête, comme pour chasser une mouche invisible.
— Se mettre dans la peau d’un criminel, reprit Graves, c’est comprendre comment les pressions du quotidien, cette tension nerveuse, peuvent altérer l’esprit et le corps jusqu’à faire basculer quelqu’un dans l’irréparable.
Harry fit une grimace, ses lèvres se tordant dans une expression de confusion mêlée de dégoût.
— Désolé, mais là, je n’pige pas plus qu’avant !
Graves ne répondit pas tout de suite. Il observa le paysage défilant à travers le pare-brise, comme s’il réfléchissait à la meilleure manière de poursuivre.
— Tiens, arrête-toi là, ordonna-t-il soudain, rompant le silence.
— Quoi ?
— Arrête-toi là, répéta Graves d’un ton impérieux.
La lueur dans les yeux de Harry s’éteignit, remplacée par un mélange de frustration et de résignation.
— Mais il nous reste encore cent kilomètres avant d’arriver à Lubbock !
Graves ouvrit déjà la portière, le froid mordant s’engouffrant dans la cabine.
— Ne t’inquiète pas. Je prendrai le bus.
Sans attendre de réponse, il sauta à terre, refermant la porte derrière lui. Harry, décontenancé, le suivit du regard, ses doigts tambourinant nerveusement sur le volant. Il laissa échapper un soupir agacé, ses épaules s’affaissant sous le poids de son irritation.
Il démarra brusquement, le camion grondant comme une bête réveillée. Dans le rétroviseur, la silhouette de Graves s’éloignait, s’effaçant peu à peu dans la grisaille du matin.
Harry secoua la tête, une expression amère sur le visage.
— Il est fou, murmura-t-il avant de s’enfoncer à nouveau dans ses pensées sombres.
Dehors, la route s’étirait, droite et silencieuse. Mais quelque part, Harry savait que la tension ne l’abandonnerait pas si facilement. Le monstre de la route, qu’il soit réel ou métaphorique, semblait maintenant peser un peu plus lourd sur son esprit fatigué.
3
La lune était vive, un disque d'argent suspendu dans un ciel d’encre. Autour de la colline, le brouillard, épais et onctueux, serpentait depuis le marécage voisin, enveloppant Sweetwater comme une main invisible. Cette bourgade texane, absente de toute carte, semblait condamnée à l'oubli, un endroit où même le vent chuchotait des secrets qu’il valait mieux ne pas entendre.
Graves, en quête de réponses ou peut-être de troubles, avait exploré chaque bar, tripot et bordel avant de tomber sur la Vera Cruz, un night-club lugubre en bordure de la ville. Dès qu’il franchit la porte, une odeur âcre d’alcool et de tabac lui emplit les narines, l’irritant jusqu’à l’estomac.
Son regard fut immédiatement attiré par un homme portant un joli foulard au cou. Un colosse en chemise grise, les épaules carrées et le visage sombre, surveillait une table où deux femmes sirotaient des cocktails, leurs rires s'effaçant dans le brouhaha ambiant. L'une d'elles mordit dans son cheeseburger, du ketchup maculant ses lèvres rose bonbon. Graves perçut quelque chose chez cet homme – une aura de menace ou peut-être un fardeau invisible – qui le poussa à rester sur ses gardes.
— Hé, toi ! D’où est-ce que tu sors ? lança un vieux gars derrière le comptoir.
Graves se tourna vers lui. Un silence inconfortable s’installa.
— Je me présente, Mason Graves, dit-il enfin en inclinant légèrement la tête.
— J’ai posé une question, pas une devinette.
Graves sentit ses joues blanchir sous la pression. Sa voix trembla légèrement lorsqu’il répondit :
— Je suis venu en stop.
Le colosse vêtu d’un foulard plissa les yeux, l’évaluant comme un fauve jauge sa proie. Finalement, il le désigna d’un signe de tête et le força à s’asseoir à une table.
— Écoute bien, le futé, prévint-il. Les autostoppeurs, on ne les aime pas trop dans le coin.
Un frisson de peur traversa Graves. L’homme se pencha soudain vers lui, ses yeux étincelant d’une lumière inquiétante.
— Moi, c’est John.
— Enchanté, John, répondit Graves, feignant un calme qu’il ne ressentait pas.
Une serveuse, charmée par les traits délicats de Graves, apporta une carte. Elle releva ses cheveux bruns pour former une queue-de-cheval avant de les relâcher avec un sourire discret.
— Pas besoin, fit John. Deux bières.
La serveuse revint rapidement avec les bières. John jeta un billet de cinq dollars sur la table.
— Gardez la monnaie.
— C’était pour moi, insista Graves en fouillant dans sa poche.
— Laisse tomber, le futé.
La serveuse esquissa un sourire hésitant, mais à l'ordre de John de les laisser seuls, elle pâlit et s’éclipsa rapidement.
John fixa Graves, son regard perçant cherchant à pénétrer ses pensées.
— Alors, le futé, que fais-tu dans la vie ?
— Je suis médecin.
John haussa un sourcil, puis se redressa brusquement.
— Bois ta bière, toubib. On file d’ici. Ce trou est encore plus miteux que moi.
— Où allons-nous ?
— Une petite virée nocturne. C’est tout ce que t’as besoin de savoir.
John sortit du club, laissant Graves seul à ses réflexions. À l’extérieur, le vent soufflait en rafales, hurlant dans l’obscurité. John s’avança vers une Chevrolet Malibu beige garée à l’arrière. Après un instant à jouer avec une tige de métal, il déverrouilla la voiture et grimpa à l’intérieur, bientôt rejoint par Graves.
La route s’étirait devant eux, déserte et glaciale, bordée d’ombres mouvantes. John roulait à vive allure, ses pensées apparemment ailleurs.
— Tu me rappelles Randy, dit-il soudain en desserrant son foulard.
— Randy ? fit Graves, intrigué.
— Mon frère jumeau.
Graves tourna la tête vers lui, cherchant une vérité derrière cette déclaration.
— Il est mort… Dans un accident de train.
— Je suis désolé.
John ricana amèrement.
— T’as pas à l’être. C’est ce putain de conducteur qui aurait dû l’être. Même s’il a été condamné à vingt ans de taule, ça n’a rien changé.
Un silence pesant tomba sur l’habitacle. Graves observait le paysage défiler, mais son esprit était happé par l’étrangeté de cet homme.
— Comment est-ce arrivé ? osa-t-il demander.
John ne répondit pas, ses mains crispées sur le volant. Puis, brisant le silence, il murmura d’une voix rauque :